[Brèves] Désolidarisation du paiement des loyers en cas de violences conjugales : pas de rétroactivité de la loi
Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2023, n° 22-13.036, F-D N° Lexbase : A75529QR
Lecture: 2 min
N5354BZC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 16 Juin 2023
► La loi ne disposant que pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, l'article 8-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, qui prévoit la possibilité pour un locataire victime de violences conjugales de se désolidariser du paiement des loyers, n'est pas applicable à un bail résilié avant son entrée en vigueur.
Pour rappel, la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018 N° Lexbase : L8700LM8 a créé l'article 8-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH, qui prévoit que, sous réserve d’informer le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, et en y joignant la copie notifiée d’une ordonnance de protection d’un juge aux affaires familiales ou la copie d’une condamnation pénale pour des faits de violence sur sa personne ou sur un enfant résidant habituellement avec lui et datant de moins de six mois, le conjoint (ou le partenaire de PACS, ou le concubin) ayant quitté le logement et la personne qui s’en est portée caution ne sont plus solidaires du paiement des dettes futures à compter de la première présentation du courrier au domicile du bailleur.
En l’espèce, la locataire exposait avoir quitté le logement en raison de violences exercées au sein du couple par son concubin, en avait informé la bailleresse, le 9 octobre 2017, afin de ne plus être tenue solidairement avec celui-ci au paiement des loyers.
Elle faisait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'arriéré locatif ; elle entendait alors se prévaloir des dispositions de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
En vain. La Cour suprême relève que la loi ne disposant que pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, l'article 8-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, n'est pas applicable à un bail résilié avant son entrée en vigueur. Or en l’espèce, le tribunal avait constaté que la bailleresse avait été informée le 9 octobre 2017 par la locataire qu'elle avait quitté le logement en raison de violences exercées par son concubin et que les clés du logement avaient été restituées le 26 février 2018.
Il en résulte que, le bail étant résilié à cette date, le texte précité n'était pas applicable, en sorte que la solidarité n'a pas pu être privée d'effet.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485354
[Brèves] Ne pas confondre loyer et indemnité d’occupation…
Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2023, n° 19-24.586, F-D N° Lexbase : A62789NT
Lecture: 2 min
N5243BZ9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 16 Juin 2023
► En condamnant les locataires à payer aux bailleurs une certaine somme incluant les loyers et charges impayés jusqu'à une certaine date alors que l'obligation des preneurs de payer le loyer et les charges avait pris fin deux ans auparavant, date d'effet du congé délivré par les bailleurs et validé par les juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré Ies conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 7, a), et 15, I, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989.
L’erreur est terminologique, mais elle est lourde de conséquences puisque l’arrêt est censuré et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel autrement composée.
Faits et procédure. En l’espèce, les bailleurs d’une maison à usage d’habitation avaient délivré aux locataires deux commandements de payer visant la clause résolutoire prévue au bail (conclu le 3 mars 2008), puis leur avaient signifié un congé pour le 2 mars 2017.
Les locataires avaient assigné les bailleurs en annulation des commandements de payer et du congé, indemnisation du préjudice de jouissance résultant de la mauvaise exécution par les bailleurs de leur obligation d'entretien et compensation entre les créances respectives des parties.
Décision CA. Pour condamner les locataires au paiement d'une certaine somme au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu qu'il résultait du décompte produit par les bailleurs qu'ils n'avaient pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2019, n° 17/03159 N° Lexbase : A0827ZPC).
Cassation. Sauf que, dans son arrêt, la cour d’appel avait également validé le congé délivré par les bailleurs le 2 mars 2017.
Ce faisant, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 7, a), et 15, I, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH, dont la Haute juridiction ne manque pas de rappeler la teneur : « Selon le premier de ces textes, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte du second que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré, à l'expiration du délai de préavis applicable ».
Si donc les locataires se sont maintenus dans les lieux après que le congé ait été délivré, ils pouvaient être redevables de sommes à titre d’indemnité d’occupation, mais en aucun cas de loyers.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485243
[Point de vue...] La « fauxtographie » et le constat
Lecture: 15 min
N6035BZK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sylvian Dorol, Commissaire de justice associé, Directeur scientifique de la revue Lexbase Contentieux et Recouvrement, Expert près l’UIHJ
Le 28 Juillet 2023
Mots-clés : commissaire de justice • preuve • photographie • fauxtographie
À l’ère de l’intelligence artificielle, ChatGPT et Dall-E, survient le spectre du « grand remplacement » des intellectuels. Sans verser dans ce débat, les lignes qui suivent interrogent le juriste sur son rapport à la preuve par l’image, et sa connaissance de la « fauxtographie », c’est-à-dire la photographie frauduleuse en ce qu’elle ne représente pas exactement la réalité. Plus largement, la photographie intelligente doit-elle convaincre de tout, bénéficiant d’une force probante inégalable ? La réponse est négative comme les développements suivants l’expliquent, démontrant que le garant contre la « fauxtographie » juridique est le commissaire de justice.

Le pape en doudoune ? « Je n’en crois pas mes yeux! ».
L’exclamation signifiait auparavant un ahurissement devant la réalité, mais tend à devenir aujourd’hui l’expression d’un véritable doute de la réalité, lit du complotisme.
Cependant, au sens premier du terme, l’expression signifie bien que les yeux sont censés donner une réalité devant s’imposer à la raison, ce qui explique en un sens la place de l’image aujourd’hui, laquelle tend même à remplacer l’écriture par une simple émoticône.
Hélas, l’époque où la photographie représentait la vérité de la réalité est révolue, puisque l’image peut aujourd’hui être altérée, par le photographe ou à l’insu de celui-ci.
D’abord, l’image peut être manipulée par le photographe, lorsqu’il maîtrise les logiciels de retouche (manipulation a posteriori) et les techniques de prise de vue (manipulation a priori).
Ensuite, l’image peut être manipulée à l’insu du photographe, lorsque l’appareil qu’il utilise est pourvu d’un logiciel dont la destinée est d’optimiser l’image capturée par l’obturateur du smartphone par exemple. C’est ainsi qu’il est possible de voir fleurir sur les façades des monuments des publicités glorifiant des smartphones et leurs photographies nocturnes ou en mode macro, montrant le plus infime et intime détail en pixels. Tout utilisateur de smartphone en a d’ailleurs fait l’expérience : qui n’a pas été impressionné par sa photographie basse luminosité montrant des éléments qu’il ne peut même pas voir lui-même ? Qui n’a pas été déçu après avoir visité un studio tout petit, loin de l’image grand angle qui illustrait l’annonce immobilière ?
C’est donc un fait : la photographie par smartphone a pour objectif d’offrir de belles images, améliorées et optimisées à l’insu du consommateur lambda, et non la réalité. Le canon est esthétique, quitte à déformer la réalité. Qu’importe la réalité, pourvu que sa représentation séduise le regard et flirte avec l’art ! L’image est donc aujourd’hui libérée de la réalité, et peut tromper la confiance traditionnellement placée en elle.
Le concept de « fauxtographie » n’est pas récent, et son histoire est presque aussi ancienne que les photographes de presse. Intimement lié à l’éthique de ces professionnels, Le Monde y avait notamment consacré un article fort intéressant [1], soulignant que la tentation du trucage a toujours existé, mais est aujourd’hui accessible très facilement grâce à la technologie, voire utilisé à l’insu du photographe comme il a été précédemment exposé.
Bien que le commissaire de justice constatant réalise mensuellement des milliers de photographies, il est plus un artiste de la preuve que de l’image, et son souci est davantage de représenter ses constatations que de faire de son procès-verbal une œuvre d’art ou un article de la presse… Ainsi, son acte est traditionnellement qualifié d’œil du juge.
Au-delà de s’interroger sur la défiance que peut inspirer la photographie, la question qui se pose réellement est de savoir si cette méfiance peut entamer la confiance du juge dans le constat de commissaire de justice.
Parce que le procès-verbal de constat de commissaire de justice doit être le réceptacle juridique d’une vérité factuelle, et que l’image désormais si accessible y acquiert une place croissante au point qu’elle peut devenir elle-même constatation [2], il apparaît légitime de s’interroger sur l’utilisation raisonnée et conditionnée de l’utilisation de la photographie par le constatant.
Pour répondre à cette interrogation, il convient d’analyser les causes de la « fauxtographie » (I) et en comprendre les conséquences (II).
I. Les causes de la « fauxtographie »
Si la « fauxtogaphie » peut être rencontrée dans un constat de commissaire de justice, cela s’explique davantage par une cause technologique (B) que morale (A).
A. L’exclusion de la cause morale
Il est dérangeant d’imaginer que la « fauxtographie » puisse apparaître dans le constat du commissaire de justice, car cela revient à penser à une remise en cause de la neutralité de cet officier public et ministériel. Le raccourci est cependant à exclure puisque la « fauxtographie » peut être traditionnellement réalisée de trois manières, que la probité du commissaire de justice exclut sous peine de sévères sanctions.
La première méthode de « fauxtographie » est la retouche d'image. Les logiciels de retouche permettent d'altérer les couleurs, les formes, la texture, etc., créant ainsi des images qui ne reflètent pas fidèlement la réalité.
La deuxième méthode de « fauxtographie » est le montage photographique qui permet, en fusionnant plusieurs images ou en superposant des éléments, de créer des scènes totalement fictives, trompant ainsi le spectateur. Au montage photographique, il est possible d’associer aujourd’hui les générateurs d’images par intelligence artificielle tels que Midjourney, Dall-E, Bing Image Creator, NightCafe ou Text to image, qui permettent de créer de fausses photographies, promettant de « matérialiser » les pensées de l’utilisateur.
La troisième et dernière méthode de « fauxtographie » est l’altération contextuelle. En changeant le contexte d'une photographie, il est possible de lui donner une signification différente ou manipuler l'opinion du spectateur. Les techniques de prise de vue s’assimilent à cette altération textuelle, plaçant la photographie sous un angle de vue ignoré par le spectateur, dont l’imagination peut s’enflammer ou être orientée.
Il faut se féliciter que la stricte déontologie du commissaire de justice lui interdit de recourir à ces trois méthodes de « fauxtographie » sans le mentionner expressément. Son procès-verbal contextualise la photographie, explique l’angle de prise de vue et précise la correspondance entre l’image par lui réalisée (et qu’il certifie souvent par l’apposition de son sceau) et ses constatations.
Pour autant, les trois méthodes de « fauxtographie » précédemment évoquées évoquent la création ou la manipulation a posteriori d’images par l’auteur, et n’envisagent pas la cause technologique, à l’insu du photographe.
B. L’admission de la cause technologique
La réalité d’une scène peut être altérée à l’insu du photographe lorsqu’il utilise son smartphone. Si le commissaire de justice n’est pas vigilant, cela peut expliquer qu’une « fauxtographie » puisse se trouver dans son procès-verbal, contredisant parfois ses constatations écrites. Il en sera ainsi s’il précise qu’une pièce n’est pas éclairée lors de ses constatations, mais que la photographie du smartphone a été réalisée en mode nuit !
Pour comprendre que la « fauxtographie » puisse naître à l’insu de l’utilisateur d’un smartphone, il convient de comprendre le mécanisme de la prise de photographie sur un « téléphone intelligent ». La photographie y est rendue possible grâce à une combinaison de matériels et de logiciels spécialement conçus pour offrir une expérience de prise de vue intuitive et de haute qualité. Cela fonctionne généralement ainsi :
- caméra : les smartphones sont souvent équipés de caméras haute résolution et de qualité supérieure. Les modèles récents peuvent comporter plusieurs objectifs, tels qu'un grand angle, un téléobjectif et un objectif ultra grand angle, ce qui permet une plus grande polyvalence dans la prise de vue ;
- appareil photo natif : chaque smartphone est livré avec une application d'appareil photo intégrée qui offre diverses fonctionnalités et modes de prise de vue. L'application fournit une interface utilisateur conviviale, permettant aux utilisateurs de contrôler des paramètres tels que l'exposition, la mise au point, le mode HDR, le flash et bien d'autres encore… ;
- traitement d'image : les smartphones utilisent un puissant processeur d'image pour capturer et traiter les photos. Ce processeur permet d'améliorer automatiquement les images en ajustant les couleurs, la luminosité, le contraste et d'autres paramètres afin d'obtenir un résultat optimisé ;
- intelligence artificielle : les smartphones intègrent également diverses technologies avancées pour améliorer la qualité des photos. Parmi elles, se trouvent la stabilisation optique de l'image (OIS), la réduction du bruit, la détection des visages, la capture en mode rafale, la mise au point automatique, la détection de scène…
En déclenchant une photographie, c’est donc une véritable machine qui se met en branle pour offrir à l’œil du photographe la plus belle image possible, flattant tant son ego que celui du sujet de l’image.
Appartient-il au commissaire de justice de bannir sans distinction toute photographie réalisée par un smartphone ?
Une réponse négative s’impose, puisque le commissaire de justice s’assure de la correspondance de l’image avec la réalité au moment de la rédaction de son procès-verbal. C’est pour cela que la loi prévoit en plusieurs hypothèses le recours à la photographie par le commissaire de justice [3].
Plus encore, la « fauxtographie » peut constituer une alliée de cet urgentiste du droit, à condition qu’il sache utiliser cet outil. Il sera ainsi de la photographie 360° qui permet la naissance du constat immersif [4], du constat par drone qui permet au commissaire de justice d’offrir un point de vue inédit, ou de la maîtrise de prise de vue permettant la mise en exergue d’un point précis (floutage de l’arrière-plan ou de données personnelles par exemple, utilisation d’un objectif grand angle qui a tendance à déformer les bords d’image).
La « fauxtographie » n’en demeure pas moins dangereuse dans ses conséquences si elle n’est pas contrôlée, comme il sera exposé dans les développements suivants.
II. Les conséquences de la « fauxtographie »
La falsification des photographies est un défi majeur à l'ère numérique. Elle remet en question la perception de la réalité et peut avoir des conséquences néfastes sur la confiance du justiciable, surtout si elle est censée constituer une preuve, mot dérivé du latin probus qui signifie bon, honnête...
L’existence de la « fauxtographie » présente de réels défis juridiques (A) aux réelles conséquences pour le justiciable tenté de recourir à des technologies de certification de photographies (B).
A. Conséquences juridiques
La conséquence de la « fauxtographie » est la perte de foi en l’image-preuve, et son incapacité à prouver, c’est-à-dire convaincre de la vraisemblance d’un fait. Une banalisation de la « fauxtographie » aurait de graves conséquences juridiques, tant pour le demandeur, le défendeur que le magistrat.
Pour le demandeur, la conséquence juridique de la « fauxtographie » est l’impossibilité de purger de soupçon la preuve qu’il produit, au risque de l’empêcher de prouver et obtenir gain de cause.
Pour le défendeur, la conséquence juridique de « fauxtographie » est la nécessité de rapporter la preuve contraire, ce qui peut s’avérer extrêmement onéreux.
Pour le magistrat, la conséquence juridique de la « fauxtographie » est le risque d’instrumentalisation de son office, notamment lorsque la procédure est non contradictoire comme en matière de mesures d’instruction in futurum.
Plus encore, et parce que le doute profite à l’accusé comme le commande l’adage in dubio pro reo, le prétexte de la « fauxtographie » peut être invoqué par une partie pour s’exonérer de sa responsabilité. Cette situation n’est pas théorique puisque l’argument du deepfake [5] a déjà été soulevé en justice en septembre 2022 [6]. Ainsi, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d’injure publique à caractère racial, à la suite d’une vidéo mise en ligne sur son site, un célèbre « humoriste » contestait en être l’auteur, soutenant que la personne qui y apparaissait présentait une apparence et une voix différentes des siennes, et que la vidéo litigieuse était en réalité un « deepfake ». Le tribunal réfuta son argumentation en s’appuyant sur différents faits, dont une expertise du département « Signal Image et Parole » de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale qui a écarté le recours à la technique du deepfake.
En définitive, la conséquence juridique de l’existence de la « fauxtographie » est l’impossibilité de produire une photographie en justice sans être en mesure de la resituer dans son contexte spatial (lieu de l’image), temporel (date et heure de l’image), juridique (image réalisée loyalement ou non ?) et, surtout, de garantir sa fidélité à la réalité. Il s’agit des critères cumulatifs de conditions de réalisation et de production de l’image, tels que nous l’avons démontré par le passé [7], qui conditionnent sa force probante.
B. Conséquences technologiques
Les thuriféraires de la technologie, ou plutôt de la fortune qu’elle permet de faire, promeuvent des solutions innovantes de certifications de photographies, reléguant la figure du commissaire de justice comme un vestige de l’Ancien Monde [8], oubliant par là même que toute technologie est éphémère, elle-même vouée à la désuétude, même si elle est réputée infaillible [9].
Séduit par le discours commercial sur les métadonnées [10] (constatées ou « certifiées » (sic) par commissaire de justice, ou ancrées dans des blockchains) des photographies, le justiciable/consommateur peu regardant peut se laisser tromper et accorder trop de foi dans une application dont il ne maîtrise pas le fonctionnement. En effet, les métadonnées peuvent être modifiées ou supprimées à l'aide d'outils spécifiques, tels que des éditeurs d'images ou des logiciels de manipulation de métadonnées. Il convient cependant de noter que bien que les métadonnées puissent être modifiées, cela ne signifie pas automatiquement que la photographie elle-même a été altérée. Les métadonnées peuvent être modifiées pour des raisons légitimes, telles que la correction d'une date ou la rotation de l'image. En d’autres termes, les métadonnées ne peuvent constituer au mieux que des indices, mais nullement des preuves juridiquement fiables.
Les métadonnées, qu’elles soient exactes ou non, présentent en outre un défaut majeur : elles sont incapables d’attester des conditions juridiques de la réalisation d’une photographie. Celle-ci peut donc être attentatoire à la vie privée, tomber sous le coup de l’article 226-1 du Code pénal N° Lexbase : L8546LXS, réalisée de manière déloyale, et donc impossible à exploiter devant un juge civil ou commercial, même si ses métadonnées ont été « déposées » ou « certifiées » par un commissaire de justice. Les dépôts ou autres « certifications » [11] n’ont de vertu que de prouver l’existence d’un document à une date donnée, sans en garantir l’authenticité, l’auteur et la conformité à la réalité. En d’autres termes, une « fauxtographie », même « déposée » ou « certifiée » chez un commissaire de justice, conserve ses vices.
À défaut de pouvoir être assimilée à un constat de commissaire de justice, une attestation de dépôt (document attestant du dépôt d’un fichier numérique chez un commissaire de justice) peut-elle se targuer de constituer un « début de preuve solide » pour reprendre la rhétorique de certaines applications de dépôt de photographies ? Le problème est que, même si un fait juridique se prouve par tout moyen, aucun dictionnaire ou ouvrage juridique ne définit ce qu’est une « preuve solide », l’analyse de la jurisprudence et l’usage de l’expression par la doctrine tendant à laisser penser qu’il s’agit d’une preuve rendant vraisemblable une allégation grâce à la conjonction de plusieurs éléments. En tout état de cause, il est possible que l’expression « début de preuve solide » soit un euphémisme commercial pour désigner une preuve faible.
La preuve n’est pas la métadonnée, mais l’image. Or, comment attester de sa conformité à la réalité autrement que par son auteur qui, seul, connaît la vérité ? Pour ce motif, il convient de sensibiliser les justiciables et juristes à la facilité de possibilité de déformer ou d’inventer une réalité, qu’ils soient « fauxtographies », deepfake ou deepvoice, et à la nécessité de vérifier l’authenticité du document qui leur est opposé.
Parce que le commissaire de justice est le professionnel de la preuve du fait juridique, il est le seul à constituer un rempart contre l’instrumentalisation du juge par la « fauxtographie ». Il constitue une source sûre, publique, crédible de vérification des faits. Les textes garantissent cela aujourd’hui plus qu’hier puisque l’article 5 du décret n° 2021-1625, du 10 décembre 2021, relatif aux compétences des commissaires de justice N° Lexbase : Z76267TP prévoit que « Le commissaire de justice (…) effectue lui-même les constatations (…). Il se rend personnellement sur les lieux du constat ».
Si saint Appronien est son patron, force est de constater que le commissaire de justice s’apparente à saint Thomas : il ne croit et ne rapporte que ce qu’il voit, que ce qu’il a personnellement expérimenté. Ainsi, tant qu’il ne l’a pas lui-même vu et touché, un commissaire de justice ne se laissera pas berner par l’image du pape en doudoune.[12]
[2] S. Dorol, L’image dans le constat, Procédures, 2015, ét. 11, p.9.
[3] CPCEx., art. R. 221-12 N° Lexbase : L2257ITR, R. 221-39 N° Lexbase : L4650MAH, R. 221-43 N° Lexbase : L2288ITW, R. 221-44 N° Lexbase : L2289ITX, R. 222-4 N° Lexbase : L2310ITQ, R. 223-6 N° Lexbase : L2337ITQ, R. 224-5 N° Lexbase : L2349IT8, R. 222-21 N° Lexbase : L2327ITD, R. 522-1 N° Lexbase : L2307ITM, et R. 525-3 N° Lexbase : L2580ITQ.
[4] Procès-verbal de constat utilisant une technologie d’acquisition d’images à 360°, dans l’esprit des logiciels de cartographie comme Google Street View.
[5] Technique de synthèse multimédia reposant sur l'intelligence artificielle et permettant de créer des vidéos en remplaçant des personnages dans des scènes.
[6] TJ Paris, 17e ch., 15 septembre 2022, Rachel K. et a. c/Dieudonné M.
[7] S.Dorol, L’image dans le constat, Procédures, 2015, ét. 11, p.9.
[8] Pour illustrer un monde où l’huissier est remplacé par un robot.
[9] En témoigne l’attaque brute fondée sur le paradoxe des anniversaires qui décrédibilise dès 2005 l’algorithme SHA-1, ainsi que toute blockchain fondée dessus.
[10] Les métadonnées sont des informations intégrées à un fichier image qui fournissent des détails sur l'appareil photo utilisé, les paramètres de prise de vue, la date et l'heure de la capture, ainsi que d'autres informations pertinentes.
[11] L’auteur utilise sciemment des guillemets car il ignore la force probante des certifications par commissaire de justice, le législateur ne donnant force probante qu’aux constatations. Aucun texte des commissaires de justice ne donne compétence à ce professionnel du droit pour établir des certificats, or en matière de saisie-attribution (certificat de non-contestation ») et irrécouvrabilité. Ces deux certificats portent sur des actions qu’il a lui-même menées et l’autorisent à en tirer des conséquences juridiques.
[12] L'auteur a utilisé l'application "Dawn AI" pour les photographies illustrant cette contribution et "ChatGPT" en partie pour les recherches.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486035
[Pratique professionnelle] Sous les sunlights des topiques*
Lecture: 9 min
N5889BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Gontran Loizon, Commissaire de justice
Le 29 Juin 2023
Mots-clés : déontologie • commissaire de justice
Il n’est pas possible aujourd’hui d’évoquer le contentieux et le recouvrement sans évoquer la déontologie des acteurs. Mais écrire sur la déontologie est délicat, encore plus lorsqu’il s’agit de celle des commissaires de justice. À titre exceptionnel, compte tenu du caractère sensible des questions évoquées, la direction scientifique de la revue a accepté la demande de l’auteur de cette chronique de signer sous le pseudonyme de Gontran Loizon. Ce « Gontran Loizon » est un commissaire de justice en activité, ancien huissier de justice.
| *Topique : valeur morale introduite dans la déontologie par des dispositions législatives ou réglementaires, donc par l’autorité publique. S’agissant de la profession d’huissier de justice, on en dénombre neuf : honneur, délicatesse, probité (issues de l’article 2, alinéa 1er, de l’ordonnance du 28 juin 1945 N° Lexbase : L7650IGG) ; loyauté, exactitude (issues de la formule du serment, article 35, du décret du 14 août 1975 N° Lexbase : L1357G8R) ; indépendance, rigueur, confraternité, dignité (issues respectivement des articles 2 et 4 du RDN) [1]. |
Un décret de 2022 [2] a institué le Collège de déontologie des commissaires de justice, qui remplace le Conseil consultatif de la déontologie des huissiers de justice créé par l’article 26 du Règlement déontologique national (RDN), approuvé par arrêté du garde des Sceaux en 2018.
On ne parle plus de déontologie des huissiers de justice, mais de déontologie des commissaires de justice. Qu’est-ce qui change ? Rien. Le texte de référence est toujours le RDN. Les questions déontologiques que se posaient les huissiers sont toujours celles que se posent les anciens huissiers devenus commissaires de justice.
Depuis son installation en 2022, le Collège a rendu une quinzaine d’avis. Notons que ces avis sont normatifs. Sont rappelées les valeurs traditionnelles que sont la loyauté, la probité, la rigueur, la confraternité. Sont prônés les principes généraux qui gouvernent la profession depuis des lustres. Là encore, rien de nouveau.
Pourtant, une lecture attentive de ces avis permet de tirer des conséquences pratiques.
Des actes…
Le commissaire de justice ne doit pas fournir des informations destinées aux parties dans un mail ou une lettre à l’avocat. S’il a quelque chose à préciser, il doit le faire dans un acte – tarifé ou non – sous forme de procès-verbal. Le commissaire de justice ne donne pas des informations, il dresse des procès-verbaux.
Pourquoi ? Parce que la correspondance adressée par un commissaire de justice à un avocat est couverte par le secret professionnel. Elle est évidemment protégée par le secret des correspondances, qui peut être levé. Mais pour ces correspondances, le Collège pose le principe du secret professionnel qui, à la différence du secret des correspondances, ne peut pas être levé par l’expéditeur ou le destinataire. Seule une réquisition judiciaire ou de l’autorité disciplinaire peut lever ce secret.
En pratique, au lieu d’adresser un mail à l’avocat pour lui indiquer la nouvelle adresse du débiteur, il faut dresser un acte [3]. S’il s’agit de faire savoir que les conditions d’occupation du bien saisi ont changé, il faut dresser un nouveau procès-verbal de description des lieux [4]. Ou encore lorsque le débiteur est insolvable, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de carence. Il ne peut pas écrire simplement une lettre, qui est couverte par le secret professionnel.
Un acte a vocation à être communiqué dans une procédure, pas un échange entre le commissaire de justice et l’avocat. Et l’acte a l’avantage d’être authentique.
| Avis n° 2023/17 Saisi du régime de confidentialité applicable aux correspondances échangées entre un commissaire de justice et son avocat donneur d’ordre dans un dossier de recouvrement, Le Collège est d’avis que : toutes les correspondances des commissaires de justice sont protégées par le secret des correspondances et par le secret professionnel. Le commissaire de justice ne peut donc en autoriser la production. |
… et encore des actes…
À la question souvent posée concernant les actes à plusieurs destinataires « faut-il faire un acte par destinataire ? » le Collège rappelle que ce qui importe, c’est la signification : elle doit être faite à chaque destinataire. Dans un acte unique à multiples destinataires, ou dans autant d’actes qu’il y a de destinataires selon le cas et selon les circonstances. Ce qui importe, c’est que chaque destinataire reçoive une expédition.
Ce qui est tarifé, ce n’est pas la constitution d’un dossier de procédure, c’est la signification. Ainsi, lorsqu’un acte doit être remis à plusieurs destinataires, le commissaire de justice procède à plusieurs significations, chacune devant être facturée. Un acte ou plusieurs, il y aura autant de coûts que de destinataires.
| Avis n° 2023/09 Saisi des conditions dans lesquelles un même acte destiné à plusieurs destinataires doit être établi, à savoir un acte par destinataire ou un acte unique et autant de copies que de destinataires Le Collège est d’avis que : conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’acte unique à multiples destinataires est admis dès lors qu’une copie a été remise à chacun d’eux. En revanche, le respect de l’ordre public et l’intérêt du destinataire imposent dans certaines matières ou procédures l’établissement d’un acte individualisé par destinataire. |
… mais pas n’importe quels actes…
Le Collège rappelle que les actes dépourvus d’existence juridique ne peuvent pas être signifiés, comme une cession de créance non encore réalisée. Et qu’en cas de cession de créance, celle-ci doit être portée à la connaissance du débiteur préalablement à toute voie d’exécution. La pratique consistant à signifier la cession de créance à l’occasion d’une dénonciation de saisie-attribution est donc proscrite. Évidemment, la dénonciation de la saisie doit être faite, que celle-ci soit fructueuse ou non.
| Avis n° 2023/13 Saisi de la possibilité pour un commissaire de justice de signifier une cession de créance non encore réalisée, Le Collège est d’avis que : un commissaire de justice ne peut en aucun cas prêter son concours à la signification d’un acte dépourvu d’existence juridique. À défaut, il contrevient à ses obligations de loyauté et de sincérité, ainsi qu’à son devoir de conseil. |
| Avis n° 2023/16 Saisi de la possibilité de régulariser un acte d’exécution sans que la cession de créance ait été préalablement signifiée ou notifiée et des conséquences disciplinaires d’une telle pratique, Le Collège rappelle que : l’article 1324 du Code civil N° Lexbase : L0973KZ3 précise que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte », et que l’article 1690 du Code civil N° Lexbase : L1800ABB dispose que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ». En conséquence, le Collège est d’avis que : pour engager une mesure d’exécution forcée, le commissaire de justice se doit préalablement de vérifier que la cession a été rendue opposable au débiteur cédé par voie de signification ou de notification. Le non-respect manifeste ou répété de ces dispositions constitue un manquement à la probité passible de sanctions disciplinaires. |
… des actes respectueux des droits de parties…
Le Collège de déontologie rappelle que le procès-verbal de description des lieux, dressé dans la cadre d’une procédure de saisie immobilière, a vocation à renseigner le créancier saisissant sur les qualités intrinsèques de l’immeuble (description, composition, superficie) et que la prise de photographie ne doit pas enfreindre l’obligation de délicatesse du commissaire de justice. « La photographie a vocation à illustrer une description ou une constatation faite par l’officier public, et […] la valeur attachée au procès-verbal tient à la seule qualité de son auteur. »
| Avis n° 2023/08 Saisi de la possibilité pour un commissaire de justice, chargé de dresser procès-verbal de description d’un bien immobilier saisi, de prendre, malgré le refus de l’occupant, des clichés photographiques à l’intérieur d’un logement, Le Collège est d’avis que : l’article R. 322-3 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2422ITU autorise le commissaire de justice à utiliser « tout moyen approprié » pour décrire les lieux. Toutefois l’article R. 322-2 du même code N° Lexbase : L2421ITT prévoit que le procès-verbal de description comprend la description des lieux, leur composition et leur superficie. Dès lors les clichés photographiques ne doivent rendre compte que de ces éléments, sans porter atteinte à l’intimité de la vie privée. Dans ces conditions, ils peuvent être pris nonobstant le refus de l’occupant, mais dans le respect du devoir de délicatesse. |
… et de la confraternité
Pour le Collège de déontologie, la confraternité – qui est une obligation déontologique – défend de faire certaines choses, comme dénigrer ses confrères, évidemment. Le RDN interdit toute forme de publicité. La publicité dite « fonctionnelle » est du domaine réservé des instances nationales représentatives. Le commissaire de justice ne doit pas, de façon franche ou détournée, se faire de la publicité.
| Avis n° 2023/14 Saisi de la possibilité pour un commissaire de justice d’établir une attestation en justice visant le comportement d’un confrère, Le Collège est d’avis que : comme tout citoyen, le commissaire de justice peut établir une attestation en justice. Conformément à l’article 202 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1645H4P, celle-ci doit se borner à relater les « faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ». En l’espèce en portant un jugement de valeur sur l’engagement et les qualités professionnelles de son confrère, sans aucun rapport avec l’objet de l’instance judiciaire pour laquelle l’attestation a été établie, son auteur méconnaît les principes fondamentaux de la déontologie de la profession que constituent la courtoisie et la délicatesse. Plus particulièrement, le Collège rappelle que l’article 14 du Règlement déontologique national relatif à la confraternité dispose qu’« en aucun cas une quelconque appréciation ne peut être portée sur un confrère ». |
| Avis n° 2023/04 Saisi de la possibilité pour un commissaire de justice de témoigner en son nom et publiquement en qualité d’utilisateur au profit d’un de ses prestataires, Le Collège est d’avis que : un tel témoignage, dès lors qu’il n’est pas anonyme est constitutif d’une publicité indirecte au profit du commissaire de justice concerné, et comme tel prohibé par le Règlement déontologique national. |
Rappelons que toute entorse à la déontologie est susceptible de faire l’objet de poursuites disciplinaires.
[1] T. Guinot, Recueil déontologique général des huissiers de justice, 2022, Éditions Juridiques et techniques, p.17
[2] Décret n° 2022-545, du 13 avril 2022, relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels N° Lexbase : L3654MCC.
[3] C. com, art. A 444-23, prestation 99 N° Lexbase : L3377LWY: acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice.
[4] C. com., art. A 444-28, prestation 114 N° Lexbase : L3380LW4: procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485889
[Pratique professionnelle] Le jour où : quand une saisie de VTM peut en cacher une autre
Lecture: 3 min
N6062BZK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Arnaud Leon, Commissaire de Justice associé (Selarl Bonnamy-Vizoso & Leon), Chargé d’enseignement à l’INCJ (Institut National des Commissaires de Justice), IJA (Institut Juridique d’Aquitaine), intervenant EDA (École des Avocats de Bordeaux) et ENM (École Nationale de la Magistrature)
Le 28 Juin 2023
Mots-clés : saisie • Véhicule Terrestre à Moteur • VTM
La revue Lexbase Contentieux et recouvrement a le plaisir de vous présenter la rubrique « Le jour où » qui laisse la parole libre à des professionnels du droit, ayant rencontré des difficultés pratiques lors de la mise en œuvre d’une procédure ou une anecdote particulière. L’objectif de cette rubrique est, au-delà de constituer un retour d’expérience, de démontrer en quoi la réalité du droit peut être éloignée des textes, contraignant le professionnel à improviser pour parvenir à ses fins.
« Je me rappelle d’une anecdote dans un dossier que j’ai appelé « la friteuse qui valait 40 k ».
Les faits. En l’espèce, un dossier m’est confié au titre de l’aide juridictionnelle en exécution du recouvrement d’une prestation compensatoire. L’ensemble des diligences effectuées révèlent un débiteur bénéficiaire du RSA sans biens apparemment saisissables. Néanmoins, après interrogation du SIV, des véhicules ressortent dont un coupé BMW série 4.
Après plusieurs échanges avec la créancière, nous nous accordons pour mettre en place une procédure de saisie de Véhicule Terrestre à Moteur avec enlèvement.
Préalablement à mes opérations, je signifie un procès-verbal d’indisponibilité de carte grise afin d’éviter que le débiteur ne puisse céder son bien. Mais le débiteur est retors et dissimule son véhicule.
Ma mandante, comme souvent dans ce type de dossier, piste son ex-époux et contacte l’étude pour m’indiquer la localisation du véhicule.
Dès lors, je réquisitionne un dépanneur et je fais pratiquer l’enlèvement pour déplacer le véhicule à la salle des ventes aux fins de vente.
En fin de journée, je reçois un appel du débiteur, particulièrement agressif et insultant, m’indiquant qu’il est en possession des clés et qu’il compte récupérer son véhicule dans la nuit. Je lui indique qu’une telle manœuvre relève du correctionnel et je l’invite dès lors à se présenter le lendemain en mon étude pour me remettre les clés et éventuellement solder sa créance.
En raccrochant, je contacte le responsable de la salle des ventes, pour le prévenir de la situation et organiser le blocage du véhicule. Ce dernier est entreposé entre quatre autres véhicules pour empêcher le débiteur de mettre à exécution sa menace durant la nuit.
Le lendemain, le débiteur arrive en mon étude avec une attitude à l’opposé de celle de la veille. Il m’explique qu’il aime beaucoup sa voiture, et qu’il souhaite surtout récupérer sa belle friteuse « toute neuve » dans le coffre de cette dernière. Il est très insistant sur le fait de pouvoir accéder à cette friteuse dont il a un besoin pressant pour cuisiner. Il me demande comment nous pouvons négocier. Ce à quoi je lui réponds qu’il n’y a aucune négociation possible, et que seules deux options s’offrent à lui : solder le montant de la créance d’un montant de 18 000 euros ou bien le véhicule sera vendu.
Le lundi matin, je reçois un virement du montant de la créance. Le débiteur me contacte et sollicite alors de reprendre possession de son bien.
Je lui fixe un rendez-vous sur le parking de la salle des ventes. Nous faisons le tour du véhicule pour s’assurer de la conformité de son état.
Cependant, par curiosité, je lui demande s’il est possible de voir sa friteuse. En effet, j’ai un doute sur la véracité de ses propos et de la présence de celle-ci. Il ouvre le coffre, et au milieu, je constate bien cette fameuse friteuse dans son carton.
Bien que très surpris, je n’en demande pas plus dès lors que le dossier est régularisé.
C’est alors que de retour à l’étude, je reçois un appel de ma cliente m’indiquant que le débiteur a avoué à sa meilleure amie (qui le connait également) qu’il avait dissimulé 40 000 euros à l’intérieur de la voiture dont une grande partie plus précisément dans cette friteuse.
Nous pouvons en conclure qu’une saisie d’espèces était possible, ou que l’éventuel acquéreur du bien aurait eu deux fois le prix du véhicule.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486062
[Le point sur...] Des diligences que doit effectuer le commissaire de justice pour rechercher le destinataire d’un acte. Le feuilleton continue.
Réf. : CA Rennes, 7 juin 2023, n° 22/05830 N° Lexbase : A34959ZH
Lecture: 8 min
N5980BZI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jean-Luc Bourdiec, Commissaire de justice, Délégué de la cour d'appel d'Orléans à la Chambre nationale des commissaires de justice
Le 03 Juillet 2023
Mots clés : 659 • diligences • commissaire de justice • signification
Quand il signifie un acte, selon qu’il est chargé ou non de ramener un titre à exécution, le commissaire de justice ne dispose pas des mêmes informations. Pourtant, toute signification est importante et participe du principe du contradictoire.
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. » (CPC, art. 659,al 1 N° Lexbase : L6831H77)
Si le commissaire de justice ne peut pas signifier dans les conditions des articles 654 N° Lexbase : L6820H7Q et suivants du Code de procédure civile (à la personne du destinataire, à une personne présente ou à domicile), il doit dresser un procès-verbal de recherches infructueuses. Il appartient ensuite au juge de vérifier si les diligences effectuées sont suffisantes ou non. Le commissaire de justice n’a pas une obligation de résultat. Il doit seulement relater précisément les diligences accomplies. Si l’obligation de résultat existait, le procès-verbal de recherches infructueuses n’existerait pas.
Une abondante jurisprudence permet de dresser la liste des diligences suffisantes pour la régularité de la signification. Récemment, la Cour de cassation a rappelé que l’huissier de justice était tenu de tenter une remise sur le lieu de travail, ou du moins de relater dans son procès-verbal les diligences accomplies pour le trouver (Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, no 21-14.145, F-B N° Lexbase : A10288YQ : R. Laher, La revue pratique du recouvrement, EJT, 2023, p. 10).
À l’évidence, les diligences relatées par le commissaire de justice doivent être appréciées in concreto au jour où elles sont accomplies, selon les circonstances, et avec les moyens dont il dispose à ce moment précis.
Un arrêt de la cour d’appel de Rennes n° 22/05830 du 7 juin 2023 annule une signification régularisée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6831H77.
Les faits : un homme assigne son frère aîné devant le tribunal judiciaire de Brest. Il lui reproche des fautes dans la gestion de sociétés civiles immobilières. Il est débouté et condamné à verser deux mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM. Le commissaire de justice tente de signifier la décision à l’adresse indiquée dans l’acte introductif d’instance, en vain. L’homme n’habite pas à cette adresse. Le commissaire de justice effectue de nombreuses démarches et finit par dresser un procès-verbal de recherches infructueuses très détaillé. Quelques mois plus tard, il régularise une saisie-attribution et la dénonce à une nouvelle adresse, trouvée grâce à une requête dans le fichier des comptes bancaires (Ficoba). L’homme en question fait appel de la décision qui lui a été signifiée six mois plus tôt. La cour annule cette signification et juge l’appel recevable. Elle confirme la décision entreprise et condamne la personne à verser trois mille euros en plus, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM.
Mais ce qui retient l’attention, ce sont les raisons pour lesquelles la signification a été annulée : les diligences relatées dans le procès-verbal sont insuffisantes, car elles n’ont pas permis de trouver l’adresse du destinataire de l’acte. La cour trouve en effet que les diligences, bien que nombreuses, sont incomplètes dans la mesure où elles n’ont pas été efficaces. Autrement dit, puisqu’elles n’ont pas été efficaces, elles sont incomplètes, comme si le commissaire de justice avait une obligation de résultat. Or, ce n’est pas le cas.
Plus étrangement, la cour d’appel constate que les démarches ne sont pas complètes « dans la mesure où des démarches similaires à celles réalisées pour la dénonciation de la saisie-attribution auraient permis une signification à l’adresse actuelle (du destinataire de l’acte) et auraient évité une signification (du titre) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ». La cour compare donc les diligences que le commissaire de justice a accomplies pour signifier le titre, et celles effectuées pour dénoncer la saisie-attribution qu’il venait de régulariser. Elle juge la première signification en se référant à la seconde, réalisée postérieurement et avec d’autres moyens.
Il y a pourtant une différence considérable : lors des premières opérations, le commissaire de justice était seulement chargé de signifier un acte. Il n’avait à sa disposition que les informations contenues dans le titre, celles fournies par son requérant, et celles recueillies auprès du voisinage, des services de la mairie, et dans les annuaires ou sur internet. Lors des secondes opérations, porteur d’un titre qu’il était chargé de ramener à exécution, le commissaire de justice disposait de tous les outils que mettent à sa disposition les articles L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L1721MAY et L. 151 A du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L1282MAQ, outils que la loi lui dénie lorsqu’il n’est pas chargé d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire.
C’est ainsi que le commissaire de justice, pour faire une saisie-attribution et la dénoncer, a pu interroger le Ficoba et obtenir une information importante qu’il n’avait pas obtenue avant malgré les diligences effectuées lors de la première signification : l’adresse actuelle du destinataire de l’acte. Information qu’il n’était pas en mesure d’obtenir lors de la signification du titre.
Au vu de cette signification, la cour constate que « des démarches similaires (…) auraient permis une signification à l’adresse actuelle du destinataire de l’acte ». Or, si le commissaire de justice avait effectué des démarches similaires, c’est-à-dire s’il avait interrogé le Ficoba, il l’aurait fait précisément en violation des dispositions qui permettent l’interrogation du Ficoba. En effet, l’article L. 151 A du Livre des procédure fiscale N° Lexbase : L1282MAQ permet à l’huissier de justice d’obtenir les informations détenues par la direction générale des finances publiques (DGFIP) s’il est chargé de ramener un titre à exécution, et seulement dans ce cas. Le commissaire de justice qui n’est chargé que de signifier un acte ne peut pas interroger le Ficoba. Le faire l’expose à des sanctions disciplinaires.
Il y a donc bien deux sortes de significations : celles qui sont faites en dehors de l’exécution, notamment les assignations, les citations et la signification des titres, et celles qui sont faites pour ramener un titre à exécution.
Là et seulement dans cette hypothèse, le commissaire de justice dispose de davantage d’informations. En tout cas, il est à même de solliciter davantage d’informations et l’administration est tenue de lui répondre.
Dans la pratique, l’avocat transmet le titre « aux seules fins de signification », tente d’obtenir le paiement et, s’il échoue, confie la grosse au commissaire de justice pour exécution. Ainsi, paradoxalement, la signification du titre exécutoire ne permet pas au commissaire de justice d’accéder aux informations utiles à sa mission.
Dans cette affaire, le commissaire de justice a signifié le titre par procès-verbal de recherches infructueuses. Ce procès-verbal relatait avec précision les nombreuses diligences effectuées. Encore une fois, à ce moment-là, il n’était que chargé de signifier, pas d’exécuter. Il a fait avec les moyens dont il disposait.
Juger cette signification à l’aune d’une autre signification, effectuée trois mois plus tard, dans d’autres circonstances à l’aide de moyens différents, et la juger insuffisante parce que résultat n’a pas permis de trouver l’adresse actuelle d’un débiteur particulièrement retors, nous semble hautement hasardeux.
Cet arrêt permet de s’interroger sur les informations dont dispose le commissaire de justice pour signifier.
Signifier, c’est accomplir la mission essentielle et primordiale que lui confient et la loi et le pouvoir exécutif, car le commissaire de justice est officier public et ministériel. Signifier, c’est avant tout porter à la connaissance du justiciable concerné un acte, un instrument créé par le commissaire de justice, et toutes les informations utiles à sa compréhension. Signifier, c’est mettre en œuvre le principe du contradictoire. Signifier, c’est « toucher » la personne. Toute signification, quelle qu’elle soit, devrait être facilitée par la possibilité d’obtenir immédiatement toutes les informations nécessaires – et pas seulement de les demander.
Il ne devrait pas y avoir deux sortes de significations, celles faites en vue de ramener un titre à exécution, au vu d’informations utiles et pertinentes, et celles qui sont faites en dehors des voies d’exécution, sans possibilité d’obtenir les moyens de bien signifier. Car chaque signification est importante. Rappelons que nul ne peut être jugé sans avoir été sinon entendu, du moins appelé.
Pourquoi les commissaires de justice n’auraient-ils pas un accès direct et gratuit au Ficoba, au cadastre et plus généralement à toutes les informations utiles à la réalisation de leur mission fondamentale ?
Pourquoi tout simplement la recherche des informations est-elle conditionnée à la mission d’exécution ? Il suffirait de supprimer les mots « chargé de l’exécution » à l’article L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L1721MAY et au II de l’article L. 151-A du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L1282MAQ. Et de rajouter après « l’exécution » les mots « de la mission ou » à l’alinéa 1 de l’article L. 152-3 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4529LN3.
Signifier un acte sans être chargé de ramener un titre à exécution, c’est aujourd’hui partir à la pêche aux informations sans aucun moyen de les obtenir. Dans un monde idéal où le commissaire de justice serait à même d’officier, il aurait toujours accès à toutes les informations nécessaires. Et peut-être qu’ainsi, il n’aurait plus à dresser de procès-verbaux de recherches infructueuses que de façon occasionnelle.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485980
[Questions à...] À la rencontre de Benoît Santoire, Président de la Chambre nationale des commissaires de justice : une perspective éclairante sur la profession
Lecture: 8 min
N5958BZP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 03 Juillet 2023
Dans le cadre de notre série d'entretiens avec des personnalités clés du domaine judiciaire, nous avons eu l'honneur de nous entretenir avec Monsieur Benoît Santoire Président de la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ). Cette interview nous offre une occasion de mieux comprendre la profession des commissaires de justice et les multiples enjeux à venir.
Cette interview est, également, à retrouver en [vidéo].
Lexbase Contentieux et Recouvrement : La réforme de la saisie des rémunérations augure-t-elle une réforme globale du Code des procédures civiles d’exécution ? Dans l’affirmative, pourquoi avoir privilégié cette procédure en priorité ? Enfin, que pensez-vous de la résolution lors de l’assemblée générale du CNB s’opposant à cette déjudiciarisation ?
Monsieur le Président Benoît Santoire : Une grande réforme globale des voies d’exécution n’est pas à l’ordre du jour tant le sujet est complexe car, outre les procédures, elle impacterait également l’ensemble de notre tarif.
En revanche, je suis bien décidé à corriger tous les points de blocage afin de rendre ces voies d’exécution plus efficaces. Dit autrement, plutôt qu’une grande réforme dont les résultats pourraient être hasardeux, je préfère adapter ces voies d’exécution aux évolutions sociales et économiques de notre société.
Et le projet de réforme de la saisie des rémunérations répond parfaitement à cette stratégie. En effet, la mise en œuvre de celle-ci apparaît aussitôt anachronique par rapport aux autres voies d’exécution. Alors que le Commissaire de Justice est porteur d’un titre exécutoire, il doit « repasser » devant un magistrat pour saisir les revenus du débiteur. Revenus qu’il pourrait par ailleurs saisir par la voie de la saisie-attribution, laquelle ne nécessite pas une ordonnance préalable, sans pour autant priver le débiteur de la possibilité de saisir le juge de l’exécution.
Outre cet anachronisme procédural, cette nouvelle saisine du tribunal entraîne des délais particulièrement longs, tant dans l’attente de l’audience que dans les répartitions effectuées par le greffe. Tous ces délais ralentissent d’autant l’exécution, et peuvent la compromettre car l’efficacité de l’exécution tient à la rapidité de mise en œuvre de celle-ci, et à notre réactivité vis-à-vis de l’évolution de la situation du débiteur. Or ces étapes, et notamment la gestion déléguée aux greffes ne nous permettent pas de « coller » à la situation du débiteur qui peut changer d’employeur, ce qui devient fréquent dans la société actuelle.
Les créanciers eux-mêmes ne comprennent pas ce qu’ils considèrent comme une inertie. Et c’est par l’économie en général qu’on peut le mieux démontrer l’inefficacité de cette procédure puisque tout ce qui est inefficace est en pratique abandonné. Et c’est ce à quoi on assiste puisque la saisie des rémunérations est tombée en désuétude dans la pratique des commissaires de justice.
Bien sûr, nous devons encore convaincre les acteurs actuels de cette procédure qui peuvent penser, à tort, qu’ils en seraient exclus demain. Tout d’abord, le juge de l’exécution pourra toujours être saisi en cas de contestation, laquelle reste bien sûr possible, car dans cette nécessaire adaptation des voies d’exécution il n’est évidemment pas question de toucher aux droits de la défense. Le juge de l’exécution serait d’ailleurs ainsi recentré sur sa véritable fonction.
Quant aux avocats, et plus particulièrement la résolution du CNB à laquelle vous faites référence, je pense qu’il s’agit davantage d’une réaction à chaud, et en décalage avec la pratique. En effet, actuellement très peu de débiteurs contestent cette procédure, et très peu sont accompagnés d’un avocat. Mais là aussi, en cas de contestation les avocats retrouveront tout leur rôle.
Lexbase Contentieux et Recouvrement : Plusieurs voix s’élèvent en réclamant une réforme de la procédure d’injonction de payer. Y’a-t-il une réflexion en cours ?
Monsieur le Président Benoît Santoire : Sur ce sujet également, plus qu’une réforme de l’injonction de payer, il s’agit de modifier plus particulièrement un point issu de la réforme du 1er mars 2022 qui en pratique a raté son objectif de simplification et surtout de rapidité.
En effet, si nous n’avons plus besoin de requérir l’apposition de la formule exécutoire, nous devons néanmoins obligatoirement demander le certificat de non-opposition, à défaut nous ne serions pas informés d’une éventuelle opposition du débiteur. Or cette obligation maintient par conséquent cette saisine du greffe en deux étapes, telle qu’elle existait précédemment. Au lieu d’apposer la formule exécutoire, le greffe doit éditer ce certificat de non-opposition, ce qui engendre les mêmes délais.
Là aussi, face à ce qui se révèle être un anachronisme inutile car il n’apporte aucune garantie supplémentaire au débiteur, et reproduit les délais inhérents aux retours des greffes, nous avons saisi la DACS d’un projet de réforme en nous inspirant de la procédure de saisie-attribution. Ainsi, le débiteur qui formerait opposition devrait dénoncer celle-ci par LRAR au commissaire de justice saisissant, lequel ainsi informé serait à même de rendre lui-même le certificat de non-opposition. Le gain de temps serait évident, et cela redonnerait tout son sens et son intérêt à cette réforme récente qui prévoyait l’apposition de la formule exécutoire dès la première phase.
Nous avons également proposé que le délai de signification soit ramené de six à trois mois, afin d’éviter un dévoiement de cette procédure qui a vocation à faire l’objet d’une exécution.
Il subsistera la problématique de la mise à disposition des pièces justificatives qui, bien que dématérialisée, reste très lourde. Mais il est difficile de trouver une alternative sans entamer la nécessaire information du débiteur. Néanmoins, si nous parvenons à régler la question du certificat de non-opposition, nous aurons fait un grand pas vers plus de rapidité et donc d’efficacité de cette procédure.
Lexbase Contentieux et Recouvrement : La profession de commissaire de justice fête son premier anniversaire. Quels souhaits peut-elle faire en soufflant sa bougie ?
Monsieur le Président Benoît Santoire : Notre profession peut souhaiter conserver et accentuer sa place dans la chaîne judiciaire. Ce souhait est tout à fait réaliste car je crois pouvoir affirmer que nous avons retrouvé la confiance des pouvoirs publics. J’ai bien conscience que cela ne suffira pas à obtenir gain de cause sur tous les sujets figurant sur la feuille de route que j’ai fixée au bureau de la Chambre nationale. Mais à coup sûr, sans cette nécessaire confiance, ce souhait serait un vœu pieux.
Nous pouvons également souhaiter conserver et accentuer notre place dans la société. En effet, avec les bouleversements que nous connaissons dans nos vies quotidiennes, nous avons plus que jamais besoin de sécurité et notre qualité d’officier public et ministériel retrouve tout son sens, tant en termes de sécurité juridique qu’en notre qualité de tiers de confiance. Formons le souhait du réflexe du recours au commissaire de justice.
Enfin, pour ne citer que ceux-là, souhaitons à cette jeune profession de grandir en ne faisant qu’un, tout en additionnant les compétences de nos deux anciennes professions. Souhaitons que ce nouveau-né riche de nos passés respectifs, conserve, valorise et élargisse ces expertises respectives dans une grande profession de l’exécution.
Lexbase Contentieux et Recouvrement : Il va bientôt exister des commissaires de justice spécialisés. Que pensez-vous que le public et les professionnels du droit attendent de la spécialisation ?
Monsieur le Président Benoît Santoire : Dans la foulée de ma précédente réponse, cette spécialisation pourra permettre aux consœurs et confrères déjà en place de se démarquer sans avoir à faire systématiquement référence à leur ancienne profession respective. De même, les futurs candidats pourront faire valoir leur penchant naturel vers l’art ou le droit.
En ce qui concerne les spécialisations propres à l’activité des anciens huissiers de justice, il faut reconnaître qu’en pratique ce métier est très polyvalent, et quasiment tous les consœurs et confrères pratiquent l’ensemble de la palette de nos activités. Mais cette spécialisation voulue par la loi Macron, si elle ne semble pas revêtir un intérêt immédiat pour nos interlocuteurs, doit nous inciter à développer des compétences plus pointues dans tel ou tel secteur en fonction de nos appétences ou de notre localisation géographique. Bien entendu, nous avons intérêt à rester polyvalents pour maintenir le maillage territorial, mais nul doute qu’avec la complexification de certains pans de notre activité, une spécialisation peut nous ouvrir de nouveaux marchés en donnant une garantie supplémentaire à nos interlocuteurs. Cela peut nous inciter, voire nous forcer, à toujours rester à la pointe tant des compétences juridiques que technologiques dans tel ou tel secteur ; et ainsi permettre à cette nouvelle profession d’aller toujours plus haut et toujours plus loin.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485958
[Le point sur...] La preuve illicite en matière civile – le droit belge fait peau neuve
Lecture: 38 min
N5769BZP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jachin Van Doninck, Professeur à l’Université libre de Bruxelles et Avocat au barreau de Bruxelles
Le 29 Juin 2023
Mots-clés : preuve • preuve illicite • preuve en droit pénal • preuve en droit civil • droit à la preuve • procès équitable
Depuis 2003, la Cour de cassation belge a rendu des arrêts retentissants sur une question récurrente : que doivent faire les cours et tribunaux des preuves obtenues en violation de la loi ? Si la position de la Cour de cassation était depuis 2003 univoque en matière pénale, elle restait controversée en matière civile. La jurisprudence de la Cour de 2021 apporte désormais sans ambiguïté une réponse à cette question épineuse. Dans cette contribution, il sera exposé comment la Cour a cherché et trouvé des balises afin de peaufiner sa jurisprudence antérieure pour les fins du procès civil.
La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il avait un aspect agréable et qu’il était désirable, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de ce fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils connurent qu’ils étaient nus. » [1]
Tu ne mangeras pas du fruit défendu. Le droit de la preuve belge adhérait jusqu’à il y a peu à cette considération de l’Ancien Testament. La collecte des éléments de preuve en contradiction avec la loi donnait lieu à l’exclusion de la preuve. D’autres conceptions ont récemment fait leur apparition, d’abord dans le droit pénal, où se trouve le fondement de cette règle, dans le droit civil de la preuve ensuite. Nous examinons ci-après ces conceptions de plus près. Paradise lost?
I. Le sort de la preuve illicite : la jurisprudence de principe
Depuis 2003, la Cour de cassation belge a rendu des arrêts médiatisés répondant à une question récurrente : que fait le juge avec les preuves obtenues en violation de la loi ? Alors que la Cour de cassation avait l’habitude d’adhérer strictement à l’idée que les tribunaux ne devaient pas tolérer d’irrégularités dans l’obtention de preuves [2], la Cour a annoncé un changement de cap fondamental avec l’arrêt « Antigone » [3] – nommé d’après une opération de police coordonnée qui était alors en cours à Anvers. Les policiers avaient fouillé le propriétaire d’un café et avaient utilisé les clés de voiture ainsi trouvées pour fouiller cette dernière. Ils y avaient trouvé une arme à feu chargée, dont le numéro de série avait été effacé. Le juge pénal chargé de la détermination de la peine suppose avec le défendeur que la voiture fût fouillée illégalement, mais il soutient tout de même le juge dans sa décision de condamner le défendeur sur base de cette preuve. La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation du condamné. Selon la Cour, l’obtention illicite de la preuve a pour conséquence unique que le juge ne puisse pas prendre la preuve en compte lorsque :
1) la condition de forme violée est prescrite à peine de nullité,
2) l’irrégularité commise entache la fiabilité de la preuve
3) l’utilisation de la preuve viole le droit à un procès équitable [4].
Cette approche a par la suite été appliquée en matière de la sécurité sociale [5] et le contentieux fiscal [6].
Le dénominateur commun de cette jurisprudence est la relativisation d’une règle – auparavant considérée comme absolue – d’exclusion des preuves, dans les cas où le Gouvernement met en œuvre des « objectifs publics ». À l’objection selon laquelle il est difficile d’accepter une ligne de conduite plus libérale dans la collecte de preuves par le Gouvernement [7], la réponse fut qu’il ne s’agit pas de l’action en justice du Gouvernement en tant que telle, mais plutôt de l’intérêt public impliqué dans cette action gouvernementale. L’action gouvernementale dans les cas décrits vise à servir l’intérêt public et mérite donc un traitement spécial [8]. Sauf si la loi en dispose autrement en prévoyant une sanction différente (le cas de nullité), il s’agit d’une approche au cas par cas [9]. Avec l’intérêt public comme justification, un nouvel équilibre se dessine donc avec plus de proportionnalité dans l’évaluation de la légalité des preuves du Gouvernement.
Depuis ce changement de direction de la Cour, le débat a fait rage dans la jurisprudence et la doctrine sur la question de savoir si les mêmes critères Antigone doivent s’appliquer à la preuve entre citoyens. L’objection selon laquelle les critères Antigone ont été conçus pour les cas où le pouvoir public mène des enquêtes et plaide dans l’intérêt public n’a pas impressionné de nombreux tribunaux. Le test dit Antigone a été repris dans la jurisprudence civile des juges du fond comme moyen ultime pour trancher les discussions sur le sort des preuves illicites. Alors que la Cour de cassation est restée silencieuse à ce sujet et que le législateur, lors de la (re)codification du droit de la preuve, a préféré laisser passer la question [10], la discussion a pris de l’ampleur dans la doctrine. Ainsi, l’on a démontré qu’Antigone a mis à l’écart l’examen de la vie privée dans les affaires civiles [11].
Le silence de la Cour a récemment pris fin. L’occasion fut une discussion sur la vente d’une voiture d’occasion. Selon le vendeur professionnel, un prix d’achat de 53 500,00 euros avait été convenu par téléphone. Le fait qu’il ait envoyé aux acheteurs un bon de commande signé indiquant un prix de vente de 43 500 euros était une erreur. Les acheteurs ont répondu qu’ils avaient contresigné le bon de commande et que le prix de 43 500 euros était donc contraignant. Le juge de première instance a estimé que l’accord avait bien été conclu pour un prix de 53 500 euros. La cour d’appel réforme cette décision. Si un bon de commande contresigné par les acheteurs indiquant 53 500 euros comme prix de vente peut constituer un début de preuve par écrit, des preuves supplémentaires sont alors nécessaires, preuve que le vendeur n’a pas apportée, ou du moins pas légalement, selon la cour d’appel. Selon cette dernière, l’enregistrement de l’appel téléphonique entre les acheteurs et lui fut effectué secrètement et lorsque les parties étaient déjà engagées dans un litige quant au prix de vente. L’enregistrement est écarté des débats. Le vendeur se pourvoit en cassation. Il avance qu’en tant que justiciable, il a le droit de présenter au tribunal les éléments de preuve dont il dispose et que, sauf si la loi en dispose explicitement autrement, le juge ne peut écarter une preuve illicite que si l’obtention de la preuve est entachée d’un vice qui en élimine la fiabilité ou compromet le droit à un procès équitable.
Annulant l’arrêt attaqué, la cour d’appel a considéré sans équivoque que « sauf disposition contraire expressément prévue par la loi, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière civile ne peut être écartée que si son obtention entache sa fiabilité ou si elle compromet le droit à un procès équitable. » [12] Cette formulation succincte est immédiatement suivie par l’instruction de la cour au juge de prendre en compte « toutes les circonstances de la cause, notamment la manière dont la preuve a été obtenue, les circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, la gravité de l’illégalité et la mesure dans laquelle le droit de la partie adverse a été violé, le besoin de preuve de la part de la partie qui a commis l’illégalité et l’attitude de la partie adverse. »
La cour confirme la voie empruntée quelques mois plus tard [13]. Dans le cadre d’un litige portant sur une pension alimentaire après un divorce, le demandeur a souhaité mettre fin à cette pension alimentaire en vertu de l’article 301, § 10 de l’ancien Code civil [14], parce que son ex-conjointe cohabitait avec un nouveau partenaire. Sa demande fut déclarée non fondée en première instance, faute de preuves d’une amélioration réelle et significative de la situation économique du bénéficiaire. En appel, cette demande fut néanmoins confirmée fondée, estimant qu’il y avait suffisamment de preuves que le bénéficiaire des pensions vivait désormais avec quelqu’un comme s’ils étaient mariés au sens de l’article 301, § 10, troisième alinéa de l’ancien Code civil. La pension alimentaire n’était donc plus due, selon la cour d’appel.
Dans le premier moyen en cassation, il est reproché au juge d’avoir pris en considération la preuve 29. Il s’agissait d’un extrait du registre national avec historique de la résidence du nouveau partenaire du demandeur. Selon la demanderesse, cette pièce aurait été obtenue en violation de l’objet de l’autorisation d’accès au registre national accordée à l’avocat et constituerait donc une preuve obtenue illégalement. Selon la demanderesse, les avocats ne peuvent utiliser les informations du registre national que pour les besoins de la procédure, notamment pour l’ouverture, la conduite et la clôture d’un procès qui leur est confié ou pour accomplir des actes préalables à la procédure des règlements de conflits. Étant donné que dans le cas présent, le registre national fut consulté par l’avocat de la demanderesse pour effectuer des recherches sur une personne qui n’était pas partie à l’affaire (à savoir le nouveau partenaire de la demanderesse), cette recherche, utilisée comme preuve devant le tribunal, constituerait une preuve obtenue illégalement. Selon la demanderesse, le principe général du droit de défense (CEDH, art. 6 N° Lexbase : L7558AIR) exige que la preuve obtenue illégalement soit toujours rejetée des litiges étant purement de matière civile. Selon la demanderesse, le juge d’appel viole entre autres l’article 6 de la CEDH et le principe général du droit de défense, en n’examinant pas si la preuve fut obtenue de façon licite et en rejetant simplement la demande sur base de la considération que la crédibilité de la preuve ne soit pas affectée et que le droit à un procès équitable ne soit pas compromis.
La Cour de cassation rejette cette critique : « Sauf disposition contraire expressément prévue par la loi, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière civile ne peut être écartée que si son obtention entache sa fiabilité ou si elle compromet le droit à un procès équitable. Le juge doit ainsi prendre en compte toutes les circonstances de la cause, notamment la manière dont la preuve a été obtenue, les circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, la gravité de l’illégalité et la mesure dans laquelle le droit de la partie adverse a été violé, le besoin de preuve de la part de la partie qui a commis l’illégalité et l’attitude de la partie adverse. Le moyen assumant que du principe général du droit de défense, tel qu’établit entre autres dans l’article 6 CEDH, découle que la preuve obtenue de façon illicite doit être écartée des débats purement de droit civil, échoue en droit. »
II. Qu’est-ce que cela signifie ? Description des tâches et normes correspondantes pour le jugement de la preuve
La doctrine s’accorde à dire qu’avec ce doublé, la Cour de cassation a fixé les normes pour trancher la question de l’exclusion de la preuve, dans ce que la Cour qualifie de « litiges de nature de droit privé pur » [15]. Avant d’entrer dans le champ d’application précis de ces critères, il convient d’apporter quelques précisions terminologiques.
L’exclusion de la preuve dans les litiges de droit privé pur est une exclusion de preuve dans la relation juridique horizontale, entre citoyens ou entre le citoyen et le Gouvernement, lorsque ce dernier entre en jeu. La relation juridique dans ce cas est en effet de nature de droit privé (« affaires civiles ») [16]. Dans cette relation juridique horizontale, le concept de preuve illicite se réfère alors aux cas où la preuve a été obtenue ou est utilisée [17] en violation d’une règle étrangère au droit de la preuve, car lorsqu’une règle du droit de la preuve est ignorée, il s’agit d’une preuve irrecevable et non d’une preuve illicite [18]. Cette dernière distinction explique, par exemple, pourquoi les documents rédigés ou les communications faites pendant et aux fins d’une procédure de médiation sont irrecevables en tant que preuves devant les tribunaux (v. C. jud., art. 1728, § 1) [19]. L’on peut également penser au cas où le parent ascendant d’un enfant avancerait la reconnaissance parentale dans une affaire où ces parents ont des intérêts opposés. Il peut être assumé qu’une telle information constitue la preuve amenée par une partie et que la décision de la rejeter peut être fondée sur son irrecevabilité à la lumière des principes établis dans les articles 931 iuncto et 1004/1 du Code judiciaire.
La formule [20] proposée par la Cour de cassation pour résoudre la question de l’exclusion des preuves respecte la primauté du législateur (« Sauf si la loi en dispose expressément autrement »), puis se penche sur les notions de l’atteinte à la « fiabilité des preuves » et au « procès équitable », qui sont souvent associées. Contrairement à ce que la discussion de l’arrêt de décembre dans le Rapport annuel de la Cour de cassation semble suggérer [21], il n’est pas question d’une simple possibilité d’exclusion de la preuve dans ces cas. La formulation « l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière civile ne peut être écartée que si son obtention entache sa fiabilité ou si elle compromet le droit à un procès équitable » établit qu’aucune exclusion de la preuve ne soit possible en dehors de ces normes. Si l’un de ces cas se présente, l’exclusion de la preuve s’impose [22]. Quels sont donc ces critères ?
A. Les critères
1) La fiabilité
La preuve rendue non fiable par son acquisition ne peut pas être prise en compte. Cela semble évident, mais la jurisprudence a pourtant eu du mal à délimiter le champ d’application précis de ce critère de fiabilité [23]. La distinction entre la fiabilité en tant que critère d’évaluation des preuves et la fiabilité en tant que critère d’écartement dans la collecte des preuves n’est pas toujours reflétée. Ainsi, la Cour a jugé que lorsque la forme juridique omise n’est pas prescrite à peine de nullité ou que l’irrégularité n’affecte ni la fiabilité de la preuve ni le droit à un procès équitable, le juge ne peut attribuer une valeur probante légale à un élément de preuve obtenu en violation des dispositions qui réglementent particulièrement la preuve et garantissent sa valeur intrinsèque [24]. L’arrêt fut souvent cité dans le passé pour illustrer qu’en cas de non-respect des règles de preuves réglementées légalement, l’écartement de la preuve s’impose en tant que sanction, à l’exception de l’application d’Antigone [25].
Il est possible de systématiser davantage en établissant une distinction en fonction de la nature de la sanction. Si la loi prescrit un mode particulier pour l’obtention des preuves qui donne lieu à une force probante accrue, le non-respect de ce mode particulier d’obtention des preuves a pour sanction la réduction de la force probante ; en d’autres termes, il n’y a plus lieu à une force probante accrue. Si, au contraire, le juge veut dénier toute valeur probante à la preuve, il doit pouvoir établir que la méthode d’obtention des preuves a fait perdre toute fiabilité à la preuve [26].
Lors de l’application de ce critère de fiabilité, il convient en tout état de cause de garder à l’esprit que le critère doit contribuer à résoudre la question la recevabilité de la preuve et que cette question précède toujours l’appréciation de sa valeur probante, c’est-à-dire l’appréciation de la crédibilité, la confiance, le crédit, le sérieux, que le juge peut lui accorder en conscience [27].
2) Le procès équitable
Il est bien connu que la Cour de cassation a raccroché la question de l’écartement de la preuve dans la relation juridique verticale entre le citoyen et le Gouvernement à la notion du procès équitable. Dans l’approche de la Cour de cassation, cette notion fonctionne comme un terme fourre-tout pour un ensemble de sous-critères destinés à donner une forme concrète à ce procès équitable. Y sont compris tant le degré de diligence avec lequel les preuves ont été recueillies, la portée exacte de la norme juridique, l’objectif normatif de cette règle juridique et la proportionnalité entre la violation de la loi et la gravité de l’infraction dont les preuves sont en cause. Comme susmentionné, l’évaluation au cas par cas en fait partie intégrante [28].
J’ai expliqué ailleurs pourquoi le transfert de cette notion de procès équitable pour résoudre la question de l’écartement des preuves dans les relations juridiques horizontales est problématique [29]. Fondamentalement, l’objection se résume à dire que la collecte de preuves dans la relation juridique verticale est un acte de procédure. Antigone offre des critères de procédure pour répondre à une question de procédure. Les affaires civiles offrent une tout autre perspective. Il n’y a là pas question de phase préliminaire de nature procédurale. Alors que dans les affaires pénales, par exemple, l’obtention de preuves est axée sur le procès et rentre dans la phase procédurale préliminaire, dans les affaires civiles, préalablement au procès il n’existe que des sujets de droit qui peuvent ou non avoir des relations juridiques [30]. La collecte de preuves est ici une question de droit matériel. Cette collecte de preuves peut être destinée à un éventuel litige, mais elle peut également avoir pour seul objectif de produire certains effets juridiques en dehors de toute procédure. Concrètement : qu’il s’agisse d’un employeur qui souhaite justifier un licenciement ou un entrepreneur qui recueille des preuves quant à la concurrence déloyale d’un concurrent, c’est le droit substantiel qui régit leurs actions. Dans les affaires civiles, la question de savoir si la collecte de preuves fut illicite et l’effet que cela a sur le litige sont principalement déterminés par le droit substantiel. Le fait que la discussion sur l’exclusion des preuves ait lieu lors du procès ne peut pas affecter ce principe. Ceux qui n’envisagent la question de l’écartement des preuves que sous l’angle de la nullité, de la fiabilité et du procès équitable n’ont plus besoin de ce droit substantiel [31]. L’exigence d’un procès équitable devient ainsi le seul critère d’appréciation débouchant d’une garantie minimale [32]. Ainsi, Antigone n’aboutit pas à la relativisation, mais bien à la négation du droit substantiel [33].
« Sauf disposition contraire expressément prévue par la loi, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière civile ne peut être écartée que si son obtention entache sa fiabilité ou si elle compromet le droit à un procès équitable. Le juge doit ainsi prendre en compte toutes les circonstances de la cause, notamment la manière dont la preuve a été obtenue, les circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, la gravité de l’illégalité et la mesure dans laquelle le droit de la partie adverse a été violé, le besoin de preuve de la part de la partie qui a commis l’illégalité et l’attitude de la partie adverse. » [34] Il est tentant de discerner dans l’énumération des « circonstances de la cause » autant de sous-critères de ce procès équitable [35]. Même la discussion de l’arrêt de décembre dans le Rapport annuel de la Cour semble le suggérer [36]. Toutefois, cela ne va pas de soi. Dans la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’exclusion de preuves dans la relation juridique verticale, ces sous-critères servent spécifiquement à étoffer la notion de procès équitable [37] et la Cour laisse au juge (du fond) le soin de choisir lesquels de ces sous-critères il souhaite inclure dans son jugement [38].
La formule actuelle adopte un ton différent dans le deuxième partie de la phrase : « ainsi », c’est-à-dire en décidant de la question de l’exclusion de la preuve, la Cour dit que le juge du fond doit prendre en compte « toutes les circonstances de la cause ». Sous ce titre, la Cour ordonne au juge civil de faire dépendre son jugement de la manière dont la preuve a été obtenue, les circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, la gravité de l’illégalité et la mesure dans laquelle le droit de la partie adverse a été violé, le besoin de preuve de la part de la partie qui a commis l’illégalité et l’attitude de la partie adverse. Dans cette énumération, trois éléments d’appréciation peuvent être distingués pour le tribunal : l’appréciation à la lumière des circonstances de l’obtention de la preuve, la nécessité de la preuve et l’attitude de la partie contre laquelle la preuve est invoquée. Pourquoi alors continuer de s’accrocher à la notion de procès équitable ? Il semble que la Cour mise sur la reconnaissance de sa formule, même si l’analyse ci-dessous montre que les critères utilisés sont principalement propres au procès civil.
a. Le mode d’obtention de la preuve
Avec ce premier critère, la Cour de cassation demande au juge d’isoler et de qualifier l’acte d’obtention des preuves. Dans l’exposé de son raisonnement, la Cour utilise d’abord des mots neutres (« la manière dont la preuve a été obtenue »), semble ensuite vouloir rappeler que, quoi qu’il en soit, il s’agit ici d’un cas où la preuve illicite est invoquée (« les circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise ») et requiert ensuite du juge qu’il analyse « la gravité de l’illégalité » et donc « la mesure dans laquelle le droit de la partie adverse a été violé » [39].
En bref [40], ce premier critère de pondération revient à la qualification du moyen d’obtention de la preuve. Cette appréciation doit tenir compte tant de l’intensité et de la finalité de la norme invoquée comme violée que de la liberté, du droit subjectif ou de l’intérêt légitime des parties au litige. Une différenciation en fonction de la nature et du contenu de la norme prétendument violée devra donc contribuer à orienter la réponse à la première question. Que constitue une preuve illicite lors de la réponse à cette question ? En m’appuyant sur les critères d’intensité et de finalité de la norme ainsi que sur les travaux de Léonard [41], j’ai précédemment tenté de démontrer que la question de l’exclusion de la preuve gagne également à expliciter la nature de la norme prétendument violée : sert-elle à sauvegarder un intérêt, une liberté ou un droit subjectif ? Et comment cette norme s’articule-t-elle avec l’intérêt, la liberté ou le droit subjectif de l’auteur de l’obtention de la preuve ? [42] Si l’obtention illégale de preuves ou l’utilisation de ces preuves est qualifiée d’acte délictuel [43], il s’agit alors d’examiner les éléments constitutifs de ce fait juridique, et donc de déterminer si, à la lumière des critères susmentionnés, existe une violation matérielle du droit qui est, en outre, imputable (nous reviendrons sur ce dernier point plus loin).
Dans son analyse de l’arrêt de juin, Schouteden préconise une approche différente. Elle aborde ensuite le critère du moyen d’obtention de la preuve, le critère des circonstances dans lesquelles l’irrégularité a été commise et le critère de la gravité de l’illégalité et la mesure dans laquelle le droit de la partie adverse a été violé [44]. Elle place sous ce premier critère l’imputabilité de l’irrégularité commise (intentionnelle ou accidentelle, provoquée, coïncidente ou résultant d’un crime), dans le cadre du deuxième critère, elle traite de l’attente raisonnable de vie privée et, dans le cadre du troisième critère, de la proportionnalité et de l’équilibre entre le droit à la vie privée et le droit à la preuve. Schouteden reconnaît que cette approche peut entraîner un double usage de critères qui ont déjà été abordés dans la qualification de la preuve [45], mais elle ne considère pas cette objection comme décisive : après tout, selon elle, la question de l’utilisation de preuves non admissibles nécessite toujours une pondération des intérêts, qui doit servir à la détermination factuelle de la vérité [46].
Cette approche s’expose à tous les risques que j’ai déjà signalés. Ainsi, l’évaluation de la nature admissible d’une atteinte à la vie privée à la lumière de la notion d’attente raisonnable de vie privée implique déjà un exercice au niveau du droit matériel. L’ajout d’une considération procédurale supplémentaire et, en ce qui me concerne, sans contours, ne peut que saper cette considération antérieure [47]. L’utilisation de concepts tels que la détermination de la vérité et la balance des intérêts ne peut que dissimuler cette situation [48]. Schouteden déclare ainsi à propos de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de juin que « noch het recht op een eerlijk proces van de kopers noch de betrouwbaarheid van de opname zijn aangetast. De zoektocht naar de feitelijke waarheid (wilsovereenstemming over de prijs) vereist dat de rechter de opname in de debatten houdt. Aan de hand van de opname wordt de feitelijke waarheid immers het best benaderd » [« ni le droit au procès équitable des acheteurs ni la fiabilité de l’enregistrement n’ont été affectés. La quête de la vérité factuelle (consentement sur le prix) exige que le juge maintienne l’enregistrement dans les débats. C’est effectivement à l’aide de cet enregistrement que la vérité factuelle est approchée au mieux »]. Dans cette approche, il ne reste plus rien du droit matériel et les éléments de pondération discutés par Schouteden en tant que sous-critères sont également vidés de leur sens [49].
Une approche graduelle, par laquelle l’application du droit matériel à la légalité de l’obtention de preuves est le point de départ et le droit procédural n’est qu’un complément (« complémenter et non substituer »), est donc préférable [50]. La procédure bénéficie plus d’un élargissement de la perspective : non pas le choix entre le droit matériel et procédural, mais celui pour le droit matériel et procédural offre la solution. Mon analyse de ce premier critère et des autres critères avancés par la Cour (v. infra) démontre que la jurisprudence de la Cour accepte une telle interprétation et qu’elle est gérable pour le juge du fond.
Un élément brillant par son absence dans l’énumération de la Cour de cassation est la gravité de la faute imputée, ou, en d’autres termes, la mesure dans laquelle l’autre partie a violé la loi [51]. Il ne s’agit pas d’une perte. L’on peut, en effet, objecter à cette évaluation propagée auparavant que l’illégalité commise et la mesure dans laquelle l’autre partie a violé la loi sont mises en balance [52]. La certitude – l’obtention illégale de preuves – serait ainsi mise en balance avec ce dont le tribunal ne peut que présumer l’existence par et après obtention des preuves légales. C’est également ce que de l’avocat général Spier avait exposé dans ses conclusions sous l’arrêt du Hoge Raad relatif au vol à l’étalage : « Onderkend moet intussen worden dat de zojuist ontvouwde gedachtegang vertrekt van het retrospectieve gezichtspunt dat een dader is ontdekt en dat de camera op hem was gericht. Beziet men de zaak vóór de ontdekking en/of vanuit de optiek van een onschuldige, dan krijgt deze uiteraard een andere kleur » [« Il faut cependant reconnaître que le raisonnement qui vient d’être exposé part du point de vue rétrospectif qu’un coupable a été découvert et que la caméra était braquée sur lui. Vue avant la découverte et/ou du point de vue d’une personne innocente, l’affaire prend évidemment une autre couleur »] [53].
b. Le besoin de la preuve
La doctrine juridique a déjà tenté à plusieurs reprises de faire en sorte que le droit à la preuve fasse contrepoids à la discussion sur l’exclusion des preuves illicites [54]. Il est toutefois possible de discuter de la valeur ajoutée du droit à la preuve propagé en tant que droit subjectif autonome – en plus de garantir le droit au procès équitable comme établi dans l’article 6 CEDH N° Lexbase : L7558AIR et le principe général du droit à la défense. Selon la Cour des droits de l’Homme, il découle de l’égalité des armes, qui est intrinsèquement liée au droit d’accès à la justice [55], que dans les litiges où des intérêts privés sont opposés, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause, y compris ses preuves, dans des circonstances qui ne la placent pas dans une position clairement désavantageuse par rapport à la partie adverse [56]. Toutefois, cela n’octroie pas aux parties le droit d’admission de toutes les preuves apportées. De « le droit d’une partie à un procès de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris les preuves » [57] en vertu de l’article 6 CEDH, ne découle pas le droit de voir préservées les preuves irrégulières.
Dans son arrêt [58] fréquemment cité N.N. et T. A. c. Belgique au sujet de la preuve (il) légitime dans le contentieux de leur divorce, bien que la Cour des droits de l’Homme commence l’analyse par le positionnement fondamental du conflit entre le droit au procès équitable et le droit à la vie privée, elle restreint ensuite ce procès équitable à la possibilité raisonnable que toute partie doit avoir de présenter sa cause, y compris ses preuves, et ne manque pas l’occasion de souligner la spécificité de l’affaire : « L’affaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure en divorce, qui est par nature une procédure au cours de laquelle des éléments de l’intimité de la vie privée et familiale des parties sont susceptibles d’être révélés. » [59] Plutôt qu’une prise de position fondamentale au sujet du conflit entre l’affectation de la preuve illicite et le droit fondamental enfreint invoqué – dans ce cas le droit à la vie privée – l’arrêt démontre que l’atteinte à la vie privée alléguée – et donc la qualification en tant que preuve illicite – ne sera pas prise à la légère dans les matières de divorce.
Des situations dans lesquelles une partie démontre qu’aucun autre moyen de preuve (légal) ne soit ou n’était à sa disposition, sont néanmoins concevables [60]. Cette situation de nécessité de la preuve doit être prise en compte par le juge, car le fait de refuser à une partie la (seule) possibilité de preuve restante constitue un obstacle déraisonnable à l’administration de la preuve et viole donc l’article 6 CEDH [61]. Il s’agit d’une bonne chose que la Cour de cassation suive l’exemple étranger [62] de souligner que le juge doive également tenir compte de cette situation de nécessité de la preuve dans son jugement. À cette fin, le juge examine l’imputabilité de cette nécessité de la preuve et, partant, l’opposabilité de celui qui s’en prévaut.
c. L’attitude de la partie contre laquelle la preuve est invoquée
Avec ce critère, la Cour de cassation comble le fossé entre le droit matériel et le droit procédural. Tel qu’invoqué, le juge au civil a l’obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et à examiner en particulier la nature juridique des faits et actes invoqués par les parties. C’est précisément parce que cette tâche incombe au juge qu’il doit examiner les faits invoqués et contestés, en recourant si nécessaire aux moyens de preuve prévus par la loi. Le rôle du juge trouve donc son effet dans l’organisation de la preuve, et c’est là que la possibilité de l’établissement des faits se présente dans toute son ampleur [63].
Dérivé du rôle du juge de trancher le litige conformément au droit (et donc – j’ajoute – sur base de l’établissement des faits), les parties sont donc obligées de coopérer à la preuve. Qualifié de principe général de droit [64] et entretemps codifié en Belgique [65], le devoir de collaboration à la preuve jouit même au niveau international d’une reconnaissance générale.
La partie qui avance que la preuve est (obtenue de façon) illicite et prétend qu’elle puisse ainsi réfuter les faits avancés, doit être consciente que cela ne la dispense pas de l’obligation de clarifier ce qui tombe sous sa connaissance, telle que le veut la charge de la preuve motivée. Selon ce concept juridique, même si le risque de la preuve reste à la charge de la partie qui apporte la preuve, une justification peut être exigée de la partie adverse lorsqu’il s’agit de faits qui doivent être considérés comme tombant sous sa connaissance [66].
Cette charge de la preuve motivée est facile à faire respecter. Aux Pays-Bas, la Cour Suprême laisse au juge du fond le choix entre accepter l’allégation comme établie en l’absence de contestation motivée, considérer l’allégation comme plausible dans l’immédiat en admettant la possibilité d’une preuve du contraire (pour cela, il suffit que la preuve fournie soit réfutée, ce qui est une mesure plus légère que le renversement de la preuve, et le risque probatoire reste à charge de la partie qui apporte la preuve) ou même – et cela indique une certaine hiérarchie – le renversement de la preuve [67]. Je suis d’accord avec Paijmans [68] pour dire que la considération comme plausible dans l’immédiat soit, pour l’instant, la meilleure incitation à la contestation motivée, dans le respect de la répartition du risque de la preuve, et je considère que ce choix est transposable en droit belge, puisque le législateur a encadré le renversement de la preuve comme un ultimum remedium dans ce cas également [69].
d. Alternative légitime procédurale
Qualifier la preuve selon les critères du droit matériel, prise en compte de l’éventuelle nécessité de la preuve et du comportement procédural de la partie contre qui la preuve est invoquée. Lors de cette évaluation [70] exigeante, le juge peut trouver du réconfort dans ce que j’ai nommé l’alternative légitime procédurale. Le raisonnement est fondé sur le droit de la responsabilité, en particulier l’appréciation du lien causal en tant qu’élément constitutif de cette responsabilité. La Cour de cassation adopte à cette fin l’alternative légitime hypothétique depuis 1988, en formulant une hypothèse contrefactuelle : « Le juge doit ainsi déterminer ce que le défendeur aurait dû faire pour agir régulièrement. Il doit faire abstraction de l’élément fautif dans l’historique du sinistre, sans en modifier les autres circonstances, et vérifier si le dommage se serait également produit dans ce cas. » [71]
Jafferali a souligné que la construction de l’alternative légitime prête également attention à l’objectif de la règle violée, et que cela n’enlève rien à l’application de la doctrine de l’équivalence des conditions [72].
L’utilisation de l’alternative légitime procédurale implique que le juge examine si, à circonstances factuelles inchangées, il aurait pu, en vertu de l’article 877 du Code judiciaire, ordonner la production de la preuve qualifiée d’illégale. À cette fin, il organisera le débat sur la question de savoir si une partie aurait pu invoquer un motif légitime tel que visé à l’article 882 du Code judiciaire [73] – et si oui, lequel – pour contester la production de cette preuve. L’analyse de ce motif légitime en tant que moyen d’opposition est souvent limitée au secret professionnel [74], mais le Rapport Van Reepinghen met plus généralement l’accent sur l’appréciation par le juge de la légitimité du motif invoqué [75]. Il s’agit pour le juge de concrétiser son appréciation en tenant compte des libertés, des droits et des intérêts en jeu [76].
L’appréciation que cela exige de la part du juge répond à une évaluation de jugements possibles : « Hij vergelijkt dus het hypothetische geval waarbij hij afwijzend op de vordering beslist met het hypothetische geval waarbij hij de vordering toewijst » [« il compare donc le cas hypothétique dans lequel il rejette la demande au cas dans lequel il fait droit à la demande »] [77]. Une telle évaluation de jugements possibles peut aider le juge à déterminer le poids réciproque des critères que la Cour de cassation lui impose de trancher [78].
B. Illustration
Un exemple peut clarifier mon appréciation des critères anno 2021. Dans le cadre d’une procédure de divorce, un époux invoque une faute grave de son épouse pour faire échec à sa demande de pension alimentaire (C. civ., anc. art. 301, § 2, al. 2) [79]. Le mari tire la preuve de cette faute grave de messages électroniques devant démontrer que sa femme entretient une relation adultère et a également tenu des propos offensifs à son égard. L’épouse demande l’écartement de cette preuve, car les messages ont été obtenus en se connectant à son compte électronique après la prise d’effet du divorce de fait avec autorisation de vie séparée.
En appliquant les critères Antigone, l’écartement de cette preuve ne sera pas envisageable [80]. Par la force des choses, la discussion portera sur la question de savoir si la preuve répond aux garanties de fiabilité, et les parties devront en débattre, car c’est la (seule) garantie que leur donne le droit de contradiction.
Si, au contraire, l’on prend le secret de la correspondance, tel que garanti par l’article 8 CEDH N° Lexbase : L4798AQR, en tant que point de départ, l’on doit conclure avec la cour d’appel que « ook wanneer die echtgenote zou hebben nagelaten de sloten van de woning c.q. de brievenbus te veranderen, dan kon geïntimeerde na de rechterlijke beslissing van 10 juli 2007 geen rechtmatige toegang meer nemen tot haar woning c.q. haar brievenbus, en bij uitbreiding tot haar elektronische brievenbus » [« même si l’épouse n’aurait pas changé la serrure de sa maison et de sa boîte aux lettres, le défendeur ne pouvait plus avoir légalement accès à sa maison et sa boîte aux lettres, et par extension à sa boîte aux lettres électronique »]. L’exclusion de la preuve en est alors la conséquence [81].
Ce résultat reste inchangé, même en appliquant l’alternative légitime procédurale. La production forcée de la preuve ne peut être prétexte à l’organisation d’une perquisition privée [82], précisément parce que cela porterait atteinte au droit au respect de la vie privée (Const., art. 22 N° Lexbase : L0848AHU et CEDH, art. 8 N° Lexbase : L4798AQR) [83]. « À circonstances factuelles inchangées » signifie ici que la production ne peut pas être ordonnée dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles la collecte illégale de preuves a eu lieu, précisément parce que la production doit être fondée sur le respect du contradictoire et les droits fondamentaux. Ordonner une telle production serait en même temps en contradiction avec l’objectif de la règle violée : le respect de la vie privée de l’époux. Admettre une telle preuve par le biais de l’alternative légitime procédurale irait donc à l’encontre de l’objectif que l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la CEDH cherchent à défendre.
L’application du premier critère anno 2021 (avec différenciation en fonction de la nature et du contenu de la norme prétendument violée) aboutit ainsi en la disqualification de la preuve obtenue de façon illicite. Les autres critères ne sont pas abordés dans l’arrêt d’Anvers, mais en tout état de cause, l’existence d’une nécessité de la preuve ne doit pas être prise à la légère. Tel que la cour d’appel l’établit correctement, le droit à la curiosité s’arrêta lorsque l’autorisation d’habitation entra en vigueur [84]. L’appréciation du comportement procédural de l’époux contre qui la preuve est invoquée ne peut pas non plus, à mon avis, aboutir à la preuve de l’existence de l’adultère. L’appréciation de la charge de la preuve motivée se fait, comme indiqué (v. supra, n° 11), avec prise en compte de la répartition du risque de la preuve, et celle-ci incombe bien à l’époux qui invoque la faute grave. En d’autres termes, il n’appartient pas au juge d’essayer de toutes ses forces de déclarer prouvé ce qui est avancé par une partie au moyen de preuves manifestement obtenues de manière illégale. À un certain moment, le juge doit décider et les parties doivent l’accepter : final, not infallible [85].
III. Conclusion
Après de nombreux détours, la doctrine du sort de la preuve illicite dans les affaires civiles est aujourd’hui en train de s’éclaircir. La jurisprudence belge devra utiliser les critères fournis par la Cour de cassation anno 2021 et éviter une approche du « tout ou rien ». L’approche du « tout », impliquant que le juge doit toujours pouvoir prendre en compte ce qui se rapproche le plus de la vérité factuelle, est en contradiction avec ce qui a été exposé plus haut. L’approche du « rien », selon laquelle l’obtention illégale de preuves aboutit toujours à l’exclusion de preuves, ne peut pas non plus être retenue depuis les arrêts de la Cour de cassation anno 2021. J’ai défendu ailleurs l’idée que la relation juridique entre citoyens ne justifiait pas et ne nécessitait pas un changement de perspective inspiré d’Antigone, maintenant qu’elle se faisait au détriment du respect du droit substantiel. La procédure civile bénéficiait selon moi plutôt d’un élargissement de la perspective : non pas le choix entre le droit matériel et procédural, mais celui pour le droit matériel et procédural offre la solution [86]. Il semble que la Cour de cassation ait répondu à cet appel. La norme de jugement que montre la Cour de cassation anno 2021 rappelle les critères de la fiabilité et du procès équitable, mais surpasse largement cette approche. La Cour construit ainsi un barrage protégeant du dérapage auquel la simple appréciation à la lumière du procès équitable donnerait lieu et garantit ainsi que la rule of law maintienne le dessus sur la rule of men [87].
[1] Genèse, 3:1-7.
[2] Cass., 10 décembre 1923, Pas., 1924, I, 66, concl. P. Leclercq.
[3] Cass., 14 octobre 2003, Arr. Cass., 2003, 1862, concl. M. De Swaef.
[4] Cass., 14 octobre 2003, Arr. Cass., 2003, 1862, concl. M. De Swaef.
[5] Cass., 10 mars 2008, Arr. Cass., 2008, 678.
[6] Cass., 22 mai 2015, Arr. Cass., 2015, 1349.
[7] E. Dirix, De vruchten van de giftige boom, in Liber amicorum Jo Stevens, Bruges, die Keure, 2011, (263) 270.
[8] J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs, Anvers, Intersentia, 2020, 137.
[9] J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs, Anvers, Intersentia, 2020, 44, n° 22 et seq.
[10] Sous prétexte de ne pas vouloir interférer avec le droit formel de la preuve (v. Exposé des motifs relatif au projet de loi portant insertion du Livre 8 « La preuve » dans le nouveau Code civil, Doc., Ch., 2018-19, n° 54-3349/001, 10).
[11] Y.S. Van Der Sype, Naar een geïntegreerde privacybescherming in de onderneming, Malines, Wolters Kluwer, 2017, 204.
[12] Cass., 14 juin 2021, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.2, AR C.20.0418.N, [en ligne], RW, 2021-22, 1108. L’arrêt fut prononcé par une chambre composée de trois conseillers, ce qui est normalement réservé aux affaires dont la solution paraît s’imposer ou n’appelle pas une décision dans l’intérêt de l’unité ou du développement du droit (v. C. jud., art. 1105 bis).
[13] Cass., 16 décembre 2021, ECLI :BE :CASS :2021 :ARR.20211216.1N.8, AR C.18.0314.N, [en ligne], RW, 2021-22, 1105. V. aussi la discussion approfondie de l’arrêt sous le titre « d’arrêts de principe » dans le Rapport annuel de la Cour de cassation de 2021 (Rapport annuel, 2021, 107 e.s.).
[14] Le dernier alinéa de l’article 301, § 10 de l’ancien Code civil dispose que : « Le juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne. »
[15] D. Mougenot, Utilisation des preuves irrégulières en justice : Antigone se met en tenue civile, JT, 2021, (537) 540, n° 8 : « Cet arrêt [l’on parle ici de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2021, JVD] clôture une longue attente » ; M. Schelkens, Cassatie hakt knopen door over onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken (note sous Cass., 14 juin 2021), TBH, 2021, (2032) 2041, n° 20 ; M. Schouteden, Antigoon in een nieuw, burgerrechtelijk jasje: klaar voor de catwalk?, TBBR, 2022, (251) 274, n° 40. J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs in civiele zaken: dat geeft te denken, RW, 2021-22, (1090) 1097, n° 10 et 1104.
[16] Pour cette distinction, v. précédemment E. Dirix, De vruchten van de giftige boom, in Liber amicorum Jo Stevens, Bruges, die Keure, 2011, (263) 269 ; repris systématiquement dans J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs, Anvers, Intersentia, 2020, 2, n° 1.
[17] Ce dernier ajout couvre également l’hypothèse d’une preuve étant illicite par nature. Avancer une preuve qui est illicite par nature (la notion implique qu’un élément de preuve est affligé d’une caractéristique qui empêche son utilisation, par exemple la production d’une preuve soumise au secret professionnel, v. B. Cattoir, Burgerlijk bewijsrecht, in APR, Malines, Kluwer, 2013, n° 997) est également qualifié d’illicite.
[18] V. désormais expressément à cet effet l’article 8.1, 13° du Livre 8 « La preuve » du Code civil : « Admissibilité : la conformité de la preuve avec les règles du présent livre, qui précisent à quelles conditions un mode de preuve [la preuve, ndlr] peut constituer la preuve d’un fait contesté » (loi du 13 avril 2019, portant création d’un Code civil et y insérant le Livre 8 « La preuve », MB, 14 mai 2019, entrée en vigueur le 1er novembre 2020). Les travaux préparatoires confirment que « Le concept d’admissibilité d’une preuve ne vise que la conformité d’un élément de preuve aux règles relatives à la preuve au sens strict et laisse de côté la problématique de la preuve déloyale ou contraire à une règle de droit étrangère à la preuve » (v. Exposé des motifs du projet de loi portant insertion du Livre 8 « La Preuve » dans le nouveau Code civil, Doc., Ch., 2018-19, n° 54-3349/001, 10).
[19] L’illustration démontre par le même effet que la notion du droit de la preuve formel, qui se situe traditionnellement dans le Code judiciaire, n’est pas dépourvue de toute importance (v. à ce sujet J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs, Anvers, Intersentia, 2020, 157, note de bas de page 577).
[20] Par analogie avec le principe général de droit du devoir du juge, l’obligeant à trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et à examiner la nature juridique des faits et actes invoqués par les parties. Ne pas prendre en considération d’autres faits que ceux qui sont invoqués et contestés, respecter l’avantage dans son avancement de fait, respecter l’accord des parties qui n’entrave pas à l’ordre public, tout en respectant les droits de la défense ; ce sont les limites du rôle du juge lors de l’application du droit aux faits (v. Cass., 14 avril 2005, Arr. Cass., 2005, 868, concl. P. De Koster, JT, 2005, 659, note J. Van Compernolle, err. JT, 2005, 796, JLMB 2005, 856, note G. De Leval, Pas., 2005, 862, concl. P. De Koster, RABG, 2005, 1663, note R. Verbeke), qui annule les considérations suivantes : « Attendu que l’arrêt relève que la demanderesse n’invoque pas la responsabilité contractuelle de la défenderesse mais seulement sa responsabilité quasi-délictuelle et décide qu’il ne peut, dès lors, examiner si la défenderesse n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, sur la base des faits que la demanderesse invoquait à l’appui de sa demande, la responsabilité contractuelle de la défenderesse n’était pas engagée, l’arrêt n’a pas justifié légalement sa décision » ; (plus) récemment Cass., 28 juin 2018, AR C.17.0696.N, concl. C. Vandewal, RW, 2018-19, 1260, note ; Cass., 4 juin 2020 AR C.19.0079.N ; à ce sujet B. Wylleman, De verplichting van de burgerlijke rechter om ambtshalve rechtsgronden op te werpen, in Hof van Cassatie, Jv.Cass. 2017, (172) 174 ; plus loin J.-F. Van Drooghenbroeck, L’office juridictionnel du juge belge, in C. Chainais, B. Hess, A. Saletti et J.-F. Van Drooghenbroeck (réd.), L’office du juge. Études de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2018, 43 et seq. ; W. Van Eeckhoutte, Schuifelen op de rechterstoel. De taak van de rechter in het Belgisch privaatrechtelijk procesrecht: een kwestie van moeten of mogen, in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIE EN NEDERLAND (réd.), Preadviezen, 2015, La Haye, Boom Juridische uitgevers, 2015, 251 et seq. ; J. Van Doninck, Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden: een tour d’horizon, in Liber amicorum Johan Erauw, Anvers, Intersentia, 2014, 229 et seq. ; précédemment B. Allemeersch, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Anvers, Intersentia, 2007, Volume III, chapitres 3 et suivants, 177 et seq.
[21] Rapport annuel 2021, 112 : « Par ailleurs, il convient de faire remarquer qu’à l’instar du contrôle pénal, le contrôle civil suppose une simple option32 (et donc pas une obligation) d’écarter la preuve dans l’appréciation des critères « atteinte à la fiabilité » et « mise en péril du droit à un procès équitable ». Le Rapport renvoie à la note infrapaginale 32 en indiquant ce qui suit : « Voir le considérant : "l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière civile ne peut être écartée que si son obtention entache sa fiabilité ou si elle compromet le droit à un procès équitable" (soulignement et gras ajoutés). » Il semble être question ici d’une erreur de raisonnement du type « foutieve disjunctie » [« disjonction fautive »] (comp. F. Peeraer, Juridisch argumenteren, Oud-Turnhout, Gompel&Svacina, 2019, 239, n° 371)
[22] Comp. en matière pénale Cass., 8 novembre 2005, Arr. Cass., 2005, 2175 ; Cass., 4 décembre 2007, Arr. Cass., 2007, 2388, Pas. 2007, 2226, RW, 2008-09, 110, note B. De Smet, T.Strafr., 2008, 274.
[23] P. Traest, Actualia bewijs in strafzaken, in DIENST PERMANENTE VORMING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (ed.), Bewijsrecht, Gand, Larcier, 2014, (129) 147-148.
[24] Cass., 26 novembre 2008, Arr. Cass., 2008, 2730, JT, 2008, 741, concl. D. Vandermeersch, Pas., 2008, 2673, concl. D. Vandermeersch, RW, 2010-11, 450, note. Il s’agissait d’une affaire dans laquelle le juge avait pris en considération la preuve provenant d’un éthylomètre (concentration d’alcool dans l’air alvéolaire expiré) qui n’était pas contrôlé par l’Institut belge pour la sécurité routière.
[25] V. la paraphrase ultérieure de ce jugement par D. Vandermeersch dans ses conclusions sous l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2014, AR P.14.0186.F, Arr. Cass., 2014, 1194, [en ligne]: « Dans certaines matières où la loi règle spécialement l’administration de la preuve, la Cour considérait [...] que là où la loi a fixé des conditions ou des formalités strictes que l’on pouvait considérer comme substantielles dès lors qu’elles étaient édictées pour garantir la qualité intrinsèque de la preuve, le test "Antigoon" ne s’appliquait pas lorsque l’irrégularité résultait du non-respect de ces règles » ; P. Traest, Het bewijs in het wegverkeerrecht en Antigoon, in P. Lecocq e M. Dambre (réd.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2012, Bruges, die Keure, 2012, (191) 201 et seq.; C. De Roy, Kroniek wegverkeersrecht 2010-2013: overzicht van de belangrijkste evoluties in wetgeving en rechtspraak, RW, 2013-14, (1323) 1324, n° 9 ; P. Traest, Actualia bewijs in strafzaken, in DIENST PERMANENTE VORMING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (réd.), Bewijsrecht, Gand, Larcier, 2014, (129) 149 ; J. De Codt, La nouvelle loi sur les nullités : un texte inutile ?, Rev.dr.pén., 2014, (245) 262-263 ; T. Decaigny, De stille evolutie inzake de uitsluiting van onbetrouwbaar bewijs, T.Strafr., 2015, (167) 170, n° 8. Pour un aperçu de la jurisprudence d’Antigone précédente relative à la circulation routière v. B. Devos et C. Bleret, La jurisprudence Antigone en matière de roulage, in R. Alvarez Campa (réd.) Circulation routière et responsabilité, Limal, Anthemis, 2012, (7) 26-44.
[26] Comp. Cass., 12 mars 2014, Arr. Cass., 2014, 752, Pas., 2014, 702 : « Pour déchoir de sa valeur probante légale une preuve réglée spécialement par la loi, le juge doit constater qu’elle a été rapportée en violation d’une disposition qui en garantit la qualité intrinsèque ; la loi ne subordonne pas ladite valeur probante au visa exact et complet de la réglementation applicable » et Cass., 26 mai 2015, Arr.Cass., 2015, 1383, Pas., 2015, 1361, T.Strafr., 2015, 263, note T. Decaigny, RW, 2016-17, 1419, note S. Van Overbeke : « En ce qui concerne le critère de la fiabilité de la preuve, le juge ne peut écarter un élément de preuve que s’il constate que l’irrégularité a effectivement porté atteinte à la fiabilité de la preuve. »
[27] F. Dumon, De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes, JT, 1978, (485) 486-487, n° 35. Également décrit ailleurs comme « l’aptitude des éléments recueillis de la sorte à persuader le juge de la vérité d’un fait » (v. Cass., 31 octobre 2012, Arr. Cass., 2012, 2385).
[28] J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs, Anvers, Intersentia, 2020, 44, n° 22 et seq.
[29] J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs, Anvers, Intersentia, 2020, 151 et seq.
[30] S. Guinchard, Une vision renouvelée de leurs relations dans l’émergence d’un droit processuel humaniste, in S. Amrani-Mekki (réd.), Procédure civile et procédure pénale. Unité et diversité ?, Bruxelles, Bruylant, 2014, (27) 28 ; comp. M. Kremer, Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 193 : « de bewering dat zulke handelingen nietig zijn, ziet daaraan volstrekt voorbij » [« l’affirmation selon laquelle ces actes sont nuls ne tient aucunement compte de cela »].
[31] Comp. E. Maes, Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken in België en Duitsland, RW, 2014-15, (682) 700, n° 45 ; B. Allemeersch, Controversiële bewijzen in handelszaken, in B. Tilleman en E. Terryn (réd.), Handels- en Economisch Recht, Deel 1, Ondernemingsrecht, Volume A, Ter gelegenheid van het emeritaat van Professor dr. Gabriël Luc Ballon, Malines, Kluwer, 2011, 663, n° 806 : « Het is inderdaad zo dat de limitatief omschreven gevallen waarin luidens deze formule wering mogelijk is, zich in burgerlijke of handelszaken zelden zullen voordoen, waardoor het leerstuk van het ongeoorloofd bewijs zo goed als helemaal ontmanteld wordt » (« En effet, les cas limitatifs dans lesquels, selon cette formule, l’exclusion est possible, se produiront rarement en matière civile ou commerciale, ce qui démantèle virtuellement la doctrine de la preuve déloyale. »
[32] L. Cadiet, Efficience versus équité, in Mélanges Jacques van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, (25) 40 : « Les exigences du procès équitable ne sont pas un idéal, mais un minimum. »
[33] Comp. M. Mekki, Preuve et vérité en France, in Travaux de l’association Henri Capitant, La preuve, Journées Pays-Bas/Belgique, t. LXIII, Bruxelles, Bruylant, 2013, (815) 846, n° 47-48, où il discute du « juge éclairé par le respect d’un débat contradictoire » en tant que seul critère.
[34] Cass., 14 juin 2021, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.2, AR C.20.0418.N, [en ligne], RW, 2021-22, 1108, moyen 2 ; Cass., 16 décembre 2021, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211216.1N.8, AR C.18.0314.N, RW, 2021-22, 1105, moyen 1.
[35] M. Schouteden, Antigoon in een nieuw, burgerrechtelijk jasje: klaar voor de catwalk?, TBBR, 2022, (251) 266, n° 31.
[36] Rapport annuel, 2021, 111: « Enfin, le contrôle civil, tout comme le contrôle pénal, doit également être précisé au moyen d’une série de sous-critères spécifiques adaptés au droit civil. »
[37] Comp. en matière civile Cass., 5 mai 2020, AR P.19.1272.N, ECLI :BE :CASS :2020 :ARR.20200505.2N.1, [en ligne], moyen 5 : « Le juge apprécie souverainement sur la base des éléments de la cause si, en raison de l’irrégularité commise, l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. Il peut notamment tenir compte dans son appréciation d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes : l’irrégularité a été commise de manière intentionnelle ou non ou en raison d’une négligence inexcusable ; la gravité de l’infraction dépasse de manière importante la gravité de l’irrégularité ; l’irrégularité concerne uniquement un élément matériel de l’infraction ; l’irrégularité a un caractère purement formel ; l’irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée. »
[38] Comp. à nouveau Cass., 5 mai 2020, AR P.19.1272.N, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200505.2N.1, [en ligne], moyen 5 : « Le juge apprécie souverainement sur la base des éléments de la cause si, en raison de l’irrégularité commise, l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. Il peut notamment tenir compte dans son appréciation d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes : l’irrégularité a été commise de manière intentionnelle ou non ou en raison d’une négligence inexcusable ; la gravité de l’infraction dépasse de manière importante la gravité de l’irrégularité ; l’irrégularité concerne uniquement un élément matériel de l’infraction ; l’irrégularité a un caractère purement formel ; l’irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée », je souligne. Ce même arrêt met en outre en évidence les situations auxquelles cette approche « facultative » de la Cour peut donner lieu, comme la Cour se voit obligée d’indiquer dans le moyen 6 que : « Si le juge ne doit pas nécessairement tenir compte d’une ou de plusieurs de ces circonstances lorsqu’il apprécie le caractère équitable du procès, la seule circonstance que l’irrégularité n’empêche pas le prévenu de contredire la preuve ou son obtention ne suffit pas pour considérer que l’usage de la preuve obtenue irrégulièrement n’est pas contraire au droit à un procès équitable. »
[39] Cass., 14 juin 2021, C.20.0418.N, ECLI :BE :CASS :2021 :ARR.20210614.3N.2, [en ligne], RW, 2021-22, 1108, moyen 2 ; Cass., 16 décembre 2021, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211216.1N.8, AR C.18.0314.N, RW, 2021-22, 1105, moyen 1.
[40]Il est remarquable que le Rapport annuel contienne des références auprès des autres critères, mais passe ce premier critère sous silence (v. Rapport annuel, 2021, 111).
[41] T. Léonard, Conflits entre droits subjectifs, libertés civiles et intérêts légitimes, Bruxelles, Larcier, 2005.
[42] Sur cette question de qualification, v. J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs, Anvers, Intersentia, 2020, 164-176 et 238-242. Van Compernolle et Fettweis qualifient ma labellisation en droit substantiel de « relativement souple » (v. J. Van Compernolle et A.-L. Fettweis, Principes directeurs du procès civil, in G. De Leval réd.), Droit judiciaire – Tome 2 : Procédure civile – Volume 1, Bruxelles, Larcier, 2021 (21) 88). Cette caractérisation me semble incontestablement correcte, considérant le dénouement. En ce qui me concerne, la voie à suivre est conforme à ce que Leijten nomma « de topische rechtsvinding » [« l’examen juridique topique »], c’est-à-dire la réflexion sur le droit matériel en partant de l’affaire soumise à la décision (probleemdenken [réflexion en partant du problème]) (v. J.C.M. Leijten, Rechtspraak en topiek, in W. Van Gerven et J.C.M. Leijten, Theorie en praktijk van de rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, (63) 75). Je souligne.
[43] J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs, Anvers, Intersentia, 2020, 180, n° 122.
[44] M. Schouteden, Antigone sous une nouvelle forme de droit civil : prêt pour le défilé ?, TBBR, 2022, (251) 267-271.
[45] M. Schouteden, Antigoon in een nieuw, burgerrechtelijk jasje: klaar voor de catwalk?, TBBR, 2022, (251) 272, n° 47 : « De lijn tussen de geoorloofdheidsbeoordeling en de weringstoets is soms flinterdun » [La distinction entre l’évaluation de l’admissibilité et le critère d’exclusion est parfois très délicate].
[46] M. Schouteden, Antigone sous une nouvelle forme de droit civil : prêt pour le défilé ?, TBBR, 2022, (251) 266, n° 31.
[47] Y.S. Van Der Sype, Naar een geïntegreerde privacybescherming in de onderneming, Malines, Wolters Kluwer, 2017, 204.
[48] J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs, Anvers, Intersentia, 2020, 205 et seq. (sur la détermination de la vérité) respectivement 231 et seq. (sur l’équilibrage des intérêts) ; J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs: een grondslagenonderzoek, RW, 2020-21, (1283) 1299-1302.
[49] Le danger de cette approche est démontré de manière adéquate dans la réflexion suivante de Stalev, lorsqu’il indiqua l’importance de la recherche de la vérité dans le cadre du droit procédural civil dans les anciens États socialistes d’Europe de l’Est : « If the illegally obtained evidence does not correspond to the truth, the party can object to it » (v. Z. Stalev, Fundamental guarantees of litigants in civil proceedings: a survey of the laws of the European people’s democracies, in M. Cappelletti et D. Tallon (réd.), Fundamental guarantees of the parties in civil litigation. Studies in National, International and Comparative Law prepared at the request of Unesco under the auspices of the International Association of Legal Science, Milan, Giuffrè, 1973, (355) 414. La recherche de la vérité dans les anciens États socialistes est l’argument par excellence pour l’admission de la preuve obtenue illégalement (v. M. Kremer, Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 170 ; G.A. Micheli et M. Taruffo, Evidence in the procedure, in M. Storme et H. Casman (réd.), Towards a Justice with a human face. The first international congress on the law of civil procedure, Anvers, Kluwer, 1978, (123) 125.
[50] J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs, Anvers, Intersentia, 2020, 163, n° 108. J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs: een grondslagenonderzoek, RW, 2020-21, (1283) 1294. Pour un excellent résumé v. J. Van Compernolle et A.-L. Fettweis, Principes directeurs du procès civil, in G. De Leval (réd.), Droit judiciaire – Tome 2: Procédure civile – Volume 1, Bruxelles, Larcier, 2021 (21) 88.
[51] K. Crauwels, Onrechtmatig bewijs… Of wat ervan overblijft? De invloed van de Antigoonrechtspraak op het onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken, in M. Faure et W. Rauws (réd.), Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem, Anvers, Intersentia, 2009, (169) 182 ; F. Kefer, Antigone et Manon s’invitent en droit social. Quelques propos sur la légalité de la preuve (note sous Cass., 10 mars 2008), RCJB, 2009, (333) 350, n° 22 ; K. Wagner, Actualia burgerlijk bewijsrecht, P&B 2009, (153) 167, n° 46 ; B. Cattoir, Burgerlijk bewijsrecht in APR, Malines, Kluwer, 2013, 570, n° 1047 ; Dirix mentionne également le critère, De vruchten van de giftige boom, in Liber amicorum Jo Stevens, Bruges, die Keure, 2011, (263) 271, tel qu’indiqué lors du renvoie à Haardt (v. W.L. Haardt, Bewijs en balans. Afweging van belangen in het nieuwe bewijsrecht, in het bijzonder bij “onrechtmatig verkregen bewijs”, in Vorm en wezen. Opstellen aangeboden aan W.H. HEEMSKERK, Utrecht, Uitgeverij Lemma, 1992, (81) 95-96).
[52] Comp. T. Léonard et K. Rosier, La jurisprudence « Antigoon » face à la protection des données : salvatrice ou dangereuse ?, RDTI, 2009, (5) 9, in fine.
[53] V. concl. J. Spier à la Cour suprême (Hoge Raad, NL) le 27 avril 2001, nr. C99/318HR, ECLI :NL :PHR :2001 :AB1347, [en ligne], nr. 3.34 ; comp. M. Kremer, Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 57.
[54] Le lien avec la problématique de la preuve illicite fut exposé de façon la plus prononcée par B. Allemeersch, Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het bewijs in rechte, in P. Van Orshoven (réd.), Gerechtelijk Recht. Themis school voor postacademische vorming. Academiejaar 2010-2011, nr. 59, Bruges, die Keure, 2010, (35) 53, n° 29 ; et B. Cattoir, Burgerlijk bewijsrecht, in APR, Malines, Kluwer, 2013, 567, n° 1042 ainsi que les renvois ; avec caution : D. Mougenot, La preuve, in Rép. Not., Bruxelles, Larcier, 2012, 96 ; D. Mougenot, Le droit à la preuve (note sous Anvers 11 février 2015), P&B, 2015, (64) 66, n° 5 ; D. Mougenot, Antigone au milieu du gué, in C. Delforge (réd.), La preuve en droit privé : quelques questions spéciales, Bruxelles, Larcier, 2017, (127) 157, n° 25.
[58] J.-P. Gridel, Respect de la vie privée et droit de la preuve devant le juge civil, Cour de cassation – Bulletin d’information, 2015, nr. 826, (5) 7 ; Cour de cassation, Rapport Annuel 2012. La preuve dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Paris, Direction de l’information légale et administrative, 2013, 329.
[59] CEDH, N.N. et T.A. c. Belgique, 2008, attendu 46 et encore attendu 47 : « les ingérences qui en découlent inévitablement » [en ligne].
[60] G. Goubeaux, Le droit à la preuve, in C. Perelman et P. Foriers (réd.), La preuve en droit – travaux du centre national de recherches de logique, Bruxelles, Bruylant, 1981, (277) 298-299, n° 29 ; M. Kremer, Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken, Deventer, Tjeenk Willink, 1999, 134 ; M. Kremer, Noot bij bewijsnood, in Amice, Opstellen aangeboden aan prof.mr. G.R. Rutgers (Rutgers-bundel), Deventer, Kluwer, 2005, (197) 204.
[61] Pour cette notion formulée récente de « limitation déraisonnable », v. Cass., 26 octobre 2017, AR C.14.0457.N, ECLI :BE :CASS :2017 :ARR.20171026.5, [en ligne], RW, 2018-19, 185 : « Le droit à un procès équitable comprend notamment les droits de la défense et implique notamment que l’administration de la preuve ne peut être entravée de manière déraisonnable. Les droits de la défense impliquent également le droit à l’assistance d’un avocat, ce qui entraîne la confidentialité de la correspondance. Il s’ensuit que le droit à l’administration de la preuve peut être limité par la confidentialité de certaines correspondances. Le moyen, qui, en cette branche, sans prendre en considération la limitation résultant de la confidentialité de certaines correspondances, suppose que les juges d’appel ne pouvaient légalement rejeter la demande de production de documents sans violer le droit à un procès équitable ainsi que les droits de la défense, ne peut être accueilli. »
[62] Cass. civ. (FR) 5 avril 2012, n° 11-14.177, F-P+B+I N° Lexbase : A1166IIZ. Dans une affaire de succession, le fils-héritier, en sa qualité d’administrateur de la succession, avait retrouvé un échange de lettres entre ses parents décédés, sa sœur et son beau-frère, qui, selon lui, constituait la preuve de donations déguisées. Son rejet entre en conflit avec le njet de la Cour de cassation : « Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Je souligne cette terminologie cruciale, comp. Cour de cassation, Rapport Annuel 2012. La preuve dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Paris, Direction de l’information légale et administrative, 2013, 329-330 (« l’exigence du "seul moyen" ») ; N. Fricero, La recevabilité des preuves « déloyales » en matière civile, Procédures, 2015, n° 12, (32) 33, n° 9 : « La preuve déloyale doit être “indispensable”. La déloyauté n’est admise qu’à titre subsidiaire, et seulement si le plaideur est dans l’impossibilité de rapporter une preuve en respectant la loi. » La Bundesgerichthof allemande reconnaît également la possibilité d’invoquer la nécessité de la preuve (v. Bundesgerichtshof (DE) 15 mai 2018, n° VI ZR 233/17, [en ligne], attendus 30, 34 et 37, jugement axé sur la difficulté de la preuve lors d’un accident de la route qui manque d’autres éléments de preuve : « Ein solcher Beweisnotstand gehe über das schlichte Beweisinteresse hinaus. Es sei mit einer rechtsstaatlichen Prozessleitung nicht vereinbar, dem Beweispflichtigen die Verwertung einer vorhandenen Video-Aufzeichnung zu versagen, mit der er die Unwahrheit der gegnerischen Unfalldarstellung oder die Identität des geflohenen Unfallgegners belegen könne. »
[63] J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs, Anvers, Intersentia, 2020, 255 et seq.
[64] Cass., 14 novembre 2013, Arr. Cass., 2013, (2401) 2406, moyen 7.
[65] L’article 8.4, alinéa 3 du Livre 8 « La Preuve » du Code civil, dispose que : « Toutes les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve » (introduit par l’article 3 de la loi du 13 avril 2019, loi portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8 « La Preuve », MB, 14 mai 2019).
[66] Aux Pays-Bas, ce raisonnement fut introduit à la Cour Suprême (Hoge Raad NL) 18 décembre 1925, NJ, 1926, 228, note E.M. Meijers ; comp. en Belgique Cass., 18 janvier 2007, Res Jur.Imm., 2007, 27 : un entrepreneur est tenu responsable par la Région Wallonne pour le non-respect de l’obligation de sécurité repris dans le cahier des charges de dragage. Selon la Cour de cassation, en reprochant à cet entrepreneur de ne pas avoir prouvé qu’il avait pris des mesures pour assurer la sécurité des bateliers, malgré la présence de rochers, le juge n’attribue pas illégalement la charge de la preuve au détriment de l’entrepreneur : « L’arrêt ne dispense pas la première défenderesse [la Région Wallonne] de démontrer que la seconde défenderesse [le contractant] n’a pas pris toutes les mesures de sécurité utiles et n’impose pas davantage à la seconde défenderesse de prouver qu’elle avait pris de telles mesures. Il détermine seulement la mesure dans laquelle cette partie, tenue à un devoir de collaboration à l’administration de la preuve, devait s’expliquer sur ce qu’elle avait fait pour prévenir la survenance du dommage. » Je souligne.
[67] Hoge Raad (NL) 4 avril 2014, n° 13/02846, ECLI:NL:HR:2014:831, [en ligne], attendu 3.6.3 ; un exposé approfondi à ce sujet : B.M. Paijmans, De verzwaarde stelplicht revisited, NTBR, 2016, afl. 1, (4) 11 et seq., particulièrement 13, n° 6 in fine ; I. Giesen, Aansprakelijkheid van de (letselschade)advocaat voor informatieverzuimen: het bewijs van de zorgplichtschending en de (ontbrekende) eigen schuld van de cliënt, TvP, 2016, (35) 38-39, n° 2.4 ; W.D.H. Asser, Bewijs in Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht Procesrecht, 3e partie, Deventer, Kluwer, 2017, 399, n° 309.
[68] B.M. Paijmans, De verzwaarde stelplicht revisited, NTBR, 2016, afl. 1, (4) 13, n° 6 in fine.
[69] L’article 8.4, alinéa 5 du Livre 8 « La Preuve » du Code civil stipule ce qui suit en ce qui concerne le renversement des preuves : « Le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l’application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s’il a ordonné toutes les mesures d’instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l’administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante » (introduit par l’article 3 de la loi du 13 avril 2019, loi portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve », MB, 14 mai 2019). Les travaux préparatoires confirment que le renversement de la preuve peut également servir de moyen de sanction en cas de non-respect de la coopération à la preuve (v. Exposé des motifs relatif au projet de loi insérant le Livre 8 « La Preuve » dans le nouveau Code civil, Doc., Ch., 2018-19, n° 54-3349/001, 15 et l’exposé de Dr. Vandenbussche pendant l’audience du 20 novembre 2018, ajouté en tant que pièce jointe au Rapport fait au nom de la commission de la justice par M. Gautier Calomné et Mme Özlem Özen portant insertion du Livre 8 « La preuve » dans le nouveau Code civil, Doc., Ch., 2018-19, n° 54-3349/005, 36). En tant qu’« ultimum remedium » (v. Exposé des motifs de la loi portant insertion du Livre 8 « La Preuve » dans le nouveau Code civil, Doc., Ch., 2018-19, n° 54-3349/001, 14). L’ajout trouve son explication dans les commentaires critiques du Conseil d’État à cet égard (v. avis n° 63.445/2, du 27 juin 2018, Doc., Ch., 2018-19, n° 54-3349/001, 84). À ce sujet, voyez également l’exposé de Dr. Vandenbussche pendant l’audience du 20 novembre 2018, ajouté en tant que pièce jointe au Rapport fait au nom de la commission de la justice par M. Gautier Calomné et Mme Özlem Özen portant insertion du Livre 8 « La preuve » dans le nouveau Code civil, Doc., Ch., 2018-19, n° 54-3349/005, 35).
[70] J. H. Nieuwenhuis, Brief aan een jonge academisch gevormde vrouw, Zutphen, Paris, 2009 : « In het burgerlijk recht valt heel wat af te wegen: belangen, kansen, rechten. Zij vergen elk een eigen weegkunst » [« En droit civil, beaucoup de choses doivent être mises en balance : intérêts, opportunités, droits. Chaque élément exige un art de mise en balance particulier »].
[71] Pour cette formulation, v. Cass., 12 juin 2017, AR C.16.0428N, [en ligne], RW, 2018-19, 381, note ; Cass., 28 juin 2018, AR C.17.0696.N, [en ligne], concl. C. Vandewal avec les références qui y figurent, RW, 2018-19, 1260, note.
[72] R. Jafferali, L’alternative légitime dans l’appréciation du lien causal. Corps étranger en droit belge de la responsabilité ?, in F. Glansdorff (réd.), Droit de la responsabilité. Questions choisies, Bruxelles, Larcier, 2015, (97) 133-134, n° 25-26.
[73] C. jud., art. 882 : « La partie ou le tiers qui s’abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu’il appartiendra. »
[74] Cass., 30 octobre 1978, Arr. Cass,. 1978-79, 235; Cass., 29 octobre 1991, Arr. Cass., 1991-92, 197.
[75] Rapport de M. Charles Van Reepinghen, Commissaire royal à la réforme judiciaire, sur le projet de loi introduisant le Code judiciaire, Sénat, Doc.Parl., 1963-64, n° 60, 214 in fine.
[76] Dans ce sens, Kaissis établissait : « Die aufgezeigten Konkretisierungsprobleme bringen zwar Unsicherheit mit sich, lassen sich aber in casu bewältigen » (v. A. Kaissis, Die Verwertbarkeit materiell-rechtswidrig erlangter Beweismittel im Zivilprozeß, Europäische Hochschulschrift en, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1978, 174).
[77] C.E. Smith, Belangenafweging door gevalsafweging, RM Themis, 2006, (141) 145.
[78] Comp. M. Schouteden, Antigoon in een nieuw, burgerrechtelijk jasje: klaar voor de catwalk?, TBBR, 2022, (251) 266, n° 33, in fine, où elle évoque que les critères qu’elle qualifie d’exceptionnels doivent être évalués en corrélation.
[79] Exemple fondé sur Anvers 21 april 2010, T.Fam., 2011, 223, note C. Van Roy, NJW, 2012, 426, note C. Declerck, voyez également au sujet de cet arrêt G. Verschelden, S. Brouwers, K. Boone, L. Pluym, W. Segers et B. Vinck, Familierecht: overzicht van rechtspraak (2007-2011), TPR, 2012, (1507) 1973, n° 863.
[80] V. C. Declerck, Briefgeheim tussen echtgenoten (note sous Anvers 21 april 2010), NJW, 2012, 428.
[81] Anvers 21 avril 2010, T.Fam., 2011, (223) 225.
[82] D. Mougenot, Mesures d’instruction en matière civile, in RPDB, Bruxelles, Larcier, 2016, 26, n° 14 ; Rapport de M. C. Van Reepinghen, commissaire royal à la réforme juridique, Projet de loi contenant le Code judiciaire, Doc. Parl., Sénat, 1963-64, n° 60, 213.
[83] Sur cette dimension de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la CEDH en tant que « droit à la vie privée », J. Velaers, De Grondwet – Een artikelsgewijze commentaar. Deel I – Het federale België, het grondgebied, de grondrechten, Bruges, die Keure, 2019, 392, n° 19.
[84] Anvers 21 avril 2010, T.Fam., 2011, (223) 225.
[85] H.L.A. Hart, The Concept of Law. Second edition, Oxford, Oxford University Press, 1994, 144.
[86] J. Van Doninck, Het lot van onrechtmatig bewijs, Anvers, Intersentia, 2020, 314.
[87] R. Foque, De rechter is het sprekende recht, in F. Evers et P. Lefranc, Kiezen tussen recht en rechtvaardigheid, Bruges, die Keure, 2009, 89.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485769
[Questions à...] Un déjeuner avec Me Anne-Laure Casado : la loyauté de la preuve en droit de la famille
Lecture: 5 min
N6018BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sylvian Dorol, Commissaire de justice associé, Directeur scientifique de la revue Lexbase Contentieux et recouvrement, Expert près l’UIHJ
Le 29 Juin 2023

Anne-Laure exerce exclusivement en droit de la famille, dont elle traite de l’ensemble des domaines.
Membre du Conseil de l’Ordre (2019 - 2021), secrétaire de l’Institut du droit de la famille et du patrimoine (IDFP), formatrice en droit de la famille à l’École de formation du barreau de Paris (EFB), auteur d’articles pour des revues spécialisées en droit de la famille, Présidente de l’Union des Jeunes Avocats de Paris, Anne-Laure est donc une référence dans son domaine.
Même si Anne-Laure et moi avons effectué toutes nos études ensemble, nous n’avions jamais échangé plus que ça. Est-ce la faute de la taille des amphithéâtres de la rue d’Assas et du Panthéon ? Je ne peux toujours pas le dire, mais l’essentiel est que nous avons enfin pu prendre un peu de temps autour d’une table pour parler de la question de la loyauté de la preuve en matière familiale.
C’est un sujet qui me tient à cœur puisque, si nos professions se côtoient quotidiennement, nous avons rarement l’occasion d’échanger en profondeur sur une thématique juridique commune…
Avant même de commander l’entrée (crudo de bar me concernant), j’assaille Anne-Laure de questions. Celle qui m’intéresse le plus est de savoir comment un avocat spécialisé en droit de la famille reçoit un dossier de contentieux, et quel est son regard sur les preuves fournies par le client.
À cette interrogation, Anne-Laure me déclare qu’en temps normal, elle préfère les écrits, de quelque nature que ce soit (courriel, SMS, documents…). Elle m’indique cependant que, concernant les SMS fournis par les clients, celui-ci ne maîtrise pas forcément son appareil et qu’il fournit des captures écran. Pressentant mon avis sur la question, elle me précise qu’elle éclaire le client sur la force probante de ce type de preuve et lui suggère donc de recourir au constat d’huissier de justice après avoir fait ensemble le point sur les éléments pertinents ou non.
Pourquoi le constat ? Pour la date certaine, l’intégrité de la preuve… Et le côté incontestable, m’avoue-t-elle. Elle me confie cependant que tous ses clients ne suivent pas ses conseils, même s’ils savent que tout document numérique est modifiable. Le principal motif réside en la volonté de limiter le fait d’exposer des frais sachant qu’ils sont dans des situations d’incertitude financière (ignorent le montant de la pension alimentaire, etc…). Mais, il faut savoir investir dans son divorce conclut-elle, un ton de regret dans la voix.
L’entrée se faisant attendre, nous poursuivons notre conversation devant nos verres d’eau pétillante. Certes nous avons évoqué la question des échanges écrits, mais qu’en est-il des SMS oraux, cette nouvelle forme d’oral écrit ? Sur ce point, dès qu’il est question de retranscription, Anne-Laure me répond « Pour moi, c’est directement constat d’huissier ».
Un léger bruit de marteau-piqueur se fait entendre, sans nous empêcher d’entamer nos entrées et de poursuivre l’échange.
J’entre donc dans le vif du sujet en lui demandant son sentiment au sujet des enregistrements audio-vidéo clandestins, effectués à l’insu de la partie adverse. Comme tout juriste, elle ne reste pas de glace et répond à l’interrogation. Mettant de côté le cas particulier des violences intra-familiales, où la preuve est très particulière, elle me rappelle d’abord que les magistrats écartent souvent ce type de preuve, notamment lorsque c’est un enfant qui est enregistré. Sachant que si un enfant veut être entendu, il peut l’être à la demande du juge…
Continuant son propos, elle précise que sa méfiance vis-à-vis des enregistrements s’explique par le fait qu’une vidéo ne représente pas forcément la réalité des faits puisqu’elle n’est que partielle.
L’entrée terminée, nous attendons le plat principal et Anne-Laure évoque la question du « snooping », terme désignant le fait d’espionner le smartphone de son conjoint à son insu… La question de la recevabilité de la preuve ainsi obtenue est très épineuse, comme dans le cas du conjoint qui a accès au compte cloud de l’autre… Le « snooping » pouvant être perçu comme violence, la question est plutôt de savoir comment prouver le « snooping »!
Prolongeant son discours, elle attire mon attention sur de nouvelles problématiques qu’elle rencontre en matière de preuve, et notamment l’espionnage par l’exploitation d’historique GPS, de smartphone.
Enfin, il ne m’était pas possible de terminer le déjeuner sans évoquer le fameux constat d’adultère. J’écoute Anne-Laure m’indiquer qu’elle n’a jamais eu à demander une telle mesure puisque le divorce pour faute n’est plus recherché par les parties, le litige se portant principalement sur des questions patrimoniales.
L’heure passant, nous n’avons pas le temps de prendre un dessert. Nous nous promettons de réparer cette erreur, ayant ensemble convenu que les avocats, notamment en droit de la famille, n’étaient souvent pas suffisamment familiarisés avec le contentieux de la preuve.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486018
[Brèves] Insaisissabilité de droit de la résidence principale : le débiteur doit rapporter la preuve que l’immeuble constitue sa résidence principale
Réf. : Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207, F-B N° Lexbase : A79979Z9
Lecture: 2 min
N5925BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 21 Juin 2023
► Il incombe au débiteur, qui se prévaut de l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale.
Faits et procédure. Les 22 juin puis 22 décembre 2017, une entrepreneuse individuelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication d'un bien immobilier situé dans le Val-d'Oise. La débitrice s'est opposée à la vente en soutenant qu'il s'agissait de sa résidence principale.
La cour d'appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 13 septembre 2021, n° 21/00088 N° Lexbase : A293644I) a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire. La débitrice a formé un pourvoi en cassation.
Décision. Il résulte de l'article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C, que la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumise à une procédure collective, peut opposer au liquidateur l'insaisissabilité des droits qu'elle détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale.
La Cour de cassation approuve alors l'arrêt d’appel d’avoir retenu exactement qu'il incombe à la débitrice de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale.
La cour d’appel avait alors constaté que l’entreprise était exploitée directement par elle dans le département de la Guadeloupe. Ainsi, selon la Haute juridiction, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ni violer le principe de la contradiction, dès lors que l'identité des débiteurs locataires de la taxe d'habitation de l'immeuble était expressément mentionnée par l'ordonnance dont la débitrice faisait appel, a légalement justifié sa décision.
En conséquence, la Cour rejette le pourvoi
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5684E7N. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485925
[Le point sur...] L’article 750-1 du Code de procédure civile ou le phénix de l’amiable préalable obligatoire – À propos du décret n° 2023-357, du 11 mai 2023
Réf. : Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile N° Lexbase : L6288MHD
Lecture: 26 min
N5723BZY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Corinne Bléry, Professeur de droit privé à l’Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes), Directrice du Master Justice, procès et procédures, Membre du conseil scientifique de Droit & Procédure
Le 13 Juin 2024
Mots-clés : CPC, art. 750-1 • amiable préalable • saisine du tribunal judiciaire • irrecevabilité • dispense • conciliateur • indisponibilité
Le décret n° 2023-357, du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, rétablit l’article 750-1 du Code de procédure civile, à compter du 1er octobre 2023. Sa rédaction, peu modifiée, tient compte des motifs du Conseil d’État pour annuler la version précédente, le 22 septembre 2022.
1. « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution ».
2. C’est ce que prévoira l’article 750-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6401MHK, à compter du 1er octobre 2023 [1] : tel un phénix, cet oiseau fabuleux qui renaît de ses cendres, l’article, annulé par le Conseil d’État le 22 septembre 2022 [2], est « rétabli » en ces termes par le décret n° 2023-357, du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile N° Lexbase : L6288MHD.
Comme l’ancienne version, la nouvelle impose au justiciable qui veut former une action en justice de tenter de s’accorder avec l’éventuel défendeur sous peine que son action soit déclarée irrecevable, au besoin d’office par le juge. Cette obligation substantielle ne concerne que certaines actions relevant de la compétence du tribunal judiciaire, mais le demandeur en est dispensé dans certains cas, eux aussi prévus au texte.
3. L’obligation substantielle est complétée par une obligation formelle, qui l’a précédée.
Cette obligation formelle issue du décret n° 2015-282, du 11 mars 2015 [3] N° Lexbase : L1333I8U était unique à l’origine ; elle n’est plus que la suite de l’obligation substantielle, depuis le décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3. Depuis le 1er janvier 2020, l’acte introductif d’instance précise les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative (art. 54, 5° N° Lexbase : L8645LYT), lorsque la demande initiale doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Cette mention existait antérieurement, sans être prescrite à peine de nullité ; c’est désormais le cas, mais elle ne concerne plus que les domaines dans lesquels la demande initiale doit être précédée d’une tentative d’accord.
Obligations formelle et substantielle ne doivent pas être mélangées, chacune ayant sa place et son régime, mais au contraire articulées correctement tant par les justiciables que par le juge. Autrement dit, « il y a deux étapes à distinguer : l’une substantielle, l’autre formelle qui n’a de sens que dans le prolongement de la première. Le demandeur doit les respecter sous peine d’encourir deux sanctions distinctes, qui s’appliquent distributivement : l’absence de tentative de MARD est sanctionnée par une FNR, l’absence de mention de l’échec de la tentative ou de la dispense est passible de nullité de forme. Le juge doit tout autant distinguer les deux obligations et la sanction de leur non-respect » [4].
Notons que le 5° de l’article 54 est actuellement vidé de sa substance, mais qu’il retrouvera son sens avec le décret du 11 mai 2023.
4. Le décret du 11 mai 2023 constitue donc une renaissance du phénix « article 750-1 », mort après un premier cycle de vie [5] (I) ; il ouvre un nouveau cycle non dépourvu d’incertitudes (II).
I. Premier cycle de vie du phénix « 750-1 »
5. L’article 750-1 du Code de procédure civile est le décret d’application (B) d’un texte de loi (A). Cette loi, c’est la loi n° 2016-1547, du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle N° Lexbase : L1605LB3 […], dont l’article 4 non codifié impose une tentative de résolution amiable du litige préalablement à certaines actions.
A. Loi
6. Initialement, en 2016, cette obligation concernait la déclaration au greffe, formule procédurale utilisable pour introduire l’instance devant le tribunal d’instance, à côté, notamment de l’assignation (à toutes fins), lorsque le montant de la demande n’excédait pas 4 000 euros [6].
Selon l’article 4 de la loi « JXXI », qui n’appelait pas de décret d’application spécifique, le juge pouvait déclarer d’office irrecevable la déclaration au greffe du tribunal d’instance, non précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ; ceci sauf si le demandeur se trouvait dans un des trois cas de dispense prévus par le même texte : « 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige [7] ; 3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ».
7. Cet article a été modifié, d’abord par la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC (art. 3. II), puis par la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T : ce sont trois modes amiables qui peuvent être choisis pour une tentative d’accord, étant rappelé que parmi eux, seule la conciliation est gratuite, donc choisie plus volontiers que les modalités payantes ; les cas de dispense ont été étendus.
L’article 4 de la loi « JXXI », en son dernier état, dispose ainsi que :
« Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage [loi « Confiance »], la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances [loi « Confiance »] ».
8. Depuis 2019, l’article 4 ajoute encore qu’« un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du Code de la consommation [8] ». Cet alinéa a été rédigé en conséquence de la décision prise par le Conseil constitutionnel en 2019, saisi de la contitutionalité de la loi « Belloubet ». Par sa décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019 N° Lexbase : A5079Y4U, le Conseil a en effet imposé d’expliciter les notions de motif légitime et de délai raisonnable, trop imprécis eu égard à l’accès au juge. C’est là l’origine de l’article 750-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6401MHK – placé dans les dispositions communes du tribunal judiciaire : créé par le décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3, il a ensuite été retouché par le décret n° 2022-245, du 25 février 2022.
B. Décret
9. L’article 750-1, alinéa 1er, consolidé en 2022, reproduisait le principe de l’obligation et sa sanction tels qu’énoncés à l’article 4 de la loi. En outre, il définissait plus précisément le domaine de la tentative préalable obligatoire de règlement amiable, afin d’être conforme aux prescriptions du Conseil constitutionnel : il chiffrait le montant de l’obligation à 5 000 euros et renvoyait aux articles R. 211-3-4 N° Lexbase : L0421LSE et R. 211-3-8 N° Lexbase : L0425LSK du Code de l’organisation judiciaire pour les conflits de voisinage. Si les conflits de voisinage étaient entendus strictement dans un premier temps – les articles du Code de l’organisation judiciaire visés évoquent les actions en bornage, les actions relatives au curage des fossés, les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice de certaines servitudes… qui relèvent de la compétence des chambres de proximité des tribunaux judiciaires, à savoir les tribunaux de proximité, successeurs des tribunaux d’instance –, l’ajout des troubles anormaux de voisinage, par un amendement en commission (CL387) avait étendu en revanche considérablement la notion [9] : l’amendement avait aussi pleinement fait de l’article 750-1 N° Lexbase : L6401MHK une disposition commune au tribunal judiciaire, et non plus spéciale à la procédure orale ordinaire, car les TAV peuvent en effet relever de la procédure écrite ordinaire – héritière de la procédure du tribunal de grande instance.
L’article 750-1, alinéa 2, reprenait aussi les cinq cas de dispense de l’article 4 de la loi « JXXI », consolidé, mais développait le troisième.
10. Or, le 22 septembre 2022 [10], le Conseil d’État a annulé l’article 750-1. Il reprochait l’imprécision du motif légitime justifiant une dispense de préalable amiable obligatoire tenant au délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux de l’affaire pour obtenir un premier rendez-vous avec un conciliateur de justice. L’annulation jouait sans rétroactivité, « sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision », c’est-à-dire sous réserve des instances en cours. Les effets du texte jusqu’au jour de sa décision n’étaient pas remis en cause [11], mais les demandes en cours, qui n’auraient pas été précédées d’une tentative de résolution amiable, ne pouvaient plus être déclarées irrecevables (et les actes introductifs ne mentionnant pas la tentative ne pouvaient plus être annulés pour vice de forme [12]).
11. Le préalable obligatoire a donc disparu pour les demandes introduites depuis le 22 septembre 2022, mais il était certain que la Chancellerie allait réécrire le texte. Alors que celle-ci aurait pu être englobée dans une réforme plus ambitieuse des MARD [13], elle n’est qu’un simple « petit pas » – selon la politique actuelle en matière de procédure civile –, en ce sens qu’elle est à peu près le seul objet du décret n° 2023-357, du 11 mai 2023 N° Lexbase : L6288MHD : ce texte rétablit l’article 750-1 en tenant compte des motifs de l’annulation [14].
II. Nouveau cycle de vie du phénix « 750-1 »
12. L’article 750-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6401MHK est réécrit, il imposera de nouveau de chercher à s’entendre avant de saisir le tribunal judiciaire, dans certains cas, à compter du 1er octobre 2023. Si le phénix qui renaîtra de ses cendres à cette date a fait peau neuve (A), il demeure la même « créature », le même article 750-1, qui avait suscité des questions – qui n’ont pas toutes trouvé une réponse (B).
A. « Peau neuve »
13. La comparaison des deux versions, celle de 2019 consolidée en 2022, et celle de 2023, débouche sur le constat qu’elles sont très proches.
Une nouveauté, assez théorique, provient de l’invocation expresse de la loi « JXXI », en ouverture de l’article 750-1 dans sa version de 2023. S’agit-il d’un « bouclier », afin de rappeler que la loi a été déclarée constitutionnelle [15] et que, tenter de mettre le phénix à mort une nouvelle fois, ne l’empêchera pas de renaître puisque la loi le protège. En réalité, il nous semble que la nouvelle formulation ne fait que montrer davantage la redontance des dispositions de la loi et du décret, redondance qui interroge quant à la répartition entre ces deux normes [16]… même si la codification de la règle a le mérite de la rendre plus accessible ; la mention de la loi « JXXI » attire peut-être aussi davantage l’attention sur le fait que celle-ci est paralysée lorsque son décret d’application est invalidé, ainsi qu’il en est depuis le 22 septembre 2022 et qu’il en sera jusqu’au 1er octobre 2023.
14. La différence pratique résulte dans l’abandon d’un délai imprécis au profit d’un délai chiffré, une nouvelle fois en conséquence de la décision d’annulation du 22 septembre dernier. Le phénix doit quitter un de ses vieux oripeaux pour renaitre : la dispense de tentative préalable de MARD sera justifiée en cas d’« indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur », étant en outre précisé que « le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ».
Il a été relevé [17] que « ce délai est suffisamment long pour permettre aux conciliateurs eux-mêmes contraints par des jours voire des demi-journées de permanence hebdomadaire de s’organiser et de recevoir le plus grand nombre possible de justiciables. Mais il n’est pas trop long, pour ne pas trop retarder l’éventuelle procédure contentieuse en cas d’indisponibilité. Il ne saurait ainsi constituer un obstacle substantiel à l’accès au juge, encore qu’il ne délimite que le temps de la mise en œuvre de la conciliation, pas la durée de celle-ci ». C’est aussi un délai « connu des modes de résolution amiable des différends », puisqu’« il fixe généralement, la durée maximale de la tentative de résolution. Ainsi, la durée maximale de la mission du conciliateur de justice dans une conciliation déléguée est de trois mois, renouvelable une fois pour une même durée (CPC, art. 129-1 N° Lexbase : L1447I84). Il en est de même de la durée du médiateur dans le cadre d’une médiation de justice (CPC, art. 131-3 N° Lexbase : L5934MBE) ».
15. Délai précis, pas trop long et connu ? Il n’est pas certain que cette fixation consiste en un progrès pour le justiciable. Il nous semble au contraire que « c’est assez regrettable car cela laissait une certaine souplesse aux magistrats qui pouvaient tenir compte de la situation des parties et de la nature de l’affaire » [18], sans parler du fait qu’un délai de trois mois avant de pouvoir saisir un juge est, en réalité, très long surtout pour qui se heurte à un adversaire qui « joue la montre » et qui souvent déjà attendu.
Il faudra prouver la saisine du conciliateur et ses suites. Certes, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, mais cela n’est pas forcément simple [19] : faudra-t-il penser à enregistrer un appel téléphonique au conciliateur, par exemple, pour attester qu’il a accepté de s’occuper du cas du justiciable… mais que la première réunion n’est organisée que plus de trois mois après cet appel ? Quid si ledit justiciable ne sait pas enregistrer ou n’y pense pas. Et d’ailleurs quelle validité pour un enregistrement qui serait occulte? Un échange de courriels serait sans doute plus sûr, permettant plus facilement de garder une trace de la « saisine ».
Que « désigne concrètement “l’organisation de la première réunion de conciliation” » [20] ? Une réunion d’information des parties qui ne serait pas suivie d’autres démarches faute de volonté des parties est-elle suffisante ? Il faut l’espérer.
Qu’est-ce que la « saisine » du conciliateur ? Est-ce le moment où il accepte la mission ? Le conciliateur est un bénévole, il n’est pas obligé d’accepter. Il est dès lors envisageable qu’un justiciable se heurte à plusieurs refus.
Plutôt que d’ériger « les suites de la saisine » en événement, c’est « l’absence de suites » qui devrait être prise en compte : l’impossibilité – ou la difficulté (pendant trois longs mois) – d’obtenir une conciliation devrait permettre d’être dispensé de ce préalable obligatoire [21] : il est vrai qu’il faudrait alors prouver l’existence de démarches infructueuses pour approcher un conciliateur.
Il n’est pas sûr que cet aspect de la nouvelle rédaction du « phénix » ne le conduise pas vers une nouvelle mort – une nouvelle annulation – qui pourrait être suivie d’une deuxième renaissance…
16. Le remplacement de l’impératif « doit être précéd[é] » par l’indicatif « est précéd[é] » ne change rien au caractère obligatoire de la tentative de MARD préalable (sauf dispense).
17. Pour le reste, c’est le même phénix qui renait, ce qui est assez surprenant au regard des difficultés suscitées par l’« oiseau », dans son premier cycle de vie… En outre, comme hier [22], l’assignation délivrée doit mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, qui ont été vaines, ou la justification de la dispense ; à défaut, l’acte de procédure serait nul (nullité de forme) pour non-respect de l’article 54, 5° du Code de procédure civile N° Lexbase : L8645LYT.
B. Même « créature »
18. L’article 750-1 N° Lexbase : L5912MBL, ancienne(s) version(s), avait suscité des interrogations, dont certaines avaient donné lieu à des arrêts ; les leçons ainsi données par la jurisprudence sur le texte ancien (voire sur l’article 4 de la loi « JXXI ») ne doivent donc pas être oubliées. Des questions demeurent en suspens…
19. Pas plus que précédemment, l’article 750-1 ne précise comment calculer le « taux de conciliation », qu’il fixe à 5 000 euros. Il a déjà été constaté que l’article 750-1 ne renvoie pas expressément au droit commun de l’évaluation de la demande, prévue au titre de la compétence d’attribution et du taux de ressort (CPC, art. 35 et s. N° Lexbase : L1182H4K), à la différence des articles 761 N° Lexbase : L8600LY8 et 853 N° Lexbase : L5414L8Z, qui prévoient désormais un « taux de procédure » : ce taux permet de savoir si la représentation est obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce, et si la procédure est écrite ou orale devant le tribunal judiciaire [23].
Des cours d’appel ont cependant appliqué les règles des articles 35 et suivants, par exemple en additionnant le demandes connexes [24] ; ce qui est de bon sens. En outre, il n’est pas discuté que les sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM ne doivent pas être prises en compte en raison de leur nature [25] ; pas plus que les dépens, dont ni le montant ni la partie qui en aura la charge ne sont définis lors de la demande, doivent logiquement être exclus du calcul. Il est sans doute permis de voir une confirmation de cette jurisprudence dans la reprise de la rédaction du « phénix ».
20. Par ailleurs, les cas de dispense [26] sont reconduits à l’identique sous la réserve du délai du 3°. Or au-delà de la question du motif légitime réécrit en 2023, le 3° a posé et continue de poser des difficultés.
Rappelons que ce 3° dispose : « Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ».
Des réponses ont été apportées, au moins par analogique, dont on peut aussi penser qu’elles n’ont pas été condamnées à défaut d’avoir été consacrées en 2023.
21. Comment apprécier le motif légitime tenant aux « circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative [de résolution amiable] » ? La généralité de la formule laisse, autant en 2023 qu’auparavant, aux juges du fond une large marge d’appréciation. Il a ainsi pu être jugé que « la situation financière que traverse le requérant depuis le non-paiement des loyers par la société preneuse constitue un motif légitime au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile » [27].
22. Il nous semble aussi que la formule englobe le cas de dispense prévu au 2° en 2016, et qui n’est plus mentionné en l’état ni dans la loi « JXXI » consolidée ni dans l’article 750-1 – ancien et rétabli : dès lors, l’existence de « pourparlers » antérieurs et vains – pas forcément formalisés par une conciliation, une médiation ou une convention de procédure participative – serait bien un tel motif de dispense. Un jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 24 juillet 2020 [28] a pu aller en ce sens : à la suite d’une mise en demeure d’avocat, l’adversaire s’est opposée de façon catégorique aux demandes. Le tribunal judiciaire en déduit que « compte tenu de cette opposition ferme et sans appel, il est manifeste que la résolution amiable du litige était impossible. Dès lors, [le demandeur] justifie d’un motif légitime pour s’exonérer de la tentative de résolution amiable mentionnée à l’article 750-1 du Code de procédure civile » [29].
Mais une cour d’appel a considéré qu’un courrier de l’huissier de justice « ne constitue pas la tentative de règlement amiable prévue par ce texte, d’une part, parce qu’il ne contient aucune allusion aux diverses possibilités de résolution amiable prévues par la loi mais une mise en demeure peu compatible avec une telle démarche, d’autre part, en raison de son ancienneté puisque l’arriéré de charges réclamé par le syndicat de copropriétaires correspond aux appels de fonds postérieurs » [30]. Une autre a estimé que « de manière erronée […], pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les [défendeurs] tirée de l’absence de recours à l’une des tentatives visées à l’article 750-1 susvisé, ce juge a tout d’abord relevé qu’il résultait des pièces communiquées par les [demandeurs] qu’ils avaient, […], accompli des démarches épistolaires en vue de trouver une solution amiable au litige, alors qu’une telle circonstance n’est pas visée par l’article 750-1 comme pouvant justifier une dispense de l’obligation mentionnée au premier alinéa de ce texte » [31]...
En l’absence d’arrêt de la Cour de cassation sous l’empire du régime de 2019, les justiciables, leurs avocats et les juges devront être prudents…
23. Qu’est-ce que l’« urgence manifeste » ? Un cour d’appel avait jugé que les demandes, devant la juridiction des référés, d’expertises et provisionnelles, au visa des articles 834 N° Lexbase : L8604LYC, 835 N° Lexbase : L8607LYG et 145 N° Lexbase : L1497H49, « n’entrent pas dans les cas énoncés à l’article 750-1 » [32].
En revanche, la Cour de cassation a estimé, le 14 février 2022, que celui qui délivre une assignation en référé n’est pas, par principe, dispensé d’avoir cherché un accord avec le défendeur, préalablement [33]. Dès lors, comme pour une action au fond, ce n’est qu’en cas d’échec de la tentative de MARD ou en cas de dispense de MARD préalable, que le juge peut être saisi ; à défaut, la demande serait irrecevable pour non-respect de l’article 750-1. Dans l’affaire en question, le fondement était l’évidence – il s’agissait d’un référé provision dont la seule condition d’ouverture est l’absence de contestation sérieuse ; cependant, la présence du terme « manifeste » dans l’article 750-1 et la généralité de l’attendu de l’arrêt de 2022 exclut une dispense automatique dans tous les cas de référé. C’est sévère, mais pas étonnant…
24. La question de la preuve s’est aussi posée, à propos de l’article 4 ancien de la loi « JXXI » et la Haute juridiction a fourni des indications à propos du 2° qui nous paraissent transposables au 3° de l’article 750-1 – tant dans la première vie du phénix que dans sa nouvelle existence. Il résulte ainsi de deux arrêts du 15 avril et du 1er juillet 2021 [34] que les juges doivent analyser concrètement les éléments apportés par le demandeur, les examiner pour vérifier si le demandeur justifie de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sans s’abriter derrière un formalisme non prévu aux textes… Ainsi, par exemple d’un courrier adressé à l’adversaire en vue d’un accord pour mettre un terme au litige (arrêt du 15 avril) ou d’écritures dans lesquelles le demandeur fait valoir diverses tentatives de résolutions amiables et offre de les prouver (arrêt du 1er juillet).
Même si la Cour de cassation devait ne plus admettre que des pourparlers antérieurs vains soient un motif de dispense [35] – ce qui semblerait contraire à l’esprit du texte –, les indications des deux arrêts quant au rôle des juges eu égard à la preuve continueraient d’être utiles, au moins pour la tentative de conciliation [36].
25. Notons, enfin, que la compétence du juge pour connaître de l’article 750-1 s’est posée qui n’a pas changé avec le rétablissement du texte : il a été jugé, par la cour d’appel de Metz, que « l’irrecevabilité des demandes des appelants fondée sur leur prescription et le non-respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile relatives à la conciliation préalable, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause les dispositions au fond du jugement, de sorte que l’examen de cette fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état »[37].
26. La renaissance du phénix de ses cendres a été saluée par les partisans de l’amiable, qui déploraient la disparition de la fin de non-recevoir de l’article 750-1. De notre côté, nous sommes beaucoup plus dubitatifs, pour ne pas dire critiques… comme pendant le premier cycle de vie de l’oiseau fabuleux : « l’amiable consenti, l’amiable “amiable” (!) est évidemment une bonne chose, l’amiable imposé ne l’est pas du tout, “d’une part, parce qu’on ne fait pas s’entendre des personnes qui ne le souhaitent pas, d’autre part, parce qu’il est source lui-même de contentieux !”… » [38] En outre, il n’est pas certain que notre phénix ne mourra pas à nouveau si sa nouvelle mouture est à nouveau attaquée devant le Conseil d’État.
[1] V. décret n° 2023-357, art. 4 N° Lexbase : Z38404UT. Les articles 2 N° Lexbase : Z38398UT et 3 N° Lexbase : Z38402UT du décret sont des dispositions de coordination ou de correction.
[2] CE, 22 septembre 2022, n° 437002 N° Lexbase : Z352792I ; M. Barba, Gaz. Pal., 15 novembre 2022, p. 15, obs. N. Reichling ; S. Amrani Mekki, JCP G, 2022, act. 1186.
[3] C. Bléry et J.-P. Teboul, Une nouvelle ère pour la procédure civile (suite et sans doute pas fin). – À propos du décret no 2015-282 du 11 mars 2015, Gaz. Pal., 17-18 avril 2015, p. 7, spéc. n° 6 et s. ; C. Bléry, D. actu., 10 mai 2021.
[4] C. Bléry, D. actu., 12 mai 2022.
[5] V. G. Maugain, D. actu., 20 janvier 2020 et D. actu., 23 mai 2023 ; C. Bléry, D. actu., 10 mai 2021, 15 juillet 2021 et 12 mai 2022 ; V. Egéa, JCP G, 2023, act. 596 – adde C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 36e éd., 2022, n° 2241 ; É. Vergès, Étude : La procédure devant le tribunal judiciaire, in Procédure civile, Lexbase, sp. n° 3-1 N° Lexbase : E91567G9.
[6] V. CPC, art. 843 N° Lexbase : L8610LYK, issu du décret n° 2010-1165, du 1er octobre 2010 N° Lexbase : L0992IN3 et abrogé par le décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3.
[7] V. infra, n° 22.
[8] C’est-à-dire aux litiges concernant les crédits à la consommation et aux crédits immobiliers.
[9] F.-X. Berger, D. actu., 3 mars 2022. Cette extension nous semble être « l’aveu flagrant d’un déni de justice assumé », l’auteur de l’amendement ayant estimé, sans suscité d’objection, que « ces contentieux du quotidien, qui empoisonnent la vie de nos concitoyens, peuvent souvent être résolus par la voie de la médiation, sans passer par des procédures longues, lourdes et coûteuses » (v. déjà D. actu., 12 mai 2022).
[10] V. supra, n° 2.
[11] CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 9 mars 2023, n° 22/07041 N° Lexbase : A57989H9.
[12] Par exemple, CA Reims, 1re ch., sect. civ., 15 novembre 2022, n° 22/01225 N° Lexbase : A54598UQ.
[13] Le garde des Sceaux a annoncé une recodification des MARD, une audience de règlement amiable (ARA) devrait être créée dans un article 750-2 du Code de procédure civile et une « césure » du procès civil, au stade de la mise en état devrait aussi voir le jour.
[14] V. la nouvelle version supra, n° 1.
[15] G. Maugain, D. actu., 23 mai 2023.
[16] C. Bléry, D. actu., 12 mai 2022 ; dans le même sens, S. Amrani-Mekki, JCP G, 2022, étude 436, sp. n° 10.
[17] G. Maugain, D. actu., 17 mai 2023.
[18] S. Amrani-Mekki, JCP G, 2022, act. 1186.
[19] Sur les difficultés de preuve déjà induites par l’ancien article 750-1, v. infra.
[20] G. Maugain, D. actu., 23 mai 2023.
[21] G. Maugain, D. actu., 23 mai 2023.
[22] V. supra.
[23] C. Bléry, D. actu., 12 mai 2022 ; v. le sujet du CRFPA 2021 ! – Adde C. Bahurel, N. Kilgus, R. Laher et T. de Ravel d’Esclapon, Épreuves écrites – Spécialité Droit civil, Dalloz, 2022, Spécial CRFPA 2022, sp. p. 370. – Sur les taux de procédure ou de conciliation, notions non inscrites dans les textes, v. C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 36e éd., 2022, n° 1504 et 1505.
[24] CA Toulouse, 1re ch., 15 novembre 2021, n° 21/00102 N° Lexbase : A89297BC. De même, l’article 750-1 n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la demande est indéterminée, par analogie avec l’article 40 N° Lexbase : L1192H4W (CA Fort-de-France, ch. civ., 19 juillet 2022, n° 22/00053 N° Lexbase : A52788E9 ; CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 4 avril 2022, n° 21/01058 N° Lexbase : A15707SX).
[25] Cass. civ. 3, 6 janvier 1981, n° 79-10.651, publié au bulletin N° Lexbase : A8495AH4 ou Cass. civ. 2, 20 novembre 1991, n° 90-15.838, publié au bulletin N° Lexbase : A5369AHC.
[26] Sur ces cas, qui laissent parfois « perplexes », v. nos notes précitées.
[27] TJ Nanterre, 8e, 24 janvier 2022, n° 20/08660 N° Lexbase : A28377SU.
[28] TJ Amiens, 24 juillet 2020, n° 11-20-000327.
[29] D. actu., 12 mai 2022, C. Bléry. Dans le même sens É. Vergès, Panorama 2021 des arrêts de la Cour de cassation en procédure civile (1re partie), Lexbase Droit privé, janvier 2022, n° 891 N° Lexbase : N0103BZT.
[30] CA Rennes, 4e ch., 27 octobre 2022, n° 22/02355 N° Lexbase : A81958RX.
[31] CA Douai, ch. 1, sect. 1, 24 février 2022, n° 21/01821 N° Lexbase : A96597N3.
[32] CA Riom, 17 mars 2021, n° 20/01181 N° Lexbase : A39734LQ.
[33] Cass. civ. 2, 14 avril 2022, n° 20-22.886, F-B N° Lexbase : A44707TQ.
[34] Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 20-14.106, F-P N° Lexbase : A80914PD ; Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-12.303, F-B N° Lexbase : A21064YN. Sur les deux, É. Vergès, Panorama 2021 des arrêts de la Cour de cassation en procédure civile (1re partie), Lexbase Droit privé, janvier 2022, n° 891 N° Lexbase : N0103BZT.
[35] V. supra, n° 22.
[36] V. supra, n° 22.
[37] CA Metz, 3e ch., 23 juin 2022, n° 21/00948 N° Lexbase : A623678H.
[38] D. actu., 12 mai 2022.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485723
[Brèves] L'huissier de justice dans la tourmente du fumier : quand la vie privée prend une tournure puante
Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2023, n° 22-15.155, F-D N° Lexbase : A208093G
Lecture: 2 min
N6106BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 04 Juillet 2023
► La Cour de cassation confirme la position d'une cour d’appel ayant procédé à la mise en balance entre le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ; dans le cas d’espèce l'atteinte portée à la vie privée de l'huissier de justice et à celle de son épouse par la révélation de leur identité n'était pas légitimée par le droit à l'information du public.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un huissier de justice et son épouse ont intenté une action en réparation de leurs préjudices contre l'éditeur du journal Le Progrès. Ils soutiennent que trois articles publiés dans ce journal portent atteinte à leur vie privée. Les deux premiers articles relatent le déversement d'un camion de fumier devant leur domicile par un débiteur, tandis que le troisième article concerne le procès pénal de l'auteur de ces faits. Les articles mentionnent leur nom patronymique et incluent la photographie de leur maison.
Le pourvoi. L’éditeur fait grief à l’arrêt d’avoir retenu que la publication des trois articles constitue une atteinte au respect de la vie privée de l’huissier de justice et son épouse et de l’avoir déclaré responsable de ces conséquences et l’a condamné à des dommages et intérêts.
En l’espèce, après avoir retenu que la divulgation, dans les articles litigieux, du nom de l'huissier de justice caractérisait une atteinte à sa vie privée et par voie de conséquence à celle de son épouse, la cour d'appel a relevé que, si le déversement de fumier devant le domicile d'un huissier de justice par un débiteur mécontent constitue un sujet d'intérêt général, la mention du nom de cet huissier, dont la notoriété ne dépassait pas le périmètre de sa commune, ne constituait pas une information de nature à éclairer le débat public sur le sujet de ce mécontentement mais ne visait qu'à satisfaire la curiosité supposée du lectorat.
Solution. La Cour de cassation énonce qu’ayant ainsi procédé à la mise en balance entre le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d'expression, la cour d’appel en a exactement déduit que l'atteinte portée à la vie privée de l'huissier de justice et à celle de son épouse par la révélation de leur identité n'était pas légitimée par le droit à l'information du public. Elle rejette le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486106
[Le point sur...] Tiers, constat et autres contrariétés…
Lecture: 22 min
N5893BZB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sébastien Racine, Commissaire de justice associé, Membre du comité scientifique de la revue Lexbase Contentieux et Recouvrement, Intervenant à l’ENM, EFB, Legal Logion Office
Le 28 Juillet 2023
Si nous devions présenter l’échange entre un client et son commissaire de justice rompu aux arcanes du constat d’achat, nous pourrions l’envisager comme un cocktail composé d’une dose d’interrogation sur un éventuel conflit d’intérêts, à laquelle il faudra ensuite ajouter une dose de disponibilité teintée d’urgence et de risque de disparition, et enfin saupoudrer le tout d’une mise en relation entre un inconnu et son client, le tout recouvert d’une couche de secret professionnel, afin de conserver le tout à température idéale pour en préserver la force et la saveur.
Cette boisson, nous en conviendrons, pourrait également être celle d’un agent, spécialiste en rencontre. Si, à cela, nous ajoutons une dose de « chaperonnage » au cours des opérations de constatations, la ressemblance est quelque peu troublante.
Une fois ses ingrédients mélangés, nous obtenons le constat d’achat parfait prêt à être savouré par le magistrat et la partie adverse, en espérant qu’aucun oubli ne vienne entacher son goût si unique.
Cette pratique ancrée dans nos procédures, doit cependant nous inviter à la réflexion quant au rôle que prend cet inconnu qu’est le tiers dans le cadre des procédures liées à la protection de la propriété intellectuelle, et qu’il pourrait prendre dans le cadre d’autres contentieux. D’ailleurs, à bien y réfléchir ce tiers est tout sauf un inconnu.
Il peut sembler hâtif de limiter le recours à un tiers au seul cas du constat d’achat, tant les motivations entérinant cette pratique semblent pouvoir s’appliquer à d’autres types de constats. Le cas du constat dans le métavers en est un bon exemple (I).
Dans le sillage d’une réflexion sur une utilisation accrue du tiers, augmentant ainsi sa visibilité, il convient, comme n’importe quel organisme dont l’exposition aux effets extérieurs, de s’interroger selon le principe de précautions sur les effets néfastes de cette surexposition et sur les solutions pour en limiter les conséquences (II).
I. Le recours à l’assistance d’un tiers, un incontournable en pleine mutation
Si le recours au tiers est depuis de nombreuses années une pratique courante, force est constater que la fréquence et les cas de recours se sont théoriquement multipliés (A). Cette multiplication nous amène à nous interroger sur la définition de la qualité de tiers, et son éventuelle évolution (B).
A. Les cas de recours au tiers, une évolution nécessaire
Autrefois réservé aux constats d’achat (1), dont la jurisprudence et la pratique ont forgé son statut, il semble prendre également de la place dans un environnement technologique en plein essor et répondant à de nouveaux codes (2).
1) Le constat d’achat : berceau du concept de tiers acheteur
Lors de la réalisation d’un constat d’achat, le rôle du commissaire de justice est clairement défini. Cette définition découle, tout d’abord, des contraintes liées à la qualification juridique du lieu des constatations, et plus précisément de ses conditions d’accès. En effet, bien souvent l’achat nécessite l’accès à un lieu privé.
Il n’est pas permis au commissaire de justice de pénétrer dans un lieu privé, même ouvert au public, sans le consentement exprès de l’occupant des lieux ou sans être muni d’une autorisation judiciaire, peu important qu’il s’agisse d’un simple constat d’achat. De fait, l’achat qui serait réalisé par le celui-ci l’obligerait, préalablement, à se présenter à l’occupant des lieux, exposer sa mission, et requérir son accord pour que les constatations soient dressées, ce qui est tout simplement incompatible avec l’objectif du constat d’achat et la stratégie procédurale dont il dépend.
Ensuite, le commissaire de justice qui réaliserait lui-même l’achat ne se contenterait pas de réaliser des constatations matérielles. En effet, l’expression « constatations purement matérielles » doit s’entendre comme « toute situation personnellement constatée par l’huissier de justice au moyen de ses sens, et qu’il n’a pas provoquée par une opération intellectuelle de nature à troubler sa qualité de tiers neutre, indépendant et impartial ». Or conclure une vente suppose la manifestation d’une volonté juridique, et donc une forme d’opération intellectuelle, et à tout le moins un rôle actif de sa part.
La pratique du constat d’achat à l’aide d’un tiers est donc venue pallier ces deux limites, tout en permettant notamment aujourd’hui de satisfaire à la Directive (CE) n° 2004/48 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle N° Lexbase : L2091DY4, en ce qu’elle impose aux États membres de proposer les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente Directive.
La force probante du constat d’achat dressé par le commissaire de justice fait de celui-ci un élément privilégié, voire incontournable, dans certains litiges. Parallèlement, il a été reconnu par la jurisprudence que le recours à un tiers acheteur est un procédé loyal de preuve au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme N° Lexbase : L7558AIR.
Le recours au tiers dans le constat d’achat permet ainsi d’harmoniser les intérêts divergents des parties aux constats. D’un côté, le demandeur souhaite pouvoir se défendre et établir la preuve des faits qu’il juge comme lui causant un dommage, de l’autre un défendeur souhaite que soit respectée l’obligation de loyauté ainsi que le droit à un procès équitable. Entre les deux, le commissaire de justice aura à cœur de procéder à des constatations dans le respect des règles régissant sa profession, tant sur le plan règlementaire que déontologique.
2) Les constats sur les réseaux sociaux et dans le métavers : un terreau fertile pour l’émergence du tiers navigateur
Au commencement, la pratique du constat d’achat avec un tiers ne concernait que l’achat physique. Il s’est donc naturellement posé la question de son applicabilité aux constats sur internet. La solution est aujourd’hui la même que pour les achats physiques, à savoir que le recours à un tiers est obligatoire.
Il a ainsi été énoncé que « l’huissier de justice ne peut effectuer des constatations sur un site internet dont l’accès est restreint par une identification, par mot de passe ou inscription préalable, comme un forum de discussion, par exemple, sauf si le propriétaire de ce site l’y autorise expressément » [1]. Or la simple création d’un compte, même en déclarant sa fonction, ne semble pas répondre à l’obligation du commissaire de justice d’agir à visage découvert. En effet, il s’agit bien souvent d’un traitement automatique qui valide les inscriptions.
En effet, « il ne suffit pas que l’huissier de justice décline ses nom, prénom et qualité par le biais d’un formulaire en ligne pour que cette condition soit remplie : encore faut-il qu’il fasse état de l’objet de sa mission pour que les constatations soient effectuées loyalement. L’identification doit donc porter tant sur la personne de l’huissier que sur le but de sa mission. Cette exigence exclut donc que l’huissier puisse accéder à des pages internet privées à la faveur d’un traitement automatique des données incapable de distinguer l’internaute lambda de l’officier public et ministériel » [2].
Par ailleurs, que l’achat soit réalisé physiquement ou par internet, le commissaire de justice outrepasserait comme précédemment évoqué le cadre de sa mission. La création d’un compte par l’officier ministériel a déjà été sanctionnée [3].
Cette nécessité d’utiliser un tiers pour le constat d’achat sur internet nous amène à nous questionner sur la pertinence de recourir à un tiers pour accéder à tout site internet privé ouvert au public, en raison de l’obligation faite de s’identifier avec un compte utilisateur pour accéder au contenu. Ceci est le cas notamment de nombreux réseaux sociaux dont le contenu public tend à s’amoindrir avec notamment une limite de temps de lecture avant le blocage de l’accès au contenu et une invitation à s’authentifier pour continuer à lire le contenu. Il en va de même des articles de journaux accessibles sur les sites de grands quotidiens dont le contenu public n’est que partiel.
Dans ces deux cas, il apparaît clairement que le site internet concerné invite l’utilisateur à s’authentifier, et à s’identifier, pour permettre le visionnage du contenu, devenant ainsi, à l’instar d’un magasin ou d’un club privé, des lieux virtuels à accès contrôlé.
Concernant le métavers, dont l’expérience utilisateur est à placer à la croisée des chemins entre le jeu vidéo et le réseau social, il ne déroge pas à cette règle. Il est à préciser que cette tendance accrue à l’identification répond avant tout à la volonté de monétiser les données personnelles des utilisateurs, reléguant ainsi la sécurisation de l’accès au site internet au second plan. Cependant, les raisons d’un tel contrôle ne semblent pas devoir influer sur la qualification juridique des lieux des constatations par le commissaire de justice. Ainsi, dans le cadre d’un salon physique public, le contrôle d’accès se fait principalement pour monétiser l’accès au salon, cependant dans le cadre de la réalisation d’un constat sur place, nonobstant l’achat de la place, il convient malgré tout d’obtenir l’autorisation du commissariat du salon pour procéder à toutes constations à l’intérieur.
B. La qualité de tiers
La qualité de tiers, telle que définie dans le constat d’achat (1), semble devoir évoluer lorsqu’il s’agit d’aborder le tiers navigateur (2).
1) La définition du tiers acheteur
Le tiers étant un concept acquis depuis de nombreuses années, la détermination de sa qualité n’a pas pour autant été chose aisée à établir. Dans un premier temps, la qualification de « tiers » s’est effectuée en fonction du rôle de la personne concernée. Cependant, une définition plus générale a émergé par la suite, sans pour autant mettre fin au débat.
Différents acteurs se sont alors retrouvés sous le feu des projecteurs. Plusieurs acteurs ont été considérés comme possibles tiers, dont le clerc de l’huissier de justice instrumentaire, le conseil en propriété industrielle du demandeur, le stagiaire du cabinet d’avocat du requérant, ou encore le directeur commercial du demandeur.
Avant 2017, l’évaluation de la qualité de « tiers » se fondait surtout sur la relation entre l’huissier de justice et la personne concernée. Ainsi, un employé de la société demanderesse ou un stagiaire d’un cabinet d’avocat pouvait être autorisé à servir de tiers acheteur. L’intérêt était double, d’une part en raison de la praticité de ce choix qui permettait tout à la fois d’être réactif respectueux du secret professionnel de l’huissier de justice. Il permettait, enfin, de garder sous « cloche » la procédure de collecte de preuve, dont la réussite dépend bien souvent du degré de discrétion dont elle bénéficie.
Depuis 2017, l’appréciation de la qualité de tiers a évolué, dépassant la simple appréciation du lien huissier de justice et tiers, et s’attachant également aux liens avec le requérant et son conseil. Une inflexion a été faite récemment par la cour d’appel de Paris, cependant il ne s’agit que d’un début, et la prudence nous dicte de suivre la position de la Cour de cassation.
Il a d’ailleurs été récemment rappelé que la mention « le tiers acheteur signifie un acheteur non-salarié de mon étude, n’ayant aucun lien ni juridique ni personnel avec la société requérante et son conseil » était suffisante pour considérer comme indépendant le tiers acheteur. Une particularité intéressante est que le commissaire de justice avait parfois simplement désigné l’acheteur comme « tiers acheteur » sans donner plus de détails, et parfois précisé le rôle du tiers acheteur, sans incidence sur la validité du constat puisque la désignation « tiers acheteur » « impliquant nécessairement l’absence de liens avec les parties ».
La mention explicite, ou non, de l’indépendance du tiers est au stade du constat purement déclaratif et n’est assortie d’aucune attestation ou pièce justificative. Ainsi, il naît de ces mentions une présomption simple d’indépendance que la partie adverse devra contester en apportant la preuve contraire.
De prime abord, il peut sembler difficile d’apporter la preuve de la dépendance d’un tiers, sauf à ce que ce dernier se déclare, in fine, dépendant de l’une des parties. Il est possible d’imaginer la production d’un témoignage d’une tierce personne venant mettre à mal l’indépendance déclarée du tiers, cela reste théorique. En pratique, il sera difficile d’apporter une telle preuve, à moins qu’il n’y ait un cas flagrant de mensonge.
2) Le tiers navigateur, une notion nouvelle
Pour dépasser cette notion de tiers acheteur, il est opportun, eu égard au développement précédent, de s’intéresser à l’émergence d’un tiers navigateur, qui, en dehors de tout acte d’achat, assistera le commissaire de justice dans ses constatations lorsque le lieu est juridiquement inaccessible à ce dernier, sauf à se déclarer préalablement.
Dans le monde réel, le recours à un « tiers navigateur » ne semble pas envisageable, pour reprendre l’exemple du tiers acheteur, sa mission sera d’entrer dans le magasin pour procéder à l’achat d’un produit déterminé et en ressortir dans la foulée pour remettre ledit produit à l’huissier de justice. A contrario, un tiers zélé qui prendrait des photographies des rayons à l’intérieur du magasin, non visibles depuis l’extérieur, ou qui procèderait à des enregistrements audio ou vidéo du discours commercial de l’un des vendeurs mettrait en danger le constat du commissaire de justice.
En revanche, lorsque les constatations ont lieu sur internet, l’accès aux informations se fait de manière différente, de sorte que le commissaire de justice va pouvoir constater personnellement les informations qui s’affichent à l’écran lors de la navigation de son tiers. Cette principale différence technique rend ainsi possible les constatations sur du contenu qui n’est accessible qu’aux personnes authentifiées en constatant par-dessus son épaule. Le tiers qui ne sera pas chargé d’acheter le produit sera en revanche invité à naviguer sur un site ou un réseau social afin que le commissaire de justice puisse constater le contenu qui apparaît à l’écran.
Dans ce type de constat, il est opportun de s’interroger sur la qualité du tiers qui pourrait être envisagé comme toute personne n’étant pas liée à l’huissier de justice, soit le même postulat qu’avant 2017. Ainsi, nous pourrions imaginer que le demandeur puisse se connecter avec son compte personnel pour faire constater une publication sur un réseau social, ou encore pour constater l’offre à la vente d’un produit sur un site de ventes réservées à des adhérents.
Il semble possible que le recours au tiers, bien que similaire dans son contour, vise en réalité ici à limiter le rôle actif de l’huissier de justice au moment des constatations. Pour mémoire ce rôle actif pourrait être caractérisé par la création d’un compte pour accéder au contenu dont l’accès est limité.
En l’état actuel de la jurisprudence, il n’est pas prévu une telle obligation lorsqu’il s’agit de constater des postes sur des réseaux sociaux par exemple. Cette question pourrait néanmoins se poser sous un nouvel angle avec l’apparition de constats dans le métavers où la création d’un avatar serait une condition préalable obligatoire pour constater des éléments dans ce nouvel espace technologique, renforçant ainsi la phase d’identification de la personne ayant accès au contenu.
Ces nouvelles perspectives semblent placer encore un peu plus le tiers au centre de constats qui font partie du quotidien des commissaires de justice, raison pour laquelle la question de sa protection doit être évoquée.
II. La protection du tiers, une nécessité
Le tiers n’est pas un parfait inconnu pour le commissaire de justice et pour les parties, à qui est communiqué un ensemble de données personnelles, portant notamment sur son identité (A) et ses moyens de paiement (B). Cette circulation de ses informations, entraîne par voie de conséquence des risques liés à leur divulgation, et doivent donc conduire à protéger le tiers et ses données.
A. Les données personnelles du tiers, son identité
La norme place en premier plan le tiers et son identité (1), cependant des moyens de substitution semblent aujourd’hui exister afin de garantir une certaine protection de ses données (2).
1) Le principe de l’identification du tiers
Le recours au tiers acheteur ou navigateur implique une identification claire et précise de celui qui assiste, dans ses constatations, le commissaire de justice. Cette obligation d’identification découle du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, qui impose que la partie adverse soit en mesure de vérifier l’authenticité du statut de tiers.
C’est ainsi que les données personnelles du tiers afférentes à son identité dans le monde physique sont mentionnées dans le procès-verbal de constat découlant des opérations. Le détail de ses informations doit être suffisant pour écarter tout risque d’homonymie. Le tiers n’est donc plus un inconnu, mais une personne parfaitement identifiable et dont les données vont être communiquées, stockées et vérifiées. La première difficulté concerne l’utilisation et la conservation de ces données dans le temps.
Outre cette problématique juridique d’actualité, le cas des représailles doit également être évoqué. En effet, le tiers pourrait être victime, par suite de la communication de ses informations personnelles à la partie adverse, de violences, dans les cas les plus extrêmes. Il faut également envisager des atteintes plus ciblées comme la communication de ces informations sur le darknet ou à des tiers. Le tiers risque de se retrouver en situation délicate sans qu’on puisse le protéger, et pouvant même, dans certains cas, fonder une action en responsabilité de la personne ayant communiqué ses informations.
Par ailleurs, outre ses données personnelles dites réelles, se pose la question de celles afférentes à son identité numérique. En effet, seront également communiqués ses identifiants de compte sur les sites web visités, à l’exception de ses mots de passe naturellement. La connaissance de ces identifiants pourrait également donner lieu à des représailles visant à porter atteinte sa e-réputation, à l’annulation de son compte utilisateur, à la divulgation « malencontreuse » de ses informations personnelles, à des actes de malveillances sur ses futures commandes, et même des messages désobligeants sur les réseaux sociaux. Ces actes sont théoriquement répréhensibles, mais en pratique il sera difficile d’identifier clairement la source de la fuite.
2) L’opportunité d’une « pseudonymisation » sous contrôle d’huissier de justice
Pour lutter contre ces représailles, il pourrait tout simplement être fait usage de compte créé pour les besoins du constat, en préservant ainsi le « vrai compte » utilisateur du tiers, cependant la création de ce compte éphémère nécessitera malgré tout la communication de ses informations personnelles in fine.
Pour protéger notre tiers des écueils liés à sa participation aux constations, il doit donc être évoqué la possibilité de la pseudonymisation qui est définie par la CNIL comme « un traitement de données personnelles réalisé de manière qu’on ne puisse plus attribuer les données à une personne physique identifiée sans information supplémentaire ». En pratique, cela consisterait à désigner le tiers sous un pseudonyme pour lequel l’huissier de justice serait le seul, avec la partie demanderesse et son conseil, à pouvoir le rattacher à l’identité réelle du tiers. Bien entendu, cela n’exonère pas le tiers à répondre aux critères d’indépendance évoqués précédemment. Concernant l’adresse de livraison dans le cadre du constat d’achat, la jurisprudence est venue rappeler que la livraison en l’étude de l’huissier de justice est parfaitement autorisée, et valable « puisque le lieu de la livraison de la commande ne fait pas l’objet de constatations que ce soit au cours du constat d’achat ou lors du constat d’ouverture de pli qui le suit nécessairement » [4]. En ce sens, il a été jugé que la livraison au sein de l’étude d’huissier répond à un « souci légitime d’établir de façon incontestable la date de livraison et la provenance du colis » et ne permet pas de qualifier le constat de saisie-contrefaçon déguisée [5].
Bien entendu, afin de satisfaire au principe de loyauté de la preuve, et au droit à un procès équitable, il faut également prévoir un mode de communication de l’identité réelle à la partie adverse et au magistrat, dans le cadre d’une réquisition judiciaire et assortie d’une obligation de confidentialité sous peine de sanctions dissuasives.
La nécessité de protéger le tiers, et le mécanisme envisagé tendraient finalement à confier au commissaire de justice la garantie de la loyauté du procédé d’obtention de la preuve, du seul fait de sa présence. Cette garantie pourrait même permettre d’envisager le recours à des tiers moins « tiers » afin de protéger son secret professionnel, et garantir une plus grande discrétion de la procédure.
B. Les données personnelles du tiers, ses informations de paiement
À l’instar des données personnelles, la question des moyens et données de paiement est également centrale. Si le tiers a théoriquement l’obligation d’utiliser ses moyens de paiement personnels (1), doivent être envisagés des moyens de protéger ses données, tant les atteintes contre ces dernières sont importantes (2).
1) L’obligation d’utiliser ses moyens de paiement personnels
Dans le cadre du constat d’achat, une autre obligation pèse sur le tiers, celle de procéder à l’achat à l’aide de ses moyens de paiement personnels. Ainsi, il a été jugé que le commissaire de justice ne pouvait acheter lui-même le bien [6], ni même prêter sa carte bleue [7]. Pour la réalisation d’un achat physique, le paiement en espèces, dans les limites légales de montant autorisées, est envisageable et prémunit le tiers de tout appauvrissement même temporaire.
En revanche, le recours à la carte bleue devient obligatoire lorsque l’achat doit être réalisé sur internet. Dans ce cas, divers incidents et contraintes, propres au tiers, peuvent survenir : solde ou plafond insuffisant du compte/carte bancaire, période de l’année où l’usage de la carte est intensif… de sorte que l’atteinte du plafond dans le cadre du constat d’achat l’empêcherait de subvenir à ses propres besoins. Par ailleurs, il peut arriver que le montant de l’achat du produit dépasse les habitudes du tiers entraînant un blocage de la carte pour suspicion de fraude, ou nécessite simplement un virement préalable à ce dernier.
Il existe également un risque lié à l’acte de paiement à savoir le piratage de ses données bancaires. Le nombre de fraudes à la carte bancaire liées à des achats sur internet a explosé ces dernières années, et il n’est malheureusement pas rare que nous soyons amenés à procéder à des achats sur des sites internet à la réputation douteuse, et servant tout simplement à collecter des données bancaires. Là encore, le tiers est exposé à un risque dont nous ne pouvons le protéger. Bien entendu, si le site internet est identifié comme étant à risque, la pratique, la prudence et le bon sens, imposent au commissaire de justice de ne pas inviter le tiers à entrer la moindre donnée personnelle et à prévenir son client du risque et de l’impossibilité de procéder à l’achat.
2) L’opportunité d’une anonymisation sous contrôle du commissaire de justice
Pour les raisons évoquées ci-avant, il semble nécessaire de permettre à l’huissier de justice, dans le cadre de son constat, d’anonymiser totalement le moyen de paiement du tiers, voire d’utiliser un moyen de paiement dédié, par exemple une carte prépayée qu’il mettrait à disposition du tiers pour les besoins des constatations. À tout le moins, et dans la mesure du possible, le tiers devra utiliser une carte prépayée pour limiter les risques sur son moyen de paiement personnel principal.
L’impossibilité, pour le commissaire de justice, de mettre à disposition un moyen de paiement au tiers ne semble plus trouver de justification, puisqu’il n’utilise pas lui-même ledit moyen de paiement, et qu’il serait difficile d’invoquer un stratagème de ce seul fait, d’autant plus si l’utilisation est transparente et inscrite dans le procès-verbal. Par ailleurs, il est intéressant de rappeler que la Cour européenne impose aux États membres la mise en place et l’acceptation de moyen de preuve selon des procédures qui ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses, de sorte que cette prohibition n’ajoute qu’une forme de complexité.
Il semble également opportun, sous réserve de faisabilité, de favoriser le recours à des modes de paiement plus sécurisés comme PayPal. Bien entendu, cela induit qu’une préparation préalable ait pu être réalisée, et que le site internet concerné le permette.
[1] S. Dorol, JCl. Encyclopédie des Huissiers de Justice, Bloc Preuve, fasc. 30, v° « Les constats », n° 106.
[2] S. Dorol, La loyauté dans les constats Internet : rappel de mise en œuvre, Gaz. Pal., 2015, n° 318, p. 16, note ss. CA Paris, 5-4, 7 octobre 2015, n° 11/03744, inédit N° Lexbase : A9044SA9.
[3] Cass. civ. 1, 20 mars 2014, n° 12-18.518, FS-P+B N° Lexbase : A7370MHG ; R. Perrot, obs., Procédures, 2014, comm. 133, p. 12.
[4] S. Dorol, note ss. CA Paris, 5-2, 25 septembre 2015, n° 14/15558 N° Lexbase : A8262SAA.
[5] CA Paris, 5-1, 25 octobre 2016, n° 15/05739, inédit N° Lexbase : A9572R9E.
[6] Cass. civ. 1, 20 mars 2014, n° 12-18.518, FS-P+B N° Lexbase : A7370MHG.
[7] TGI Paris, 3e, 8 novembre 2011, n° 10/00437, inédit {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 5655815, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "TGI Paris, 3\u00e8me, 08-11-2011, n\u00b0 10/00437", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A2634H4C"}}.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485893
[Jurisprudence] La preuve de la faute d’un salarié par un système de géolocalisation
Réf. : Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-22.852, F-D N° Lexbase : A97609KP
Lecture: 17 min
N5775BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Claire Chambas et Elise Guilcher, INLO avocats
Le 29 Juin 2023
Mots-clés : contrat de travail • faute disciplinaire • géolocalisation • preuve • principe de loyauté • contrôle de proportionnalité • preuve illicite
L’utilisation d’un système de géolocalisation des véhicules de la société par l’employeur ne doit pas permettre un contrôle permanent du salarié en collectant des données relatives à la localisation de son véhicule en dehors de ses horaires et de ses jours de travail.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2023, précise à nouveau les conditions de recevabilité d’une preuve obtenue par l’employeur au moyen d’un système de géolocalisation.
Dans cet arrêt, un salarié a été licencié pour faute grave en raison d’une utilisation abusive du véhicule de la société à des fins personnelles. Pour démontrer que le salarié utilisait ce véhicule de service en dehors de ses horaires et de ses jours de travail, l’employeur produit devant le juge des données recueillies au moyen d’un système de géolocalisation.
La géolocalisation porte évidemment atteinte à de très nombreux droits ou libertés en constituant une ingérence dans la vie privée des salariés, son utilisation doit donc être strictement encadrée.
Le salarié considère alors que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié repose uniquement sur une preuve illicite, car l’employeur ne justifie pas du respect des conditions préalables à la mise en place d’un système de géolocalisation ni de la proportionnalité du traitement des données de localisation par rapport à la finalité poursuivie.
La Cour de cassation, au visa de l’article L. 1121-1 du Code du travail N° Lexbase : L0670H9P, va confirmer la position de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en considérant que les données collectées avaient porté une atteinte disproportionnée aux droits et libertés individuelles du salarié, et constituaient dès lors des preuves irrecevables.
La décision de la Cour de cassation rappelle le contrôle de la licéité des preuves obtenues au moyen d’un dispositif de contrôle des salariés qui, lorsqu’il est illicite, doit être en principe écarté des débats (I). Par exception, la preuve obtenue de manière illicite peut être acceptée par le juge si le droit à la preuve de l’employeur le justifie (II).
I. Principe : La licéité de la preuve produite en justice
L’arrêt du 22 mars 2023, comme les précédents rendus par la Cour de cassation sur ce sujet, appelle à une certaine méthodologie pour déterminer la recevabilité d’une preuve obtenue au moyen d’un système de géolocalisation.
La licéité des preuves obtenues au moyen d’un dispositif de contrôle des salariés repose en réalité sur deux principes complémentaires : le principe de loyauté dans l’administration de la preuve qui interdit d’opposer à une personne une preuve obtenue à son insu (A), et le principe de proportionnalité lors de la mise en place d’un procédé portant atteinte à une liberté fondamentale (B).
A. La nécessité d’informer préalablement sur le moyen de preuve et sa finalité
La Cour de cassation a posé un principe de loyauté de la preuve en droit civil (Cass. ass. plén., 7 janvier 2011, n° 09-14.316, publié au bulletin N° Lexbase : A7431GNK). En droit du travail, ce principe s’oppose à la recevabilité de preuves obtenues au moyen d’un procédé clandestin de surveillance des salariés.
Ainsi, l’employeur est soumis à une obligation de transparence à l’égard des salariés concernés, mais également à l’égard des représentants du personnel, concernant à la fois le dispositif mis en place et sa finalité (1). De plus l’utilisation faite de ce dispositif doit correspondre à l’information donnée par l’employeur aux salariés et aux représentants du personnel (2).
1) L’obligation de transparence
- L’information individuelle
L’article L. 1222-4 du Code du travail N° Lexbase : L0814H9Z dispose qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Dans le cadre de la mise en place d’un système de géolocalisation, l’information individuelle du salarié doit porter sur la mise en œuvre du système, la finalité poursuivie par ce système et les données collectées.
Les preuves obtenues au moyen d’un dispositif qui n’a pas été préalablement porté à la connaissance du salarié doivent être considérées comme illicites.
- L’information collective
Les articles L. 2312-37 N° Lexbase : L1434LKC et L. 2312-38 N° Lexbase : L8271LGG du Code du travail prévoient l’obligation, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, de consulter le comité social et économique (CSE) préalablement à la décision de mise en œuvre de moyens de contrôle de l’activité des salariés. La consultation préalable du CSE doit également porter sur l’utilisation qui en est prévue (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-11.792, FS-P+B N° Lexbase : A1613Z8A).
En l’absence de consultation préalable du CSE, la preuve obtenue par le dispositif de surveillance sera regardée comme illicite (Cass. soc., 2 novembre 2016, n° 15-20.540, F-D N° Lexbase : A8964SEQ).
2) L’obligation d’une utilisation conforme à l’information donnée
Il ne suffit pas que le système de géolocalisation soit porté à la connaissance des salariés et du CSE, encore faut-il qu’il soit utilisé conformément aux finalités énoncées avant sa mise en place.
Cette précision a été apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2022 (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5253HZL) : « Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la CNIL, et portées à la connaissance des salariés ».
| À noter. – Les systèmes de géolocalisation des véhicules professionnels des employés n’ont plus à être déclarés à la CNIL depuis le 25 mai 2018, date d’entrée en application du RGPD. |
Le respect de l’ensemble de ces éléments est essentiel pour reconnaître la licéité de la preuve et permettre l’utilisation par l’employeur de cette preuve notamment pour justifier l’existence d’une faute disciplinaire du salarié.
Dans l’arrêt commenté, l’employeur établit l’existence de la déclaration de son système de géolocalisation des véhicules de service à la CNIL (obligation antérieure au RGPD) et de la consultation des représentants du personnel, mais ne justifie pas de l’information individuelle du salarié.
En l’absence de cette information individuelle, la cour d’appel a considéré que le système de géolocalisation est un procédé de contrôle illicite, et la preuve obtenue par un tel procédé est irrecevable.
La cour ne s’arrête pas à cette constatation et elle examine, dans un second temps, si le recours à la géolocalisation était indispensable pour assurer le suivi du temps de travail des salariés en recourant au test de proportionnalité.
B. Le contrôle du respect du principe de proportionnalité
Comme tout procédé technique de contrôle de l’activité des salariés, le pointage effectué au moyen d’un système de géolocalisation est soumis à une stricte exigence de proportionnalité, car il porte atteinte à de nombreux droits et libertés des salariés.
Cette obligation découle de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS, devenu l’article 4 de la loi « Informatique et Libertés » [1] : « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : /1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite […] /3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs… » et de l’article L. 1121-1 du Code du travail N° Lexbase : L0670H9P qui prévoit un principe général selon lequel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Pour déterminer si ce principe est respecté, les juges ont recours au test de proportionnalité, qui consiste à mettre en balance la finalité poursuivie par l’employeur (en l’espèce, le contrôle de l’activité du salarié) avec les droits et libertés fondamentaux du salarié auxquels il est porté atteinte (en l’espèce, le droit au respect de sa vie privée).
Le test de proportionnalité en matière de contrôle du salarié par un système de géolocalisation a été défini par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 3 novembre 2011 (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5253HZL) dans lequel la Haute juridiction est venue poser deux principes :
- l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. Ainsi, un tel contrôle sera, par exemple, jugé illicite sur un cadre au forfait annuel en jours, qui est censé disposer d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ;
- l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen. Le Conseil d’État est par ailleurs venu préciser qu’il importe peu que le moyen de contrôle alternatif soit moins efficace. Si un autre moyen de contrôle existe, le système de géolocalisation sera considéré comme excessif au sens du 3°, de l’article 6, de la loi du 6 janvier 1978 précité (CE, 9e-10e ch. réunies, 15 décembre 2017, n° 403776, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1345W8C).
Sur ce point, la Cour relève dans l’arrêt du 22 mars 2023 qu’en application du décret n° 2003-1242, du 22 décembre 2003, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes N° Lexbase : L9722DLN, l’employeur avait l’obligation d’enregistrer la durée du temps de travail au moyen d’un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués. Ainsi le recours à la géolocalisation n’était pas indispensable pour mesurer le suivi du temps de travail de son personnel, puisqu’il pouvait être assuré par un autre moyen, certes moins efficace.
De plus l’arrêt précise que : « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n’est pas justifiée pour localiser le conducteur en dehors du temps de travail ».
La Cour considère que le système de géolocalisation des véhicules de la société avait permis un contrôle permanent du salarié, en collectant des données relatives à la localisation de son véhicule en dehors de ses horaires et de ses jours de travail, de sorte que cette atteinte importante à son droit à une vie personnelle était disproportionnée par rapport au but poursuivi, et a pu en déduire que les données collectées étaient irrecevables.
La cour d’appel a, dans ce contexte, rejeté la preuve apportée par l’employeur sans vérifier, car cela ne lui était pas demandé, si le droit à la preuve ne justifiait pas l’utilisation d’une preuve obtenue de manière illicite.
II. Par exception le droit à la preuve justifie la production de preuve illicite
Depuis quelques années, la jurisprudence admet écarter les arguments concernant l’atteinte à la vie privée au profit du droit à la preuve (A) permettant la production en justice de preuves obtenues de manière illicite (B).
A. L’utilisation du droit à la preuve
Traditionnellement, lorsqu’un moyen de preuve était obtenu de manière déloyale, celui-ci devait automatiquement être déclaré irrecevable par les juges du fond et rejeté des débats.
La Cour de cassation, depuis un arrêt du 25 novembre 2020 (Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5510379) considère désormais que l’illicéité d’un moyen de preuve au regard des dispositions de la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801, du 6 août 2004 N° Lexbase : L0722GTW, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du RGPD, ne doit pas entraîner systématiquement son rejet des débats. Le juge doit apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve de l’employeur.
Le droit à la preuve peut justifier la production d’une preuve illicite si elle est indispensable à l’exercice de ce droit et si l’atteinte portée aux droits des personnes et libertés fondamentales est proportionnée au regard du but poursuivi.
Ainsi, sur le fondement du droit à la preuve, la jurisprudence est intervenue à plusieurs reprises pour reconnaître recevable une preuve obtenue de manière illicite qui aurait auparavant été déclarée irrecevable.
Les juges du fond doivent donc rechercher, dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité, si l’atteinte portée à la vie privée du salarié par la production de cette preuve obtenue de manière déloyale est justifiée au regard du droit à la preuve de l’employeur et sous réserve d’être indispensable à l’exercice de ce droit, et strictement proportionnée au but poursuivi.
Un des moyens du pourvoi de l’arrêt du 22 mars 2023 reprochait le rejet de la preuve illicite des débats sans prise en compte par le juge de l’atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, mettant en balance les droits du salarié et le droit de l’employeur à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments obtenue illicitement à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte aux droits du salarié, à la supposer établie, soit proportionnée au but poursuivi.
Cependant, cet argumentaire n’avait pas été développé devant les juges du fond, donc la Cour de cassation rejette ce moyen en précisant que « la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par le moyen, laquelle ne lui était pas demandée, a pu déduire que les données collectées à partir du système de géolocalisation portaient une atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale, et étaient dès lors irrecevables. »
La preuve illicite est donc écartée des débats sans vérifier la proportionnalité de l’atteinte au droit à la preuve.
Une solution différente a été décidée dans d’autres arrêts où les juges du fond ont considéré que le droit à la preuve justifiait la production d’éléments obtenus de manière illicite.
B. La production en justice d’une preuve obtenue de manière illicite
L’utilisation d’une preuve obtenue de manière illicite a été admise par la jurisprudence obligeant les juges à réaliser, en matière de contrôle de l’activité des salariés, deux contrôles de proportionnalité :
- celui consistant à mettre en balance la finalité poursuivie par l’employeur (le contrôle de l’activité du salarié) avec les droits et libertés fondamentaux du salarié ;
- et, si la preuve a été obtenue de manière déloyale, à l’insu du salarié, celui consistant à mettre en balance le droit à la preuve de l’employeur avec les droits et libertés fondamentaux du salarié.
Ainsi, après avoir déterminé si la preuve est licite, au regard du principe de loyauté, et du test de proportionnalité, le juge pourra vérifier si le droit à la preuve justifie une atteinte au droit à la vie privée du salarié pour accepter une preuve considérée comme illicite.
En conséquence, l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son irrecevabilité en cas de contentieux.
Cette jurisprudence a été confirmée par trois arrêts rendus le 8 mars 2023 [2], la Chambre sociale confirme le principe selon lequel le droit à la preuve peut, en effet, justifier la production d’une preuve illicite si elle est indispensable à l’exercice de ce droit et si l’atteinte portée à la vie personnelle du salarié est proportionnée au regard du but poursuivi.
Après avoir rappelé ce principe, les juges vérifient dans les faits la proportionnalité de l’atteinte à la vie personnelle du salarié et du droit à la preuve de l’employeur.
Dans un des arrêts du 8 mars 2023, la Cour de cassation considère que les enregistrements litigieux n’étaient pas indispensables à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, dès lors que celui-ci disposait d’un autre moyen de preuve – en l’espèce un audit – qu’il n’avait pas versé aux débats. Il s’agissait d’un dispositif de vidéo surveillance clandestine qui n’avait pas été porté à la connaissance des salariés. Ce dispositif confirmait les soupçons de vol mis en lumière par un audit réalisé dans l’entreprise. L’employeur avait donc d’autres procédés pour prouver la faute du salarié et les enregistrements litigieux ont été écartés des débats (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17.802, FS-B N° Lexbase : A92179GH).
En revanche, dans un autre arrêt du 8 mars 2023, la Haute juridiction admet la production en justice d’une preuve illicite à la double condition qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte au respect de la vie personnelle du salarié soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il s’agissait, en l’espèce, d’informations collectées par un système de badgeage. Ce système, situé à l’entrée de l’entreprise, avait été déclaré à la CNIL et présenté au CSE comme ayant pour seule finalité le contrôle des accès aux locaux et parkings, mais son utilisation pour contrôler l’activité et les horaires de travail dépassait la finalité prévue et était donc illicite. La cour d’appel avait écarté la preuve illicite des débats. La Cour de cassation casse cette décision au motif que les juges du fond auraient dû vérifier si la preuve litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-20.798, FS-D N° Lexbase : A08949HL).
| Depuis quelques années, le juge admet que le droit à la preuve justifie la production en justice d’éléments obtenus de manière déloyale, à l’insu des salariés. Cependant, la Cour de cassation n’abandonne pas pour autant son « test de proportionnalité », et si une telle preuve illicite est jugée recevable au nom du droit à la preuve, ce n’est qu’à la condition d’être indispensable à l’exercice de ce droit, et strictement proportionnée au but poursuivi. |
[1] Modifié par l’ordonnance n° 2018-1125, du 12 décembre 2018 N° Lexbase : L3271LNH.
[2] Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-20.798, FS-D N° Lexbase : A08949HL ; Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17.802, FS-B N° Lexbase : A92179GH ; Cass. soc., 8 mars 2023, n° 20-21.848, FS-B N° Lexbase : A08979HP.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485775
[Jurisprudence] Huissiers et significations internationales : attention danger !
Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 21-23.773, F-B N° Lexbase : A39429UK
Lecture: 23 min
N6055BZB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charles Simon, avocat au Barreau de Paris, administrateur de l’Association des avocats et praticiens des procédures et de l’exécution (AAPPE) et de Droit & Procédure
Le 28 Juillet 2023
Mots-clés : saisie-attribution • notification internationale • caractère exécutoire du titre • responsabilité de l’huissier
En matière internationale, la date de la notification d’un jugement faite « à distance » est celle à laquelle le destinataire est effectivement touché. En conséquence, le jugement ne devient exécutoire qu’à cette date et des mesures d’exécution forcées ne peuvent pas être accomplies avant cette date. L’huissier doit vérifier tout cela.
Un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-23.773) est un feu d’artifice des difficultés qu’on peut rencontrer en matière de notifications, en particulier internationales, des jugements et des actes d’exécution forcée (II) : notification par le greffe et signification, par définition par huissier, concurrentes ; système de la double date ; augmentation des délais de contestation des saisies-attribution pour les personnes demeurant à l’étranger ; moment du certificat de non-contestation, tout y passe.
Cerise sur le gâteau, il y est aussi question de responsabilité de l’huissier instrumentaire (III), facialement ou en sous-main. En effet, en l’espèce, l’huissier mis en cause pilotait la procédure avec un correspondant pour la réalisation matérielle de certains actes.
Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut d’abord revenir sur les faits (I).
I. Les faits : l’exécution de jugements prud’homaux contre une banque étrangère
A. Les jugements prud’homaux de septembre 2019 et leurs notifications à l’étranger en mars 2020 au plus tard
En l’espèce, l’arrêt d’appel dont pourvoi (CA Paris, Pôle 1 Chambre 10, 2 septembre 2021, n° 20/14029 N° Lexbase : A195143N) expose que le conseil des prud’Hommes de Paris a rendu dix-huit jugements à l’encontre de la Banque Centrale Populaire du Maroc le 17 septembre 2019.
En application de l’article R. 1454-26 du Code du travail N° Lexbase : L6683LEA, le greffe du conseil des prud’Hommes a procédé à la notification de ces jugements, par lettres recommandées avec accusé de réception, à une date inconnue. La Banque Centrale Populaire du Maroc a effectivement reçu ces notifications le 9 juin 2020 selon l’arrêt de cassation.
En parallèle, les bénéficiaires des jugements ont fait signifier les jugements le 6 mars 2020, c’est-à-dire notifier par huissier aux termes de l’article 651 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6814H7I. La Banque Centrale Populaire du Maroc a effectivement reçu ces significations le 27 juillet 2020.
B. Les saisies-attributions d’avril 2020 et le paiement des sommes saisies en juillet 2020
Le 20 avril 2020, les bénéficiaires des jugements ont chacun fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Natixis à l’encontre de la Banque Centrale Populaire du Maroc.
Selon l’arrêt d’appel, ces saisies ont permis d’appréhender plus de quatre millions d’euros. Elles ont été dénoncées le 27 avril 2020.
L’huissier a dressé les certificats de non-contestation le 1er juillet 2020 et les a signifiés à Natixis le 6 juillet 2020. À la suite de quoi, Natixis s’est libérée des sommes saisies entre les mains de l’huissier le 9 juillet 2020.
C. La contre-attaque de la Banque Centrale Populaire du Maroc, sans doute en août 2020, et l’annulation des saisies en septembre 2020 et l’aménagement de l’exécution provisoire en novembre 2020
Ce n’est que postérieurement à la libération des sommes que la Banque Centrale Populaire du Maroc a mené une contre-attaque sur deux fronts, en assignant les bénéficiaires des jugements :
- le 24 août 2020 devant le Juge de l’exécution, en contestation des saisies pratiquées ;
- à une date inconnue devant le premier Président de la Cour d’appel, en aménagement de l’exécution provisoire, à savoir la consignation des sommes dues au titre des jugements dans l’attente de l’arrêt d’appel sur les jugements prud’homaux.
Par jugement du 24 septembre 2020, le Juge de l’exécution a annulé les saisies.
Par ordonnances du 12 novembre 2020, le premier Président de la Cour d’appel a aménagé l’exécution provisoire.
D. La mise en cause de l’huissier
Outre l’annulation des saisies, la Banque Centrale Populaire du Maroc demandait au Juge de l’exécution de condamner l’huissier ayant pratiqué les saisies, aux motifs qu’il était garant de la légalité des poursuites.
Le juge de l’exécution s’y est refusé, de même que la cour d’appel. C’est le point sur lequel un pourvoi a été formé et auquel la Cour de cassation répond donc dans son arrêt.
Particularité de l’espèce, deux huissiers de justice avaient réalisé les différents actes.
L’huissier de justice qui était poursuivi en responsabilité n’était pas celui ayant pratiqué les saisies et délivré les certificats de non-contestation, mais celui qui avait procédé à la signification du jugement et à la dénonciation des saisies.
En effet, selon la Banque Centrale Populaire du Maroc, l’huissier ayant pratiqué les saisies et établi les certificats de non-contestation n’était que le mandataire de celui qui avait procédé à la signification du jugement et à la dénonciation des saisies. Ce dernier était lui-même le mandataire désigné par les bénéficiaires des jugements pour procéder aux saisies.
On était donc face à des mandats en cascade, le « cerveau » étant le premier huissier qui pilotait le second, pour des raisons de compétence territoriale.
II. Les difficultés multiples en matière de notification
A. La question de la notification multiple
Le cas d’espèce est représentatif du fouillis qui peut exister en pratique en matière de notification des jugements, plusieurs notifications s’empilant les unes sur les autres.
Le principe est pourtant simple en apparence. Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6620H7C: « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »
La notification est, par principe, à l’initiative des parties, par voie d’huissier, c’est-à-dire par signification aux termes de l’article 651 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6814H7I ainsi qu’il a été vu.
Mais elle peut être à l’initiative du greffe lorsque les textes le prévoient. Elle a alors habituellement lieu par lettre recommandée avec accusé de réception.
C’était le cas en l’espèce, s’agissant de jugements du Conseil des prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail ainsi qu’il a aussi été vu.
La notification par le greffe n’empêche cependant pas la signification à l’initiative des parties. D’autant que la notification par le greffe est incertaine, dépendant des diligences :
- du greffe (qui peut mettre du temps à y procéder ou perdre les preuves d’envoi et de réception) ;
- des services postaux (qui peuvent aussi mettre du temps à y procéder ou égarer le courrier) ;
- du destinataire de la notification (qui peut ne pas aller chercher la lettre recommandée).
C’est pourquoi une double notification est courante quand le greffe notifie le jugement, les parties y procédant également en parallèle, par voie de signification.
Cette notification multiple n’a pas pour effet de donner une date multiple aux effets attachés à la notification.
Par exemple, en cas de notification multiple, c’est la première qui fait courir le délai de recours (Cass. civ. 2, 5 février 2009, n° 07-13.589, FS-P+B N° Lexbase : A9453EC4 ; Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-12.914, F-B N° Lexbase : A14857IT), puisqu’il s’agit d’un des autres effets de la notification aux termes de l’article 528 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6676H7E.
En l’espèce, la double notification réalisée par le greffe à une date inconnue et par huissier de justice le 6 mars 2020 est donc l’illustration d’une pratique courante. L’objectif pour les bénéficiaires du jugement, en procédant à une signification par huissier en parallèle de la notification par le greffe, était double :
- d’assurer la notification, en se prémunissant contre un défaut de diligence du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris, des services postaux ou de la Banque Centrale Populaire du Maroc, destinataire de l’acte ;
- possiblement, d’avancer le point de départ du délai d’appel et la date à laquelle les jugements obtenus étaient exécutoires.
B. Système de la double date
Sur ce dernier point, une difficulté particulière existait en l’espèce, dès lors que le destinataire de l’acte se trouvait à l’étranger.
En effet, le propre de l’huissier est que, par principe, lorsqu’il doit délivrer un acte, il se déplace à l’endroit où le destinataire de l’acte demeure pour les personnes physiques ou est établi pour les personnes morales (CPC, art. 689 N° Lexbase : L6890H7C et 690 N° Lexbase : L6891H7D). S’il ne peut pas remettre l’acte à quelqu’un sur place, il doit procéder à des vérifications pour s’assurer que la personne demeure bien à l’adresse indiquée (CPC, art. 656 N° Lexbase : L6825H7W).
Du fait des diligences matérielles que l’huissier accomplies, l’acte est réputé fait au jour où l’huissier s’est rendu sur place, même s’il ne rencontre pas le destinataire de l’acte (CPC, art. 664-1 N° Lexbase : L4822ISE).
Mais l’huissier ne peut pas procéder à ces diligences dès lors que le destinataire de l’acte demeure à l’étranger. C’est pourquoi l’article 664-1 du Code de procédure civile prévoit une exception, par renvoi à l’article 647-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0172IP3, dans le cas où la notification doit être faite à l’étranger. La date de notification est alors, pour celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier. Quant au destinataire, la date de notification est, par principe, celle à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié (CPC, art. 687-2 N° Lexbase : L1181LQS).
C’est ce qu’on appelle le système de la double date.
Ce système n’est pas universellement reconnu. Par exemple, la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Partir du point de vue du demandeur est révélateur. En effet, le système de la double date est protecteur pour le destinataire de l’acte. Par exemple, c’est seulement à compter de la réception effective de la signification du jugement par le destinataire demeurant à l’étranger que le délai d’appel commencera à courir et non à la date de remise au Parquet (Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-13.501, F-D N° Lexbase : A02877H4).
Du point de vue de la personne à l’origine de l’acte, pour laquelle la date de signification est celle de sa remise à Parquet, cela crée cependant une longue période d’incertitude comme la jurisprudence l’illustre. Ainsi, dans le cas d’une partie taïwanaise, le jugement avait été remis à Parquet le 21 septembre 2016. Mais il n’avait été effectivement remis à cette partie étrangère que le 30 mars 2017, soit six mois plus tard. Avec l’augmentation des délais prévus à l’article 644 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6757LEY pour les parties demeurant à l’étranger, la partie taïwanaise pouvait ainsi faire appel jusqu’au 30 juin 2017, neuf mois après la date de signification du jugement pour la partie y ayant procédé.
Dans le cas d’une dénonciation d’une saisie-attribution, l’incertitude crée même une situation inextricable pour l’huissier qui y procède puisque l’acte de dénonciation de la saisie-attribution doit indiquer, à peine de nullité, non seulement que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte, mais encore la date à laquelle le délai de contestation expire (CPCEx, R. 211-3, 2° N° Lexbase : L2667ITX).
Or, l’huissier de justice ne peut pas connaître cette date au moment il notifie l’acte à l’étranger puisque le délai d’un mois ne commencera pas à courir à la date où il envoie l’acte, mais à celle où il sera effectivement remis à son destinataire à l’étranger. La date d’expiration du délai qu’il est obligé de mentionner sur son acte est donc nécessairement fausse.
Enfin, l’incertitude que le système de la double date crée devient même une attente potentiellement insupportable quand il s’agit non pas de faire courir les délais, mais de faire exécuter le jugement. D’autant que, en pratique, il arrive parfois que l’huissier de justice n’obtienne jamais aucun retour de la notification à l’étranger. Dans ce cas, le jugement se trouve, de fait, réduit à néant puisqu’il ne pourra jamais être exécuté, faute d’être devenu exécutoire, malgré la signification qui en a été faite.
C. Le choix des juges de protéger le débiteur du jugement et les contre-mesures à la disposition du créancier
En l’espèce, les juges successifs ne s’embarrassent cependant pas de telles considérations pratiques. La seule question qui est posée devant la Cour d’appel et la Cour de cassation est celle de savoir si l’huissier a commis une faute en ne vérifiant pas que le titre en vertu duquel il pratiquait une saisie était exécutoire.
C’est-à-dire que, de façon cohérente avec la jurisprudence en matière de point de départ du délai de recours, les juges successifs considèrent que le jugement ne devient exécutoire qu’au jour où il est effectivement remis à l’étranger à la personne à qui on l’oppose.
Ceci posé, comment, en pratique, contourner la difficulté pour le créancier qui ne souhaite pas attendre le retour de la notification à l’étranger pour commencer à exécuter son jugement ?
On peut penser à la saisie conservatoire, d’autant que la mise en œuvre de celle-ci est facilitée en l’espèce. En effet, aux termes de l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5914IRH: « une autorisation préalable du juge [pour pratiquer une mesure conservatoire] n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. »
Le créancier de l’exécution pourra ainsi placer l’argent de côté, dans l’attente du retour de la notification faite à l’étranger et de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. Si, bien sûr, la notification revient un jour…
La difficulté est cependant que la détention d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire ne dispense pas le créancier, en cas de contestation devant le juge de l’exécution, d’avoir à prouver la réunion des deux conditions nécessaires pour pratiquer une mesure conservatoire (CPCEx, art. R. 512-1 N° Lexbase : L2544ITE).
Pour rappel, il s’agit (CPCEx, art. L. 511-1 N° Lexbase : L5913IRG) de l’existence :
- d’une créance paraissant fondée en son principe ;
- et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La première condition ne pose pas de difficulté en présence d’un jugement. La seconde est plus épineuse.
En effet, tout d’abord, il est douteux que le seul fait que le débiteur demeure à l’étranger suffise à caractériser une menace sur le recouvrement. Aucun précédent ne semble, en tout cas, avoir retenu cette seule circonstance comme permettant de justifier une mesure conservatoire. Ensuite, dans le cas d’espèce, le débiteur est une banque, a priori solvable, même pour une créance de plus de quatre millions euros. Preuve en est, les saisies-attributions ont manifestement été fructueuses. L’existence d’un risque objectif sur le recouvrement paraît donc difficile à établir.
Le recours à une mesure conservatoire n’est ainsi pas une solution qui permet, à coup sûr, de garantir les sommes dues, dans l’attente du retour de la notification du jugement à l’étranger. Mais, faute de grives…
D. L’augmentation des délais de contestation pour le saisi demeurant à l’étranger
Autre difficulté que le cas d’espèce illustre, le fait que le délai de contestation des saisies-attributions soit augmenté lorsque le saisi demeure à l’étranger est loin d’être certain.
En l’espèce, la Banque Centrale Populaire du Maroc reprochait à l’huissier d’avoir mentionné dans ses actes de dénonciation du 27 avril 2020 que le délai de contestation des saisies pratiquées expirait le 27 mai 2020.
La cour d’appel a retenu, comme une évidence, que l’augmentation de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger, prévue à l’article 644 du Code de procédure civile, s’appliquait effectivement au délai de contestation. En conséquence, les actes de dénonciation auraient dû indiquer le 27 juillet 2020 comme date d’expiration du délai de contestation des saisies pratiquées, mais rien n’est moins sûr.
L’article 644 du Code de procédure civile réserve en effet l’augmentation des délais aux délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition et de recours en révision. La Cour de cassation a une interprétation stricte de cette liste et refuse, par exemple, d’appliquer l’augmentation des délais à :
- un recours présenté au directeur général de l’Inpi (Cass. civ. 2, 14 mai 2013, n° 12-15.127, F-P+B N° Lexbase : A5135KDK) ;
- une demande en revendication d’un bien dans le cadre d’une procédure collective (Cass. Com., 7 février 2006, n° 04-19.342, F-P+B N° Lexbase : A8470DMN) ;
- la requête en déféré qui est un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel et n’ouvre pas une instance autonome (Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-23.992, F-P N° Lexbase : A2014XAT).
La meilleure doctrine pense qu’il ne devrait pas être possible d’appliquer l’augmentation des délais au délai de contestation des saisies-attributions, tout en le regrettant (S. Guinchard, T. Moussa, N. Cayrol, E. de Leiris, siècle la dir., Dalloz Action Droit et pratique des voies d’exécution 2022|2023¸10e éd., Dalloz, 2022, 822.85). Nous sommes du même avis, à la fois sur l’analyse des textes et sur le caractère regrettable de leurs conséquences en l’espèce.
La Cour de cassation ne semble pas s’être penchée sur ce point et, quand le point est soulevé devant les juges du fond, leurs justifications pour trancher dans un sens ou l’autre semblent être aussi évanescentes que dans le cas d’espèce. Un juge de l’exécution parisien se distingue cependant, en justifiant sa décision de la façon suivante : le délai de contestation serait un délai de comparution (TJ Paris, 3 janvier 2022, n° 21/81534 [LXB=A58027W]). En conséquence, il bénéficie de l’augmentation des délais lorsque le saisi demeure à l’étranger.
La procédure commencerait ainsi par la saisie, suivie par sa dénonciation. Puis la dénonciation déclencherait un délai pour le saisi afin de comparaître devant le juge de l’exécution, pour contester la saisie.
L’idée est intéressante. Reste qu’on est ici, à notre sens, en pleine spéculation intellectuelle.
E. Le moment du certificat de non-contestation
Dernière difficulté que le cas d’espèce soulève, le débiteur reprochait à l’huissier de justice d’avoir délivré le certificat de non-contestation le 1er juillet 2020, alors que le délai de contestation n’était pas écoulé, puisqu’il ne commençait à courir qu’à la réception effective de la dénonciation, soit, ici, le 27 juillet 2020.
La cour d’appel, confirmant le jugement, écarte le moyen, en l’absence de grief. Mais le rejet s’imposait pour une raison bien plus fondamentale : le délai à l’expiration duquel l’huissier peut établir le certificat de non-contestation n’est pas aligné avec l’expiration du délai de contestation.
Au contraire, l’article R. 211-6 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2212IT4 dispose que : « le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. »
En l’espèce, la dénonciation des saisies pratiquées datait du 27 avril 2020. L’huissier de justice n’a donc fait que relater la réalité quand il a attesté qu’aucune contestation n’avait été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, quand bien même il aurait eu conscience que le délai de contestation n’était pas expiré.
C’est une énième bizarrerie des saisies-attributions dans un environnement international.
III. La responsabilité de l’huissier
A. L’obligation de vérification du caractère exécutoire du titre mis à la charge de l’huissier de justice
On ne peut que plaindre l’huissier au vu des éclipses, non-dits et autres fausses évidences auxquels il doit faire face dès lors qu’il doit réaliser une saisie-attribution à l’encontre d’un débiteur demeurant à l’étranger.
Le point de départ des délais et les délais eux-mêmes sont incertains et flottants.
Pourtant, la Cour de cassation délivre pour sa part un message simple :
« Vu les articles 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 et L. 122-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5811IRN :
« 5. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie. »
Exit donc la bienveillance dont le Juge de l’exécution et la cour d’appel avaient fait preuve à l’égard de l’huissier, en retenant qu’il n’était pas juge de la régularité des significations auxquelles il procède.
Au vrai, ce n’est pas une nouveauté, la Cour de cassation ne fait ici qu’adapter un précédent attendu de principe, posé il y a neuf ans et répété une fois depuis, selon lequel il incombe à l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre provisoire, en vertu duquel il pratique une mesure d’exécution forcée aux risques du créancier mandant, restait exécutoire au jour de l’acte de saisie (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 14-29.776, FS-P+B N° Lexbase : A7244R43 ; Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-25.511, FS-P+B+I N° Lexbase : A0458MLK).
Mais ces précédents étaient dans un cadre franco-français où les dates et les délais ne bougeaient pas comme en sarabande.
Quoi qu’il en soit, de façon plus générale, la Cour de cassation ne fait que répéter l’idée selon laquelle l’huissier est tenu de veiller à la validité et à l’efficacité des actes qu’il est requis de délivrer et doit réunir les justificatifs nécessaires à son intervention (Cass. civ. 1, 12 septembre 2019, n° 18-17.783, FS-P+B N° Lexbase : A4798ZNZ). Il ne peut donc pas se réfugier derrière le fait qu’il ne savait pas, même dans un cas comme celui d’espèce où bien malin celui qui a des certitudes.
B. Quel huissier responsable en cas de mandats en cascade
Dernier point d’intérêt de cette affaire, ainsi qu’il a été vu, l’huissier dont la responsabilité était recherchée n’était pas celui qui avait pratiqué les saisies et établi les certificats de non-contestation, mais celui qui avait procédé à la signification du jugement et à la dénonciation des saisies.
On était en réalité face à des mandats en cascade : l’huissier qui avait pratiqué les saisies et établi les certificats de non-contestation l’avait fait sous la direction de l’autre. C’est la pratique du « pilotage ».
Cette pratique est courante et se rencontre quand des huissiers différents sont territorialement compétents pour réaliser les actes successifs permettant de mettre à bien l’exécution d’un jugement.
Pour prendre un exemple, soit un débiteur qui demeure à Paris, mais qui possède une résidence secondaire à Deauville. C’est un huissier dont l’étude est située dans le ressort de la cour d’appel de Paris qui procèdera à la signification du jugement au domicile parisien du débiteur et c’est un huissier dont l’étude est située dans le ressort de la cour d’appel de Caen qui procèdera à la saisie des meubles de la résidence secondaire deauvillaise du débiteur.
En pratique, les différents huissiers interviendront souvent sur les ordres d’un seul qui aura reçu mandat du créancier. C’était le cas en l’espèce. C’est pourquoi la cour d’appel a retenu que l’huissier-pilote pouvait voir sa responsabilité engagée, y compris pour les actes réalisés par l’huissier piloté.
La solution est logique. En effet, l’huissier peut engager sa responsabilité personnelle envers les tiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, en particulier envers celui contre qui il a exécuté à tort (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 14-29.776, FS-P+B N° Lexbase : A7244R43). L’arrêt de cassation est d’ailleurs ici rendu au visa de l’article 1240 du Code civil. Or, la plasticité de la responsabilité délictuelle de droit commun fait que l’huissier-pilote doit aussi répondre des fautes de l’huissier qu’il se substitue, dès lors qu’il est bien à l’origine du dommage, pour en être l’auteur intellectuel.
Cette affaire est donc l’occasion de faire ressortir cette pratique du pilotage et ses risques pour l’huissier-pilote qui ne peut pas se réfugier derrière le fait qu’il n’est pas l’auteur matériel des faits reprochés.
Après ce très long commentaire, balayant une multitude de problèmes pratiques liés à la notification internationale des actes, en particulier d’exécution forcée, on conclura en remerciant les huissiers qui ont le courage, ou l’inconscience, de se risquer à s’y livrer.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486055
[Jurisprudence] Une signification qui fait des vagues
Réf. : CA Versailles, 16e ch., 13 avril 2023, n° 22/06484 N° Lexbase : A78299PN
Lecture: 16 min
N5776BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandre Duflos, Commissaire de justice associé - Médiateur (SAS Nemesis)
Le 21 Août 2023
Mots-clés : commissaire de justice • signification • dépôt étude • lieu de travail • domicile • avis de passage
La cour d’appel de Versailles consacre l’efficacité de la signification par commissaire de justice en retenant qu’aucune obligation ne lui est faite de signifier à personne sur le lieu de travail dès lors que le domicile du destinataire est certain. Il n’a pas à préciser à quel endroit exactement il a déposé l’avis de passage.
La vie de commissaire de justice n’est pas un long fleuve tranquille.
Ce professionnel du droit se trouve parfois confronté dans son ministère de signification à des habitats insolites, éloignés de la notion classique d’habitation : squats, baraquements le long d’autoroutes, etc. Tel est le cas de la présente espèce où le commissaire de justice devait signifier une décision de justice à un destinataire qui avait fait d’une péniche son habitation principale.
Dans cette affaire, la Direction générale des Finances publiques a fait procéder à la saisie de la péniche appartenant à la débitrice pour avoir paiement de divers impôts et taxes. Après dénonciation de l’acte de saisie à la débitrice, la créancière a assigné cette dernière devant le juge de l’exécution de Pontoise afin qu’il soit procédé à la vente forcée du bateau, laquelle fut ordonnée selon jugement rendu le 31 mai 2022.
Afin de couvrir la tardiveté de son appel et dire que le délai n’a pas couru, la débitrice demande l’annulation de l’acte de signification du jugement, en reprochant au commissaire de justice :
- de ne pas avoir tenté une signification sur son lieu de travail, alors qu’il ne pouvait s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte, et que celui-ci était absent ;
- d’avoir laissé un avis de passage à son adresse sans aucune précision permettant de savoir où et comment il a été déposé.
La cour d’appel de Versailles balaie cette argumentation et déclare l’appel irrecevable comme tardif.
Plus encore, sa lecture apporte des précisions intéressantes sur la place de la remise sur le lieu de travail au sein des modes de signification (I), ainsi que sur l’obligation pour le commissaire de justice de déposer un avis de passage au domicile ou à la résidence du destinataire lorsque la signification à personne s’avère impossible (II).
I. La signification sur le lieu de travail
La cour d’appel confirme que dans la hiérarchie des modes de signification (A), la signification sur le lieu de travail tient une place particulière, pouvant être remise en cause en pratique (B).
A. La hiérarchie traditionnellement acceptée
Le Code de procédure civile instaure une véritable hiérarchie des modes de signification.
L’article 654 N° Lexbase : L6820H7Q pose un principe : la signification doit être faite à personne. Une lecture laisse donc entendre que la signification à personne demeure la règle, les autres modes n’étant que subsidiaires.
Cette primauté est facilement compréhensible, l’essence même de la signification étant la bonne information du justiciable. Remettre l’acte à la personne même du destinataire apporte toutes les garanties nécessaires à sa parfaite compréhension et sécurise la procédure face à d’éventuelles contestations, comme celles soulevées en l’espèce.
L’importance de la remise à personne est d’ailleurs telle qu’elle peut influer sur le cours de la procédure, comme pour l’injonction de payer où la remise à personne va ouvrir au débiteur le délai d’un mois pour former opposition à l’ordonnance [1].
Cet impératif de remise à personne s’impose au commissaire de justice significateur. Contrairement à la notification postale où la qualification de remise à personne dépend de l’attitude du destinataire, selon qu’il ait ou non signé l’avis de réception [2], la signification à personne induit une action de la part du commissaire de justice significateur : la recherche du destinataire pour lui remettre l’acte en mains propres.
Plus généralement, l’article 689 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6890H7C dispose que lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. Ainsi, la remise sur le lieu de travail fait bel et bien partie de la famille des remises à personne, seules remises acceptées lorsque le commissaire de justice se transporte à l’extérieur du domicile ou de la résidence.
La signification à personne étant érigée en principe, le commissaire de justice ne doit passer au mode suivant qu’en cas d’échec. Si (et seulement si) la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence [3]. Le commissaire de justice pourra ainsi délivrer l’acte à une personne présente au domicile, à condition que celle-ci l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité, ou déposer son acte à l’étude si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée [4].
Sur le lieu de travail, le commissaire de justice ne pourra délivrer l’acte à une personne autre que le destinataire. Il est impossible d’envisager une remise à un tiers présent, même si celui-ci l’accepte, encore moins une signification par dépôt de l’acte à l’étude, fondé sur la certitude du lieu de travail.
Enfin, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice peut dresser un procès-verbal de recherches infructueuses [5], lequel vaut signification, à la dernière adresse connue.
Et c’est précisément ce qui est reproché ici au commissaire de justice : ne pas avoir respecté la hiérarchie des modes de signification, à défaut d’avoir tenté une signification à personne sur le lieu de travail, préalablement à la signification à domicile.
La cour d’appel de Versailles n’est pas sensible à cet argument et retient que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail. Cette décision remet ainsi opportunément en question la place de la signification sur le lieu de travail au sein de la hiérarchie des modes de signification.
B. Une hiérarchie nouvellement remise en cause
La jurisprudence est venue tempérer l’impératif de remise à personne s’agissant du lieu de travail.
Le présent arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui retient que dès lors qu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, le commissaire de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile [6]. L’impossibilité de signifier à personne s’apprécie donc au lieu du domicile.
La cour d’appel de Versailles s’aligne sur ce courant. Ce n’est que lorsque le commissaire de justice n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent qu’il est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail [7]. A contrario, lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, le commissaire de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail.
Pour valider la signification à domicile, la cour retient comme suffisantes les vérifications effectuées par le commissaire de justice, à savoir que le nom figurait sur la péniche et que le signifié était connu de lui, ce qui suppose qu’il l’ait déjà rencontré à son domicile flottant.
La cour relève également que le destinataire ne contestait pas demeurer à l’adresse mentionnée dans l’acte à la date de signification, laquelle figure également au jugement, dans l’acte d’appel transmis au greffe de la cour et dans ses écritures.
À lire cet arrêt, et même si elle est classiquement positionnée dans les textes au sommet de la pyramide des modes de signification, la remise à personne sur le lieu de travail trouve plus logiquement sa place entre le dépôt de l’acte à l’étude et le procès-verbal de recherches infructueuses.
Cette position se justifie en pratique, la signification à personne sur le lieu de travail pouvant s’avérer semée d’embûches. Ainsi, le commissaire de justice devra d’abord solliciter et obtenir l’autorisation de l’employeur pour pénétrer dans les lieux. Reste encore à trouver le destinataire, lequel ne pourra pas forcément quitter son poste pour recevoir copie de l’acte…
Signifier sur le lieu de travail n’est pas sans soulever la question de la délicatesse et la discrétion auxquelles est soumis le commissaire de justice dans l’exercice de ses fonctions. Rencontrer le destinataire devant ses collègues ou en présence de son employeur pourrait contrevenir au respect de la vie privée [8], générant une faute susceptible de réparation en dommages et intérêts (la nullité de l’acte est une sanction à écarter en l’espèce).
Il convient de s’interroger également sur le risque d’instrumentalisation de la remise sur le lieu de travail par un requérant mal intentionné, qui se rendrait coupable d’un « abus de signification ». Ainsi est-il possible d’imaginer qu’un employeur fasse délivrer à son ancien salarié, dans le seul but de lui nuire, une assignation devant le Conseil de prud’hommes sur son nouveau lieu de travail, alors qu’il est en période d’essai…
Il est enfin ironique de constater qu’en pratique, il est fréquemment reproché au commissaire de justice par le signifié de s’être présenté sur son lieu de travail, alors qu’il connaissait son domicile. C’est ici tout l’inverse, la destinataire reprochant au commissaire de justice d’avoir déposé l’acte en son étude, sans avoir préalablement tenté de lui remettre sur son lieu de travail !
Afin d’éviter les écueils d’une signification sur le lieu de travail, le commissaire de justice significateur doit donc s’assurer de la réalité du domicile, en multipliant les diligences. Comme le prévoit la loi, le domicile certifié, il lui faut informer le destinataire absent de son passage par le dépôt d’un avis de passage.
II. L’avis de passage
La cour d’appel de Versailles juge que s’il appartient au commissaire de justice signifiant à domicile de déposer un avis de passage (A), il n’a pas à préciser le lieu exact du dépôt de l’avis (B).
A. Un dépôt obligatoire
S’il ne parvient pas à rencontrer personnellement le destinataire de l’acte, le commissaire de justice doit laisser, à son domicile ou à sa résidence, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise [9].
Cet avis revêt une importance toute particulière, car c’est le seul document qui va permettre d’informer immédiatement le destinataire de la visite du commissaire de justice et des modalités pour retirer l’acte. Le commissaire de justice doit également envoyer une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage. À l’instar de la notification postale, celle-ci n’offre toutefois pas les mêmes garanties que le déplacement au domicile de l’officier public et ministériel.
Le dépôt de l’avis de passage est une formalité substantielle qui doit, à peine de nullité, être mentionnée dans l’acte de signification [10].
Il peut être tentant pour le défendeur qui espère s’affranchir des conséquences procédurales de l’acte signifié, de mettre en doute l’accomplissement de ces formalités, comme en l’espèce où l’appelante déclare ne pas avoir reçu l’avis de passage, pas plus que la lettre simple.
Mais la cour d’appel de Versailles rappelle ici avec force qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de passage soit effectivement parvenu à son destinataire [11]. Elle retient que le commissaire de justice satisfait à son obligation dès lors que la mention du dépôt de l’avis figure dans l’acte de signification et consacre par là même la force probante des mentions relatives à la signification. En effet, les commissaires de justice confèrent à leurs actes l’authenticité [12]. Les diligences mentionnées dans l’acte de signification valent jusqu’à inscription de faux. La simple preuve contraire n’est pas admise.
Le raisonnement de la cour d’appel est implacable. Faute de prétendre s’être inscrite en faux contre la signification de jugement, la contestation visant à remettre en cause le dépôt d’un avis de passage ne peut prospérer.
Par analogie, elle applique le même raisonnement à la mention de l’envoi de la lettre simple, laquelle vaut également jusqu’à inscription de faux [13], sans qu’il importe que la lettre soit effectivement parvenue au destinataire [14].
Si la mention générique du dépôt de l’avis de passage doit apparaître à peine de nullité dans le procès-verbal de signification, il n’appartient toutefois pas au commissaire de justice de préciser le lieu exact du dépôt.
B. La précision du lieu exact de dépôt inutile
Il résulte des articles 655 et 656 du Code de procédure civile que l’avis de passage doit être laissé au domicile ou à la résidence du destinataire.
Dans la présente affaire, l’appelante reproche au commissaire de justice d’avoir laissé l’avis de passage « à l’adresse du signifié », sans aucune précision permettant de savoir où et comment il a été déposé, ajoutant que si le commissaire de justice avait trouvé une boîte aux lettres, « il en aurait certainement fait mention ».
Il convient de s’interroger au préalable sur la notion de domicile, laquelle revêt un caractère particulièrement large. Le Code civil définit le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, au lieu où il a son principal établissement [15]. L’utilisation du terme « adresse » vise quant à elle la localisation géographique précise du domicile du destinataire de l’acte.
Le choix du lieu exact de dépôt de l’avis de passage relève quant à lui d’un juste équilibre entre un endroit facilement accessible du destinataire, pour en assurer la bonne information et un affichage trop évident, au vu et au su de tous.
Pour étayer ses contestations, la débitrice a fait constater (par un autre commissaire de justice) l’absence de boîte aux lettres et d’endroit sur la péniche pour y déposer l’avis de passage.
Se pose immédiatement la question déontologique d’un tel constat, dans l’hypothèse où le commissaire de justice constatant connaissait le dessein de son requérant. Le Conseil consultatif de la déontologie des huissiers de justice s’est prononcé sur des sujets proches, retenant d’abord que l’usage d’un constat est de décrire un état de fait à un instant déterminé, sans que le commissaire de justice ait à apprécier l’usage qui sera fait de ses constations ni à aviser sa chambre si le constat était tourné contre un de ses confrères [16]. Il tempéra par la suite sa position en précisant que les actes d’huissiers de justice, qui sont des actes publics, valent jusqu’à inscription de faux, leur contrôle relevant de la seule compétence du juge de l’exécution, et que dès lors, l’huissier de justice requis pour constater les conditions dans lesquelles une exécution est diligentée par un confrère ne peut que décliner sa compétence [17].
En l’espèce, il s’agissait de constater que la péniche était dépourvue de boîte aux lettres et qu’il n’existait aucun autre endroit où laisser l’avis de passage, celui-ci ne pouvant notamment être déposé sous la porte. L’objectivité du constat s’est toutefois retournée contre l’appelante, la cour d’appel relevant, à bon escient, qu’il ressort des constatations que celle-ci disposait bien d’une boîte aux lettres, portant indication du nom de sa péniche, à quelques mètres du quai desservant son bateau.
Il est fréquent pour les commissaires de justice de rencontrer ces batteries de boîtes aux lettres, utilisées pour desservir un lotissement, un immeuble ou un groupe d’habitations difficile d’accès. Tel est le cas des boîtes aux lettres CIDEX (Courrier individuel à distribution exceptionnelle), boîtes aux lettres individuelles et normalisées regroupées en batterie près d’un axe de communication, fournies, installées et entretenues par La Poste.
Mais alors qu’elles sont implantées à l’écart de l’habitation, souvent sur le domaine public, peut-on considérer que le fait d’y laisser l’avis de passage est conforme au dépôt au domicile prévu par les textes ?
Les batteries de boîtes aux lettres se trouvant à une distance raisonnable de l’habitation, il faut les voir comme une extension à part entière du domicile, justifiant que l’avis de passage y soit valablement déposé. Cette extension est bien évidemment inapplicable aux boîtes postales, qui, se trouvant dans un bureau de poste, ne peuvent en aucun cas être assimilées à un domicile.
Comme le relève très justement la cour d’appel de Versailles, le commissaire de justice a donc bien déposé au domicile du destinataire de l’acte, ainsi qu’il appert de son procès-verbal de signification, celui-ci n’étant pas tenu d’apporter des précisions complémentaires. Demander au commissaire de justice de justifier le lieu exact du dépôt reviendrait à dépasser la lettre de l’article 656 du Code de procédure civile. Cette solution apparaît naturellement transposable au document d’information délivré aux locataires assignés aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de bail, lequel doit être déposé au domicile par pli séparé de l’avis de passage [18].
Cet arrêt, qui sacralise le caractère authentique des mentions relatives à la signification, enseigne deux choses :
- le procès-verbal de signification se suffit à lui-même ;
- à partir du moment ou le commissaire de justice fait mention de la réalité du domicile, il n’a pas à se transporter sur le lieu de travail, pas plus qu’il ne doit préciser l’endroit exact où il a déposé l’avis de passage.
Un arrêt de bon sens, qui nous prouve quand même que la signification à un destinataire domicilié sur une péniche n’est pas un long fleuve tranquille…
| À retenir :
|
[1] CPC, art. 1416 N° Lexbase : L6356H7K. À défaut de remise à personne, c’est la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur qui ouvrira le délai d’opposition. La recevabilité d’une contestation du titre au stade de l’exécution fait peser des risques bien plus importants sur le créancier qu’au moment où l’ordonnance est rendue.
[2] CPC, art. 670 N° Lexbase : L6848H7R.
[3] CPC, art. 655 N° Lexbase : L6822H7S.
[4] CPC, art. 656 N° Lexbase : L6825H7W.
[5] CPC, art. 659 N° Lexbase : L6831H77.
[6] Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 19-24.170, F-B N° Lexbase : A90927D4.
[7] Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-14.145, F-B N° Lexbase : A10288YQ.
[8] C. civ., art. 9 N° Lexbase : L3304ABY.
[9] CPC, art. 655 et 656, préc.
[10] CA Nîmes, 19 mars 1975 – CA Rennes, 12 novembre 1987.
[11] V. également Cass. civ. 2, 12 novembre 1980, n° 79-15.199, F-B N° Lexbase : A2256CHZ.
[12] Ordonnance n° 2016-728, du 2 juin 2016, relative au statut de commissaire de justice, art. 10 N° Lexbase : Z24501PC.
[13] Cass., mixte, 6 octobre 2006, n° 04-17.070, F-B N° Lexbase : A5094DR4.
[14] Cass. civ. 2, 12 octobre 1972, n° 71-11.981, F-B N° Lexbase : A6804AG4.
[15] C. civ., art. 102 N° Lexbase : L9050IZ9.
[16] Cas n° 2020-27, du 17 septembre 2020.
[17] Cas n° 2021-38, du 29 septembre 2021.
[18] Décret n° 2017-923, du 9 mai 2017, relatif au document d'information en vue de l'audience délivré aux locataires assignés aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de bail, art. 1er N° Lexbase : Z97501P4.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485776
[Brèves] Appel dématérialisé : quid de l'absence de l’avis de réception électronique de la déclaration d’appel ?
Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 22-12.065, F-B N° Lexbase : A39309U4
Lecture: 3 min
N5720BZU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 28 Juin 2023
► Il résulte de l'article 748-3 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402, du 3 mai 2019, que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1, font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci ; dans le cadre des envois, remises et notifications mentionnés à l’article précité se font par l'intermédiaire d'une plate-forme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant, l'heure de la mise à disposition ; Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
Faits et procédure. Dans cette affaire un appel a été interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Amiens, 14 décembre 2021, n° 21/01297 N° Lexbase : A11217GM) d’avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel. Dans la première branche du moyen, le demandeur invoque la violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l'espèce, l’avis de réception. Le conseil de l’appelant avait produit, en annexe de sa note en délibéré, l'avis de réception reçu à la suite de l'envoi de la déclaration d'appel. Par ailleurs, que l’appel avait été formé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. L’intéressé fait valoir la violation des articles R. 1461-1 N° Lexbase : L2663K87 et R. 1461-2 N° Lexbase : L2664K88 du Code du travail, ensemble les articles 931 N° Lexbase : L0426ITX et 748-3 N° Lexbase : L1183LQU du Code de procédure civile.
En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration transmise par voie électronique n’avait fait l'objet ni d'un accusé de réception par la cour d'appel ni d'un enregistrement dans son registre général et n'avait donc pas donné lieu à une instance d'appel.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel, déclare que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et le déclare non fondé pour le surplus. En conséquence, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
Il convient de retenir que le message adressé par le conseil de l’appelant ne correspond pas à l’avis électronique attestant de la réception de sa déclaration d’appel. En l’absence d’un tel avis, et d’un enregistrement dans le registre général de la cour d’appel, l’acte d’appel ne donne pas lieu à une instance d’appel.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485720
[Brèves] Notification et mentions erronées : quid du point de départ du délai d’appel ?
Réf. : Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-21.242, F-B N° Lexbase : A02519PY
Lecture: 2 min
N5184BZZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 11 Juillet 2023
► Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, consacrant le droit d'accès au juge, qu'un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction ; dès lors, le délai d'appel ne peut pas courir contre la partie qui a reçu une notification du jugement effectué par le greffe comprenant des mentions erronées sur l'identité des parties ; l'irrecevabilité de son recours s'analysant en une entrave à son droit d'accès à un tribunal.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a licencié un salarié. Ce dernier a contesté ce licenciement devant un conseil de prud'hommes. Le salarié a interjeté appel à l’encontre du jugement.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Amiens, 18 novembre 2020, n° 20/01639 N° Lexbase : A367837D), d’avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel et d’avoir constaté le dessaisissement de juridiction. L’intéressé fait valoir la violation de l’article 6, § 1 de la Convention précitée dans la solution N° Lexbase : L7558AIR.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l'erreur dans l'identité des parties n'a pas pour effet de rendre irrégulière la notification opérée par le greffe du conseil de prud'hommes, ces mentions ne figurant pas au nombre de celles prévues par les articles 680 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1240IZX et R. 1454 du Code du travail N° Lexbase : L2645K8H.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 1525, alinéa 1er du Code de procédure civile N° Lexbase : L2180IPG la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoie l’affaire. La Haute juridiction relève que la cour d’appel avait constaté que l'acte de notification comportait une mention erronée dans l'identification de la société, imputable à la juridiction, qui avait été reprise par l'appelant dans sa déclaration d'appel. En conséquence, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que le délai d'appel n'avait pas couru.
Cette décision va dans le sens de la jurisprudence constante, selon laquelle, le délai de recours ne court pas en cas d’absence de mention ou de mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités (v. Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 17-17.480, F-D N° Lexbase : A4615XNA).
| Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, L’objet des voies de recours, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E12507CB. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485184
[Brèves] Recours formé contre la décision rendue par une commission de surendettement sur la recevabilité de la demande du débiteur : périmètre des pouvoirs du JCP
Réf. : Cass. civ. 2, 8 juin 2023, n° 20-21.625, F-B N° Lexbase : A79259Y8
Lecture: 2 min
N5833BZ3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 20 Juin 2023
► Le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire, aucune disposition du Code de la consommation n'autorisant, à l'occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Faits et procédure. Le 14 mai 2019, une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande d’une débitrice tendant au traitement de sa situation financière. Le service des impôts des entreprises a formé un recours contre cette décision.
Après avoir constaté l'état d'endettement et la bonne foi de la débitrice ainsi que l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, le jugement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le service des impôts a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation commence par rappeler qu’aux termes de l’article L. 722-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L0753K7Z, la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande.
Ensuite, selon l’article R. 722-2 du même code N° Lexbase : L1484LSR, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En outre, selon l’article L. 723-1 N° Lexbase : L0737K7G après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur.
Enfin, en application de l’article L. 724-1 N° Lexbase : L4242LSW, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 N° Lexbase : L7540LBU, L. 733-1 N° Lexbase : L7538LBS, L. 733-4 N° Lexbase : L2652LBT et L. 733-7 N° Lexbase : L2650LBR. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ainsi, pour la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire, aucune disposition du Code de la consommation n'autorisant, à l'occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Cour en conclut donc qu’en statuant comme il l’a fait, le juge des contentieux de la protection a excédé ses pouvoirs et violé les textes cités.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485833
[Brèves] Caducité du plan de surendettement : précisions sur les conditions dans lesquelles le créancier recouvre son droit de poursuite individuel
Réf. : Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-18.121, F-B N° Lexbase : A02399PK
Lecture: 3 min
N5125BZT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 24 Avril 2023
► Lorsque par l'effet d'une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d'une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d'une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan.
Faits et procédure. Un tribunal d'instance a condamné un débiteur à payer à la société X une certaine somme au titre d'une offre préalable de crédit.
Par la suite, une commission de surendettement a recommandé au bénéfice du débiteur des mesures prévoyant le versement à la société Y de mensualités d'un certain montant pendant une période de cent vingt mois, avec un effacement du solde de la dette à l'issue de ces mesures, et leur caducité en cas d'inexécution. Sur la contestation formée par un autre créancier, une cour d'appel a confirmé les mesures recommandées.
La société Y a sollicité d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations du débiteur. Le tribunal d'instance a rejeté cette demande.
La société Y a alors fait délivrer au débiteur une mise en demeure afin de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées.
La cour d’appel (CA Paris, 4-8, 5 novembre 2020, n° 19/12369 N° Lexbase : A645233D) ayant ordonné la saisie de ses rémunérations, le débiteur a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation relève qu’aux termes de l'article L. 332-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L9809INM, alors applicable, les créanciers, auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 N° Lexbase : L5251IXR et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 N° Lexbase : L9808INL sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Ainsi, selon la Haute Cour, il résulte de ce texte que lorsque par l'effet d'une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d'une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d'une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan.
En l’espèce, la société Y créancière versait aux débats une mise en demeure afin de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées et devant le premier juge, le débiteur n'avait pas contesté ne pas avoir respecté ces mesures. La Cour de cassation en conclut que la cour d'appel en a exactement déduit que la créancière était fondée à poursuivre l'exécution forcée de son titre exécutoire, sans qu'il importe que celles-ci soient arrivées à leur terme au jour où elles sont dénoncées.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485125
[Le point sur...] La saisie des rémunérations : relooking extrême
Réf. : Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, déposé au Sénat le 3 mai 2023
Lecture: 10 min
N6057BZD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Xavier Louise-Alexandrine, Commissaire de justice associé (Calippe & Associés)
Le 30 Juin 2023
Mots-clés : saisie des rémunérations • commissaire de justice
La saisie des rémunérations est actuellement au cœur de l’actualité des praticiens de l’exécution. Le projet actuellement en discussion témoigne d’avancées majeures, mais n’est pas exempt de reproches, invitant à explorer quelques pistes d’amélioration.
Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 du 3 mai 2023, dans son article 17, a pour ambition de faire mentir le vieil adage « C’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleurs soupes ».
Cette proposition de réforme est guidée par le souhait d’améliorer la procédure de saisie des rémunérations en augmentant son efficience en la recentrant dans les mains des commissaires de justice (ex huissiers de justice) pour, in fine, soulager les magistrats et leurs greffes. C’est ainsi qu’il serait tentant d’utiliser le mot « déjudiciarisation » pour expliquer cette réforme, mais ce serait occulter le fait que le juge y tient toujours sa place, non pour autoriser la saisie des rémunérations, mais pour en trancher les contestations uniquement. La saisie des rémunérations telle que projetée est donc bel et bien judiciaire puisqu’elle doit être fondée sur un titre exécutoire et validée par le juge en cas de contestation. Ce n’est que sa mise en branle qui ne nécessite plus l’aval du magistrat, et la réserve de temps qui pouvait aller de pair.
Si le comité national des barreaux, dans sa résolution du 12 mai dernier, s’est opposé au transfert de la procédure de saisie des rémunérations des greffes des tribunaux vers les seuls commissaires de justice, il n’en demeure pas moins que cette procédure est bien souvent utilisée en dernier recours par les créanciers, qui aujourd’hui se découragent à obtenir leur dû par cette procédure… L’échange commissaire de justice/créancier se résume donc à : « Oui j’ai identifié un employeur »/« Non non retournez-moi le dossier, c’est trop long ».
La question qui se pose est de savoir si l’utilisation d’un nouveau look garantira la nouvelle vie de la saisie des rémunérations.
En cette période de Fashion Week parisienne, le législateur entend redorer la saisie des rémunérations en envisageant un relooking extrême (I) et en instaurant un nouveau « directeur artistique » en la personne du commissaire de justice (II).
I. Un nouveau look
Fashion Week oblige, la nouvelle procédure de saisie des rémunérations naît d’un patron (A) inédit (B).
A. Le « patron » de la nouvelle procédure
Si nous fêtions en début d’année 2023 le dixième anniversaire du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure de saisie des rémunérations n’avait pas été réellement affectée depuis la loi du 9 juillet 1991 N° Lexbase : L9124AGZ. En effet, le transfert de compétence vers le juge de l’exécution n’avait pas à l’époque concerné cette procédure.
Afin d’exposer cette réforme, il faut rappeler quelle est la procédure actuellement suivie, voir l’infographie, Saisie des rémunérations, n° 139, Voies d'exécution N° Lexbase : X9586APQ.
Il s ‘agit donc d’une procédure longue, remplie d’aléas, et qui subit les créanciers concurrents….
La réforme, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2025, prévoit notamment la délivrance d’un commandement de payer au débiteur, préalable à la saisie des rémunérations. Le projet de loi prévoit également que le débiteur disposera d’un délai d’un mois pour contester la mesure. En cas de contestation, le juge de l’exécution sera amené à contrôler la proportionnalité de la mise en œuvre de la procédure ainsi que les frais d’exécution du commissaire de justice, comme c’est le cas aujourd’hui.
Il est à préciser que la possibilité pour le débiteur de contester sera ouverte à tout moment de la procédure mais que celle-ci perdra son effet suspensif à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du commandement préalable.
Dans la volonté de concilier les parties, il sera encore possible pour le débiteur, afin d’éviter une saisie de ses rémunérations, de conclure un accord avec son créancier sur les modalités de paiement, entraînant la signature d’un procès-verbal d’accord. Celui-ci devra intervenir dans les mois suivant la délivrance du commandement et avant la signification du procès-verbal de saisie entre les mains de son employeur.
La signature d’un procès-verbal d’accord suspend la saisie des rémunérations, mais il est néanmoins prévu qu’elle pourra reprendre en cas de non-respect par le débiteur de l’accord ou en cas de signification au premier saisissant d’un acte d’intervention, ce qui à ce jour n’est pas le cas puisque la signature d’un procès-verbal de conciliation empêche la mise en place d’une intervention sans conciliation préalable pour un nouveau créancier.
La procédure de saisie des rémunérations s’opérera par la signification au tiers saisi – employeur d’un procès-verbal de saisie qui devra faire l’objet d’une dénonciation au débiteur.
Les obligations (déclarations des informations, etc..) et les sanctions pesant sur les employeurs demeurent inchangées.
SCHÉMA NOUVELLE PROCÉDURE
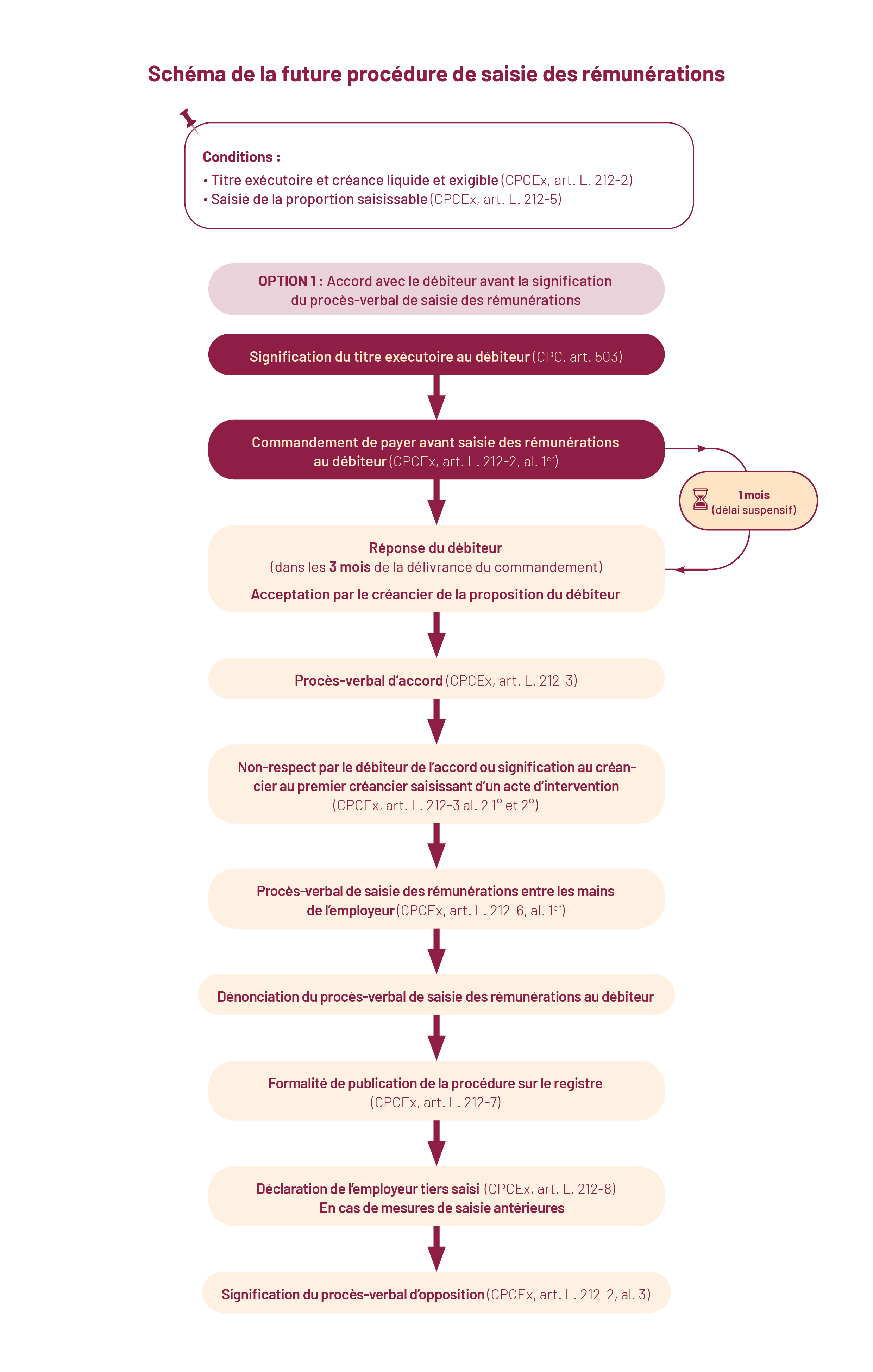
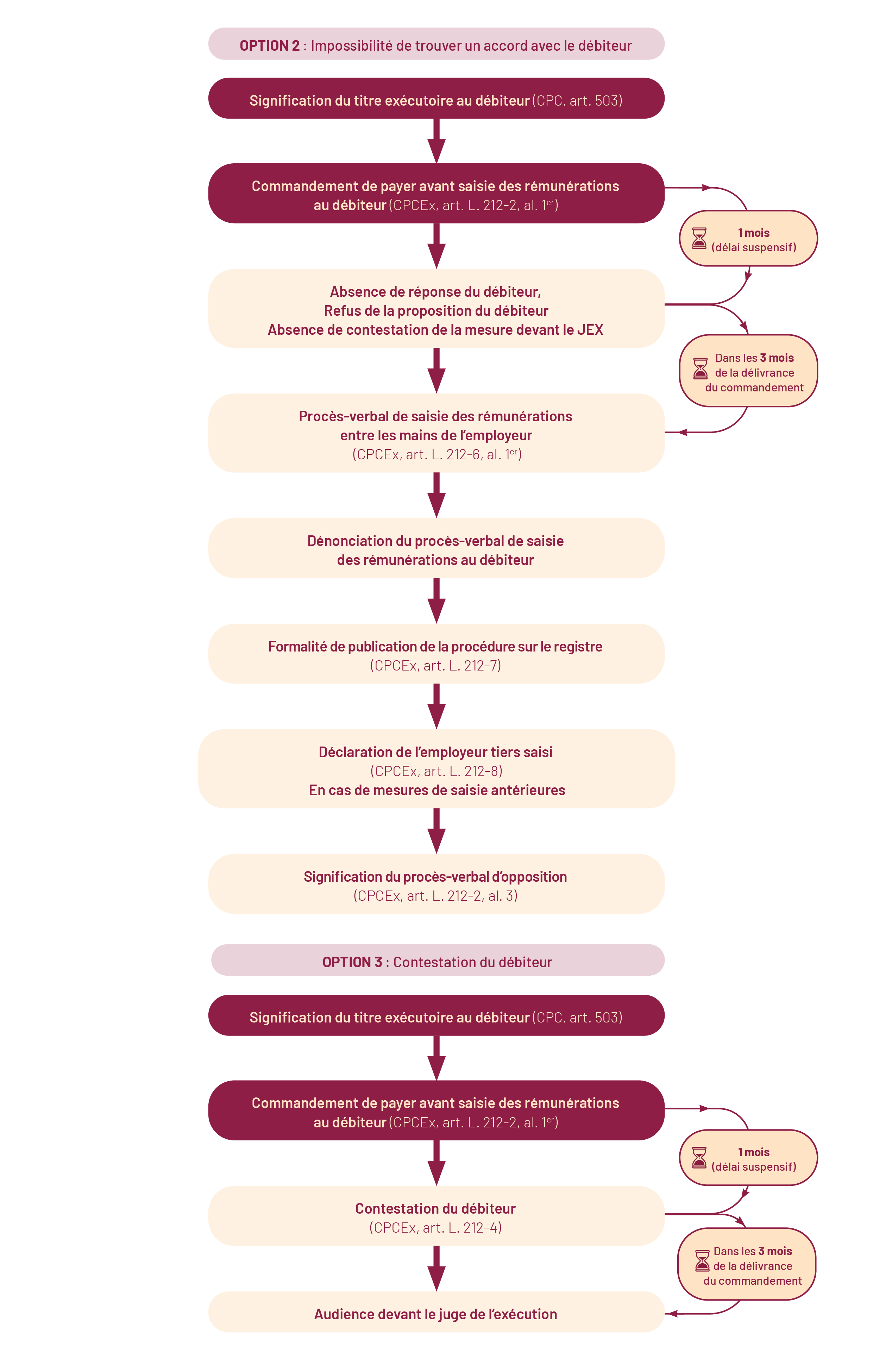
B. Du « neuf » dans le positionnement
Les textes qui lui sont applicables figurent dans de nombreux textes du code du travail (C. trav., art, L. 3252-1 N° Lexbase : L0945H9U et suivants, R. 3252-1 N° Lexbase : L8965H9W et suivants) et trois articles du Code des procédures civiles d’exécution (CPCEx, art, L. 212-1 N° Lexbase : L5842IRS, L. 212-2 N° Lexbase : L0731L79 et L. 212-3 N° Lexbase : L5847IRY) renvoyant eux-mêmes au code du travail : elle n’a jamais trouvé sa place dans le « rayon » des voies d’exécution.
Un des objectifs du projet de loi est, en plus de transférer la gestion aux commissaires de justice et de faire des économies en masse salariale et en frais de notification pour l’Etat, de l’intégrer au « catalogue » des mesures d’exécution par la création des nouveaux articles L. 212-1 à L. 212-16 du Code des procédures civiles d’exécution.
Si l’esprit de la loi de 1991 était de faire évoluer les mesures d’exécution pour les rendre « au gout du jour », la procédure de saisie des rémunérations était restée au fond de l'armoire.
Les principes de subsidiarité et de proportionnalité avaient voulu en faire un « indispensable » aux côtés de la saisie-attribution mais n’a jamais connu le succès escompté, reléguée au rang de procédure, peu couteuse certes, mais lente et inefficace.
La réforme entend la rendre plus rapide en réduisant les délais de mise en place et en faisant une mesure d’exécution premier choix.
Il est à noter l’étrange amendement présenté le 26 mai 2023 par Mesdames Verien et Canayer prévoit néanmoins d’insérer une phrase à l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice N° Lexbase : L4070K8A : « Dès la signification du commandement de payer en vue d’une saisie des rémunérations, le commissaire de justice informe le débiteur qu’il entre dans sa mission de lui permettre de parvenir à un accord avec le créancier, dans le respect de ses obligations déontologiques. »
S’il est possible de percevoir dans cet amendement que la réforme, bien que supprimant l’audience de conciliation, entend conserver l’esprit de la recherche d’un accord entre les parties, il apparaît inopportun. Le mandat du commissaire de justice est d’obtenir le paiement de la créance et il ne dispose de moyens autre que le devoir de conseil pour inviter le créancier à accepter un échéancier. Cet amendement crée une nouvelle obligation du commissaire de justice envers le débiteur, presque contractuelle, alors que même sa responsabilité vis-à-vis du débiteur est statutaire, liée à sa fonction. En matière de saisie-vente, le commissaire de justice transmet l’éventuelle offre d’achat amiable des biens saisis au créancier, sans qu’une telle formule n’apparaisse dans l’acte…
II. Pour une nouvelle vie
Si la réforme est ambitieuse, elle promet une mise en œuvre complexe (A) qui peut laisser place à des espoirs d’amélioration (B).
A. Changement de « propriétaire »
Les missions en matière de saisie des rémunérations, pour les greffiers et les régisseurs, s’articulent autour de la tenue des fiches individuelles spéciales (C. trav., art. R. 3252-9 N° Lexbase : L4752LT8), la gestion comptable (COJ, art. R. 123-20 N° Lexbase : L0409LSX) et les envois de fonds ou répartitions en fonction du nombre de créanciers participant à la procédure de saisie des rémunérations (C. trav., art. R. 3252-9).
Il est prévu que ses tâches soient désormais dans les missions relevant du monopole des commissaires de justice.
Le texte prévoit également la création d’une nouvelle fonction, celle de commissaire de justice répartiteur, qui hérite de la « double casquette » du greffe et la régie. Compte tenu de l’importance de cette mission et la lourde charge qu’elle représente, les commissaires de justice devront certainement suivre une formation spécifique pour ensuite solliciter une inscription sur la liste des commissaires de justice répartiteurs auprès de la Chambre Nationale des commissaires de justice (CNCJ). Il est également prévu la création d’un registre numérique des saisies des rémunérations auprès de la CNCJ, permettant d’y retrouver toutes les données nécessaires concernant les commissaires de justice répartiteurs, les débiteurs saisis, les créanciers saisissants, les employeurs tiers saisis. Une avancée à saluer, d’autant que ce « cloud » de la saisie des rémunérations ne sera sans aucun doute accessible qu’aux commissaires de justice porteur d’un titre exécutoire et ne permettra d’accéder aux informations concernant uniquement le débiteur poursuivi, comme pour les fichiers d’informations accessible par voie numérique aujourd’hui (Ficoba, Siv).
B. La nécessité d’un design plus audacieux
« Plongé dans la tourmente quand les fonds manquent, à force de m’plaindre, j’attends plus l’argent, j’vais l’prendre. » rappait Booba à ses débuts… C’est dans cet état d’esprit qu’aurait pu être rêvée la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Sur le canevas de la saisie-attribution à exécution successive, il aurait été intéressant de permettre au commissaire de justice de saisir directement les rémunérations du débiteur entre les mains de son employeur par la délivrance d’un procès-verbal de saisie-attribution des rémunérations, pourquoi pas par voie électronique.
De plus, si les articles L. 152-1 N° Lexbase : L1721MAY et suivants du Code des procédures civiles d’exécution permettent au commissaire de justice d’interroger les « tiers » pouvant communiquer des renseignements permettant la mise en place d’une procédure de saisie des rémunérations, seul l’accès au fichier des déclarations d’embauche permettrait d’identifier les changements d’employeurs. En effet, de nombreux dossiers sont ralentis faute par les créanciers d’obtenir des informations en temps réel sur la situation du débiteur.
Pour finir, il sera utile de relever que les rémunérations demeurent insaisissables par voie de saisie conservatoire et donner aux commissaires de justice la possibilité de saisir en urgence les rémunérations des débiteurs d’aliments, ce permettrait d’éviter qu’ils aient le temps d’organiser leur insolvabilité.
Un jour peut-être on entendra prononcer au sujet de cette procédure qu’elle est « à la mode ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486057
[Brèves] L’huissier de justice : garant de la vérification du titre exécutoire pour pratiquer une exécution forcée
Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 21-23.773, F-B N° Lexbase : A39429UK
Lecture: 3 min
N5509BZ3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 29 Juin 2023
► Il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie ; dès lors, est censurée la cour d’appel ayant rejeté la demande formée par un débiteur à l’encontre de l’huissier de justice ayant pratiqué une saisie sur ses biens, alors qu'elle avait constaté que le débiteur n'avait ni reçu notification des jugements dont l'exécution était poursuivie ni été rendu destinataire de la signification de ceux-ci.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque marocaine a été condamnée par différents jugements à verser diverses sommes à différents créanciers ayant donné mandat à une société civile professionnelle d’huissiers de justice. Pour exécuter ces jugements, les créanciers ont donné mandat à la société professionnelle d'huissiers de justice pour procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la banque dans les livres de la société Natixis. En réponse, la banque a assigné les créanciers en contestation des saisies et la SCP en responsabilité et indemnisation.
Le pourvoi. La banque fait grief à l'arrêt (CA Paris, 1-10, 2 septembre 2021, n° 20/14029 N° Lexbase : A195143N) d’avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts. La banque invoque la violation des articles 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 et L. 122-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5811IRN.
En l’espèce, la cour d’appel pour rejeter la demande précitée a retenu que la SCP a procédé à la signification des jugements par actes du 6 mars 2020, soit antérieurement à la signification des saisies, et que l’huissier de justice n’est pas juge de la régularité de ces significations.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 1240 du Code civil et L. 122-2 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts formée par la banque. Elle relève que la notification n’avait touché la banque que le 9 juin 2020, et qu’elle n’avait été destinataire des significations adressées par la SCP.
|
Observations. La rédaction de la décision ne fait pas ressortir que le litige relevait en l’espèce d’une problématique de signification internationale. Comme les faits le font apparaître, le jugement exécutoire avait été signifié en France avant les saisies, mais les autorités étrangères ont mis plus de 3 mois pour signifier ce jugement. Cette décision illustre les problèmes inhérents à l’articulation de la signification internationale et ses délais avec le droit de l’exécution interne et les contraintes des créanciers. Pour aller plus loin : la présente décision fera l'objet d'un commentaire rédigé par Charles Simon, à paraître prochainement. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485509
[Jurisprudence] Précisions opportunes sur l’office du juge d’appel en matière de saisie immobilière
Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-14.906, F-B N° Lexbase : A39349UA
Lecture: 16 min
N5934BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Richard Ouedraogo, Docteur en droit privé, Magistrat
Le 29 Juin 2023
Mots-clés : saisie immobilière • lien d’indivisibilité • fin de non-recevoir d’ordre public • procédure d’appel • office du juge
En raison du lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière, la cour d’appel est tenue de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel lorsque les créanciers inscrits n’ont pas été intimés.
La technicité procédurale induite par la saisie immobilière confère une coloration toute singulière aux arrêts épars rendus en la matière par la Cour de cassation.
Le présent arrêt, en date du 17 mai 2023, ne manquera pas de retenir l’attention des praticiens, tant il participe de l’œuvre de construction d’une forme de cohérence de la jurisprudence de la deuxième chambre civile quant à l’office du juge d’appel.
Afin d’en appréhender les principaux enjeux, il n’est pas inutile de revenir sur les faits et sur la procédure à l’origine de cette décision, dont la publication au bulletin apparaît, somme toute, bienvenue eu égard à sa portée non négligeable.
Le 20 juin 2007, un établissement de crédit avait consenti à une société un prêt de 600 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble en Gironde.
Confrontée quelques années plus tard à des échéances impayées, la banque a fait délivrer à l’emprunteur, le 24 février 2017, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier. Puis, par acte d’huissier en date du 8 juin 2017, elle a assigné la société débitrice à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Libourne afin de voir ordonner la vente forcée du bien saisi. Ladite assignation a également été délivrée à six créanciers inscrits, dont le Trésor public à travers différents pôles de recouvrement spécialisés.
Le juge de l’exécution, suivant jugements des 20 avril 2018 et 13 juillet 2018, a validé la procédure de saisie et orienté l’affaire en vente forcée, l’audience d’adjudication ayant été fixée au 2 novembre 2018.
La société débitrice a toutefois interjeté appel de ces deux jugements. Elle sollicitait de la cour, à titre principal, de prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 13 juillet 2018 ainsi que la nullité de la saisie immobilière. Subsidiairement, elle contestait l’existence d’un titre exécutoire et concluait donc au débouté des demandes de la banque.
Dans un arrêt du 19 novembre 2020, aux termes duquel le créancier poursuivant apparaissait comme seule partie intimée, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé les deux décisions du juge de l’exécution du tribunal de Libourne.
Un pourvoi a alors été formé par la société débitrice, cette dernière soutenant un moyen unique sur lequel la Cour de cassation n’aura pas à se prononcer.
À l’appui de son pourvoi, le débiteur saisi faisait valoir qu’un commandement de payer valant saisie immobilière avait été délivré le 6 août 2014, puis publié le 3 septembre 2014, et qu’un jugement de caducité avait été publié le 1er septembre 2015 en marge dudit commandement sans toutefois qu’une décision de radiation ait été prise.
À l’évidence, le caractère inopérant de ce moyen aurait pu être relevé, dans la mesure où la sanction de caducité avait eu pour effet la mainlevée du premier commandement, de sorte qu’un nouveau commandement pouvait être légitimement publié. Mais ce ne fut pas la solution retenue par la juridiction suprême.
Relevant d’office un moyen de pur droit, la Cour de cassation a, en effet, de façon tout à fait magistrale, cassé la décision attaquée en ce que le juge d’appel avait méconnu le périmètre de son office.
Ce faisant, la deuxième chambre civile vient opportunément, d’une part rappeler les effets juridiques du lien d’indivisibilité unissant les parties à la procédure de saisie immobilière (I), d’autre part préciser sa position quant à la faculté ou non pour le juge du fond, dans ce contentieux spécifique de la saisie immobilière, de relever d’office le moyen tiré de l’indivisibilité procédurale (II).
I. Les effets juridiques du lien d’indivisibilité des parties à la procédure de saisie immobilière
La notion d’indivisibilité au sens procédural, bien que n’étant pas définie dans le code (v. not. art. 552 N° Lexbase : L6703H7E et 553 N° Lexbase : L6704H7G du Code de procédure civile), renvoie à l’existence d’une relation de proximité d’intérêts entre différentes parties à une même instance. Ce lien de proximité ne s’entend toutefois pas nécessairement d’une communauté d’intérêts, les parties pouvant parfaitement poursuivre des intérêts divergents.
En matière de saisie immobilière, le Code des procédures civiles d’exécution prévoit, aux articles R. 322-6 N° Lexbase : L2425ITY, R. 322-7 N° Lexbase : L2426ITZ et R. 322-8 N° Lexbase : L2427IT3, la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits, c’est-à-dire aux créanciers qui, au jour de la publication du commandement de payer, ont inscrit une sûreté sur le bien saisi. Ces derniers doivent en effet être informés de la procédure de saisie immobilière, puisque le jugement d’adjudication que viendra éventuellement à rendre le juge de l’exécution purgera leurs inscriptions ; concrètement, en application de l’article L. 322-14 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L0433L8K, le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente. L’information des créanciers inscrits est aussi essentielle dans la mesure où ceux qui, régulièrement sommés, auront omis ou se seront abstenu de déclarer leur créance seront de fait déchus du bénéfice de leur sûreté au stade de la distribution.
Et comme il est acquis que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure (Cass. avis, 16 mai 2008, n° 080002 P, C. Laporte, note, Procédures, 2008, n° 212), l’on comprend aisément que, dès la dénonciation des créanciers inscrits, se crée automatiquement une unicité procédurale en raison du lien d’indivisibilité entre le débiteur, le créancier poursuivant et le créancier inscrit.
Ce lien d’indivisibilité emporte comme conséquence logique l’obligation, en cas d’appel portant sur le jugement d’orientation, et même si l’appel est limité à la seule contestation de la créance du poursuivant, d’intimer tous les créanciers inscrits en application des dispositions de l’article 553 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6704H7G (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-31.350, F-P+B N° Lexbase : A8802YYN ; Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-15.274, F-B N° Lexbase : A90977DB).
Techniquement, l’appelant qui aurait par exemple omis d’intimer un créancier inscrit dans une déclaration d’appel pourra régulariser la procédure devant la cour avant toute décision au fond, par une seconde déclaration à l’encontre du même jugement. La cour procèdera dans ce cas à une simple jonction des procédures sans qu’il y ait une quelconque entorse au principe d’indivisibilité des parties à la procédure de saisie immobilière (CA Versailles, 16e ch., 9 mars 2023, n° 22/05734 N° Lexbase : A79489HT ; Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-16.009, F-P+B+I N° Lexbase : A945134S).
Et dans l’hypothèse où tous les créanciers inscrits auront été intimés, il va de soi que les conclusions d’appel devront être signifiées à chacun d’eux, sous peine d’irrecevabilité à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance (CA Nîmes, 2e ch., sect. A, 25 mai 2023, n° 22/03428 N° Lexbase : A10769ZU).
Pour autant, l’obligation d’intimer tous les créanciers inscrits n’est pas toujours sans limites en pratique.-
En effet, dès lors qu’un créancier inscrit n’était pas, par exemple, partie à l’instance devant le juge de l’exécution, comme n’ayant pas été mis dans la cause en première instance par le créancier poursuivant qui a fait délivrer l’assignation à l’audience d’orientation, le principe d’indivisibilité entre tous les créanciers ne rend pas l’appel irrecevable pour défaut d’assignation du créancier inscrit omis en première instance (CA Paris, 1-10, 16 mars 2023, n° 22/15507 N° Lexbase : A05849KT).
En revanche, même si le créancier inscrit n’a pas constitué avocat devant le juge de l’exécution, le simple fait qu’il ait été appelé de manière régulière à l’instance, par exemple à travers un appel incident devant la cour, régularise en quelque sorte la procédure (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 13 avril 2023, n° 22/12309 N° Lexbase : A91939P8).
Et à hauteur de cassation, cet impératif de diriger le pourvoi contre l’ensemble des créanciers, qui résulte d’une jurisprudence constante (Cass. civ. 2, 13 novembre 2014, n° 14-11.986, F-P+B N° Lexbase : A2939M3A ; Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, n° 14-17.027, F-D N° Lexbase : A4883NN8), n’est pas de nature à restreindre l’accès au juge d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même, dès lors que les dispositions de l’article 615, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L6773H7Y (qui prévoient qu’en cas d’indivisibilité le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance) poursuivent un but légitime au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, en l’occurrence une bonne administration de la justice et le respect des droits des défendeurs au pourvoi, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge de cassation, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé (Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-18.006, FS-B N° Lexbase : A02489PU).
Un autre effet de l’indivisibilité entre tous les créanciers en matière de saisie immobilière a trait à l’impossibilité absolue d’exécuter simultanément à leur égard deux décisions qui viendraient à être rendues en sens contraire. Concrètement, l’hypothèse est celle de l’article 370 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2987LWK qui dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue notamment par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible. En cas de décès du débiteur au cours de l’instance d’appel, si une notification de cet événement n’est pas faite à certains créanciers, l’interruption de l’instance d’appel ne pourra en principe leur être opposée s’il n’est pas établi qu’ils en ont réellement eu connaissance, de sorte que la cour sera logiquement amenée à statuer à l’égard de ces derniers (CA Angers, ch. A, 23 mai 2023, n° 22/01176 N° Lexbase : A03639XQ).
Le lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance de saisie immobilière a donc une incidence fondamentale sur la procédure d’appel, imposant alors au juge du fond de relever d’office, en actionnant le critère tiré de l’ordre public, l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de mise en cause de tous les créanciers.
II. L’obligation de relever d’office la fin de non-recevoir d’ordre public
Il est établi, de longue date, que le juge du fond est tenu, eu égard au lien d’indivisibilité unissant des parties à une même procédure, de relever d’office l’irrecevabilité d’un appel non dirigé contre toutes ces parties. C’est le cas, par exemple, lorsque le lien d’indivisibilité à l’égard des parties résulte de relations contractuelles qu’elles ont conclues (Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 15-26.133, F-P+B N° Lexbase : A2043TCN), ou lorsque ce lien d’indivisibilité se rapporte à un bien immobilier indivis (Cass. civ. 2, 28 mai 1990, n° 88-15.257, publié au bulletin N° Lexbase : A3725AHG). C’est également le cas en matière de procédures collectives, eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à l’admission des créances (Cass. com., 13 septembre 2016, n° 14-28.304, F-D N° Lexbase : A2409R3M ; Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-29.885, F-P+B+I N° Lexbase : A0703SHI), ou encore dans la situation du bail conclu au profit de copreneurs, qui est indivisible (Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-24.608, F-D N° Lexbase : A2115SXM).
Et c’est le critère tiré de l’ordre public, posé à l’article 125 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1421H4E, qui fonde cette solution.
Aux termes de cet article, les fins de non-recevoir doivent en effet être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Dans l’arrêt commenté, la solution retenue par la deuxième chambre civile spécifiquement en matière de procédure de saisie immobilière n’allait pourtant pas forcément de soi.
Car, si la sanction de l’irrecevabilité de l’appel, lorsque le recours n’est pas formé contre tous les créanciers – poursuivant comme inscrits – semblait évidente (en ce sens, Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-31.350, F-P+B N° Lexbase : A8802YYN ; Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-15.274, F-B N° Lexbase : A90977DB ; et pour une application par le juge du fond, CA Caen, 2e ch. civ. et com., 23 mars 2023, n° 22/01497 N° Lexbase : A38439LW), on pouvait néanmoins s’interroger, légitimement, sur l’obligation pesant sur le juge d’appel de relever d’office cette irrecevabilité au visa de l’article 125 du Code de procédure civile.
En effet, dans un arrêt inédit du 4 juin 2020 (Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.277, F-D N° Lexbase : A05613N4), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que la cour d’appel n’était pas tenue de relever d’office le moyen relatif à l’indivisibilité procédurale et l’application de l’article 553 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6704H7G qui supposait de caractériser cette indivisibilité procédurale au vu des éléments de fait du litige.
Mais l’espèce, reconnaissons-le, se distinguait à bien des égards du cas ayant donné lieu à la présente solution.
D’abord, parce que le lien d’indivisibilité entre les parties résultait, à l’énoncé du moyen de cassation, de contrats interdépendants. Or la saisie immobilière a ceci de singulier qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure civile d’exécution et non d’une relation simplement contractuelle.
Ensuite, parce que l’indivisibilité procédurale ne se déduisait pas forcément des éléments de fait du litige, comme semble l’indiquer la cour.
Néanmoins, cette décision du 4 juin 2020 avait de quoi surprendre dès lors qu’elle apparaissait en contradiction avec la position des autres chambres quant à l’obligation, pour le juge d’appel, de relever d’office le moyen relatif à l’indivisibilité procédurale sur le fondement combiné des articles 553 et 125 du Code de procédure civile.
Il est donc à saluer que, par une motivation exempte de toute ambiguïté, la deuxième chambre civile retienne, en matière de procédure de saisie immobilière, une position parfaitement respectueuse de l’esprit des textes d’ordre public du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, faut-il le rappeler, la réglementation applicable à la saisie immobilière a un caractère impératif qui n’est évidemment pas sans conséquence sur l’office du juge en la matière.
On pourrait tout de même objecter que la Haute juridiction vise ici un critère au contenu éminemment imprécis et difficilement saisissable pour les juges du fond, s’agissant de la notion même d’ordre public se rattachant à une fin de non-recevoir.
En clair, il n’apparaît pas toujours aisé de dégager en pratique les contours précis d’une irrecevabilité d’ordre public, tant l’office du juge civil en la matière dépend finalement des solutions qu’édicte la Cour de cassation au cas par cas, sans doute en tentant d’ailleurs de convaincre (principalement les juges du fond) que le droit n’est, finalement, que ce qu’elle juge justifié qu’il soit (sur cette idée, v. B. Mathieu, La Cour de cassation et l’art de la rhétorique, RTD civ., 2023, p. 45).
En matière de procédure de saisie immobilière, il est vrai que certaines décisions, bien connues des praticiens, imposent déjà certains réflexes procéduraux aux juges du fond : certaines contestations et demandes incidentes formées après l’audience d’orientation sont d’office irrecevables (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.312, FS-P+B+I N° Lexbase : A1841ETD ; Cass. civ. 2, 10 février 2011, n° 10-11.944, F-P+B N° Lexbase : A7351GW8) ; également, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité devant être relevée d’office (Cass. civ. 2, 22 février 2012, n° 10-24.410, FS-P+B N° Lexbase : A3205ID3).
Dorénavant donc, l’office du juge d’appel en matière de fin de non-recevoir d’ordre public connaît une précision supplémentaire à travers cet arrêt publié du 17 mai 2023.
Bien entendu, il importe de rappeler enfin que si, au cas d’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait eu à relever d’office l’irrecevabilité de l’appel de la société débitrice, elle aurait été naturellement tenue de recueillir contradictoirement les observations des parties sur ce moyen, en application de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q. C’est d’ailleurs ce que fait ici la Cour de cassation elle-même, puisque, préalablement à sa décision de cassation, elle a invité les parties à présenter leurs observations, conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5802L8E, sur le moyen qu’elle a relevé d’office en application de l’article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L6779H79.
En définitive, cette solution de la Cour ne peut qu’être approuvée pour son pragmatisme et son souci de cohérence, qui concourent assurément à l’édification d’un droit lisible en matière de procédure de saisie immobilière.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485934
[Panorama] Petit panorama en matière de saisie immobilière
Réf. : Cass. civ. 2, 3 arrêts, 17 mai 2023, n° 21-19.356, F-B N° Lexbase : A39689UI, n° 21-16.167, F-B N° Lexbase : A39659UE et n° 21-17.853, F-B N° Lexbase : A39699UK - TJ Paris, 2 jugements, JEX, 23 mars 2023, n° 22/00171 N° Lexbase : A29139WS et n° 21/00295 N° Lexbase : A29169WW
Lecture: 7 min
N6019BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Frédéric Kieffer, Avocat au Barreau de Grasse, Membre du Conseil de l’Ordre, Président d’honneur de l’AAPPE
Le 12 Juillet 2023
Mots-clés : saisie immobilière • commandement • proportionnalité • titre exécutoire • office du JEX • clauses abusives • démembrement de copropriété • donation • droit de suite
Un petit florilège de décisions récentes de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en matière de saisie-immobilière.
- L’effet interruptif inattendu du commandement radié (Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-19.356, F-B N° Lexbase : A39689UI)
Voilà un arrêt aussi inattendu qu’important en pratique. Moins de deux mois plus tôt la même chambre avait jugé que si le commandement de payer valant saisie, qui est un acte interruptif au sens de l’article 2244 du code civil, était annulé, l’assignation à l’audience d’orientation qui faisait suite à ce commandement ne conservait pas davantage un effet interruptif au sens de l’article 2242 du Code civil N° Lexbase : L7180IA8 (Cass. civ. 2, 23 mars 2023, n° 21-20.447, F-B N° Lexbase : A39509KI). La solution est identique pour le commandement jugé caduc. Mais qu’en est-il pour le commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière et non suivi d’effet (pas d’assignation à l’audience d’orientation, pas de dépôt du cahier des conditions de vente) puis radié à l’initiative du créancier poursuivant ?
La deuxième chambre répond à cette question : le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, publié sans être suivi d'effet puis radié à la demande de la banque qui en a donné mainlevée, conserve un effet interruptif de prescription puisqu’il ne peut plus être déclaré nul ou caduc.
| Conseil pratique : Pour conserver un effet interruptif au commandement de payer valant saisie il est conseillé de prendre l’initiative de sa radiation avant qu’il ne soit jugé nul ou caduc. Une fois radié, le juge de l’exécution perd tout pouvoir juridictionnel. |
- La proportionnalité s’invite dans l’exécution forcée immobilière alsacienne-mosellane (Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-16.167, F-B N° Lexbase : A39659UE)
La procédure d’exécution forcée immobilière du droit local alsacien-mosellan n’est pas moderne puisqu’elle est régie par une loi bientôt centenaire (loi du 1er juin 1924 N° Lexbase : L7971GTE), la partie saisie disposant d’une protection moins étendue que dans la procédure applicable dans la vieille France. Devant cette situation, une partie saisie s’est insurgée au visa de l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4798AQR qui pose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et de l’article 8, § 2 qui impose un devoir de non-ingérence de l’autorité publique.
La Cour de cassation n’est pas séduite pas cette argumentation et considère que le débiteur saisi dispose d'un recours juridictionnel lui permettant de contester l'ordonnance d'exécution forcée rendue sur la requête du créancier poursuivant et n'alléguant pas du caractère disproportionné de la mesure diligentée à son encontre, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu.
| Conseil pratique : Le prochain saisi qui entend contester la procédure d’exécution forcée applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle serait bien inspiré de démontrer le caractère disproportionné de l’ingérence de l’autorité publique et l’inégalité avec le reste du pays. |
- Le jugement d’orientation n’est pas un titre exécutoire (Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-17.853, F-B N° Lexbase : A39699UK)
C’est pourtant une évidence puisqu’une procédure de saisie immobilière ne peut être mise en œuvre qu’en vertu d’un titre exécutoire pourquoi le jugement d’orientation serait-il un titre exécutoire qui pourrait se substituer à titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ? C’est pourtant ce qu’a audacieusement soutenu un créancier pour tenter de se dérober à une condamnation. Ce créancier avait poursuivi une saisie immobilière jusqu’à son terme, sans être totalement désintéressé par le prix d’adjudication. Quelques années plus tard, la partie saisie obtient un arrêt condamnant le créancier à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information et fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente. Le créancier lui oppose la compensation avec le solde de sa créance non-réglée par le prix d’adjudication perçu six années auparavant.
Le saisi se prévaut de la prescription de ce solde de créance et le créancier originaire soutient que le jugement d’orientation ayant mentionné le montant de la créance, il constitue un titre exécutoire se prescrivant par dix ans en vertu de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5792IRX.
Il n’est pas suivi par la Cour de cassation qui précise que le jugement d’orientation dont l’objet est de vérifier que le créancier dispose d’un titre exécutoire et de mentionner la créance retenue ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution [1].
| Conseil pratique : Lorsque le prix d’adjudication ne solde pas la créance en totalité, il appartient au créancier de poursuivre le solde avant la prescription encourue, laquelle recommence à courir soit à compter de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution en présence de plusieurs créanciers, soit jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai (dans ce sens Cass. civ. 2, 2 mars 2023, n° 20-20.776, F-B N° Lexbase : A23899GL) [2]. |
- Clauses abusives et office du juge de l’exécution (TJ Paris, JEX, 23 mars 2023, n° 22/00171 N° Lexbase : A29139WS)
Ce jugement d’orientation illustre les nouveaux pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution en matière de clauses abusives sous l’inspiration des décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne, office confirmé récemment par la deuxième chambre civile retenant que lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d'un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen, et pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif (Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-14.540, FS-B+R N° Lexbase : A02289P7).
Dans l’espèce soumise au juge de l’exécution parisien, plusieurs clauses de pénalités stipulées à l’acte de prêt ont été considérées comme abusif et réputées non-écrites.
| Conseil pratique : s’assurer de l’absence de clauses abusives avant d’engager la procédure. |
- Conséquence d’un démembrement de propriété postérieur à l’hypothèque sur la saisie-immobilière (TJ Paris, JEX, 23 mars 2023, n° 21/00295
N° Lexbase : A29169WW )
Ce jugement d’orientation présente un intérêt pratique car il aborde les sujets du démembrement de propriété, du droit de suite et de la publicité foncière.
Un créancier poursuit une saisie immobilière portant sur un bien appartenant à son débiteur sur lequel elle avait pris une inscription d’hypothèque mais qui par la suite avait fait l’objet d’une donation de la nue-propriété. L’hypothèque ayant été inscrite le 21 juillet 2014 et la donation publiée le 4 août 2014, à la date de l’inscription d’hypothèque le bien appartenait en pleine propriété au débiteur et le créancier ayant, à compter de son inscription, acquis un droit de suite, sa procédure de saisie immobilière portant sur l’ensemble du bien était régulière.
| Conseil pratique : en présence d’un démembrement de propriété il est conseillé de bien examiné les dates de publication des inscriptions hypothécaires et des actes de transfert de propriété avant d’engager les hostilités. |
[1] A. Martinez-Ohayon, Saisie immobilière : jugement d’orientation vs titre exécutoire, Lexbase Droit privé, mai 2023, n° 947 N° Lexbase : N5503BZT.
[2] I. Faivre, Fin de l’effet interruptif de prescription en matière de saisie immobilière lors de la distribution du prix : quelles dates, quelles formalités ?, Lexbase Contentieux et recouvrement, mars 2023, n° 1 N° Lexbase : N4818BZH.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486019
[Chronique] Chronique de jurisprudence (mars 2023 à juin 2023)
Lecture: 34 min
N5924BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sylvian Dorol, Commissaire de justice associé, Directeur scientifique de la revue Lexbase Contentieux et recouvrement, Expert près l’UIHJ
Le 29 Juin 2023
La revue Lexbase Contentieux et Recouvrement vous propose de retrouver la deuxième chronique illustrée par les plus récentes décisions jurisprudentielles sous la forme d’un contenu original rédigé par Sylvian Dorol, correspondant également à l’évolution du Bulletin d’informations de Vénézia & Associés, édité en partenariat avec les éditions juridiques Lexbase.
Mots-clés : significations • saisie-attribution • commissaire de justice • MARD • clause médiation • expulsion • saisie véhicule terrestre à moteur • constat
Sommaire
CA Paris, 1-10, 16 mars 2023, n° 22/06534
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 30 mars 2023, n° 22/06948
CA Paris, 1-2, 1er juin 2023, n° 22/16112
CA Versailles, 16e ch., 13 avril 2023, n° 22/06484
CA Paris, 1-10, 13 avril 2023, n° 22/08268
CA Reims, ch. civ., 12 mai 2023, n° 22/02025
CA Grenoble, ch. com., 23 mars 2023, n° 20/04227
CA Grenoble, 1re ch. civ., 28 mars 2023, n° 21/01298
CA Agen, 1re ch., 27 mars 2023, n° 22/00649
CA Agen, 1re ch., 27 mars 2023, n° 22/00649
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 avril 2023, n° 22/04100
V. Saisie des véhicules terrestres à moteur
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 avril 2023, n° 22/04438
CA Toulouse, 26 mai 2023, n° 21/04694
CA Paris, 5-1, 19 avril 2023, n° 21/17661
CA Toulouse, 3e ch., 24 mai 2023, n° 22/02138
CA Lyon, 8e ch., 5 avril 2023, n° 21/01876
CA Bastia, 21-06-2023, n° 22/00134
- Signification (procès-verbal de recherches infructueuses) (CA Paris, 1-10, 16 mars 2023, n° 22/06534 N° Lexbase : A05749KH)
Suivant procès-verbal du 19 octobre 2021, un créancier a fait pratiquer à l’encontre de son débiteur une saisie-attribution entre les mains d’une banque pour avoir paiement d’une somme totale de 14 794,54 euros. Cette saisie, qui s’est avérée entièrement fructueuse, est dénoncée à la débitrice par acte d’huissier du 25 octobre 2021 (dépôt étude).
Le débiteur conteste la mesure, soulevant l’irrégularité de la signification du jugement, laquelle a été effectuée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6831H77. Il invoque en premier lieu l’insuffisance des diligences de l’huissier, soutenant que celui-ci doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile du destinataire de l’acte et doit relater avec précision, dans son procès-verbal, toutes les diligences accomplies. En l’espèce, le procès-verbal reproduit mot pour mot celui dressé pour la délivrance de l’assignation où l’huissier a limité ses recherches sur infogreffe et le Bodacc de sorte qu’il n’a pas opéré de véritables vérifications selon le saisi, alors qu’il a un site internet, connu du créancier, qui permet de connaître ses coordonnées, notamment son adresse, qui a été modifiée le 26 avril 2021.
En l’espèce, l’huissier de justice avait ainsi rédigé son acte :
« À l’adresse ci-dessus indiquée qui constitue le dernier siège connu déclaré par le requérant, ou étant :
Au [adresse], le clerc significateur a constaté que tant le nom de la société que le nom de sa gérante, Madame [débiteur], ne figuraient sur les boîtes aux lettres et interphone. II a rencontré le gardien qui lui a indiqué que Madame [débiteur] était la fille de l’ancienne gardienne ; il a ajouté qu’elle n’habitait plus à cette adresse, sans préciser depuis combien de temps. Nos recherches sur infogreffe et Bodacc ne révèlent aucune procédure collective ni aucun transfert de siège social et confirment l’adresse du siège de la société au [adresse]. II a été constaté qu’à ce jour aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte ni à son domicile, sa résidence ou son siège. En conséquence, après avoir interrogé les proches et commerçants, ces diligences n’ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte.
J’en ai avisé mon correspondant qui après avoir effectué des recherches, m’a déclaré que l’adresse ci-dessus était la dernière connue. »
La cour d’appel de Paris juge « qu’en 2021, il est pour le moins surprenant que l’huissier n’ait pas effectué de recherches sur internet, autres qu’infogreffe, notamment sur les Pages Jaunes, site de référence pour rechercher les adresses des personnes physiques et morales. En outre, une recherche sur Google ou un autre moteur de recherche aurait permis de découvrir que la société débitrice avait un site internet, comme la créancière le savait d’ailleurs ». Une solution qui peut apparaître dure de prime abord, mais qui se justifie pleinement à l’ère de l’open data…
- Confirmation du siège social par le gérant contacté téléphoniquement (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 30 mars 2023, n° 22/06948 N° Lexbase : A60909MI)
Dans cette affaire, un huissier de justice se déplace sur le lieu d’une signification pour y accomplir son office. Rien de plus normal. Là où l’affaire sort de l’ordinaire, c’est qu’arrivé sur place, l’officier public et ministériel constate que la société est fermée. Il prend donc l’initiative de contacter téléphoniquement le gérant, lequel lui confirme la réalité de l’adresse. Il signifie donc l’acte en « dépôt étude » et relate ses diligences dans son procès-verbal.
Le temps venu de l’exécution, le gérant de la société débitrice conteste la signification de l’acte en relevant que l’adresse où s’est rendu l’huissier de justice est le lieu d’exploitation, et non le siège social ! La Cour, en retenant l’absence de grief, juge que « le procès-verbal mentionne que le bureau est fermé mais que l’huissier a reçu confirmation du siège par contact téléphonique avec le gérant. L’appelante ne peut contester cette communication par simple dénégation alors qu’elle constitue une vérification personnelle de l’huissier, laquelle fait foi jusqu’à inscription de faux ». Elle valide donc la signification.
- Adresse de signification et lieu de livraison (CA Paris, 1-2, 1er juin 2023, n° 22/16112 N° Lexbase : A28529YB)
Une assignation est délivrée à une société. L’huissier de justice, juriste de terrain, délivre l’acte à l’entrée dédiée aux livraisons de colis et non à l’adresse indiquée sur l’extrait K-bis comme siège social. Plus encore, l’assignation ne portait pas l’adresse du siège social, mais uniquement l’adresse du lieu de livraison.
Pour ce motif, la cour d’appel parisienne rappelle que selon l’article 648 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6811H7E, tout acte d’huissier de justice doit indiquer, à peine de nullité, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Puis, elle souligne que selon l’article 114 du même code N° Lexbase : L1395H4G, la nullité d’un acte pour vice de forme est encourue à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Elle en conclut la nullité de l’acte puisqu’en l’espèce, force est de constater que l’assignation introductive d’instance est entachée d’irrégularité en ce qu’elle ne mentionne pas l’adresse exacte du siège social de la société défenderesse, mais une adresse erronée.
Afin d’éviter la nullité de l’acte, la solution pour l’huissier de justice aurait peut-être été d’indiquer de manière manuscrite sur l’assignation l’adresse du siège social, et de préciser en mention manuscrite « rencontré à [adresse] », « ci-devant et actuellement [adresse] » ou « et pour signification [adresse] », comme l’a admis la jurisprudence (CA Rennes, 2e ch., 9 février 2012, n° 11/03353 N° Lexbase : A2309ICI ; CA Rennes, 4e ch., 26 avril 2012, n° 11/07669 N° Lexbase : A2820IKN).
- Avis de passage (CA Versailles, 16e ch., 13 avril 2023, n° 22/06484 N° Lexbase : A78299PN)
Un commissaire/huissier de justice est requis pour signifier un acte à une personne demeurant sur une péniche.
Sur place, en l’absence du destinataire de l’acte, l’officier public ministériel laisse, conformément à la loi, un avis de passage puis envoie une copie de l’acte par courrier.
Le destinataire de l’acte conteste cette signification au motif que l’huissier de justice connaissait son lieu de travail et qu’il n’a pas indiqué avec précision où il avait déposé l’avis de passage.
Il prétend ne pas avoir trouvé l’avis de passage, d’autant que la péniche n’avait ni porte ni boîte aux lettres (seule une batterie de boîtes aux lettres existe à plusieurs dizaines de mètres de la péniche…) ce qu’il a d’ailleurs fait constater par huissier de justice !
Le commissaire/huissier de justice doit-il indiquer dans son acte l’endroit exact où il a déposé son avis de passage, dépassant par là même les exigences de l’article 656 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6825H7W ? De plus, le commissaire/huissier de justice peut-il s’abstenir de se présenter sur le lieu de travail du destinataire de l’acte s’il a la certitude du domicile ? Comment lire ensemble les articles 654 N° Lexbase : L6820H7Q et 689 N° Lexbase : L6890H7C du Code de procédure civile ?
La cour d’appel versaillaise valide la signification.
Elle juge que l’obligation qui incombe à l’huissier est de laisser un avis de passage au domicile, peu important, pour la validité de l’acte, que cet avis soit effectivement parvenu à son destinataire et qu’aucune obligation n’est faite de préciser à quel endroit exactement il a déposé l’avis de passage.
Elle poursuit en indiquant que : « Lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est, a contrario, pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail ».
Cet arrêt est intéressant en ce qu’il consacre la force la signification, d’autant qu’en l’espèce le destinataire de l’acte ne contestait pas demeurer effectivement à l’adresse indiquée par le commissaire/huissier de justice.
Cette décision propose une lecture intéressante des articles 654 et 689 du Code de procédure civile, conforme à une jurisprudence constante. Certes, la remise à personne peut être faite en tout lieu, mais la tentative sur le lieu de travail n’est obligatoire que si le domicile est incertain ou inconnu, comme l’indique d’ailleurs l’article 659 N° Lexbase : L6831H77 du même code.
- Acquiescement à saisie-attribution et abus de confiance (CA Paris, 1-10, 13 avril 2023, n° 22/08268 N° Lexbase : A76069PE)
Les faits sont communs : un débiteur se présente à l’accueil de l’étude d’huissier de justice qui lui a signifié une dénonciation de saisie-attribution. L’huissier de justice lui présente un formulaire d’acquiescement, que le débiteur signe.
Étonnamment, le débiteur revient peu après en réclamant de récupérer l’acquiescement, ce que l’officier public et ministériel lui refuse. Mécontent, le débiteur se rend au commissariat de police le plus proche pour porter plainte contre l’huissier des chefs d’abus de faiblesse. Le créancier conteste bien sûr les allégations du débiteur au motif :
- que cet acquiescement ne lui a nullement été extorqué ;
- que l’intéressé disposait de toutes ses facultés intellectuelles ;
- qu’il sera rappelé qu’il a pu se rendre seul à l’étude de l’huissier de justice, de même qu’au commissariat de police pour y porter plainte contre cet auxiliaire de justice ; que la teneur de son audition démontre qu’il était en pleine possession de ses moyens.
En première instance, le juge de l’exécution écarte les prétentions du débiteur. La cour d’appel infirme cependant le jugement au motif qu’il s’avère que l’avocat des créanciers avait répondu à l’avocat du débiteur « vous m’indiquez vouloir contester la saisie-attribution » ce qui démontre qu’il savait que ladite contestation était imminente. Elle poursuit en jugeant que : « Même s’il n’est pas démontré que l’huissier de justice en était informé, sa connaissance de l’intervention d’un avocat au soutien des intérêts du débiteur lui interdisait de faire signer à ce dernier un acte d’acquiescement, dont manifestement il n’avait pas réalisé l’entière portée, ayant seulement compris que cela lui permettrait de faire débloquer son compte immédiatement, mais non pas que cela interdirait toute contestation future ».
Un arrêt à la conclusion étonnante finalement : il est possible pour un débiteur de signer un acquiescement à saisie-attribution, puis de revenir dessus ! En espérant que cet arrêt soit isolé…
- Immatricule huissier de justice ou commissaire de justice (CA Reims, ch. civ., 12 mai 2023, n° 22/02025 N° Lexbase : A70669UA)
Depuis le 1er juillet 2022, les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ont fusionné pour laisser place à un nouveau professionnel du droit : le commissaire de justice.
Le 18 novembre 2022, une signification est régularisée par le ministère de Me X., qui se dit « huissier de justice ». Or depuis le 1er juillet 2022, la profession d’huissier de justice a disparu et elle est remplacée par une nouvelle profession, celle de commissaire de justice.
La personne qui s’est vu signifier cette décision soulève la nullité de cette signification au motif qu’il n’existe plus d’huissier de justice !
L’appelant suggère deux questions préjudicielles à soumettre à la Cour de cassation :
- La profession de commissaire de justice constitue-t-elle une nouvelle profession ou une simple réorganisation des deux professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur ?
- La profession de commissaire de justice nécessite-t-elle la mise en place d’une prestation de serment s’agissant d’un officier ministériel ?
Plus concrètement, la question qui se pose est de savoir si un acte peut être signé par un « huissier de justice » et non par un « commissaire de justice » depuis le 1er juillet 2022 ?
La cour d’appel valide la procédure.
Pour ce faire, elle retient que l’ordonnance du 2 juin 2016 rappelle en effet que, tant qu’ils ne remplissent pas les conditions de formation à la profession de commissaire de justice, les professionnels en exercice au 1er juillet 2022 conservent leur titre d’huissier de justice (ou de commissaire-priseur judiciaire).
Partant, Me X. demeure huissier de justice tant qu’il n’aura pas accompli sa formation et les actes qu’il régularise sont parfaitement valables. Ce n’est qu’à compter du 1er juillet 2026 que les professionnels qui ne rempliront pas les conditions de la formation spécifique cesseront d’exercer.
- Clause de médiation et fin de non-recevoir (CA Grenoble, ch. com., 23 mars 2023, n° 20/04227 N° Lexbase : A30589LT)
Il est de jurisprudence constante que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Cela justifie l’importance portée à la clause de médiation dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 23 mars 2023.
Dans cette espèce, la clause était ainsi rédigée : « Les éventuels désaccords ou litiges quant à la validité, l’application ou l’interprétation de la présente convention devront donner lieu à une médiation préalable à toute saisine de la juridiction compétente ». La cour retient que cette clause utilise le verbe « devoir », terme dénué d’équivoque, ce qui impose donc aux parties de mettre en œuvre une mesure de médiation avant la saisine du juge concernant les litiges quant à la validité, l’application ou l’interprétation de la convention.
Elle souligne que ce caractère obligatoire est renforcé par la stipulation prévoyant que : « Durant tout le processus de médiation et jusqu’à son issue, les parties s’interdisent d’exercer toute action en justice l’une contre l’autre et pour le conflit objet de la médiation ».
La Cour précise que la description des modalités précises de mise en œuvre du processus, notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties à l’autre partie indiquant les éléments du conflit et proposant le non du médiateur, la saisine du médiateur par lettre recommandée avec accusé de réception et la durée de la médiation, ne caractérise pas un processus long et complexe visant à dissuader de toute action judiciaire.
Enfin, les juges retiennent que ni les échanges entre les parties et leur conseil ni la saisine de la Direccte ne constituent une médiation, celle-ci consistant à recourir à un tiers neutre et impartial dans les conditions prévues par le contrat aux fins que les parties trouvent par elles-mêmes une solution pour résorber leur conflit.
- Rédaction de la clause de médiation (CA Grenoble, 1re ch. civ., 28 mars 2023, n° 21/01298 N° Lexbase : A17589M3)
Une partie saisit la justice sans avoir mis en œuvre la clause de médiation contractuelle, laquelle était ainsi rédigée : « En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet ou gestionnaire habituel qui disposera de dix jours pour accuser réception de la réclamation pour y répondre.
À défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de l’AMF (suivent le nom du médiateur et l’adresse). En cas d’échec, le litige pourra être porté devant les tribunaux judiciaires ».
La cour juge que le libellé de cette clause n’est aucunement conditionnel, les termes « le client pourra » ou encore « les parties pourront » devant s’entendre comme l’autorisation, le pouvoir donné aux parties d’initier un arrangement amiable et à défaut une médiation, avant d’envisager l’éventualité de saisir les tribunaux, cette saisine étant cette fois-ci simplement envisagée (en cas d’échec, le litige pourrait être « porté ». Le fait de ne pas l’appliquer est donc susceptible de constituer une fin de non-recevoir.
- Décompte et provision (CA Agen, 1re ch., 27 mars 2023, n° 22/00649 N° Lexbase : A74439LA)
Si les bons comptes font les bons amis, les mauvais décomptes exacerbent les motifs d’inimitié !
Ainsi en est-il du cas où un débiteur subit une saisie-attribution, et qu’il l’observe d’un œil aussi attentif qu’avisé. Aussi remarque-t-il une erreur, en sa défaveur, dans l’application du taux d’intérêt qui lui est appliqué.
De plus, en se référant à la lettre de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2207ITW, il observe l’existence d’une ligne « frais à prévoir » (dénonciation-certificat de non-contestation-signification) non prévue par ce texte.
Saisi par cette contestation, le juge de l’exécution parisien avait validé l’acte, mais cantonné la saisie au montant recalculé conformément aux règles légales.
Quelle sanction encourt une saisie-attribution portant un décompte erroné défavorable au débiteur, l’erreur étant relative au taux d’intérêt appliqué ?
De la même manière, de quelle manière est sanctionné l’acte de saisie-attribution qui prévoit les frais subséquents à cet acte, alors même que le texte du Code des procédures civiles d’exécution ne précise pas cette possibilité ?
La cour d’appel parisienne valide l’acte.
Elle juge que « la mention d’une somme erronée -ou contestée- quant au quantum de la créance n’est pas de nature à entraîner l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, seule une absence de mention pouvant avoir cette conséquence. Il s’ensuit que l’erreur quant aux intérêts […] ne saurait avoir pour effet la nullité du procès-verbal de saisie-attribution querellé ».
Concernant les frais à prévoir, non prévus par la loi dans le décompte, cependant obligatoires dans la procédure, la Cour juge de manière lacunaire que « cette erreur ne peut avoir pour conséquence la nullité de l’acte ».
Elle en conclut à la validité de l’acte.
Il est vrai qu’accepter la validité d’une saisie-attribution portant un décompte non établi conformément à la loi peut surprendre. Il faut pourtant se rassurer en soulignant le fait que le juge a cantonné la saisie, de sorte que le débiteur n’a pas payé plus que ce à quoi il était condamné.
Quant aux « frais à prévoir » non prévus par le texte, le juge a respecté la philosophie du Code des procédures civiles d’exécution en les acceptant dans le décompte puisqu’il s’agit d’actes obligatoires, et donc non frustratoires.
- Saisie-attribution électronique et agence fermée (CA Agen, 1re ch., 27 mars 2023, n° 22/00649 N° Lexbase : A74439LA)
Une saisie-attribution électronique peut-elle être diligentée un lundi, alors même que l’agence qui tient le compte est fermée ?
Telle est l’étonnante question posée à la cour d’appel d’Agen, laquelle répond que : « Contrairement à ce que prétend [le débiteur], celle-ci était tout à fait réalisable le lundi 11 octobre 2021, jour de fermeture de l’agence locale et l’huissier de justice a bien mentionné sur la page intitulée “modalités de remise de l’acte” que l’acte a été remis à “la personne du destinataire Mme [Ab] [S] qui a pris connaissance du présent acte le jour même de sa signification conformément à l’article 662-1 du Code de procédure civile. ” Ce procès-verbal est daté et horodaté et signé numériquement par l’huissier de justice et la banque répond le jour même pour information sur la situation du compte ».
- Suppression de la trêve hivernale et voie de fait (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 avril 2023, n° 22/04100 N° Lexbase : A22459SX)
Les articles L. 412-1 N° Lexbase : L0259LNW et L. 412-6 N° Lexbase : L0258LNU du Code des procédures civiles d’exécution, ces délais peuvent être supprimés ou réduits notamment quand les occupants du logement s’y sont introduits par voie de fait. C’est ainsi qu’un jugement de première instance avait ordonné l’expulsion d’occupants sans droit ni titre, en prenant soin de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale et le délai de deux mois, habituellement lié au commandement de quitter les lieux.
En appel, pour confirmer le jugement, la cour retient qu’« il ressort du procès-verbal de constat du 1er mars 2022 que les portes anti-squats qui avaient été posées par le propriétaire ont été démontées et que la serrure de la porte d’entrée est neuve, que les voies de fait commises par les consorts [Aa] pour entrer dans le logement sont donc démontrées ».
V. Saisie des véhicules terrestres à moteur
- Maserati et outil de travail – appréciation du critère luxueux (CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 avril 2023, n° 22/04438 N° Lexbase : A50379SD)
Un créancier fait procéder à la saisie d’un véhicule Maserati Ghibli Diesel, SUV de luxe. Le débiteur conteste la mesure, arguant de ce que ce bien est insaisissable au sens de l’article L. 112-2-5 du Code des procédures civiles d’exécution, s’agissant d’un bien nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille et qui de surcroît ne présente pas un caractère luxueux au sens du 6° du même article.
Afin de dénier le caractère luxueux du véhicule, le débiteur soutient que la valeur d’un véhicule doit être appréciée in concreto, au regard de l’état réel de sa carrosserie et de son moteur et que le sien, évalué en janvier 2023 à la somme de 22 193 euros, n’a rien de luxueux, une berline de luxe avoisinant le prix de 60 à 70 000 euros. Il produit en outre une offre de reprise à hauteur de 18 950 euros…
Se pose donc la question de savoir comment apprécier le caractère luxueux d’un bien.
Pour répondre, la cour relève que le véhicule est en bon état, que la cotation Argus versée aux
débats n’émane pas d’un professionnel, et qu’elle ne cadre pas avec le prix d’achat du véhicule. Elle écarte ensuite l’estimation de reprise faite le 29 novembre 2022 à hauteur de 18 850 euros puisqu’elle n’est pas probante, dès lors qu’elle n’est pas signée de son auteur et qu’elle ne correspond pas à l’évidence à la valeur de ce véhicule sur le marché.
Elle en conclut à la validité de la saisie, le caractère luxueux du véhicule étant incontestable.
- Expert informatique (CA Toulouse, 26 mai 2023, n° 21/04694 N° Lexbase : A83339XW)
Dans la nuit du 21 au 22 février 2019, une société remarque la suppression de son Cloud de presque 2 000 fichiers sensibles et confidentiels.
Soupçonnant un de ses salariés parti en congés le 22 février, elle fait intervenir un huissier et un expert judiciaire qui procèdent ensemble à la copie de l’ordinateur portable du salarié pour analyse. Leur intervention confirme les doutes qui planent sur le salarié, qui aurait copié ces données sur un disque externe. Son employeur le licencie pour faute grave.
Par la suite, un juge mandate un huissier/commissaire de justice, en vain, pour se rendre chez le salarié afin de retrouver les documents supprimés.
Le conseil de prud’hommes saisi par le salarié, qui estime être victime de harcèlement moral, juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Deux questions se posent à la lecture de l’arrêt :
1. L’intervention d’un huissier/commissaire de justice couplée à celle d’un expert déploie-t-elle suffisamment de force probante pour établir la réalité d’une faute grave, quand bien même :
- elle a été réalisée de manière non contradictoire ?
- les fichiers n’ont pas été retrouvés ?
2. Faire appel plusieurs fois à un huissier/commissaire de justice constitue-t-il un harcèlement moral ?
La cour d’appel admet la faute grave en relevant notamment que l’intervention du commissaire de justice a permis la traçabilité des opérations, et que la note technique de l’expert met en exergue le comportement fautif du salarié.
Elle juge que « les notes techniques annexées aux constats d’huissiers peuvent être discutées par les parties et ne sont pas dépourvues de valeur probante ».
Même si les fichiers supprimés n’ont pas été retrouvés in fine, comme le disque dur externe, la preuve est établie de leur suppression volontaire puisque le salarié était encore en possession de son ordinateur, dont le mot de passe était inconnu de l’employeur.
Elle juge enfin que l’intervention d’un huissier au domicile du salarié ayant été autorisée par un juge, elle ne peut être constitutive d’une faute.
Le recours au tandem huissier/expert informatique est des plus courant, que ce soit dans le cadre d’une fuite de données, d’un détournement de clientèle ou d’un acte de malveillance interne.
La décision évoquée est intéressante en ce qu’elle rappelle que l’intervention huissier/expert peut être réalisée de manière non contradictoire, à l’insu de la partie adverse, pourvu que l’acte puisse être discuté par la suite en cours d’instance.
- Internet et norme Afnor (CA Paris, 5-1, 19 avril 2023, n° 21/17661 N° Lexbase : A72669Q8)
Un commissaire/huissier de justice dresse trois constats sur internet.
Produit en justice, la partie adverse critique ces actes au motif (entre autres !) :
- qu’ils ne respectent pas la norme Afnor NF Z67-147 ;
- que l’heure de l’horloge est illisible ;
- que des copies-écran sont illisibles ;
- qu’il n’est pas justifié que l’huissier ait procédé au rafraîchissement de chacune des pages ;
- qu’il est possible que l’historique de navigation n’ait pas été complètement purgé.
En première instance, le tribunal judiciaire balaie ces arguments et valide les trois constats sur internet.
Deux questions se posent :
La norme Afnor NF Z67-147 s’impose-t-elle aux huissiers de justice appelés à dresser des constats sur internet ?
Dans la négative, quelles obligations s’imposent à ces officiers publics et ministériels ?
La cour d’appel parisienne valide les constats.
Pour ce faire, elle retient que « la norme Afnor NF Z67-147 n’a pas un caractère obligatoire » et rappelle les diligences préalables requises avant l’établissement d’un constat :
- description du matériel ;
- indication de l’adresse IP ayant servi aux opérations de constat ;
- vidage des caches de l’ordinateur ;
- désactivation de la connexion par proxy ;
- suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur, de l’ensemble des cookies et de l’historique de navigation.
Seul le protocole prétorien est donc nécessaire à la bonne réalisation d’un constat sur internet.
Cet arrêt confirme une nouvelle fois que la norme Afnor NF Z67-147 n’a aucun caractère contraignant, ce qui est fidèle à une jurisprudence constante depuis 2010.
Cette norme possède une vertu pédagogique indéniable, mais ne saurait constituer une source de droit, d’autant qu’elle fait référence dans ses annexes à un navigateur internet qui n’est plus utilisé aujourd’hui, et qu’elle est difficilement compatible avec l’internet mobile.
- Afnor : internet et smartphone (CA Toulouse, 3e ch., 24 mai 2023, n° 22/02138 N° Lexbase : A52389XB)
Une nouvelle fois, la question de la norme Afnor s’est posée. Dans cette affaire, un débiteur demande la nullité d’un constat d’huissier au motif que « l’huissier a déclaré déroger par pure convenance au protocole probatoire de la norme Afnor NF Z67-147 garantissant la neutralité des informations constatées, purgées de tout contenu parasite ». La cour écarte sa demande au motif que la norme Afnor n’étant pas une disposition légale ou règlementaire, le non-respect des diligences techniques préalables n’est pas sanctionné par la nullité du procès-verbal de constat, mais éventuellement, par le défaut de force probante des constatations ainsi effectuées. Elle en conclut que « le procès-verbal de constat -internet qui n’est pas établi suivant cette norme n’est pas susceptible d’annulation et sa force probante n’est pas non plus utilement critiquée ».
Elle souligne en plus qu’un constat sur smartphone n’ayant pas nécessité de navigation sur smartphone n’a pas à respecter le protocole des constats sur internet.
- État des lieux (CA Lyon, 8e ch., 5 avril 2023, n° 21/01876 N° Lexbase : A68779NZ)
Un couple a pris à bail une maison en 2015, et a donné congé.
Les locataires mandatent un huissier de justice pour convoquer le bailleur et dresser un état des lieux de sortie. Alors même que le bailleur convoqué informe l’huissier/commissaire de son absence, l’état des lieux est dressé. Au terme de la loi, cet acte est donc réputé contradictoire.
Une semaine après, sans convoquer les locataires, le bailleur fait appel à un autre huissier pour dresser un état des lieux non contradictoire.
Sur le fondement de ce constat, le bailleur assigne les locataires, demandant notamment leur condamnation à payer 6 501,50 euros au titre des réparations locatives.
En première instance, le juge a retenu que « le constat d’état des lieux de sortie réalisé à l’initiative des propriétaires ne présentait pas de caractère contradictoire contrairement à celui réalisé à la demande des locataires ». Il fonde donc sa décision sur cet acte et octroie au bailleur 2 000 euros au titre des réparations locatives. Bien moins que ce qu’il demandait.
Le bailleur interjette appel, demandant notamment à que le constat d’huissier qu’il a fait dresser unilatéralement soit déclaré opposable aux locataires, même s’ils n’avaient pas été convoqués, et qu’ils en supportent donc le coût.
La cour d’appel lyonnaise confirme le jugement attaqué.
Elle relève que l’huissier/commissaire de justice a dressé son état des lieux de sortie à la requête et en présence des locataires, après convocation du bailleur qui avait informé le professionnel du droit de son absence. Le bailleur n’ayant pas demandé de report de date de l’état des lieux de sortie, la cour d’appel en conclut que le constat est contradictoire et son coût supporté à frais partagés.
Concernant le constat dressé par le bailleur sans convocation, elle juge que « ce constat ne s’assimile pas à un constat d’état des lieux de sortie comme prévu par […] la loi du 6 juillet 1989, les locataires n’ayant pas été avisés de l’acte. Il constitue une pièce versée au débat comme d’autres pièces ».
Elle en conclut que le coût du constat établi à la demande du bailleur doit rester à ses frais.
- Constat : pénétration dans un lieu privé (CA Bastia, 21-06-2023, n° 22/00134 N° Lexbase : A931094L)
Il existe des arrêts à retenir. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 21 juin 2023 en fait partie. Il traite d’une délicate question qui se pose régulièrement au commissaire de justice compétent : celle de savoir comment accéder à un lieu privé en l’absence de l’occupant, lorsqu’il est mandaté pat un tiers ?
Il est constant que l’huissier de justice a l’obligation de demander l’autorisation à l’occupant des lieux pour y pénétrer, sauf s’il est porteur d’une décision de justice. En matière de constat à la requête de particuliers, l’huissier de justice ne peut faire l’économie d’une demande d’autorisation à pénétrer dans les lieux, comme il résulte d’une circulaire du 31 janvier 1903 du garde des Sceaux [1]. Cette interdiction fut très vite complétée par une sanction des juges [2].
La demande d’accès aux lieux doit être formulée auprès de l’occupant, étant ici précisé que l’huissier de justice n’a pas à s’assurer de la qualité de son interlocuteur. Comment obtenir l’accord de l’occupant pour pénétrer chez lui alors qu’il est absent ? Cette situation se rencontre fréquemment, notamment lorsque l’occupant a confié les clés au requérant ou au gardien… Il résulte d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qu’en l’absence de l’occupant, l’huissier de justice doit s’assurer de la réalité de l’accord du locataire et ne pas se contenter des déclarations de son mandant. Dans le cas où la personne rencontrée sur place est un « occupant du chef de l’occupant principal », la cour d’appel de Douai indique que la seule indication qu’il s’agissait de son concubin, sans nulle autre précision, est insuffisante.
L’arrêt de la cour d’appel de Bastia éclaire encore plus la question, répondant à celle de savoir si sur un chantier, un commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires cherche à constater la réalité de travaux non autorisés dans un appartement. Dans le lot indiqué, il ne rencontre pas le propriétaire, mais un « ami » (certainement un ouvrier qui était sur le chantier alors qu’il n’était pas censé d’y être), qui le laisse entrer dans les lieux.
Bien évidemment, la partie à qui est opposée (le copropriétaire qui faisait les travaux non autorisés) le constat conteste les conditions de sa réalisation.
La cour d’appel indique tout d’abord que « selon l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice N° Lexbase : L8061AIE, ces derniers peuvent effectuer des constatations matérielles, sur commission d'un juge ou à la requête de particuliers. Dans cette dernière hypothèse, le constat d'huissier peut être réalisé dans un lieu privé occupé par un tiers à condition d'obtenir l'autorisation de l'occupant ».
Elle poursuit ainsi « il ressort du procès-verbal de constat que l'huissier de justice a réalisé des photographies à l'extérieur du logement avant de manifester sa présence à la porte de l'appartement et de constater qu'elle lui était ouverte par un individu à qui il exposait sa qualité ainsi que le motif de sa venue. Il ajoutait que celui-ci lui avait indiqué être un ami de [L] [X], venu poser de la faïence dans la salle de bains, mais qu'il avait refusé de lui communiquer son identité tout en le laissant pénétrer dans l'appartement. L'huissier de justice concluait son procès-verbal en mentionnant que [L] [X] était finalement arrivé dans l'appartement après avoir été prévenu par son ami et s'était montré verbalement agressif à son égard ». Elle en conclut que « l'huissier de justice est intervenu à la demande d'un particulier dans un lieu privé sans avoir obtenu, ni même sollicité l'assentiment de ce dernier. Il ne saurait se déduire de l'attitude passive de la personne non-identifiée, présente lors de son intervention, que celle-ci avait qualité à lui permettre de pénétrer dans les lieux, ce qu'elle n'a au demeurant pas fait de manière positive au regard des énonciations du procès-verbal (…). L'absence d'opposition de cette personne à l'action de l'huissier de justice ne peut valablement être assimilée en l'espèce à une autorisation d'entrer dans les lieux qui lui aurait été délivrée ».
Dès lors, la cour d’appel sanctionne le constat « réalisé en dehors de toute autorisation judiciaire dans un lieu privé et sans tentative préalable de contacter son occupant pour l'inviter à y assister » et l’écarte des débats.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485924
[Brèves] Mainlevée de mesure conservatoire : quid de la conséquence sur l’effet interruptif de prescription ?
Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-11.987, F-B N° Lexbase : A39579U4
Lecture: 2 min
N5499BZP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 28 Juin 2023
► La décision de mainlevée, prise en application de l'article L. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, n'a pas d'effet rétroactif ; par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription.
Faits et procédure. Dans cette affaire, sur le fondement d’un jugement et de deux arrêts de cour d’appel, une société a fait pratiquer le 11 juin 2018 un nantissement provisoire des parts sociales détenues par M. X dans son capital social dont la mainlevée a été ordonnée par un jugement du 12 novembre 2018, puis confirmé par un arrêt du 20 juin 2019. Par la suite se fondant sur les mêmes titres exécutoires, la société a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente au débiteur. Ce dernier a saisi le juge de l’exécution en contestation.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Paris, 4-8, 19 novembre 2020, n° 19/15654 N° Lexbase : A072437X), d’avoir confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, sauf sur le quantum. Il fait valoir notamment la violation des articles L. 511-1 N° Lexbase : L5913IRG et L. 512-1 N° Lexbase : L5917IRL du Code des procédures civiles d'exécution et 2244 du Code civil N° Lexbase : L4838IRM. Il soutient que la mesure conservatoire ayant fait l’objet d’une mainlevée, elle ne pouvait avoir interrompu le délai de prescription de la créance.
En l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'effet interruptif du nantissement provisoire des parts sociales était resté intact. La décision de mainlevée de cette mesure conservatoire n'a pas d'effet rétroactif, et par conséquent, la mesure conservatoire conserve son effet interruptif de prescription même après sa mainlevée.
Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions des articles 2244 du Code civil et L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485499
[Brèves] Revalorisation du RSA correspondant à la fraction insaisissable
Réf. : Décret n° 2023-340, du 4 mai 2023, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active N° Lexbase : L5931MH7
Lecture: 1 min
N5390BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 28 Juin 2023
► Un
La notice explicative énonce que le coefficient de
Dès lors, le
Il convient de rappeler que le
Le
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485390
[Brèves] Revalorisation du RSA à Mayotte correspondant à la fraction insaisissable
Réf. : Décret n° 2023-341 du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte N° Lexbase : L5929MH3
Lecture: 1 min
N5391BZP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 28 Juin 2023
► Un
La notice explicative énonce que le coefficient de
Dès lors, le
Il convient de rappeler que le
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485391
[Pratique professionnelle] Infographie : l'expulsion d'un local d'habitation
Réf. : INFO704, L'expulsion d'un local d'habitation N° Lexbase : X2251CQG
Lecture: 1 min
N6008BZK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 27 Septembre 2023

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486008
