[Brèves] Non-communicabilité des comptes annuels d’une fondation d'entreprise n'ayant reçu aucune subvention publique
Réf. : CE Sect., 7 octobre 2022, n° 443826, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A91988MM
Lecture: 4 min
N2902BZI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 12 Octobre 2022
► Les comptes des fondations n'ayant reçu aucune subvention publique ne sont, en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément, pas communicables aux tiers.
Rappel. Il résulte des articles L. 300-2 N° Lexbase : L4910LA4, L. 311-1 N° Lexbase : L4912LA8, L. 311-6 N° Lexbase : L7092MAW et L. 311-7 N° Lexbase : L1871KNM du Code des relations entre le public et l'administration que les documents produits par une personne privée qui n'est pas investie d'une mission de service public acquièrent le caractère de documents administratifs, pour l'application du CRPA, dès lors qu'ils ont été reçus par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public.
De tels documents, sauf à ce qu'il soit possible d'occulter ou de disjoindre les mentions en cause, ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée au sens et pour l'application de l'article L. 311-6 précité.
Ces dispositions doivent être entendues, s'agissant de leur application aux personnes morales de droit privé, comme excluant en principe, sous réserve qu'elle ne soit pas imposée ou impliquée par d'autres dispositions, la communication à des tiers, par l'autorité administrative qui les détient, des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. La circonstance que de tels documents aient été transmis à l'administration afin de permettre à celle-ci d'exercer un contrôle sur l'activité de l'organisme concerné est sans incidence, par elle-même, sur les conditions dans lesquelles des tiers peuvent se les voir communiquer.
Application. Les comptes annuels d'une fondation d'entreprise, reçus par l'administration dans le cadre de la mission de service public de contrôle administratif des fondations d'entreprise qui lui est dévolue par l'article 19-10 de la loi n° 87-571, du 23 juillet 1987 N° Lexbase : L8334AGR, constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) N° Lexbase : L4910LA4.
De tels documents sont, par nature, relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de la fondation et entrent donc dans le champ de la protection instituée par le 1° de l'article L. 311-6 du CRPA N° Lexbase : L7092MAW (voir de manière analogue pour la non-communicabilité d’informations se rapportant à la stratégie commerciale de l'ONF, CE, 9°-10° ch. réunies, 27 septembre 2022, n° 451627, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A21338LL).
Position CE. Il résulte du septième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321, du 12 avril 2000 N° Lexbase : L0420AIE, des dispositions combinées de l'avant-dernier alinéa de cet article, du premier alinéa de l'article L. 612-4 du Code de commerce N° Lexbase : L7465L7M et de l'article D. 612-5 du même Code N° Lexbase : L2454HZW et de l'article 13 du décret n° 91-005, du 30 septembre 1991 N° Lexbase : L5636MEH que :
- les statuts des fondations d'entreprise sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des informations qui seraient couvertes par les secrets protégés par la loi ;
- mais que les comptes des fondations n'ayant reçu aucune subvention publique, qui relèvent de la vie privée de ces organismes au sens de l'article L. 311-6 du CRPA et qui font l'objet des contrôles résultant des articles 19, 19-9 et 19-10 de la loi n° 87-571, du 23 juillet 1987, ne sont, en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément, pas communicables aux tiers (voir pour l’absence d’obligation pour le ministère du Travail de communiquer à une personne qui n'est pas directement concernée par ces informations, la liste des entreprises adhérentes d'une union syndicale et des effectifs de celles-ci – également sous le prisme de la protection de la vie privée - CE, 9°-10° s-s-r., 17 avril 2013, n° 344924, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1385KCB).
Position rapporteur public. Selon Laurent Domingo, « Dans ces conditions, dès lors que les comptes d’une fondation d’entreprise relèvent de ses affaires internes, dès lors que le législateur n’en a pas prévu la publicité, et qu’il n’a d’ailleurs envisagé que l’accès aux statuts de la fondation d’entreprise, et dès lors que celle-ci n’a pas perçu de subventions publiques, l’exception de l’article L. 311-6 du CRPA relative à la protection de la vie privée doit s’appliquer en cas de demande de communication de ces comptes auprès de l’autorité administrative qui les a reçus au titre de sa mission de contrôle administratif ».
Application. Le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que la fondation Louis Vuitton n’avait perçu aucune subvention publique au titre des années 2016 et 2017, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les comptes correspondant à ces deux exercices n’étaient pas communicables à l’association Anticor.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482902
[Brèves] Passerelle « juriste d’entreprise », juriste en galerie d’art et étude d’huissier : illustration de l’application stricte du régime dérogatoire
Réf. : CA Versailles, 27 septembre 2022, n° 21/04953 N° Lexbase : A14768MM
Lecture: 7 min
N2945BZ4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
Le 02 Novembre 2022
► Le régime dérogatoire aux règles générales relatives à l’inscription des avocats à un barreau dont peuvent bénéficier les juristes d’entreprise est d’application stricte et son bénéfice est conditionné à la preuve, par le demandeur, de la réalisation effective des conditions fixées. Il appartient aux juristes d’entreprise désireux de bénéficier de cette passerelle de démontrer l’existence d’une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise, exercée exclusivement au sein d’un service spécialisé, identifié comme tel au sein de l’entreprise.
La multitude de tâches liées à l’activité normale d’une galerie d’art exclut le caractère exclusif des fonctions de juriste. De même, ne peut bénéficier de cette passerelle le demandeur qui a réalisé les tâches liées à l’activité juridique classique d’une étude d’huissier mais n’a pas été affecté à un service dédié aux problématiques juridiques posées par l’activité de l’étude.
Rappels des faits et de la procédure. Après avoir exercé six ans et demi (juin 2003 à décembre 2009) dans une galerie puis quatre ans (mai 2011 à juin 2015) chez une huissier de justice et dispensé des cours de droit à des élèves de BTS et des étudiants en gestion de patrimoine et métiers du notariat, le titulaire d’une maîtrise de droit (obtenue en 2011) a sollicité son inscription au barreau du Val-d’Oise au titre de la passerelle prévue par l’article 98, alinéa 3, du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat N° Lexbase : Z26469MD.
Cette passerelle prévoit la dispense de la formation théorique et pratique et du CAPA au profit des « juristes d’entreprise justifiant de huis ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises ».
Le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau du Val-d’Oise a admis l’intéressé au barreau du Val-d’Oise sur le fondement de l’article précité et dit qu’il pourrait, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 avril 2012, prêter serment après obtention de l'examen de contrôle des connaissances en matière de déontologie et de réglementation professionnelle organisé par le centre régional de formation.
Le procureur général près la cour d’appel de Versailles a interjeté appel contre la décision du Conseil de l’Ordre.
Motifs de l’appel. Le procureur général sollicitait l’infirmation de la décision du Conseil de l’Ordre et le rejet de la demande d’inscription au barreau du Val-d’Oise.
Le procureur général soutenait que l’intéressé ne justifiait par avoir exercé, pendant huit années, une activité de juriste d’entreprise au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises au sens de l’article 98, alinéa 3, précité.
Or, le ministère public souligne que la Cour de cassation envisage de façon stricte l’activité de juriste d’entreprise mentionnée dans ce texte en précisant que celle-ci « doit avoir été exercée de façon exclusive et révéler une certaine autonomie de la part de celui qui s’en prévaut dans la pratique du droit au sein d’un service spécialisé ». Au soutien de son argumentation, le procureur cite plusieurs arrêts en ce sens de la Cour de cassation.
Décision. La cour d’appel de Versailles infirme la décision du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau du Val-d’Oise ayant admis l’impétrant au barreau du Val-d’Oise.
La cour confirme que ce régime dérogatoire aux règles générales relatives à l’inscription des avocats à un barreau est d’application stricte et que son bénéfice est conditionné à la preuve, par le demandeur, de la réalisation effective des conditions fixées.
Sur la notion de juriste d’entreprise. Cette notion n’était définie ni par la loi ni par décret, les juges d’appel s’en remettent à la définition jurisprudentielle selon laquelle est juriste d’entreprise celui qui « exerce ses fonctions dans un département chargé au sein d'une entreprise publique ou privée, considérée comme étant la réunion de moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de réaliser un objectif économique déterminé, de connaître les problèmes juridiques ou fiscaux se posant à celle-ci, d'y assurer les fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie de l'entreprise qui ne peut être confondue avec le simple exercice professionnel du droit assimilable à une activité d'administration pure et simple couramment pratiquée dans cette entreprise ».
Au-delà de la notion même de juriste d’entreprise, la cour d’appel ajoute que la dispense accordée est subordonnée à la preuve d’une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise, exercée exclusivement au sein d’un service spécialisé, identifié comme tel.
S’agissant de l’activité au sein de la galerie d’art. La cour d’appel note qu’avant 2011, l’intéressé, qui exerçait comme responsable juridique non cadre, n’était pas titulaire d’une maîtrise de droit et ne remplissait donc pas les conditions de diplôme pour occuper un poste de juriste d’entreprise lequel est, selon la jurisprudence, généralement confié à des cadres.
Observant dans un deuxième temps les différentes tâches dont l’intéressé atteste (notamment : gestion des problématiques juridiques liées à l’activité de l’entreprise et à ses fonctions d’expert, rédaction et vérification de contrats d’achat, de vente ou de dépôt, vérification et respect du registre de police obligatoire, gestion juridique du transport et de l’acheminement de biens, maîtrise juridique du processus d’identification d’un bien, gestion du bail et de l’assurance du lieu, gestion du contentieux de l’entreprise, défense de l’entreprise lors de contestations relatives au processus d’identification ou de restauration, au contenu d’un certificat, gestion juridique de certains sinistres de l’entreprise, représentation de l’entreprise sur le plan du droit lors de déplacements, conseil juridique en matière de partage de succession, de fiscalité, de statut, de responsabilité) les juges d’appel estiment que seule la mission de gestion du contentieux de l’entreprise était susceptible de correspondre à la définition jurisprudentielle de juriste d’entreprise dégagée par la Cour de cassation.
En considération de la multitude de tâches liées par à l’activité normale de la galerie exercée par l’intéressé, celui-ci n’exerçait pas à titre exclusif les fonctions de juriste d’entreprise.
S’agissant de l’activité chez l’huissier de justice. Appréciant à nouveau les missions confiées à l’employé (rédaction d’actes, mise en place de procédures judiciaires, recherches juridiques dans les dossiers contentieux, contrôle de conformité, argumentation juridique pour la défense des intérêts des créanciers) les juges d’appel constatent qu’il s’agit de tâches liées à l’activité juridique classique d’une étude d’huissier mais que l’intéressé n’a pas été affecté à un service dédié aux problématiques juridiques posées par l’activité de l’étude.
S’agissant de l’activité d’enseignement. La cour d’appel constate sans peine que le demandeur à l’inscription avait fondé sa demande sur l’article 98 précité et non sur l’article 97, 4° du même décret N° Lexbase : Z30430LQ lequel prévoit une passerelle similaire au profit de certains universitaires.
Au terme de leurs constatations, les juges d’appel constatent que les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l’article 98 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 ne sont pas remplie, raison pour laquelle la décision du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau du Val-d’Oise admettant l’intéressé au barreau du Val-d’Oise est infirmée.
| Pour aller plus loin : voir ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Le principe général de la « passerelle » juriste d'entreprise-avocat, in La profession d’Avocat, (dir. H Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33343RW. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482945
[Le point sur...] Un élève avocat peut-il bénéficier des avantages stagiaires lors de son PPI ?
Lecture: 8 min
N2766BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sarah Zerouali-Ducrocq, responsable juridique et formatrice
Le 13 Octobre 2022
Mots clés : avocat • élève-avocat • statut • indemnités • stage • stagiaire • PPI • avantages
Dès son entrée à l’école des avocats, l’élève-avocat a un statut particulier, de plus en plus décrié par la profession et par les principaux intéressés.
Face à cela, l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux (CNB) avait adopté en novembre 2018, sur rapport de la commission de formation professionnelle, un ensemble de propositions de réforme concernant la formation initiale des avocats au regard de la durée de la formation mais également du statut des élèves-avocats.
En avril 2021, le Conseil constitutionnel a refusé une partie des propositions formulées par le CNB N° Lexbase : A36894PC. Par la suite, un avant-projet de décret [1] a vu le jour prévoyant notamment la généralisation de l’alternance pour les élèves avocats et donc la reconnaissance d’un statut plus stable pour ces derniers. Cette réforme n’est actuellement pas encore mise en place au niveau national.
Sur la formation initiale telle qu’elle existe encore, trois périodes se suivent, dont le projet pédagogique individuel (PPI) qui a pour objet d’encourager l’élève avocat à découvrir divers milieux sociaux et professionnels, hors du cabinet d’avocat. L’élève avocat n’a pas réellement le même statut lors de ces trois phases. Dès lors, il n’a pas non plus les mêmes avantages, lesquels sont règlementés différemment (par exemple la rémunération).
Qu’est-ce que le PPI ?
La formation professionnelle exigée pour devenir avocat débute par l’obtention de l’examen d’accès au Centre Régional de Formation Professionnelle, elle se poursuit par trois phases distinctes, pour un total de dix-huit mois, et elle s’achève par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat [2].
Le projet professionnel individuel (PPI) est une des trois phases du programme de l’école des avocats [3] et a pour objectif de familiariser l’élève-avocat avec différents milieux sociaux et professionnels.
Il s’agit d’une période de stage professionnel de six mois, pouvant être portée à huit mois, permettant à l’élève avocat de suivre :
- soit un stage au sein d’une structure nationale telle qu’une entreprise, une collectivité territoriale, une association, un syndicat, une étude de notaires ou d’huissiers, chez un mandataire judiciaire, etc. ;
- soit un stage dans un cabinet d’avocat à l’étranger, ou d’un avocat près la Cour de cassation ou près le Conseil d’État ;
- soit de suivre une formation (M2 – D.U. – Mastère… d’une durée de 250 heures).
Les modalités et le contenu du PPI sont déterminés par l’élève avocat, en collaboration avec son école et le maître de stage afin d’assurer une certaine pertinence pédagogique du projet.
Ainsi, le PPI est encadré par une convention de stage qui précise les droits et devoirs de l’élève avocat et de la structure d’accueil.
Il est permis aux élèves avocats de varier les expériences pendant cette période, tout en limitant la durée minimale de chaque stage à un mois.
Le PPI ne peut pas être effectué dans un cabinet d’avocat français. Aucune dérogation n’est possible.
Lors du PPI, l’élève avocat est soumis au secret professionnel [4] : c’est le fameux « petit serment » de début de parcours.
En 2015, alors qu’elle était saisie à ce propos, la Chancellerie a indiqué que la formation initiale des élèves avocats ne relevait pas du service public de l’enseignement mais correspondait à une formation professionnelle, organisée par les avocats.
Plus généralement, la formation des élèves avocats est assurée par les centres régionaux de formations professionnelles. Il en existe actuellement seize en France métropolitaine et territoires d’Outre-Mer.
Quel statut et avantages pour l’élève avocat pendant ce PPI ?
L’élève avocat bénéficie d’un statut hybride, aux contours parfois flous.
Étant en période d’apprentissage, celui-ci n’a pas pour autant la qualification et les avantages de l’apprenti.
Il n’est pas non plus en contrat de professionnalisation.
De plus, l’élève avocat n’étant pas rattaché à l’Université, il n’est pas non plus stagiaire étudiant au sens initial de la législation commune des stages réglementés par le Code de l’Éducation [5].
Également, puisqu’il n’a pas encore prêté serment (en dehors du petit serment), il ne peut pas être considéré comme avocat, salarié ou collaborateur.
Il s’agit donc d’un régime autonome encadré par le décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d’Avocat N° Lexbase : L8168AID, empruntant parfois certaines dispositions de certains Codes.
Par exemple, dans des cas spécifiques, la formation de l’élève-avocat peut s’inscrire dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, dont les contours sont prévus par le titre Ier du livre Ier du Code du travail [6].
Également, si l’élève-avocat a la qualité de stagiaire de la formation professionnelle, il bénéficie de l'aide de l'État en ce qui concerne sa rémunération dans les conditions fixées dans le Code du travail [7].
Il semble également que les dispositions du Code de l’éducation peuvent s’appliquer.
En effet, le stage PPI est répertorié comme un stage en milieu professionnel intégré dans un cursus pédagogique [8].
D’autres règles sont précisées par des sources spécifiques telles que :
- Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ ;
- Décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat N° Lexbase : L8168AID ;
- Arrêté du 6 décembre 2004, fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats N° Lexbase : L5245IGD ;
- Arrêté du 7 décembre 2005, fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat N° Lexbase : L5238HDD ;
- Arrêté du 19 juillet 2017, fixant le plafond du montant des droits d'inscription pouvant être exigés des bénéficiaires de la formation initiale dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats N° Lexbase : L3133LG7 ;
- Décision du 11 septembre 2020, définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) [LXB= Z9502493].
Dès lors, malgré la variété de sources qui encadre son statut et les différences qui peuvent subsister, l’élève-avocat bénéficie, dans le cadre de son PPI, de nombreux avantages communs aux stagiaires de l’Université.
En effet, lorsque la durée de stage au sein de la structure d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs, les stages font l’objet d’une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu.
À défaut, le montant horaire de cette gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité́ sociale.
Par ailleurs, si l’élève-avocat réalise son PPI dans une structure de la fonction publique ou en juridiction, le stage est régi par le Code de l’Éducation [9], via les dispositions relatives aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
De surcroît, dès lors que la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, le stagiaire reçoit une gratification minimale [10].
Ce seuil n’empêche pas la structure de gratifier un stage de durée inférieure.
Cette gratification doit être versée mensuellement [11] et correspond à un montant fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret.
Il y a un véritable débat sur la précarité des élèves-avocats. Les syndicats tentent depuis quelques années de réformer le statut de l’élève avocat, qui est l’une des seules formations (aux métiers réglementés du droit) payante et non rémunérée.
Enfin, lorsque l’élève avocat fait son stage au sein d’une entreprise, ce dernier doit bénéficier des mêmes avantages que les autres stagiaires concernant la rémunération, la restauration, les remboursements de frais, etc.
Également, il bénéficie des dispositions de la convention collective applicable et des éventuels accords d’entreprise.
Par ailleurs, le statut de stagiaire n’efface pas la protection des libertés individuelles et droits fondamentaux notamment le respect de la vie privée, la protection contre toute discrimination et contre le harcèlement moral et sexuel prévue par le Code du travail [12].
De plus, le stagiaire reste protégé par les dispositions du Code du travail et les dispositions conventionnelles concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, les heures de nuit, le repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les jours fériés [13].
De la même façon, comme les salariés, les stagiaires bénéficient des dispositions protectrices en cas de grossesse, de paternité, d’adoption, d’autorisation d’absence mais également en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle [14].
| À retenir Le statut de l’élève-avocat, et de facto, ses droits et devoirs, varie en fonction de la période de sa formation initiale. Dans le cadre du projet personnel individuel (PPI), ce dernier effectue un stage hors cabinet d’avocat français, correspondant à un ensemble pédagogique déterminé. Ainsi, son statut hybride emprunte des traits au Code de l’éducation, au Code du travail, mais aussi à des sources spécifiques, dont le décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat. Dans sa position de stagiaire en entreprise ou au sein d’un service public, l’élève avocat bénéficie des mêmes droits que les autres stagiaires, et des mêmes avantages que l’ensemble des salariés concernant, notamment, les avantages liés à la restauration, au remboursement des frais de transports publics, ou encore à l’accès aux activités sociales et culturelles du conseil économique et social dans les mêmes conditions que les salariés [15]. In fine, l’ensemble des règles et avantages de l’élève-avocat, par son statut de stagiaire, est encadré par la convention de stage tripartite entre lui, son école et sa structure d’accueil. |
[1] Avant projet de décret modifiant les dispositions du décret du 27 novembre 1991 relatives à la formation professionnelle [en ligne].
[2] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 12 N° Lexbase : L6343AGZ.
[3] Décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d’Avocat, art. 58 N° Lexbase : L8168AID.
[4] Loi n° 71-1130, du 31 décembre, 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 12-2.
[5] C. éduc., art. L. 124-1 s. N° Lexbase : L7729I3N.
[6] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 12.
[7] Décret n°91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, art. 62.
[9] C. éduc., art. D.612-56 N° Lexbase : L7592IXH à D.612-59 N° Lexbase : L7595IXL.
[10] Loi n° 2006-396, du 31 mars 2006, pour l’égalité des chances, art. 9 N° Lexbase : L9534HHL, modifié par l’article 30 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 pour l’égalité des chances N° Lexbase : L9345IET.
[11] C. éduc., art. D. 124-8 N° Lexbase : L9449I4Q.
[12] C. trav., art. L1121-1 N° Lexbase : L0670H9P, L1132-1 N° Lexbase : L0918MCY, L1152-1 N° Lexbase : L0724H9P et L1153-1 N° Lexbase : L4433L7C.
[13] C. éduc., art. L124-14 N° Lexbase : L7744I39.
[14] C. éduc., art. L124-12 N° Lexbase : L7742I37 et L124-13 N° Lexbase : L7743I38.
[15] C. éduc., art. L. 124-16 N° Lexbase : L7746I3B.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482766
[Jurisprudence] La modification de l’ordre du jour du CSE en début de séance, quésaco ?
Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-83.914, F-B N° Lexbase : A99508HY
Lecture: 8 min
N2937BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Hugues Ciray, Avocat associé, Hujé Avocats
Le 12 Octobre 2022
Mots-clefs : réunion du CSE • ordre du jour • modification en début de séance • conditions
Le comité social et économique peut valablement, à l’unanimité des membres présents en début d’une réunion, voter l’ajout d’un nouveau point à l’ordre du jour.
Les modalités de fixation de l’ordre du jour des réunions du comité social et économique (CSE) sont encadrées par un principe : celui d’une fixation concertée entre le président et le secrétaire du comité. La discussion de l’ordre du jour constitue un temps d’échange privilégié entre ces deux protagonistes afin de préparer au mieux les réunions du comité. L’objectif premier est de permettre à chacune des parties, à savoir la direction et la délégation du personnel, d’avoir une visibilité sur les sujets qui seront abordés. À cette fin, la loi a prévu un délai minimal que doit respecter le président du CSE afin de transmettre l’ordre du jour aux membres du CSE et aux personnes intéressées avant la date de la réunion : 3 jours pour les réunions ordinaires du comité social et économique (C. trav., art. L. 2315-30 N° Lexbase : L8341LGZ) et 8 jours pour les réunions ordinaires du comité central (C. trav., art. L. 2316-17 N° Lexbase : L8424LG4). Quid lorsque, le jour de la réunion, la délégation du personnel souhaite délibérer sur un point non-prévu à l’ordre du jour et qui ne présente aucun lien avec un point prévu à l’ordre du jour ? C’est à cette épineuse question que la Cour de cassation répond dans l’arrêt sous examen. Il convient de relever que si la décision a été rendue en présence de l’ancien comité central d’entreprise, les fondements juridiques utilisés sont identiques aux nouveaux textes applicables au comité social et économique central. Aussi, pour inscrire notre analyse dans le présent, il sera uniquement évoqué les textes applicables au CSE.
I. Le contexte juridique de l’affaire
L’affaire. Le 9 mars 2019, le comité central d’entreprise de la société France Télévisions a fait citer la société et sa présidente devant le tribunal correctionnel de Paris pour délit d’entrave pour avoir omis d’informer et de consulter le comité central d’entreprise préalablement à la mise en place en avril 2014 et au cours de l’année 2015 de fiches nominatives d’évaluation de performance et de potentiel. Ces fiches comportaient les remarques émises par les supérieurs hiérarchiques à la suite des entretiens annuels d’évaluation, qui n’étaient pas portées à la connaissance des salariés. En somme, il s’agissait d’un système occulte d’évaluation des salariés. En vue de cette action, le secrétaire du comité central d’entreprise, lors d’une réunion du 1er octobre 2015, est intervenu en début de séance pour solliciter l’ajout d’un nouveau point à l’ordre du jour intitulé : « vote d’un mandat au secrétaire du CCE pour ester en justice pour entrave ». L’objectif était ainsi d’engager une action en justice à l’encontre de la société. La société a soutenu devant le juge pénal l’irrecevabilité de la citation directe aux motifs que la délibération autorisant le mandat d’ester en justice n’a pas été préalablement inscrite à l’ordre du jour de la réunion du comité et ne présentait aucun lien avec les questions devant être débattues. Les juges du fond ont rejeté cette demande et ont jugé la citation recevable aux motifs que, lors de la réunion litigieuse, le point relatif à l’action en justice a été ajouté en début de séance, sans aucune contestation. La société s’est, sans surprise, pourvue en cassation. En raison du passage en CSE, le comité social et économique central est venu en cours de procédure aux droits de l’ancien comité central d’entreprise.
La problématique. En matière pénale, l'action civile en réparation du dommage directement causé au CSE par un crime, un délit ou une contravention doit être exercée par l'un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet [1]. Ce mandat doit être donné avant l’introduction de l’instance [2]. La régularité du mandat donné par le CSE constitue ainsi un point de contrôle habituel dans le cadre d’une action pénale en entrave. Dans ce cadre, l’article L. 2316-17 du Code du travail N° Lexbase : L8424LG4 dispose que l’ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire. Une fois arrêté, cet ordre du jour doit être communiqué aux membres du comité huit jours au moins avant la séance. Il est de principe qu’en cas de désaccord entre le président et le secrétaire sur les points à mettre à l’ordre du jour, il appartient au plus diligent d’entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté [3]. Hormis les consultations rendues obligatoires par la loi, qui peuvent être inscrites unilatéralement par le président ou le secrétaire en cas de désaccord conformément à l’article L. 2316-17 du Code du travail, l’un ou l’autre ne peuvent donc unilatéralement imposer au CSE un point à l’ordre du jour. Selon la jurisprudence, est irrégulière la délibération du comité d'entreprise décidant d'engager des poursuites pénales, alors que cette question ne figurait pas à l'ordre du jour et ne présentait aucun lien avec celles devant être débattues [4]. La particularité de l’affaire sous examen résulte de l’inscription du mandat d’ester en justice à l’ordre du jour de la réunion en début de séance par le seul secrétaire, sans aucune objection de la part des autres membres du comité central. Certains élus étaient absents lors de cette réunion, et n’ont donc pas été en mesure de donner leur avis au changement inopiné de l’ordre du jour le jour de la réunion, alors qu’ils ont pu faire le choix de s’absenter de la réunion en toute connaissance de cause, au motif par exemple que l’ordre du jour ne présentait pas de point stratégique nécessitant leur présence. Dans le cadre de son pourvoi, la société a ainsi reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l'ajout du point litigieux à l'ordre du jour de la réunion en tout début de séance, n'était pas de nature à établir l'irrégularité de la résolution litigieuse et du mandat confié au secrétaire d’ester en justice, faute d'avoir permis aux membres titulaires absents de la possibilité de s'exprimer sur ce sujet.
II. La solution retenue par la Cour de cassation et sa portée
La solution. Rejetant l’argumentation de l’employeur, la Cour de cassation a approuvé les décisions des juges du fond aux motifs que « si l'article L. 2327-14 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que l'ordre du jour du comité central d'entreprise est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance, ce délai était édicté dans leur intérêt afin de leur permettre d'examiner les questions à l'ordre du jour et d'y réfléchir.
Or, il résulte du procès-verbal du comité du 1er octobre 2015, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la modification de l'ordre du jour a été adoptée à l'unanimité des membres présents, de sorte qu'il en résulte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile ». Selon la Cour de cassation, la modification de l’ordre du jour le jour de la réunion, sans respecter le délai de prévenance de 8 jours, n’emporte donc aucune irrégularité si les membres du comité n’ont émis aucune objection. L’accord en vue de modifier l’ordre du jour en séance peut ainsi être tacite. La Chambre criminelle reprend à son compte une position dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation depuis 1969, suivant laquelle le délai de prévenance a été édicté par la loi dans le seul intérêt des élus, de sorte que le non-respect de ce délai n’entraîne aucune irrégularité s’ils ont, sans contestation, examiné les points à l’ordre du jour au cours de la réunion [5]. Le Conseil d’État a également jugé que « si l’ordre du jour est communiqué aux membres du comité d’entreprise 3 jours au moins avant la séance, la méconnaissance, en l’espèce, de ce délai n’a pas empêché le comité d’entreprise de donner son avis en connaissance de cause ; l’avis du comité doit être regardé comme ayant été régulièrement émis » [6]. Mais, dans ces affaires, l’ordre du jour avait été communiqué à l’avance, même si le délai de prévenance n’avait pas été respecté. Allant donc plus loin dans le raisonnement, la Cour de cassation soumet l’irrégularité pouvant résulter du non-respect du délai de prévenance à l’appréciation première des élus du comité. Il convient de rappeler que le non-respect de ce délai, s’il est dénoncé par les élus, peut justifier une condamnation de l’employeur pour entrave [7].
Portée de la solution. Si, dans le cas d’espèce, le point litigieux concernait le mandat d’ester en justice dans le cadre du comité central, la solution adoptée par la Cour de cassation concerne tout autre point à l’ordre du jour et s’étend également à tout CSE (d’entreprise, d’établissement et central). La solution n’est donc pas limitée au seul sujet du mandat d’ester en justice. Il convient néanmoins de relativiser la portée de cette décision. D’abord, la régularité de la modification de l’ordre du jour au cours de la séance est soumise à l’accord unanime des membres du comité présents. Une simple majorité, habituellement suffisante pour adopter une décision en réunion du CSE, n’est donc pas autorisée. Ensuite, par membres, il convient d’entendre, d’une part, les élus titulaires présents et, d’autre part, le président du CSE. En effet, dans la présente affaire, la présidente du comité central ne s’était pas opposée à la modification de l’ordre du jour et avait permis aux élus de voter sur le point ajouté. Le désaccord du président du CSE sera donc de nature à faire échec à l’inscription régulière du point non prévu à l’ordre du jour.
Enfin, il convient de distinguer les conditions dans lesquelles un point non prévu peut être ajouté à l’ordre du jour, des conditions dans lesquelles ce point peut ensuite faire l’objet d’une délibération engageant le CSE. Si, pour ajouter un nouveau point au cours de la réunion, l’unanimité est exigée, le CSE pourra ensuite délibérer sur ce point ajouté à la seule majorité des élus titulaires présents.
[1] Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-83.139, F-P+B+I N° Lexbase : A16733T7.
[2] Cass. crim., 22 novembre 2011, n° 11-80.232, F-D N° Lexbase : A8401H8N.
[3] Cass. soc., 23 juin 1999, n° 97-17.860 N° Lexbase : A4711AGL.
[4] Cass. crim., 5 septembre 2006, n° 05-85.895, F-P+F N° Lexbase : A0363DRU.
[5] Cass. soc., 2 juillet 1969, n° 68-40.383, publié.
[6] CE, 27 juin 1986, n° 61506 N° Lexbase : A6303AME ; CE, 7 novembre 1990, n° 105026 N° Lexbase : A8376AQB.
[7] Cass. crim., 11 juin 1974, n° 73-93.299, publié N° Lexbase : A0494CHR.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482937
[Brèves] Sapeur-pompier contestant l’obligation de vaccination devant la CEDH : un nécessaire épuisement préalable des voies de recours internes !
Réf. : CEDH, 13 septembre 2022, Req. n° 46061/21, Thevenon c/ France N° Lexbase : A86308ML
Lecture: 3 min
N2873BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 12 Octobre 2022
► La requête d’un sapeur-pompier qui contestait l’obligation de vaccination contre la Covid-19 posée à l’égard de certaines professions par la loi du 5 août 2021 est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne.
Faits. L’affaire concerne le refus d’un sapeur-pompier de respecter l’obligation de vaccination contre la Covid-19 posée à l’égard des membres de certaines professions par la loi n° 2021-1040, du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire N° Lexbase : L4664L7U. Ayant refusé se faire vacciner sans se prévaloir d’un des motifs de contre-indication prévus par la loi, le requérant fut suspendu de ses fonctions et de son engagement. Il saisit directement la Cour en invoquant des violations des articles 8 N° Lexbase : L4798AQR (droit au respect de la vie privée), 14 N° Lexbase : L4747AQU (interdiction de discrimination) et 1 du Protocole n° 1 N° Lexbase : L1625AZ9 (protection de la propriété).
Position CEDH. La Cour rappelle qu’en droit français, le recours pour excès de pouvoir est une voie de recours interne à épuiser et que, pour pleinement épuiser les voies de recours internes, il faut donc, en principe, mener la procédure interne, le cas échéant, jusqu’au juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour.
Elle rappelle ensuite que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’Homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller [en premier lieu] à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne (CEDH, 25 mars 2014, Req. n° 17153/11, Vuckovic et autres c/ Serbie N° Lexbase : A7886MHK).
Dans le contexte de l’épuisement des voies de recours internes et à l’égard du caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour a toujours reconnu que les autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe en ce qui concerne la protection des droits de l’Homme et que grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les besoins et le contexte locaux (voir, par exemple CEDH, 6 octobre 2005, Req. n° 11810/03, Maurice c/ France N° Lexbase : A6794DKT).
Écartant l’argumentation du requérant sur ce point, elle précise qu’une telle exigence vaut indépendamment, d’une part, de l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi du 5 août 2021 conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 N° Lexbase : A62354ZX), dès lors qu’il ne se prononce pas au regard des dispositions de la Convention et, d’autre part, de l’avis rendu sur le projet de loi par la commission permanente du Conseil d’État, dans le cadre des fonctions consultatives de ce dernier.
Décision. La Cour en déduit qu’un recours effectif était donc ouvert en droit interne qui aurait permis au requérant de contester devant le juge administratif, outre les décisions individuelles de suspension professionnelle, le respect par la loi n° 2021 1040, du 5 août 2021 et son décret d’application n° 2021-1056, du 7 août 2021 N° Lexbase : L4933L7T des articles de la Convention invoqués devant la Cour. Dans ces conditions, elle déclare sa requête irrecevable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482873
[Jurisprudence] Domaine public maritime : quand le titulaire d’une autorisation confond occupation et habitation
Réf. : TA Rennes, 26 septembre 2022, n° 2102583 N° Lexbase : A07278LI
Lecture: 10 min
N2877BZL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Otero, Maître de conférences en droit public, Université de Rouen
Le 12 Octobre 2022
Mots clés : domaine public maritime • contravention • grande voirie • autorisation • occupation
Le tribunal administratif de Rennes annule le refus du préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre d’une société. Si cette dernière dispose bien d’un titre pour occuper le domaine public maritime, il n’en demeure pas moins que l’autorisation dont s’agit concernait spécifiquement des activités liées à la mer. Cependant le titulaire a cru pouvoir changer la destination de l’autorisation pour utiliser le bâtiment édifié à des fins d’habitation. Ce changement porte atteinte à l’affectation du domaine public. La juridiction enjoint le préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de l’occupant.
Plus de quarante ans après avoir été à l’origine d’un arrêt de principe [1], l’Association Les amis des Chemins de Ronde montre qu’en matière de contravention de grande voirie l’on est loin d’avoir fait le tour. L’affaire dont s’agit offre l’occasion de rappeler les principes fondamentaux de la domanialité publique dont la majesté, parfois malmenée, n’a d’égale que la beauté des lieux concernés. En l’espèce, ceux-ci ont pour cadre l’île de Berder située à Larmor-Baden dans le golfe du Morbihan. Il est possible grâce à un circuit le long du sentier côtier d’en faire le tour à pied. Cependant, la continuité de ce chemin prisé a été rompue en raison des agissements de l’actuel propriétaire. Par arrêté du 28 novembre 2016, le préfet du Morbihan a autorisé la société OCDL à occuper temporairement des dépendances du domaine public maritime jusqu’au 31 décembre 2020, puis par un nouvel arrêté, a prolongé l’autorisation jusqu’au 31 décembre 2021.
L’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public porte spécifiquement et exclusivement sur trois cales, une chaussée et un terre-plein sur lequel est édifié en partie un bâtiment dit « La Pêcherie ». Estimant que l’occupant aurait outrepassé l’autorisation dont il bénéficie, plusieurs associations, dont la fédération d’association de protection de l’environnement du Golfe du Morbihan, ont demandé au préfet territorialement compétent d’établir un procès-verbal de contravention de grande voirie. Face au refus implicite du représentant de l’État d’engager des poursuites, les associations, sur le fondement de la jurisprudence quarantenaire, ont sollicité la juridiction administrative aux fins d’obtenir, par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet et, d’autre part, qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de la société. La spécificité de la présente affaire, en même temps que son intérêt, tient à l’existence d’un titre. En effet, généralement le contentieux des contraventions de grande voirie concerne par principe des occupants sans titre du domaine public maritime ou fluvial (péniches [2], paillotes [3], etc.) ou plus rarement des occupants ayant légalement obtenus un titre, lequel dans l’intervalle a été retiré [4], abrogé [5], ou a expiré [6], situation qui les place dans la même position que les premiers. Mutatis mutandis, il n’en demeure pas moins que l’existence d’un titre en l’espèce ne change rien à l’affaire dans la mesure où l’autorisation d’occupation du domaine public octroyée a été dévoyée (I) et que les travaux effectués sur le bâtiment portent atteinte à l’affectation du domaine public à l’utilité publique et sont donc constitutifs d’une infraction (II).
I. Une autorisation d’occupation du domaine public dévoyée
Pour bien cerner la présente espèce, il convient de la replacer dans un contexte à la fois local et national. S’agissant du premier, l’île a fait l’objet d’une acquisition en 2013 par la société OCDL du groupe Giboire, à l’exclusion bien entendu des immeubles appartenant au domaine public maritime. Le groupe prévoyait la construction d’un hôtel de luxe, mais à la demande de plusieurs associations, le tribunal administratif de Rennes a, le 9 juillet 2021 [7], annulé partiellement le PLU de la commune et, en référé, le 12 avril 2022, suspendu le permis de construire octroyé en 2020. S’agissant du contexte national, il appert, depuis de nombreuses années, un changement de paradigme où à la publicisation de la propriété privée succède une privatisation de la propriété publique, et la présente affaire est à inscrire dans ce cadre. Plusieurs illustrations dans la jurisprudence, qui sans être en tout point identique, participent d’une logique similaire, celle d’une forme d’appropriation par des propriétaires privés de la domanialité publique, du moins des dépendances de celle-ci, et ceci sous deux formes différentes. La première repose sur la conception que leur propriété jouxtant la domanialité publique, cette dernière peut être sinon légalement du moins impunément annexée au point par exemple de construire sur celle-ci une piscine, une terrasse et un débarcadère tout cela naturellement à usage exclusivement privatif [8]. La deuxième hypothèse consiste, sur le fondement du bénéfice d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, en ce que le titulaire vient de son propre chef la détourner pour s’approprier une dépendance publique dans un autre but que celui précisément visé par l’AOT. Il en est ainsi lorsqu’une maison d’habitation est aménagée au-dessus d’un abri à bateaux ayant seul fait l’objet d’une autorisation [9] ou d’une autorisation accordée pour une activité de restauration sur un bateau, laquelle n’est pas exercée, ledit bateau servant uniquement d’habitation principale au titulaire [10].
En l’espèce, la société n’a pas entendu choisir et a opté pour les deux variantes de façon cumulative. En effet, la propriétaire a à la fois profité de son voisinage avec des dépendances du domaine public et de l’autorisation qui lui avait été octroyé pour détourner celle-ci. En effet, à la fois le titre et le contenu de l’autorisation ont été dévoyés. Le titre trouve son origine dans l’arrêté l’octroyant et est intitulé « arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour trois cales, un terre-plein sur lequel est édifié en partie le bâtiment dit ‘la Pêcherie’ et une chaussée situés au lieu-dit ‘Ile de Berder’, sur la commune de Larmor Baden ». Le contenu du titre prévoit en son article 5 que « la partie du bâtiment dit de ‘la Pêcherie’ édifié sur le domaine public maritime devra accueillir des activités liées à la mer ». Cependant, ainsi que le juge le tribunal : « il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des propres déclarations du gérant de la société titulaire de l’autorisation, et des photographies produites mettant en évidence la réalisation de travaux de rénovation du bâtiment, que ce bâtiment est utilisé à usage d’habitation par le gérant de la société, lorsqu’il réside sur l’île ». L’aveu, longtemps considéré comme la reine des preuves, confessio est regina probatio, par les déclarations du gérant du titulaire démontrent manifestement le détournement opéré. Au surplus, le lien entre activités liées à la mer et habitation n’est pas ténu, il est même antinomique. Les juristes, plus que d’autres, le savent, les mots ont un sens. Chacun des termes de l’expression « autorisation d’occupation temporaire » du domaine public revêt une signification. Le terme autorisation nécessite donc un titre exprès dont l’objet est clairement défini, de même que l’occupation ne saurait se transformer en appropriation, ce que le caractère temporaire vient confirmer.
II. Une atteinte manifeste à l’affectation d’utilité publique du domaine public
À titre liminaire, le tribunal administratif de Rennes rappelle qu’en vertu de l’article L. 2121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4517IQD, « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation » et que parallèlement en vertu de l’article L. 2122-1 du même code N° Lexbase : L9590LDK : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Ces deux articles font respectivement référence au fait que l’utilisation privative du domaine public doit être conforme à l’affectation et que cette même utilisation privative doit être compatible avec l’affectation. En effet, l’utilisation privative du domaine public, par rapport à l’utilisation collective, se présente d’emblée comme « anormale » raison pour laquelle elle est conditionnée. Outre d’être personnelle, temporaire, précaire et révocable, l’utilisation privative doit donc présenter un caractère de conformité et de compatibilité avec l’affectation du domaine public à l’utilité publique. Concernant la conformité, elle recouvre un usage normal. C’est-à-dire que la faculté d’utilisation privative qui est octroyée doit expressément être conforme à l’affectation première de la dépendance du domaine public.
Comme le rappelle constamment la jurisprudence, « si, dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, il appartient à l’administration d’accorder des autorisations d’occupation privatives dudit domaine, ces autorisations ne peuvent légalement intervenir que si, compte tenu des nécessités de l’intérêt général, elles se concilient avec les usages conformes à la destination du domaine que le public est normalement en droit d’y exercer, ainsi qu’avec l’obligation qu’a l’administration d’assurer la conservation de son domaine public » [11]. En l’espèce, le bâtiment dont s’agit servait à la pêche comme en témoigne son nom, et n’étaient autorisées par l’AOT que des activités maritimes, à savoir conchylicoles. Le fait d’habiter ledit bâtiment le rend non conforme à l’affectation à savoir notamment son usage direct à destination du public. S’agissant de la compatibilité, l’usage privatif octroyé ne doit pas dénaturer la vocation première de l’affectation d’un bien domanial [12]. Ainsi par exemple, une autorisation d’occupation privative du domaine public ferroviaire qui prévoit la dépose des voies pour l’aménagement d’une infrastructure routière est incompatible avec l’affectation première de la dépendance dès l’instant où naturellement la création d’une voie routière sur la voie ferrée ne rend plus cette dernière utilisable [13]. En l’espèce, là encore le fait de confondre une occupation octroyée pour des activités liées à la mer et de considérer que l’AOT valait autorisation d’habitation témoigne d’une occupation privative incompatible avec l’affectation du domaine public à l’utilité publique. Dès lors ainsi que le juge la juridiction bretonne le changement de destination de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est de nature à porter atteinte à l’affectation à l’utilité publique de celui-ci. Compte tenu de ces éléments l’autorité chargée de la police domaniale, en l’espèce le préfet, aurait donc dû mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il détient aux fins d’assurer le respect de l’affectation du domaine public. C’est la raison pour laquelle, il est enjoint dans un délai de trois mois, et ce malheureusement sans astreinte, au préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de la société, laquelle est autant sortie du droit chemin que…du chemin du droit.
[1] CE, 23 février 1979, n° 04467 N° Lexbase : A2200AKP.
[2] CAA Versailles, 10 février 2021, n° 19VE01992 N° Lexbase : A430773W.
[3] CAA Marseille, 29 octobre 2021, n° 19MA05501 N° Lexbase : A39597BA.
[4] CAA Bordeaux, 9 juillet 2014, n° 14BX00648 N° Lexbase : A1355NAG.
[5] CAA Lyon, 7 octobre 2021, n° 19LY04598 N° Lexbase : A811248X.
[6] CAA Marseille, 9 juillet 2021, n° 19MA05509 N° Lexbase : A83184Z4.
[7] TA Rennes, 9 juillet 2021, n° 1803926.
[8] CAA Marseille, 12 juillet 2016, n° 15MA03646 N° Lexbase : A1416RY4.
[9] CE, 22 avril 2021, n° 438824 N° Lexbase : A10374QH.
[10] CAA Marseille, 20 décembre 2010, n° 09MA04736 N° Lexbase : A9487GQG.
[11] CAA Lyon, 28 décembre 2010, n° 08LY01204 N° Lexbase : A29218NI.
[12] CE, 23 juin 1995, n° 161311 N° Lexbase : A4802AN8.
[13] CAA Lyon, 17 août 2010, n° 09LY02254 N° Lexbase : A4259E9M.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482877
[Jurisprudence] La confidentialité de la conciliation, une exigence même entre les parties !
Réf. : Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-13.108, F-B N° Lexbase : A58878MY
Lecture: 10 min
N2883BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université Côte d'Azur, Directeur du Master 2 Administration et liquidation des entreprises en difficulté de la Faculté de droit de Nice, Membre CERDP (EA 1201)
Le 12 Octobre 2022
Mots-clés : procédures préventives • procédure de conciliation • obligation de confidentialité • étendue • obligation entre les parties (oui)
L’obligation de confidentialité posée par l’article L. 611-15 du Code de commerce pour les personnes appelées à la conciliation n’est pas uniquement posée à l’égard des tiers ; elle s’impose également entre les parties.
L’obligation de confidentialité est une question en vogue. Les lecteurs se souviennent d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles [1] commenté le mois dernier dans ces colonnes et ayant également pour centre d’intérêt cette question. Il est vrai que la confidentialité apparaît aujourd’hui comme un principe cardinal du droit de la prévention.
L’obligation de confidentialité est posée en lettres d’or à l’article L. 611-15 du Code de commerce N° Lexbase : L4119HB8, tant pour le mandat ad hoc que pour la conciliation, la Cour de cassation s’étant attachée à assurer la plus large portée à ce principe. On se souvient en effet d’un arrêt [2] ayant condamné des organes de presse pour manquement au principe de confidentialité, la Cour de cassation n’hésitant pas alors à dépasser la lettre de l’article L. 611-15 du Code de commerce, qui énonce que « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». Il suffit en effet d’en avoir connaissance, même si on n’y a pas été appelé ou que les fonctions de l’intéressé ne conduisent à cette connaissance [3]. C’est encore le leitmotiv de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 octobre 2022 d’assurer l’efficacité maximale de la confidentialité, dans le domaine de la conciliation, mais la solution peut naturellement être exportée dans celui du mandat ad hoc, l’article L. 611-15 du Code de commerce ayant une portée commune à cette mesure et à la procédure de conciliation.
Mandat ad hoc et conciliation reposent largement sur un socle contractuel. De là à dire que c’est l’affaire des parties, comme le contrat lui-même, il n’y a qu’un pas, que pourtant, farouchement, la Cour de cassation s’est refusée à franchir s’agissant de la problématique de la confidentialité.
Si le contenu de l’accord est l’affaire des parties, et des parties seulement, en revanche, la mécanique générale qui entoure la conciliation doit rester, au même titre que le contenu de l’accord, secrète. Il y va de l’efficacité du mandat ad hoc et de la conciliation.
Signalons cependant que l’obligation de confidentialité n’interdit nullement au débiteur de communiquer sur son état. Il en est spécialement ainsi à l’égard de partenaires contractuels ayant fait figurer dans leurs conditions contractuelles une obligation d’indiquer l’existence d’une procédure de conciliation. Le non-respect de cette information peut être une cause de résiliation du contrat ou, en matière bancaire, de rupture des concours, pour manquement à l’obligation contractuelle de sincérité. La rupture des concours ne peut donc être considérée comme abusive et est donc exclusive de responsabilité du banquier, du fait du comportement gravement répréhensible du partenaire contractuel [4].
À la vérité, la lettre de l’article L. 611-15 ne commandait pas d’inclure dans la liste des personnes tenues par l’obligation de confidentialité le débiteur, qui n’est pas une personne appelée à la conciliation, ni une personne ayant connaissance par ses fonctions de la conciliation ou du mandat ad hoc [5].
Au-delà de la simple lettre des textes visés dans l’arrêt, c’est sans doute à cette efficacité que la Cour de cassation a pensé en posant, dans l’espèce commentée, une solution de principe, qui explique que l’arrêt soit soumis à une publicité au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation.
En l’espèce, une banque a consenti à la Société de distribution une ouverture de crédit de 350 000 euros et un prêt de 800 000 euros, dont son dirigeant, M. N., s'est rendu caution solidaire. La Société de distribution ayant rencontré des difficultés financières, une procédure de conciliation a été ouverte et un protocole de conciliation du 28 avril 2008 a été homologué. À cette occasion, M. N. a contracté de nouveaux engagements de cautionnement solidaire au profit de la banque.
L'accord de conciliation n'a pas été exécuté jusqu'à son terme et, après l'échec d'une nouvelle procédure de conciliation, la Société de distribution a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 18 janvier 2012, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 9 janvier 2013.
Après avoir déclaré sa créance qui a été admise, la banque a assigné, le 10 janvier 2014, M. N., la caution, en paiement. Celui-ci a alors formé des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées au titre des cautionnements et à la compensation de leurs dettes respectives, en invoquant un comportement fautif de la banque à l'occasion de la nouvelle procédure de conciliation. Il s’est fondé sur des pièces, notamment un mail de la banque adressé au conciliateur, pour rechercher la responsabilité de la banque. Le pouvait-il ?
Pour répondre à cette interrogation, il faut de façon plus générale répondre à la question de savoir si une partie à la procédure de conciliation peut utiliser des documents transmis par une autre, dans le cadre de la conciliation, à l’occasion d’une procédure ultérieure. C’est ce que pensait la caution en distinguant l’utilisation de documents de la conciliation faite par une partie contre un tiers, qui est illicite, et l’utilisation de documents faite par une partie contre une autre partie à la conciliation, qui selon la caution, serait licite, ce qui l’a amenée à contester la décision de la cour d’appel.
La Cour de cassation va rejeter le pourvoi de la caution, en énonçant qu’il « résulte de l'article L. 611-15 du Code de commerce que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. Le moyen, qui postule que cette obligation ne s'applique qu'à l'égard des tiers et non entre les parties à la procédure et que M. [N], gérant de la Société […], était fondé à opposer à la banque le contenu de leurs échanges pour rechercher sa responsabilité, manque en droit ».
Ainsi, par cet arrêt, Cour de cassation pose-t-elle en règle que l’obligation de confidentialité s’impose entre les parties à la procédure de conciliation ; elle ne s’impose pas seulement à l’égard des tiers.
La lecture de l’arrêt laisserait, a priori, penser que l’adage selon lequel là où la loi ne distingue pas l’interprète n’a pas à distinguer (Ubi lex…) suffit à justifier la solution, puisqu’effectivement la lettre de l’article L. 611-15 soumettant à l’obligation de confidentialité les « personnes appelées à la conciliation » ne distingue pas selon qu’il est question de respecter le principe de confidentialité à l’égard des tiers, ou à entre les parties.
Mais au-delà de la lettre des textes, l’esprit de ces procédures préventives et le climat qui les entoure conduisent à la même solution.
En interdisant aux parties de communiquer à l’égard des tiers sur la conciliation ou le mandat ad hoc, l’obligation de confidentialité a, d’une part, pour objet d’éviter des fuites préjudiciables à l’image du débiteur, à son crédit, et, d’autre part, tend à empêcher que soient divulguées les pratiques des créanciers, et spécialement la politique de remise de dettes et de délais des créanciers institutionnels, au premier rang desquels figurent les établissements de crédit, pratiques dont pourraient ensuite s’emparer d’autres débiteurs désireux d’obtenir des avantages identiques.
En interdisant aux parties d’utiliser les unes contre les autres des pièces de la conciliation, cela permet d’éviter que la prévention ne soit l’antichambre de procédures contentieuses, si la prévention échoue et que s’ouvre ensuite une procédure collective. Il ne faut pas que la confiance, témoignée par les acteurs les uns envers les autres, condition nécessaire à la recherche d’un accord global, et qui conduit nécessairement à la communication de documents et à des échanges laissant des traces, se retourne ensuite contre ces acteurs ayant joué le jeu de la transparence.
Le plus souvent, comme en l’espèce, celui qui aura généralement intérêt à l’utilisation de ces pièces sera le dirigeant social caution, qui aura tôt fait de désigner le coupable de son échec. C’était le cas en l’espèce.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’aborder la question de l’obligation de confidentialité que cherchait à écarter une caution. Elle a jugé que, du fait de cette obligation de confidentialité, un mandataire ad hoc ne peut délivrer une attestation à la société débitrice ainsi qu’à sa caution, afin de rapporter la preuve que la banque qui avait refusé de donner son accord s’était opposée à tort au moratoire proposé par le mandataire ad hoc pour apurer son passif. C’est à bon droit, énonce la Cour de cassation, qu’une cour d’appel écarte des débats « l’attestation remise à la caution de la société débitrice par le mandataire ad hoc de celle-ci, dans laquelle, au mépris de l’obligation de confidentialité qui le liait en application de l’article L. 611-15 du Code de commerce, il stigmatisait l’attitude de la banque lors des négociations » [6]. Il importe d’observer que le mandataire ad hoc, comme le conciliateur, sont des personnes ayant, par leurs fonctions, connaissance du mandat ad hoc ou de la conciliation [7].
On terminera en indiquant que la caution ne peut obtenir de la juridiction la levée de l’obligation e confidentialité, cette levée étant réservée au ministère public et à la juridiction, elle-même, et seulement dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective subséquente. Il n’existe en effet, qu’une seule disposition, dans la partie législative du livre VI du Code de commerce, qui s’intéresse à la question de levée de la confidentialité : l’article L. 621-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9117L7S. Selon l’alinéa 5 de cette disposition, « L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ». L’alinéa 6 ajoute que, « Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 ». Pour sa part, l’article R. 611-44 du Code de commerce N° Lexbase : L0661L8Y prévoit la communication de l’accord à l’autorité judiciaire « en application de l’article L. 621-1 », c’est-à-dire lorsque le tribunal statue sur l’ouverture d’une sauvegarde, mais aussi, puisque l’article L. 621-1 est applicable en redressement et en liquidation judiciaires, lorsqu’il s’agit de statuer sur l’ouverture de l’une de ces deux procédures [8]. La levée de la confidentialité du contenu de l’accord n’intervient que dans ce cas précis [9] et c’est pourquoi elle ne peut être décidée une fois la procédure ouverte [10].
On le voit, ce qui entoure la conciliation doit rester un secret bien gardé. C’est une condition d’efficacité de cette procédure préventive, qui doit inspirer confiance à tous, et ne jamais être la source du moindre début de répulsion, sauf à rendre cette procédure, qui repose sur le bon vouloir de chacun, totalement illusoire.
[1] CA Versailles, 13ème ch., 24 mai 2022, n° 21/07444 N° Lexbase : A07467YB, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, septembre 2022, n° 728 N° Lexbase : N2614BZT.
[2] Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-11.500, FS-P+B+I N° Lexbase : A3643NZX, D., 2016, actu 5, note A. Lienhard ; JCP E, 2016, 1085, note Th. Stefania ; Rev. proc. coll., 2016, comm. 1, note Ch. Delattre ; Rev. sociétés, 2016, 193, note Ph. Roussel Galle ; Bull. Joly Entrep. en diff., 2016, 92, note S. Doray ; RTD com., 2016, 191, n° 2, note F. Macorig-Venier ; LPA, 7 juin 2016, n° 113, p. 11, note B. Freleteau ; Ch. Lebel, Lexbase Affaires, janvier 2016, n° 451 N° Lexbase : N1012BWE.
[3] C. Saint-Alary-Houin et M.-H. Monsèrié-Bon, Prévention et traitement amiable des difficultés des entreprises, LGDJ, 2018, n° 382.
[4] Cass. com., 7 février 2012, n° 10-28.815, F-D N° Lexbase : A3503ICQ, Rev. proc. coll., 2012, comm. 177, note Ch. Delattre.
[5] V. a priori en ce sens, C. Saint-Alary-Houin et M.-H. Monsèrié-Bon, Prévention et traitement amiable des difficultés des entreprises, préc., spéc. n° 481.
[6] Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-17.377, F-P+B N° Lexbase : A8343NPP, P.-M. Le Corre, in Chron, Lexbase Affaires, octobre 2015, n° 440 N° Lexbase : N9418BUD.
[7] C. Saint-Alary-Houin et M.-H. Monsèrié-Bon, Prévention et traitement amiable des difficultés des entreprises, préc., spéc. n° 483.
[8] Illustr. : T. com. Quimper, 1er juin 2012, n° 2012/004764, Rev. proc. coll., 2012, comm. 178, note Ch. Delattre.
[9] M. Koehl., La négociation en droit des entreprises en difficulté, thèse Paris Nanterre, 2019, n° 26.
[10] CA Versailles, 13ème ch., 24 mai 2022, n° 21/07444, préc. et les obs. préc.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482883
[Jurisprudence] GPA : lorsque la mère porteuse est titulaire de l’autorité parentale…
Réf. : Cass. civ. 1, 21 septembre 2022, deux arrêts, n° 21-50.042, FS-B+R N° Lexbase : A25338KZ, et n° 20-18.687, F-B N° Lexbase : A25398KA
Lecture: 15 min
N2930BZK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université de Bordeaux, Présidente de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance de la Gironde
Le 13 Octobre 2022
Mots-clés : gestation pour autrui (GPA) • filiation • autorité parentale • délégation de l’autorité parentale • retrait de l’autorité parentale • adoption • parent d’intention • parent biologique • déclaration judiciaire de délaissement
Deux arrêts de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 (n° 21-50.042 et n° 20-18.687) apportent, quoique de manière inégale, quelques réponses aux questions soulevées par la situation dans laquelle la mère porteuse est titulaire de l’autorité parentale. La lecture de ces deux décisions permet en effet d’écarter certaines solutions et de préciser les conditions de l’adoption de l’enfant du conjoint dans une telle hypothèse.
Le premier arrêt (n° 21-50.042) comporte surtout un intérêt par la lecture a contrario qui peut en être faite puisque, contrairement à ce que prétendait le ministère public, il ne s’agissait pas, en l’espèce, d’une GPA. Le second arrêt (n° 20-18.687) répond plus frontalement et de manière négative, à la question de savoir s’il est possible de retirer l’autorité parentale de la mère porteuse pour permettre l’adoption de l’enfant par le conjoint de son parent biologique.
En prohibant la transcription intégrale de l’acte de naissance des enfants nés de GPA à l’étranger, la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a contraint le parent d’intention, conjoint du parent biologique, à recourir à l’adoption pour établir la filiation de l’enfant à son égard. Cette réforme n’est pas sans susciter des difficultés lorsque l’adoption est impossible, notamment en cas de séparation du couple de parents d’intention [1].
La question de l’adoption par le parent d’intention s’avère également problématique lorsque la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de la mère porteuse, et ce même si celle-ci a renoncé à ses droits parentaux. Dans ce cas en effet, l’adoption est, de toute façon, la seule voie possible puisque le parent d’intention n’est pas, par hypothèse, inscrit sur l’acte de naissance.
Deux arrêts de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 (n° 21-50.042 et n° 20-18.687) apportent, quoique de manière inégale, quelques réponses aux questions soulevées par la situation dans laquelle la mère porteuse est titulaire de l’autorité parentale. La lecture de ces deux décisions permet en effet d’écarter certaines solutions et de préciser les conditions de l’adoption de l’enfant du conjoint dans une telle hypothèse.
Le premier arrêt (n° 21-50.042) comporte surtout un intérêt par la lecture a contrario qui peut en être faite puisque, contrairement à ce que prétendait le ministère public, il ne s’agissait pas, en l’espèce, d’une GPA. Le second arrêt (n° 20-18.687) répond plus frontalement et de manière négative, à la question de savoir s’il est possible de retirer l’autorité parentale de la mère porteuse (I) pour permettre l’adoption de l’enfant par le conjoint de son parent biologique (II).
I. L’impossibilité d’écarter l’autorité parentale de la mère porteuse
Autorité parentale de la mère porteuse. Le fait que la mère porteuse soit titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant rend, évidemment, plus difficile la reconnaissance de droits à l’égard de l’enfant au bénéfice du parent d’intention qui n’est pas son parent biologique. Il est ainsi logique que les parents d’intention aient songé à recourir aux différents moyens permettant de priver la mère porteuse de ses droits parentaux. Mais les arrêts rendus par la Cour de cassation le 21 septembre 2022 permettent d’exclure la délégation de l’exercice de l’autorité parentale (A) comme le retrait de l’autorité parentale (B).
A. La prohibition du recours à la délégation de l’exercice de l’autorité parentale en cas de GPA
Délégation de l’autorité parentale pendant la grossesse. Le premier des deux arrêts du 21 septembre 2022 (pourvoi n° 21-50.042) répond a contrario à la question de savoir si l’on peut envisager que l’exercice de l’autorité parentale de la mère porteuse, à l’égard de qui la filiation de l’enfant a été établie, soit délégué aux parents d’intention. En l’espèce, les parents d’un enfant, né à Tahiti, avaient saisi quelques mois après sa naissance, un juge aux affaires familiales d'une demande de délégation de l'exercice de l'autorité parentale sur leur enfant, au profit d’un couple avec qui ils étaient entrés en relation pendant la grossesse, à la suite de recherches pour trouver une famille adoptante en métropole. Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a intenté un pourvoi contre l'arrêt qui avait accueilli la demande de délégation d'autorité parentale, en affirmant « qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a enfreint la prohibition d'ordre public de la gestation pour autrui spécifiée aux articles 16-7 N° Lexbase : L1695ABE et 16-9 N° Lexbase : L1697ABH du code civil. » La Cour de cassation considère cependant que « le projet d'une mesure de délégation d'autorité parentale, par les parents d'un enfant à naître, au bénéfice de tiers souhaitant le prendre en charge à sa naissance, n'entre pas dans le champ des conventions prohibées par l'article 16-7 du code civil. » Elle constate que l'enfant n'a pas été conçu en vue de satisfaire la demande des candidats à la délégation et que la mesure de délégation d'autorité parentale n'avait été envisagée qu'au cours de la grossesse par les parents biologiques de l'enfant. La cour d’appel a pu exactement déduire de ces circonstances que la mesure sollicitée ne consacrait pas, entre les délégants et les délégataires, une relation fondée sur une convention de gestation pour autrui. La Cour de cassation admet ainsi la validité de la délégation demandée au bénéfice de plusieurs personnes qui ne font pas partie de l’entourage des parents de naissance, alors que ce point était également contesté par le ministère public [2].
Délégation de l’autorité parentale pendant la grossesse. L’interprétation a contrario de l’arrêt permet d’affirmer que si l’enfant avait été conçu dans le cadre d’une GPA – qui plus est sur le territoire français –, la Cour de cassation aurait exclu la délégation de l’exercice de l’autorité parentale au bénéfice des parents d’intention, laquelle aurait été qualifiée de convention découlant d’une gestation pour autrui et considérée comme nulle par application de l’article 16-7 du Code civil N° Lexbase : L1695ABE. Si les parents biologiques et les parents d’intention avaient convenu d’une délégation avant la conception de l’enfant, celle-ci étant organisée pour satisfaire les délégataires de l’exercice de de l’autorité parentale, la délégation serait tombée sous le coup de l’article 16-7 du Code civil N° Lexbase : L1695ABE et n’aurait pu être admise. En effet, selon la Cour de cassation cet article tient pour nulles les conventions ayant pour objet « de disposer librement de sa qualité de père ou de mère » dont la délégation de l’exercice de l’autorité parentale fait partie. La voie de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale est donc clairement fermée en cas de gestation pour autrui, au moins lorsque celle-ci a lieu sur le sol français. On peut se demander si la même solution serait applicable en cas de gestation pour autrui dans un pays où elle est légale.
B. L’impossibilité de prononcer le retrait de l’autorité parentale de la mère porteuse
Retrait de l’autorité parentale pour permettre l’adoption. Le second arrêt (n° A 20-18.687), concerne un couple d’hommes souhaitant obtenir le retrait de l’autorité parentale de la mère porteuse, à l’égard de qui la filiation de l’enfant avait été établie, dans le but bien compris de permettre son adoption plénière par le conjoint du père biologique.
Conditions du retrait. Comme elle l’avait déjà affirmé dans un arrêt du 23 avril 2003 [3], la Cour de cassation refuse d’admettre qu’un tel retrait est possible dans une telle hypothèse. En 2003, elle avait considéré qu’« a légalement justifié son refus de retirer l'autorité parentale à la mère, la Cour d'appel qui constate que même si celle-ci s'est désintéressée de son enfant, il n'est pas démontré que la sécurité, la santé ou la moralité de celui-ci était en danger dès lors qu'il était confié au couple ayant procédé à la procréation médicalement assistée. » En 2022, la Cour de cassation constate également que « la cour d'appel a rappelé que le retrait de l'autorité parentale, qui est une mesure de protection de l'enfant, suppose la démonstration par le requérant d'un danger manifeste pour la santé, la sécurité ou la moralité de ce dernier. » Or, les juges du fond ont relevé que les enfants étaient « équilibrés, heureux et parfaitement pris en charge » et que l’absence de leur mère n’était pas source de danger pour eux. La Cour de cassation applique strictement les conditions légales du retrait de l’autorité parentale : l’existence d’un comportement visé par l’article 378-1 du Code civil N° Lexbase : L5369LTZ, en l’occurrence le délaissement, mais également le danger qui découle de ce comportement. En l’espèce, selon les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, cette dernière condition n’était pas satisfaite. Sans doute pourrait-on discuter cette analyse. Certains juges du fond ont en effet déduit le danger du désintérêt lui-même [4]. Mais selon l’arrêt du 21 septembre 2022, la seule absence de la mère porteuse dans la vie de l’enfant est insuffisante à caractériser le danger auquel est subordonné le retrait.
Impossibilité d’établir un lien de filiation adoptive. Le demandeur a tenté de démontrer que le danger résidait dans l’impossibilité d’établir un lien de filiation adoptive entre les enfants et leur parent d’intention résultant de l’absence de retrait de l’autorité parentale. Les juges du fond ont écarté cet argument en affirmant qu’il n’était pas établi en quoi « la protection de l’intérêt supérieur de ces deux enfants commandait le retrait d'autorité parentale de Mme [K], le dispositif conventionnel et législatif n'ayant pas vocation à faciliter ces démarches administratives », manifestant ainsi le refus de voir utiliser le retrait de l’autorité parentale pour faciliter l’établissement du lien des enfants nés de GPA avec leur parent d’intention.
Contrôle de conventionnalité. La Cour de cassation approuve cette solution et refuse de procéder à un contrôle de conventionnalité du refus de retirer l’autorité parentale sur le fondement du droit au respect de la vie familiale. Elle considère que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme N° Lexbase : L4798AQR n'impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis [5]. Cette analyse s’inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme selon laquelle le droit au respect de la vie familiale est applicable aux liens familiaux existant et non à la seule volonté de les établir [6]. Ainsi comme l’affirme justement Caroline Siffrein-Blanc [7], dans le cadre du retrait de l’autorité parentale, « le danger doit s’apprécier exclusivement à l’égard de la relation entre le parent abandonnique et l’enfant et ce indépendamment des relations affectives nouées par ailleurs. »
Déclaration judiciaire de délaissement. Une telle situation relève davantage de la déclaration judiciaire de délaissement de l’article 388-1-1 du Code civil N° Lexbase : L1461KM3 qui peut être prononcée à l’égard d’un seul parent. Reste cependant à se demander si une telle déclaration permettrait l’adoption plénière de l’enfant par le conjoint de son parent alors que l’article 345-1 du Code civil N° Lexbase : L4404MBQ vise expressément « le parent qui s’est vu retirer l’autorité parentale ». Une réponse affirmative semble s’imposer mais mériterait une confirmation.
II. La voie restreinte de l’adoption
Possibilité de l’adoption. Le second argument de la Cour de cassation pour considérer que la cour d’appel n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, réside dans le fait que la voie de l'adoption des enfants par le conjoint du père demeure ouverte (A), sous réserve de certaines conditions tenant au consentement de la mère biologique (B).
A. La possibilité de recourir à l’adoption simple de l’enfant du conjoint
Cas limités d’adoption plénière de l’enfant du conjoint. Si la Cour de cassation affirme que l’adoption de l’enfant du conjoint demeure ouverte, malgré l’absence de retrait de l’autorité parentale, elle ne précise pas qu’il ne pourra s’agir que d’une adoption simple. En effet, l’article 345-1 du Code civil N° Lexbase : L4404MBQ énumère les cas dans lesquels l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, - étendue depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 réformant l’adoption N° Lexbase : L4154MBH, au partenaire lié par un PACS et au concubin [8] - est permise. Outre les hypothèses dans lesquelles l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard du conjoint ou assimilé, y compris si elle est adoptive, le texte admet l’adoption plénière lorsque l’enfant a une filiation établie à l’égard de son autre parent si celui-ci s’est vu retirer l’autorité parentale [9].
Exclusion de l’adoption plénière. En refusant de retirer l’autorité parentale à la mère porteuse, la Cour de cassation exclut l’adoption plénière de l’enfant par le conjoint de son père et permet seulement le recours à l’adoption simple. Cette adoption qui, certes, maintient le lien de filiation de l’enfant à l’égard de la mère porteuse, établit un lien de filiation entre l’enfant et l’adoptant et permet à ce dernier d’exercer l’autorité parentale conjointement avec son conjoint. L’adoption simple est également subordonnée au consentement de la mère dès lors que la filiation de l’enfant à son égard est établie.
B. L’exigence relative du consentement de la mère
Renonciation aux droit parentaux. La Cour de cassation précise que l’adoption de l’enfant par le conjoint de son père biologique demeure ouverte sous réserve que « le juge vérifie la validité et la portée de déclaration du 30 juillet 2010 par laquelle la mère a renoncé à ses droits parentaux et qu'il s'assure de sa conformité avec l'intérêt de l'enfant. » On peut s’étonner que la Haute cour n’exige pas expressément le consentement de la mère, imposé en cas d’adoption simple par l’article 348 du Code civil N° Lexbase : L4407MBT, auquel renvoie l’article 361 du même code N° Lexbase : L4417MB9. Les renonciations aux droits parentaux, qui n’existent pas en droit français puisque l’article 376 du Code civil N° Lexbase : L2922ABT qualifie d’indisponibles les droits découlant de l’autorité parentale, sont admises dans certaines législations étrangères dont celles de l’Inde et peuvent produire leurs effets en France.
Consentement à l’adoption par un tiers. En exigeant du juge qu’il vérifie la portée de la renonciation de la mère porteuse à ses droits parentaux, la Cour de cassation semble quand même exiger qu’il vérifie que la mère a bien consenti à l’adoption de son enfant. Dans la mesure où il s’agit seulement d’une adoption simple, elle n’a pas à consentir à la rupture définitive du lien entre elle et lui, mais seulement à l’ajout d’un nouveau lien de filiation entre l’enfant et un tiers, dont découlera des conséquences en matière d’autorité parentale. Or, il n’est pas du tout évident que la mère ait donné un tel consentement lorsqu’elle a renoncé à ses droits parentaux, cette renonciation ayant probablement eu lieu au seul profit du père de l’enfant. Les circonstances de la naissance de l’enfant et de son abandon par sa mère sont de nature à rendre difficile le recueil ultérieur de son consentement.
Consentement sans contrepartie. On peut, en outre, se demander si la mère porteuse peut réellement donner un consentement à l’adoption conforme aux exigences du droit français et plus particulièrement à l’article 348-3 du Code civil N° Lexbase : L4411MBY tel qu’issu de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 N° Lexbase : L4154MBH qui a repris, pour toutes les adoptions, les conditions du consentement auparavant exigées seulement pour l’adoption internationale. Selon ce texte en effet, « le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. ». Est-il vraiment concevable que le consentement de la mère porteuse soit donné sans contrepartie alors qu’il intervient dans le cadre - ou en parallèle - d’une gestation pour autrui rémunérée ?
[1] CEDH, 18 mai 2021, n° 71552/17, Valdís Fjölnisdóttir et autres c/ Islande
[2] L’arrêt posait également un problème d’application immédiate de la jurisprudence nouvelle qui n’admettait pas ce type de délégation. Mais selon la Cour de cassation : « Dès lors, l'application immédiate de la jurisprudence nouvelle porterait également une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 30. Ces circonstances exceptionnelles justifient par conséquent de déroger à l'application immédiate de la jurisprudence nouvelle aux situations des enfants pour lesquels une instance est en cours. »
[3] Cass. civ. 1, 23 avril 2003 n° 02-05.033, F-D N° Lexbase : A6798BMQ, Dr. fam. 2003 comm. n°143 obs. P. Murat ; RJPF 2003 n° 7/8 p. 23, obs. A.-M Blanc ; JCP 2004, II 10 058, comm. A. Bourrat-Gueguen.
[4] CA Nîmes, 18 décembre 2008, n° 08/00108 ; CA Nîmes, 12 février 2009, n° 08/00173 ; CA, Lyon Chambre spéciale des mineurs, 27 octobre 2015, 2015-024896.
[5] La Cour de cassation considère en outre que la cour d’appel « n'a pas davantage violé l'interdiction de toute discrimination posée par l'article 14 de la Convention, les dispositions de l'article 378 du code civil N° Lexbase : L8562LXE s'appliquant indifféremment à tous les enfants, sans distinction aucune fondée sur la naissance. »
[6] F. Sudre, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, PUF 2022, p.629
[7] Droit de la famille 2022, comm. n°165.
[8] A. Gouttenoire, La réforme de l’adoption : entre ouverture et sécurisation, Lexbase Droit privé, n° 901, 7 avril 2022 N° Lexbase : N1014BZL.
[9] Le texte admet également l’adoption plénière lorsque le parent est décédé et que les ascendants n’ont plus de lien avec l’enfant.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482930
[Focus] Éclairages concernant la notion de NFTs : réflexions et prospection sur le régime applicable en matière de fiscalité
Lecture: 34 min
N2936BZR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Ghizlane Loukili, Juriste d’affaires et doctorante en droit du numerique University Hassan the first Morocco
Le 14 Octobre 2022
Mots-clés : fiscalité • NFT • non-fungible tokens • blockchain • marché de l’art
Cet article a vocation à traiter des règles applicables en matière de fiscalité des NFTs.
1. Définition et particularités des NFTs : Notion [1] qui continue d’être au cœur de nombreuses interrogations, les NFTs [2] s’apparentent techniquement au jeton classique en raison des caractéristiques communes avec celles de ce dernier : ils sont originellement numériques, peuvent s’échanger sur une blockchain et sont conservés dans un portefeuille ou wallet d’actifs numériques. Cependant, ils s’en écartent sur la particularité que chaque unité d’informations qui compose un ensemble ou le NFT ne peut être divisée, et peut être distinguée des autres en raison de caractéristiques qui lui sont propres.
En somme, les NFTs sont des jetons uniques, dotés de caractéristiques propres, qui représentent un bien matériel ou immatériel via un processus de codification. Les NFTs sont donc, dans cette logique, un certificat numérique d’authentification du bien. Ni plus ni moins. Cette définition est restrictive, une définition extensive regroupant le NFT et le sous-jacent est aussi défendue par les spécialistes.
L’avènement des NFTs signe le glas d’un nouveau cap vers un internet des valeurs [3] en rupture avec la logique initiale ou les images étaient accessibles et copiables à souhait [4].
Cette technologie disruptive est aux racines d’une protection qui se déploie en légitimant un droit de propriété numérique, ce dernier, se voit doté de deux principaux avantages : garantir l’authenticité et la traçabilité historique.
2. Le fonctionnement des NFTs : Si les NFTs marquent le passage de la dématérialisation à la tokénisation, alors son fonctionnement mérite quelques développements, ainsi, une première étape est celle de l’existence d’un conglomérat de données qui affectent des caractéristiques propres aux NFTs, comme un nom, une image et un descriptif par exemple. Ces données qui assurent la lisibilité du jeton sont stockées à l’extérieur du blockchain dans un espace distribué ou centralisé. Cette étape est celle de la dématérialisation.
Les deux secondes étapes sont celles de la tokénisation, tout d’abord, l’opération de l’inscription du NFT au blockchain ou mintage, où l’intervention d’un smart contract [5] est primordiale ce dernier étant un programme qui s’auto-exécute et qui est à l’origine du déploiement du NFT sur la blockchain.
Le troisième élément est le jeton. Il s’agit d’une empreinte alphanumérique et cryptographique, un hash, qui est obtenu grâce à une fonction de hachage, ce hachage étant à sens unique. Voici résumé l’architecture et les composants des NFTs.
3. La problématique juridique et fiscale des NFTs : S’il existe aujourd’hui un débat sur un nombre exponentiel d’éléments juridiques relatifs aux NFTs, c’est que ces écueils persistent, comme l’illustrent les questions entourant la qualification juridique : s’agit-il d’un simple certificat d’authenticité ? Est-il en mesure de garantir cette fonction juridiquement parlant ? Peuvent-ils être qualifiés de bien ? répondent-ils à la définition d’actif numérique ?
Par ailleurs, et non sans liens le régime fiscal des opérations portant sur des NFTs soulève de nombreuses interrogations, ces dernières, donneront lieu, tôt ou tard, à de nouvelles dispositions législatives. Une intégration efficiente des fonctions exercées par les actifs numériques permettrait d’établir des règles fiscales préservant les recettes de l’administration fiscale, sans entraver le développement des activités qui y sont liées. Voilà, ce qui résume les enjeux en présence.
3.1 Les racines des difficultés à l’élaboration d’un régime juridique et fiscal : La difficulté concernant la notion est la grande diversité des usages quelle peut recouvrir [6]. Les NFTs se déclinent en applications et utilisations qui se présentent sous des formes multiples : certificat d’authenticité d’œuvres d’art physiques ou numériques émis ou cédés par leurs créateurs; les NFTs peuvent porter sur des personnages numériques d’un jeu vidéo en ligne; les NFTs peuvent être émis pour accorder aux supporters d’un club la possibilité de s’exprimer (à l’image de la plateforme Socios). Autant de facettes d’un même concept rendent la systématisation difficile.
Dans le même sens, l’explosion des NFTs en 2021, a permis le renouveau du concept de métavers [7] en introduisant la possibilité de monétiser des fichiers numériques (tels que des parcelles d’un monde virtuel), ou encore, les défilés de mode organisés par les grandes maisons de mode Givenchy ou Paco Rabanne à l’issue desquels des NFTs de collection sont proposés sous forme d’objets de la collection ou quelques minutes d’enregistrements du défilé [8], sont autant d’exemples et de déclinaisons des NFTs. Ainsi, il est légitime de soutenir que les formes de NFTs sont pléthores un focus et une expertise sont nécessaires pour une intervention législative de qualité pour que ne soit négligée aucune dimension de la notion.
En effet, certains NFTs voient leur mode de fonctionnement être étroitement dépendant de l’actif sous-jacent, d’autres sont indépendants, comme le NFT d’une œuvre éphémère. Alors, comment appliquer le régime fiscal de l’actif sous-jacent lorsque celui-ci n’existe pas ou n’existe plus ?
Le régime juridique des NFTs cristallise le désarroi du juriste, une allégorie de manquements se relaye, un vide légal, un vide conceptuel, une propriété qui n’est pas celle du sous-jacent, une exclusivité sans fondement juridique, un contrat à l’objet indéterminé qui induit la transmission du vide. La question est comme les tonneaux d’Adélaïde sans fin tant les problématiques sont diverses.
3.2 L’opportunité d’une prise en charge : Dans la mesure où les mondes virtuels ont pour conséquences la multiplication des interactions sociales et économiques, la question de la fiscalité devient centrale. Pour les NFTs, la détention, la transmission à titre gratuit ou encore la cession à titre gratuit sont autant de faits générateurs de l’impôt qui mobilisent les branches de droit fiscal [9].
L’avènement des NFTs montre à quel point le juriste ne peut ignorer la technique mais qu’il ne peut en devenir son vil serviteur non plus.
Puisque ces actifs peuvent rentrer dans la composition du patrimoine, la détermination de la valeur a une importance majeure dans les relations avec l’administration fiscale. Tout d’abord, en application de la logique juridique la question de la fiscalité ne peut être posée sans préalable sur le régime juridique relatif à ce dernier.
3.3 Historique législatif : Tour à tour et depuis 2014, l’administration fiscale, le Conseil d’État [10] et l’OCDE [11] œuvrent sur la question en tentant d’apporter des réponses aux problématiques relatives à la fiscalité des NFTs.
Et cela, en fixant des dispositions dans le Code monétaire et financier, c’est dans cette logique que s’inscrit l’adoption de la loi PACTE et l’intégration dans le Code général des impôts de dispositions dédiées, cette loi nous offre quelques éléments correspondant à des nuances d’une même teinte fiscale en éludant les questionnements de fond.
Lors de l’adoption de la loi de finances 2022, les débats jadis étouffés ressurgissent via de nombreuses critiques qui ont été formulées quant aux difficultés que représentent la prise en charge fiscale des NFTs [12] et plus particulièrement l’application à ces derniers du régime du sous-jacent [13].
Si la France a été l’un des premiers pays à légiférer et donner une définition aux actifs numériques, le cadre juridique et fiscal en vigueur sont encore largement incomplets et ne permettent pas d’offrir la sécurité juridique que pourrait espérer tout contribuable. La législation actuelle est dite partielle et lacunaire, cette étude se propose d’en faire une analyse.
I. Le régime fiscal des NFTs.
A. L’écosystème fiscal des NFTs
4. La qualification des NFTs : Dire que les jetons numériques n'ont pas de qualification est une affirmation à atténuer car il existe une classification des tokens en vertu de leurs caractéristiques, laquelle, induit l'application dans chaque cas de règles différentes.
En effet, si les NFTs sont :
- Des utility tokens alors leur acquisition donne un droit d'accès à un produit ou service d'une entreprise leur valeur pourrait éventuellement augmenter avec l'évolution de l'entreprise, l'inverse et tout aussi probable.
- Des security tokens alors il s'agit de titre d'actifs numériques générés par une entreprise.
- Restent des jetons divers dit à collectionner...
5. Les enjeux de cette qualification : En fonction de la qualification du jeton, des obligations réglementaires sont applicables à l'émetteur et au détenteur, en effet, si l'utility tokens donne accès à un bien ou service futur, les obligations afférentes peuvent être réalisées. Les security tokens doivent être soumises aux règles applicables à l'émission des actifs numériques.
Si les NFTs sont dits divers alors la place à l’application du droit de la consommation est évidente, en effet, si l'acheteur est un particulier l'article L.111-1 relatif à l'information précontractuelle est la disposition de référence que l'émetteur est sommé de respecter.
Les NFTs ne sont nuls autre que des titres de possession de biens incorporels sur blockchain,
ils peuvent faire l'objet de nombreuses transactions souvent à la valeur monétaire « FIAT » très élevée.
La qualification juridique de ce phénomène est une épreuve supplémentaire de la révolution numérique à l'égard du juriste. Véritable défi, la question fiscale fait partie d’un ensemble plus large, à ses côtés, la question des responsabilités contractuelles lors de l'échange de ces derniers est porteuse de questionnement.
Si le juriste est féru de catégories, son œuvre est dédiée à : « capturer le fait pour l'inscrire dans l'ordre juridique est, de tout temps, une préoccupation de l'être humain. D'où les registres, les registres, les procès-verbaux, inventaires, livres de comptes, contrats, formulaires, etc., et d'autres titres qui peuplent la vie des individus, entreprises et administrations pour acter d'une réalité, la conserver, l'opposer aux tiers, la faire reconnaître par le juge. Le droit ne peut se construire sur du sable ou du vent, il lui faut du tangible du durable [14] ». Autant dire que la question des NFTs est propice à réveiller ses démons.
Cependant, les NFTs n'échappent pas à cette réalité décrite, il doit entrer dans les cases rigides nécessaires au fonctionnement du droit et nous conduire vers l'étude des rapports entre le titre et le droit à l’épreuve de la créativité numérique.
La question centrale demeure : que possède ton à l'achat d'un NFT ?, pour faire simple et direct : quels sont les droits sur l'œuvre que l'acheteur du NFT acquiert ?
Les NFTs ont pour unique caractère de disposer d'un numéro unique d'identification par les smart contrats qui les génèrent. C'est là l'essence de la non-fongibilité à l'inverse des crypto- monnaies comme le bitcoin.
Ainsi, le titre que possède la personne qui achète le NFT fait le lien entre cette dernière et l'association entre le smart contrat et les données relatives à son exécution. La confiance en ce lien se justifie par le recours au blockchain qui est la garantie d'inviolabilité, en l'espèce, l'intégrité des données portées par le NFT est ainsi assurée.
B. Le régime fiscal des NFTs
6. Chronologie et contenu législatif : Il convient de porter à l’attention du lecteur que c’est dès 2014 que des éléments sont apportés au régime fiscal du bitcoin [15], puis en avril 2018, le Conseil d’État apporte des précisions sur la qualification et le régime fiscal de ce dernier [16]. Une fois ces éléments épars mis en relief, une attention directe est apportée à cette question à partir de 2019.
Le régime fiscal des NFTs est partiellement traité en droit hexagonal par l'intervention sur la cryptomonnaie organisée par la loi PACTE n° 2019-486 (loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK) [17] qui ambitionne de créer une nouvelle catégorie de biens, les actifs numériques [18] et amorce par cet outil juridique la tokenisation de l’économie. En effet, « la tokénisation consiste à transformer tout actif en valeur grâce à la création d’un nouvel outil juridique désigné sous le nom de token (jeton) qui pourra être inscrit et transmis via un DEEP. La tokénisation désigne l’inscription d’un actif et de ses droits sur un token afin d’en permettre la gestion et l’échange en pair-à-pair sur une blockchain, de façon instantanée et sécurisée. La numérisation des actifs permise par la tokénisation constitue le pendant de la numérisation de l’information permise par Internet [19] ». Ce glissement est central dans la compréhension des univers dans lequel évoluent les NFTs.
La loi PACTE à son article 86 annonce que le titre IV du livre V du Code monétaire et financier est complété par un chapitre X qui pose une définition des actifs numériques, en faisant référence à l'article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7609LQU et l'article L. 552-2 du même Code N° Lexbase : L7517LQH qui définit la notion de jeton numérique, cette dernière, correspondant partiellement à la définition du NFT : « Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien corporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».
Quant aux tokens monétaires ou les currencies tokens [20] qui sont des jetons natifs vont être la première catégorie d’actifs numériques va être définie à l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier : « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ». Les NFTs sont-ils des actifs numériques la question demeure entière [21] : rien ne s’y oppose et rien ne le consacre.
En parallèle à la loi PACTE, c’est la loi de finance 2019 [22] qui apporte les clarifications à la fiscalité des actifs numériques qui va introduire l’article 150 VH bis dans le Code général des impôts N° Lexbase : L9043LQY.
Rappelons que le député LREM Pierre Person a introduit un amendement relatif au NFT [23] dans la loi de finances 2022 [24], en proposant que l'imposition de la cession doit se faire sur la base de l'actif sous-jacent [25]. Cette proposition a été abandonnée car elle conduirait à une distinction entre Token fongible et NFT.
En entrant les actifs numériques dans le champ de l’article 150 VH bis du Code général des Impôts s’opère la consécration d’un régime d’imposition des plus-values sur les actifs numériques lors de la cession par des particuliers à titre occasionnel. Ce régime se rapproche du régime des plus-values mobilières assorties de certaines exceptions.
Ainsi, les cessions à titre onéreux des jetons numériques sont soumises à l'article 150 VH bis, tel qu’il résulte de l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier qui ne vise pas les security token.
Cet article pose aussi la règle du sursis d'imposition, la cession ne sera imposée que lors de la transformation de la vente en monnaie étatique. Rappelons ici, que ce régime d’imposition et sans incidence sur la fiscalité des activités de minage soumise au régime des bénéfices non commerciaux BNC [26], ni les modalités d’imposition des actifs numériques à caractère habituel qui demeurent sous le régime BIC [27].
En somme, la loi de finances pour 2019 a mis en place un régime de plus-values sur actifs numériques, dont le contenu est présenté à l’article 150 VH bis du Code général des Impôts, ces dispositions ne sont pas sans susciter de nombreux questionnements quant à leur portée teneur.
Les points les plus importants de ce régime sont les suivantes :
- il vise les personnes physiques dont la domiciliation est en France ;
- il repose sur un système déclaratif ;
- il est exclusif du régime prévu à l’article 150 UA du Code général des impôts N° Lexbase : L9065LN3 ;
- il permet de distinguer ceux qui agissent comme des particuliers dans le cadre de leur patrimoine privé et ceux qui agissent comme des professionnels ;
- les moins-values nettes ne sont pas reportables ;
- la fiscalisation des gains ou revenus sur actifs numériques est réalisée à chaque cession de ces valeurs, sachant que les échanges entre actifs numériques bénéficient d’un sursis d’imposition.
Cette disposition est critiquable à plusieurs égards, tout d’abord, car l’article repose sur une idée erronée, « notamment sur une fiction : chaque foyer fiscal est réputé disposer d’un portefeuille unique d’actifs numériques... sans considération pour le type de wallet effectivement utilisé et sans prendre en compte non plus la nature des actifs qui y sont inscrits. Les dispositions du CGI instaurent ainsi une fongibilité fiscale [28] », ce qui conduit à un raisonnement tendancieux, « La plus-value ne se détermine pas en comparant la valeur d’acquisition et la valeur de cession de chacun des actifs numériques, mais conduit à prendre en compte leur poids relatif dans le portefeuille à la date de la cession. L’assiette de la plus-value imposable est déterminée à partir des plus ou moins-values contenues dans l’ensemble du portefeuille de cryptoactifs du redevable, comme cela est déjà le cas, par exemple, en cas de retrait anticipé d’un plan d’épargne en actions ou de rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie. Cette fongibilité fiscale n’est-elle pas la preuve que les NFT n’entraient pas dans les prévisions du législateur ? [29] ».
Par ailleurs, d’autres questions demeurent en suspens, l’article vise les personnes physiques mais ne donne aucune précise sur la ligne fine entre un particulier et un collectionneur occasionnel ou un professionnel.
À compter du 1er janvier 2023, c’est le régime des bénéfices non commerciaux qui trouvera à s’appliquer, la loi de finances pour 2022 ayant décidé d’assimiler aux BNC les personnes exerçant une activité de trading sur actifs numériques, en s’appuyant sur des moyens équivalents à ceux d’un professionnel.
En ce sens, la proposition 8 du rapport CSPLA invite à une clarification sur l’applicabilité de cet article aux NFTs : » proposition n° 8 : clarifier l’applicabilité aux NFT du régime fiscal des actifs numériques défini par les articles 150 VH bis et 200 C du CGI [30] ».
7. La TVA des NFTs : En matière de TVA, l’article 256 A du Code général des impôts N° Lexbase : L3557IAY, affirme que toute opération consistant en une livraison de biens ou une prestation de service effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel est soumise à TVA. Les assujettis sont des personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique.
Dans la logique d’application des règles relatives à la TVA, les opérations portant sur des actifs incorporels, comme les cryptoactifs, sont assimilées à des prestations de services, à condition que la fourniture de services corresponde à la définition de l’article 256, IV du Code général des impôts, entendue comme toute opération qui ne constitue pas une livraison de bien corporel.
En somme, les NFTs sont incontestablement des biens incorporels et leur vente doit à ce titre être regardée comme une prestation de services susceptible d’être assujettie à la TVA lorsqu’elle est réalisée, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel.
Compte tenu de la diversité de ces opérations, il y a lieu de s’interroger sur la nature de chacune d’elles pour déterminer si elles sont susceptibles d’être assujetties à la TVA [31].
Ainsi, en pratique, comme les jetons, peuvent relever de réalités bien différentes. Ils peuvent constituer une sorte de certificat de propriété d’un fichier numérique. Cette fonction explique le développement de cet outil dans le monde de l’art numérique et du jeu vidéo. Ils peuvent également représenter des droits sur l’émetteur, au même titre qu’un jeton fongible classique (accès à des réseaux, des jeux, des événements, etc.). Mais ils peuvent surtout associer ces deux fonctions.
L’enjeu primordial se loge ainsi dans la détermination de l’objet de la prestation. Techniquement, lorsque le NFT associe les deux fonctions précitées, il est donc incontournable de déterminer si la livraison du NFT constitue la prestation en elle-même ou si cette prestation consiste en la fourniture des droits associés au NFT livré.
Dans ce cas de figure, deux niveaux de réflexion peuvent être retenus :
Dans une première illustration, un lien direct pourrait être mis en relief entre la livraison du NFT et la contrepartie reçue, c’est-à-dire le paiement du NFT, généralement en cryptoactifs.
L’administration fiscale espagnole a publié une position pertinente et complète sur le sujet concluant à l’assujettissement au taux normal de la vente d’un NFT représentant une œuvre numérique [32].
Dans une seconde illustration, un certain nombre d’émissions de collections de NFTs poursuivent un objectif de financement et le développement de projets dans desquels les NFTs pourront être un moyen d’arriver à ces fins. C’est le cas, par exemple, des NFTs représentant des personnages qui sont vendus pour financer le développement d’un métavers ou d’un jeu vidéo auxquels les détenteurs du NFT auront un accès privilégié.
En présence d’un aléa sur le principe même des contreparties futures, le lien direct entre le paiement et ces contreparties pourrait être inexistant.
Dans le cas où la vente de NFTs est assujettie à la TVA, des écueils liés à la territorialité, laisse plane des questionnements sur le taux applicable.
Dans le cas où il est impossible de recourir à l’application d’un taux réduit, le taux normal de 20 % devrait s’appliquer.
Les dispositions de l’article 278-0 bis I du Code général des Impôts qui fixent le taux réduit de 5,5 % comme taux applicable aux livraisons d’œuvres d’art est clairement à exclure.
Et cela parce que la notion d’œuvre d’art dans le cadre des règles applicables en matière de TVA est délimitée par le recours au renvoi à une liste limitative de créations artistiques qui doivent être exécutés « à la main par l’artiste », comme l’affirme l’article 98 A, annexe III du Code général des impôts N° Lexbase : L2271HM3. Ces règles sont exclusives de « l’emploi de tout procédé, quel qu’il soit, permettant de suppléer, en tout ou en partie, à cette intervention humaine » [33] comme le soutient l’administration fiscale.
Les œuvres totalement numériques, réalisées au moyen d’outils logiciels, sont exclues de la définition [34].
Le taux réduit de 10 % applicable à la cession ou la concession de droits de propriété intellectuelle tel qu’il résulte de la rédaction de l’article 279, g du Code général des impôts N° Lexbase : L6288LUG en faveur de l’auteur est exclu lorsque la vente de NFTs n’induit pas la cession de ce droit [35].
II. Les NFTs dans le marché de l’art
A. Le régime des NFTs dans le marché de l’art
8. Les NFTs et l’art : La Galerie des offices à Florence a attaché des NFTs aux chefs-d’œuvre de Michel Ange, cette brillante idée mercantile a été suivie par d’autres musées et lieux d’expositions d’œuvres d’art comme : Galeries de l’académie de Venise, Galerie nationale des Marches, musée de Capodimonte, la Pinacoteca Ambrosiana, BritishMuseum, et enfin musée de l’Ermitage [36]. L'artiste américain Beeple, quant à lui, a vendu son œuvre sous forme NFT pour 70 millions de dollars à ce jour le NFT le plus cher. Cette tokénisation de l’art ne fait que débuter [37].
Rappelons ici, les rapports entre les NFTs et le droit d'auteur qui protège une œuvre de l'esprit : voir article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3636LZP. Cet article pose un certain nombre de conditions à remplir par l’œuvre, cette dernière doit notamment être originale et tangible. Au regard du droit de la propriété intellectuelle la qualification d'œuvre d'art pour les NFTs semble encore compromise, pour démonstration, l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3334ADT qui liste les œuvres d'art cette liste ne reconnaît pas les NFTs. Elle n'est cependant pas exhaustive, une inclusion de ces derniers dans sa rédaction serait la bienvenue. Ici la condition d'originalité est en question, le processus de tokenisation n'est en aucun cas un processus original qui relève de la créativité du créateur de l'œuvre.
Car en réalité l'acheteur du NFT reçoit un jeton numérique et non l'œuvre en elle-même, ce dernier donnant accès à un fichier numérique sur blockchain, il s'agit d'un certificat d'authenticité de l'actif sous-jacent. En cas, d'absence de cession de droit d’auteur, l'auteur de l'œuvre reste titulaire des droits moraux et patrimoniaux.
9. L’apport des NFTs au marché de l’art : La particularité du NFT dans le marché de l’art est la mise en place d’un original authentifié distingué parmi les autres copies et versions [38].
Il s’agit donc d’un renouvellement de l’art et de la pratique des artistes. Ici, la particularité des NFTs qui est exploitée est que cette technique est créatrice de rareté [39].
Ainsi, les NFTs sont une technologie disruptive pour le marché de l’art et cela sous deux aspects principaux:
Le marché de l’art qui est en recherche de transparence comme vertu, laquelle vertu est rattachable aux NFTs avec cette capacité d’authentification qui permet d’en faire un atout dans un secteur malheureusement opaque.
C’est aussi sous l’impulsion de la loi du 28 février 2022 [40], qu’il est désormais possible d’acheter une œuvre incorporelle lors d’une vente aux enchères ouvrant ainsi l’accès à l’acquisition de NFTs d’œuvres numérisées. C’est l’ouverture de l’accès d’un marché de connaisseurs à une clientèle nouvelle devenant par la même un outil de démocratisation de l’art que les NFTs ont permis.
10. La question fiscale des NFTs dans le marché de l’art : Face aux multiples transactions dont il fait l’objet, la question de l’imposition des NFTs dans le marché de l’art est devenue brûlante et porteuse de nombreux enjeux.
Il s’agit là, d’un phénomène que la fiscalité ne peut ignorer, sont ainsi visés, en particulier les cas de l’imposition des plus-values réalisées et de l’assujettissement à la TVA des opérations.
Pour entamer une étude sur la fiscalité des NFTs sur le marché de l’art, il convient de traiter de la fiscalité des œuvres d’art physiques pour vérifier son éventuelle applicabilité aux NFTs.
La définition fiscale d’œuvre d’art est un préalable au traitement de la question de la fiscalité des NFTs. L’inventaire des dispositions en présence souligne un dispositif hermétique aux changements dans sa formulation, en effet, l’article 98 A, annexe III du Code général des impôts propose une liste d’œuvres d’art correspondant aux dispositions de la Directive TVA en la matière sans ouvrir la possibilité au texte de s’adapter aux évolutions des artistiques.
En l’absence de dispositions claires applicables il convient de se tourner vers la jurisprudence qui pourrait apporter des éléments d’éclairages sur la question. Dans cette optique, c’est l’arrêt « Regards Photographiques » rendu par la CJUE le 5 septembre 2019 [41] qui marque la volonté des juges européens de dégager des critères objectifs afin de limiter la marge de manœuvre des administrations nationales. Deux éléments sont dégagés par cette jurisprudence : le critère de la réalisation de l’œuvre sous le contrôle de l’artiste et celui de la technicité employée (matérielle ou digitalisée).
Cet arrêt ne manqua pas de mettre en lumière les NFTs est marque un pas vers la reconnaissance des œuvres d’art numérisées sous forme de NFT à condition que la preuve de l’originalité de l’œuvre ne soit apportée.
En effet, conformément aux conclusions de cet arrêt rien ne fait obstacle à la reconnaissance des NFTs comme œuvre d’art à part entière.
Donc, si l’on raisonne à partir du postulat que les NFTs sont attachés à leur sous-jacent, alors peut-être nous pouvons l’examiner et le mettre à l’épreuve des règles applicables aux œuvres physiques dans le Code général des Impôts. L’emploi du conditionnel est nécessaire en raison de l’absence règle directe consacrant cette œuvre d’art numérique qu’est le NFT.
S’il est largement acquis que ces NFTs sont des actifs numériques à inscrire au patrimoine des personnes alors l’administration doit recourir à la détermination de leur valeur, si les méthodes d’évaluation classique des œuvres physiques peuvent être appliquées, alors, il faut se référer à l’article 764 du Code général des impôts N° Lexbase : L7320MBQ qui retient plusieurs outils tels que l’acte de vente, le contrat d’assurance, un inventaire ou un forfait mobilier de 5 %. Il faut aussi souligner que les NFTs ne sont pas assurés pour le moment, aucun contrat d’assurance les concernant n’existe, il est donc impossible de se baser sur ce dernier pour une estimation du bien.
Les NFTs peuvent-ils épouser les contours du meuble meublant au sens fiscal ? En droit civil cette qualification est rattachable au support tangible de l’œuvre. Visiblement rien ne semble faire obstacle à la qualification de NFT d’ornement dans un lieu d’habitation et cela dans les mêmes circonstances que les œuvres physiques (tableau numérique sur écran permanent).
La question mérite son intérêt puisque depuis le mois d’avril 2022 il existe une plateforme permettant à tout propriétaire de NFTs artistiques d’imprimer les NFTs sur une toile de qualité. Les juges ont admis la possibilité qu’un tableau unique puisse être considéré comme un meuble meublant et être déclaré pour une valeur égale à 5 % des biens possédés, lorsque sa fonction décorative ne peut être contestée [42].
La question de la fiscalité des œuvres d'art est importante en raison du régime de ces dernières en effet, il reste très favorable car il propose le choix au contribuable entre une imposition, une imposition sur la plus-value réalisée sur la vente 36,2 % ou celle au prix de la cession à 6 %
Plus, l'article 150 VJ 4° du Code général des impôts N° Lexbase : L1267IZX qui prévoit une exonération d'impôts pour les œuvres dont la cession ne dépasse pas les 5000 euros.
L'article 98 A, annexe III du CGI dresse une liste des objets considérés comme des œuvres d'art, mais surtout pose la condition de elle doit être réalisée par la main de l'artiste. C’est sur cette condition que l'administration s'oppose à la reconnaissance des actifs numériques comme œuvre d'art. Cette situation est porteuse d'inégalité à l'égard des artistes du numérique par rapport aux artistes du monde réel. La loi de finances 2022 applicable à partir de janvier 2023 modifie partiellement le régime applicable ici.
11. Le régime fiscal applicable à la cession d’un NFT artistique : Si l’on décide que l’on fait application du régime de l’œuvre d’art aux NFTs alors on admet que le NFT ne peut être distinct de l’œuvre sous-jacente. En effet, ce raisonnement tombe sous le sens, autrement la situation est singulière car la cession porte sur l’œuvre sous-jacente au NFT.
Quelle est donc la démarche à adopter ici faut-il assimilé le NFT à l’œuvre artistique ou cette configuration se prête telle à la création d’un nouveau régime? C’est là que réside l’enjeu de cette qualification.
Si l’œuvre numérisée n’est pas reconnue comme telle, est-il possible d’appliquer le régime lié à la cession des biens meubles ? Ce régime est prévu à l’article 150 UA du Code général des impôts qui porte sur l’imposition des plus-values réalisées sur les cessions de biens mobiliers et immobiliers.
Ce régime s’applique autant sur un bien corporel, qu’incorporel [43].
Toutefois, pour les œuvres d’art qualifiées comme telles, l’article 150 UA du Code général des Impôts renvoie à l’article 150 VL du même code, lequel prévoit un régime spécial dédié aux œuvres d’art. Cependant, pour les œuvres numériques exclues de la qualification fiscale d’œuvre d’art, il faut faire une application du régime de droit commun, dédié aux biens meubles. Les NFTs peuvent être intégrés dans ce cas de figure, cela va de soi.
L’imposition du NFT demeure curieuse à de multiples égards, en effet, il ne s’agit que d’un instrument d’authentification. Le principe de neutralité technologique peut être invoqué ici pour soutenir que les NFT ne sont qu’un outil de certification de l’œuvre, dans cette logique, l’imposition semble être une vue de l’esprit qui ne répond aucun sens commun.
Ainsi, on peut légitimement soutenir que l’idée est à ce point saugrenue qu’elle reviendrait à imposer le certificat d’authenticité d’une œuvre dans le monde réel.
Cependant, cette fonction d’authentification soulève des questionnements car elle s’opère par le biais du blockchain qui ne permet pas de déterminer avec certitude l’originalité de l’œuvre.
En l’absence de reconnaissance légale claire des arbitrages s’organiseront au cas par cas.
Cette imposition du jeton n’est pas sans conséquence, en ce qu’elle ouvre la porte à un conflit juridique et doctrinal sur la notion d’œuvre d’art et sème le flou dans le cas des œuvres d’art ayant deux supports numérique et matériel.
B. Le spectre de la dissimulation de revenus et de requalification fiscale
12. Les risques liés à la fiscalité des NFTs [44] : Les dispositions de l’article L. 110-1 et L. 121-1 du Code de commerce, traitent de la notion d’acte de commerce et de commerçant. Posant ainsi, les jalons de ce qu’est un commerçant ces éléments sont transposables sans obstacles à la question du NFT. En résulte qu’une personne réalisant des actes de commerce multiples dans le cadre de son activité habituelle est un commerçant.
En ce sens, la jurisprudence la cour administrative d’appel de Douai en 2020 [45] a précisé les contours de l’application de l’article 35 du Code général des impôts N° Lexbase : L3342LCR, lequel fait application du régime des BIC aux bénéfices réalisés par les commerçants de biens. En affirmant que, la soumission à ce régime est subordonnée à la réunion d’une double condition : il faut un caractère habituel et une intention spéculative.
Plus loin dans le temps, un arrêt du Conseil d’État le 27 janvier 2010 [46] énonce plusieurs critères permettant d’apprécier le caractère professionnel :
- la fréquence et le nombre d’opérations ;
- l’absence d’intermédiaire et la mise en œuvre de procédés professionnels ;
- les brefs délais entre les transactions [47].
Les critères traditionnellement admis par la jurisprudence sont-ils toujours pertinents pour la transaction de ces actifs ? L’administration va orienter son appréciation autour de la complexité technique des opérations réalisées.
En cas de requalification fiscale, l’administration imposera les recettes au titre de l’exercice d’une activité occulte en vertu de l’article L. 16-0 BA du LPF N° Lexbase : L6010LMK.
Pour les opérations exceptionnelles c’est le régime des BNC qui est applicable.
Cependant, la loi de finances pour 2022 a instauré un nouvel alinéa à l’article 92 du Code général des Impôts qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 [48].Ce nouvel alinéa prévoit de classer les cessions d’actifs numériques réalisées à titre professionnel dans la catégorie des BNC : les BNC comprennent notamment,« les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ». Cette formulation est inspirée par le droit boursier.
| Conclusion : L’insécurité juridique autour de la qualification juridique et fiscale des NFTs est majoritairement la conséquence de la diversité des NFTs existants et donc des réalités multiples qu’ils décrivent. Le cadre juridique et par conséquent fiscal des NFTs ne sont pas fixés, il convient donc de mesure garder pour les investisseurs et de bien garder en tête que le NFT n’est qu’un outil d’authentification et de traçage. Le modèle juridique qui sera adopté tel qu’il soit à l’ avenir doit tenir compte d’un certain nombre de paramètres, comme une articulation cohérente avec les régimes fiscaux existants en cas de création inédite ou une extension des régimes existants à l’ensemble des particularités du NFT. Quant au contenu de ces dispositions, il serait préférable qu’il soit exempt de développements trop techniques [49]. Et surtout veiller à instaurer une fiscalité avantageuse pour ne pas faire fuir les artistes vers d’autres horizons et aussi assurer une compétitivité française sur ce terrain. Pour finir l’innovation ne doit occulter les points faibles du NFT, ainsi, le caractère récent du phénomène et la spéculation qui lui est assortie sont des éléments qui poussent à questionner le potentiel effet de mode qu'il représente plus que le placement. Bouleversant les catégories de droit traditionnel, il s'agit d'un écosystème récent qui en gagnant en maturité définira de facto son identité juridique. |
[1] Sur cette histoire du NFT, V. J.-G. Dumas, P. Lafourcade, E. Roudeix, A. Tichit et S. Varette, Les NFT en 40 questions, Dunod, 2022, n° 12, p. 71 et s..
[2] Sur le rapport dématérialisation vers la tokenisation, V. A. Favreau (dir.), R. Baron et N. Barbaroux, Blockchain et Finance, Approche pluridisciplinaire, Répertoire Dalloz, IP/IT et communication, juin 2020, n° 52.
[3] F. Fleuret, A. Lourimi et W. O’Rorke, Blockchain – 3 questions – Vers un droit des cryptoactifs et de la blockchain ?, JCP E 2021, n° 5, 85. Le NFT marque par la réintroduction des concepts de rareté et d’unicité, tel que le souligne Ch. Le Stanc, NFT : Propr. industr. 2022, repère 3.
[4] A. Favreau, Le NFT et le droit de la propriété intellectuelle, Revue droit bancaire et financier, Lexisnexis, n° 4, juillet –août 2022.
[5] Sur cette notion la littérature est riche : Loukili Ghizlane, Les smart contracts : pour une reconnaissance juridique équanime, efficiente et pérenne du syntagme trompeur dans l’écosystème numérique, à paraître aux éditions Artemis ; Sébastian Drillon, La révolution Blockchain, la redéfinition des tiers de confiance, RTD Com 2016 p 893. M. Gauchet, La Révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation 1789-1799, Paris Gallimard, 1995, 288 p. 14. P. Rosanvallon, La Légitimité démocratique, Seuil, Points Essais, 2008, p. 368 ; B. Ancel, Les smart contracts : révolution sociétale ou nouvelle boîte de Pandore ? Regard comparatiste, Communication – Commerce électronique - n° 7-8 – juillet – août, 2018.
La disparition des tiers de confiance est toutefois discutable, T. Douville et T. Verbiest, Blockchain et tiers de confiance : incompatibilité ou complémentarité ?, D. 2018. 1144. Fabian Gillioz, du contrat intelligent au contrat juridique intelligent, in Dalloz IP/IT, N 1, janvier 2019, p 16 ; E. Marique, Les smart contracts en Belgique : une destruction utopique du besoin de confiance, in Dalloz IP/IT, N 1 janvier 2019, p 22 et suiv..
[6] T. Girard-Gaymard et R. Garcia, Fiscalité des NFT : réflexion au confluent de la propriété intellectuelle, du droit financier et du droit fiscal, NF, n° 1307, p. 13, 1er avr. 2022.
[7] Loukili Ghizlane, The law and the metaverse: overview of the concept and legal issues relating to the appropriateness of implementing legislation, Revue spécial des sociétes, du 17 juin 2022, prix de droit privé aux doctoriales de Settat, le 16 juin 2022 ; Loukili Ghizlane, Le droit et le métavers : panorama de la notion et enjeux juridiques relatifs à l’opportunité de mettre en œuvre une législation. Revue spéciale des Sociétés, 13 juillet 2022 ; Loukili Ghizlane, Le métavers touristique : entre leurre ou lueur pour les professionnels du secteur, Juris-Tourisme, novembre 2022, Dalloz.
[8] A. Faguer, Première Fashion Week dans le metavers, Les Échos, mars 2022.
[9] C. Zerbib, W. O’Rorke, NFT : chaînon manquant ou maillon faible de l’art numérique : Propr. industr. 2021, étude 11, n° 5. – G. Chatain, B. Znaty et L. Pinto, NFT : quelle qualification ? quel traitement fiscal ?, Dalloz actualité, 17 mai 2021. – A. Favreau, Jetons non fongibles et droit d’auteur, Propr. intell. 2021, n° 79, p. 6.
[10] CE 26 avril 2018, nos 417809, 418030, 418031, 418032 et 418033, Lebon avec les conclusions ; AJDA, 2018. 951 ; AJ fam. 2018. 320, obs. S. Paillard ; Dalloz IP/IT 2018. 431, obs. F. Douet.
[11] OCDE (2020), Fiscalité des monnaies virtuelles : Panorama des traitements fiscaux et des sujets émergents de politique fiscale : OCDE, Paris, 2020 [en ligne].
OCDE, Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard Public – Consultation Document, mars 2022.
OCDE, Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard Public – Consultation Document, mars 2022, p. 4 : « Furthermore, the ability of individuals to hold Crypto-Assets in wallets unaffiliated with any service provider and transfer such Crypto-Assets across jurisdictions, poses a risk that Crypto-Assets will be used for illicit activitiesor to evade tax obligations ».
[12] Question écrite n° 22200 : JO Sénat 15 avril 2021, p. 2459, M. Jérôme Bascher, qui relève que « les NFT ne font à ce jour l’objet d’aucune régulation spécifique » [en ligne]. – V. lors des débats parlementaires, lors de l’adoption de la loi de finances pour 2022, l’amendement I-1387 de la commission des finances et l’amendement I-1894 de M. Pierre Person. –V. également, rapp. d’information sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux cryptoactifs, déc. 2021, spéc. p. 35.
[13] Le projet de règlement MiCA (Comm. UE, PE et Cons. UE, prop. de règl., 24 sept. 2020, sur les marchés de cryptoactifs : Doc.COM(2020) 593 final, 2020/0265 (COD)) prévoit en l’état actuel du texte de sortir les NFT qui représentent des droits de propriété intellectuelle ou certifient l’authenticité d’un actif physique unique comme une oeuvre d’art du champ d’application du règlement européen, ouvrant la voie à un régime sur-mesure.
[14] E. Papin, Non Fungible Token : approche juridique d'une nouvelle pratique sur le marché de l'art, sur le site NEXT avocats, avril 2021 [en ligne].
[15] BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 N° Lexbase : X5858ALK ; V. T Guillebon, Quel régime fiscal pour les bitcoins ?, Dr. fisc.2015, n° 38 . -Position ACPR n° 2014-P-01, du 29 janvier 2014, relatives aux opérations sur bitcoin en France (Rev. ACPR sept - oct 2014.6).
[16] F. Douet, Modalités d’imposition des produits tirés de la cession de monnaies virtuelles, Observations sous Conseil d’État, 26 avril 2018, n° 417809 - Qualification de la requête : Importante, Dalloz IP/IT 2018 p. 431. Ariane Périn-Dureau, Régime fiscal des bitcoins : quand le Conseil d’État saisit l’insaisissable, RTD Com, 2018, p. 1073.
[17] JORF, n° 0119, du 23 mai 2019.
[18] D. Legeais, L’avènement d’une nouvelle catégorie de biens : les actifs numériques Projet de loi Pacte, RTD Com, 2019, p. 191.
[19] D. Legeais, L’avènement d’une nouvelle catégorie de biens : les actifs numériques Projet de loi Pacte, RTD Com, 2019, p. 191.
[20] Sur la question des dons des cryptomonnaies voir : A-S. De Jotemps, Tentative d’abécédaire du don, Juris associations 2021, n° 2021, n° 641, p. 18.
[21] V. sur les ICO : G. Kolifrath, J. Nivot et F. Martineau, Initial Coin Offerings, Actes prat. ing. sociétaire 2022, dossier 8.. D. Legeais, La folie NFT, RD bancaire et fin. 2022, repère 2. V. sur les actifs numériques : JCl. Commercial, fasc. 535, Actifs numériques et prestataires de services numériques, par D. Legeais.
[22] Loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : Z839238Z.
[23] QE n° 22000 de M. Jérôme Bascher, JO Sénat 14 avril 2021 p. 2459 [en ligne], qui relève que « les NFT ne font à ce jour l’objet d’aucune régulation spécifique ». – V. lors des débats parlementaires, lors de l’adoption de la loi de finances pour 2022, l’amendement I-1387 de la commission des finances et l’amendement I-1894 de M. Pierre Person. –V. également, rapp. d’information sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux cryptoactifs, déc. 2021, spéc. p. 35. Amendement n° I-CF879-Pierre Person.
[24] Loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM.
[25] Le projet de Règlement MiCA (Comm. UE, PE et Cons. UE, prop. de règl., 24 sept. 2020, sur les marchés de cryptoactifs : Doc.COM(2020) 593 final, 2020/0265 (COD)) prévoit en l’état actuel du texte de sortir les NFT qui représentent des droits de propriété intellectuelle ou certifient l’authenticité d’un actif physique unique comme une oeuvre d’art du champ d’application du règlement européen, ouvrant la voie à un régime sur-mesure. T. Girard-Gaymard et R. Garcia, Fiscalité des NFT : réflexion au confluent de la propriété intellectuelle, du droit financier et du droit fiscal, NF, n° 1307, p. 13, 1er avril 2022.
[26] Les bénéfices non commerciaux (BNC) sont une catégorie de revenus applicable aux personnes qui exercent une activité professionnelle non commerciale, à titre individuel ou comme associés. Ils font partie du revenu imposable et sont soumis, après déduction des charges, au barème de l’impôt sur le revenu.
[27] Les BIC pour bénéfice industriels et commerciaux sont une catégorie de revenus applicable aux personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Ils font partie du revenu imposable. Et soumis à des obligations déclaratives qui dépendent du régime fiscal applicable micro BIC, réel simplifié ou réel normal. Ils sont soumis au barème de l’impôt sur le revenu.
[28] R. Vabres, Les NFT quelle réglementation fiscale, Revue droit bancaire et financier, n° 4, juillet – août 2022, Lexisnexis.
[29] Ibid.
[30] Le CSPLA publie son rapport de mission sur les « Non- Fungible Tokens » (NFT) CSPLA, actualités, 12 juillet 2022, CSPLA, rapp., 12 juill. 2022
[31] P. Pailler NFT – Non Fungible Tokens ou NFT : quelle régulation en droit financier ?, RD bancaire et fin. 2022, n° 2, alerte 35. – D. Legeais, NFT – La folie NFT ; RD bancaire et fin. 2022, n° 2, repère 2. – P. Bordais, Finance décentralisée (DeFi) – Finance décentralisée et NFT (non fungible token) : deux nouvelles innovations de la blockchain, RD bancaire et fin. 2021, n° 6, étude 19.
[32] Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0486-22, 10 mars 2022. Dans les faits, l’artiste ne vendait pas directement l’œuvre d’art ou les droits sous-jacents à la propriété de l’œuvre, mais accordait simplement à l’acheteur le droit d’utiliser les NFTs.
[33] BOI-TVA-SECT-90-10 N° Lexbase : X8325ALW.
[34] QE n° 22584 de Mme Annie Genevard, JOANQ 3 septembre 2019, réponse publ. 12 janvier 2021 p. 219, 15ème législature N° Lexbase : L2173L7M ; Dr. fisc. 2021, n° 5, act. 70.
[35] V. Varnerot, Le régime fiscal des NFTs artistiques, Dr. fisc. 2022, n° 14, étude 176.R. Vabres, Tokens – La fiscalité des opérations, RD bancaire et fin. 2020, n° 3, dossier 13.
[36] Chiche-Attali, L. Toubas, L’exposition d’oeuvres sous forme de NFT : du musée au métavers, Point contemporain, 2022.
[37] L. Grynbaum, C. Le Goffic et L. Haidara Morlet, Droit des activités numériques ; Dalloz, coll. Précis, 2014, n° 925 et s., p. 638 et s.
V. not. C. Zerbib, W. O’Rorke, NFT : chaînon manquant ou maillon faible de l’art numérique, Propr. industr. 2021, étude 11, n° 5. – G. Chatain,
B. Znaty et L. Pinto, NFT : quelle qualification ? quel traitement fiscal ? : Dalloz actualité, 17 mai 2021. – A. Favreau, Jetons non fongibles et droit d’auteur, Propr. intell. 2021, n° 79, p. 6.
[38] M. Vivant, NFT : le renouvellement du marché de l’art par la finance ?, Revue droit bancaire et financier, juillet-août 2022.
[39] A. Favreau, NFT et droit de la propriété intellectuelle, RD bancaire et fin. 2022, dossier 34.
[40] Loi n° 2022-267, du 28 février 2022, visant à moderniser la régulation du marché de l’art N° Lexbase : L5716MBC.
[41] CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-145/18, Regards Photographiques SARL N° Lexbase : A3893ZM7. Lire en ce sens, F. Laffaille, De la photographie comme objet d’art (et de la TVA à taux réduit), Lexbase Fiscal, octobre 2019, n° 797 N° Lexbase : N0555BY9. – V. Chambaud, Art & fiscalité ; Ars vivens, 14ème édition, 2022.
[42] V. Cass. com., 17 octobre 1995, n° 94-10.196 N° Lexbase : A1360ABY : Bull. civ. IV, n° 240 ; Dr. fisc. 1996, n° 5, comm. 116 ; JCP N, 1996, n° 12, 451, note B. Jadaud ; D. 1996, jurispr. p. 33, note A. Robert ; RJF, 1/1996, n° 140 ; Defrénois 1997, p. 527, note A. Chappert ; RTD civ. 1996, p. 650, obs. F. Zenati ; LPA 27 mars 1996, note F. Deboissy ; Dr. & patr. 1995, n° 12, p. 33, note B. Poullain.
[43] V. Varnerot, Le régime fiscal des NFTs artistiques, Dr. fisc. 2022, n° 14, étude n° 176.
[44] En ce sens, J. Beaumont, La protection des marques dans le métavers, in Droit et métavers, dossier Lamy, avr. 2022, n° 191, p. 50.
41. Note A. Lucas-Schloetter ss Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-14.205, F-D N° Lexbase : A89874BH : JurisData n° 2021-000043 ; Comm. com. électr. 2021, chron. 10, n° 1, M. Ranouil ; JCl. Propriété littéraire et artistique, Synthèse 25 : Objet du droit d’auteur. Titulaires du droit d’auteur, par A. Lucas ; Propr. intell. 2021, n° 79 ; Droit d’auteur et droits voisins, p. 81, spéc. p. 82 et 83.
42. En ce sens, B. Gleize, L’irrésistible ascension des jetons non fongibles, RLDC 2021, n° 194, p. 32-36.
Loi n° 2022-267, du 28 février 2022, visant à moderniser la régulation du marché de l’art ; JCP N, 2022, n° 10, act. 339, obs. G. Goffaux Callebaut.
En ce sens, E. Papin, Les NFT dans le monde de la création artistique : quels sont les droits effectifs derrière l’argent échangé ?, RLDI 2021, n° 187.
[45] CAA Douai,18 juin 2020, n° 18DA00359 N° Lexbase : A34473PD.
[46] CE 8° et 3° ssr., 27 janvier 2010, n° 306956 N° Lexbase : A7553EQS : RJF, 4/2010, n° 379 ; BDCF, 4/2010, n° 48, concl. L. Olléon.
[47] V. CE 10° et 9° ssr., 18 juin 2007, n° 270734, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8586DWW ; Lebon T., p. 779 ; Comm. com. électr. 2008, comm. 49, note Ph. Neau-Leduc ; RJF, 10/2007, n° 1088.
[48] Loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, art. 70 : Dr. fisc. 2022, n° 1-2, comm. 25, note Th. Guillebon.
[49] European Parliament, Committee on Economic and Monetary Affairs, The Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on markets in crypto-assets and amending Directive (EU) 2019/ 1937 (Doc. COM (2020) 0593 – C9 0306/2020 – 2020/0265 (COD)), pt 5 : « The proportionate treatment of issuers of crypto-assets and service providers, guaranteeing an equal chance of market access and development in the Member States, should be ensured. A Union framework should provide for proportionate treatment of the different types of crypto-assets and the issuing set-ups, thus allowing equal opportunities for market entry and ongoing andfuture development ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482936
[Brèves] L’obligation de réaliser une analyse physique dans un entrepôt français pour le calcul du taux de la TIRIB est-elle conforme au droit de l’Union européenne ?
Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 30 septembre 2022, n° 449850, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A77038LU
Lecture: 5 min
N2896BZB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 12 Octobre 2022
► La circulaire du 18 août 2020 concernant la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants, et imposant, pour les huiles végétales hydrogénées, la réalisation d'une analyse physique en laboratoire aux fins de déterminer leur teneur réelle en molécules biosourcées lors de leur réception dans le premier entrepôt fiscal de stockage français est-elle conforme au droit de l’UE ? Le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la CJUE se prononce.
Les faits :
- une société importe en France des carburants contenant des huiles végétales hydrotraitées fabriquées en Espagne selon le procédé du cotraitement, qui consiste à incorporer, en raffinerie, en amont de l'unité de désulfuration, des huiles végétales à la matière fossile, aboutissant à ce que ces huiles végétales se transforment en HVO sous l'effet de l'hydrogène ; ces carburants sont ensuite réceptionnés en France dans un entrepôt fiscal de stockage avant d'être mis à la consommation ;
- la société demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre délégué, chargé des Comptes publics, du 18 août 2020 concernant la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants, en tant qu'elle impose, pour les HVO, la réalisation d'une analyse physique en laboratoire aux fins de déterminer leur teneur réelle en molécules biosourcées lors de leur réception dans le premier entrepôt fiscal de stockage français. Elle demande également l'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite de son recours gracieux introduit le 16 octobre 2020.
Principe. Les redevables de la taxe intérieure de consommation sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants (TIRIC) (C. douanes, art. 266 quindecies N° Lexbase : L7420MD8). Le redevable doit justifier que les carburants imposables contiennent de l'énergie produite à partir de sources renouvelables notamment au moyen de comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable.
Solution du CE. « Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du TFUE et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par la société requérante ».
Il est sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
1° Les dispositions des articles 17 et 18 de la Directive 2009/28/CE, et celles de l'article 30 de la Directive 2018/2001, doivent-elles être interprétées en ce sens que les mécanismes de suivi par bilan massique, et les systèmes nationaux ou volontaires qu'elles prévoient, n'ont pour objet que d'apprécier et de justifier de la durabilité des matières premières et des biocarburants ainsi que de leurs mélanges, et n'ont ainsi pas pour objet d'encadrer le suivi et la traçabilité, au sein de produits finis issus de cotraitement, de la part d'énergie d'origine renouvelable contenue dans ces produits et par suite, d'harmoniser la prise en compte de la part d'énergie contenue par des tels produits aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c) de la Directive 2009/28/CE et à l'article 25 ainsi qu'à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c) de la Directive 2018/2001 ?
2° En cas de réponse négative à la question précédente, ces mêmes dispositions s'opposent-elles à ce qu'un État membre, pour fixer la quantité de HVO à retenir en entrée des comptabilités matières que les opérateurs doivent tenir aux fins de l'établissement d'une taxe incitative à l'incorporation de biocarburants, acquittée dans cet État lorsque la part d'énergie renouvelable dans les carburants mis à la consommation sur l'année civile est inférieure à un pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, exige, lors de la réception dans le premier entrepôt fiscal national d'importations de carburants contenant des HVO produites dans un autre État membre dans le cadre d'un processus de cotraitement, la réalisation d'une analyse physique de la teneur en HVO de ces carburants, y compris lorsque l'usine au sein de laquelle ces carburants ont été produits a recours à un système de bilan massique certifié par un système volontaire reconnu par la Commission comme un régime complet ?
3° Le droit de l'Union, notamment les stipulations de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'oppose-t-il à une mesure d'un État membre telle celle décrite au point 14 de la présente décision, alors, d'une part, que les carburants contenant des biocarburants résultant de cotraitement au sein d'une raffinerie située sur son territoire ne sont pas soumis, lorsqu'ils sont mis à la consommation dans cet État membre directement en sortie d'usine, à une telle analyse physique, et alors, d'autre part, que cet État membre accepte, pour déterminer en sortie d'usine exercée ou d'établissement fiscal national la teneur en biocarburants pouvant être allouée pour les besoins de la taxe entre les certificats de teneur délivrés au titre d'une période, d'évaluer sur la base d'une moyenne d'incorporation mensuelle de l'établissement ou de l'usine la teneur en biocarburants des exportations ou des mises à la consommation dans d'autres secteurs que le transport ?
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482896
[Brèves] Licenciement du salarié protégé ayant proféré des propos racistes et sexistes
Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 7 octobre 2022, n° 450492, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92088MY
Lecture: 2 min
N2916BZZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 17 Octobre 2022
► Les propos tenus par un salarié protégé, sans antécédents disciplinaires, visant systématiquement et de manière réitérée les personnes de sexe féminin, d'origine maghrébine et de confession musulmane, qui plus est placées sous sa subordination juridique, ne constituent pas simplement des propos triviaux, mais une faute grave de nature à justifier son licenciement pour motif disciplinaire.
Faits et procédure. Un inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement d’un salarié protégé pour motif disciplinaire. À la suite d’un recours hiérarchique formé par l’employeur, la ministre du Travail a retiré sa décision implicite rejetant ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié.
Le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du Travail. Par un arrêt contre lequel l’employeur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 19 janvier 2021, n° 19PA02121 N° Lexbase : A15744DN) a rejeté l’appel contre ce jugement.
La cour administrative d’appel, après avoir relevé que le salarié avait prononcé, à l'encontre de trois salariées de son service, des propos faisant explicitement référence, d'une part, au sexe de ces salariées et, d'autre part, à leur origine et à leur religion supposées, qualifie ces propos de « brutaux ou maladroits », « déplacés et sexistes », et présentant un caractère blessant pour leurs destinataires. Pour la cour, le fait d'avoir proféré de tels propos ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, alors que les propos tenus par le salarié visaient systématiquement et de manière répétée des salariées ayant pour point commun d'être des femmes, supposément d'origine magrébine et de confession musulmane, qui, au surplus, se trouvaient sous sa responsabilité, et ne pouvaient, dès lors qu'ils revêtent un caractère raciste pour certains, et sexiste pour d'autres, être réduits à des propos triviaux, la cour, en estimant qu'ils ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement, en prenant en compte l'existence de tensions entre le salarié et son employeur et l'absence d'antécédents disciplinaires de ce salarié protégé, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
|
Pour aller plus loin : rappr. CE, 7 octobre 2022, n° 454723 N° Lexbase : A91888MA, à propos du licenciement pour faute d'un salarié protégé qui oublie un enfant dans l'autocar. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482916
[Brèves] Non-respect d’une licence de logiciel : la Cour de cassation consacre la possibilité d’agir en contrefaçon
Réf. : Cass. civ. 1, 5 octobre 2022, n° 21-15.386, FS-B N° Lexbase : A58928M8
Lecture: 5 min
N2900BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 12 Octobre 2022
► Le titulaire de droits d’auteur portant sur un programme d’ordinateur peut agir en contrefaçon contre son cocontractant en cas de violation d'une clause du contrat de licence.
Faits et procédure. Une société (la titulaire des droits) a conçu un logiciel permettant la mise en place d'un système d'authentification unique, qu'elle diffuse sous licence libre ou sous licence commerciale en contrepartie du paiement de redevances à son profit.
À la suite d'un appel d'offres de l'État pour la réalisation d'un portail internet, Orange a fourni une solution informatique au moyen d'une plate-forme logicielle intégrant le logiciel.
Estimant que cette mise à disposition de son logiciel n'était pas conforme aux clauses de la licence libre et qu'elle constituait un acte de concurrence déloyale, la société titulaire des droits, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société Orange, a assigné celle-ci en contrefaçon de droits d'auteur et parasitisme.
La cour d’appel (CA Paris, 5-2, 19 mars 2021, n° 19/17493 N° Lexbase : A74524LL, C. Le Goffic, Lexabase Affaires, avril 2021, n° 672 N° Lexbase : N7087BY7) ayant rejeté les demandes de la titulaire des droits au titre de la contrefaçon de droits d’auteur mais accueilli celles fondées sur le parasitisme, cette dernière a formé un pourvoi en cassation, tandis que la société Orange a formé un pourvoi incident.
Décision. Seule retiendra ici notre attention la réponse de la Cour de cassation sur le pourvoi principal, c’est-à-dire sur la question de savoir si le titulaire de droits d’auteur portant sur un programme d’ordinateur peut agir en contrefaçon ou si, comme l’avait jugé la cour d’appel, seule une action en responsabilité contractuelle est possible.
C’est la première option que consacre la Haute juridiction, censurant l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 335-3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3557IEH, les articles 7 et 13 de la Directive n° 2004/48/CE, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle N° Lexbase : L2091DY4 et l'article 1er de la Directive n° 2009/24/CE, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur N° Lexbase : L1676IES.
Après avoir rappelé la teneur de ces textes, la Cour de cassation relève que la CJUE a dit pour droit que « la Directive [n° 2004/48] et la Directive [n° 2009/24] doivent être interprétées en ce sens que la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un programme d'ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d'auteur de ce programme, relève de la notion d'"atteinte aux droits de propriété intellectuelle", au sens de la Directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national » (CJUE, 18 décembre 2019, aff. C-666/18 N° Lexbase : A4336Z84).
La Cour poursuit en énonçant que si, selon l'article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, en cas d'inexécution de ses obligations nées du contrat, le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts, ceux-ci ne peuvent, en principe, excéder ce qui était prévisible ou ce que les parties ont prévu conventionnellement. Par ailleurs, il résulte de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49 que les mesures d'instruction légalement admissibles ne permettent pas la saisie réelle des marchandises arguées de contrefaçon ni celle des matériels et instruments utilisés pour les produire ou les distribuer.
La Cour en déduit que, dans le cas d'une d'atteinte portée à ses droits d'auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la Directive n° 2004/48 s'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon.
Or, pour déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon de droits d'auteur au titre de la violation du contrat de licence liant les parties, l'arrêt d’appel a retenu que la CJUE ne met pas en cause le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et il en déduit que, lorsque le fait générateur d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d'un manquement contractuel, seule une action en responsabilité contractuelle est recevable.
Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés.
Observations. L’arrêt de la cour d’appel avait fait l’objet de vives critiques, certains appelant alors de leurs vœux que celui-ci fasse l’objet d’un pourvoi et que la Cour de cassation saisisse l’occasion d’abandonner le principe de non-cumul des responsabilités en cas de contrefaçon commise par un licencié (v. C. Le Goffic, Lexbase Affaires, préc.). C’est donc chose faite avec l’arrêt rapporté.
La solution retenue par la cour d’appel se révélait en effet critiquable pour deux raisons essentielles.
D’une part, elle était difficilement praticable. En effet, il est souvent très difficile de tracer la ligne de départ entre les prérogatives légales des titulaires de droits de propriété intellectuelle et leurs prérogatives contractuelles, dès lors que les contrats précisent les contours du droit d’usage concédé.
D’autre part, la solution était inopportune en ce qu’elle aboutissait à ce que le contrefacteur licencié soit traité avec plus de bienveillance que le contrefacteur tiers, compte tenu du régime a priori plus favorable pour le défendeur qu’est la responsabilité contractuelle.
Enfin, on relèvera qu’un jugement du tribunal judiciaire de Paris avait déjà pris le contrepied de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en condamnant pour contrefaçon un licencié de logiciel qui avait dépassé les limites de la licence (TJ Paris, 3e ch., 6 juillet 2021, n° 18/01602 N° Lexbase : A264744S, C. Le Goffic, septembre 2021, n° 689 N° Lexbase : N8844BY9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482900
[Focus] La carrière parlementaire de l’expertise ADN
Lecture: 15 min
N2600BZC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Julien Larregue, Département de sociologie, Université Laval Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie
Le 13 Octobre 2022
Mots-clés : sociologie • ADN • Parlement • preuve scientifique • expertise génétique
Introduction
Devenue omniprésente dans les procédures judiciaires, notamment pénales, l’expertise ADN est généralement perçue par les professionnels du droit comme un outil technique particulièrement fiable [1], tant et si bien qu’il semble a priori bien futile d’interroger ses usages. Lorsque certains s’y risquent malgré tout, leurs propos sont globalement reçus avec circonspection et, disons-le, largement ignorés. Ceci est tout particulièrement le cas lorsque ces critiques sont émises par des avocats. Du fait de leur rôle judiciaire, ceux-ci seront alors immédiatement suspectés de vouloir venir à l’aide de leurs clients par quelque moyen que ce soit, ce qui constitue une façon bien commode de disqualifier des questionnements tout à fait légitimes [2].
Cet état de fait ne peut que surprendre le sociologue qui, bien au fait des controverses scientifiques ayant entouré l’arrivée de l’ADN dans les enceintes judiciaires britanniques et états-uniennes [3], en vient à s’interroger sur la relative insouciance avec laquelle les professionnels du droit et, avant eux, les parlementaires français, ont fait de cette macromolécule une technique de « véridiction » [4] particulièrement redoutable. Les recherches empiriques que je conduis depuis quelques années ont eu pour objet d’apporter des éléments de réponse à cette interrogation [5]. J’essaierai, dans cet article, d’en résumer certains des principaux enseignements en me concentrant sur la période qui a précédé l’usage croissant de cette technique par les juridictions pénales. En réalisant ce pas de côté, on en vient à comprendre que l’expertise ADN a très tôt fait l’objet d’une adoption acritique, en profitant notamment de l’attention croissante que le personnel politique, de gauche comme de droite, a porté aux questions sécuritaires à compter des années 1990. Revenons donc sur la « révolution tranquille » de l’ADN.
Réunir les traces de l’activité parlementaire
Lorsqu’on se penche sur la genèse d’une disposition législative, le premier réflexe consiste généralement à se tourner vers les travaux préparatoires à la loi, qu’il s’agisse du premier projet et de ses réécritures successives ou bien des comptes-rendus établis à la suite d’échanges ayant pris place lors de séances tenues à l’Assemblée nationale. Aussi utiles puissent-elles être, ces traces et indices [6] de l’activité parlementaire ne suffisent pas à rendre compte de la façon dont certaines problématiques jusque-là largement ignorées deviennent, parfois subitement, des problèmes publics nécessitant l’intervention des organes étatiques [7]. Ainsi, si l’on s’en tenait aux travaux préparatoires à la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et la répression des crimes sexuels, laquelle a acté la création du Fichier national automatisé des empreintes génétiques, on disposerait d’assez peu d’éléments empiriques sur les raisons ayant présidé à l’introduction généralisée de l’ADN dans les procédures judiciaires françaises.
Voici ce que l’on pourrait établir avec quelque certitude : alors que la future loi du 17 juin 1998 est en préparation, le député du Rassemblement pour la République Jean-Luc Warsmann propose, lors d’une séance du 30 septembre 1997, « la création d’un fichier national des traces et empreintes génétiques » [8]. On sait également que les parlementaires socialistes de la majorité se rallieront à cette proposition (le projet de loi étant présenté par la ministre de la Justice Élisabeth Guigou), ce qui se traduira par un amendement proposé par Frédérique Bredin, alors rapporteure de la commission des lois. On pourrait bien sûr se satisfaire de ces quelques éléments, mais alors nous serions dans l’impossibilité d’établir comment l’idée même d’un fichier génétique a pu émerger.
Heureusement, les députés laissent d’autres sortes de traces au cours de leur activité parlementaire. Les questions au gouvernement en font partie. Pouvant être orales ou écrites, celles-ci constituent sans aucun doute le « mode d’expression parlementaire le plus emblématique » [9]. Elles contiennent, à ce titre, des données empiriques pouvant se révéler précieuses pour qui entend se pencher sur la construction des politiques publiques [10]. Suivant cette hypothèse, j’ai cherché dans ces questions les éléments empiriques qui auraient pu permettre de retracer avec précision l’évolution des préoccupations entourant les usages judiciaires de l’ADN.
En procédant de la sorte, je suis parvenu à identifier 157 questions au gouvernement portant sur les usages judiciaires de l’ADN. Bien que la première question soit soulevée au cours de la 8ème législature (1986-1988), c’est réellement à compter de la 11ème (1997-2002) que cette problématique devient régulièrement discutée au sein de l’Assemblée nationale (v. le Tableau 1). Cela n’a rien de surprenant : la création du FNAEG fait de l’expertise ADN un enjeu politique et judiciaire dont certains parlementaires vont évidemment se saisir.
Tableau 1. Évolution du nombre de questions posées par des députés au sujet de l’ADN, 8ème-15ème législature
| Législature | Questions ADN | Total des questions | Ratio [11] |
| 8ème (1986-1988) | 1 | 40896 | 0,0024% |
| 9ème (1988-1993) | 4 | 62403 | 0,0064% |
| 10ème (1993-1997) | 2 | 55068 | 0,0036% |
| 11ème (1997-2002) | 37 | 81307 | 0,0455% |
| 12ème (2002-2007) | 53 | 128634 | 0,0412% |
| 13ème (2007-2012) | 28 | 138598 | 0,0202% |
| 14ème (2012-2017) | 23 | 110539 | 0,0208% |
| 15ème (2017-…) | 9 | 37570 | 0,0240% |
Bien entendu, ces statistiques descriptives ne nous renseignent pas davantage sur le contenu de ces interventions ni, par conséquent, sur le cadrage opéré par les parlementaires qui en sont à l’origine. L’analyse qualitative du contenu des questions se révèle donc ici précieuse, d’autant qu’elle peut être utilement combinée à des analyses dites lexicométriques. Celles-ci permettent en effet d’identifier les principaux registres lexicaux qui sont investis au sein d’un corpus de textes [12]. On peut ainsi obtenir une classification des 157 questions en fonction des mots-clés qui sont les plus fréquemment mobilisés par les parlementaires dans le texte de leur question. Grâce à cette méthode, on peut conclure que la grande majorité des segments de texte (85,76 %) se répartissent entre quatre grandes classes thématiques, dont trois sont très clairement centrées sur le champ pénal (v. les classes 1-2-3, Graphique 1). Cette orientation se confirme d’ailleurs si l’on analyse la fréquence avec laquelle les différents ministères sont interpellés à propos de l’ADN : bien que le ministère de la Justice arrive logiquement en tête (86 questions sur 157), celui-ci est suivi d’assez près par le ministère de l’Intérieur, avec 55 questions.
Graphique 1. Dendrogramme de la classification des questions au gouvernement
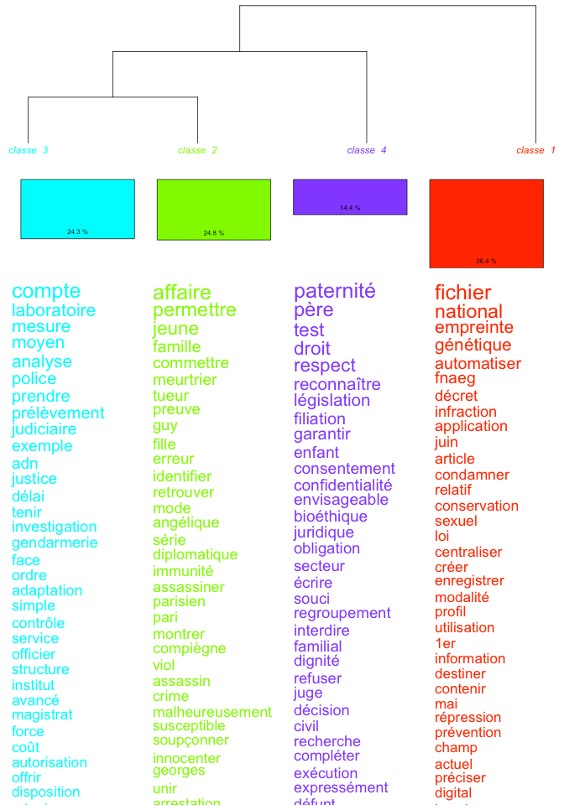
Le lien effectué entre l’ADN et le droit pénal peut bien nous sembler évident aujourd’hui, une telle association n’a pourtant rien de naturel. La toute première application judiciaire de la technique d’identification génétique développée outre-Manche par le généticien Alec Jeffreys eut ainsi lieu dans le cadre d’une affaire d’immigration et de rapprochement familial (Sarbah vs. Home Office, 1985) : il s’agissait de démontrer scientifiquement qu’un enfant vivant au Ghana était bien le fils d’une résidente britannique [13]. La toute première question au sujet de l’ADN, adressée en 1988 au ministre de la Justice par le député RPR des Pyrénées-Atlantiques Jean Gougy, porte d’ailleurs la trace de cette indistinction, puisque les applications pénales sont envisagées au même titre que celles touchant à la filiation :
« M. Jean Gougy attire l'attention de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur l'efficacité en médecine légale de la technique dite des “empreintes génétiques”. Inventée en 1985 par un universitaire anglais, cette technique est de plus en plus souvent utilisée dans les affaires de recherche de paternité comme les affaires criminelles. Pourtant elle n'est pas encore mise en œuvre en France, les spécialistes français devant adresser en Angleterre leurs prélèvements. Il lui demande si des mesures sont envisagées pour que la technique des “empreintes génétiques” soit désormais mise en œuvre dans notre pays. » [14]
Les promesses de l’ADN à l’Assemblée nationale
Comment en est-on arrivé à l’écrasante domination des considérations pénales ? L’analyse qualitative du corpus de 157 questions révèle assez rapidement que des parlementaires déploient très tôt une entreprise promotionnelle puisant dans la rhétorique bien connue de l’économie de la promesse [15]. Leur propos peut être résumé comme suit : si seulement la police et la justice avaient pu avoir à leur disposition un fichier génétique, alors nous aurions pu éviter bien des malheurs et des faits divers. Il n’y a qu’à consulter le dendrogramme de l’analyse lexicométrique pour identifier plusieurs mentions de faits divers ayant défrayé la chronique dans les années 1990 (Guy Georges/assassin/parisien, Angélique [Dumetz]/Compiègne).
Bien que la problématique de l’ADN soit majoritairement investie au sein de l’Assemblée nationale par des hommes de droite (François Grosdidier avec 14 questions, Christian Estrosi avec 10 questions, et Jean-Luc Warsmann avec 9 questions sont les principaux moteurs de cette entreprise), des personnalités de gauche participent activement à cette œuvre promotionnelle, ce qui peut s’interpréter comme l’une des nombreuses manifestations du tournant sécuritaire que les socialistes opèrent au cours des années 1990 [16]. Ainsi l’intervention de l’élue socialiste Frédérique Bredin, applaudie par plusieurs parlementaires de gauche, constitue-t-elle sans doute l’une des meilleures illustrations de la rhétorique mise en place pour promouvoir le développement et, plus tard, l’extension, du FNAEG :
« Jeudi dernier, le tueur en série présumé de l'Est parisien a enfin été arrêté. Cette affaire permet de mesurer l'ampleur, longtemps sous-estimée dans notre pays, des crimes et des délits de nature sexuelle: plus de 7 000 viols sont constatés chaque année par la police ou la gendarmerie et plus d'un viol sur deux est commis sur un enfant. Face à ces chiffres, les condamnations de justice paraissent insuffisantes: environ 1 000 par an, soit 15 % seulement des infractions constatées. Il est symbolique que l'un des tout premiers textes soumis au Parlement par le gouvernement actuel soit un projet de loi sur les infractions sexuelles et sur la protection des enfants. Nous avons été très sensibles à cette volonté gouvernementale. À l'occasion du débat parlementaire qui s'en est suivi, notre assemblée a voté la création d'un fichier génétique destiné à centraliser les empreintes génétiques des condamnés, donc à faciliter les enquêtes policières et judiciaires. L'instruction menée sur le tueur en série de l'Est parisien illustre la nécessité d'un tel fichier puisque le suspect a pu être identifié grâce à la comparaison entre ses empreintes génétiques et celles qu'il a laissées sur les lieux du crime. Toutefois, ce résultat n'a été atteint qu'après trois années d'enquêtes et de recherches artisanales alors que l'existence d'un tel fichier génétique aurait sans doute permis une interpellation plus rapide du suspect et, par là même, peut-être sauvé la vie de plusieurs victimes. Il est donc urgent d'agir – vous vous y êtes engagée très fermement lors de nos débats – afin de faciliter et d'accélérer les enquêtes criminelles. Ma question sera donc simple : concrètement, comment ce fichier fonctionnera-t-il ? Et, puisque urgence il y a, dans quel délai sera-t-il créé ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.) » [17]
On voit dans cette intervention comment l’économie de la promesse déployée par ces parlementaires vient puiser dans le registre émotionnel des faits divers [18], tout se passant comme si l’ADN fournissait une solution technique à des problèmes face auxquels les représentants de l’État ne peuvent se permettre, politiquement, de se montrer impuissants. Les exemples étrangers sont également régulièrement mobilisés au cours de ces interventions. Le Royaume-Uni et les États-Unis sont régulièrement présentés comme des modèles de progrès technique et judiciaire, tandis que la France est dépeinte comme un pays en retard. Pour ne mentionner qu’un exemple de ce procédé rhétorique, le député Georges Sarre soulignera la chose suivante dans l’exposé des motifs de sa proposition de loi « visant à l’extension du fichier national des traces et empreintes génétiques par ADN » : « si on avait mis en place un fichier d'ADN pour les délinquants, comme c'est le cas en Angleterre, beaucoup d'assassins auraient pu être arrêtés plus tôt et plusieurs personnes seraient encore en vie » [19].
L’invisibilisation des controverses scientifiques entourant l’ADN
L’intérêt des analyses qualitatives et lexicométriques menées sur le corpus des questions parlementaires ne réside pas uniquement dans ce qu’elles rendent visible, mais aussi dans ce qui en est absent. On ne trouve en effet nulle trace, parmi ces 157 interventions, des incertitudes qui règnent parmi les scientifiques quant à la fiabilité et l’interprétation des résultats issus des techniques d’identification génétique. Avant même que l’ADN ne pénètre l’enceinte judiciaire, les parlementaires ont ainsi fait en sorte d’imposer cette nouvelle expertise comme une évidence, la plaçant ainsi hors de portée de toute critique. Le généticien Alec Jeffreys, qui est généralement crédité pour le développement de cette technique, admettra ainsi à l’occasion d’un échange portant sur le très médiatique procès d’O. J. Simpson que l’une des méthodes (dite single locus) qui avait été mobilisée dans le cadre d’une affaire criminelle britannique n’est en réalité pas complètement prête à l’usage [20]. Les controverses qui entourent l’identification génétique sont alors loin d’être marginales. Des articles paraissent dans des revues scientifiques aussi centrales que Nature ou Science, et l’on peut y trouver le nom de biologistes respectés, parmi lesquels Richard Lewontin et Eric Lander.
Malgré leur importance et les enjeux considérables qu’ils charrient, ces débats ne franchiront jamais les portes de l’Assemblée nationale. Lorsque quelques voix critiques émergent dans le sillage de l’implémentation du FNAEG, celles-ci sont généralement reléguées et, en tout état de cause, n’exercent pas d’influence majeure sur les processus parlementaires. Un bon exemple de la marginalisation des critiques méthodologiques adressées à l’expertise ADN peut être fourni à partir du rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques qui portait sur « la valeur scientifique de l’utilisation des empreintes génétiques dans le domaine judiciaire » (2001). Figure en effet en annexe de ce rapport une analyse statistique qui a été communiquée à l’Office par deux chercheurs suisses en criminalistique. La conclusion de leur travail est tout à fait explicite et ne saurait porter à confusion. Selon eux, « l’évaluation de la preuve scientifique est souvent limitée, simpliste et parfois erronée » [21].
Le député RPR Christian Cabal, qui a dirigé et signé ce travail de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, ne peut donc pas ignorer que des critiques existent à propos des usages judiciaires de l’expertise génétique. Pourtant, seulement un mois avant la parution de ce rapport, celui-ci soumet une question parlementaire en faisant complètement abstraction de ces doutes, vantant au contraire le caractère fiable de cet outil et sa nécessaire extension :
« Nous sommes malheureusement très en retard. Une loi a été votée, il y a près de trois ans, mais une loi trop restrictive, Madame la garde des Sceaux. Deux ans plus tard, un décret a été publié, après de nombreuses interventions de parlementaires, dont moi-même, ici, auprès de Mme Guigou, il y a un an. Depuis, on a l'impression que la marche est lente, trop lente, en tout cas. Les informations publiées dans la presse nous indiquent que le fichier des empreintes génétiques, élément essentiel de l'architecture, risque malheureusement d'attendre encore près d'un an avant d'être opérationnel. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire – les enquêteurs, les magistrats, les avocats – que cette technique est incomparable, qu'elle permet d'identifier les criminels mais aussi d'innocenter des personnes suspectées à tort. » [22]
Le cas français n’est à cet égard pas exceptionnel, bien que l’ampleur de la marginalisation des critiques soit tout de même notable. Des phénomènes similaires ont également été documentés au Canada [23] et en Belgique [24], pays dans lesquels le caractère fiable de l’identification génétique a également été très tôt tenu pour acquis, contrairement à ce qu’on pouvait observer du côté des États-Unis ou bien au Royaume-Uni. L’analyse des questions parlementaires révèle en tous les cas le rôle central que les faits divers, en particulier de nature sexuelle, ont pu jouer à cette occasion. Ce gouvernement par la peur [25] a en effet conduit à faire passer l’ADN comme une solution technique indispensable à la lutte contre certaines formes de délinquance. La question demeure néanmoins de savoir si les belles promesses des parlementaires ont été tenues.
Contact : julien.larregue@ulaval.ca
[1] E. Supiot (ed.), Le procès pénal à l’épreuve de la génétique, Mission de recherche Droit et Justice, 2017 [en ligne] ; B. Py, L’utilisation des caractéristiques génétiques dans les procédures judiciaires. Étude de dix années de pratiques en Meurthe-et-Moselle (2003-2013), Mission de recherche Droit et Justice, 2017 ; J. Vailly (ed.), Sur la trace des suspects. L’incorporation de la preuve et de l’indice à l’ère de la génétique, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2021.
[2] V. par ex. P. Reviron, L’ADN : la preuve parfaite ?, in AJ pénal, septembre 2012, no 11, p. 590‑591 ; P. Reviron, L’avocat à l’épreuve de l’ADN, in AJ pénal, février 2018, no 2, p. 73‑76.
[3] Sh. Jasanoff, The Eye of Everyman: Witnessing DNA in the Simpson Trial, in Social Studies of Science, Sage Publications, Inc., 1998, vol. 28, no 5‑6, p. 713‑740 ; J. D. Aronson, Genetic Witness: Science, Law, and Controversy in the Making of DNA Profiling, Rutgers University Press, 2007 ; M. Lynch, S. A. Cole, R McNally, and K. Jordan, Truth Machine. The Contentious History of DNA Fingerprinting, University of Chicago Press, 2009.
[4] M. Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, Cour de Louvain, Fabienne Brion et Bernard E. Harcourt (ed.), Presses universitaires de Louvain, University of Chicago Press, 2022.
[5] J. Larregue, La « vérité », l’ADN et l’avocat pénaliste. La mise en scène de la crédibilité dans le champ juridique, in Sociétés contemporaines, 2020, no 118, p. 133‑165 ; J. Larregue, La révolution tranquille de l’ADN : questionner les usages judiciaires de la génétique à l’Assemblée nationale, in Mots. Les langages du politique, 2022, no 130.
[6] C. Ginzburg, Clues: Roots of a Scientific Paradigm, in Theory and Society, Springer, 1979, vol. 7, no 3, p. 273‑288.
[7] J. R. Gusfield, The Culture of Public Problems: Drinking-Driving and the Symbolic Order, University of Chicago Press, 1984.
[8] Assemblée nationale, séance du 30 septembre 1997, compte rendu intégral, p. 13.
[9] A.-L. Nicot, La démocratie en questions. L’usage stratégique de démocratie et de ses dérivés dans les questions au gouvernement de la 11e Législature (1997-2002), in Mots. Les langages du politique, 2007, no 83, p. 9 [en ligne].
[10] O. Rozenberg, Sh. Martin, Questioning Parliamentary Questions, in The Journal of Legislative Studies, 2011, vol. 17, no 3, p. 394‑404 ; V. Dubois et M. Lieutaud, La « fraude sociale » en questions, in Revue francaise de science politique, 2020, vol. 70, no 3, p. 341‑371.
[11] Ce ratio a été calculé à l’aide de la formule suivante : (Questions ADN / Total des questions posées à l’Assemblée nationale)*100.
[12] M. Reinert, Alceste une méthodologie d’analyse des données textuelles et une application : Aurelia De Gerard De Nerval, in Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique, 1990, vol. 26, no 1, p. 24‑54 ; M. Marpsat, La méthode Alceste, in Sociologie, 2010, vol. 1, no 1 [en ligne].
[13] J.-D. Aronson, DNA fingerprinting on trial: the dramatic early history of a new forensic technique, in Endeavour, 2005, vol. 29, no 3, p. 126‑131.
[15] P. Martin, N. Brown and A; Turner, Capitalizing hope: the commercial development of umbilical cord blood stem cell banking, in New Genetics and Society, 2008, vol. 27, no 2, p. 127‑143 ; P-B. Joly, On the Economics of Techno‐scientific Promises (dir. Madeleine Akrich et a.), in Débordements. Mélanges offerts à Michel Callon, Presses des Mines, 2010, p. 203‑222.
[16] R. Cos, La carrière de « la sécurité » en milieu socialiste (1993-2012). Sociologie d’une conversion partisane, in Politix, 2019, no 126, p. 135‑161 [en ligne].
[18] M. Perrot, Fait divers et histoire au XIXe siècle, in Annales, Histoire, Sciences Sociales, 1983, vol. 38, no 4, p. 911‑919 [en ligne] ; L. Mucchielli, Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, La Découverte, 2016.
[19] G. Sarre, Exposé des motifs, Proposition de loi visant à l’extension du fichier national des traces et empreintes génétiques par ADN, n° 2316, 4 avril 2000 [en ligne].
[20] J.D. Aronson, DNA fingerprinting on trial, précit., p. 129.
[21] P. Mangin et F. Taroni, L'évaluation de la ‘preuve génétique’ (ADN) en criminalistique et l'utilisation des probabilités, in La valeur scientifique de l'utilisation des empreintes génétiques dans le domaine judiciaire, Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, 2001, p. 123.
[23] M. Dufresne et D. Robert, Les effets de vérité du discours de l’ADN pénal au Canada, in Criminologie, Les Presses de l'Université de Montréal, 2008, vol. 41, no 1, p. 83‑102 [en ligne].
[24] B. Renard, L’identification génétique et la discrétion des controverses scientifiques dans son usage par la justice pénale, in Déviance et Société, 2013, vol. 37, no 3, p. 289‑303 [en ligne].
[25] J. Simon, Governing through crime: How the war on crime transformed American democracy and created a culture of fear, in The British Journal of Criminology, Oxford University Press, 2007.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482600
[Brèves] Plafond annuel de la Sécurité sociale pour 2023 : le BOSS précise une augmentation de 6,9 % au 1er janvier 2023
Réf. : Communiqué du 10 octobre 2022, Plafond de la Sécurité sociale
Lecture: 1 min
N2904BZL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 12 Octobre 2022
► Dans un communiqué daté du 10 octobre 2022, le BOSS est venu préciser que le plafond de la Sécurité sociale augmentera de 6,9 % au 1er janvier 2023.
Le plafond n’avait pas été modifié depuis trois années. L’augmentation prend en compte l’évolution du salaire moyen par tête depuis 2019, en application des dispositions de l’article D. 242-17 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L3886L73.
Le plafond de la Sécurité sociale correspond au montant maximal des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations, principalement les cotisations d’assurance vieillesse de base, et sert également de référence pour la définition de l’assiette de certaines contributions et le calcul des droits sociaux.
Un arrêté publié au Journal officiel reste à venir.
La modification sera intégrée au chapitre 6 de la rubrique « Assiette générale » au 1er janvier 2023.
Les valeurs du plafond de la Sécurité sociale pour 2023 seront alors les suivantes :
|
Annuel |
43 992 € |
|
Trimestriel |
10 998 € |
|
Mensuel |
3 666 € |
|
Quinzaine |
1833 € |
|
Hebdomadaire |
846 € |
|
Journalier |
202 € |
|
Horaire |
27 € |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482904
