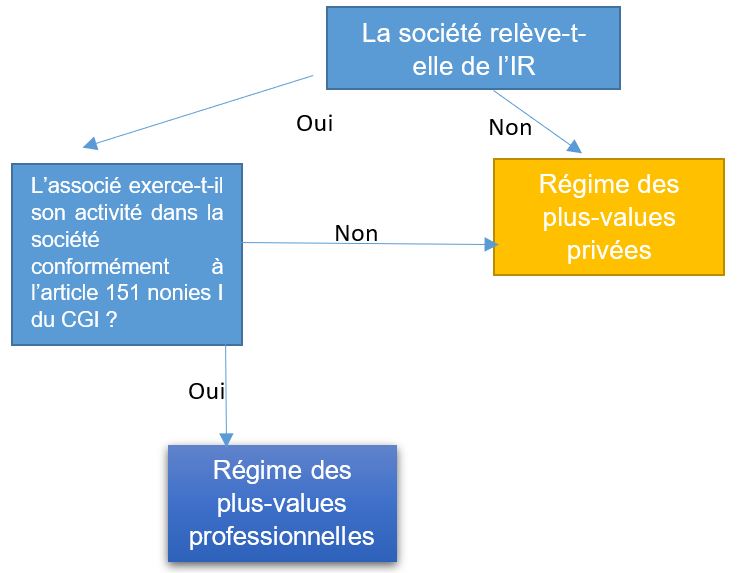[Brèves] Prévention de la récidive terroriste et réinsertion : publication de deux décrets
Réf. : Décrets n° 2022-358 N° Lexbase : L9034MB9 et n° 2022-359 N° Lexbase : L9030MB3, du 14 mars 2022, relatif à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Lecture: 7 min
N0768BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
Le 22 Mars 2022
► Parus au Journal officiel du 15 mars 2022, les décrets n° 2022-358 et n° 2022-359 du 14 mars 2022 précisent les modalités de mise en œuvre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue par les articles 706-25-16 à 706-25-21 du Code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement N° Lexbase : Z80686TH.
Cet article 6 de la loi n° 2021-998 avait créé une mesure judiciaire applicable aux auteurs d’infractions terroristes, décidée à l’issue de leur peine en considération de leur particulière dangerosité, afin de les soumettre à certaines obligations, en vue de prévenir la récidive et d’assurer leur réinsertion.
Demande d’informations sur la situation de l’intéressé. Le décret n° 2022-358 crée un chapitre relatif à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, lequel détermine les conditions dans lesquelles le procureur de la République antiterroriste demande au chef d’établissement pénitentiaire et au JAP compétent de lui transmettre les éléments concernant la situation pénale, personnelle, sociale et familiale de l’intéressé. Le texte précise que les décisions et rapports relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont la personne concernée a pu bénéficier pendant l’exécution de sa peine sont également communiqués (C. proc. pén., art R. 50-70).
Saisine pour avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Ce même chapitre prévoit que lorsque le prononcé d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion lui parait pertinent, le procureur de la République antiterroriste saisit concomitamment la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, en informe le JAP compétent et communique au tribunal de l’application des peines les éléments relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont a été mis en mesure de bénéficier l’intéressé pendant l’exécution de sa peine (C. proc. pén., art R. 50-71).
Placement au centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire. Le président de la commission est chargé de demander le placement de la personne concernée dans le centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire (C. proc. pén., art R. 50-73). La durée du placement est déterminée par l’administration pénitentiaire et ne peut ni être inférieure à six semaines, ni excéder douze semaines. À l’issue du placement, le centre transmet un rapport d’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité à la commission pluridisciplinaire.
Évaluation de la dangerosité du condamné. La commission pluridisciplinaire est chargée de procéder à l’évaluation de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer. Un article R. 50-72 du Code de procédure pénale fixe sa composition. La commission peut procéder ou faire procéder sur l’ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles. Elle peut également demander la comparution de la personne condamnée. Cette comparution est de droit si la personne condamnée en fait la demande. L’intéressée peut être assistée de son avocat (C. proc. pén., art R. 50-74).
Avis de la commission pluridisciplinaire. À l’issue de la période de placement de l’intéressé, la commission rend un avis motivé sur l’opportunité de prononcer une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion au regard de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer. Cet avis est transmis au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée (C. proc. pén., art R. 50-75).
Détermination de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. Le tribunal de l’application des peines de Paris saisit le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de détention de l’intéressé qui lui communique des propositions de mesures propres à favoriser la réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Le tribunal ordonne ensuite la prise en charge de la personne soumise à la mesure judiciaire retenue et désigne, dans sa décision, l’établissement concerné ainsi que la durée (C. proc. pén., art R. 50-76 et R. 50-78). L’intéressé ou son avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier de la procédure ou le consulter au greffe du tribunal de l’application des peines de Paris (C. proc. pén., art. R. 50-77).
Suivi de la mesure. Le JAP du tribunal judiciaire de Paris mandate le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent pour veiller au respect des obligations auxquelles l’intéressé est assujetti. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat lequel tient un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l’intéressé et son avocat au greffe du JAP.
Adaptation de la mesure. La personne concernée peut informer à tout moment le JAP de l’évolution de sa situation. Le magistrat peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider d’office, par une ordonnance motivée d’adapter les obligations auxquelles la personne est astreinte « afin de faciliter l'exécution de la mesure et de garantir la réalisation des buts poursuivis ». Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.
Demande de mainlevée ou de modification de la mesure. Ces demandes doivent être adressées par la personne concernée au tribunal de l’application des peines de Paris. Les articles R. 50-81 et R. 50-82 du Code de procédure pénale précisent les délais et conditions dans lesquels les demandes de mainlevée et de modification de mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peuvent être formulées et les conditions dans lesquelles il doit y être répondu.
Renouvellement de la mesure. L’article R. 50-83 vient préciser les conditions du renouvellement de la mesure. Après saisine de la commission pluridisciplinaire par le procureur de la République antiterroriste, l’avis de la commission doit être rendu trois mois au moins avant la fin de la mesure et le tribunal de l’application des peines de Paris doit se prononcer avec l’expiration de la mesure dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu’il ordonnance une mesure.
Suspension de la mesure supérieure à six mois. Dans cette hypothèse, lorsque la mesure est suspendue en raison de la détention de l’intéressé, le procureur de la République antiterroriste saisit le tribunal de l’application des peines de Paris avant la cessation de la détention, aux fins de confirmation de la reprise d’une ou de plusieurs des obligations de la mesure (C. proc. pén., art. R. 50-84).
Recours contre les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris. Les décisions du tribunal mentionnées au chapitre ainsi créé peuvent être attaquées par la voie de l’appel (C. proc. pén., art. R. 50-85).
Le décret n° 2022-359 précise quant à lui les règles de procédure applicables devant le tribunal de l’application des peines de Paris compétent pour la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue par les articles 706-25-16 N° Lexbase : L4181L7Y à 706-25-21 N° Lexbase : L4178L7U du Code de procédure pénale (C. proc. pén., art. D. 47-6-16 et D. 47-6.17).
| Pour aller plus loin : A. Léon, Publication de la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : les principaux apports, Lexbase Pénal, septembre 2021 N° Lexbase : N8519BY8. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480768
[Textes] L’entrepreneur individuel nouveau
Réf. : Loi n° 2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L3215MBP
Lecture: 35 min
N0750BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Bastien Brignon, Maître de conférences - HDR à Aix-Marseille Université, Directeur du master professionnel Ingénierie des sociétés et Henri Leyrat, Docteur en droit, chercheur associé au CMH (UPR 4232) UCA, AUREP
Le 17 Mars 2022
Le présent article est issu d’un dossier spécial intitulé « La réforme de l'entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022 » et publié dans l’édition n° 709 du 17 mars 2022 de la revue Lexbase Affaires. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici N° Lexbase : N0787BZ8.
Mots-clés : entrepreneur individuel • nouveau statut • patrimoine personnel • patrimoine professionnel • transfert universel du patrimoine professionnel • TUPP
La loi n° 2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante crée un nouveau statut de l’entrepreneur individuel avec l’instauration d’un patrimoine professionnel, automatiquement distinct de son patrimoine personnel. Dans le même temps, la loi crée également le transfert universel du patrimoine professionnel dit « TUPP ».
1. Traditionnellement, l’on enseigne aux étudiants la théorie de l’unicité du patrimoine selon laquelle chaque personne physique ou morale dispose d’un patrimoine unique, permettant ainsi de justifier, conformément aux articles 2284 N° Lexbase : L1112HIZ et 2285 N° Lexbase : L1113HI3 du Code civil, qu’il constitue le gage commun et général des créanciers, et même de tous les créanciers, qu’ils soient personnels ou professionnels.
Tirée des travaux d’Aubry et Rau [1], cette thèse, qu’ils mirent en exergue en matière de transmission successorale, connaît pour autant des exceptions notables. Parmi celles-ci figure bien évidemment l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, aujourd’hui qualifiée d’acceptation à concurrence de l’actif net (C. civ., art. 787 N° Lexbase : L9860HNI), dont les auteurs strasbourgeois avaient évidemment noté le caractère dérogatoire à l’unicité du patrimoine.
2. Par la suite, le législateur a consacré certaines exceptions à ce principe telles que le contrat de fiducie (C. civ., art. 2011 N° Lexbase : L6507HWW), ainsi que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL ; v. C. com., art. L. 526-6 N° Lexbase : L2004IPW et s.). Dans ces deux cas de figure, la loi a prévu un patrimoine affecté distinct du patrimoine principal de la personne physique ou morale. Ainsi, s’agissant de la fiducie, le fiduciaire détient-il le patrimoine fiduciaire séparé de son patrimoine personnel. Avant cela, on se souvient de la création de la SARL unipersonnelle en 1985 (loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 N° Lexbase : L2051A4Q) et de la possibilité de procéder, pour tous les entrepreneurs individuels, à une déclaration notariée d’insaisissabilité (« DNI ») relative à leur résidence principale, dès 2003 (loi n° 2003-721 du 1er août 2003 N° Lexbase : L3557BLC), laquelle insaisissabilité est devenue automatique avec la loi « Croissance » du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC), la DNI perdurant toutefois pour les autres droits que l’entrepreneur détiendrait sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affectés à un usage professionnel.
3. Parachevant cette évolution, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante [2], consacre un patrimoine d’affectation automatique en prévoyant, dans un nouvel article L. 526-22 du Code de commerce N° Lexbase : L3666MBE, que chaque entrepreneur individuel se trouve titulaire d’un patrimoine personnel et d’un patrimoine professionnel et ce, sans aucune formalité. L’objectif de cette loi est clair : cantonner le gage des créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel à ses seuls actifs professionnels, lui assurant ainsi la protection de ses biens personnels [3], au premier rang desquels sa résidence principale.
4. À cette occasion, le législateur fait le choix de rendre désormais impossible l’affectation d’un patrimoine professionnel à un EIRL [4], mettant ainsi un terme à ce statut, ce qui n’étonnera pas tellement il était moribond. Cependant, les EIRL en cours ne sont pas remis en cause, de sorte qu’il n’y a en principe pas à craindre, espérons-le, de taxation immédiate de la plus-value latente liée à l’option à l’impôt sur les sociétés que tel ou tel EIRL aurait pu formuler. En effet, et la mesure avait été prise précisément pour « booster » le choix en faveur de ce statut, les EIRL peuvent, s’ils le souhaitent, exercer l’option pour l’impôt sur les sociétés [5], conformément à l’article 1655 sexies du CGI N° Lexbase : L9082LNP. Sa mise en œuvre s’accompagne en principe d’une constatation d’une plus-value taxable placée en report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI N° Lexbase : L5581MAX [6]. La loi du 14 février 2022, en ce qu’elle ne permet plus de constituer des EIRL tout en autorisant les EIRL en cours à conserver ce statut, au demeurant non abrogé, n’est pas de nature à déclencher la taxation à plus-value sus-évoquée [7].
5. Par ailleurs, et sans doute afin de laisser aux praticiens le temps de se familiariser avec cette innovation considérable, et de permettre de préparer le décret d’application, ce nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur, vraisemblablement, le 15 mai 2022, soit trois mois après la promulgation de la loi au Journal officiel [8]. En effet, l’article 19, I, de la loi du 14 février 2022 dispose que : « Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du Code de commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi […] ».
La loi a été publiée au JO du 15 février mais a été promulguée le 14 février. Puisqu’elle retient la promulgation comme point de départ du délai de trois mois et qu’elle indique qu’elle entre en vigueur à la fin de ce délai de trois mois, on peut raisonnablement penser que les articles 1er à 5 de la loi entrent en vigueur le 15 mai 2022.
6. Quoi qu’il en soit, s’il est clair que l’objectif d’instaurer une scission entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à travers un nouveau statut unique est louable (I), le législateur est allé plus loin en organisant les modalités nouvelles d’un transfert universel de patrimoine professionnel dit « TUPP » (II).
I. Le nouveau statut unique d’entrepreneur individuel
7. Le cœur de la matière figure dans le nouvel article L. 526-22 du Code de commerce N° Lexbase : L3666MBE, lequel fait le choix bienvenu de définir l’entrepreneur individuel comme « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes » (C. com., art. L. 526-22, al. 1er). Il crée ainsi le principe d’un patrimoine professionnel, automatiquement distinct du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (A), tout en prévoyant certaines exceptions (B).
A. Un entrepreneur individuel titulaire de deux patrimoines
8. La première mesure du « Plan Indépendants » dévoilé en septembre 2021 par l’équipe d’Alain Griset avait pour objectif de créer un statut unique et protecteur pour l’entrepreneur individuel. Elle était formulée ainsi : « Le plan en faveur des indépendants instaure ainsi un statut unique pour l’entrepreneur individuel. La mise en place de ce statut unique impliquera la suppression du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Il n’y aura donc plus qu’un seul statut juridique contre deux actuellement. Ce statut unique permettra que l’ensemble du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel devienne par défaut insaisissable par les créanciers professionnels, sauf si l’entrepreneur en décide autrement. Dorénavant, seuls les éléments nécessaires à l’activité professionnelle de l’entrepreneur pourront être saisis en cas de défaillance professionnelle. C’est une avancée juridique considérable qui permet d’éviter la "double peine" pour l’entrepreneur qui, en plus de difficultés professionnelles, devait gérer un risque sur son patrimoine personnel. Cette réforme concernera toutes les créations d’entreprises après l’entrée en vigueur de la loi. Pour les entreprises déjà créées avant la réforme, la protection ne s’appliquera qu’aux nouvelles créances. Par ailleurs, le statut unique offrira aux entrepreneurs la possibilité d’opter pour un assujettissement à l’impôt sur les sociétés ».
9. Dans son second alinéa, le nouvel article L. 526-22 du Code de commerce prévoit de distinguer le patrimoine professionnel, comprenant « les biens, droits, obligations et sûretés » dont il est titulaire et qui sont utiles à son ou ses activités professionnelles indépendantes, du patrimoine personnel lequel comprend les autres biens. Le texte précise, en outre, que le patrimoine professionnel ne peut être scindé. Dès lors, et dans le prolongement de cette dualité de patrimoines, la suite du texte précise que, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil et sans préjudice au principe d’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 526-1 N° Lexbase : L2000KG8), les biens utiles au patrimoine professionnel constituent le gage des créanciers professionnels, tandis que les autres biens constituent le gage des créanciers personnels.
10. Ces propos appellent quatre remarques.
11. Premièrement, alors que le législateur avait opté dans l’EIRL pour la notion d’affectation au patrimoine professionnel (C. com., art. L. 526-6, al. 1er), il est simplement question ici d’utilité au patrimoine professionnel. C’est le critère qui a été finalement retenu alors que le Sénat proposait, on s’en souvient, que ce patrimoine devait accueillir les biens « exclusivement utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ». Il s’agira certainement des éléments courants de l’entreprise individuelle tels qu’un fonds de commerce ou un fonds artisanal par exemple, mais également des immeubles dès lors qu’ils sont nécessaires et utiles à l’exploitation, ce qui est fréquemment le cas des exploitants agricoles [9]. Bien évidemment, il ne saurait être question ici de raisonner d’un point de vue comptable ou fiscal. Ainsi, des biens inscrits au bilan de l’entreprise individuelle, mais non utiles à l’exploitation, n’ont pas à être compris dans le patrimoine professionnel. À l’inverse, des biens utiles à l’activité professionnelle, mais non inscrits au bilan de l’entreprise, doivent figurer dans ce patrimoine.
Au demeurant, il nous semble, qu’en pratique, les biens, dès lors qu’ils sont jugés utiles par l’entrepreneur, devraient figurer à son bilan [10], étant observé cependant que la charge de la preuve de ce caractère utile est bien supportée par l’entrepreneur « pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier ». Pour autant, cette notion d’utilité, nullement définie par le texte, devrait s’entendre des biens servant à « la réalisation de l’activité professionnelle indépendante » [11]. La question des biens mixtes devra bien être tranchée également, peut-être à l’occasion du décret d’application prévu [12].
12. Deuxièmement, même si le texte ne vise pas expressément les dettes, l’on voit mal de quelle manière elles pourraient être exclues du patrimoine professionnel, dès lors qu’elles ont été contractées pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle, et, partant, qu’elles sont utiles à l’activité [13]. En effet, l’effet de levier du crédit, dans un environnement à taux bas, fait de la dette bancaire un élément nécessaire à l’exploitation.
13. Troisièmement, les biens communs sont laissés à la gestion des époux selon les règles de leur régime matrimonial (C. com., art. L. 526-26, nouv. N° Lexbase : L3670MBK). Si l’on prend ainsi le cas d’un fonds de commerce commun figurant dans le patrimoine professionnel de l’époux exploitant, sa cession relèvera nécessairement de la cogestion par application de l’article 1424 du Code civil N° Lexbase : L2300IBS. Il n’y a donc aucune révolution en la matière.
14. Quatrièmement, le nouvel article L. 526-23 du Code de commerce N° Lexbase : L3667MBG fait naître la distinction entre les deux patrimoines à compter de la date d’immatriculation de l’entrepreneur au registre dont il relève [14]. C’est donc à cette date que les créanciers se voient distinguer en deux catégories : les créanciers personnels et les créanciers professionnels. Cela étant, plusieurs hypothèses sont plausibles, si bien que le texte lui-même envisage divers cas de figure :
- si l’entrepreneur individuel relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d'immatriculation la plus ancienne ;
- si la date d'immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d'activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d'activité, étant précisé que le décret d’application devra en prévoir les conditions ;
- à défaut d'obligation d'immatriculation (cas des professionnels libéraux exerçant à titre individuel), la dérogation court à compter du premier acte qu'il exerce en qualité d'entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.
Concrètement, ce nouveau statut de l’entrepreneur individuel s’appliquera à celles et ceux qui déclarent une activité en tant qu’indépendant à compter du 15 mai 2022 [15], ainsi qu’à celles et ceux qui sont déjà des entrepreneurs individuels mais uniquement pour les créances qui naissent à compter de cette date [16], celles nées avant restant soumises au droit antérieur.
15. Enfin, bien que la mesure ne soit pas prévue par la loi sous commentaire mais est issue de la loi de finances pour 2022 (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 N° Lexbase : L3007MAM), il faut évoquer l’option à l’impôt sur les sociétés que l’entrepreneur individuel pourra exercer. Cette mesure, jadis réservée exclusivement aux EIRL, peut aujourd’hui être exercée par tous les entrepreneurs individuels, étant précisé que cette possibilité ne sera en vigueur que lorsque le nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel le sera, c’est-à-dire soit le 14 soit le 15 mai [17].
16. Ainsi, l’article 13 de la loi de finances pour 2022, modifiant l’article 1655 sexies du CGI, crée un mécanisme d’option pour l’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL (ou à une EARL pour les exploitants agricoles). Plus exactement, ce texte prévoit que l’option pour l’assimilation sur le plan fiscal à une EURL (société unipersonnelle à responsabilité limitée) est réservée aux entrepreneurs individuels exerçant une activité relevant, de plein droit ou sur option, d’un régime réel d’imposition dans les catégories des bénéfices non commerciaux (BNC), des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA). Par exemple, les professionnels libéraux exerçant en nom propre pourront se placer sous le régime de l’IS (impôt sur les bénéfices des sociétés).
17. Pour rappel, cette option permet de bénéficier des atouts de l’IS et notamment des règles favorables en matière de base d’imposition (déduction de la rémunération du libéral de son bénéfice imposable à l’IS, possibilité de pratiquer des amortissements, de déduire des provisions ou encore de réinvestir les bénéfices à un moindre coût fiscal au sein de l’entreprise) et de taux d’imposition. Le taux de l’IS pour les PME est de 15 % sur les premiers 38 120 euros de bénéfices puis de 25 % au-delà en 2022. Ces taux doivent être mis en comparaison avec le barème progressif de l’impôt sur le revenu où la tranche de 30 % est applicable à partir de 26 070 euros de revenu imposable pour une part. De plus, l’IS augmente la capacité d’investissement de l’entreprise et favorise le financement des projets professionnels en réduisant in fine la durée de remboursement de l’emprunt souscrit par rapport aux entrepreneurs soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
18. Il est important également d’indiquer que l’option pour l’assimilation à une EURL entraîne les conséquences d’une cessation d’activité, c’est-à-dire l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu des bénéfices et plus-values de l’exercice en sursis d’imposition ainsi que des créances émises et non encore recouvrées. En outre, pour faire suite à l’exercice de l’option pour l’IS, l’entrepreneur devra tenir une comptabilité d’engagement et sa rémunération sera une charge déductible selon le régime du gérant majoritaire (CGI, art. 62 N° Lexbase : L2354IBS). Des cotisations sociales sur dividendes au-delà du versement de 10 % du montant du bénéfice net imposable sont applicables.
19. Il sera par conséquent bientôt possible pour tous les entrepreneurs individuels d’opter pour l’assimilation à une EURL et bénéficier de l’impôt sur les sociétés. Cette première option est irrévocable alors que l’option pour l’IS pourra être révoquée dans les cinq ans suivant l’option. En cas de révocation de l’option pour l’IS, l’indépendant sera assimilé à une EURL à l’IR.
20. Protection automatique du patrimoine personnel, option pour l’IS possible, on voit ainsi que les critères qui pouvaient motiver un entrepreneur individuel à passer en société – à savoir la séparation des patrimoines personnel et professionnel et la fiscalité – seront demain possibles précisément sans constituer de société. Le vieux débat de l’exercice d’une activité en nom propre ou en société se trouve quelque peu relancé.
21. Toutefois, il nous semble qu’en l’état le texte est trop récent pour susciter un enthousiasme sans retenu. D’une part, d’un point de vue juridique et civiliste, si la distinction entre le patrimoine personnel et celui professionnel est certaine dans son principe, elle demeure encore assez floue tant dans son contenu que dans sa mise en œuvre. D’autre part, d’un point de vue fiscal, l’option pour l’IS exercée par l’entrepreneur individuel n’est pas différente de celle d’une société à l’IS en ce sens qu’elle s’accompagne des mêmes avantages mais aussi des mêmes inconvénients, dont la constatation d’une plus-value placée en report voire en sursis. Pour que l’option pour l’IS soit intéressante pour l’entrepreneur individuel, il aurait fallu prévoir un régime de faveur, ce que ni la loi du 14 février 2022 ni la loi de finances pour 2022 n’ont envisagé.
B. Les exceptions à la distinction entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel
22. Du fait de la scission de principe entre les deux patrimoines, il aurait pu être tentant pour l’entrepreneur individuel de se porter caution à hauteur de son patrimoine personnel pour une dette professionnelle et inversement. L’on se souvient d’ailleurs qu’un débat sur la validité d’une telle opération avait animé la doctrine [18]. La solution est claire s’agissant du droit nouveau : une telle opération est expressément prohibée par le nouvel article L. 526-22, alinéa 3, du Code de commerce.
23. En revanche, la loi a prévu expressément deux hypothèses générales de réunion totale ou partielle des patrimoines personnel et professionnel, la première assurant une préservation des droits des créanciers personnels et la seconde une protection des droits des créanciers professionnels.
24. S’agissant de la préservation des droits des créanciers personnels, lorsque le patrimoine personnel est insuffisant, ces derniers voient leur gage étendu au montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos de l’entreprise individuelle (C. com. art. L. 526-22, al. 6). L’on trouvait d’ailleurs déjà une application de ce principe en matière d’EIRL (C. com., art. L. 526-12, II, al. 3 N° Lexbase : L1993IPI) [19]. À première vue, une telle règle semble inutile dans la mesure où le bénéfice, une fois constaté, échappe mécaniquement du patrimoine professionnel pour intégrer le patrimoine personnel. Pour autant, l’insuffisance du patrimoine personnel permet aux créanciers personnels d’élargir leur gage au résultat net à venir dans la limite du dernier bénéfice constaté [20].
25. S’agissant de la protection des droits des créanciers professionnels, la scission des patrimoines est logiquement sans effet pour les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité (C. com., art. L. 526-22, al. 6). Toutefois, un créancier professionnel peut obtenir de l’entrepreneur individuel une sûreté conventionnelle sur son patrimoine personnel, voire une renonciation à la scission des patrimoines dans les conditions du nouvel article L. 526-25 du Code de commerce N° Lexbase : L3669MBI (C. com., art. L. 526-22, al. 4).
Cet avantage consenti par le législateur aux créanciers professionnels ne bénéficie pas aux créanciers personnels [21]. Néanmoins, il s’explique sans aucun doute par le fait que le besoin de crédit de l’entrepreneur individuel implique qu’il puisse élargir le gage qu’il a à offrir aux différents prêteurs de deniers.
Dans l’hypothèse de la renonciation à la scission des patrimoines au profit d’un créancier professionnel déterminé, le nouvel article L. 526-25 du Code de commerce prévoit un formalisme strict, assorti d’un délai de réflexion de sept jours, permettant ainsi à l’entrepreneur individuel de mesurer le risque qu’il assume à cette occasion [22]. Sur ce point, il est probable que les établissements bancaires imposent fréquemment de telles renonciations à l’entrepreneur.
26. Enfin, il est prévu deux cas particuliers emportant réunion des patrimoines : le premier a pour cause la cessation de toute activité professionnelle indépendante de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 526-22, al. 6) et la seconde a pour origine des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées par l’entrepreneur dans ses obligations fiscales ou sociales, permettant ainsi aux administration fiscale et sociale de voir leur gage élargi aux deux patrimoines (C. com., art. L. 526-24). À ce sujet, le recouvrement de l'IR, des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l'activité professionnelle dont est redevable l'entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel et ce, en dehors de toute hypothèse de fraude, sauf option pour l’IS dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du CGI. Le droit de gage des organismes de Sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133-4-7 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1999IPQ (C. com., art. L. 526-24 N° Lexbase : L3668MBH), de la même manière, sans qu’il soit nécessaire de mettre en exergue une quelconque fraude.
II. Le transfert universel de patrimoine professionnel
27. La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante ne se contente pas d’instituer un patrimoine d’affectation au profit de l’entrepreneur individuel, elle lui permet également d’en assurer la transmission universelle aussi bien à titre onéreux (A), qu’à titre gratuit (B).
A. Le transfert universel de patrimoine professionnel à titre onéreux
28. De manière tout à fait originale, la loi du 14 février 2022 crée le « TUPP », c’est-à-dire le Transfert Universel du Patrimoine Professionnel dont le siège se trouve à l’article L. 526-27 du Code de commerce N° Lexbase : L3671MBL [23]. Ce TUPP fait sans conteste écho à la TUP, c’est-à-dire la transmission universelle du patrimoine dont il tente d’adopter, pour l’essentiel, la forme et les effets, bien que le résultat ne soit pas si abouti que cela.
29. La loi répond ainsi à la mesure n° 2 du « Plan des Indépendants » d’Alain Griset destinée à faciliter le passage d’une entreprise individuelle en société, formulée en ces termes : « La vie d’une entreprise implique parfois qu’un entrepreneur ait besoin de transmettre l’intégralité de son patrimoine vers une autre structure. C’est le cas lorsqu’il veut faire évoluer son activité en passant d’une entreprise individuelle à une société. C’est également le cas lorsqu’il souhaite transmettre son entreprise à un tiers, lorsqu’il prend sa retraite ou lorsqu’il souhaite changer d’activité professionnelle. Aujourd’hui, cette transmission est complexe, ce qui est parfois dissuasif. Cette mesure permettra aux indépendants de bénéficier d’un dispositif efficace du droit des affaires, jusque-là essentiellement utilisé à l’occasion d’opérations de fusions de sociétés, pour permettre la transmission de la totalité du patrimoine professionnel en une seule opération, simple à réaliser. Le cadre de l’opération veille aux intérêts des créanciers et les contrats pourront prévoir de n’être cédés, transmis ou apportés à une société qu’après accord écrit du co-contractant ».
30. La loi a donc pour objectif de faciliter le passage de l’entrepreneur individuel en société. Est-ce réellement le cas ? Étant rappelé qu’elle devait également prévoir l’inverse, à savoir faciliter le passage d’une société à un exercice en nom propre, mais que tel ne paraît pas être le cas.
31. Par un certain côté, oui, le passage en société paraît plus aisé.
C’est ainsi qu’en vertu du nouvel article L. 526-27 du Code de commerce, l'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d'éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés. Le TUPP emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d'un apport. Sous certaines réserves, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l'apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats. Dans le cas où le cédant s'est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui-ci à titre universel, l'inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l'ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert. Le transfert de propriété ainsi opéré n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publicité, dans des conditions qui seront prévues par le décret d’application à venir.
32. Afin de donner pleine efficacité à ce régime, le nouvel article L. 526-30 N° Lexbase : L3674MBP sanctionne par la nullité le transfert si :
- il n’a pas porté sur l'intégralité du patrimoine professionnel, qui ne peut être scindé ;
- en cas d'apport à une société nouvellement créée, l'actif disponible du patrimoine professionnel ne permet pas de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;
- l'auteur ou le bénéficiaire du transfert est frappé de faillite personnelle ou d'une peine d'interdiction par une décision devenue définitive.
33. Enfin, comme pour un apport en société, sous réserve des articles L. 223-9 N° Lexbase : L7636LBG, L. 225-8-1 N° Lexbase : L5712ISD et L. 227-1 N° Lexbase : L2397LR9 du Code de commerce, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d'un apport en nature, il doit être fait recours à un commissaire aux apports (C. com., art. L. 526-31 N° Lexbase : L3675MBQ).
34. En outre, à l’instar des oppositions que des créanciers peuvent former à une TUP en droit des sociétés, les créanciers de l'entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au TUPP, dans un délai qui sera fixé par décret (C. com., art. L. 526-28 N° Lexbase : L3672MBM). L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire le transfert du patrimoine professionnel. La décision de justice statuant sur l'opposition soit rejette celle-ci, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes. Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l'entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions prévues à l'article 2284 du Code civil, sans préjudice de l'article L. 526-1 du Code de commerce.
35. Ici aussi, pour donner pleine efficacité au TUPP et faciliter sa mise en œuvre, ne lui sont pas applicables (C. com., art. L. 526-29 N° Lexbase : L3673MBN) :
- l’article 815-14 du Code civil N° Lexbase : L9943HNL (cession par un indivisaire à un tiers) ;
- l’article 1699 du Code civil N° Lexbase : L1809ABM (cession d’un droit litigieux) ;
- et les articles L. 141-12 N° Lexbase : L7275LQI à L. 141-22 du Code de commerce (cession de fonds de commerce).
Toute clause contraire à ces trois séries d’exclusion est réputée non écrite.
36. Le TUPP est-il donc de nature à favoriser le passage en société ?
37. On constate d’abord que le TUPP, qui s’inspire fondamentalement de la TUP, s’en détache assez largement. En effet, si le TUPP est possible par voie d’apport, il est également possible par voie de cession et de donation. Ensuite, ce TUPP n’est envisagé qu’au profit d’une société. Quid dès lors en l’absence de société ? Par exemple, un entrepreneur individuel qui cède son fonds à un autre entrepreneur en nom propre ou à un acquéreur qui n’entend pas exercer en société est-il soumis à ce texte ? Il semble que la réponse soit négative. En outre, le TUPP est nécessairement global, c’est-à-dire que le patrimoine ne peut être transféré que dans son intégralité et non partiellement, alors qu’en droit des sociétés il est possible de ne transférer, au moyen d’un apport partiel d’actif (« APA »), qu’une branche complète et autonome (« BCA »), ce qui ne semble pas permis dans la loi du 14 février 2022.
38. Enfin, le texte indique que le TUPP, quel qu’il soit, se fait « sans liquidation », à l’instar d’une TUP qui conduit à la dissolution d’une société mais sans sa liquidation. C’est en ce sens que le régime du passage de l’EI à la société serait facilité. Qu’il nous soit permis d’en douter et ce, pour les raisons suivantes.
39. La première est que cette absence de liquidation prévue expressément par le Code de commerce n’est pour l’heure pas prévue par le CGI. Il en résulte que l’absence de liquidation peut être problématique dans au moins deux cas : d’une part, le cas de la cession du fonds de commerce ou du fonds libéral, et d’autre part, le cas d’une TUP. Dans le cas d’une cession de fonds ou de droit de présentation de clientèle ou de patientèle, on sait que le prix de vente doit être séquestré pendant au moins 90 jours en raison de la solidarité fiscale prévue par l’article 1684 du CGI N° Lexbase : L7941LG9. Ce délai de 90 jours commence à courir au jour du dépôt de la déclaration des résultats par le vendeur du fonds ou du droit de présentation, ou bien, si la déclaration des résultats n’est pas déposée dans les temps par le vendeur (dans les 45 jours suivant la publication de la vente au journal d’annonces légales), au jour imparti pour déposer la déclaration des résultats, voire encore au dernier jour imparti pour procéder à la déclaration de cessation d’activité. S’il n’y a pas ou plus de liquidation, le calcul du délai risque d’être compliqué ; le pire serait que les 90 jours ne commencent jamais à courir ! S’agissant d’une TUP, on sait qu’un régime fiscal de faveur s’applique en vertu de l’article 210 A du CGI N° Lexbase : L9521ITS dont l’une des conditions d’application est que l’opération de fusion intervienne entre deux sociétés à l’IS. L’EI n’étant pas à l’IS, sauf si une option est exercée en ce sens, l’absence de liquidation prévue par le Code de commerce ne pourrait pas suffire pour permettre d’appliquer ledit régime de faveur.
40. La seconde raison repose sur le fait que cette absence de liquidation peut en réalité recouvrer de nombreuses hypothèses, toutes n’étant pas de nature à opérer un TUPP de manière aussi aisée qu’il y paraît, en particulier d’un point de vue fiscal.
41. On peut ainsi relever les opérations suivantes :
- tel que l’article L. 526-27 du Code de commerce est conçu, le TUPP n’est envisagé qu’en présence d’une société (bénéficiaire dudit patrimoine professionnel), ce qui est logique puisqu’il s’agit de faciliter le passage en société ; toutefois, un EI qui opterait pour l’IS sans procéder à un TUPP ne pourrait pas bénéficier du régime de faveur lié à l’absence de liquidation puisqu’en raison de l’absence de TUPP il y aurait précisément liquidation et donc taxation (placée en report d’imposition) du fait de l’option à l’IS ;
- en cas de TUPP de l’EI à l'IR vers une société à l'IR, l’absence de liquidation devrait permettre de bénéficier d’une fiscalité avantageuse ;
- en cas de TUPP de l’EI à l'IR vers une société à l'IS, bien que le texte précise qu’il n’y a pas de liquidation, étant donné que le CGI n’a pas été modifié en la matière, le régime de taxation des plus-values devrait s’appliquer pleinement ;
- en cas de TUPP de l’EI avec option à l’IS vers une société à l'IS, ici le régime de faveur de l’article 210 A du CGI devrait être applicable (régime fiscal des TUP), étant observé qu’il est conditionné à l’exercice de l’option par l’EI à l’IS avant de procéder au TUPP ;
- reste enfin le cas du passage d’un exercice en société vers un exercice individuel ; l’on nous avait promis ici aussi des souplesses : force est de constater que la loi demeure muette sur la question.
42. En outre, deux points sont encore à évoquer.
43. D’abord, la nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L. 145-16 du Code de commerce N° Lexbase : L3661MB9. Ce texte prohibe les clauses qui interdisent au locataire d’un bail commercial de céder son droit au bail en même temps qu’il cède son fonds. Néanmoins, s’il n’y a pas de fonds, de telles clauses sont valables. Sont également interdites les clauses qui font échec à la transmission d’un droit au bail dans le cadre d’une TUP. Les clauses d’agrément des bailleurs demeurent valables en toute hypothèse.
44. Pour tenir compte de la création d’un TUPP, le premier alinéa précise que sont également réputées non écrites les clauses qui interdisent la transmission du droit au bail précisément dans le cadre d’un TUPP. Les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel seront donc dorénavant réputées non écrites. Par conséquent, il ne peut être stipulé une clause interdisant de céder un bail commercial au bénéficiaire du transfert du patrimoine professionnel. Cependant, bien que le nouvel article ne le dise pas expressément, rien ne semble s’opposer à un aménagement conventionnel des cessions de baux commerciaux intervenant à l’occasion d’un transfert universel de patrimoine professionnel, au moyen par exemple d’une clause d’agrément au profit du bailleur [24].
45. Enfin, la loi de finances pour 2022, qui contient des dispositions de faveur pour les EI, en lien avec la loi du 14 février 2022, dont l’option pour l'IS, contient un mécanisme assez innovant d’amortissement du fonds commercial pour les petites entreprises [25]. Il s’agit de la mesure n° 12 du « Plan des Indépendants », « Dynamiser la reprise des fonds de commerce » : « La réglementation comptable prévoit, sous certaines conditions, la possibilité de constater la dépréciation définitive d’un fonds commercial acquis. Cependant, les règles fiscales en vigueur ne permettent pas de déduire du résultat imposable les amortissements comptabilisés. La mesure autorise temporairement la déduction fiscale de ces amortissements pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Ce dispositif permettra de réduire le coût de la reprise d’une entreprise, et de rendre les opérations de rachat de fonds commerciaux existants plus attractives pour les entrepreneurs qui s’acquitteront de leur impôt sur une base fiscale plus faible ».
46. Ainsi, pour favoriser la transmission d’entreprise en période de crise sanitaire, le législateur a donné la possibilité aux petites entreprises soumises à l’IS ou suivant le régime réel des bénéfices industriels et commerciaux de pratiquer des amortissements déductibles fiscalement sur les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 (loi n° 2021-1900, art. 23). La mesure temporaire vise donc les fonds commerciaux acquis à titre onéreux (vente ou apport) entre ces deux dates par les petites entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) et aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition et dont les résultats sont taxés dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux).
47. Plusieurs amendements ont été déposés visant à étendre ce dispositif aux libéraux relevant des BNC (bénéfices non commerciaux) ayant acquis un fond libéral. Ces derniers n’ont pas été adoptés mais il semblerait que cette extension pourrait être acceptée par l’administration et qu’elle devrait figurer dans la doctrine administrative à venir commentant ledit dispositif [26].
48. La mesure est intéressante car l’éventuel coût fiscal du passage en société, et notamment celui résultant de l’imposition des créances non recouvrées, serait limité par l’économie d’impôt sur les sociétés dont bénéficierait l’EI qui vendrait son fonds à la structure qu’il constitue ou à la structure déjà existante qu’il rejoint.
49. Cependant, si cet amortissement supplémentaire améliore la situation financière et fiscale des acquéreurs pouvant en bénéficier, il est indispensable de bien mesurer l’ensemble des conséquences de ce choix à moyen et long terme. En effet, ce choix aura une incidence fiscale lorsque l’activité sera cédée notamment si l’EI ne peut pas ensuite bénéficier d’un des dispositifs d’exonération. Quid du coût fiscal à la revente du fonds ?
B. Le transfert universel de patrimoine professionnel à titre gratuit
50. Le transfert universel de patrimoine professionnel (TUPP) à titre gratuit est visé par le nouvel article L. 526-27 du Code de commerce, lequel prévoit qu’il ne peut avoir lieu qu’entre vifs. Par conséquent, il ne peut s’agir que d’une donation universelle de patrimoine professionnel [27], d’autant plus que le nouvel article L. 526-22, alinéa 8, du même code prévoit une réunion des patrimoines en cas de décès.
51. À cela s’ajoute l’exigence formulée par la loi nouvelle selon laquelle le TUPP ne saurait avoir pour effet de scinder le patrimoine professionnel (C. com., art. L. 526-30, 1° N° Lexbase : L3674MBP). Dès lors, il sera possible pour l’entrepreneur individuel de consentir une donation universelle de patrimoine professionnel, par donation simple ou donation-partage, à la condition de ne pas le scinder. Une réserve d’usufruit pourrait également être mise en place.
52. Il s’agit donc, sur le plan du droit des successions et des libéralités, d’une figure nouvelle puisque seules existaient jusqu’ici des transmissions universelles à cause de mort. Pour autant, la donation universelle n’est rendue possible que sur le seul patrimoine professionnel et ne saurait donc être étendue au patrimoine personnel de l’entrepreneur, lequel demeure inaliénable [28].
53. Enfin, l’on regrettera l’absence de mise en concordance du TUPP à titre gratuit avec les dispositifs fiscaux, qu’il s’agisse des engagements « Dutreil » portant sur une entreprise individuelle (CGI, art. 787 C N° Lexbase : L8958IQT) ou des différents régimes applicables aux plus-values professionnelles [29].
[1] Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 5ème éd., d’après Bartin, 1917, t. 9 § 573 et s..
[2] X. Delpech, Consécration du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, Dalloz Actualité du 1er mars 2022 : « […] L’idée a été présentée en septembre dernier, par le président de la République, dans le cadre du "plan Indépendants" dont la loi du 14 février 2022 constitue la principale traduction législative (la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances pour 2022 ont été les autres véhicules législatifs de ce plan, notamment cette dernière, en ce qu’elle a institué un dispositif d’amortissement fiscal temporaire des fonds commerciaux). Elle est elle-même inspirée d’une proposition qui avait été faite il y a une petite dizaine d’années, fin 2013, dans le cadre d’une mission menée par le député Laurent Grandguillaume sur les entreprises et les entrepreneurs individuels. La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (art. 32) relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, avait repris timidement l’idée, prévoyant simplement que l’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle devait faire l’objet d’un rapport remis au gouvernement et au Parlement élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création, mais celui-ci n’a jamais vu le jour. Ce qui pouvait se comprendre car les obstacles, notamment fiscaux, à la mise en place de ce statut paraissaient difficilement surmontables (sur ce dispositif, v. P. Serlooten, La personnalisation de l’entreprise : réflexion à propos du rapport Grandguillaume, BJS 2014. 126)) ».
[3] S. Piédelièvre, Premières remarques sur la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité indépendante, JCP N, 2022, n° 9, 301.
[4] Loi n° 2022-172, art. 6 ; v. not. J.-N. Stoffel, Vers l’extinction du statut d’EIRL, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 709 N° Lexbase : N0731BZ4.
[5] La loi du 14 février 2022 ne modifie pas cette possibilité qu’elle étend même à tous les entrepreneurs individuels.
[6] BOI-BIC-CHAMP-70-30.
[7] Selon l’article 6, II, de la loi du 14 février 2022 : « À compter de la publication de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6 du Code de commerce. L'affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d'éléments de celui-ci demeurent possibles.
Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi ».
[8] Loi n° 2022-172, du 14 février 2022, art. 19.
[9] Th. Revet, La désubjectivation du patrimoine, D., 2022, p. 469, spéc. n° 10 et s.
[10] Même si l’on sait que les exploitants agricoles individuels font parfois le choix de ne pas procéder à cette inscription.
[11] Th. Revet, préc., spéc. n° 13.
[12] Le Conseil d’État a souligné que des précisions indispensables à la sécurité juridique du nouveau régime devront être apportées par voie réglementaire, s’agissant en particulier des « contours exacts de la notion de “biens utiles” à l’activité professionnelle » (doc. Assemblé nationale n° 4811, 14 décembre 2021, p. 19 [en ligne]).
[13] Rapp. Th. Revet, préc., spéc. n° 10 et 17.
[14] Notons que la loi n’offre qu’un patrimoine professionnel à l’entrepreneur individuel, même s’il exerce une pluralité d’activités indépendantes, ce qui n’est pas illogique. En effet, un travailleur indépendant, qui détient plusieurs établissements distincts, reste, du moins aux yeux de l’Urssaf, toujours le même et unique indépendant : son numéro SIREN demeure le même, pour toutes ses activités, il n’y a que le SIRET ou le code activité qui change
[15] Ou du 14 mai pour les auteurs estimant que la date d’entrée en vigueur à retenir est celle du 14 et non du 15.
[16] Ou du 14.
[17] L’article 13 de la loi de finances pour 2022 prévoit une entrée en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article fixant le nouveau statut d’entrepreneur individuel.
[18] V. N. Borga, L’EIRL et la constitution de sûretés personnelles, Bull. Joly Entrep. en diff., 2011, n° 1, p. 76 ; A. Aynès, EIRL : la séparation des patrimoines à l’épreuve du droit des sûretés, RLDC, 2011, n° 86.
[19] V. E. Dubuisson, Jcl. Entreprise individuelle, v° Fasc. 952-1 : EIRL – Constitution et modification du patrimoine affecté, 2011, spéc. n° 102.
[20] Th. Revet, La désubjectivation du patrimoine, préc., spéc. n° 23.
[21] Th. Revet, La désubjectivation du patrimoine, préc., spéc. n° 26.
[22] V. obs. S. Piédelièvre, Premières remarques sur la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, préc..
[23] F. Roussel, Transmettre une entreprise individuelle : place au transfert universel de patrimoine professionnel !, DEF, 17 février 2022, n° DEF206e3.
[24] P. Gaiardo, Cession de bail commercial et loi « activité professionnelle indépendante », Dalloz Actualité du 2 mars 2022.
[25] Ce sont celles ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : chiffre d’affaires inférieur ou égal à 12 millions d’euros, total bilan inférieur ou égal à 6 millions d’euros et nombre moyen de salariés qui ne dépasse pas 50.
[26] D. Jensen, L. Mancini et M. Warneys, Nouvelles mesures pour les indépendants : quel impact pour les avocats ?, Dalloz Actualité du 11 mars 2022.
[27] H. Leyrat et B. Brignon, La nouvelle transmission universelle du patrimoine professionnel à titre gratuit, Defrénois, 2022, à paraître.
[28] Th. Revet, La désubjectivation du patrimoine, préc., spéc. n° 33.
[29] H. Leyrat et B. Brignon, préc..
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480750
[Jurisprudence] Parenté transgenre : quand la cour de renvoi contredit la Cour de cassation
Réf. : CA Toulouse, 9 février 2022, n° 20/03128 N° Lexbase : A22987NG
Lecture: 12 min
N0756BZZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Favier, Professeur à l’Université Savoie Mont Blanc, Directeur adjoint du Centre de Recherche en Droit Antoine Favre
Le 16 Mars 2022
Mots-clés : transsexualisme • transgenre • parenté • reconnaissance
Dans une affaire jugée en 2018 par la cour d’appel de Montpellier, il avait été retenu qu’un homme devenu femme à l’état civil et ayant conçu postérieurement à son changement de sexe un enfant avec son épouse, pouvait le reconnaître en qualité de « parent biologique ». Après un arrêt de cassation rendu en 2020, l’affaire est renvoyée devant la cour de Toulouse qui, contrairement à l’analyse développée par la première chambre civile, juge dans un arrêt du 9 février 2022, que c’est bien en qualité de mère et non de père que le parent transgenre peut établir sa filiation par reconnaissance.
Un homme devenu femme peut-il valablement reconnaître l’enfant né de ses œuvres après son changement de sexe à l'état civil et dans l’affirmative, à quel titre : celui de de père ou de mère ?
Dans un arrêt du 9 février 2022, la cour d’appel de Toulouse saisie sur renvoi, remet en question la solution de la Cour de cassation qui avait statué le 16 septembre 2020 sur la détermination de la parenté d’un homme transgenre ayant naturellement conçu un enfant avec son épouse après sa transition et son changement de sexe à l’état civil en jugeant que le père devenu femme à l’état civil n’en était pas moins père de l’enfant né de ses œuvres.
Rappelons les faits : un couple de sexe différent se marie en 1999 et ont deux enfants nés en 2000 et 2004. En 2009, l’homme saisit le tribunal d’une demande de changement de sexe à l’état civil et de changement de prénom mais sans opération impliquant la perte de la fonctionnalité de ses organes sexuels masculins. Le couple, toujours marié, mais désormais de même sexe donne naissance à un enfant en 2014. Le parent transgenre procède alors à une reconnaissance prénatale d’enfant, déclarée « de nature maternelle, non gestatrice » par un acte notarié passé quelques jours avant la naissance. Sans surprise, l’officier d’état civil refuse de la transcrire comme telle dans l’acte de naissance de l’enfant. Saisi par le parent, le tribunal de Montpellier l’a débouté de sa demande de transcription de sa reconnaissance maternelle.
Dans un arrêt très remarqué, la cour d’appel de Montpellier [1] avait ordonné la transcription de la reconnaissance litigeuse du « parent biologique » c’est-à-dire sans indication de la paternité ou de la maternité de son auteur. Saisie sur pourvoi du procureur général, la Cour de cassation ne pouvait que censurer cette invention d’un troisième sexe à titre de parenté dans son arrêt rendu le 16 septembre 2020 [2], mais l’arrêt fut cassé pour violation de la loi dans des termes surprenants. En effet, pour refuser la transcription de la reconnaissance maternelle, la Cour de cassation affirme que l’homme devenu femme n’en était pas moins… père au motif qu’ « en l'état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l'état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n'est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l'enfant, mais ne peut le faire qu'en ayant recours aux modes d'établissement de la filiation réservés au père ».
Or la cour d’appel de renvoi ne s’est pas pliée à cette interprétation en jugeant au contraire qu’« en l’absence de tout conflit et de toute contradiction entre les filiations des deux parents biologiques, toutes deux de sexe féminin à l’état civil, la filiation maternelle […] sera judiciairement établie » et ordonne la transcription de la reconnaissance du parent transgenre mais... en qualité de mère.
Faut-il en tirer une forme de généralisation de la co-maternité en droit français au-delà même des frontières de l’assistance médicale à la procréation au profit de couples de femmes (I) ? En outre, la question ne doit-elle pas être posée sur le plus vaste terrain des droits fondamentaux tout à la fois du parent transgenre et de l’enfant (II) ?
I. La reconnaissance d’une co-maternité dans la parenté transgenre
Père ou mère, en quoi est-ce un problème de devoir choisir pour définir un lien de parenté aux effets pourtant strictement identiques en droit ? Les juges montpelliérains tout comme la Cour de cassation, mais avec des conclusions différentes, y avaient vu un obstacle légal. En effet, la double filiation maternelle ne peut être établie, hors adoption plénière de l’enfant, sans encourir le grief de contradiction dans le sens que lui donne l’article 320 du Code civil N° Lexbase : L8822G9M : « Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ». L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse considère l’obstacle en quelque sorte neutralisé par l’admission de la double parenté maternelle depuis la loi dite « bioéthique » du 2 août 2021. On sait que cette loi a permis et même organisé avec un effet partiellement rétroactif une double maternité par reconnaissance anticipée pour toutes les femmes en couples ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec donneur (C. civ., art. 342-10 N° Lexbase : L4373L74). Ainsi, selon ce raisonnement, la co-maternité instituée par la loi ne constitue pas un obstacle d’ordre public à la transcription d’une reconnaissance maternelle d’un enfant dont la filiation maternelle est établie par l’effet de la loi à l’égard de la femme qui accouche (C. civ., art. 311-25 N° Lexbase : L8813G9B).
Bien que reconnaissant l’existence d’un « vide juridique » en la matière, la cour de Toulouse en tire la conclusion que le double établissement d’une filiation maternelle, en dépit de l’opposition très claire de la Cour de cassation, n’est que la conséquence d’une évolution législative non prise en compte par la juridiction suprême à la date où elle avait statué (en septembre 2020) et alors même que depuis 2016 le changement de sexe d’une personne transgenre n’est plus subordonné à la preuve d’une transformation et d’une altération définitive des capacités procréatives et de l’appareil génital (C. civ., art. 61-6 al. 3 N° Lexbase : L5362LTR). Autrement dit, si la loi tout à la fois permet à une personne transgenre de procréer selon son sexe d’origine et admet le double établissement de la filiation maternelle, hors adoption plénière conjointe ou de l’adoption du conjoint (ou concubin ou partenaire depuis la récente loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption N° Lexbase : L4154MBH), l’article 320 du Code civil N° Lexbase : L8822G9M n’est plus réellement un obstacle à la transcription de la reconnaissance maternelle.
Or en l’espèce, la filiation devait être établie à l’égard du père devenu femme, qui réclamait en accord avec son épouse une co-maternité par reconnaissance. On peut noter d’ailleurs qu’en sa qualité de père et de mari de la mère, le parent transgenre aurait pu si l’on devait suivre le raisonnement de la Cour de cassation, se prévaloir d’une présomption de paternité qui aurait joué de manière automatique (C. civ., art. 312 N° Lexbase : L8883G9U).
Il est vrai que, comme le soutenait la Cour de cassation pour ne pas avoir à refuser d’établir un lien de filiation à l’égard d’un parent transgenre, fût-il le père biologique de l’enfant, il aurait été loisible à celui-ci lui d’adopter l’enfant de sa conjointe (C. civ., art. 345-1 N° Lexbase : L4404MBQ). Mais le couple s’y opposait au nom de l’intérêt de l’enfant qui, selon eux, est de faire prévaloir « la réalité de sa filiation biologique et non la fiction d’une filiation par voie d’adoption ». « … Il est vrai que cela nous ramènerait à l’époque où l’enfant dit naturel devait être adopté par ses propres père ou mère pour jouir des mêmes prérogatives qu’un enfant légitime, et plus encore lorsqu’il s’agissait d’un enfant adultérin…».
La contradiction de la solution de la Cour de cassation avec les principes du droit de la filiation apparaît plus préoccupante encore. Le parent transgenre se voit empêché d’établir une filiation qui coïncide pourtant avec la vérité biologique et l’enfant, d’avoir une filiation qui corresponde à la réalité vécue. Soit les deux éléments de la vérité en matière de filiation… et d’état civil !
De plus, selon la cour d’appel de Toulouse, ce sont également les droits fondamentaux de l’enfant comme du parent transgenre qui sont remis en cause par la solution de la Cour de cassation.
II. Le droit à l’établissement de la parenté transgenre
Le droit de de l’enfant de jouir d’une filiation conforme à la réalité vécue est au centre du problème posé dans cette affaire. Certes, l’empêchement de voir établie la filiation est relatif, dans la mesure où deux solutions s’offraient au parent transgenre pour y répondre : faire transcrire sa reconnaissance paternelle ou adopter son propre enfant. Ainsi, affirmer que l’enfant se voit privé de filiation serait donc inexact.
Toutefois, il est plus contestable au regard du respect des droits fondamentaux de lui imposer, ainsi qu’au parent transgenre, une filiation qui, soit ne correspond pas à la réalité vécue du changement de sexe de son parent dès avant sa naissance, soit revient à nier la réalité biologique de la filiation, en obligeant le parent transgenre à adopter l’enfant de son épouse comme s’il était un étranger pour l’enfant. Sur ces deux points, le droit européen des droits de l’homme au travers de la jurisprudence de la Cour européenne apporte des éléments de réponses sur le fondement des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (principe de non-discrimination) de la Convention.
En effet, le respect de la vie familiale exige que la réalité biologique et sociale prévale sur une des règles d’établissement de la filiation heurtant de front tant les faits établis que la volonté des personnes concernées [3]. Le droit de l’enfant au respect de son identité implique qu’: « au regard de l’importance de la filiation biologique en tant qu’élément de l’identité de chacun, on ne saurait prétendre qu’il est conforme à l’intérêt d’un enfant de le priver d’un lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l’enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance » [4]. En outre, contraindre le parent transgenre à afficher dans ses rapports avec les tiers comme avec l’enfant une identité de genre contraire à son identité de parent, revient à lui nier son changement de sexe dans ses implications sociales, lesquelles comprennent indéniablement la fonction parentale. Comme l’avait conclu l’avocat général, Mme Caron Deglise à propos de cette même affaire : « la désignation, dans l’acte de naissance de l’enfant, d’un sexe du parent contraire à celui figurant dans l’acte d’état civil de ce même parent porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, alors même d’une part, que les deux parents sont les parents génétiques, que d’autre part, dès sa naissance l’enfant avait deux femmes comme parents et qu’en troisième lieu, cette situation correspond à la réalité de son vécu, de celui de chacun de ses parents et de ses frères. »
Du point de vue des droits fondamentaux, la question du genre dépasse de beaucoup les droits des personnes transgenres. Au fond d’ailleurs, la parenté transgenre n’est pas si différente de la parenté tout court. Qu’est-ce qu’une parenté transgenre ? Une parenté dont la seule particularité est qu’elle rend réversible la caractérisation genrée du lien de filiation alternativement maternel ou paternel. En quoi cette caractérisation est-elle de nature à empêcher l’établissement d’une filiation et, partant, des droits et devoir qui y sont attachés ? Comme l’écrivait avec justesse Jacqueline Rubellin-Devichi, « (…) peu importe que ces parents soient juridiquement de sexe identique : les droits et devoirs des parents ne sont pas sexués, et subsistent sans altération » [5]. Dès lors le changement d’identité de genre, au moins pour la filiation établie postérieurement à la modification de l’acte de naissance, devrait être mis en cohérence avec le statut familial du parent transgenre.
C’est pourquoi il aurait été utile d’amender la réforme du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle N° Lexbase : L1605LB3, qui avait précisé à l’article 61-8 du Code civil N° Lexbase : L1867LBR que « la modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard des tiers ni sur les filiations établies avant la modification » en ajoutant : « Pour les enfants nés postérieurement à cette modification, le parent pourra faire établir sa filiation maternelle ou paternelle en fonction du sexe acquis ». En effet, s’agissant des enfants nés antérieurement au changement de sexe à l’état civil de leur père ou mère, leur vécu familial et parental est différent de celui de l’enfant né après cette modification, ce qui justifie qu’à leur égard, la situation au regard du droit au respect à la vie privée et familiale puisse être appréhendée de manière distincte.
| A retenir : l’affaire jugée par la cour d’appel de Toulouse le 9 février 2022 met en valeur une lacune de la loi du 16 novembre 2016 qui n’avait pas envisagé la situation du parent qui, changeant de sexe sans être opéré de manière irréversible, conçoit un enfant dont il peut être alternativement mère ou père, selon que l’on considère nécessaire ou pas de mettre en adéquation son genre avec sa qualité de parent et géniteur, comme le fait la cour de renvoi à rebours de ce qu’avait tranché la Cour de cassation. |
[1] CA Montpellier, 14 novembre 2018, n° 16/06059, JCP G. 2019, doctr. 215, obs. Y. Favier ; JCP G 2019, 95, note F. Vialla et J.- P. Vauthier ; JCP G 2019, act. 91, Libres propos L. Brunet et Ph. Reigné ; Dr. famille 2019, comm. 6, obs. H. Fulchiron.
[2] Cass. civ. 1, 16 septembre 2020, n° 18-50.080, FS-P+B+R N° Lexbase : A37263UK et 19-11.251, JCP 2020, doctr. 1189, obs. Y. Favier ; D. actu. 22 sept. 2020, obs. L. Gareil-Sutter ; D. 2020. 2096 , note S. Paricard ; ibid. 2072, point de vue B. Moron-Puech ; AJ fam. 2020. 534, obs. G. Kessler , obs. E. Viganotti ; ibid. 497, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; JCP 2020. 1164, note L. Brunet et P. Reigné, RTDciv. 2020, 266, obs. A.-M. Leroyer.
[3] CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, Req. 18535/91 N° Lexbase : A6635AWN.
[4] CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, Req. 58757/00 N° Lexbase : A4844DQH.
[5] Sur l’identité sexuelle : à propos du transsexualisme : Ed. AFI, 1996, p. 131.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480756
[Brèves] Droit de reprise du bailleur versus droit à prorogation du preneur pour atteindre l’âge de la retraite : dispositions censurées par le Conseil constitutionnel
Réf. : Cons. const., décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022 N° Lexbase : Z3985317
Lecture: 3 min
N0798BZL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 16 Mars 2022
► Le troisième alinéa de l'article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, est déclaré contraire à la Constitution, en ce qu’il résulte de ses dispositions que, dans le cas où le preneur s'oppose à la reprise moins de dix-huit mois avant l'expiration de la période de prorogation, le bailleur est placé dans l'impossibilité de notifier un nouveau congé, dans le délai imparti ; ces dispositions portent ainsi au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
L'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4008AE8 prévoit que le bailleur qui entend refuser le renouvellement d'un bail rural aux fins de reprise de l'exploitation doit délivrer au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, un congé présentant les motifs et les conditions de cette reprise. En application du deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du même code N° Lexbase : L4470I4C, le preneur peut toutefois s'y opposer s'il se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu pour les exploitants agricoles ou de l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. Le bail est alors prorogé de plein droit pour une durée égale à celle lui permettant d'atteindre l'âge correspondant.
Les dispositions contestées imposent au bailleur qui souhaite reprendre son bien au terme de la période de prorogation de délivrer, au moins dix-huit mois avant son expiration, un nouveau congé au preneur.
Selon le Conseil constitutionnel, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir la continuité des exploitations agricoles en s'assurant qu'à l'issue de la période de prorogation, le bailleur souhaite toujours reprendre son bien en vue de l'exploiter et remplit les conditions pour ce faire.
Toutefois, il résulte des dispositions contestées que, dans le cas où le preneur s'oppose à la reprise moins de dix-huit mois avant l'expiration de la période de prorogation, le bailleur est placé dans l'impossibilité de notifier un nouveau congé, dans le délai imparti.
Dès lors, ces dispositions portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
Abrogation différée. Les Sages relèvent qu’en l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2022 la date de l'abrogation de ces dispositions.
En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, en cas d'opposition du preneur à la reprise du bail dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur n'est pas tenu de délivrer un nouveau congé en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles si la durée de la prorogation du bail résultant de cette opposition est inférieure à dix-huit mois.
|
Pour aller plus loin : - cf. ÉTUDE : Droit de reprise du bailleur à ferme, Reprise pour exploiter du bailleur après la prorogation du bail, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9156E9Y ; - cette décision fera également l’objet d’un commentaire approfondi par Christine Lebel, à paraître prochainement dans Lexbase Droit privé. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480798
[Le point sur...] Transmission d’une exploitation agricole : quel régime fiscal de faveur utilisé ?
Lecture: 46 min
N0764BZC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jérôme Mazeres, Fiscaliste - Diplômé en gestion de patrimoine, Les fourmis du patrimoine
Le 20 Août 2024
Mots-clés : exploitation agricole • transmission d’entreprises • régime fiscal • DMTG • pacte Dutreil
Selon la chambre de l’agriculture, près d’un tiers des exploitants agricoles pourront prendre leur retraite d’ici 2026, soit environ 160 100 exploitants.
Le sujet de la transmission de l’exploitation agricole a ainsi vocation à prendre de l’importance dans les prochaines années.
La transmission de l’exploitation agricole et ses conséquences fiscales nécessitent d’intégrer plusieurs paramètres tenant notamment à la structuration juridique de l’activité, à la présence de baux, à la volonté de transmettre à des enfants repreneurs, ou encore des besoins financiers.
En fonction des stratégies adoptées, la fiscalité et les régimes de faveur pouvant être utilisés seront différents.
Cette transmission est ainsi susceptible de générer des conséquences au regard du régime des plus-values professionnelles ou privées, des droits de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit, et également au niveau de la TVA.
Nous vous proposons, sans pour autant rechercher à être exhaustifs, certaines de ces conséquences. Notre objectif consistera à vous présenter quelques dispositifs susceptibles de s’appliquer, en alertant sur certaines difficultés pratiques ou théoriques.
Nous aborderons dans un premier temps la qualification des plus-values professionnelles sur cession de titres (I). Nous aborderons ensuite, l’application des différents régimes de plus-values professionnelles et privées (II) en distinguant le cas de la cession des parts ou de l’entreprise individuelle. Nous traiterons du cas des droits de mutation à titre gratuit et du pacte Dutreil (III). Enfin, nous terminerons avec les droits de mutation à titre onéreux (IV).
I. Plus-value privée ou professionnelle en présence de cession de titres de sociétés agricoles ?
En règle générale, même si cela est de moins en moins vrai, les sociétés agricoles relèvent de l’impôt sur le revenu de plein droit.
On notera que depuis quelques années, le législateur tend à favoriser l’option pour l’impôt sur les sociétés, notamment en aménageant les conséquences de celle-ci.
Cependant, cette option peut s’avérer intéressante si l’exploitant agricole ne raisonne qu’à partir du taux d’imposition. En regardant de plus près l’assiette d’imposition, cette option peut être pénalisante dans la mesure où l’exploitant perd l’ensemble du régime de faveur propre aux bénéfices agricoles tel que : la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement (DEP), la moyenne triennale, l’étalement des revenus exceptionnels sur sept ans…
L’absence d’application de ces régimes en cas d’option pour l’impôt sur les sociétés peut expliquer pour partie, le nombre encore important de sociétés agricoles relevant de l’impôt sur le revenu.
En cas de cession de titres d’une société agricole relevant de l’impôt sur le revenu, tel qu’une SCEA ou une EARL, il est nécessaire de s’interroger sur l’activité de l’associé au sein de cette société.
En effet, si celui-ci est un « associé exploitant », conformément à l’article 151 nonies, I du Code général des impôts N° Lexbase : L9116LKT, alors les cessions de titres ou leurs donations relèveront du régime des plus-values professionnelles.
Si, il s’agit d’un associé non exploitant, alors les plus-values relèveront du régime des plus-values privées. Dans ce dernier cas, la donation des titres relevant du régime des plus-values privées ne sera pas soumise à imposition [1].
La qualification « d’associé exploitant » au regard du droit fiscal est autonome. Il est impératif que l’associé participe de manière personnelle, directe et régulière à l’activité. À titre d’exemple, l’associé gérant unique d’une société unipersonnelle peut voir les titres qu’il possède qualifier d’élément d’actif professionnel [2], alors même que la gestion aurait été confiée à tiers. La jurisprudence [3] a également pu considérer que l’associé-gérant unique, seulement un associé majoritaire, pouvait voir ses titres qualifiés de professionnels.
Plus récemment, le Conseil d’État [4] a également considéré, dans certaines situations, que les titres détenus par un associé non-gérant pouvaient être considéré comme des éléments d’actifs professionnels.
Dans cette affaire, l’associé exerçait des fonctions d’exécution dans le cadre d’un contrat de travail à hauteur de dix-huit par semaine. Les tâches de cet associé consistaient notamment dans l’accueil téléphonique de la clientèle, l’accueil des clients, la réception des commandes, la préparation des livraisons et le suivi des règlements.
On peut ainsi constater que la qualification des titres de sociétés agricoles comme constituant un élément d’actif professionnel relevant du régime des plus-values professionnelles est plus large que la notion d’associé exploitant visé à l’article L. 321-6 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3795AEB, ou de celle de gérant.
En pratique, il n’est pas rare de rencontrer des associés qui pensaient relever du régime des plus-values privées.
Attention, un associé d’une société agricole relevant du régime de l’impôt sur le revenu qui n’aurait vraiment aucune activité dans celle-ci est susceptible de relever du régime des plus-values privées.
Si on exclut le cas des plus-values immobilières, le schéma de décision entre les plus-values professionnelles et privées sur parts devrait être le suivant :
II. Différents régimes d’exonération des plus-values pour différentes situations
Ainsi, si les titres relèvent du régime des plus-values privées, alors c’est l’ensemble du régime des plus-values privées qui est susceptible de s’appliquer (A).
En présence, du régime des plus-values professionnelles, les titres pourront bénéficier des régimes spécifiques propres à cette qualification (B).
Enfin, en cas de cession de l’entreprise individuelle, là encore, le régime des plus-values professionnelles pourra trouver à s’appliquer avec quelques particularités (C).
A. Le régime des plus-values privées et la cession des titres
Le régime des plus-values privées trouvera à s’appliquer dans deux grandes situations :
- cession à titre onéreux de titres de sociétés agricoles relevant du régime de l’impôt sur les sociétés ;
- cession à titre onéreux de titres de sociétés agricoles relevant du régime de l’impôt sur le revenu, dans laquelle l’associé n’exerce pas d’activité.
Les cessions de titres recevant cette qualification sont ainsi soumises par principe au prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit une taxation globale au taux de 30 % (12,8 % d’IR, et 17,2 % de CSG/CRDS). Sur option, il est possible d’opter pour l’application du barème progressif.
Attention, l’option pour l’application du barème progressif implique de prendre plusieurs paramètres en compte :
- l’option est globale, annuelle et irrévocable ; l’option s’étend aux revenus de capitaux mobiliers ;
- la CSG en cas d’option pour le barème progressif pourra faire l’objet d’une déduction à hauteur de 6,8 % ; cependant, cette déduction est susceptible de faire l’objet d’un plafonnement selon les abattements utilisés ;
- l’option pour le barème progressif permet l’application de certains abattements ;
- l’option pour le barème progressif est susceptible d’impacter le calcul du prélèvement à la source.
Dans ces hypothèses de cession, sous réserve d’opter pour l’application du barème progressif, l’exploitant pourra utiliser les abattements pour durée de détention. Trois abattements sont susceptibles de s’appliquer, non cumulables entre eux :
Abattement de droit commun
L’abattement de droit commun, celui-ci pouvant atteindre 65 % d’abattement lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans. Entre deux et moins de huit ans de détention, l’abattement est de 50 %. Cet abattement ne s’applique que sur le montant de l’impôt sur le revenu, et non sur la CSG/CRDS. Il convient de rappeler que cet abattement ne s’applique que pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, et sous réserve d’avoir opté pour l’application du barème progressif.
Abattement renforcé sur les gains de cession de titres de moins de dix ans
L’abattement renforcé sur les gains de cession de titres de moins de dix ans, celui-ci pouvant atteindre 85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans. Entre quatre ans et moins de huit ans de détention, l’abattement s’élève à 65 %. Entre un an de détention et moins de quatre ans de détention, l’abattement s’élève à 50 %. Là encore, l’abattement s’applique au montant de l’impôt sur le revenu et non à la CSG/CRDS. Plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime, les titres doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2018, et le cédant doit avoir opté pour l’application du barème progressif. La société dont les titres sont cédés doit être une PME au sens du droit de l’Union européenne. En contrepartie de leur souscription au capital de la société, les associés ne doivent avoir reçu que des droits résultants de la qualité d’associé, à l’exclusion de toute garantie en capital ou autre avantage. La société doit être passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent. Elle doit avoir son siège dans l’espace économique européen. Elle doit exercer une activité de type agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Les titres doivent avoir été acquis ou souscrits dans les dix premières années de la vie de la société. Attention, la société ne doit pas avoir été issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’une activité préexistante.
Cette dernière condition est susceptible de poser des difficultés dans la mesure où, en pratique il est fréquent qu’une EARL ou une SCEA soit constituée à partir de l’apport d’une entreprise individuelle. En effet, si l’apport est intervenu plus de dix ans après la création de l’entreprise individuelle, le régime de faveur ne trouvera pas à s’appliquer [5].
Abattement fixe pour départ à la retraite
Le dernier abattement est un abattement fixe de 500 000 euros en cas de départ à la retraite. Cet abattement s’applique que l’associé ait opté pour le régime du barème progressif ou non. On relèvera ici que la loi de finances pour 2022 a aménagé la date de fin de ce dispositif. En effet, celui-ci devait prendre fin au 31 décembre 2022. Il s’éteindra dorénavant au 31 décembre 2024. Là encore, l’application de ce dispositif nécessite de remplir plusieurs conditions. Sans rechercher à être exhaustif quant aux conditions d’application de ce régime, certaines d’entres elles sont susceptibles de poser des difficultés.
En effet, la société bénéficiaire de ce régime doit être soumise à l’impôt sur les sociétés. De fait, les associés non exploitants des SCEA, EARL ou GAEC relevant de l’impôt sur le revenu sont exclus de ce régime.
En outre, les associés ne sont pas nécessairement et systématiquement rémunérés, surtout lorsque l’associé est également associé d’autres sociétés agricoles, ou exerce une activité de travaux agricoles.
Il convient de rappeler que le cédant doit cesser toute fonction de direction ou salariés dans la société et faire valoir ses droits à la retraite. En principe ces événements doivent intervenir dans les deux années suivant ou précédant la cession. À titre exceptionnel, la loi de finances pour 2022 a porté ce délai à trois ans, sous réserve que le cédant ait fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et que le départ en retraite intervienne avant la cession.
La cession doit porter sur l’intégralité des titres ou droits détenus par le cédant dans la société. Ou, lorsque le cédant détient plus de 50 % des droits de vote, la cession doit porter sur plus de 50 % de ces droits. L’une des difficultés peut résulter des cessions échelonnées. En effet, il n’est pas rare en pratique de constater, notamment pour des raisons d’accompagnement de l’enfant, que l’exploitant procède à la cession d’une partie des titres en plusieurs fois, ainsi qu’une donation de ceux-ci.
La chronologie des opérations peut ici revêtir une importance capitale, qui ne va pas toujours de pair avec les intentions de l’exploitant.
En effet, les juridictions du fond [6] ont pu indiquer que l’appréciation de la quotité des titres cédés est effectuée au vu des seules cessions à titre onéreux.
Les donations ne sont pas prises en compte. Ainsi, les schémas dans lesquels l’associé cède une partie des titres, donne une partie, et cède le reliquat sont susceptibles de poser des difficultés.
Comparaison entre le PFU et le barème progressif (hors CSG déductible)
| PFU | Barème progressif | ||||||
| Taux | 0 % | 11 % | 30 % | 41 % | 45 % | ||
| 12,8 % | Sans abattement | 0 % | 11 % | 30 % | 41% | 45 % | |
| 12,8 % | Avec abattement | 50 % | 0 % | 5,5 % | 15 % | 20,5 % | 22,5 % |
| 65 % | 0 % | 3,85 % | 10,50 % | 14,35 % | 15,75 % | ||
| 85 % | 0 % | 1,65 % | 4,50 % | 6,15 % | 6,75 % | ||
Schéma d’apport cession
On constate en pratique que de plus en plus d’associés de société agricole optent pour l’application de l’impôt sur les sociétés. Il convient ici de rappeler que cette option est susceptible de bénéficier d’un régime de report d’imposition visé à l’article 151 nonies III du Code général des impôts. Ces schémas trouvent à s’appliquer au cas de la SCEA. En effet, le GAEC ne peut avoir d’associé-personne morale. Au niveau de l’EARL, les associés exploitants doivent être majoritaires.
En outre, au vu de la rédaction de l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4462I4Z, le preneur à bail peut mettre à disposition les terres dont il est le fermier à une société dont il est associé exploitant. Ainsi, cela oblige ce dernier à être présent en tant qu’associé exploitant au sein de la société fille. À défaut, il s’expose à la résiliation de son bail.
Ces éléments, lorsque la société relève de l’impôt sur le revenu et que l’associé y exerce son activité sont de nature à empêcher l’application de l’article 151 nonies IV bis du Code général des impôts qui permet en cas d’apport de l’intégralité des titres de la société agricoles à une société holding de bénéficier d’un régime de report d’imposition.
Ainsi, certains praticiens, notamment pour des motifs d’organisation juridique, mais aussi d’optimisation peuvent opter pour l’application de l’impôt sur les sociétés. L’associé exploitant pourra ainsi apporter une partie seulement des titres à une société holding soumise à l’impôt sur les sociétés, avec l’application du régime de report d’imposition visé à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts N° Lexbase : L6170LU3.
Plus de trois ans après l’apport, la société holding pourra céder les titres en quasi exonération d’impôt, sauf une réintégration d’une quote-part de frais et charge de 12 % au niveau de la société holding soumise au taux de l’impôt sur les sociétés, soit une taxation effective d’un peu plus de 3 %.
B. Le régime des plus-values professionnelles et la cession des titres
Si la société agricole (SCEA, EARL, GAEC…) relève de l’impôt sur le revenu et que l’associé y exerce son activité professionnelle, alors c’est le régime des plus-values professionnelles qui trouvera à s’appliquer en cas de cession des titres.
Il convient ici de faire la distinction entre les plus-values à court terme ou à long terme. Les plus-values professionnelles à long terme sont imposées au taux de 12,8 % à l’impôt sur le revenu, et à 17,2 % à a CSG/CRDS.
En cas de cession des titres, plusieurs régimes sont susceptibles de s’appliquer :
- exonération en fonction du chiffre d’affaires (CGI, art. 151 septies) ;
- exonération en fonction de la valeur des éléments cédés (CGI, art. 238 quindecies N° Lexbase : L5680MAM) ;
- exonération pour départ à la retraite (CGI, art. 151 septies A N° Lexbase : L5580MAW) ;
- exonération des plus-values immobilières à long terme (CGI, art. 151 septies B N° Lexbase : L1142IEZ).
Ces régimes peuvent pour certains se cumuler.
Quelques difficultés concernant l’application du régime d’exonération en fonction du chiffre d’affaires
L’application de l’article 151 septies du Code général des impôts nécessite de remplir les conditions suivantes :
- l’activité agricole doit être exercée à titre professionnelle durant à minima cinq ans ;
- le chiffre d’affaires de la société doit être inférieur à 250 000 euros pour une exonération totale. Si celui-ci est compris entre 250 000 euros et 350 000 euros, l’exonération sera partielle.
La référence de chiffre d’affaires s’apprécie par rapport à la moyenne des recettes, hors taxes, réalisées au cours de deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation des plus-values.
L’appréciation du seuil d’exonération est susceptible de poser des difficultés dans plusieurs situations. Cela sera notamment le cas lorsque l’associé exploitant est également entrepreneur individuel, ou associé d’une autre société agricole soumise à l’impôt sur le revenu.
Dans ce cas, pour apprécier le seuil de 250 000 euros, il convient de faire la somme de quote-part de recettes réalisées par la société et les recettes réalisées par l’entreprise individuelle [7].
Au cas d’un couple, la doctrine administrative [8] apporte un éclairage intéressant, en cas de cession des titres. Si les parts constituent un bien commun et si chacun des époux est membre associé ou membre de la société ou du groupement, il convient de distinguer selon que ces droits ou parts sont individualisés au nom de chacun des époux ou, au contraire, que l’ensemble des parts sont détenues par la communauté. Dans le premier cas (chacun des époux étant titulaire, en tant qu'associé, d'un nombre de parts), il est fait application des règles rappelées précédemment selon la situation de l'époux dont les titres sont cédés.
Dans le second cas, et lorsqu'un seul des époux exerce son activité dans la société, la répartition de la plus-value réalisée entre la plus-value professionnelle et la plus-value des particuliers dépend des droits réels de chacun des conjoints sur la communauté.
On constate également que certaines stratégies de transmissions des titres bâtis sur le démembrement de propriété peuvent permettre de rentrer dans ce régime d’exonération. La donation temporaire de l’usufruit des titres aboutit à modifier la répartition des droits dans les bénéfices sociaux de la société au profit de l’usufruitier [9]. Il est ici impératif de justifier le démembrement temporaire afin d’éviter de tomber sous le joug de l’abus de droit.
Exonération en fonction de la valeur des éléments cédés
Afin de bénéficier de l’exonération prévue à article 238 quindecies du Code général des impôts, il convient de respecter plusieurs conditions cumulatives :
- il est nécessaire d’avoir exercé son activité professionnelle durant 5 ans au sein de la société ;
- il faut céder l’intégralité des éléments d’actifs ;
- depuis la loi de finances pour 2022, pour bénéficier d’une exonération totale, la valeur des éléments cédés ne doit pas excéder 500 000 euros ; entre 500 000 euros et 1 000 000 d’euros, l’exonération sera partielle ;
- ce régime vise les cessions à titre gratuit et à titre onéreux ;
- le cédant ne doit pas contrôler le cessionnaire du fait de la participation qu’il détient ou des fonctions qu’il y exerce.
Ces conditions doivent être satisfaites de manière continue durant les trois années qui suivent la cession, sous peine de remise en cause du régime de faveur.
Dans certaines régions, en raison de la valeur des exploitations, notamment dans le nord de la France, ce régime n’était pas nécessairement le plus utilisé en raison des anciens seuils. En effet, auparavant, l’exonération était totale dès lors que la valeur des éléments cédés n’excédait pas 300 000 euros. L’exonération était partielle dès lors que la valeur des éléments cédés était comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros. Il reste à voir comment la pratique s’emparera des modifications apportées par la loi de finances pour 2022.
En outre, il convient de rappeler que ce régime ne s’applique pas aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Il convient de porter une attention particulière sur les biens immobiliers présents à l’actif du bilan. Il n’est en effet pas rare de constater que dans un souci de diversification, un certain nombre d’exploitants ont pu loger dans la société agricole des biens immobiliers non affectés à celle-ci.
Exonération pour départ à la retraite
Là encore, plusieurs conditions doivent être remplies afin de bénéficier de l’application de l’exonération totale prévue à l’article 151 septies A du CGI :
- l’activité doit avoir été exercée pendant cinq ans à titre professionnel ;
- le cédant ne doit pas contrôler le cessionnaire ; cela implique qu’il ne détienne pas plus de 50 % des droits de vote ou dans les bénéfices sociaux du cessionnaire ;
- l’associé doit cesser toute fonction dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans suivants ou précédant la cession ; il convient ici de relever que la loi de finances pour 2022 a aménagé de façon temporaire ce dispositif ; en effet, si le départ à la retraite est intervenu avant la cession et entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le cédant disposera d’un délai de trois ans.
La date de départ à la retraite s’entend de la date d’entrée en jouissance de ses droits dans le régime obligatoire de base auprès duquel l’exploitant est affilié au titre de cette activité.
Par cessation des fonctions, il convient d’entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salarier au sein de l’entreprise ou de la société concernée. Cependant, l’administration fiscale [10] tolère sous réserve du cumul des règles emploi-retraite, que le cédant exerce une activité professionnelle dans une autre entreprise, ou qu’il exerce une activité non salariée auprès de l’entreprise cédée.
Cela permet ainsi de mettre en place des logiques d’accompagnement des repreneurs s’étalant dans le temps.
- les opérations à titre gratuit comme les donations sont exclues de ce régime.
Dans un certain nombre de situations, l’associé peut préférer céder les éléments d’actif plutôt que les titres de la société. Ici, en cas de cession de l’ « activité » par la société et sous réserve que celle-ci soit dissoute de manière concomitante, l’article 151 septies A sera susceptible de s’appliquer.
Exonération des plus-values immobilières à long terme
Les parts de sociétés agricoles à prépondérance immobilière sont susceptibles de bénéficier de l’application de l’article 151 septies B du Code général des impôts.
Ce régime permet de bénéficier d’un abattement égal à 10% par an, sur les plus-values immobilières à long terme, au-delà de 5 ans de détention.
Ainsi, au bout de 15 ans de détention, les plus-values immobilières professionnelles à long terme sont intégralement exonérées d’impôt sur le revenu.
Là encore, il est nécessaire que l’associé exerce son activité professionnelle dans la société.
Les commentaires administratifs [11] précisent : « Une société est réputée à prépondérance immobilière pour la mise en œuvre du présent dispositif lorsqu’au moment de la cession, son actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle de biens immobiliers affectés à l’exploitation de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est lui-même constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle de tels biens. Pour apprécier le seuil de 50 %, il convient de comparer la valeur réelle des seuls biens immobiliers (ou droits de sociétés ou groupements à prépondérance immobilière) affectés à l’exploitation avec la valeur réelle de l’ensemble des autres éléments d’actifs (immobiliers et non immobiliers, immobilisés et non immobilisés). Cette comparaison doit être effectuée d’après la valeur réelle des éléments d’actif au jour où la plus-value est réalisée ».
Il est là encore nécessaire de vérifier l’affectation des différents biens immobiliers.
Attention au régime de report d’imposition
Outre les régimes d’exonération, l’exploitant peut préférer avoir recours à des régimes de report d’imposition visé à l’article 151 nonies du Code général des impôts.
Notamment, en cas de donation, l’associé donateur pourra bénéficier d’un report d’imposition lorsque le donataire est une personne physique.
Ce régime de report d’imposition pourra se transformer en régime d’exonération dès lors que l’activité est poursuivie pendant cinq ans.
Il convient ici de relever que la rédaction de l’article 151 nonies, II du Code général des impôts ne précise pas qui doit poursuivre l’exploitation.
Un certain nombre de praticiens considèrent que cette activité peut être poursuivie par une personne autre que l’associé.
Ces reports d’imposition peuvent être pénalisants dans la mesure où la plus-value doit faire l’objet d’une imposition en cas de réalisation de certains événements : cession des titres donnés, rachats des titres ou annulation des titres, ou transmission ultérieure.
En effet, lorsque l’un de ces événements se produit, il y a deux plus-values imposables, celle issue du report d’imposition et celle générée par la réalisation de l’événement.
Ce point est susceptible de poser des difficultés au donataire, notamment lorsque celui-ci envisage d’apporter ces titres à une société holding.
Il est vrai qu’il est possible de maintenir les reports d’imposition [12], encore faut-il que la nouvelle opération ouvre elle-même droit à un report d’imposition.
L’article 151 nonies, IV bis du Code général des impôts permet de bénéficier d’un report d’imposition en cas d’apport de l’intégralité des titres à une société holding, sous réserve de respecter plusieurs conditions.
Dès lors, en cas de donation des titres suivis d’un éventuel apport un peu plus tard de ceux-ci à une société holding par le donataire, il est en principe possible de maintenir le report d’imposition initiale issue de la donation, voire éventuellement d’aller chercher à purger celle-ci.
Cependant, en pratique, il peut être difficile de faire application de ce mécanisme en raison du statut du fermage, empêchant l’associé d’apporter l’intégralité de ces titres.
En dehors de ces cas, il convient systématiquement de vérifier les régimes de report d’imposition « en stock » dans les dossiers.
En pratique, un certain nombre de sociétés agricoles ont été créées par voie d’apport de l’entreprise individuelle avec application de l’article 151 octies du CGI N° Lexbase : L5581MAX. La cession des titres est là encore susceptible de faire tomber le report d’imposition.
Outre les systèmes de maintien des reports d’imposition, il convient d’avoir à l’esprit que certains régimes d’exonération permettent de purger cette plus-value en report d’imposition.
Le choix du régime d’exonération peut donc s’avérer important. À titre d’exemple, en cas de cession des titres pour départ à la retraite, l’article 151 septies A du Code général des impôts permet de purger les reports d’imposition issus de l’apport de l’entreprise individuelle avec application de l’article 151 octies du même Code [13].
C. La cession de l’entreprise individuelle et des éléments d’actifs
En cas de cession de l’entreprise individuelle ou des éléments d’actif par la société, la plupart des régimes vus ci-dessus vont également pouvoir trouver à s’appliquer avec certaines spécificités, à l’exception bien évidemment de ceux qui ne concernent que les titres de sociétés.
Il convient notamment de faire attention à l’application du délai de cinq ans. Il n’est pas rare que la société agricole exerce plusieurs activités. Le cas classique vise l’exercice d’une activité agricole à laquelle est associée la production d’électricité photovoltaïque.
Sous réserve de respecter les conditions visées à l’article 75 du Code général des impôts N° Lexbase : L9086LNT, cette activité peut être imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles.
En cas de cession de l’une de ces branches par la société agricole, la question du décompte du délai de cinq ans se pose nécessairement.
La cour administrative d’appel [14] de Nantes considère que l’analyse de la durée d’activité doit être appréciée de manière distincte pour chacune des activités
L’appréciation de la durée de cinq ans en cas de cession des éléments d’actifs par une société agricole à la suite de l’apport de l’entreprise individuelle nécessite également des précisions.
En effet, la doctrine administrative [15] propre aux bénéfices industriels et commerciaux considérés qu’en cas d’apport de l’entreprise individuelle dans les conditions de l’article 151 octies du Code général des impôts, c’est à dire sans opter pour celui-ci permet de reprendre l’antériorité de l’entreprise individuelle.
Or, la doctrine administrative [16] propre aux bénéfices agricoles ne reprend pas cette condition relative à l’apport dans les conditions de l’article 151 octies du Code général des impôts, étant rappelé que l’article de l’article 151 septies du Code général des impôts N° Lexbase : L4192LI4 ne contient aucune référence à cet article.
En outre, le Conseil d’État [17] a considéré que « dans le cas où le contribuable a poursuivi son activité d'abord à titre d'exploitant individuel puis en tant qu'associé d'une des sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI N° Lexbase : L1176ITQ et exerçant la même activité, il convient de tenir compte de l'ensemble de cette période pour apprécier si la condition de durée de l'activité est satisfaite ».
Ainsi, certains praticiens considèrent que même en présence d’un apport qui n’aurait pas été fait dans les conditions de l’article 151 octies du Code général des impôts, il est possible de reprendre l’antériorité de l’entreprise individuelle, en cas de cession des éléments d’actif.
En outre, il convient d’indiquer que l’appréciation de seuil de 250 000 euros vu précédemment pour l’application de l’article 151 septies du Code général des impôts est spécifique en cas de cession des éléments d’actif par une société agricole.
En effet, pour l’application de l’article 151 septies du Code général des impôts, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société [18].
Le Conseil d’État [19] a apporté des précisions qui soulèvent également d’autres questions. La haute juridiction administrative a indiqué clairement que pour les associés entrants, c’est-à-dire ceux ayant moins de deux ans de présence dans la société en tant qu’associés exploitants, il n’est pas possible de considérer que le chiffre d’affaires de référence est égal à 0.
Le Conseil d’État considère que dans ce cas, l’article 151 septies du Code général des impôts n’est pas applicable.
Cet arrêt soulève des questions sur le traitement des plus-values sur cessions d’élément d’actif pour les associés non exploitants, ou encore pour les associés non exploitants devenus exploitants.
Au niveau de la cession des éléments d’actif, le cas de l’amortissement du fonds agricole résiduel est susceptible d’interroger. En effet, la loi de finances pour 2022 permet d’amortir de manière temporaire le fonds commercial acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
L’article 618-8 du plan comptable général définit le fond agricole résiduel de la manière suivante :
« Sont comptabilisés au compte " fonds agricole résiduel " les éléments incorporels du fonds agricole acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une inscription dans un compte distinct du bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité ».
La lettre du texte ne vise pas le cas du fond agricole résiduel. Cependant, plusieurs éléments militent pour un tel amortissement :
- le règlement de l’ANC n° 2020-03, du 3 juillet 2020 N° Lexbase : X9340CMU assimile de fond agricole résiduel au fonds commercial [en ligne] ;
- les grands principes des bénéfices agricoles suivent expressément les grands principes des bénéfices non commerciaux [20] ;
- la notice de la déclaration n° 2139-SD vise l’amortissement du fond agricole résiduel (ligne HM) [en ligne].
Une telle option, si elle peut être séduisante nécessite cependant de s’interroger côté repreneur sur la durée d’amortissement et sur valeur de cet élément.
Concernant plus spécifiquement le cas de la transmission à titre gratuit de l’entreprise individuelle, il convient de ne pas perdre de vue qu’il est possible de bénéficier sous réserve d’en remplir les conditions, d’un régime de report d’imposition visé à l’article 41 du Code général des impôts N° Lexbase : L4078ICZ.
III. Les droits de mutation à titre gratuit et le pacte Dutreil
Les schémas de transmissions familiales peuvent également être effectués dans le cadre d’une donation. Comme vu précédemment, en présence de la donation d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société agricole soumise à l’impôt sur le revenu dans laquelle l’exploitant exerce son activité, il s’agit d’un fait générateur de plus-values professionnelles.
Dans le cadre schéma, l’utilisation du pacte Dutreil est généralement conseillée afin de réduire les droits de mutation à titre gratuit.
Un certain nombre de points sont susceptibles de poser des difficultés au cas d’une exploitation agricole.
A. Le cas de la transmission à titre gratuit des parts sociales
En cas de transmission à titre gratuit de parts de société agricole, comme une SCEA ou une EARL, il est possible de faire application de l’article 787 B du Code général des impôts N° Lexbase : L5936LQW. Ce dispositif permet de bénéficier d’un abattement de 75 % sur les droits de mutation à titre gratuit.
En cas de donation en pleine propriété, ce régime peut se cumuler avec une réduction de droits de 50 %.
Selon la situation, il sera possible de mettre en place un engagement collectif ou unilatéral de conservation. Il convient de préciser que cet engagement doit porter, pour des sociétés non cotées, sur un minimum de 34 % des droits de vote et 17 % des droits au bénéfice. Cet engagement doit être à minima de deux ans.
La transmission doit intervenir durant la phase d’engagement collectif ou unilatéral.
Sous réserve d’en remplir les conditions, il est possible d’avoir recours à un pacte réputé acquis. Celui-ci permet de gagner du temps, en ce sens qu’il n’y a pas d’engagement collectif ou unilatéral.
Une fois que l’engagement collectif ou unilatéral a pris fin, débute une phase d’engagement individuel de quatre ans. Les bénéficiaires de la transmission ayant fait application de l’abattement de 75 % doivent ainsi s’engager à conserver les titres reçus durant cette période de quatre ans.
L’application de ce dispositif nécessite de remplir une condition tenant à l’exercice d’une fonction de direction. Celle-ci doit être exercée durant l’engagement collectif et trois ans après la transmission. Au vu des derniers commentaires administratifs [21], pendant l’engagement collectif, la fonction de direction doit être exercée par l’un des signataires initiaux du pacte, y compris par tolérance, par un associé qui aurait depuis la signature du pacte, transmis tous les titres qui y sont soumis.
À compter de la transmission, la fonction de direction doit être exercée par l’un des héritiers, légataires, qui a pris l’engagement individuel de conserver les titres reçus, ou par l’une des personnes visées ci-dessus.
Au cas du pacte réputé acquis, même si les commentaires administratifs du 21 décembre 2021 apportent un peu souplesse en reconsidérant l’exercice d’une codirection parents/enfants, permettant ainsi de favoriser les transmissions progressives de l’exploitation, il demeure impératif que l’enfant exerce la fonction de direction [22].
Attention, l’analyse est distincte selon que le pacte Dutreil porte sur une société soumise à l’impôt sur le revenu ou sur une société relevant de l’impôt sur les sociétés.
En effet, au cas d’une société relevant de l’impôt sur les sociétés, l’une des personnes ci-dessus doit exercer l’une des fonctions visées à l’article 975,III-1-1° du Code général des impôts N° Lexbase : L9125LHG, à savoir : la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d'associé en nom d'une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. Les commentaires administratifs du 21 décembre 2021 précisent explicitement qu’il n’y a pas de conditions de rémunération.
Au cas d’une société agricole soumise à l’impôt sur le revenu, l’une des personnes visées ci-dessus doit exercer son activité professionnelle à titre principale. La doctrine administrative [23] précise que cette notion s’apprécie comme en matière d’impôt sur la fortune immobilière. Or la doctrine administrative ne renvoie qu’au paragraphe 10 à 40 du BOI-PAT-IFI-30-10-10-30. Ceux-ci précisent qu’il convient, afin de déterminer en présence de plusieurs activités, si celle concernée est l’activité principale, de vérifier si elle constitue l’essentiel de ses activités économiques. Pour cela, il est nécessaire de regarder le temps passé sur chaque activité, le niveau de responsabilité, la taille des diverses exploitations.
À défaut, si ce critère ne peut être rempli parce que les activités sont d’égales importances, alors il convient de basculer sur le critère de la prépondérance des revenus.
Au cas particulier des sociétés agricoles relevant de l’impôt sur le revenu, ces critères sont susceptibles de poser des difficultés. En effet, il n’est pas rare que les exploitants agricoles soient associés dans plusieurs structures. À titre d’exemple un producteur de pommes de terre sera généralement associé d’une SARL de commercialisation de pommes de terre. On comprend ainsi qu’il faut faire un choix, et qu’au vu des règles de renvoi, il semble difficile de se rattacher à une éventuelle notion de biens professionnels unique.
En outre, l’activité principale doit s’exercer sur un temps relativement long, et en présence de plusieurs activités, pour lesquels on serait obligé de se retrancher derrière le critère de la prépondérance des revenus, il y a un risque d’entrée et sortie du pacte Dutreil, notamment au gré des conjonctures économiques. La rédaction de l’article 787 B du Code général des impôts apparaît ainsi mal adaptée à ce type de schéma.
Cela peut certainement expliquer les options pour l’impôt sur les sociétés. Certains praticiens rentrent ainsi la stratégie suivante, celle-ci s’inscrivant dans un temps long :
- dans un premier temps, ils optent pour l’application de l’impôt sur les sociétés ; ils bénéficient ainsi du report d’imposition visé à l’article 151 nonies, III du Code général des impôts ;
- il procède dans un second temps à donation des titres, étant rappelé qu’en cas de transmissions à titre gratuit à une personne physique, si celle-ci prend l’engagement de déclarer en son nom la plus-value en cas de réalisation de certains événements, le report est maintenu ; la plus-value professionnelle sur titre en report d’imposition peut être purgée sous réserve que l’activité soit poursuivie pendant 5 ans et sous réserve de remplir les conditions de l’article 151 nonies, III du Code général des impôts ;
- il est fait application de l’article 787 B du CGI lors de la donation des titres de cette société ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.
B. Le cas de la transmission à titre gratuit de l’entreprise individuelle
L’abattement de 75 % est également susceptible de s’appliquer au cas des transmissions à titre gratuit d’exploitation agricole exercée dans le cadre d’une entreprise individuelle. On retrouve ici les mêmes conséquences que vues précédemment au niveau des plus-values professionnelles.
L’application de ce dispositif nécessite de remplir plusieurs conditions cumulatives.
L’entreprise individuelle, lorsque celle-ci a été acquise à titre onéreux, doit avoir été détenue depuis au moins deux ans. En revanche, aucun délai n’est exigé lorsque l’entreprise a été « acquise » par donation ou succession.
Il convient également de rappeler qu’en cas de transmission à titre gratuit de l’entreprise individuelle, les héritiers, les donataires ou légataires doivent prendre l’engagement de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant quatre ans à compter de la date de la transmission.
L’article 787 C du Code général des impôts N° Lexbase : L8958IQT n’impose pas de conditions d’exercice de l’activité professionnelle à titre principal pour les héritiers, donataires ou légataires. Celui-ci impose simplement que l’activité soit poursuivie par ces derniers durant trois ans après la transmission à titre gratuit.
L’administration fiscale considère pour sa part que l’activité doit être exercée à titre principale par ces derniers. Ce n’est pas le positionnement d’un certain nombre de juridictions du fond [24].
L’abattement de 75 % porte sur la totalité des biens transmis affectés à l’exploitation. Ici, l’administration fiscale adopte une présomption. Celle-ci considère que les biens inscrits au bilan sont présumés être affectés à l’activité professionnelle [25]. Cependant, il s’agit d’une présomption simple qui peut faire l’objet d’une remise en cause. Récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler notamment au regard de la trésorerie de l’entreprise [26].
Concernant la trésorerie, la Cour de cassation valide le critère permettant de considérer celle-ci comme affectée ou non à l’exploitation. En l’espèce la Cour d’appel relevait que la moyenne des besoins de trésorerie de l’entreprise sur les trois derniers exercices complets, et la trésorerie était très supérieure aux charges courantes.
Il est possible de rattacher cet arrêt à celui rendu en matière d’ISF (Cass. com., 16 décembre 2020 n° 18-24-871, F-D).
L’organisation sous forme sociétaire est ainsi susceptible d’apporter un peu plus de sécurité de ce point de vue.
En outre, en règle générale, les terres ne sont pas inscrites au bilan. Leur sort ne peut donc pas être réglé au moyen de l’article 787 C du Code général des impôts.
C. Les régimes d’exonération concernant les terres
Généralement, les terres sont en dehors du bilan. Cependant, l’exploitant peut désirer transmettre celle-ci à son repreneur, un membre de la famille ou un tiers. Par ailleurs, il peut détenir celle-ci directement ou dans le cadre d’un GFA.
La mise en place d’un bail cessible hors du cadre familial peut permettre de bénéficier d’un abattement sur les droits de mutation à titre gratuit. Celui-ci s’élève à 75 % jusqu’à 300 000 euros de valeur de biens ruraux, pour la fraction excédentaire, l’abattement s’élève à 50 %. Ce régime trouve également à s’appliquer au cas des parts de GFA.
L’application de ce régime au cas d’une détention en direct des biens ruraux nécessite de remplir plusieurs conditions cumulatives. Cette exonération est conditionnée au fait que le bénéficiaire de la transmission reste propriétaire des biens pendant cinq ans.
Attention, le bail doit avoir été conclu depuis au moins deux ans lorsque celui-ci a été consenti :
- au donataire de la transmission, à son conjoint, à l'un de leurs descendants ;
- à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
L’administration fiscale [27] en tire la conclusion que les baux consentis depuis moins de deux ans au donataire, à son conjoint, à ses descendants ou à une société contrôlée par une de ces personnes privent la donation de la possibilité de bénéficier du régime de faveur.
Au cas de parts de GFA, il convient ici de respecter les conditions suivantes :
- les statuts du groupement doivent lui interdire l'exploitation en faire-valoir direct ; ce point est important dans la mesure où certains anciens GFA ne contiennent pas cette rédaction. Il est important de procéder à un audit des statuts afin de vérifier ce point. Quand bien même le GFA n’aurait pas exploité en faire-valoir direct, cette simple clause suffit à déqualifier le GFA [28] ;
- les immeubles à destination agricole du groupement doivent faire l'objet d'un bail rural à long terme ou d'un bail rural cessible hors du cadre familial ;
- en principe, les parts doivent être détenues depuis au moins deux ans ; ce délai n’est pas exigé en cas d’apports d’immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole effectués lors de la constitution du groupement ;
- l'article 793 bis du CGI N° Lexbase : L9073LND subordonne l'application du régime de faveur à la condition que les biens reçus restent la propriété du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit pendant une durée minimale de cinq ans ;
- on retrouve également une condition d’antériorité du bail de deux ans [29].
L'exonération ne s'applique qu'à la fraction de la valeur nette des parts correspondant aux biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible hors du cadre familial et à concurrence d'un certain pourcentage.
Récemment, la cour d’appel de Caen [30] a eu l’occasion d’indiquer que l’apport des biens à GFA au cours de la période de cinq ans n’apparaît pas comme une cause de déchéance du régime de faveur à la lecture de l’article 793 du Code général des impôts N° Lexbase : L3146LDU.
IV. Les droits de mutation à titre onéreux
En cas de cession des titres l’exploitation agricole, il convient de prendre garde à la rédaction de l’article 730 bis du Code général des impôts N° Lexbase : L6240LUN.
Celui-ci dispose : « Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 euros. Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 euros ».
Il convient de relever que la modification de l’article 730 bis du Code général des impôts est susceptible de poser un certain nombre de difficultés pratiques.
Il ressort des débats parlementaires en date que cette rédaction vise en réalité à empêcher certains montages aboutissant à une transformation de sociétés civiles immobilières en SCEA afin de bénéficier du régime de faveur. Ce point est explicitement repris dans le cadre de l’analyse de l’article 5 quater (nouveau) du projet de loi de finances pour 2020, par le rapporteur public Monsieur Joël GIRAUD, dans le cadre du rapport n° 2493, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2019. Celui-ci précisant : « La durée d’un minimum de trois années entre la constitution de la société civile agricole et le bénéfice du droit fixe paraît de nature à éviter des transformations de société à une date rapprochée de la cession des parts ».
L’esprit de la loi n’est pas en accord avec sa rédaction.
La rédaction de l’article 730 bis du Code général des impôts exclut de son champ d’application les cessions de titres de SCEA constituées depuis moins de trois ans.
Certains praticiens considèrent que dans ce cas, les cessions de parts autres que celles visées par les mécanismes d’exceptions sont soumises à un taux de 3 %. Ce taux est porté à 5 % pour les parts de sociétés à prépondérance immobilière.
D’autres en revanche, considèrent qu’il faudrait revenir à l’article 727 du Code général des impôts. Les tenants de cette analyse expliquent notamment que si l’article 726 du Code général des impôts est le principe, celui-ci s’applique sous réserve des exceptions.
L’article 727 du Code général des impôts est un régime d’exception. Celui-ci précise : « Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés ».
Une telle lecture permettrait d’échapper au droit proportionnel.
Cependant, une difficulté résulte de la rédaction de la doctrine fiscale [31] qui n’a pas été modifiée à la suite de la loi de finances pour 2020. Celle-ci exclut de manière générale l’application de l’article 727 du Code général des impôts à l’ensemble des parts de GAEC, d’EARL et de toutes sociétés civiles à objet principalement agricoles, même non exploitante.
Il convient d’indiquer que depuis le 1er janvier 2021, la cession du fond agricole est enregistrée gratuitement, au lieu de 125 euros auparavant.
[2] CE 9° et 10° ssr., 28 décembre 2012 n° 340135, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6824IZR.
[3] CE 9° et 10° ssr., 28 décembre 2012, n° 340135 N° Lexbase : A6824IZR.
[4] CE 9° et 10° ch.-r., 8 juin 2016, n° 387826, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2415RSA.
[5] QE n° 3501 de Monsieur Mohamed Laqhila, JOANQ 5 décembre 2017, réponse publ. 13 août 2018, p. 7471, 15ème législature [en ligne].
[6] CAA Nantes, 12 décembre 2019, n° 17NT02539 N° Lexbase : A9091Z9L.
[7] BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 n° 640 N° Lexbase : X5888ALN.
[8] BOI-BA-BASE-20-20-30-30 n° 150 N° Lexbase : X9001ALX.
[9] TA Rouen, 16 juin 2020 n° 1081116 ; RJF, 2020, n° 889 ; CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 407063, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1650YLP ; CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 407065, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1651YLQ.
[10] BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 n° 50.
[11] BOI-BIC-PVMV-20-40-30 n° 160 N° Lexbase : X5185ALM.
[12] CGI, art. 151-0 octies N° Lexbase : L2335IGL.
[13] BOI-BIC-PVMV-40-20-20-40 n° 120 N° Lexbase : X6861ALP.
[14] CAA Nantes, 7 janvier 2022, n° 20NT03391 N° Lexbase : A86997HN.
[15] BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 n° 130 N° Lexbase : X5888ALN.
[16] BOI-BA-BASE-20-20-30-30 N° Lexbase : X9001ALX.
[17] CE 3° et 8° ssr., 13 janvier 2010, n° 301985, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3286EQR ; CE 3° et 8° ssr., 13 janvier 2010, n° 301986, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3287EQS.
[18] CGI, art 70 N° Lexbase : L3848KWG.
[19] CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2018, n° 412474, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0739YRS ; CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2018, n° 412475, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0740YRT.
[20] CGI, art. 72 N° Lexbase : L0055IKA.
[21] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 390 et suivants N° Lexbase : X6754ALQ.
[22] QE n° 99759 de M. Yannick Moreau, JOANQ 11 octobre 2016, réponse publ. 7 mars 2017 p. 1983, 14ème législature N° Lexbase : L7071LDA.
[23] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 280.
[24] CA Pau, 10 janvier 2013, n° 11/03410 ; CA Grenoble, 8 septembre 2015 n° 13/00609.
[25] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40 n° 10.
[26] Cass. com., 9 février 2022, n° 20-10.753, F-D N° Lexbase : A09707NA.
[27] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40 n° 10.
[28] CA RIOM, 27 mai 2010, n° 05/01756 N° Lexbase : A4462E97.
[29] BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30 n° 140.
[30] CA Caen, 16 novembre 2021, n° 19/02794 N° Lexbase : A88987B8.
[31] BOI-ENR-DMTOM-40-20 n° 60 N° Lexbase : X5432ALR.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480764
[Jurisprudence] Nullité du licenciement fondé sur un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression
Réf. : Cass. soc., 16 février 2022, n° 19-17.871, FS-B N° Lexbase : A33567NM
Lecture: 17 min
N0751BZT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Venosino, Avocate associée et Florian Clouzeau, Avocat, Beside Avocats
Le 16 Mars 2022
Mots-clés : liberté d’expression • liberté fondamentale • nullité • licenciement • lanceur d’alerte
Par un arrêt, publié au bulletin, du 16 février 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce que « le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul ». Dans cette hypothèse, une cour d’appel ne peut donc se limiter à retenir une absence de cause réelle et sérieuse et ce, même si elle écarte l’application du statut de lanceur d’alerte.
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées […] ». L’article 10, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4743AQQ, au visa de l’arrêt commenté, confère un caractère universel à la liberté d’expression. Cette liberté fondamentale a donc vocation à s’appliquer dans les relations entre un employeur et un salarié, ce que l’arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022 vient rappeler avec force.
L’affaire. Courant 2014, une société de courtage (Newedge) faisait l’objet d’un projet de rachat par un établissement bancaire (Société générale). Dans le cadre de ce projet, un salarié occupant le poste de « Managing director » de la direction fiscale de la société faisait part de son désaccord concernant les modalités d’intégration de Newedge au sein de la Société générale et plus précisément concernant le transfert des comptes de compensation de Paris à Londres qu’il considérait illicite. La direction de la société ne partageant pas cette position, le salarié réitérait ses inquiétudes en avertissant ses supérieurs hiérarchiques sur le caractère, selon lui, frauduleux du projet et les risques encourus par l’entreprise.
Le 31 juillet 2014, le salarié était licencié pour insuffisance professionnelle. Ce licenciement était, en synthèse, fondé sur trois griefs :
- des retards dans le traitement de dossiers et un manque de rigueur ;
- des difficultés relationnelles avec ses interlocuteurs ;
- le ton inadapté adopté dans le cadre des échanges relatifs aux orientations de l’entreprise et une opposition de principe au projet de rachat.
Le salarié contestait son licenciement en soutenant notamment que ce dernier avait été notifié en représailles à l’alerte qu’il avait émise. Il sollicitait, sur ce fondement, la nullité du licenciement et sa réintégration.
La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 16 janvier 2019, n° 17/05927 N° Lexbase : A1844YTH), saisie du litige, considérait que les griefs invoqués par la société au titre de retards de traitement, d’un manque de rigueur et de difficultés relationnelles n’étaient pas de nature à justifier le licenciement.
Elle retenait ensuite que l’expression par le salarié de son désaccord avec la direction concernant le projet de rachat n’était pas de nature à justifier un licenciement « dès lors qu'il le fait dans des termes acceptables et n'abuse pas de sa liberté d'expression ».
En revanche, la cour rejetait la demande de nullité en considérant que le désaccord n’avait pas été exprimé par le salarié dans le cadre d’une alerte susceptible de conférer le statut de lanceur d’alerte, mais dans le cadre de ses fonctions de directeur fiscal qui lui imposait de délivrer cet avertissement.
Le pourvoi. Le salarié décidait de former un pourvoi en cassation pour contester notamment le rejet de sa demande de nullité du licenciement, outre une question portant sur l’application de la convention de forfait annuel en jours ne faisant pas l’objet du présent commentaire.
En premier lieu, il soutenait en substance que la protection inhérente au statut de lanceur d’alerte concerne tous les salariés de l'entreprise, même ceux dont la fonction consiste précisément à alerter l'employeur. Par ailleurs, dans la dernière branche du moyen, le salarié arguait que la nullité du licenciement devait être prononcée dès lors que la cour avait relevé que le licenciement était fondé sur le désaccord exprimé par le salarié sans abuser de sa liberté d’expression.
La décision. Par arrêt, publié au bulletin, du 16 février 2022, la Cour de cassation fait droit à cette demande en s’appuyant sur la seule dernière branche du moyen, relative à la liberté d’expression.
La Cour rappelle ainsi que « sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ».
Elle retient ensuite, dans un attendu général, que « le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul ».
Par conséquent, dans l’affaire objet du pourvoi, la cour d’appel, qui avait constaté l’absence d’abus de liberté d’expression, aurait nécessairement dû en déduire la nullité du licenciement.
L’arrêt est donc cassé.
Si cette solution n’est pas surprenante, elle fixe clairement dans un attendu de principe la position de la Cour de cassation concernant la sanction d’un licenciement fondé sur un usage non abusif de la liberté d’expression du salarié.
Par ailleurs, cet arrêt interroge sur les limites appliquées à la liberté d’expression du salarié ainsi que sur l’articulation de cette liberté fondamentale avec la protection inhérente au statut de lanceur d’alerte.
1. La liberté d’expression en entreprise : une liberté fondamentale
Le caractère fondamental de la liberté d’expression ne fait pas de débat, cette dernière étant reconnue non seulement par l’article 10, § 1 de la CESDH, au visa de l’arrêt, mais également, entre autres, par l’article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1358A98 qui énonce que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme ». C’est donc logiquement que la Cour de cassation a, très tôt, considéré que le salarié jouit dans l’entreprise d’une liberté d’expression en relevant que « l'exercice du droit d'expression dans l'entreprise étant, en principe, dépourvu de sanction, il ne pouvait en être autrement hors de l'entreprise où il s'exerce, sauf abus, dans toute sa plénitude » [1].
Depuis lors, la Chambre sociale rappelle régulièrement, comme elle le fait dans l’arrêt commenté, que « sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ».
En application de ces principes, la Cour a eu l’occasion à de multiples reprises de rappeler le caractère non fondé des licenciements motivés par l’usage, non abusif, par un salarié, de sa liberté d’expression.
Tel est le cas, à titre d’illustrations, du licenciement :
- d’un joueur de football ayant fustigé, ouvertement dans la presse, le manque de cohérence et de diplomatie de son entraîneur [2] ;
- d’un directeur commercial adressant une lettre au Conseil d’administration et aux dirigeants de la société mère de son employeur, dans laquelle il dénonce les « décisions incohérentes et contradictoires » des dirigeants [3] ;
- d’une responsable comptable ayant porté des accusations de falsification de comptes à l’encontre du dirigeant [4] ;
La Haute Cour va même jusqu’à consacrer un « droit de critique » [5] au bénéfice du salarié concernant son employeur.
La Cour de cassation entend donc conférer une large place à la liberté d’expression des salariés, qu’elle soit mobilisée dans le cadre ou hors du cadre de l’entreprise, à condition toutefois qu’ils n’en abusent pas.
2. Les limites à la liberté d’expression en entreprise
Si la Cour de cassation reconnaît le caractère fondamental de la liberté d’expression, intégrant même un « droit de critique » à l’encontre de l’employeur, dans le présent arrêt, elle rappelle que cette liberté n’est pas sans limites.
En premier lieu, elle précise que le licenciement d’un salarié ne peut être prononcé pour un motif lié à l’exercice « non abusif » par le salarié de sa liberté d’expression.
La notion d’abus est strictement contrôlée par la Cour de cassation. Cette dernière considère que pour retenir un abus à la liberté d’expression, les juridictions du fond doivent le caractériser par l'emploi de termes « injurieux, diffamatoires ou excessifs » [6].
L’injure et la diffamation sont les limites habituelles de la liberté d’expression notamment en droit de la presse et, d’évidence, compte tenu de leur conséquence sur la relation de travail, elles doivent pouvoir être sanctionnées.
Cela étant, même dans ces hypothèses, dans le cadre de la relation de travail, les juridictions font parfois preuve d’une certaine tolérance à l’égard des salariés. Aussi, certains licenciements fondés sur des injures ont pu être écartés aux motifs que celles-ci s’expliquaient par le contexte ou une provocation de l’employeur [7].
Le caractère « excessif » des propos est, quant à lui, plus difficile à circonscrire. On peut déduire, en synthèse, des décisions rendues en la matière que l’« excès » de liberté d’expression tient plus à la manière dont le salarié a fait usage de cette liberté, notamment lorsqu’il fait preuve d’agressivité [8], qu’au fond, même virulent [9], du message qu'il a entendu délivrer.
Au-delà de la notion d’abus, la Haute Cour précise, également en second lieu, que des « restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées » à la liberté d’expression du salarié. Elle reprend ici le libellé de l’article L. 1121-1 du Code du travail N° Lexbase : L0670H9P, cité au visa.
Cette limite se concrétise le plus souvent dans le cadre des obligations légales, conventionnelles ou contractuelles de secret ou de discrétion qui sont imposées aux salariés dans l’intérêt notamment de l’entreprise et de ses clients ou usagers.
Ainsi, la violation du secret médical par un salarié est de nature à justifier un licenciement pour faute grave [10]. Il en va de même du manquement contractuel à l’obligation de ne pas divulguer les procédés d'étude, de fabrication ou les méthodes commerciales de l’entreprise [11]. Tel est également le cas de l’engagement pris, dans le cadre d’une transaction, de « cesser tout propos critique et dénigrant » à l’encontre de l’employeur [12].
En dehors des limites liées à l’abus et aux restrictions justifiées et proportionnées, le licenciement prononcé à l’encontre du salarié portant atteinte à sa liberté d’expression, se voit appliquer une sanction aux incidences indemnitaires particulièrement lourdes : la nullité.
3. L’atteinte à la liberté d’expression sanctionnée par la nullité
L’enjeu de la sanction prononcée à l’encontre d’un licenciement est devenu majeur dans les contentieux prud’homaux, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN, fixant le barème des indemnités prud’homales [13]. En effet, ce barème ne s’applique pas aux licenciements entachés de nullité.
Or, ce même article précise qu'est nul, le licenciement résultant de « la violation d’une liberté fondamentale » [14].
Dans la mesure où, comme exposé ci-avant, le caractère fondamental de la liberté d’expression ne fait pas de débat, il faut en déduire, logiquement, que le licenciement portant atteinte à cette liberté d’expression est nul. C’est ce que vient rappeler, avec clarté, la Cour de cassation dans le présent arrêt en retenant que « le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul ».
Puisqu’elle est tout à fait logique, cette solution n’est pas surprenante. En effet, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a pu, par le passé, confirmer des décisions de cours d’appel prononçant la nullité de licenciements pris en violation de la liberté d’expression [15].
Toutefois, il faut relever que, dans le même temps, la Chambre sociale a validé de nombreux arrêts se limitant, dans une telle hypothèse, à retenir l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement [16].
Dans ce contexte, en prononçant, dans un arrêt publié au bulletin, une cassation faisant précisément grief au juge du fond de ne pas avoir retenu la nullité du licenciement, la Cour a manifestement entendu opérer un rappel, ne souffrant d’aucune ambiguïté, sur la sanction affectant un licenciement portant atteinte à la liberté d’expression.
En revanche, l’arrêt laisse une question en suspens : qu’en est-il lorsqu’un licenciement fondé sur l’exercice non abusif de la liberté d'expression est également motivé par d’autres motifs ? Le licenciement est-il nul dès lors qu’il porte atteinte à cette liberté ? Ou peut-il être valide dès lors qu’un autre motif non attentatoire à la liberté le justifie ? Ou encore, la nullité doit-elle être prononcée lorsque l’exercice de la liberté d’expression est le motif véritable et prépondérant du licenciement ?
La Cour ne répond pas précisément à ces questions.
D’une part, elle reprend la constatation de la cour d’appel selon laquelle l’usage par le salarié de sa liberté d’expression était « au cœur des reproches faits par l’employeur », ce qui pourrait induire que cette atteinte doit avoir présidé à la décision de l’employeur. D’autre part, elle relève que la nullité est encourue lorsque le licenciement est prononcé « pour un motif » portant atteinte à la liberté d’expression, ce qui pourrait induire que les autres motifs sont sans incidence.
En dépit de cette ambiguïté, il faut, à notre sens, s’attendre à ce que la Cour privilégie cette dernière position qui serait en cohérence avec sa position concernant, par exemple, les licenciements portant atteinte à la liberté d’agir en justice. En la matière, la Chambre sociale considère, en effet, que « la seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse envisagée par le salarié était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture » [17].
Compte tenu des conséquences pécuniaires considérables résultant du prononcé d’une nullité (une indemnité non plafonnée correspondant, au minimum, aux salaires des six derniers mois [18]), les employeurs devront faire preuve de la plus grande vigilance lorsqu’ils seront amenés à envisager un licenciement lié à des propos tenus par des salariés.
4. L’articulation entre la liberté d’expression et la protection du lanceur d’alerte
Dans l’affaire commentée, c’est, en premier lieu, sur la base de la violation du statut de lanceur d’alerte que le salarié soutenait la nullité de son licenciement, tant devant la cour d’appel que dans le cadre du pourvoi.
La protection accordée aux lanceurs d’alerte se traduit dans le Code du travail par les dispositions de l’article L. 1132-3-3 N° Lexbase : L7446LBE qui prévoient qu’« […] aucun salarié ne peut être […] licencié […] pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ». Le licenciement prononcé en méconnaissance de cet article est nul [19].
En l’occurrence, la cour d’appel avait rejeté l’application de ces dispositions au motif, en substance, que le salarié avait alerté sa direction sur l’éventuelle constitution d’une infraction dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la direction fiscale et non en qualité de lanceur d’alerte. Dans le cadre du pourvoi, dans la première branche du moyen portant sur le licenciement, le salarié contestait cette appréciation au motif que la protection des lanceurs d’alerte « s'étend à tous les salariés de l'entreprise, même à ceux dont la fonction consiste précisément à alerter l'employeur ».
Cette première branche du moyen n’était pas, à notre sens, dénuée de toute pertinence. Pourtant, la Chambre sociale a fait le choix de ne pas discuter cet argument et de privilégier l’analyse de la seule question de l’atteinte à la liberté d’expression qui inclut donc l’hypothèse d’une alerte.
Cette position est dans la droite ligne d’arrêts rendus quelques mois plus tôt. En effet, dans ces arrêts, sur le fondement de la seule liberté d’expression et sans aucune référence au dispositif de protection du lanceur d’alerte, la Chambre sociale a pu considérer qu’était entaché de nullité, le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié ayant relaté, de bonne foi, des faits susceptibles de caractériser une infraction pénale ou des manquements déontologiques prévus par la loi ou le règlement [20].
Certains commentateurs relevaient alors, fort justement, que ce recours à la liberté d’expression était rendu nécessaire puisque les dispositions de l’article L. 1132-3-3 du Code du travail n’étaient pas entrées en vigueur au moment des faits en cause dans ces deux arrêts.
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation s’inscrit donc dans la continuité de ses récentes décisions, mais franchit une nouvelle étape. En effet, d’une part, elle choisit de fonder sa décision exclusivement sur l’atteinte à la liberté d’expression, alors même que, dans cette affaire, l’article L. 1132-3-3 du Code du travail était entré en vigueur et pouvait donc être mobilisé. D’autre part et surtout, elle ne mentionne plus la condition tenant à la dénonciation, de bonne foi, de faits de nature à caractériser des infractions pénales. La Cour retient, au contraire, de manière très générale, que « le licenciement prononcé pour un motif lié à l’exercice non abusif de sa liberté d’expression est nul ».
Il faut relever qu’en faisant ce choix, la Cour ne fait alors plus référence à la condition de « bonne foi » du salarié émettant une alerte. Faut-il en conclure que le salarié de mauvaise foi pourrait se prévaloir de cet arrêt pour obtenir la nullité du licenciement ? Rien n’est moins sûr et il faut s’attendre à ce que la Cour de cassation considère comme abusive la dénonciation de mauvaise foi émise par un salarié à l’encontre de son employeur.
En tout état de cause, force est de constater que la Cour de cassation profite ici de la souplesse du fondement de la liberté d’expression, en tant que liberté fondamentale, qui permet d’étendre le champ de la protection au-delà de celui du dispositif du lanceur d’alerte.
Faut-il pour autant en déduire que la protection des salariés lanceurs d’alerte est devenue inutile ? Certainement pas à notre sens. En effet, il ne faut pas omettre que le statut du lanceur d’alerte n’est pas constitué de la seule sanction du licenciement lui portant atteinte. Outre un régime de preuve favorable, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP, dite loi « Sapin II », qui en fixe le régime, prévoit des mesures visant à prévenir les éventuelles répercussions à l’encontre d’un salarié lanceur d’alerte. Ainsi, elle impose notamment la mise en œuvre d’une procédure censée garantir la « stricte confidentialité des auteurs du signalement » [21] ?
L’intérêt majeur du statut de lanceur d’alerte ne se trouve donc pas dans la sanction infligée en cas de licenciement, laquelle résulte en tout état de cause de la seule atteinte à la liberté d’expression, mais dans l’ensemble des mesures de protection qui visent à libérer la parole ainsi qu’à dissuader et prévenir toute mesure de représailles.
Il faut souligner que c’est principalement en ce sens que le projet de loi dit « Waserman », adopté par le Parlement et actuellement soumis au Conseil constitutionnel, vise à réviser et à enrichir le statut du lanceur d’alerte.
[1] Cass. soc., 28 avril 1988, n° 87-41.804 N° Lexbase : A4778AA9.
[2] Cass. soc., 28 avril 2011, n° 10-30.107, F-P+B N° Lexbase : A5365HPE.
[3] Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-19.734, FS-P+B N° Lexbase : A2827KBC.
[4] Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-20.516, FS-D N° Lexbase : A7858XHI.
[5] Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-23.486, F-D N° Lexbase : A8098IQY.
[6] Cass. soc., 24 novembre 2021, n° 20-18.143, F-D N° Lexbase : A51347DI ; Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-20.516, FS-D N° Lexbase : A7858XHI ; Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-19.734, FS-P+B N° Lexbase : A2827KBC.
[7] Cass. soc., 17 juin 2009, n° 08-41.663, F-D N° Lexbase : A3138EI3 ; Cass. soc., 17 janvier 1990, n° 86-44.013 N° Lexbase : A8791AAT.
[8] Voir en ce sens : Cass. soc., 12 juin 2019, n° 17-24.589, F-D N° Lexbase : A5757ZEX ; Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-23.486, F-D N° Lexbase : A8098IQY.
[9] Voir en ce sens : Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-19.734, FS-P+B N° Lexbase : A2827KBC.
[10] Cass. soc., 28 avril 2000, n° 97-45.905, inédit N° Lexbase : A6018C4N.
[11] Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-16.995, F-D N° Lexbase : A9023SGB.
[12] Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-27.284, FS-P+B N° Lexbase : A7772KTZ.
[13] C. trav., art. L. 1235-3 N° Lexbase : L1442LKM.
[14] C. trav., art. L. 1235-3-1 N° Lexbase : L1441LKL.
[15] Cass. soc., 19 mai 2016, n° 15-12.311, F-D N° Lexbase : A0896RQA.
[16] Cass. soc., 2 mai 2000, n° 98-41.557 N° Lexbase : A8294AHN ; Cass. soc., 28 avril 2011, n° 10-30.107, F-P+B N° Lexbase : A5365HPE ; Cass. soc., 2 mars 2017, n° 15-21.737, F-D N° Lexbase : A9882TRG ; Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-10.123, FS-D N° Lexbase : A69333WP.
[17] Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-11.122, FS-P+B N° Lexbase : A0000YNC.
[18] C. trav., art. L. 1235-3-1 N° Lexbase : L1441LKL.
[19] Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 19-25.989, FS-D N° Lexbase : A049948Y.
[20] Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-10.057, FS-B N° Lexbase : A76997IY ; Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 19-25.754, FS-B N° Lexbase : A62994YX.
[21] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP, art. 9.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480751
[Brèves] Appel civil : quid de la rédaction du dispositif des conclusions de l’appelant principal ?
Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2022, n° 20-20.017, F-B N° Lexbase : A24677P3
Lecture: 3 min
N0747BZP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 16 Mars 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 3 mars 2022, vient préciser que lorsque l’appelant principal, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, la cour d’appel doit statuer sur ces demandes ; l’appelant n’est pas tenu de reprendre, les chefs de dispositif du jugement dont il sollicite l’infirmation.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de commerce l’ayant notamment condamnée au paiement à la partie adverse.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 18 mai 2020, n° 18/02006 N° Lexbase : A78703L3) d’avoir confirmé le jugement de première instance l’ayant condamné une certaine somme à la partie adverse et l’ayant débouté de sa demande reconventionnelle. L’intéressée fait valoir la violation de l’article 954 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7253LED dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL.
En l’espèce, pour confirmer le jugement la cour d’appel a relevé que :
- les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 954 du code précité imposent à la cour de ne statuer que sur les prétentions expresses, récapitulées dans le dispositif des conclusions et que l'absence dans le dispositif des conclusions d'une partie appelante de la demande expresse d'infirmation de dispositions du jugement clairement mentionnées ne la saisit pas de cette demande et ne l'autorise pas à infirmer le jugement ;
- en l'absence d'infirmation préalable de ce qui a déjà été jugé, la cour ne peut pas statuer sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des appelants, auxquelles il a été déjà répondu par un jugement qui subsiste à défaut d'infirmation et que la circonstance que des prétentions claires, précises et motivées figurent dans le dispositif des conclusions n'est pas de nature à combler cette absence. En conséquence, la cour relève qu’elle ne peut y faire droit, ou les rejeter, que si dans le même temps elle infirme ou confirme, le jugement critiqué sur des dispositions clairement visées ;
- que la société appelante principale a sollicité dans le dispositif de ses conclusions d'« infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués », sans que ce dispositif n’indique les dispositions du jugement dont la réformation était sollicitée.
Les juges d’appel ont considéré qu’ils n’étaient pas saisis de demande d'infirmation par l'appelante principale.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa 954 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de Versailles.
|
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480747
[Brèves] Liquidation judiciaire et portabilité des droits : confirmation de la condition de l’absence de résiliation du contrat
Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2022, n° 20-20.898, F-B N° Lexbase : A03537Q7
Lecture: 3 min
N0728BZY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 16 Mars 2022
► L'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0437IXH, créé par la loi n° 2013-504, du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi N° Lexbase : L0394IXU, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code N° Lexbase : L2615HIP contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine ; ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte ; toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
Les faits et procédure. Une société a conclu avec une institution de prévoyance un contrat de mutuelle santé et prévoyance au profit de ses salariés. La liquidation judiciaire ayant été prononcé par jugement du 16 février 2016, l’institution a résilié le contrat de prévoyance avec effets au 29 février 2016 et a formulé une proposition de « prolongation onéreuse du contrat » à compter du 1er mars 2016. Le liquidateur lui a adressé à ce titre, le 18 mars suivant, une somme de 35 120,18 euros afin de maintenir, pour un an, les garanties précédemment souscrites pour les salariés licenciés.
Le liquidateur es qualités a assigné l'institution de prévoyance en remboursement de la somme ainsi versée, selon lui indûment, et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La cour d’appel (CA Colmar, 8 juillet 2020, n° 18/03277 N° Lexbase : A03253RH) ayant écarté sa demande de remboursement, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la portabilité de l'assurance couverture santé et prévoyance joue, même en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, sans condition de l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien de ces couvertures. En vain.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel, relevant que l’institution de prévoyance a résilié le contrat le 29 février 2016, soit dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2177LED, et qu'à compter de la prise d'effet de cette résiliation prévue par la loi, les garanties ouvertes ont pris fin pour n'être plus en vigueur dans l'entreprise, a pu en déduire que le paiement volontairement opéré par le liquidateur, en ce qu'il portait sur des cotisations dues au-delà du 29 février 2016, ne pouvait être assimilé à un paiement indu.
Contexte. Dans cinq avis rendus le 6 novembre 2017 (Cass., avis, 6 novembre 2017, n° 17013 N° Lexbase : A8557WYL, n° 17014 N° Lexbase : A8558WYM, n° 17015 N° Lexbase : A8559WYN, n° 17016 N° Lexbase : A8560WYP et n° 17017 N° Lexbase : A8561WYQ), la Cour de cassation avait subordonné l’application de la portabilité aux anciens salariés d’une société placée en liquidation judiciaire à la seule condition que le contrat d’assurance liant l’employeur à l’organisme assureur n’ait pas été résilié. Puis dans un arrêt du 5 novembre 2020 (Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-17.164, FS-P+B+I N° Lexbase : A521033D), la Cour de cassation a finalement pris une position conforme aux avis rendus en 2017 : dès lors qu’il existe un contrat de complémentaire santé et de prévoyance au jour où le licenciement du salarié est intervenu, ce salarié peut prétendre au maintien « à titre gratuit » de ces couvertures. Le présent arrêt confirme la solution.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480728
[Brèves] Aggravation du dommage corporel, après conclusion d’une transaction, consécutive à des soins visant à améliorer l’état de la victime : rappel des principes
Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2022, n° 20-16.331, F-B N° Lexbase : A03527Q4
Lecture: 2 min
N0778BZT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 16 Mars 2022
► En cas d’aggravation du dommage corporel après la conclusion d’une transaction, aggravation consécutive à des soins qui avaient pour but d’améliorer l’état de la victime, cette dernière est en mesure d’agir dans le délai prévu par l’article 2226 du Code civil.
Faits et procédure. En l’espèce, les victimes d’un accident de la circulation avaient conclu une transaction relative à l’indemnisation du préjudice corporel. Par la suite, l’une d’elles invoqua une aggravation de son préjudice, aggravation consécutive à des interventions chirurgicales, lesquelles visaient à améliorer son état. La cour d’appel (CA Grenoble, 14 janvier 2020, n° 18/02279 N° Lexbase : A10773BI) débouta la victime de sa demande d’indemnisation du préjudice, considérant que la victime d’un dommage corporel indemnisé qui se soumet ultérieurement à des soins ayant pour but d’améliorer son état, lesquels aggravent son état, ne peut obtenir réparation.
Solution. La cassation de l’arrêt d’appel intervient au visa de l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 N° Lexbase : L0950KZ9, de l’article L. 211-19 du Code des assurances N° Lexbase : L7248IAP et du principe de la réparation intégrale du préjudice. La Cour de cassation constate la violation de la loi dès lors que « l’aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d'améliorer son état séquellaire résultant de cet accident ». Ce faisant, la victime est en mesure d’obtenir réparation de son dommage. Ainsi, l’aggravation du dommage est assimilée à un préjudice distinct de celui ayant antérieurement fait l’objet de la transaction. Ce faisant, la victime ne saurait se heurter à l’effet extinctif des transactions. En outre, peu importe que cette aggravation résulte de soins médicaux ou chirurgicaux ultérieurs qui avaient pour but d’améliorer l’état séquellaire, mais qui ont emporté une aggravation du dommage. La victime peut alors, dans le délai prévu par l'article 2226 du Code civil N° Lexbase : L7212IAD, demander réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480778
[Brèves] Publication d'une circulaire présentant les dispositions de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense
Réf. : Circ. DACG, n° 2022-05, du 28 février 2022, présentant les dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense N° Lexbase : L8275MB4
Lecture: 1 min
N0656BZC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 22 Mars 2022
► Dans une circulaire du 28 février 2022 présentant les dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense, le Garde des Sceaux est venu préciser les modifications opérées par le l’article 3 de la loi.
La nouvelle loi N° Lexbase : L3146MAR modifie le Code de procédure pénale et a pour ambition de renforcer la protection du secret professionnel de l’avocat. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 2022.
La circulaire revient sur :
- la modification de l’article préliminaire ;
- la modification des règles relatives aux perquisitions (procédure et règles de fond) : la circulaire précise ici notamment le régime spécifique qui s’applique à certaines infractions financières ;
- l’encadrement des réquisitions des données de connexion concernant un avocat ;
- la modification des règles relatives aux interceptions de correspondances.
Un tableau comparatif des dispositions du Code de procédure pénale modifiées est également à retrouver en annexe de la circulaire.
|
Pour en savoir plus : M. Bouchet, « Décryptage » sur la loi « confiance dans l’institution judiciaire » et ses nouveautés en matière de secret professionnel des avocats, Lexbase Avocats, mars 2022 N° Lexbase : N0540BZZ |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480656
[Brèves] SAS : les conditions de révocation des dirigeants sont librement fixées par les statuts
Réf. : Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, F-B N° Lexbase : A94347P4
Lecture: 4 min
N0723BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 16 Mars 2022
► Les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ;
Par conséquent, le directeur général d'une société par actions simplifiée peut être révoqué sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnent pas la révocation du dirigeant à une telle condition.
Faits et procédure. Un dirigeant de sociétés a été révoqué en mai 2012 de ses fonctions de directeur général de deux SAS et de gérant d’une SARL.
Faisant valoir que ces révocations étaient intervenues sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires, il a assigné ces sociétés en paiement de dommages-intérêts.
Sur renvoi après cassation (Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-10.018, F-D N° Lexbase : A5700XUN), la cour d’appel d’Angers (CA Angers, 17 septembre 2019, n° 18/01525 N° Lexbase : A1992ZYG) a notamment jugé que les modalités de révocation de son mandat de directeur général de l’une des SAS n'étaient pas fautives et n'engageaient pas sa responsabilité, et que sa révocation était donc régulière et n'était pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires. Elle a ainsi débouté le dirigeant de l'ensemble de ses demandes contre cette SAS.
Pourvoi. L’intéressé a donc formé un pourvoi en cassation. Il y soutenait qu’en l'absence de mention statutaire dispensant la société de justifier d'un motif pour procéder à la révocation du dirigeant, la révocation ne peut intervenir que pour un juste motif.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Selon elle, la cour d’appel a exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités. Or, l'arrêt constate que l'article 18 des statuts de la SAS stipule que les autres dirigeants que le président « sont révocables à tout moment par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président ». La cour d’appel a ainsi retenu que, sauf à ajouter à l'article 18 précité, celui-ci ne conditionne nullement la révocation du dirigeant à l'existence de justes motifs.
Dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt décide que la révocation de l’intéressé en tant que directeur général de la SAS pouvait intervenir sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un juste motif.
Observations. On rappellera qu’à côté de l’exigence impérative de désignation d’un président, il est possible de prévoir statutairement au sein de la SAS la désignation d’autres organes de direction qui porteront le titre de directeur général ou de directeur général délégué (C. com., art. L. 227-6 N° Lexbase : L6161AIZ). Les conditions de leur révocation, comme celles du président de SAS, doivent être fixées par les statuts. C'est ce que rappelle l'arrêt rapporté.
Toutefois, il convient de noter que quelles que soient les prévisions statutaires en la matière, la révocation des dirigeants doit respecter les exigences traditionnelles forgées en jurisprudence : l’absence de caractère brutal, vexatoire ou injurieux (par ex. Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-21.633, F-D N° Lexbase : A1055WES) et le respect du principe du contradictoire ou de loyauté dans la révocation (v. Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19.563, F-D N° Lexbase : A8335IQR – Cass. com., 22 novembre 2016, n° 15-14.911, F-D N° Lexbase : A3494SLY).
| Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480723
[Brèves] Création d’un parc éolien : inopposabilité d'un règlement départemental de voirie à une autorisation unique tenant lieu d'autorisation d'urbanisme
Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 7 mars 2022, n° 440245, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A86757PY
Lecture: 3 min
N0724BZT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 16 Mars 2022
► Les dispositions d'un règlement départemental de voirie qui n'appellent l'intervention d'aucune décision administrative dont l'autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu, au sens du quatrième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu'elle tient lieu d'autorisation d'urbanisme.
Faits. Par un arrêté du 5 octobre 2018, le préfet du Morbihan a délivré à la société d'exploitation du parc éolien du Moulin Neuf une autorisation unique pour la réalisation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Malansac (Morbihan).
Première instance. Par un arrêt n° 19NT00588 du 28 février 2020 N° Lexbase : A406138W, la cour administrative d'appel de Nantes, compétente pour en connaître en premier et dernier ressort, a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette autorisation. Elle avait estimé que cette autorisation environnementale dispense de permis de construire et que donc l'exploitant n'étant pas tenu de solliciter une autorisation pour édifier les aérogénérateurs composant le parc éolien, le permis de construire délivré pour la construction de ce parc présente un caractère superfétatoire et n'est pas susceptible de faire grief aux tiers (voir déjà pour cette solution, CE, 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 409227, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9353XQH et lire le commentaire de S. Bécue, La dispense de permis de construire pour les projets éoliens : précisions et questions résiduelles, Lexbase Public, juin 2018, n° 508 N° Lexbase : N4738BXR).
Dispositions du règlement. Aux termes du III de l'annexe 5 du règlement départemental de la voirie du Morbihan approuvé par la délibération de la commission permanente du conseil départemental du Morbihan du 16 septembre 2016 et relatif à l'implantation d'éoliennes en bordure de la voie publique : « Les éoliennes devront être implantées à une distance au moins égale à leur hauteur (mât + pale) prise à partir de l'emprise de la voie sans pouvoir être inférieure aux marges de recul édictées par le document d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune d'implantation des ouvrages »,
Position CE. Ces dispositions, qui n'appellent l'intervention d'aucune décision administrative dont l'autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu, au sens du quatrième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 alors en vigueur N° Lexbase : L8116IZM, selon lequel « lorsque les projets mentionnés à l'article 1er sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations, l'autorisation unique tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente », ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu'elle tient lieu d'autorisation d'urbanisme.
Validation CAA. Dès lors, en écartant les moyens tirés de la méconnaissance du règlement départemental de voirie au motif que, en application du principe d'indépendance des législations, les règles qu'il fixe n'étaient pas opposables à l'autorisation unique contestée, la cour administrative d’appel n'a pas commis d'erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480724