[Brèves] Faute dolosive de l’assuré qui, en se suicidant, crée d’importants dommages collatéraux ? Deux exemples en sens inverse
Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-11.538, F-P+B+I (N° Lexbase : A06493MY) ; Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-14.306, F-P+B+I (N° Lexbase : A83323L8)
Lecture: 6 min
N3475BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 27 Mai 2020
► Après avoir relevé que les moyens employés par l’assuré, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, qui « dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l'incendiaire, même s'il était difficile d'en apprécier l'importance réelle et définitive, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l’assuré avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur et a légalement justifié sa décision ;
► en revanche, ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qu'en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l'intention de l’assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoire, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de faute dolosive, a légalement justifié sa décision.
Telles sont les solutions de deux arrêts rendus le 20 mai 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-11.538, F-P+B+I (N° Lexbase : A06493MY) ; Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-14.306, F-P+B+I N° Lexbase : A83323L8).
Pour rappel, l’article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) prévoit que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
La jurisprudence de la Cour de cassation est venue définir progressivement la notion de faute dolosive, que l’on peut résumer ainsi (cf. les obs. de Didier Krajeski, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 766, 2018 N° Lexbase : N6846BXT ; et plus récemment, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 818, 2020 N° Lexbase : N2724BYK) comme suit ; deux caractères sont exigés :
- un comportement ;
- et un effet de ce comportement sur l’aléa.
S’agissant du comportement, il s’agit d’un manquement délibéré de l’assuré à ses obligations, et non d’une simple négligence (Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-23.696, F-D (N° Lexbase : A1487WXD, et les obs. de Didier Krajeski, in chron, Lexbase, éd. priv., n° 721, 2017 N° Lexbase : N1506BX3 ; RGDA, 2017, 610, obs. L. Mayaux), ou une conscience de faire courir un risque (Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-10.042, F-D N° Lexbase : A0860S8D), RGDA, 2017, 169, obs. L. Mayaux).
Quant à l’effet du comportement de l’assuré sur l’aléa, il s’agit d’une disparition totale de l’aléa, et non seulement une diminution (Cass. civ. 2, 25 octobre 2018, n° 16-23.103, F-P+B N° Lexbase : A5373YIT).
Les deux arrêts rendus le 20 mai 2020 s’inscrivent dans la lignée de cette jurisprudence, dans un contexte similaire d’un assuré qui créé d’importants dommages en se suicidant. Dans la première affaire, la faute dolosive est caractérisée, tandis qu’elle ne l’est pas dans la seconde affaire.
♦ Dans la première affaire, les faits étaient les suivants. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2009, un incendie s'était produit dans un appartement et avait provoqué le décès de son occupant ainsi que d'importants dommages à l'immeuble. L’assureur de la copropriété, après avoir indemnisé les frais de réparations, s'était retourné contre l’assureur de la victime, qui avait refusé sa garantie au motif que ce dernier s'était suicidé et avait cherché à causer le dommage à la copropriété.
Le 30 janvier 2014, l’assureur de la copropriété avait assigné l’assureur responsabilité civile du défunt en garantie. Il n’obtiendra pas gain de cause.
La Cour de cassation approuve les juges d’appel ayant exactement énoncé que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire.
Tel était le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé plus haut, étant relevé que les moyens employés témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l'incendiaire, même s'il était difficile d'en apprécier l'importance réelle et définitive.
♦ En revanche, dans la seconde affaire, l’assuré s’était suicidé en se jetant sous un train lors de l'arrivée de celui-ci en gare. L’accident provoqué ayant entraîné des dommages matériels et immatériels, la SNCF avait sollicité la réparation de son préjudice auprès de l’assureur de la responsabilité civile du défunt. L'assureur ayant refusé sa garantie, la SNCF l'avait assigné en réparation de ses préjudices.
Elle avait obtenu, devant la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 29 novembre 2018, n° 17/03258 N° Lexbase : A4903YNW), la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 62 039,90 euros avec intérêts au taux légal. L’assureur avait alors formé un pourvoi, invoquant les conditions telles que dégagées par la jurisprudence, puisqu’il reprochait notamment aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si le comportement de l'assuré ne caractérisait pas une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur, dès lors qu'il ne pouvait ignorer que son geste, procédant de la méconnaissance des obligations incombant aux passagers, rendait inéluctable la réalisation du dommage de la SNCF et faisait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti.
Mais la Cour de cassation s’en remet ici au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont ils disposaient. La cour d’appel a estimé, au contraire de l’assureur requérant, qu'en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l'intention de l’assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoire. Ce faisant, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de faute dolosive, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473475
[Brèves] Poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office : la Chambre criminelle précise l’office du juge
Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-25.136, FS-P+B+I (N° Lexbase : A83303L4)
Lecture: 10 min
N3404BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 27 Mai 2020
► Il incombe au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office, de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d’assises rejetant les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs.
Ainsi statue la première chambre civile dans un arrêt du 20 mai 2020 dans l’affaire qui concernait l’avocat Lillois Franck Berton (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-25.136, FS-P+B+I N° Lexbase : A83303L4 ; v., à propos de l'arrêt censuré rendu par la cour d'appel de Douai, M. Boissavy, La conscience de l’avocat et les droits de la défense face à la commission d’office par le président d’une juridiction pénale, in Lexbase Avocats, 2018, n° 276 N° Lexbase : N6888BXE).
Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi avait relevé appel de la décision d’une cour d’assises le condamnant à vingt-neuf ans de réclusion criminelle pour assassinat (CA Douai, 21 novembre 2018, n° 18/03942 N° Lexbase : A9209YQ7). Lors de l’ouverture des débats devant la cour d’assises d’appel, les avocats désignés par l’accusé, avaient décidé de se retirer de la défense de leur client, en accord avec celui-ci. Après avoir commis d’office l’un des deux avocats, la présidente de la cour d’assises avait, par ordonnance du 14 mai 2014, rejeté les motifs d’excuse et d’empêchement invoqués par ce dernier pour refuser son ministère. L’avocat avait, néanmoins, quitté la salle d’audience et les débats s’étaient déroulés en l’absence de l’accusé et de son avocat commis d’office. Par arrêt du 22 mai 2014, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par l’intéressé (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-84.221, FS-P+B+I N° Lexbase : A6748NLI, Bull. Crim., 2015, n° 137), la cour d’assises du Pas-de-Calais avait condamné ce dernier à vingt-cinq ans de réclusion criminelle. Il était reproché à l’intéressé de ne pas avoir déféré à la commission d’office, nonobstant la décision de la présidente de la cour d’assises de rejeter ses motifs d’excuse ou d’empêchement, la procureure générale près la cour d’appel de Douai avait, le 19 janvier 2017, saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de ladite cour aux fins de poursuites disciplinaires.
- Sur la communication des conclusions écrites du ministère public
Enoncé du moyen. L’avocat fait grief à l’arrêt de dire que son refus de se soumettre à la commission d’office décidée par la présidente d’une cour d’assises caractérise une faute disciplinaire lorsque les motifs d’excuse présentés par l’avocat n’ont pas été retenus par la présidente de la cour d’assises et de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de l’avertissement, alors « qu’en matière disciplinaire, l’arrêt qui se prononce sur des poursuites doit mentionner que la personne poursuivie et son avocat ont eu communication des conclusions écrites du ministère public et ont été mis en mesure d’y répondre utilement ; que l’arrêt attaqué, qui ne comporte pas cette mention, doit être annulé pour violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR), de l’article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q) et des droits de la défense ».
Réponse de la Cour. L’arrêt, qui prononce la peine disciplinaire de l’avertissement, mentionne que le ministère public a déposé des conclusions écrites le 14 septembre 2018 et qu’à l’audience du 10 octobre suivant, les parties ont maintenu oralement leurs écritures. La première chambre civile qui déduit sa solution des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et articles 15 (N° Lexbase : L1132H4P) et 16 du Code de procédure civile, estime qu'en procédant ainsi, sans constater que l’avocat poursuivi avait eu communication des conclusions écrites du ministère public afin d’être mis en mesure d’y répondre utilement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
- Sur l'office du juge
Enoncé du moyen. L’avocat fait le même grief à l’arrêt, alors « que la régularité de la décision du président de la cour d’assises n’ayant pas approuvé les motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par l’avocat commis d’office peut être contestée par l’avocat à l’occasion de la procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d’assises ; que le juge disciplinaire exerce dans ce cadre un contrôle autonome, qui lui est propre, distinct de celui exercé dans le cadre du pourvoi formé par l’accusé ou d’une requête en récusation ; qu’en se référant, pour « confirmer la décision de la présidente de la cour d’assises qui n’avait pas retenu les motifs d’excuse présentés par Maître X... », à l’arrêt de la Chambre criminelle du 24 juin 2015 ayant validé la procédure et à la décision du 19 mai 2014 ayant rejeté la requête en récusation sans se livrer à sa propre appréciation, la cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), et de l’article 62 de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L7403HHN)».
Réponse de la Cour. Aux termes de l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’avocat régulièrement commis d’office par le Bâtonnier ou le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le Bâtonnier ou par le président. Selon le dernier, l’avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d’office, sauf motif légitime d’excuse ou d’empêchement admis par l’autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission. Lorsque le président de la cour d’assises constate que l’accusé n’est pas ou plus défendu et lui commet d’office un avocat, en application de l’article 317 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3715AZM), il est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par ce dernier (Cass. civ. 1, 9 février 1988, n° 86-17786, publié au bulletin N° Lexbase : A6989AA4, Bull. 1988, I, n° 31 ; Crim., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-84.221, Bull. Crim. 2015, n° 167). L’avocat qui, malgré la décision du président de la cour d’assises de ne pas approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il a présentés, persiste dans son refus d’exercer la mission qui lui a été confiée, peut être sanctionné disciplinairement (Cass. civ. 1, 15 novembre 1989, n° 88-11413, publié au bulletin, N° Lexbase : A6244CHQ, Bull. 1989, I, n° 347 ; Cass. civ. 1, 2 mars 1994, n° 92-15.363 N° Lexbase : A2054CLN). Toutefois, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée à l’occasion de la présente instance, le Conseil constitutionnel, dont les décisions s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles, a retenu que, si le refus du président de la cour d’assises de faire droit aux motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par l’avocat commis d’office n’est pas susceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l’accusé à l’occasion d’un pourvoi devant la Cour de cassation, et par l’avocat à l’occasion de l’éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d’assises (Cons. const., décision n° 2018-704 QPC, du 4 mai 2018 (N° Lexbase : A1936XMN § 9 ; v., A. Cappello, L’appréciation des motifs d’excuse de l’avocat par le président de la cour d’assises jugée conforme à la Constitution, Lexbase Pénal, n° 6, 2018 N° Lexbase : N4557BX3).
La Chambre criminelle rend sa décision au visa des articles 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et 6, alinéa 2, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat (N° Lexbase : L6025IGA). Elle en déduit qu’il incombe au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office, de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d’assises rejetant les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs. Or, pour prononcer la sanction disciplinaire de l’avertissement contre l’avocat, après avoir relevé que celui-ci avait invoqué, notamment, l’animosité de l’avocat général occupant le siège du ministère public, un calendrier de procédure établi sans consultation préalable des avocats de la défense et la volonté de la présidente de la cour d’assises d’éviter la présence des deux avocats choisis, l’arrêt retient que ces arguments ont déjà été rejetés par l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 juin 2015, qui a validé la procédure à l’égard de l’accusé, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision de la présidente de la cour d’assises de ne pas retenir les motifs d’excuse présentés par l’avocat. En statuant ainsi, alors que, pour apprécier le caractère fautif du refus de l’avocat de déférer à la commission d’office, il lui incombait de procéder elle-même à l’examen des motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par ce dernier, la cour d’appel a méconnu son office et violé les textes susvisés.
Cassation. La Cour censure par conséquent l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de Douai (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E9554ETZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473404
[Focus] La gestion du conflit d’intérêts à l’occasion de l’intervention de l’avocat en garde à vue
Lecture: 13 min
N3101BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maître Fabrice Giletta, avocat au Barreau de Marseille, ancien Bâtonnier de l'Ordre
Le 28 Mai 2020
|
Mots-clés : garde à vue • Bâtonnier • conflit d’intérêts • libre choix de l’avocat • droits de la défense. Résumé : la question du conflit d’intérêts à l’occasion de la garde à vue est sensible à plus d’un titre. Elle est perçue par les enquêteurs comme la possibilité d’élaborer une défense d’opportunité affranchie de l’imperméabilité propre au déroulement de mesures de garde à vue durant la période cruciale de cette phase d’enquête. Elle peut être vue par les avocats comme une entrave pour le justiciable au libre choix de son défenseur et une suspicion à leur endroit les stigmatisant comme de potentiels complices de leurs clients. Dès lors, toute différence d’appréciation à cet égard entre l’avocat et l’OPJ ou le procureur de la République peut être source de tensions. Le rôle du Bâtonnier est alors fondamental pour arbitrer mais quels sont les impératifs qui vont guider sa décision ? Voyage entre droits fondamentaux de la défense et nécessités de l’enquête. |
L’actualité récente, qui a vu un avocat se présenter dans les locaux d'un service de police pour assister l’un de ses clients placé en garde à vue sans cependant être autorisé à accomplir son office, nous conduit à rappeler les règles applicables en la matière et à envisager l’hypothèse d’un désaccord entre le Bâtonnier et le procureur quant à la caractérisation d’un conflit d’intérêts.
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4969K8K) qui prévoit les modalités de désignation et d’assistance du gardé à vue par un avocat, règle la problématique liée au conflit d’intérêts de la façon suivante :
« S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur ».
Ainsi, au terme de l’article précité, la divergence d’appréciation n’est envisagée qu’entre l’avocat et l’OPJ ou le procureur de la République. Dans cette hypothèse, selon le texte, c'est le Bâtonnier qui est le seul habilité, s’il le souhaite (« il peut »), à désigner un autre défenseur.
Il semble donc que le législateur n’ait envisagé que le conflit d’intérêts comme étant susceptible d’entraîner un empêchement à intervenir pour un avocat.
Mais y aurait-il d’autres obstacles à l’intervention d’un conseil ? Et en pareille hypothèse quelle solution ?
Pour répondre à cela, il est nécessaire d’abord de définir le conflit d’intérêts avant d’en dresser les contours, puis d’examiner les autres situations que le Bâtonnier peut être amené à rencontrer.
Définition du conflit d’intérêts
Dès lors qu’il n’existe pas de définition spécifique du conflit d’intérêts à la matière de la garde à vue, il importe de se référer à la notion qu’en donne le RIN en son article 4.2 (N° Lexbase : L4063IP8) :
« Il y a conflit d’intérêts :
- dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties ;
- dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie ;
- lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus ».
Il faut également noter que l’article 4.1 énonce quant à lui :
« L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client.
Lorsque des avocats sont membres d’un groupement d’exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s’appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret professionnel.
Les mêmes règles s’appliquent entre l’avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel ou laquelle il collabore ».
La référence à l’accord des parties comme susceptible d’autoriser l’intervention de l’avocat en cas de risque de conflits d’intérêts est ici intéressante puisqu’en matière de garde à vue, cela aurait précisément pour effet de permettre ce que le législateur souhaitait éviter, à savoir une porosité de la garde à vue.
Ainsi, un seul et même avocat qui interviendrait concomitamment dans la défense de plusieurs individus placés au même moment en garde à vue pourrait être soupçonné de favoriser la coordination des positions de chacun.
Certes, raisonner ainsi est problématique (mais symptomatique de la méfiance que l’avocat a générée chez le législateur de 2011) car cela fait peser sur l’avocat un soupçon d’irrespect du secret professionnel et des règles applicables à la garde à vue.
Ainsi, pour la propre protection de l’avocat, et présumant que cet homme de loi ne serait pas capable de la respecter, il faudrait par principe, lui interdire d’intervenir en cas de conflit d’intérêts potentiel.
Mais de plus, la perspective d’une intervention commune en cas d’accord des parties pourrait aller à l’encontre de l’objectif visé par le législateur de 2011, à savoir, trouver un point d’équilibre entre les droits du gardé à vue (mais sans accès au dossier cependant…) et l’efficacité de cette phase d’enquête.
L’étude des travaux préparatoires de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN) est édifiante quant aux craintes du législateur.
Ainsi, lors de l’examen du rapport et des textes de la commission du 16 février 2011, à l’occasion de la discussion relative à l’amendement n° 7, le rapporteur M. François Zocchetto indiquait (répondant à M. Hyest, président qui admettait que lorsque plusieurs personnes sont mises en cause, il peut y avoir conflit d’intérêts) : « dans ces cas-là, les petits sont chargés, et le gros s’en sort ».
Une telle vision des choses est choquante pour l’avocat car elle suppose que le conseil commun n’aurait à cœur que de défendre les intérêts du gros en sacrifiant ceux plus minimes du petit.
Pour autant, cette appréhension illustre assez bien la difficulté à laquelle pourrait être confronté un avocat, non en ce qu’il participerait à l’élaboration d’un scénario visant à dédouaner tel ou tel participant, mais en ce qu’il serait placé dans une situation insoluble ne pouvant plus en définitive accomplir son office, étant pris en tenailles entre les positions possiblement divergentes des uns et des autres.
Ce risque doit, à mon sens, conduire l’avocat, en pareille hypothèse, à se désister de lui-même de la défense de plusieurs gardés à vue.
Ce n’est évidemment que s’il n’entend pas le faire alors que l’OPJ ou le procureur de la République le lui demande que le Bâtonnier doit intervenir.
Les travaux préparatoires donnent (et le texte le reprend d’ailleurs) une compétence exclusive et en dernier ressort au Bâtonnier, manifestement seul juge alors du conflit d’intérêts.
Mais que se passerait-il en cas de désaccord entre le Bâtonnier et le procureur de la République ?
Pour répondre à cette question, il faut avoir à l’esprit le principe du libre choix de l’avocat.
Ce principe est considéré comme sacré puisqu’il interdit notamment aux règlements intérieurs des barreaux de prévoir une interdiction pour un avocat de plaider contre un confrère de son même barreau.
De même, il a entraîné logiquement le bannissement de ce qui avait été un temps envisagé en matière de terrorisme : l’établissement de liste d’avocats agréés.
En effet, en matière de terrorisme, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN) avait prévu que le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur à la demande de l'officier de police judiciaire ou du juge d'instruction, pouvait décider que le suspect serait assisté par un avocat désigné par le Bâtonnier sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur proposition des conseils de l'Ordre de chaque barreau (C. proc. pén., art. 706-88-2 N° Lexbase : L9641IPR).
Le Conseil constitutionnel a estimé qu’il eût fallu apporter plus de précisions sur les conditions et les modalités selon lesquelles l'atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense pouvait être mise en œuvre (Cons. const., 17 février 2012, n° 2011-223 QPC N° Lexbase : A9100MWX). Le législateur a tiré les conséquences de cette abrogation et a lui-même abrogé le décret d'application de l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale en date du 14 novembre 2011 par celui du 13 avril 2012.
Cependant, il faut noter que la Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu'il était possible de passer outre le choix effectué par le suspect s'il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commande (CEDH, 25 septembre 1992, Req. 13611/88, Croissant c/ Allemagne N° Lexbase : A6435AWA)
En matière de garde à vue, l’intérêt peut paraître assez évident...
Mais l’intérêt réside-t-il toujours exclusivement dans le fonctionnement de la justice ?
Assurément, le Bâtonnier prendra également en considération les intérêts de l’avocat.
En effet, même si le texte n’envisage que le conflit d’intérêts entre les gardés à vue, le Bâtonnier aura également le souci de préserver son confrère ainsi que l’image de la profession.
Récemment, l’actualité a mis en évidence, dans le cadre d’une affaire au fort retentissement médiatique, qu’un avocat n’avait pu intervenir pour assister son client à l’occasion d’une garde à vue. En l’état d’une certaine confusion régnant autour des informations ayant présidé à ce refus, seules des hypothèses seront formulées ; on a en effet entendu tour à tour que l’avocat n’avait pas été désigné par le mis en cause, ou qu’il existait un conflit d’intérêts donnant lieu à enquête déontologique mais alors entre quelles personnes puisqu’il n’aurait de toutes façons assisté qu’un seul client…
L’absence de désignation sera volontairement laissée de côté n’appelant aucun commentaire.
Reste donc l’hypothèse d’un conflit d’intérêts envisagé alors entre le client et son conseil… ce que n’a pas manqué de relayer une certaine presse, une journaliste allant même jusqu’à formuler, à l’occasion de l’interview de l’avocat en question (devrait-on dire l’interrogatoire...) des accusations à peine voilées quant au rôle qu’il aurait pu jouer s’agissant des faits eux-mêmes…
Cela provoque l’indignation de l’ancien Bâtonnier que je suis :
En effet, soit il existe des raisons plausibles de soupçonner l’avocat quant à la perpétration même des faits objets de l’enquête et il peut faire l’objet d’une audition libre ou d’une garde à vue,
Soit il n’en existe pas, et alors il ne saurait être empêché d’accomplir son office au profit de son client.
Il reste une dernière question à envisager : quelle est la valeur contraignante de la décision du Bâtonnier ?
Cette question présente un intérêt purement théorique car compte tenu de la durée assez réduite de la GAV, et de la quasi-impossibilité (hors cas particulier de l’article 63-4-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4968K8I) de différer l’intervention de l’avocat, la décision du Bâtonnier de désigner (ou pas) un autre conseil sera en pratique sans appel.
Mais par analogie avec la matière civile, on doit rappeler qu’en cette matière, le Bâtonnier en cas de conflit d’intérêts ne peut qu’inviter l’avocat à se déporter sans cependant pouvoir l’y contraindre. Il n’émet donc qu’un avis insusceptible de recours.
En matière de garde à vue la valeur contraignante semble différer car le Bâtonnier se voit investi de l’autorité de désigner un avocat pour assister le gardé à vue.
Cela permettra aux enquêteurs en pareille hypothèse de refuser à l’avocat initialement désigné d’intervenir.
Mais dans le cadre de la suite de la procédure (instruction ou jugement en cas de CI, COPJ ou CPPV), le mis en cause pourra être tenté de soulever une exception de nullité de la mesure et des actes subséquents au motif qu’une atteinte a été portée à la liberté dont il disposait de choisir son défenseur et de l’entrave causée à sa défense.
Le juge sera alors immanquablement saisi, a posteriori, de la question de l’existence d’un conflit d’intérêts.
Peut-on en déduire qu’in fine, c’est le juge qui dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain sur l’existence ou pas d’un conflit d’intérêts ?
Sans doute, et la comparaison avec la matière civile se révèle ici encore intéressante :
En effet, la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 27 mars 2001, n° 98-16.508, FS-P+B+R N° Lexbase : A1113ATE) a estimé qu'en l'état de carence du Conseil de l'Ordre, le juge compétent pour statuer sur le conflit d'intérêts qui lui était soumis ne peut être que le juge des référés eu égard aux dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9113LTP).
Cette décision concerne un contentieux civil et vise le cas d’une carence ordinale, mais il est certain qu’à l’occasion d’un contentieux de la nullité, c’est au juge qu’il appartiendrait de dire si le conflit était ou non caractérisé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473101
[Textes] Cristallisation de la période de renouvellement automatique des contrats de syndic et des mandats des membres des conseils syndicaux et avènement des assemblées générales dématérialisées
Réf. : Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L1697LX7)
Lecture: 30 min
N3435BYU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Florence Bayard-Jammes, Docteur en droit, Professeur associé TBS Business School
Le 30 Août 2021
L’épidémie de covid-19 et les mesures législatives et gouvernementales qui s’en sont suivies en vue de prévenir la propagation du virus ont eu un impact sur les copropriétés empêchant la tenue des assemblées générales qui devaient, notamment pour certaines d’entre elles, statuer sur les contrats de syndic arrivant à expiration.
Des dispositions dérogatoires successives ont été prises en matière de copropriété à la suite de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT, publiée au Journal officiel du 24 mars 2020), qui a habilité le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation.
En droit de la copropriété, ces mesures ont concerné les contrats de syndics et les mandats des membres des conseils syndicaux mais pas les assemblées générales des copropriétaires malgré les demandes des professionnels (v. les préconisations du GRECCO : préconisation n° 8 concernant la tenue des assemblées générales en période d’épidémie du virus covid-19 et postérieurement à cette période et préconisation n° 9 concernant la tenue à distance des assemblées générales en période d’épidémie du virus covid-19). C’est chose faite avec l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1697LX7, publiée au Journal officiel du 21 mai 2020), modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L5722LWT, publiée au Journal officiel du 26 mars 2020). L’article 13 de l’ordonnance du 20 mai 2020 modifie les article 22 et 22-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 en cristallisant la période de renouvellement automatique des contrats de syndics et des mandats des membres des conseils syndicaux (I) et en créant quatre nouveaux articles (art. 22-3 à 22-5) destinés à faciliter la tenue des assemblées générales des copropriétaires durant la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 (II).
I. Les contrats de syndic et les mandats des conseillers syndicaux
A. Les contrats de syndic
C’est dans le cadre de l’habilitation donnée au Gouvernement par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 24 mars 2020) qu’est intervenue l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 qui, pour éviter que les copropriétés soient dépourvues de syndic en l’absence de réunions d’assemblée générale du fait du confinement, a, dans son article 22, renouvelé les contrats de syndic qui devaient prendre fin entre le 12 mars 2020 et « l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire ». La cessation d’état d’urgence sanitaire ayant été fixée initialement au 24 mai 2020, tout contrat de syndic expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 [1] était, en vertu de l’article 22, automatiquement renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires qui devait intervenir « dans les six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire » soit au plus tard le 24 novembre 2020 [2].
Ces dispositions sont apparues insuffisantes pour assurer une bonne gestion des copropriétés notamment celles dans lesquelles les contrats du syndic expiraient après le 24 juin qui ne bénéficiaient pas du dispositif. L’article 22 de l’ordonnance du 25 mars 2020 a donc été modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS, publiée au Journal officiel du 23 avril 2020). En premier lieu, la période de référence des contrats automatiquement renouvelés a été augmentée d’un mois et concernait en conséquence ceux expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020 (ou plus tard si l’état d’urgence sanitaire était prorogé). En second lieu, le délai de prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par l’assemblée générale a été augmenté de deux mois passant de six à huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit au 24 janvier 2021 ou plus tard si l’état d’urgence sanitaire était prorogé [3]. Or, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8351LW9, publiée au Journal officiel du 12 mai 2020) a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ce qui impliquait un prolongement des périodes relatives, d’une part au renouvellement automatique des contrats de syndic jusqu’au 10 septembre 2020 [4], et d’autre part la date de prise d’effet du contrat du syndic désigné par l’assemblée générale reportée au 10 mars 2021 [5].
Ces durées, laissant aux syndics un importante latitude pour convoquer les assemblées générales, sont apparues trop longues au Gouvernement qui a une nouvelle fois modifié l’article 22 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. Ainsi l’article 13 de l’ordonnance n° 2010-595 du 20 mai 2020 a simultanément facilité la tenue des assemblées générales entièrement dématérialisées (voir infra) et cristallisé les périodes de références relatives au renouvellement des contrats de syndic en décidant que « le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient, au plus tard le 31 janvier 2021 ». Des dispositions semblables ont été prises pour le renouvellement des mandats de membres des conseils syndicaux.
B. Les mandats des membres du conseil syndical
Si l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée s’était préoccupée du renouvellement des contrats de syndic, elle avait omis celui des mandats des conseillers syndicaux dont la désignation a souvent lieu en même temps que celle du syndic et pour la même durée. C’est l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, en ajoutant un nouvel article 22-1 à l’ordonnance du 25 mars 2020, qui a remédié à cette situation.
Ainsi, initialement, les mandats des membres des conseils syndicaux qui devaient expirer entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020 (cette date pouvant être modifiée en cas de modification de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire) étaient renouvelés jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale, laquelle devait intervenir au plus tard huit mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, et donc au plus tard le 24 janvier 2021 [6]. Toutefois, le dernier alinéa de l’article 21-1 prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de l’ordonnance soit avant le 26 mars 2020.
Afin d’harmoniser les dispositions dérogatoires relatives aux mandats des conseilleurs syndicaux avec celles applicables aux contrats de syndic, l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifie l’article 22-1 de l’ordonnance du 22 avril 2020 qui prévoit désormais que : « par dérogation aux dispositions de l’article 21 et du c de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires . Cette assemblée générale intervient au plus tard le 31 janvier 2021. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de la présente ordonnance ».
II. La tenue des assemblées générales entre le 1er juin 2020 et le 31 janvier 2021
Alors que le confinement a été amorcé le 11 mai 2020, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, et le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8355LWD, publié au Journal officiel du 12 mai 2020) prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans la cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ces différentes mesures, et notamment les interdictions de regroupement, qui pourraient durer au-delà de la période d’état d’urgence sanitaire, empêchent la tenue de nombreuses assemblées générales de copropriétaires et les pouvoirs publics, ayant identifié que cette situation risquait de porter atteinte au bon fonctionnement des copropriétés, ont souhaité permettre aux syndicats des copropriétaires de pouvoir convoquer des assemblées générales rapidement et les tenir sans présence physique des copropriétaires ceux-ci pouvant participer à l’assemblée à distance ou y voter par correspondance [7]. Pour cela, il était nécessaire d’adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de son décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967, c’est l’objet des articles 22-2 à 22-5 ajoutés à l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, ci-dessous étudiés.
A. Des dérogations temporaires
L’article 13 de l’ordonnance du 20 mai 2020 modifie quelques dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967 relatives à la convocation et la tenue des assemblées générales de copropriété, mais il s’agit de dispositions dérogatoires temporaires qui s’appliqueront à compter du 1er juin 2020 [8] jusqu’au 31 janvier 2021, date à laquelle les autres dispositions dérogatoires relatives à la copropriété s’appliquent.
Remarquons que la date du 1er juin 2020 coïncide avec l’entrée en vigueur des dispositions relatives au vote par correspondance prévu par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété, à condition toutefois que le décret modificatif du décret de 1967 précisant ses modalités d’application et que l’arrêté fixant le modèle du formulaire de vote par correspondance soient publiés avant cette date. A défaut, la mise en application du vote par correspondance sera retardée.
B. La tenue de l’assemblée générale sans présence physique de copropriétaires
1° Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relatives à la participation des copropriétaires à l’assemblée générale et au vote par correspondance
- Participation des copropriétaires à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique
Dans le but de lutter contre l’absentéisme endémique qui frappe les assemblées générales des copropriétaires, la loi « Elan » n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8) a permis une évolution des modalités de participation à l’assemblée générale à l’image de ce qui se fait déjà depuis de nombreuses années en droit des sociétés. Elle a créé un article 17-1 A (N° Lexbase : L6780LNG) dans la loi du 10 juillet 1965, qui permet aux copropriétaires de « participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification » renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir les conditions d’identification des copropriétaires usant de ces moyens de communication.
Ces conditions ont été définies par l’article 6 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 (N° Lexbase : L6760LQG) qui a créé un article 13-1 dans le décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L1276LRP) exigeant que « l'assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant » étant précisé que la décision doit être prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l’initiative du syndic ou du conseil syndical et que les coûts sont supportés par le syndicat des copropriétaires. Le même texte précise dans son dernier alinéa que : « pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ». D’autres dispositions du décret de 2019 ont modifié l’article 14 du décret de 1967 sur la tenue de la feuille de présence et l’article 17 relatif au procès-verbal afin de tenir compte de ces nouvelles modalités de participation à distance des copropriétaires.
Ainsi, depuis le 29 juin 2019 [9], il appartient à l’assemblée générale de délibérer, par un vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 [10], sur les modalités de mise en œuvre techniques et financières permettant aux copropriétaires de participer à distance à l’assemblée générale. Or, force est de constater que bien peu de copropriétés ont délibéré sur cette question qui, à l’époque, ne semblait pas prioritaire alors qu’elle se révèle aujourd’hui impérieuse et c’est bien l’absence de délibération préalable de l’assemblée générale qui empêche les assemblées générales de se tenir à distance. Cette condition devait donc être écartée pour faciliter la prise de décision en assemblée générale et cette mesure devra être accompagnée rapidement de la mise en application du vote par correspondance pour que le dispositif soit pleinement efficace.
- Vote par correspondance
Alors qu’il avait toujours été écarté en copropriété du fait de la « souveraineté » de la réunion d’assemblée générale, lien d’échanges et de discussions entre les copropriétaires, la loi « Elan » du 23 novembre 2018 a fait du vote par correspondance une modalité de participation à l’assemblée générale. Dans sa rédaction initiale, l’alinéa 2 de l’article 17-1 A nouveau la loi du 10 juillet 1965, prévoyait que les mentions du formulaire et ses modalités de remise au syndic devaient être définies par décret du Conseil d’Etat. Or, ni le décret du 27 juin 2019 précité pris pour l’application des dispositions de la loi « Elan », ni aucun autre décret n’ont précisé ces modalités d’application, empêchant cette nouvelle modalité de vote d’entrer en vigueur. La situation s’explique par la rédaction quelque peu maladroite des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 17-1 A qui, au mépris de l’esprit et de la lettre de la loi du 10 juillet 1965, identifiaient le copropriétaire exprimant une abstention dans le formulaire comme un copropriétaire opposant.
Les critiques de la doctrine ont été vives et le texte a été réécrit par l’article 35 de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : Z955378U) dont les dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2020 qui supprime toute référence aux « formulaires ne donnant aucun sens précis de vote ou exprimant une abstention ». Par ailleurs, si les modalités de remise au syndic du formulaire doivent toujours être précisées par décret en Conseil d’Etat qui devrait paraître très prochainement, le formulaire sera établi « conformément à un modèle fixé par arrêté ». En conséquence, à ce jour, la mise en application du vote par correspondance en assemblée générale est conditionnée par la publication du décret modifiant le décret du 17 mars 1967 et de l’arrêté fixant le modèle de formulaire de vote.
C’est dans ce contexte qu’interviennent les nouvelles dispositions des article 22-2 à 22-4 de l’ordonnance du 20 mai 2020.
2° Possibilité pour le syndic de décider de la tenue d’une assemblée générale sans la présence physique des copropriétaires
Art. 22-2.-I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
« Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
« II. ‒ Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Art. 22-5.-Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation. »
En application de l’alinéa 1 de l’article 22-2 I de l’ordonnance, le syndic peut, par dérogation aux dispositions de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, l’alinéa 2 prévoit que les copropriétaires participent à l'assemblée générale « par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification ». Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale
La tenue d’assemblée générale entièrement dématérialisée n’est pas une obligation pour le syndic mais une simple faculté. Ainsi pour les copropriétés ayant un nombre de copropriétaires inférieur à dix, le syndic pourrait décider sous réserve de respecter les mesures prescrites pas le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 de ne pas faire application de ces dispositions dérogatoires et de tenir une assemblée générale en présentiel en application de l’alinéa 1 de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, le pouvoir de décider de tenir une assemblée générale sans présence physique des copropriétaires appartient au syndic seul, qu’il soit professionnel ou non, sans avoir besoin de l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. L’accord de l’assemblée n’est requis ni pour décider du principe de la tenue de l’assemblée générale à distance ni pour décider des moyens et supports techniques permettant la participation des copropriétaires par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique (v. art. 22-5 nouveau). C’est tout l’intérêt du dispositif qui déroge à l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967.
Le texte n’envisage pas non plus que le syndic sollicite au préalable l’avis du conseil syndical mais il est probable qu’en pratique, dans un esprit de collaboration, la décision sera prise en concertation avec le conseil syndical associé à la préparation de l’ordre du jour [11]. Enfin, aucun copropriétaire ne pourrait contraindre le syndic de faire application des dispositions de l’article 22-2.
La disposition étant dérogatoire, elle doit être strictement interprétée et, limitée au syndic[12] et non pas étendue aux autres personnes qui pourraient être amenées à convoquer l’assemblée générale durant la période juridiquement protégée [13]. Enfin, toutes les assemblées des copropriétaires qu’elles soient générales ou spéciales pourront être tenues selon ces nouvelles modalités sur décision du syndic.
L’alinéa 3 de l’article 22-2 précise que, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Cette précision est importante, car au lendemain de la loi « Elan » qui a consacré le vote par correspondance sans le limiter par rapport aux autres modalités de participation à l’assemblée générale, la doctrine s’est interrogée sur la validité d’une assemblée générale où tous les copropriétaires voteraient par correspondance sans aucune présence physique le jour de la réunion ce qui ne permettrait pas le respect des dispositions de l’article 15 du décret de 1967 imposant la désignation du bureau en début de réunion [14]. Par dérogation, l’article 22-2, alinéa 3, affirme la validité d’une assemblée générale au cours de laquelle les décisions seraient prises au seul moyen de votes par correspondance et règle au 4° de l’article 22-3 la question de la désignation du président de séance ; toutefois, cette faculté est conditionnée à la preuve par le syndic de l’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique. Primauté est donc donnée à la participation des copropriétaires à l’assemblée générale à distance et non pas à la seule consultation écrite.
Enfin, le paragraphe II de l’article 22-2 prend le soin de préciser que, pour les assemblées générales qui auraient déjà été convoquées avant l’entrée en vigueur du dispositif, le syndic est en droit d’avoir recours à ces nouvelles possibilités à condition d’en informer les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée « par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information ». Cette disposition concerne les quelques assemblées générales qui auraient été convoquées depuis la levée partielle du confinement le 11 mai 2020. Il sera prudent que l’information aux copropriétaires résulte d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès de chaque copropriétaire.
- Dérogations aux règles de convocations de l’assemblée générale
Art. 22-3.-Lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9,14,15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
« 1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;
« 2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ;
« 3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale ;
« 4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé.
L’article 22-3 de l’ordonnance précise les modalités d’application des dispositions de l’article 22-2 par dérogation aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967.
- Absence d’indication du lieu de réunion dans la convocation
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5600IGI), relatif au contenu de la convocation d’assemblée générale, exige qu’elle contienne l’indication du lieu de réunion qui doit se situer, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, dans la commune de situation de l’immeuble. Le texte précise qu’à défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, c’est la personne qui convoque l’assemblée qui en fixe le lieu. Cette mention est prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale [15].
Par dérogation à l’article 9 du décret de 1967, l’article 22-3, 1° prescrit que lorsque le syndic prend la décision qu’aucune personne physique ne participera à la réunion, l’assemblée générale pourra être convoquée « sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ». L’absence de cette mention ne pourra donc pas fonder une demande en nullité de l’assemblée générale dans les conditions de l’article 42, alinéa 2.
- Obligation de mentionner dans la convocation les modalités de participation à l’assemblée générale
En application de l’article 22-3, 2° de l’ordonnance, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Cette mention permet d’informer les copropriétaires de la décision du syndic de tenir l’assemblée générale sans leur présence physique et de leur préciser les modalités particulières et les supports techniques qui seront utilisés pour participer à l’assemblée générale.
Remarquons que le texte n’écarte pas l’application de l’article 13-2 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L1278LRR) qui impose au copropriétaire qui souhaite participer à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique d’en informer par tout moyen le syndic trois jours francs au plus tard avant la tenue de la réunion de l’assemblée générale. Les copropriétaires étant peu habitués à ces nouvelles modalités de participation à l’assemblée générale, il sera opportun que le syndic rappelle cette obligation aux copropriétaires dans la convocation.
Dans l’hypothèse où le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique ne serait pas possible, le syndic devra préciser dans la convocation que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance.
Dans tous les cas, le formulaire de vote par correspondance, qui sera fixé par arrêté à paraître devra être joint à la convocation. Ses modalités de remise aux syndics seront précisées par décret et devront être respectées pour que le vote soit pris en considération.
- Dérogation relative à la désignation du président de séance dans le cas où les copropriétaires ne pourraient voter que par correspondance
La tenue d’une assemblée générale à distance n’écarte pas l’obligation prévue à l’article 15 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5501IGT) de désigner, « au début de la réunion », un président de séance et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs étant rappelé qu’en principe le secrétariat de la séance est assuré par le syndic sauf décision contraire de l’assemblée générale. Si la désignation d’un ou plusieurs scrutateurs n’est qu’éventuelle et peut être écarté en cas d’impossibilité de désignation [16], celle du président de séance est considérée comme une formalité substantielle qui conditionne la validité de l’assemblée générale [17]. Or, si la désignation d’un président de séance, en début de réunion, est possible dans le cas où les copropriétaires participent à l’assemblée générale à distance, elle ne l’est plus lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, puisque, par principe, il n’y a plus de réunion et que l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 interdit au syndic de présider l’assemblée générale.
L’article 22-3, 4° règle la situation en décidant que les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 sont assurées par « le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic ». Compte tenu des circonstances particulières dans la mesure où il n’y aura pas eu de réunion d’assemblée générale au cours de laquelle il aurait veillé au respect de l’ordre du jour et mené les débats, la mission du président de séance se limitera à certifier exacte la feuille de présence et à signer le procès-verbal de la réunion dans les conditions prévues au 3° de l’article 22-3 de l’ordonnance.
- Dérogations relatives à la certification de la feuille de présence et la signature du procès-verbal
L’article 14 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5500IGS), relatif à la tenue de la feuille de présence a été modifié par le décret du 27 juin 2019 pour tenir compte des nouvelles modalités de participation des copropriétaires à l’assemblée générale. Ainsi, si le syndic est obligé de tenir la feuille de présence, il est déjà expressément prévu que l’émargement n’est pas requis pour les participants à l’assemblée par visioconférence, par audioconférence ou par un moyen électronique de communication. Le prochain décret modifiant le décret du 1967 pour préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance du 30 octobre 2019, portant réforme du droit de la copropriété, devrait préciser les mentions à porter sur la feuille de présence concernant les copropriétaires ayant voté par correspondance.
L’article 14 impose, par ailleurs, que la feuille de présence soit « certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale ». A titre dérogatoire, dans le cas où aucun copropriétaire ne participe physiquement à l’assemblée et que le syndic ne peut être désigné président de séance [18], l’article 22-3 3° donne au président de séance qui aura été désigné en début de réunion à distance ou à celui qui aura été désigné en application des dispositions de l’article 22-3, 4° dans le cas où les copropriétaires n’auront pu voter que par correspondance, un délai de huit jours après la tenue de l’assemblée générale pour certifier exacte la feuille de présence qui aura été établie par le syndic.
Le même délai s’applique au président de séance et aux éventuels scrutateurs désignés le jour de la réunion qui se serait tenue à distance, pour signer le procès-verbal des décisions de l’assemblée générale nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 17 du décret de 1967 (N° Lexbase : L5503IGW) qui prescrit qu’il doit être signé « à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ».
III. Accroissement des possibilités de représentation des copropriétaires à l’assemblée générale
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4822AH3) permet à tout copropriétaire de déléguer son droit de vote à un mandataire de son choix, mais afin de préserver la participation des copropriétaires à la réunion d’assemblée générale, il limite à trois le nombre de délégations de vote que peut recevoir un mandataire. Face à l’absentéisme patent des copropriétaires, le législateur de 2018 (loi « Elan ») a permis qu’un copropriétaire puisse recevoir plus de trois délégations de votes si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat au lieu des 5 % précédemment fixés. Ce seuil est temporairement relevé à 15 % pour toutes les assemblées générales qui se tiendront entre le 1er juin 2020 et le 31 janvier 2021.
La mesure est destinée à permettre une représentation accrue des copropriétaires qui pourraient, du fait des risques sanitaires qui n’ont pas disparu, être réticents à assister physiquement à l’assemblée générale dans les prochaines semaines ou les prochains mois mais également ceux dépourvus des équipements permettant la mise en œuvre de la participation à l’assemblée générale à distance.
Dans le communiqué de presse du Gouvernement le 20 mai 2020, le ministre Julien Denormandie justifiait les nouvelles dispositions dans ces termes : « Les visites virtuelles et la dématérialisation des actes notariés ont d’ores et déjà permis aux Français de continuer à se projeter dans leur projet immobilier. Aujourd’hui, le Gouvernement en permettant la dématérialisation des assemblées générales de copropriété à partir du 1er juin facilite la prise de décisions et assure la continuité de leur fonctionnement. C’est une simplification considérable très attendue par les millions de Français qui vivent en copropriété ». Gageons que les syndics et les copropriétaires s’emparent sans réticence de ce dispositif permettant d’ancrer le droit de la copropriété dans l’ère des nouvelles technologies et que de temporaire, il puisse, au moins pour parti, se pérenniser au-delà du 31 janvier 2021.
[1] Ou plus tard, si l’état d’urgence sanitaire était prorogé.
[2] V. L. Guegan-Gélinet, Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et le renouvellement du contrat de syndic pendant la période de Covid-19, Revue des loyers n°1006, 1er avril 2020.
[3] V. L. Guegan-Gélinet, Covid-19 : le renouvellement du contrat du syndic et la désignation du conseil syndical après l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, Revue des loyers, n° 1007, 1er mai 2020.
[4] L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée concernait les contrats expirant entre le 12 mars 2020 et « l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ».
[5] L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée exigeait que la prise d’effet du nouveau contrat du syndic intervienne « au plus tard huit mois après la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ».
[6] Cette date pouvant être modifiée en cas de modification de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
[7] Voir le rapport au Président de la république (N° Lexbase : Z972139T), relatif à l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (publié au Journal officiel du 21 mai 2020).
[8] V. ordonnance du 20 mai 2020, art. 16.
[9] Date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019.
[10] A défaut de précision dans l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L1276LRP) d’application d’une autre majorité.
[11] V. décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 26 (N° Lexbase : L5516IGE).
[12] Auquel doivent être assimilés le syndic judiciaire et l’administrateur ad hoc.
[13] Voir, pour le président du conseil syndical, en application de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : Z45709RS), ou pour un copropriétaire, en application de l’article 17, dernier alinéa, de loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : Z80645RR).
[14] V. F. Bayard-Jammes, La prise de décisions par le syndicat des copropriétaires : constats et perspectives, AJDI, juillet 2019.
[15] En application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5499IGR).
[16] V. sur les conséquences de l’absence de désignation d’un scrutateur en l’absence de candidat, Cass. civ. 3, 30 septembre 2015 n° 14-19.858, FS-P+B (N° Lexbase : A5626NS8).
[17] V. Cass. civ. 3, 14 décembre 2010, n° 09-71.974, F-D (N° Lexbase : A2677GNH).
[18] V. loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 22 (N° Lexbase : L4822AH3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473435
[Brèves] Prolongation des détentions provisoires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : conventionnalité et renvoi de QPC
Réf. : Cass. crim., 26 mai 2020, deux arrêts, n° 20-81.910 (N° Lexbase : A13833M8) et n° 20-81.971 (N° Lexbase : A13843M9) FS-P+B+I
Lecture: 6 min
N3486BYR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 27 Mai 2020
► La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux arrêts qui tranchent plusieurs questions de principe concernant l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI ; v. le commentaire de J.-B. Thierry, La procédure pénale confinée par voie d’ordonnance : commentaire de l’ordonnance « covid-19 », Lexbase Pénal, avril 2020 N° Lexbase : N3033BYY) qui porte sur les prolongations de plein droit de détention provisoire, dans un contexte d’insécurité juridique importante ;
Cet article prévoyant la prolongation de plein droit des détentions provisoires soulevait une difficulté majeure d’interprétation, suscitant des divergences d’analyse par les différentes juridictions de première instance comme d’appel ;
Elle transmet également à cette occasion deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la loi d’habilitation du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT) sur le fondement de laquelle l’article 16 a été adopté (Cass. crim., 26 mai 2020, deux arrêts, n° 20-81.910 N° Lexbase : A13833M8 et n° 20-81.971 N° Lexbase : A13843M9, FS-P+B+I).
Contexte. La difficulté existante tenait à l’adoption à l’adoption, dans l’ordonnance du 25 mars 2020, de l’article 16, qui prévoyait une prolongation de plein droit des « délais maximums de détention provisoire ». Cet article avait alors soulevé plusieurs interrogations :
- quelle interprétation devait être donnée à l’expression « délais maximums » et « prolongés de plein droit » ?
- l’ordonnance avait-elle excédé les limites de l’habilitation législative ?
- l’article 16 est-il conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles en matière de liberté individuelle ?
Leurs enjeux sont considérables dès lors que l’article 16 a vocation à s’appliquer à toutes les détentions provisoires en cours, qu’elles soient pendant l’information judiciaire ou après règlement de la procédure jusqu’à la condamnation définitive.
S’agissant de l’interprétation de l’article 16 de l’ordonnance
La difficulté était la suivante : l’expression « délais maximums de détention provisoire » désigne-t-elle la durée totale de la détention susceptible d’être subie après l’ultime prolongation permise par le Code de procédure pénale ou la durée au terme de laquelle le titre de détention cesse de produire effet en l’absence de décision de prolongation ?
Pour répondre à cette question, dans une motivation dite enrichie, la Chambre criminelle développe le raisonnement suivant :
- l’expression « délais maximum de détention provisoire », ne permet pas, à elle seule, de déterminer la portée de l’article 16 ;
- les autres articles de l’ordonnance ne permettent pas davantage d’interpréter de façon évidente, dans un sens ou dans un autre, les termes de « délais maximums » ;
- en revanche, l’expression « prolongation de plein droit » des délais maximums de détention provisoire ne peut être interprétée que comme signifiant l’allongement de ces délais, pour la durée mentionnée à l’article 16, sans que ne soit prévue l’intervention d’un juge ;
- or, il serait paradoxal que l’article 16 ait prévu que l’allongement de la durée totale de la détention s’effectue sans intervention judiciaire tandis que l’allongement d’un titre de détention intermédiaire serait subordonné à une décision judiciaire prise en application de l’article 19 de l’ordonnance.
Elle en déduit que l’article 16 doit être interprété comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, et ce à une reprise au cours de chaque procédure. Par voie de conséquence, dans les deux affaires soumises à son examen, la Chambre criminelle écarte les griefs par lequel les demandeurs aux pourvois reprochaient aux chambres de l’instruction d’avoir interprété l’article 16 dans le même sens.
Sur la conformité de l’article 16 de l’ordonnance à la loi d’habilitation
La Chambre criminelle considère qu’en prévoyant la prolongation de plein droit des titres de détention, pour les durées prévues à l’article 16 de l’ordonnance, le Gouvernement n’a pas excédé les limites de la loi d’habilitation.
La Cour de cassation rappelle que la chambre criminelle n’a que rarement été amenée à examiner la conformité d’une ordonnance à la loi d’habilitation législative (Cass. crim., 17 novembre 2009, n° 09-81.531, F-D N° Lexbase : A4614EPL).
Sur l’examen de la constitutionnalité de la loi d’habilitation et de l’article 16 de l’ordonnance
La Cour de cassation retient que l’article 11 de la loi du 23 mars 2020, en ce qu’il pourrait ne pas préciser suffisamment les modalités de l’intervention du juge judiciaire lors de l’allongement des délais de détention, pose, au regard de l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), une question sérieuse, justifiant le renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité des demandeurs au Conseil constitutionnel. Le grief pris de la violation de l’article 66 de la Constitution par l’article 16 de l’ordonnance est irrecevable, en application de la théorie de la « loi-écran ».
Dans les deux procédures, les prévenus ont saisi la Chambre criminelle d’une QPC qui peut être résumée en substance ainsi : l’article 11 de la loi du 23 mars 2020, à supposer qu’il crée une prolongation de plein droit de toute détention sans intervention du juge, est-il contraire à l’article 66 de la Constitution ?
Sur l’examen de la conventionnalité de l’article 16
La Chambre criminelle considère que l’article 16 de l’ordonnance n’est compatible avec l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4786AQC) et la prolongation qu’il prévoit n’est régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention prend, dans un délai rapproché courant à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention. Ce délai ne peut être supérieur à un mois en matière délictuelle et à trois mois en matière criminelle ainsi qu’en cas d’appel d’une décision de condamnation.
Sur ce point, les moyens des demandeurs ont conduit la Chambre criminelle à se pencher sur la question inédite suivante : dans quelle mesure la prolongation, de par l’effet de la loi, sans intervention d’un juge, d’un titre de détention venant à expiration est-il conforme à l’article 5 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l’Homme garantissant « le droit à la liberté et à la sûreté » ?
Pour la motivation détaillée, nous recommandons aux lecteurs de se reporter à la notice explicative disponible sur le site de la Cour de cassation.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473486
[Brèves] Publication d’une seconde ordonnance adaptant le droit des entreprises en difficulté aux conséquences de l’épidémie de covid-19
Réf. : Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L1695LX3)
Lecture: 4 min
N3399BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 27 Mai 2020
► Prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), une seconde ordonnance, publiée au Journal officiel du 21 mai 2020, apporte des adaptations en droit des entreprises en difficulté (ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 N° Lexbase : L1695LX3).
Pour rappel, une première ordonnance (ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 N° Lexbase : L5884LWT) a apporté une première réponse aux difficultés immédiates rencontrées par les entreprises et exploitations agricoles. Selon le rapport au Président de la République, l’ordonnance du 20 mai 2020 a pour objet, d'une part, de consolider les dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020 et, d'autre part, d'adapter les dispositions du livre VI du Code de commerce afin de les rendre plus efficaces en fonction des spécificités liées à la nature exceptionnelle de la crise sanitaire. Voici une présentation rapide de ses dispositions.
L’article 1er permet une transmission plus précoce de l’information au président du tribunal par le commissaire aux comptes dans la cadre de la procédure d’alerte.
L’article 2, relatif à la conciliation, permet au débiteur de saisir le président du tribunal pour qu’il ordonne un certain nombre de mesures proches de celles qui sont prévues en cas d'ouverture d'une procédure collective : interruption et interdiction des actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent, arrêt et interdiction des procédures d’exécution, ou encore report et rééchelonnement des sommes dues.
L’article 3 écarte les conditions de seuils pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou d’une procédure de sauvegarde accélérée. Il prévoit également la possibilité, avant même la cessation de leurs fonctions, pour l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de former une demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
L’article 4 est relatif à l’adoption des plans de sauvegarde et de redressement. Il est prévu un raccourcissement à 15 jours des délais de consultation des créanciers par le juge-commissaire, ainsi qu’un allègement des formalités de consultation des créanciers. Le troisième alinéa de l'article 4 autorise, à titre temporaire, que les engagements pour la mise en œuvre du plan portent sur un passif prévisible et suffisamment vraisemblable pour permettre au tribunal d'apprécier le caractère sérieux du projet de plan qui lui sera soumis.
L’article 5 s’intéresse à l'exécution des plans de sauvegarde et de redressement. L'ordonnance du 27 mars 2020 prévoit la possibilité de prolonger la durée d'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement ; l'article 5 de l'ordonnance du 20 mai le permet, dans la limite supplémentaire de deux ans. Il introduit également un nouveau privilège au bénéfice des personnes qui consentent un nouvel apport de trésorerie au débiteur pendant la période d'observation et à celles qui s'engagent, pour l'exécution du plan arrêté ou modifié par le tribunal, à effectuer un tel apport.
L’article 6 écarte, en premier lieu, les conditions de seuils prévus pour la liquidation judiciaire simplifiée pour les personnes physiques dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, tout en réservant la possibilité, pour le tribunal de ne pas faire application de cette procédure pour les entreprises comptant au moins six salariés. En second lieu, cet article réhausse à 15 000 euros le plafond de l’actif des débiteurs pouvant bénéficier d’un rétablissement professionnel.
L’article 7 met en place des mesures pour faciliter le maintien d'emplois dans le cadre d'une cession de l'entreprise en liquidation judiciaire, notamment en réduisant les délais de procédure.
L’article 8 ramène à un an le délai au terme duquel est radiée du RCS la mention d'une procédure collective, lorsque le plan arrêté est toujours en cours.
L’article 9 vient préciser les durées prévues par l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020.
Enfin, l’article 10 vient préciser l’application dans le temps. En premier lieu, les dispositions introduites par l’ordonnance s'appliquent aux procédures en cours, à l’exception des dispositions qui affectent les droits des créanciers dans la procédure. Il distingue, en outre les dispositions qui demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2020, et celles qui demeurent applicables au plus tard, jusqu'à la date à laquelle la Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 (N° Lexbase : L6745LQU) doit être transposée et au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473399
[Pratique professionnelle] Contrôles de l’activité partielle : ce qui doit être anticipé
Lecture: 15 min
N3472BYA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliana Kovac et Emmanuel Raynaud, Avocats Associés, Flichy Grangé Avocats
Le 27 Mai 2020
Depuis le mois de mars 2020, les entreprises ont massivement utilisé le dispositif d’activité partielle (communément appelé chômage partiel). Au 12 mai 2020, plus d’un million d’entreprises ont déposé une demande d’autorisation d’activité partielle pour 12,4 millions de salariés (soit six emplois sur dix dans le secteur privé).
Dès le 29 mars 2020, la ministre du Travail a indiqué que des contrôles seraient mis en œuvre en rappelant que la fraude à l’activité partielle constitue du travail illégal (qui, pour mémoire, recouvre six infractions dont la fraude à l’activité partielle et le travail dissimulé).
Le 5 mai 2020, la ministre du Travail a envoyé aux Préfets et aux Direccte une instruction relative au plan de contrôle a posteriori sur l’activité partielle, complétée par une instruction du 14 mai 2020 commune à la Direction générale du travail et à la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.
1 - Quels sont les objectifs des contrôles ?
En l’état, deux objectifs sont fixés par l’administration, à savoir la lutte contre la fraude et la régularisation des demandes d’indemnisation mal renseignées. Pour l’heure, le contrôle de l’application des exonérations sociales par les Urssaf n’est pas cité. Il doit néanmoins, lui aussi, être anticipé.
2 - Quelles entreprises vont être prioritairement contrôlées ?
Le ministère du Travail a demandé aux Direccte de contrôler prioritairement les entreprises ayant formulé des demandes d’indemnisation sur la base de taux horaires élevés, celles qui appartiennent à des secteurs d’activité ayant le plus utilisé l’activité partielle (le BTP, les activités de services administratifs, de soutien et de conseil aux entreprises) et celles qui emploient majoritairement des cadres susceptibles de télétravailler.
Les Direccte sont, en outre, invitées à contrôler les entreprises qui leur seront signalées par des salariés, des syndicats ou des CSE.
3 - Quand vont commencer les contrôles ?
Les contrôles par l’Agence de services et de paiement (ASP) et les Direccte ont d’ores et déjà commencé.
En revanche, l’Urssaf dispose de plus de temps.
D’abord, les délais relatifs au contrôle de l’Urssaf sont actuellement suspendus et ce, jusqu’au 30 juin 2020 inclus (sauf en cas de travail dissimulé) (v. ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5739LWH, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 N° Lexbase : L9169LWI).
Ensuite, en application des articles L. 244-3 (N° Lexbase : L0463LC7) et L. 244-11 (N° Lexbase : L0470LCE) du Code de la Sécurité sociale, l’Urssaf dispose d’un délai de trois ans pour procéder à un redressement, voire de cinq ans en cas de procès-verbal de travail illégal. Les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle pourraient donc être contrôlées par les Urssaf au moins jusqu’en 2023, voire 2025.
4 - Comment vont se dérouler les contrôles ?
Plusieurs acteurs sont mobilisés au niveau national (création d’un comité ad hoc dédié) et régional.
Les premiers contrôles vont être mis en œuvre par l’ASP. Elle va procéder à un contrôle sur pièces sur la base des demandes d’indemnisation reçues ainsi que l’ensemble des données dont elle dispose. Le ministère du Travail invite les différents acteurs à « croiser » leurs informations. Les Direccte ont à cet égard accès aux éléments transmis à l’ASP. De même, des travaux sont en cours pour permettre de croiser les données qui figurent dans les bases de l’ASP et les Déclarations Sociales Nominatives (DSN).
Si ce premier contrôle révèle des anomalies, un contrôle complémentaire sera mis en œuvre par les Direccte et les inspecteurs du travail, en lien notamment avec les inspecteurs du recouvrement.
5 - En quoi consiste le contrôle initial de l’ASP ?
L’ASP est chargée du « contrôle sur pièces ».
Pour cela, elle dispose d’un grand nombre d’informations telles que les informations relatives à l’identité de l’employeur, les informations relatives à l’identité des salariés (catégorie socioprofessionnelle, mode d’aménagement du temps de travail, nombre d’heures chômées et nombre d’heures ouvrant droit à indemnisation, etc.) et les données inscrites sur les bulletins de paie (classification conventionnelle, nombre d’heures de travail dont les heures supplémentaires, montant de la rémunération brute du salarié, dates des congés et montant de l’indemnité de congés payés, etc.) (C. trav., art. R. 5122-5 N° Lexbase : L6070I39 et R. 5122-21 N° Lexbase : L5814LWA).
Toutes ces informations donnent lieu à un traitement automatisé de la part de l’ASP (C. trav., art. R. 5122-20 N° Lexbase : L6077I3H et R. 5122-21 N° Lexbase : L5814LWA). D’autres acteurs telle que la Direccte y ont accès (C. trav., art. R. 5122-22 N° Lexbase : L6075I3E).
6 - En quoi consiste le contrôle complémentaire de l’inspecteur du travail et quels sont ses pouvoirs ?
Si le contrôle sur pièces par l’ASP révèle une fraude ou nécessite des investigations plus approfondies, un contrôle complémentaire sera mis en œuvre par la Direccte.
L’inspecteur du travail est doté de pouvoirs d’enquête très invasifs en matière de travail illégal. Il peut entrer dans l’entreprise (C. trav., art. L. 8113-1 N° Lexbase : L7449K9R), sans en avertir l’employeur (C. trav., art. R. 8124-25, al. 2 N° Lexbase : L9468LDZ) et demander communication d’un très grand nombre de documents sociaux, administratifs et comptables (C. trav., art. L. 8113-4 N° Lexbase : L7447K9P et L. 8113-5-1 N° Lexbase : L9790LL8).
Il a accès aux logiciels et aux données stockées comme les logiciels de décompte du temps de travail, les boîtes emails, les invitations Outlook, Zoom, l’intranet, etc. (C. trav., art. L. 8113-5-1, al.2 N° Lexbase : L9790LL8). Dans le cadre de l’activité partielle, il peut demander, en plus des documents habituels (contrats de travail, registre du personnel, double des bulletins de salaire), les documents relatifs au temps de travail (aménagements et décomptes), les DSN, les conventions et accords sur l’activité partielle (voire la décision unilatérale de l’employeur), la demande d’activité partielle elle-même, l’avis du CSE, les documents comptables attestant des difficultés économiques rencontrées, les demandes d’indemnisation, les états nominatifs de remboursement et les avis de paiement.
Il peut recueillir des informations directement auprès des salariés, y compris par l’envoi de questionnaire à leur domicile pour ceux qui seraient toujours en télétravail (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-14.388, FS-P+B N° Lexbase : A2252GXP) et leur demander communication de tout élément permettant de démontrer la réalisation d’un travail effectif, comme des plannings, emails, relevés d’appels, SMS, etc. (C. trav., art. L. 8113-1 N° Lexbase : L7449K9R).
L’inspecteur du travail peut enfin procéder à l’audition de toute personne susceptible de fournir des informations utiles, avec son consentement (salariés, responsable RH, responsable de l’activité partielle, employeur ou son représentant etc.) en quelque lieu que ce soit, y compris à son domicile (C. trav., art. L. 8271-6-1 N° Lexbase : L5006K8W). Il peut également entendre toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction dans le cadre de l’audition pénale libre comme il en a désormais la faculté en matière de travail illégal (C. trav., art. L. 8271-6-1, al. 2 N° Lexbase : L5006K8W et CPP, art. 28 N° Lexbase : L5210LRE et 61-1 N° Lexbase : L7470LPD).
L’analyse croisée de ces documents et informations lui permettra, le cas échéant, de relever différents comportements infractionnels et d’en dresser procès-verbal.
7 - En quoi consiste le contrôle complémentaire de l’Urssaf et quelles sont les prérogatives de l’inspecteur du recouvrement ?
L’Urssaf a des prérogatives importantes. Elle peut contrôler le calcul des cotisations sociales et des exonérations afférentes à l’activité partielle ainsi que le travail illégal.
S’agissant du travail illégal, l’Urssaf peut intervenir de trois façons :
- elle peut procéder à un redressement sur la base du constat de travail dissimulé dressé par l’inspection du travail (C. trav., art. L. 8271-6-4 N° Lexbase : L0188LCX et CSS, art. L. 243-7-5 N° Lexbase : L8842LKP) ;
- elle peut se présenter en vue de rechercher uniquement des faits de travail dissimulé à l’instar de l’inspection du travail. L’Urssaf dispose, dans ce cadre, de pouvoirs similaires à ceux de l’inspecteur du travail ;
- elle peut se présenter pour un contrôle classique et, à l’occasion de ses vérifications, constater des faits de travail dissimulé. Le contrôle est alors effectué dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 243-7 N° Lexbase : L4623LW7 et R. 243-59 N° Lexbase : L9076LSX).
Lors du contrôle classique, l’Urssaf dispose de nombreuses prérogatives.
Elle peut notamment demander à l’employeur tout document nécessaire à l'exercice de son contrôle ainsi que l’accès à tout support d’information et interroger les personnes rémunérées (CSS, art. R. 243-59 N° Lexbase : L9076LSX).
Elle peut également utiliser le matériel informatique de l’employeur (CSS, art. R. 243-59-1 N° Lexbase : L2869K97).
Elle peut, enfin, utiliser le contrôle par échantillonnage et extrapolation (CSS, art. R. 243-59-2 N° Lexbase : L2868K94). Ce procédé est souvent utilisé lorsque le contrôle sur une base réelle est impossible à réaliser compte tenu du nombre de salariés concernés et de pièces à contrôler (par exemple, frais professionnels, primes de panier). Il pourrait ainsi être particulièrement adapté au contrôle de l’activité partielle.
8 - Quelles sont les issues possibles des contrôles ?
Plusieurs situations peuvent être envisagées.
→ Les demandes d’indemnisations peuvent-elles être régularisées ?
Les demandes d’indemnisation pourront, en premier lieu, être régularisées si le contrôle révèle des erreurs de la part de l’entreprise, voire de l’administration.
Les Direccte sont invitées à encourager les entreprises, en cas d’erreur de leur part, à régulariser la situation d’elles-mêmes et à leur appliquer le droit à l’erreur tel que défini par l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration (N° Lexbase : Z09224Q3). Rappelons que ce texte ne peut pas être invoqué en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Si l’entreprise refuse de régulariser d’elle-même la situation, en particulier, parce que l’analyse de la Direccte lui paraît susceptible d’être contestée, elle recevra une demande de remboursement de la part de l’administration. Cette décision pourra être contestée par la voie du recours hiérarchique ou contentieux.
→ L’administration peut-elle retirer les décisions d’autorisation et d’indemnisation ?
L’instruction du 5 mai 2020 rappelle qu’en application de l’article L. 241-2 du Code des relations entre le public et l’administration (N° Lexbase : L1853KNX), la Direccte dispose d’un délai de quatre mois pour retirer une décision d’autorisation. Le point de départ de ce délai est reporté, par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5730LW7), au 24 juin 2020. En cas de fraude, l’article L. 241-2 du même code permet à l’administration de retirer sa décision à tout moment.
L’administration a aussi la possibilité, en application de l’article L. 242-2 du Code des relations entre le public et l’administration (N° Lexbase : L1855KNZ), de retirer la décision d’indemnisation « sans condition de délai […] lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ».
Ces décisions de retrait doivent être précédées d’une procédure contradictoire (CRPA, art. L. 122-1 N° Lexbase : L1800KNY et L. 121-1 N° Lexbase : L1798KNW). Elles pourront, en outre, être contestées par la voie du recours hiérarchique et du recours contentieux. Un référé en vue d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision de retrait pourrait aussi être engagé.
Un retrait remet, en effet, en cause tout le régime de l’activité partielle. L’entreprise doit rembourser les allocations d’activité partielle à l’ASP, payer aux salariés leurs rémunérations, et verser aux organismes sociaux l’ensemble cotisations sociales y afférentes.
9 - Quelles sont les sanctions pénales et administratives encourues ?
La fraude de l’article L. 5124-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9344LNE).
Si l’employeur a effectué des demandes d’indemnisation pour des salariés en réalité placés en télétravail, redéployés à d’autres tâches, ayant posé des congés payés ou encore, en surévaluant les taux horaires, le délit de fraude à l’activité partielle pourrait trouver à s’appliquer (C. trav., art. L. 5124-1 N° Lexbase : L9344LNE).
L’auteur de cette infraction risquerait alors deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (C. pén. art. 441-6 N° Lexbase : L0848IZG) outre des peines complémentaires et des sanctions administratives telles que le refus d'octroi de certaines aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle pendant une durée maximale de cinq ans, y compris les allocations d’activité partielle et/ou le remboursement de ces aides pour les douze derniers mois précédant le procès-verbal de constat de travail illégal (C. trav., art. L. 8272-1 N° Lexbase : L5119IQN).
L’escroquerie. Si la déclaration mensongère est accompagnée d’éléments extrinsèques destinés à lui donner force et crédit, le délit d’escroquerie par l’emploi de manœuvres frauduleuses pourrait être envisagé (C. trav., art. L. 5124-1 N° Lexbase : L9344LNE et C. pén., art. 313-1 N° Lexbase : L2012AMH).
A cet égard, la Cour de cassation a pu considérer comme constitutif de manœuvres frauduleuses le fait de formuler des demandes d’indemnisation de chômage partiel en produisant des états nominatifs par salariés non conformes à l’accord de modulation du temps de travail ni à la réalité de l’activité durant la période concernée, confortées par le non-établissement de documents qui auraient permis de contrôler leur régularité (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-81.980, F-D N° Lexbase : A5807XUM).
Les sanctions encourues seraient alors portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende (3 750 000 euros d’amende pour les personnes morales) dès lors que l’infraction serait commise au préjudice d’une personne publique pour l’obtention d’une allocation indue, outre des peines complémentaires (C. pén., art. 313-2, al. 1er N° Lexbase : L0849IZH).
Le travail dissimulé par la dissimulation d’emploi salarié. Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est le fait de commettre un des agissements énumérés à l’article L. 8221-5 du Code du travail (N° Lexbase : L7404K94) tels que mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou éluder les cotisations sociales assises sur les rémunérations.
L’analyse des bulletins de paie, sur lesquels figurent notamment le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre l’activité partielle, pourrait ainsi permettre de relever cette infraction, étant précisé que la Cour de cassation a considéré en la matière que « la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal » (Cass. crim., 7 mai 2019, n° 17-86.428, FS-D N° Lexbase : A0683ZBW).
L’employeur encourt à ce titre trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende outre des peines complémentaires et des sanctions administratives telles que le refus et/ou le remboursement d’aides publiques dans les mêmes conditions que pour la fraude à l’activité partielle, la fermeture temporaire de l'établissement et l’exclusion temporaire des contrats administratifs (C. trav., art. L. 8272-2 N° Lexbase : L0322LMU et L. 8272-4 N° Lexbase : L7804I3G).
10 - Quelles peuvent être les conséquences d’un contrôle sur les cotisations sociales ?
Plusieurs situations peuvent être envisagées.
Si la décision d’autorisation est retirée, tout le dispositif d’activité partielle est remis en cause : les salaires doivent être payés, de même que l’ensemble des cotisations sociales dues.
Si c’est la décision d’indemnisation qui est retirée, tout dépend des motifs de cette décision. Si l’indemnisation est retirée parce que l’entreprise ne pouvait pas bénéficier de l’activité partielle, on se trouve dans la même situation que celle exposée plus haut. Si en revanche l’indemnisation est remise en cause pour des motifs qui lui sont propres, les conséquences pourraient être plus limitées. Il est possible, toutefois, que les erreurs commises dans le calcul des allocations d’activité partielle versées par l’ASP se retrouvent dans celui des indemnités versées aux salariés. Un redressement de la part de l’Urssaf pourrait, ainsi, être possible.
Qu’en est-il, pour finir, en l’absence de retrait des décisions d’autorisation ou d’indemnisation par la Direccte ? Un retrait par l’Urssaf est-il possible ? Non. Le retrait relève de la seule compétence des autorités administratives. L’Urssaf pourrait toutefois contrôler les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle et vérifier, par exemple, le calcul des limites d’exonération. Elle pourrait également vérifier que l’entreprise n’a pas versé, à tort, une indemnité d’activité partielle au lieu et place du salaire (jours fériés, congés payés). Les modalités de calcul de la « réduction Fillon » pourraient aussi être contrôlées et donner lieu le cas échéant à un redressement (CA Angers, 18 janvier 2018, n° 15/00475 N° Lexbase : A0986XB7 : sur une mauvaise proratisation du SMIC). Enfin, si à l’occasion de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement relève une fraude à l’activité partielle ou un travail illégal, il pourrait alerter la Direccte pour qu’elle en tire toutes les conséquences sur les décisions d’autorisation et d’indemnisation. L’inspecteur du recouvrement pourrait, de son côté, procéder aux redressements consécutifs à une telle infraction.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473472
[Questions à...] Responsabilité pénale des décideurs publics et urgence sanitaire - Questions* à Antony Taillefait, agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université d’Angers
Lecture: 15 min
N3391BYA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Antony Taillefait, agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université d’Angers
Le 28 Mai 2020
A l’heure d’une judiciarisation accrue de notre société et alors que plus de soixante plaintes ont déjà été déposées contre certains membres du Gouvernement pour que leur responsabilité dans la gestion de la crise du Covid-19 soit engagée, il faut constater que ce phénomène touche également les élus locaux, et particulièrement les maires, dont nombre d’administrés estiment qu’ils doivent être comptables des moindres désagréments, chutes ou accidents advenus sur le territoire de la commune. Si le citoyen doit évidemment pouvoir demander aux personnes investies d’un mandat local de répondre présents lorsqu’il est confronté à un disfonctionnement au niveau communal, on peut néanmoins se demander si cette tendance à vouloir trouver des coupables à tout prix n’est pas de nature à décourager les vocations et les volontés de s’investir au service de ses concitoyens. Pour faire le point sur ce sujet, Lexbase Hebdo – édition publique a rencontré Antony Taillefait, agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’Université d’Angers, conseiller municipal, communautaire et métropolitain.
Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler le cadre légal entourant la responsabilité pénale des élus ?
Les élus et les agents publics, comme l’ensemble des citoyens, sont soumis aux règles de droit commun de la procédure pénale ; n’échappent à ce droit commun que les ministres lesquels relèvent de la Cour de justice de la République.
Si on laisse de côté les cas d’improbité des décideurs publics (corruption, favoritisme, prise illégale d’intérêts, etc.), ce cadre légal ne peut être compris si nous n’avons à l’esprit le malaise qu’éprouvent les élus à son égard. Souvent, trop souvent à mon sens, ils estiment que la responsabilité politique, celle qui est engagée devant les électeurs lors du suffrage ou qui est engagée devant les représentants des électeurs, les députés, épuise leurs responsabilités personnelles de nature juridique. Au surplus, malgré des imperfections, ils observent que les régimes de responsabilité collective devant les juridictions administratives et civiles jouent leur rôle en offrant des possibilités d’indemnisation des victimes des préjudices résultant éventuellement de leurs actions publiques.
De leur côté les victimes de ces dommages ne s’en tiennent plus à un fatalisme qui progressivement atténuerait leurs tourments. La responsabilité de l’auteur du préjudice doit aussi faire une place à la recherche de son éventuelle culpabilité. Il devient de moins en moins supportable au sein de la société des individus qu’il ne soit pas possible de punir un décideur public qui cause même involontairement un dommage et qui se désintéresse des risques que ses actions font courir à autrui. Il s’en déduit assez logiquement que toute règle qui rend plus difficile l’engagement de la responsabilité des élus à raison de leurs actions est assez promptement qualifiée ici ou là de « loi scélérate ».
Au regard de ces considérations assez communes, c’est dire qu’il existe un déficit global de la responsabilité personnelle des décideurs et agents publics. Ce déficit est d’ailleurs plus fort au niveau des gouvernants. Jean-Michel Blanquer, Professeur de droit public spécialiste de ces questions juridiques et actuel ministre de l’Education nationale, démontrait dans une étude publiée par la revue Le Débat [1] les insuffisances de la responsabilité des gouvernants compte tenu de l’irresponsabilité du Président de la République, chef de l’Etat juridiquement le plus puissant des pays occidentaux, et de l’irresponsabilité politique de fait du gouvernement sous la Vème République : compte tenu du fait majoritaire, son action échappe à tout contrôle parlementaire sérieux susceptible de l’amener à démissionner.
Dans le champ répressif, la loi n’a pas répudié la faute même légère. Les défaillances de toutes sortes demeurent punissables lorsqu’elles sont en relation de causalité directe avec le dommage. En cas de causalité indirecte, le législateur en 1996, puis en 2000, a en quelque sorte tordu le bras à certains principes du droit pénal en imaginant des délits non intentionnels dans le champ l’action publique. L’objectif en 1996 comme en 2000 a été de lier la sanction pénale à la gravité de la faute.
Une première loi « Fauchon » du 13 mai 1996 (loi n° 96-393 du 13 mai 1996, relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence N° Lexbase : L3097AIK) avait modifié la rédaction de l’article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY) afin d’y inscrire le principe de l’appréciation in concreto de la faute d’imprudence, lequel principe a été maintenu par la seconde « loi Fauchon » du 10 juillet 2000 (loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels N° Lexbase : L0901AI9) et figure à l’article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4860LUK). La loi limite l’étendue de la responsabilité pénale des personnes physiques pour les infractions non intentionnelles.
Pour l’essentiel, les dispositions résultant de cette nouvelle rédaction de l’article 121-3 du Code pénal sont celles de son quatrième alinéa qui agence le critère du lien de causalité avec celui de l’importance de la faute en exigeant que celle-ci soit plus importante lorsque le lien de causalité est indirect. Cet alinéa dispose qu’en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
La notion de causalité indirecte vise ici deux situations où l’« auteur médiat », soit a créé (action ou omission) ou a contribué à créer la situation à l’origine de la réalisation du dommage, soit n’a pas pris les mesures qui aurait permis d’éviter le dommage. Le tribunal répressif peut donc retenir la responsabilité en cas de pluralité de causes indirectes et certaines et en cas de différentes contributions ayant créé la situation à l’origine du dommage. Tel a été le cas du maire qui s’est abstenu d’ordonner la fermeture d’une piste de ski avant qu’une avalanche prévue par les services de la météorologie nationale n’ensevelisse des skieurs. Tel a été le cas du proviseur et surtout de l’intendant qui n’ont pas pris les précautions indispensables pour assurer la sécurité des personnes, entraînant le décès d’un élève causé par la chute d’un panneau de basket (CAA Bordeaux, 4 mars 2004, n° 00BX02462 N° Lexbase : A6617DBP). En 2000, certaines affaires ont vu leur cours se modifier telle la relaxe en appel de la maire de l’Ile d’Ouessant condamnée en première instance pour ne pas avoir interdit la pratique du vélo sur le chemin des douaniers (CA Rennes, 19 septembre 2000, n° 99-01598 N° Lexbase : A22703MZ) ; un enfant ayant chuté du haut d’une falaise lors d’une sortie scolaire.
Lexbase : De quelle manière les juges judiciaire et administratif ont-il procédé à son application ?
Votre question m’amène à montrer que c’est à propos de la notion de faute exigée en cas de causalité indirecte que le juge était attendu après l’entrée en vigueur de la loi de 2000.
Ainsi donc en cas de causalité indirecte, l’engagement de la responsabilité pénale est possible si le décideur public a eu un comportement consistant, de manière alternative, en l’une des deux fautes suivantes : une faute de mise en danger délibérée ou une faute caractérisée exposant à un risque grave.
La première catégorie de fautes est celle en vérité exigée par l’article 223-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3399IQX) relatif à la mise en danger d’autrui : existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ce qui exclut les obligations générales ; démonstration que le décideur qui a connaissance de cette obligation prudence ou de sécurité a de manière manifestement délibérée choisi de ne pas la respecter. Cette notion de faute délibérée est somme toute assez restrictive et susceptible dans une certaine mesure de laisser échapper du champ de cette responsabilité pénale pas mal d’évènements et de situations. D’où une seconde catégorie de fautes soumises à l’appréciation des juridictions.
Les fautes caractérisées exposent à un risque grave que l’auteur médiat ne pouvait ignorer. De nombreuses conditions ont été prévues par le législateur et mises en œuvre par les juges. La notion de faute caractérisée est une imprudence, une négligence ou le non-respect d’une obligation de sécurité. Elle présente une caractérisation particulière : un certain degré de gravité, une particulière intensité. Caractérisée, la faute doit exposer autrui à un risque d’une particulière gravité, ce qui est différent bien entendu de la gravité du dommage. Cela vise les risques de mort, de blessures graves, de contagion, d’atteintes à l’environnement, etc. Cela vise au surplus une plus ou moins grande probabilité de réalisation du risque. Ce risque enfin ne peut être ignoré du décideur. Le juge tiendra compte de l’expérience « professionnelle » de l’auteur médiat, de la publicité donnée à la situation. Cela nécessite pour la défense de l’auteur indirect - du présumé « délinquant non intentionnel » - de démontrer qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer l’existence du risque que j’ai défini auparavant.
Il résulte de cette addition de conditions exigée pour définir la faute caractérisée que seules les situations les plus « pathologiques » sont à l’origine de l’engagement de la responsabilité pénale d’un élu pour délit inintentionnel. En 2002, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 18 juin 2002, n° 01-86.539, F-P+F N° Lexbase : A0935AZN) à propos d’un accident causé lors d’un défilé a considéré que la cour d’appel pouvait retenir la responsabilité du maire de Bonvillers, coupable de blessures involontaires, et que « l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adaptés, que seul un conseiller municipal se trouvait en avant du cortège et a vainement fait signe à l'automobiliste pour qu'il s'arrête, alors que le maire aurait dû interdire la circulation pendant la durée du défilé, ou prescrire la mise en place de barrières de sécurité, ou faire précéder la fanfare par un véhicule muni d'un gyrophare, ou encore poster une personne à l'entrée du village ». Dans cette même affaire, classiquement les juges administratifs (CAA Douai, 8 février 2007, n° 06DA00066 N° Lexbase : A7736DU3) rappellent que la compagnie d’assurances, « qui, en qualité d'assureur, a indemnisé les victimes de l'accident et qui est subrogée dans les droits de [l’automobiliste], ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des fautes qu'aurait commises le maire de la commune de Bonvillers, dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale, en s'abstenant de mettre en œuvre les moyens propres à assurer la sécurité des participants et des spectateurs de cette manifestation, pour demander au juge administratif, qui n'est lié que par les constatations de fait du juge pénal, de condamner la commune à lui rembourser, en tout ou en partie, les indemnités versées aux victimes ».
Lexbase : Quelles sont les modifications apportées en ce domaine par la nouvelle loi du 11 mai 2020 ?
De mai 1995 au mois d’avril 1999, tandis que la France compte environ 500 000 élus, 48 avaient été mis en cause pour des infractions non intentionnelles et 14 ont été condamnés. De 2000 à 2019, 139 ont été poursuivis et 31 ont vu ce type de responsabilité pénale engagée à leur encontre. Le nombre des précédents est donc très limité. Les élus n’ont pas, on l’a compris, d’obligation de résultats qui devrait les conduire à empêcher la propagation de la Covid 19. Ils ont seulement une obligation de moyens compte tenu de l’état des connaissances et des prescriptions des lois et règlements. La « loi Fauchon » de 1996 a malgré tout été jugée insuffisamment protectrice des élus. Les effets de sensibilité ont éludé les données statistiques d’où la seconde « loi Fauchon » de 2000, d’où une nouvelle fois l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9).
Au prétexte de protéger les maires des petites communes de l’engagement de leur responsabilité pénale pour manquement à une obligation de sécurité, le Sénat a proposé une modification législative qui flirte avec l’irresponsabilité juridique. A tout le moins on pouvait se demander si cette solution n’était pas déséquilibrée au détriment des victimes. Un remaniement de la faute pénale sous l’effet de l’émotion consistait à poser le principe selon lequel « nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire […] soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination ». Grace à cette rédaction, l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal aurait permis, pendant le temps de l’état d’urgence, d’anesthésier la responsabilité pénale pour infraction non intentionnelle, de mettre en sommeil la responsabilité pénale pour faute caractérisée. Il aurait interdit de trouver une faute dans l’exposition d’autrui à la contamination ou dans le fait d’avoir causé ou contribué à cette contamination. Il aurait sinon supprimé mais atténué la responsabilité pénale des gouvernants. Il faut bien entendu ajouter, qu’à titre d’exception, cette responsabilité était toujours engagée en particulier lors de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par les lois ou les règlements. L’épais protocole sanitaire de sortie du confinement ou d’ouverture des écoles n’a ni valeur légale, ni valeur règlementaire de sorte que son inobservation, a priori, aurait échappé au champ des règles susceptibles d’être violées. Les réseaux sociaux, mais pas seulement, n’ont pas manqué de dénoncer, souvent violemment, cette forme d’immunité pénale en matière d’infractions non intentionnelles.
Après la commission mixte paritaire du Parlement, le texte final est revenu à davantage de sérénité. L’absence d’évaluation préalable de la mesure proposée par le Sénat a amené la loi à créer un nouvel article L. 3136-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8575LWI) qui précise que l’article L. 121-3 du Code pénal, qui n’est donc pas modifié, « est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ». Les faits à prendre en considération sont donc ceux commis pendant le temps de l’état d’urgence. Ni avant. Ni après. Les actions publiques concernées sont celles qui mettent en œuvre les précautions sanitaires (organisation de la distanciation physique, distribution effective de masques, etc.) et non celles qui définissent ces mêmes actions au moyen de textes et par le truchement de la mise à disposition de moyens. Les membres du gouvernement ne devraient pas être concernés par ces dispositions. Cela dit un doute subsiste, lequel doute a conduit une partie de l’opposition parlementaire à ne pas voter ce texte.
Lexbase : Les critiques relatives à une volonté d'"amnistier" en toute circonstance les élus locaux vous semblent-elles justifiées ?
D’un point de vue politique il n’est jamais souhaitable d’envisager d’alléger la responsabilité des élus, notamment juridique. La sanctuarisation d’un contentieux particulier aux décideurs, publics ou privés, a mauvaise presse. En Europe, la France est le seul pays, je crois, où la méfiance, voire la défiance vis-à-vis du personnel politique est forte. Il est vrai qu’à l’égard des élus locaux ce (re)sentiment des français est moins intense mais il demeure plus fort que dans le reste de l’Europe. Modifier le droit de la responsabilité pénale des décideurs publics dans l’urgence, après un débat national atrophié et dans ce contexte de faible confiance ne permet pas une analyse sereine des dispositions adoptées.
Cela dit, la loi du 11 mai 2020 formalise le mode de raisonnement in concreto adopté par le juge pénal dans ces affaires de délinquance inintentionnelle. Elle ne semble pas constituer une amnistie par anticipation des élus locaux et encore moins des membres du Gouvernement. Seulement les juridictions devront examiner les recours effectués par les citoyens, les parents d’élèves, les salariés, les fonctionnaires, etc. à l’aune de cet article du Code de la santé publique et démontrer que les décideurs publics ont pris en considération les circonstances extraordinaires de la période de l’état d’urgence sanitaire. Il demeure que la réalité dépassant l’imagination, on ne peut pas assurer qu’aucun élu local, qu’aucun directeur d’école par exemple, ne verra pas sa responsabilité personnelle pour infraction non intentionnelle en période d’état d’urgence sanitaire ne pas être engagée.
* Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
- [1] Le principe irresponsabilité, Le Débat n° 108, 2000, p. 32 et s.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473391
[Brèves] Régime des mesures de placement en quarantaine ou à l'isolement
Réf. : Décrets n° 2020-610 (N° Lexbase : L1706LXH) et n° 2020-617 (N° Lexbase : L1712LXP) du 22 mai 2020
Lecture: 3 min
N3420BYC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 27 Mai 2020
► Deux décrets du 22 mai 2020, publiés au Journal officiel du 23 mai 2020, précisent le régime des mesures de placement en quarantaine ou à l'isolement pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (décrets n° 2020-610 N° Lexbase : L1706LXH et n° 2020-617 N° Lexbase : L1712LXP).
Le décret n° 2020-617 énonce qu’une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (N° Lexbase : L8825HBH), pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation que l’arrêté du 22 mai 2020, identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 (N° Lexbase : L1743LXT), identifie comme « l'ensemble du territoire national et des pays du monde ».
Il en est de même des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution depuis le reste du territoire national ou l'étranger et des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l'étranger présentant des symptômes d'infection au covid-19. La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.
Le décret n° 2020-610 fixe quant à lui les conditions dans lesquelles sont prises et renouvelées les mesures individuelles de mise en quarantaine et les mesures de placement à l'isolement prévues au II de l'article L. 3131-17 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8572LWE) (lieu d'exécution de la mesure, durée de la mesure, restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées, conditions permettant la poursuite de la vie familiale, situation particulière des mineurs), ainsi que les modes d'information des personnes concernées (indication des voies et délais de recours). Il prévoit les modalités de transmission au préfet du certificat médical permettant de constater que la personne est atteinte par le virus, préalablement à la décision de placement à l'isolement. Le décret fixe la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation ou de mainlevée d'une mesure de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473420
[Brèves] Activité partielle : la prise en charge par l'Etat abaissée à 85 % au 1er juin
Réf. : Ministère du Travail, 25 mai 2020, communiqué de presse
Lecture: 1 min
N3481BYL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 27 Mai 2020
► Dans un communiqué de presse du 25 mai 2020, le Ministère du travail précise que les conditions de prise en charge de l’indemnité d’activité partielle seront revues au 1er juin 2020.
Au 1er juin, les conditions de prise en charge de l’indemnité d’activité partielle seront revues, pour accompagner la reprise d’activité :
→ L’indemnité versée au salarié est inchangée : pendant l’activité partielle, il perçoit 70 % de sa rémunération brute (environ 84% du salaire net), et au minimum le SMIC net.
→ La prise en charge de cette indemnité par l’Etat et l’Unédic sera de 85 % de l’indemnité versée au salarié, dans la limite (inchangée) de 4,5 SMIC. Les entreprises seront ainsi remboursées de 60 % du salaire brut, au lieu de 70 % précédemment.
→ Les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire, continueront à bénéficier d’une prise en charge à 100%.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473481
[Le point sur...] La responsabilité médicale au temps du covid-19 : enjeux, difficultés et perspectives
Lecture: 19 min
N3443BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Catherine Szleper, avocat à la Cour
Le 28 Mai 2020
La crise sanitaire que nous traversons est unique. Ses conséquences humaines sont donc difficilement prévisibles et il en est de même concernant ses effets juridiques.
Pour y faire face, a été mis en place l’état d’urgence sanitaire, par la loi du 23 mars 2020 (loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 N° Lexbase : L5506LWT) complétée par celle du 11 mai 2020 (loi n° 2020-572, prorogeant l’état d’urgence N° Lexbase : L8351LW9), consacrant les articles L. 3131-1 (N° Lexbase : L8568LWA) et suivants dans le Code de la santé publique. Ces dispositions exceptionnelles autorisent notamment le Gouvernement à prendre des mesures relatives aux soins et traitements prodigués aux victimes du Covid-19, généralisant notamment la téléconsultation, pour éviter le risque de contamination.
L’équilibre entre la préservation des libertés fondamentales et la protection de la population face à un risque mal connu a été complexe, mettant en exergue un manque de préparation important et un système hospitalier en crise. Le principe de précaution a parfois été appliqué strictement avec un confinement contesté à de multiples niveaux, notamment dans les cas d’interdiction pour les proches de demeurer au chevet d’une victime du covid-19 en fin de vie, et parfois de façon laxiste avec une pénurie de masques, de gel hydroalcoolique et autres matériels de soin.
Face à ces circonstances exceptionnelles, des mesures exceptionnelles ont été justifiées. Elles n’ont pas été dépourvues de risques et les victimes de cette crise sont malheureusement (trop) nombreuses.
Si le régime actuel de responsabilité médicale apporte des réponses, il n’est pas certain que les situations créées par la crise sanitaire puissent toutes être analysées par ce biais, notamment du fait du contexte de crise dans lequel a dû agir le personnel soignant (I)
Si la préservation de l’intérêt des victimes du covid-19 est essentielle, la responsabilisation de tous les gestionnaires de cette crise, solidaires des professionnels de santé, serait un compromis raisonnable (II).
I - Le régime classique de responsabilité médicale à l’épreuve du covid-19
L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), dans sa version modifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG), consacre le régime actuel de la responsabilité médicale avec une responsabilité pour faute à l’égard du professionnel de santé.
Dans le cas où aucun manquement ne pourrait être reproché à ce dernier, mais le patient aurait subi des dommages importants, liés à un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale, il peut bénéficier d’une réparation de son préjudice au titre de la solidarité nationale.
Classiquement, les fautes pouvant être reprochées à un professionnel de santé sont de plusieurs ordres : une faute technique dans l’exécution des soins, un défaut d’information et de conseil, une négligence dans le diagnostic, l’absence de consentement du patient à un acte de soin...
Dans le cadre de la crise sanitaire à laquelle nous faisons face, certaines situations entrent dans le champ d’application de ce régime de responsabilité médicale. Elles ne pourront néanmoins être appréciées par le juge qu’au regard du caractère d’urgence et de panique qui a certainement altéré le bon déroulement des protocoles de soins et qui ne peut être reproché au seul personnel soignant.
Par ailleurs, la spécificité du covid-19, pathologie dont la contamination, l’évolution et le traitement demeurent incompris, ainsi que la gestion difficile de cette crise pourraient créer des situations juridiques nouvelles.
A - Les problématiques liées au diagnostic du covid-19 : le cas de la téléconsultation et du télésoin
Dans le régime actuel de responsabilité médicale, la victime doit apporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité exclusif, direct et certain entre ce dernier et le manquement reproché.
Typiquement, dans le cas d’une erreur de diagnostic effectuée par un médecin, la victime pourrait se retourner contre lui si elle rapporte la preuve d’un défaut de diligence et d’information de sa part.
Si le professionnel de santé n’a pas posé les questions nécessaires, et donc n’a pas pris les précautions utiles dans ce contexte particulier, engendrant un retard ou une absence de prise en charge de la victime du covid-19, il pourrait être tenu responsable des séquelles causées à un patient.
Cet exercice est rendu encore plus complexe dans le cas des téléconsultations, obéissant aux mêmes règles que les consultations en cabinet [1].
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5507LWU) a rendu prioritaires les téléconsultations puisque seuls étaient autorisés, pendant le confinement, « les déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ».
Cette disposition enjoignait donc aux patients de privilégier la téléconsultation, la télésurveillance et le télésoin. En revanche, pour les affections longue durée, la consultation en cabinet demeurait la règle.
Evidemment, la téléconsultation présente des risques dès lors que le médecin ne peut se reposer que sur les informations fournies par le patient qu’il n’ausculte pas. Il aura tout intérêt à suivre scrupuleusement les questionnaires et directives fournies par la Haute autorité de santé [2] et de relayer en détail dans le dossier médical le déroulement de la consultation pour préserver la preuve de sa diligence [3].
Des situations complexes juridiquement peuvent en résulter : le médecin décide de ne pas hospitaliser le patient alors même que ce dernier présente un stade avancé du covid-19 car, sur la base des déclarations de ce derniers et des consignes du Gouvernement, il considère que ce dernier ne rentre pas dans la catégorie des patients devant être hospitalisés.
Prenons également le cas d’un patient qui présente d’autres soucis de santé mais dont le médecin, pour éviter un risque de contamination, conseille d’attendre pour se faire soigner. Si la pathologie présentée par ce patient s’aggrave, il pourrait agir contre le médecin, ce dernier n’ayant pas mesurés les conséquences d’un retard de prise en charge.
L’on peut néanmoins considérer que, peu importe la situation, si le professionnel de santé démontre qu’il a prodigué des soins consciencieux et fondé son diagnostic sur les données actuelles de la science ainsi qu’un interrogatoire minutieux du patient, aucun manquement ne pourra, en théorie, lui être reproché puisqu’il aura pris sa décision sur la base d’informations précises et détaillées.
Par ailleurs, la preuve du lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage paraît difficile à caractériser lorsqu’il est question du diagnostic du Covid-19.
En effet, le moment exact de contamination par le Covid-19 demeure toujours un mystère et il en est de même de son évolution [4].
C’est sans compter d’autres facteurs aggravants, indépendant du professionnel de santé, qui ne peuvent être occultés tels qu’une organisation du système de soins lacunaires, un manque de matériel et surtout l’absence d’un nombre de tests fiables suffisants, rendant difficile le diagnostic, qui pourraient amener le juge à modérer sa responsabilité dans ce contexte.
B - Les problématiques liées au traitement du Covid-19
Il n’existe pas, à l’heure actuelle de traitement préconisé pour le covid-19. Pourtant, certains professionnels de santé considèrent que l’hydroxychloroquine, antipaludique prescrit hors de son autorisation de mise sur le marché, pourrait être un remède efficace.
Son administration a finalement été autorisée dans le cadre du traitement du covid-19 par le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5675LW4), complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, uniquement dans le cas de patients présentant un cas grave de Covid-19 et hospitalisés, prescription subordonnée à un avis collégial, comme le rappellent l’avis du Haut conseil de la santé publique en date du 23 mars 2020 et les recommandations de l’ANSM en date du 30 mars 2020 [5].
Ces dispositions sont applicables à la lecture de la loi décrétant l’état d’urgence sanitaire, prévoyant en son article L. 3131-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9615HZ7), un régime de responsabilité spécifique, exonérant les professionnels de santé, les fabricants du produit et titulaires de l’autorisation de mise sur le marché en cas de dommages résultant de la prescription de ce médicament.
On ne peut donc, en théorie, reprocher à un médecin d’avoir prescrit de l'hydroxychloroquine hors de son autorisation de mise sur le marché.
En revanche, dans le cas où le médecin fait le choix de ne pas prescrire ce traitement, il convient de rappeler que ce dernier est libre de sa prescription, sur le fondement de l’article 8 du Code de déontologie médicale, codifié à l’article R. 4127-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1217ITA).
Par ailleurs, tout choix thérapeutique est apprécié au regard de l’état des connaissances scientifiques à l’instant même où est délivré ou non le traitement. Compte tenu de l’absence de consensus scientifique sur l’efficacité de la hydroxychloroquine dans le traitement du covid-19, il paraît peu probable que l’on puisse établir un lien de causalité direct et certain entre l’absence de ce traitement et la survenue du décès d’un patient et les complications qu’il a présentées.
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs rejeté le 28 mars 2020 la requête de la SMAER (Syndicat des médecins d’Aix et de région) qui sollicitait la généralisation du traitement par l'hydroxychloroquine, en considérant que les rares études effectuées étaient contestables d’un point de vue méthodologique et qu’elles ne permettaient pas de conclure à l’efficacité clinique du traitement [6].
Il n’en demeure pas moins que, si le médecin fait le choix de prescrire ou non le traitement, il sera obligé de délivrer, dans la mesure du possible, une information éclairée au patient afin qu’il en comprenne bien les enjeux et de s’assurer de son consentement éclairé.
L’article L. 1110-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4249KYZ) rappelle encore que « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».
Le médecin est donc tenu d’effectuer un arbitrage difficile entre l’obligation de délivrer les soins les plus consciencieux au patient sans lui faire courir de risques inutiles.
Rappelons à ce titre le célèbre arrêt « Mercier », rendu par la première chambre de la Cour de cassation le 20 mai 1936 (Cass. civ. 1, 20 mai 1936, Dr Nicolas c/ Mercier N° Lexbase : A7395AHD), consacrant une obligation pour le médecin de délivrer des soins conformes aux données acquises de la science « réserve faite des circonstances exceptionnelles ».
Il semble cohérent de qualifier la pandémie actuelle de circonstance exceptionnelle. C’est pourquoi, face à ces impératifs et charge de responsabilité importante, le professionnel de santé ne saurait être laissé pour seul responsable.
II - Une responsabilité médicale partagée par l’ensemble des acteurs de la gestion de la crise sanitaire
En responsabilité médicale, les enjeux sont délicats. Il est souvent question de douleur et de décisions impactant la vie humaine. Dans le contexte du covid-19, ce régime sera mis à rude épreuve. Car comment concilier la douleur des personnes dont les proches sont décédés ou dans un état critique de celle du personnel soignant devant prendre des décisions difficiles dans l’urgence, risquant sa propre vie pour sauver celle des autres ? Si l’enjeu principal est d’indemniser les victimes, il semblerait légitime que d’autres acteurs jouent un rôle important que ce soient les assureurs des professionnels de santé ou l’Etat.
Les assureurs ont décidé de compléter l’assurance de responsabilité civile professionnelle de ces derniers durant la crise. Tel a été le cas de la téléconsultation, le télésoin et le télésuivi, couverts sans déclaration préalable pour les actes nécessaires à la prise en charge du covid-19 par la MACSF [7]. Ils ont considéré, à juste titre, que cet exercice sortait du cadre exceptionnel des garanties habituelles.
Espérons que ces extensions de couverture de garantie par les assureurs s'avéreront efficaces dans le cas de différends avec des victimes du Covid 19 et que les compagnies d’assurance privilégieront des discussions amiables, sans tenter de s’exonérer de leurs obligations.
Reste la question du rôle de l’Etat face à ces dernières. Il lui est notamment reproché d’avoir tardé à organiser un système de soins opérant, de ne pas avoir commandé de masques, de tests fiables, engendrant des contaminations massives et des prises en charge compliquées.
Son action a été encadré par l’article L. 3131-1 de la loi du 11 mai 2020, l’autorisant à prescrire « dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. » L’article L. 3131-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9612IQ3) prévoit que le Haut conseil de la santé publique examine périodiquement le bien-fondé de ces mesures.
Le juge devra donc apprécier si les mesures décidées par l’Etat ont été suffisamment anticipées et efficaces au regard des risques prévisibles et exceptionnels.
A - La responsabilité pénale des dirigeants dans la gestion de la crise du covid-19
En matière pénale, une plainte a été déposée contre Agnès Buzyn et Edouard Philippe leur reprochant le délit d’une abstention volontaire, prévu par l’article 223-6, alinéa 2 du Code pénal (N° Lexbase : L6224LL4), délit complémentaire du délit de non-assistance à personne en danger. Toutefois, son succès n’est pas certain car ce délit nécessite la preuve d’un élément intentionnel, soit que l’auteur avait conscience que son inaction porterait atteinte à la sécurité de personnes. Ce d’autant plus qu’en matière pénale, l’appréciation de cet élément est stricte et la jurisprudence sévère.
L’article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY), consacrant le délit de non-assistance à personne en danger, applicable à la crise sanitaire en vertu de l’article L. 3136-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8575LWI), permet également d’engager la responsabilité pénale des dirigeants sous réserve de prouver une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Le juge devra effectuer un arbitrage délicat entre les actions menées par les ministres avant et pendant la crise, les moyens réels dont ils disposaient, l’idéal de précaution et protection d’un intérêt général, et les connaissances scientifiques sur cette même période.
On peut envisager que, par exemple, l’absence d'approvisionnement suffisant en masques puisse constituer une telle faute. Toutefois, en droit pénal, le doute profite toujours à l’innocent. Or, face à une crise sanitaire de telle ampleur, il paraît difficile de dire avec certitude ce qui aurait dû être fait et anticipé par une personne physique ou morale déterminée, à l’exclusion de l’Etat, qui ne peut être poursuivi pénalement [8].
B - La responsabilité administrative de l’Etat pour faute
La responsabilité de l’Etat peut être engagée pour faute devant le tribunal administratif. L’obligation de démontrer une faute lourde, c’est-à-dire d’une particulière gravité, a été abandonnée et seule une faute simple est désormais exigée. Il existe une exonération en cas de force majeure. Toutefois, il paraît difficile d’admettre que cette crise sanitaire constituerait un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible pour l’Etat, ne serait-ce qu’au regard des précédentes épidémies déjà vécues.
Dans le cas du Covid-19, sont alléguées à l’Etat des carences dans la gestion de la crise sanitaire, notamment dans l'approvisionnement en masque, gels hydroalcooliques, en tests de dépistage et lits de réanimation. Il est également reproché une organisation défaillante, avec des personnes retrouvées en état de solitude, des malades ne pouvant être accompagnés par leurs proches, même en fin de vie.
On peut enfin songer aux professionnels de santé, nécessairement concernés. Pour ces derniers, en cas de contamination, il est prévu une indemnisation intégrale, notamment pour les réservistes, en vertu de l’article L. 3133-6 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9632HZR).
L’Etat a dû faire des choix face à une situation méconnue et le juge aura à vérifier si au regard des connaissances du danger qu’il pouvait avoir, il a correctement agi.
Par le passé, dans le cas de l’affaire du sang contaminé, l’Etat avait été condamné pour ne pas avoir retiré les lots de sang contaminé. Son inaction à prendre des mesures pour lutter contre l’exposition des travailleurs à l’amiante a également caractérisé une carence fautive. Dans l’affaire du « Médiator », l’Etat a été jugé responsable de ne pas avoir retiré l’autorisation de mise sur le marché alors même que son système de pharmacovigilance aurait dû l’inciter à le faire à partir d’une certaine date [9]. Le tribunal administratif de Paris a reconnu la carence fautive de l’Etat en raison de l’insuffisance de mesures prises pour lutter contre la pollution de l’air le 4 juillet 2019, sans toutefois faire droit aux demandes d’indemnisation des victimes, considérant l’absence de lien certain et direct entre leurs préjudices et l’insuffisance des mesures [10].
En prenant l’exemple des masques, il est possible de reprocher à l’Etat de ne pas avoir constitué de stocks suffisants avant la crise, d’avoir tardé à en commander dès le début de la crise et enfin, de ne pas assurer des stocks réguliers pendant toute la durée de la crise [11]. La question de l’anticipation de la crise et de sa gestion devra être distinguées.
Là encore, se pose la question de la preuve du préjudice et du lien de causalité. En effet, à considérer que le juge considère que l’Etat a commis une faute, quelles ont été les répercussions exactes sur la victime ? Celle-ci devrait démontrer que l’absence du port du masque a causé sa contamination et les séquelles qui s’en sont suivies. Même si les scientifiques semblent s’accorder sur l’efficacité du masque, ce lien ne saurait être qualifié de certain. Par conséquent, le juge risquerait d’indemniser une perte de chance qui diminuerait le montant de l'indemnisation.
Quant au préjudice, sa nature paraît également incertaine car la seule contamination ne saurait, en principe, être réparable. L’hypothèse d’un préjudice d'anxiété pourrait là encore être évoquée. Il sera simplement rappelé que ce préjudice demeure exceptionnel lorsqu'il est reconnu de façon indépendante, qu’en l’espèce, le risque de contamination est rapide et la plupart des personnes contaminées ne présente qu’une symptomatologie légère voire sont asymptomatiques. Enfin, encore faudrait-il pouvoir démontrer qu’elles subissent une angoisse réelle liée au covid-19 liée, par exemple, à l’absence de port de masque et à la peur d’une contamination [12].
Le rôle des médias, qui au lieu d'être une source d’informations pertinentes et éclairées, générent de l’angoisse, pourrait avoir une place dans ces débats. Pourraient enfin être soulevés de nouveaux préjudices spécifiques à cette situation telle que l’angoisse générée par le fait de mourir seul et pour la victime indirecte, de ne pas avoir pu assister son proche en fin de vie.
***
Le dispositif juridique actuelle ne semble pas apporter de réponse adéquate aux possibles litiges en lien avec le covid-19. C’est pourquoi, la création d’un Fonds de solidarité comme il y en a eu pour les victimes de l’amiante, de terrorisme ou du Médiator, pourrait être une réponse adéquate, dans la mesure où, dans certaines situations, il est difficile d’imputer les préjudices subis par une victime à une personne déterminée. Elle permettrait symboliquement à l’Etat d’assumer l’indemnisation de ces dernières.
On notera que, dans la loi du 11 mai 2020, l’article L. 3131-4 (N° Lexbase : L9616HZ8) reprend le dispositif d’indemnisation prévu pour les victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour l’étendre aux difficultés survenues dans le cadre d’actes de diagnostic, prévention et soins liées au covid-19. Cela ne semble pas suffisant, la disposition n’englobant pas toutes les situations juridiques liées au virus.
Mais qui dit solidarité nationale, dit fonds financés par les contribuables. Et l’absence de recours subrogatoire de l’Office est à prévoir puisqu’il semble difficile de trouver un fautif déterminé. Il conviendrait d’encadrer la saisine du Fonds, en maintenant par exemple un seuil de gravité ou en excluant l’indemnisation du seul préjudice d’angoisse. Là encore, un arbitrage humain est à prévoir.
[1] CSP, art. L. 6316-1 (N° Lexbase : L6174LR4).
[2] Auto-questionnaire, 28 mars 2020, Ministère des Solidarités et de la Santé.
[3] Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 -Prise en charge des patients COVID-19, sans indication d’hospitalisation, isolés et surveillés à domicile, HAS, avril 2020 ; Guide méthodologique, Préparation à la phase épidémique de Covid-19, Ministère des solidarités et de la santé, 16 mars 2020.
[4] C. Younes, Téléconsultation, Covid-19 et responsabilité médicale, 7 avril 2020, Village de la Justice.
[5] Coronavirus SARS-Cov-2 : recommandations thérapeutiques, Haut Conseil de la santé publique, 23 mars 2020
[6] CE référé, 28 mars 2020, n° 439726 (N° Lexbase : A49793KM).
[7] G. Perrin, Coronavirus : les assureurs des professionnels de santé se mobilisent, 18 avril 2020, L'argus de l’assurance.
[8] C. pén., art. 121-2 (N° Lexbase : L3167HPY).
[9] O. Beaud, D. Rebut, C. Broyelle, La responsabilité des ministres et de l’Etat dans la gestion de la crise du coronavirus, 23 mars 2020, Le club des juristes.
[10] TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333 (N° Lexbase : A5750ZHG), n° 1810251 (N° Lexbase : A5735ZHU), n° 1814405 (N° Lexbase : A5738ZHY).
[11] A. Jacquemet-Gauché, Pénurie de masques : une responsabilité pour faute de l’Etat, 24 mars 2020, Le club des juristes.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473443
[Brèves] Publication d’un décret sur l’assouplissement du régime d’imposition des gains et distributions de « carried interest »
Réf. : Décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 modifiant les dispositions de l'article 41 DGA de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L1505LXZ)
Lecture: 3 min
N3378BYR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Mai 2020
►Le décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 (N° Lexbase : L1505LXZ), publié au Journal officiel du 20 mai 2020, vient modifier l'article 41 DGA de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L3226KQK), en conséquence des modifications apportées par l'article 8 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L6297LNK) aux articles 150-0 A (N° Lexbase : L6169LUZ) et 163 quinquies C (N° Lexbase : L6177LUC) du même Code.
Ces nouvelles dispositions viennent assouplir la condition de seuil minimal d'investissement que doivent représenter les parts de « carried interest » dans le montant total des souscriptions dans les structures de capital-risque. Il maintient la possibilité d'ajuster le seuil dans des conditions fixées par décret.
Le texte est entré en vigueur le 21 mai 2020.
| Précisions sur le régimes d'imposition des parts ou actions de « carried interest » La loi de finances pour 2009 (loi 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 N° Lexbase : L3783IC4) a précisé le régime fiscal des parts ou actions dites de « carried interest ». Pour rappel, peuvent bénéficier sous certaines conditions du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, les distributions et gains réalisés du fait de la détention de parts ou actions de « carried interest », sous réserve du respect des conditions cumulatives fixées au 8 du II de l'article 150-0 A du Code général des impôts et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du même Code. A défaut, les distributions et gains relèvent du régime des traitements et salaires. A cet effet, - le bénéficiaire doit percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions ; - les produits doivent être versés au moins 5 ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission des titres ; - les titres de carried interest détenus par l’équipe de gestionnaires doivent en principe représenter un seuil minimal de 1 % du montant total des souscriptions reçues par le fonds ou la société. Sur cette dernière condition, l’ensemble des parts ou actions de « carried interest » d’un même fonds commun de placement à risques ou d’une même société de capital-risque devait représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société. Avec la nouvelle loi de finances pour 2020, pour les gains nets réalisés et les distributions perçues à compter du 1er janvier 2020, la condition du seuil de détention pour bénéficier du régime fiscal des plus-values mobilières est assouplie pour les structures d’investissement dont la capitalisation excède un milliard d’euros. Pour ces dernières, l’ensemble des parts ou actions de « carried interest » doit représenter au moins 0,5 % (contre 1 % auparavant) de la fraction du montant total des souscriptions. |
Lire en ce sens, Questions à Florence Moulin et Emmanuel de la Rochethulon, Avocats associés, Jones Day, Le carried interest : aspects juridiques et fiscaux, Lexbase Fiscal, 2017, n° 697 (N° Lexbase : N7890BW7).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473378
[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions organisant l'accès de la HADOPI à tous documents, dont des données de connexion des internautes
Réf. : Cons. const., décision n° 2020-841 QPC, du 20 mai 2020 (N° Lexbase : A83343LA)
Lecture: 4 min
N3425BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 27 Mai 2020
► Dans une décision du 20 mai 2020, le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2020-841 QPC, du 20 mai 2020 N° Lexbase : A83343LA) censure des dispositions organisant l'accès de la HADOPI à tous documents, dont des données de connexion des internautes (C. prop. intell., art. L. 331-21 N° Lexbase : L3539IES).
L’affaire. Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 10° ch., 12 février 2020, n° 433539 N° Lexbase : A35313EI) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des trois derniers alinéas de l'article L. 331-21 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la loi « HADOPI » (loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 N° Lexbase : L3432IET).
En vertu de l'article L. 336-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L8870IEA), le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin, sans l'autorisation des titulaires de ses droits, lorsqu'elle est requise. Au sein de la HADOPI, la commission de protection des droits est chargée, lorsqu'elle est saisie d'un manquement à cette obligation, de prendre les mesures destinées à en assurer le respect. Il s'agit d'adresser aux auteurs des manquements à l'obligation précitée une recommandation leur rappelant le contenu de cette obligation, leur enjoignant de la respecter et leur indiquant les sanctions encourues à défaut. Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle faisant l'objet de la QPC confèrent aux agents de la HADOPI le droit d'obtenir, d'une part, communication, par les opérateurs de communication électronique, de l'identité, de l'adresse postale, de l'adresse électronique et des coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé en violation de l'obligation précitée et, d'autre part, communication et copie de tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données de connexion détenues par les opérateurs de communication électronique.
Selon les associations requérantes, ces dispositions méconnaissaient le droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et le secret des correspondances.
La décision.
- En ce qui concerne le droit de communication portant sur certaines informations d'identification de l'abonné
Le Conseil constitutionnel juge que, la communication de l'identité, de l'adresse postale, de l'adresse électronique et des coordonnées téléphoniques de l'abonné n'est pas assortie d'un pouvoir d'exécution forcée et n'est ouvert qu'aux agents publics de la Haute autorité, dûment habilités et assermentés, qui sont soumis, dans l'utilisation de ces données, au secret professionnel. En outre, ces informations sont nécessaires à la Haute autorité pour leur adresser la recommandation leur rappelant leur obligation. Elles présentent donc un lien direct avec l'objet de la procédure mise en œuvre par la commission de protection des droits. Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le dernier alinéa de l'article L. 331-21 du Code de la propriété intellectuelle est conforme à la Constitution, hormis le mot « notamment ».
- En ce qui concerne le droit de communication portant sur tous documents et les données de connexion
En revanche, le Conseil constitutionnel juge que, en faisant porter le droit de communication sur « tous documents, quel qu'en soit le support » et en ne précisant pas les personnes auprès desquelles il est susceptible de s'exercer, le législateur n'a ni limité le champ d'exercice de ce droit de communication, ni garanti que les documents en faisant l'objet présentent un lien direct avec le manquement à l'obligation énoncée à l'article L. 336-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui justifie la procédure mise en œuvre par la commission de protection des droits. En outre, ce droit de communication peut également s'exercer sur toutes les données de connexion détenues par les opérateurs de communication électronique. Or, compte tenu de leur nature et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, de telles données fournissent sur les personnes en cause des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée. Elles ne présentent pas non plus nécessairement toutes de lien direct avec le manquement à l'obligation énoncée à l'article L. 336-3.
Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-21 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que le mot « notamment » figurant au dernier alinéa du même article.
Report de l’abrogation. L'abrogation immédiate de ces dispositions étant susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il juge qu'il y a lieu de reporter au 31 décembre 2020 la date de leur abrogation.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473425
[Brèves] Irrecevabilité de la demande en rétractation d’une ordonnance sur requête en référé, relevant de la compétence exclusive du juge l’ayant rendue
Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.323, F-P+B+I (N° Lexbase : A05473M9)
Lecture: 3 min
N3419BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 28 Mai 2020
► L’article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6613H73) énonce que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;
► seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de cette dernière ;
► dès lors, est irrecevable la demande en rétractation sollicitée a titre reconventionnel, devant le juge des référés, qui n’était pas le juge des requêtes.
Telle est la spécificité précisée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 mars 2020 (Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.323, F-P+B+I N° Lexbase : A05473M9 ; en ce sens Cass. civ. 2, 23 juin 2011, n° 10-23.189, F-P+B N° Lexbase : A6352HUS et Cass. civ. 2, 9 novembre 2006, n° 05-16.691, FS-P+B N° Lexbase : A3045DSL).
Faits et procédure. Une société a été autorisée, par ordonnance rendue sur requête à faire procéder par un huissier de justice à diverses mesures d’instruction dans les locaux d’une autre société. Il était prévu que les documents ou fichiers saisis seraient séquestrés en l'étude de l'huissier de justice jusqu'à ce que le juge en autorise la communication. Le requérant a engagé une procédure devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la mainlevée des éléments et pièces placés sous séquestre. Lors de cette instance, la défenderesse a reconventionnellement sollicité la rétractation de l’ordonnance préalablement rendue.
Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 25 octobre 2018, n° 18/02635 (N° Lexbase : A0739YI9), d’avoir violé les articles 496 et 497 (N° Lexbase : L6614H74) du Code de procédure civile et les articles L. 213-1 (N° Lexbase : L7744LPI) et L. 213-2 (N° Lexbase : L1743LRY) du Code de l'organisation judiciaire, en annulant l’ordonnance de référé, ayant rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, et en la déclarant irrecevable, au motif qu’elle n’aurait pas été adressée au juge compétent. En l’espèce, cette demande avait été sollicitée durant l’instance engagée devant le juge des référés, c’est-à-dire le président du tribunal de la juridiction, qui a également compétence pour rendre des ordonnances sur requête dans les cas spécifiés par la loi. Néanmoins, ce dernier, n’avait pas été saisi en tant que juge ayant rendu l’ordonnance.
Solution de la Cour. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, en rejetant le pourvoi.
| Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les dispositions communes aux ordonnances sur requête(N° Lexbase : E1665EU9) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473419
[Textes] Application pratique des nouveaux textes afin de maîtriser les délais de procédure civile pour faire face à l’épidémie de covid-19
Réf. : Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L9169LWI) ; ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L1697LX7)
Lecture: 40 min
N3395BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charles Simon, Avocat au barreau de Paris,
Le 28 Mai 2020
| 1. Rappel sur la situation antérieure aux ordonnances n° 2020-560 et n° 2020-595 1.1. Les raisons d'intervenir sur les délais 1.2. La création de deux périodes initialement liées entre elles : état d’urgence sanitaire et période juridiquement protégée. 2. L’allongement de la durée de l’état d’urgence sanitaire nécessitant d’en détacher la période juridiquement protégée 2.1. L’allongement de la durée de l’état d’urgence sanitaire et donc de la période juridiquement protégée 2.2. Les raisons de détacher fin de l’état d’urgence sanitaire et fin de la période juridiquement protégée 2.3. La fixation d’une nouvelle date de fin de la période juridiquement protégée par les ordonnances n° 2020-560 et n° 2020-595 3. La fixation d’une date déterminée pour la fin de la période juridiquement protégée 3.1. Les difficultés liées au caractère initialement déterminable de la date de fin de la période juridiquement protégée 3.2. Le choix fait de donner une date déterminée à la fin de la période juridiquement protégée, déconnectée de la fin de l’état d’urgence sanitaire 3.3. Les interrogations découlant de la déconnection existant désormais entre période juridiquement protégée et état d’urgence sanitaire 4. Exemples pratiques de délais prorogés à la suite des ordonnances n° 2020-560 et n° 2020-595 4.1. La conservation de plusieurs régimes de prorogation selon le type de délais 4.2. La prorogation des délais de procédure et d’action 4.2.1. Rappel du mécanisme mis en place 4.2.2. Exemples de délais arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée et faisant l’objet d’une prorogation 4.2.3. Exemples de délais arrivant à échéance après la période juridiquement protégée et ne faisant l’objet d’aucune prorogation 4.2.4. L’outil de calcul des délais de Lexavoué 4.3. La prorogation de certaines mesures administratives ou juridictionnelles 4.3.1. Rappel du mécanisme mis en place 4.3.2. L’allongement de la durée de la prorogation des mesures 4.3.3. Exemple de mesures juridictionnelles arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée et faisant l’objet d’une prorogation 4.4. La prorogation des délais en matière d’astreintes, de clauses pénales, résolutoires et prévoyant une déchéance 4.4.1. Rappel du mécanisme mis en place 4.4.2. Première hypothèse : exemples d’astreintes et de clauses prenant effet avant la période juridiquement protégée et faisant l’objet d’une suspension jusqu’à sa fin, hors clauses résolutoires et prévoyant une déchéance déjà acquises 4.4.2.1. La suspension des astreintes et des clauses pénales 4.4.2.2. L’absence de suspension des clauses résolutoires et prévoyant la déchéance 4.4.2.3. L’incohérence du régime créé s’agissant des clauses pénales 4.4.3. Deuxième hypothèse : exemple d’astreintes et de clauses prenant effet pendant la période juridiquement protégée et faisant l’objet d’une suspension jusqu’à sa fin 4.4.4. Troisième hypothèse : exemples d’astreintes et de clauses prenant effet après la période juridiquement protégée et faisant l’objet d’une suspension jusqu’à sa fin, sauf astreintes et clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation de somme d’argent 4.4.4.1. La suspension des astreintes et des clauses autres que portant sur l’exécution de sommes d’argent 4.4.4.2. L’absence de suspension des astreintes et clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation de sommes d’argent 4.5. La prorogation des délais en matière de saisie immobilière 4.5.1. Rappel du mécanisme mis en place 4.5.2. Exemples de délais suspendus pendant la période juridiquement protégée |
Les ordonnances n° 2020-560 (N° Lexbase : L9169LWI) et n° 2020-595 (N° Lexbase : L1697LX7) fixent désormais du 12 mars au 23 juin 2020 inclus la « période juridiquement protégée ».
Il s’agit de la période pendant laquelle les délais de procédure et pour agir font l’objet d’une adaptation du fait de l’épidémie de covid-19.
L’adoption d’une date déterminée pour la fin de la période, objet des ordonnances n° 2020-560 et n° 2020-595, garantit un niveau de sécurité élevé aux parties.
Mais le régime mis en place tient malheureusement plus du foisonnement baroque que de l’épure classique : chaque type de délais bénéficie de son propre régime de prorogation qui s’apparente en réalité la plupart du temps à une suspension innommée, avec des aménagements et des exceptions complexifiant la structure d’ensemble.
Cet article a pour objet d’éclairer le praticien en rappelant brièvement les mécanismes mis en place (1. et 2.) et en en présentant les dernières évolutions (3.), puis en les illustrant grâce à des exemples pratiques (4.).
1. Rappel sur la situation antérieure aux ordonnances n° 2020-560 et n° 2020-595
1.1. Les raisons d'intervenir sur les délais
L’épidémie de covid-19 entrave l’action des personnes publiques et privées. En conséquence, des délais peuvent expirer sans que ceux ayant intérêt à s’y opposer ne puissent le faire, avec des conséquences potentiellement graves pour eux.
Une intervention du législateur était donc nécessaire pour garantir la sécurité juridique de tout un chacun en aménageant les délais. De nombreux articles ont déjà été consacrés à ce sujet [1].
1.2. La création de deux périodes initialement liées entre elles : état d’urgence sanitaire et période juridiquement protégée
L’intervention du législateur a pris la forme de la création de deux périodes spéciales, jusqu’à présent liées entre elles :
- tout d’abord l’état d’urgence sanitaire, commençant le 24 mars 2020 et se terminant initialement deux mois plus tard en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT) d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.Il s’agit de la période pendant laquelle le gouvernement peut prendre des mesures exceptionnelles tel que le confinement ou la limitation des déplacements des personnes en application des articles L. 3131-12 (N° Lexbase : L5643LWW) et suivants du Code de la santé publique nouvellement créés ;
- ensuite la « période juridiquement protégée » commençant le 12 mars 2020 et se terminant initialement à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article 1er de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5730LW7) relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Comme le titre de l’ordonnance n° 2020-306 l’indique, la période juridiquement protégée correspond au laps de temps pendant lequel les délais font l’objet d’aménagements, du fait des difficultés pratiques liées à l’épidémie de covid-19.
Les délais sur lesquels cette ordonnance intervient sont ceux :
- de procédure et d’action prescrits par la loi ou le règlement (article 2) ;
- relatifs à certaines mesures administratives ou juridictionnelles (article 3) ; et
- liés aux astreintes, clauses pénales et résolutoires ou prévoyant une déchéance (article 4).
Cette première ordonnance était accompagnée d’une deuxième de la même date, portant le n° 2020-304 (N° Lexbase : L5722LWT) et adaptant les règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Cette deuxième ordonnance traite aussi de la question des délais en matière de saisie immobilière (article 2 II. 3°).
Il est à noter que l’expression « période juridiquement protégée » ne résulte d’aucun texte contraignant mais de la circulaire du ministère de la Justice accompagnant l’ordonnance n°2020-306 [2].
Elle a, en pratique, été adoptée par l’ensemble des commentateurs.
2. L’allongement de la durée de l’état d’urgence sanitaire nécessitant d’en détacher la période juridiquement protégée
2.1. L’allongement de la durée de l’état d’urgence sanitaire et donc de la période juridiquement protégée
Sept semaines après la publication des ordonnances n° 2020-304 et n° 2020-306, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8351LW9) prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est venue allonger la durée de l’état d’urgence sanitaire (article 1er I.).
L’état d’urgence sanitaire prend désormais fin le 10 juillet 2020 inclus, sous réserve d’une éventuelle nouvelle prorogation ou d’un abrègement futur.
La fin de la période juridiquement protégée étant liée à la fin de l’état d’urgence sanitaire, elle se trouvait mécaniquement allongée par la loi n° 2020-546.
Mais cet allongement supplémentaire des délais a fait l’objet de critiques dès avant l’adoption définitive de la loi.
2.2. Les raisons de détacher fin de l’état d’urgence sanitaire et fin de la période juridiquement protégée
En effet, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que le principal frein au respect des délais pendant l’épidémie de covid-19 était le confinement.
Adapter les délais pour tenir compte de situation liée à l’épidémie en cours perdait donc en légitimité dès lors que l’activité reprenait [3].
Une intervention gouvernementale était ainsi attendue pour détacher fin de l’état d’urgence sanitaire et fin de la période juridiquement protégée.
2.3. La fixation d’une nouvelle date de fin de la période juridiquement protégée par les ordonnances n° 2020-560 et n° 2020-595
C’est l’objet des ordonnances n° 2020-560 et n° 595.
L’ordonnance n° 2020-560 date du 13 mai 2020. Elle fixe les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire. Elle modifie notamment l’ordonnance n° 2020-306.
L’ordonnance n° 2020-n° 2020-595 date du 20 mai 2020 et modifie l'ordonnance n° 2020-304.
Elles modifient toutes deux la date de fin de la période juridiquement protégée pour les différents types de délais évoqués plus haut (cf. 1.2.).
3. La fixation d’une date déterminée pour la fin de la période juridiquement protégée
3.1. Les difficultés liées au caractère initialement déterminable de la date de fin de la période juridiquement protégée
Ainsi qu’il a été précisé, avant sa modification par l’ordonnance n° 2020-560, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 fixait la période juridiquement protégée du 12 mars 2020 à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Cette définition a cependant posé des difficultés.
Un débat s'est en effet élévé sur la question de savoir quand l’état d’urgence prenait fin [4], ce qui, par ricochet, avait une influence sur la date de fin de la période juridiquement protégée un mois plus tard.
La date majoritairement retenue était le 23 mai 2020 pour la fin de l’état d’urgence sanitaire [5].
Le raisonnement était le suivant : l’état d’urgence sanitaire a été déclaré à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290, soit le jour de sa publication le 24 mars 2020, et devait durer deux mois en application de ses articles 4 et 22.
S’agissant d’un délai « ordinaire » et non de procédure, l’article 641 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6802H73) prévoyant la computation des délais exprimés en mois de quantième à quantième ne lui était pas applicable aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass, civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-25.697 N° Lexbase : A1401YQX).
En conséquence, la date de fin de l’état d’urgence sanitaire devait être fixée au 23 mai 2020.
La période juridiquement protégée arrivant à échéance un mois plus tard et n’étant pas non plus un délai de procédure, on aurait pu penser que la majorité des commentateurs s’accorderait également pour fixer sa fin au 22 juin 2020.
Mais cela n’a pas été le cas et elle était majoritairement fixée au 23 juin 2020.
3.2. Le choix fait de donner une date déterminée à la fin de la période juridiquement protégée, déconnectée de la fin de l’état d’urgence sanitaire
Les ordonnances n° 2020-560 et n° 2020-595 ont le mérite de couper court à tout débat futur en fixant désormais la fin de la période juridiquement protégée à cette date du 23 juin 2020 inclus.
Le schéma est donc désormais le suivant :
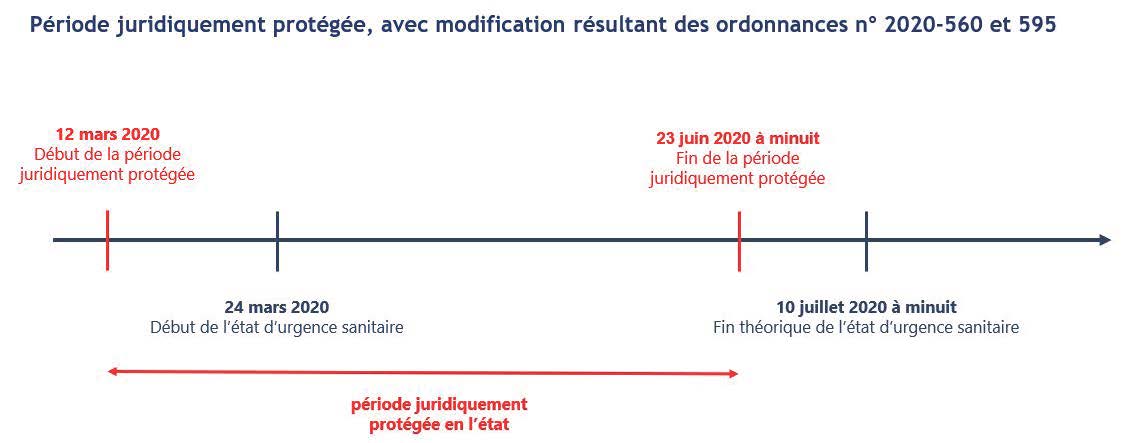
3.3. Les interrogations découlant de la déconnection existant désormais entre période juridiquement protégée et état d’urgence sanitaire
Deux remarques :
- la période juridiquement protégée débute avant l’état d’urgence sanitaire.
Cela est dû au fait que le gouvernement ne pouvait pas faire débuter l’état d’urgence sanitaire avant l’entrée en vigueur de la loi le déclarant.
Au contraire, le gouvernement a fait le choix de faire remonter dans le temps le début de la période juridiquement protégée, couvrant ainsi a posteriori des délais qui étaient déjà
venus à expiration avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-306 (N° Lexbase : L5730LW7) créant cette période.
Ce choix qui peut susciter des interrogations a été fait dès le départ.
Il est pragmatique et nous paraît heureux ;
- la période juridiquement protégée prend désormais fin avant l’état d’urgence sanitaire.Ce choix qui résulte de l’ordonnance n° 2020-560 nous paraît moins heureux.
En effet, quand bien même les mesures de confinement ne seraient plus en place depuis le 11 mai 2020, l’état d’urgence sanitaire continue de faire peser des contraintes anormales sur les parties.
Mais les parties ne pourront plus profiter du régime spécial mis en place dans le cadre de la période juridiquement protégée entre le 23 juin 2020 à minuit, date de fin de la période juridiquement protégée, et le 10 juillet 2020 à minuit, date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Elles devront donc plaider le droit commun de la force majeure, de l’impossibilité d’agir ou autres pour tenter de sauver des délais qui viendraient à expiration sans qu’elles ne puissent s’y opposer du fait de la situation actuelle, avec l’aléa inhérent à ce type d’arguments.
4. Exemples pratiques de délais prorogés à la suite des ordonnances n° 2020-560 et n° 2020-595
4.1. La conservation de plusieurs régimes de prorogation selon le type de délais
Ce contexte rappelé, les ordonnances n° 2020-304 et n° 2020-306 ne créaient pas un mais en réalité plusieurs régimes de prorogation selon le type de délais.
Les ordonnances n° 2020-560 et n° 2020-595 n’ont pas modifié ce mécanisme.
L’impact de la fixation au 23 juin 2020 inclus pour la fin de la période juridiquement protégée doit donc être étudié en distinguant selon le type de délais.
Dans les exemples pratiques qui suivent, les délais prorogés sont calculés en adoptant la position la plus conservatrice, c’est-à-dire en les computant à compter du 23 juin 2020 à minuit et non du 24 juin à 00h00.
4.2. La prorogation des délais de procédure et d’action
4.2.1. Rappel du mécanisme mis en place
Pour rappel, c’est l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 qui fixe le régime de prorogation des délais de procédure et d’action dans les termes suivants :
- « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
« Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.
« Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. »
La période mentionnée à l’article 1er est la période juridiquement protégée comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Comme il a été expliqué dans un précédent article, le mécanisme mis en place consiste à faire courir un nouveau délai de la même durée que celui initial à partir de la fin de la période juridiquement protégée, dans la limite de deux mois [6].
Ce mécanisme ne concerne pas les délais de procédure résultant de calendriers fixés par les juges de la mise en état des tribunaux judiciaires par exemple car il ne s’agit pas de délais prescrits par la loi ou le règlement. En pratique, ce type de délais a été balayé par l’arrêt de l’activité des tribunaux et des nouveaux calendriers seront fixés par les juridictions dans le cadre de leur reprise d’activité.
4.2.2. Exemples de délais arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée et faisant l’objet d’une prorogation
Le mécanisme de prorogation mis en place par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 aboutit au résultat suivant dans le cas d’un délai d’appel de quinze jours venant à échéance pendant la période juridiquement protégée :

Le mécanisme choisi faisant courir un nouveau délai de même durée que le délai initial, dans la limite de deux mois, à compter de la fin de la période juridiquement protégée, la fraction du délai potentiellement écoulé avant le début de la période juridiquement protégée est indifférente.
À titre d’exemple, un délai de procédure de quinze jours prorogé par ce mécanisme s’achèvera toujours le 8 juillet 2020, quelle que soit la date de son point de départ initial.
Le délai de trois mois pour déposer les conclusions d’appelant en application de l'article 908 du Code de procédure civile sera quant à lui traité ainsi, du fait du délai-butoir de deux mois :
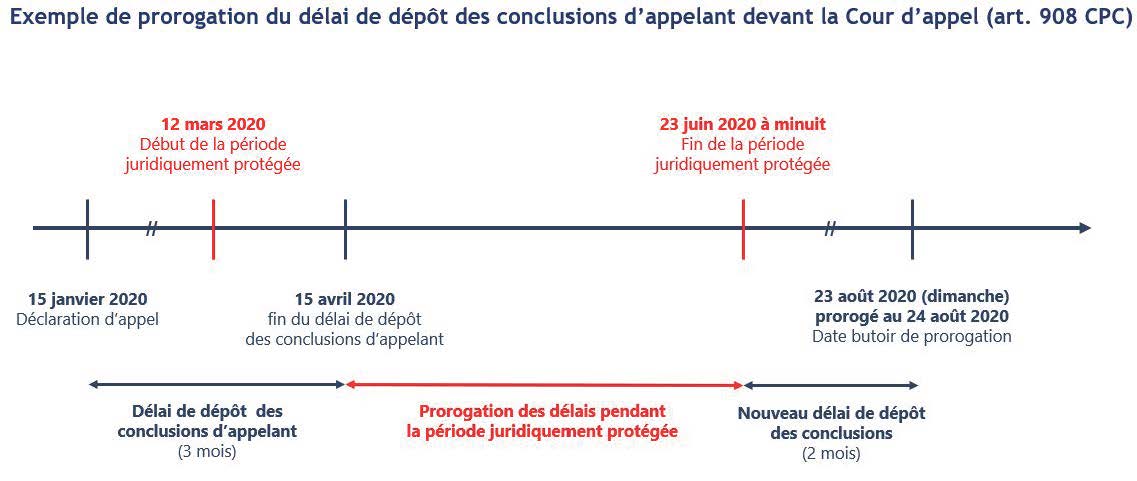
Une précision doit être apportée concernant les délais de prescription qui sont aussi concernés par ce mécanisme : n’étant pas des délais de procédure, ils ne sont pas computés de quantième à quantième lorsqu’ils sont typiquement exprimés en années. De même, ils ne sont pas prorogés au lundi lorsqu’ils s’achèvent un samedi ou un dimanche. En effet, les articles 640 (N° Lexbase : L6801H7Z) et suivants du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à eux ainsi qu’il a été vu ci-dessus (3.1).
En conséquence, la situation sera la suivante dans leur cas :
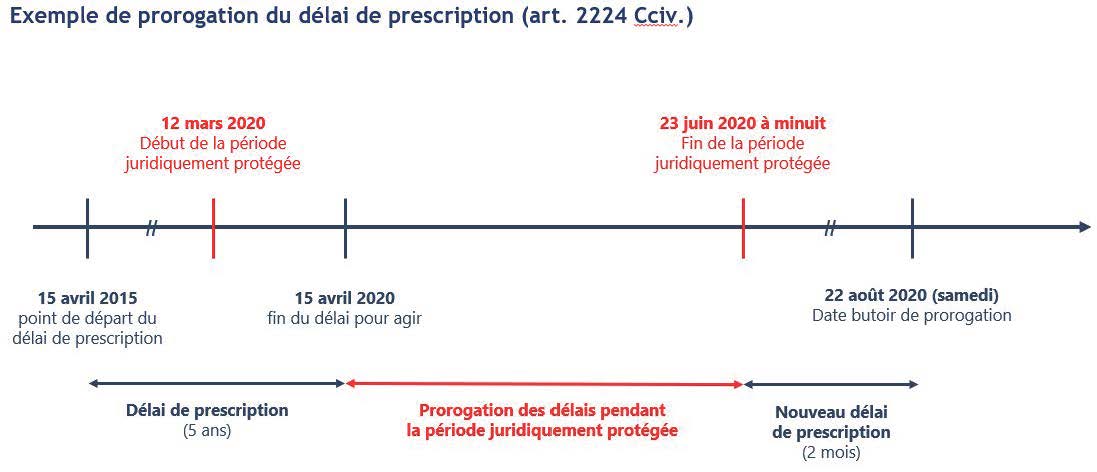
4.2.3. Exemples de délais arrivant à échéance après la période juridiquement protégée et ne faisant l’objet d’aucune prorogation
L’ordonnance n° 2020-560 n’a cependant pas touché à une problématique soulevée précédemment, à savoir que le mécanisme ne s’applique qu’aux délais de procédure et d’action s’achevant à l’intérieur de la période juridiquement protégée.
En conséquence, les délais s’achevant immédiatement après celle-ci continuent de ne bénéficier d’aucune prorogation.
Ainsi :
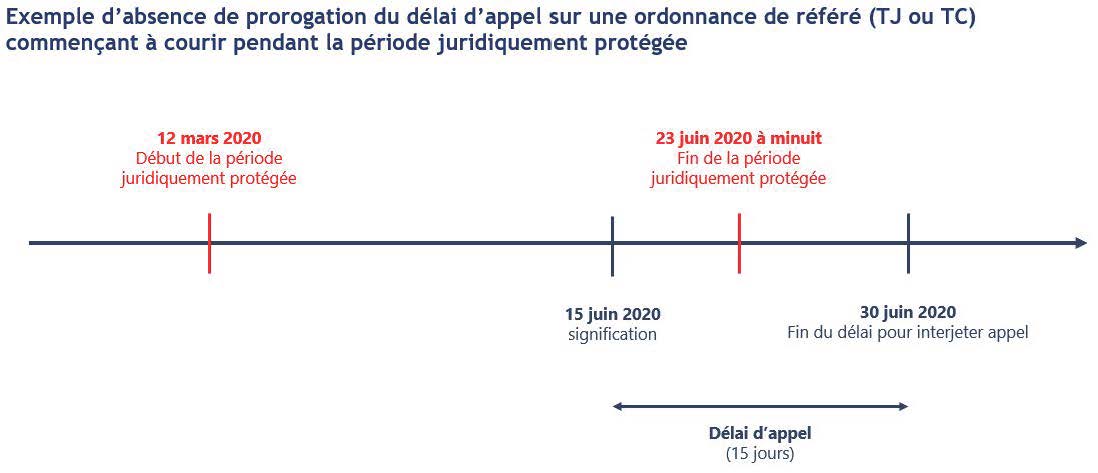
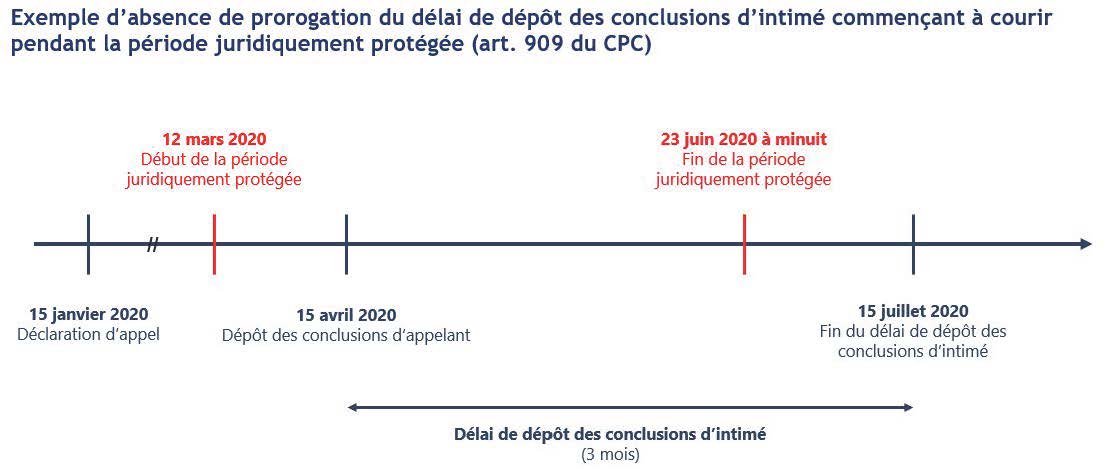
Nous avons déjà écrit à quel point cette situation nous paraissait illogique et injuste [7].
En tout état de cause, la prudence reste de mise, en particulier à l’égard des délais qui ont commencé ou commenceront à courir pendant la période juridiquement protégée.
4.2.4. L’outil de calcul des délais de Lexavoué
À signaler que le cabinet Lexavoué a mis à disposition un outil permettant de vérifier à la fois :
- que le régime de prorogation des délais s’applique à un délai particulier ;
- et sa date de prorogation si c’est le cas.
Nous avons testé l’outil et les résultats qu’il donne sont les mêmes que les nôtres, à l'exception des délais de prescription. En effet, ces derniers délais semblent calculés de quantième à quantième quand ils sont exprimés en mois et en années, alors même que l’article 641 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6802H73) prévoyant cette règle de computation ne leur est pas applicable ainsi qu’il a été dit. Il nous semble donc falloir retirer un jour aux délais de prescription prorogés calculés par l’outil, en se rappelant que ces délais ne sont pas reportés au premier jour ouvrable s’ils tombent un samedi, dimanche ou jour férié, l’article 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74) ne leur étant pas plus applicable que l’article 641.
4.3. La prorogation de certaines mesures administratives ou juridictionnelles
4.3.1. Rappel du mécanisme mis en place
Pour rappel, c’est l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 qui fixe le régime de prorogation des délais de certaines mesures administratives ou juridictionnelles dans les termes suivants :
- « Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la fin de cette période :
« 1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
« 2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
« 3° Autorisations, permis et agréments ;
« 4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
« 5° Mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice, par le juge ou l'autorité compétente, de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu'il détermine. Dans tous les cas, le juge ou l'autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire. »
À nouveau, la période mentionnée à l’article 1er est la période juridiquement protégée comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
À nouveau également et comme il a été expliqué dans un précédent article, le mécanisme mis en place présente l’avantage de la simplicité. Il consiste à reporter à une date unique la date d’échéance de mesures prenant normalement fin pendant la période juridiquement protégée [8].
4.3.2. L’allongement de la durée de la prorogation des mesures
Sans toucher au mécanisme de report de la date de fin des mesures, l’ordonnance n° 2020-560 a reculé d’un mois la date unique de report. Celle-ci était initialement fixée à deux mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée, elle est désormais fixée à trois mois, soit au 23 septembre 2020.
L’administration justifie cette prorogation additionnelle de la façon suivante : il faut éviter que ces mesures viennent à échéance le 23 août 2020 (23 juin + deux mois) et permettre aux intéressés d'accomplir les formalités nécessaires dans le courant du mois de septembre [9].
La justification paraît particulièrement hypocrite : ainsi que leurs noms l’indiquent, ces mesures « administratives ou juridictionnelles » concernent au premier chef les tribunaux. Or, ceux-ci seront en vacances en juillet et en août cette année comme les autres années, malgré le retard accumulé dans le traitement des dossiers du fait d’abord de la grève des avocats à compter de la fin 2019 puis de l’épidémie de covid-19
Les délais visés par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 concernent quant à eux leur délai-butoir de prorogation de deux mois à l’issue de la période juridiquement protégée, soit au 23 août 2020, alors qu’ils sont plus manifestement à la charge des parties.
On peut donc regretter que l’administration utilise une justification de nature à irriter les usagers du service public de la justice. Ceux-ci seront contraints d’accomplir les formalités nécessaires à la sauvegarde de leurs droits en juillet et en août 2020 alors que les juridictions pourront laisser filer le suivi des mesures administratives et juridictionnelles pendant leurs vacances d’été.
4.3.3. Exemple de mesures juridictionnelles arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée et faisant l’objet d’une prorogation
Quoi que l'on puisse penser du report d’un mois supplémentaire de la date d’échéance des mesures administratives et juridictionnelles visées à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306, la situation est donc la suivante à la suite des modifications apportées par l’ordonnance n° 2020-560 :
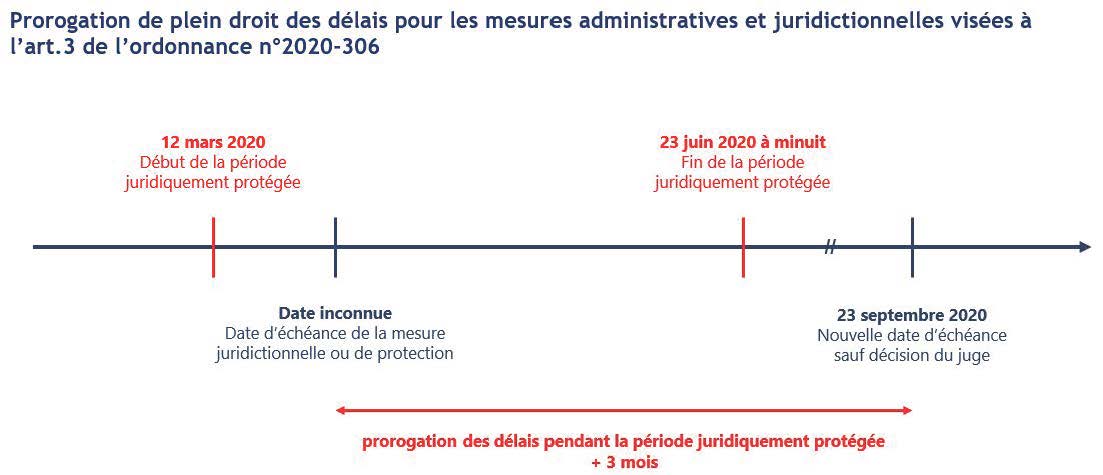
Les mesures arrivant à échéance hors de la période juridiquement protégée, soit avant le 12 mars 2020 et après le 23 juin 2020, ne font l’objet d’aucune prorogation, de même que celles non listées à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 puisque la liste que cet article fixe est manifestement limitative.
4.4. La prorogation des délais en matière d’astreintes, de clauses pénales, résolutoires et prévoyant une déchéance
4.4.1. Rappel du mécanisme mis en place
Pour rappel, c’est l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 qui fixe le régime de prorogation des délais en matière d’astreintes, de clauses pénales, résolutoires et prévoyant une déchéance dans les termes suivants :
« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
« Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
« La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.
« Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er. »
La période mentionnée à l’article 1er est toujours la période juridiquement protégée comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Le système mis en place est particulièrement difficile à lire et à comprendre, ce qui est d’autant plus regrettable que, au final, il paraît inutilement compliqué : il se décompose en effet en trois hypothèses qui se réduisent en réalité toutes à une suspension des délais pendant la période juridiquement protégée. Malheureusement, ces trois hypothèses comprennent des exceptions qui compliquent le tableau.
4.4.2. Première hypothèse : exemples d’astreintes et de clauses prenant effet avant la période juridiquement protégée et faisant l’objet d’une suspension jusqu’à sa fin, hors clauses résolutoires et prévoyant une déchéance déjà acquises
Cette première hypothèse est réglée par le 4e et dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 :
- « Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er. »
Cet alinéa crée implicitement deux régimes distincts : un régime nommé de suspension pour les astreintes et les clauses pénales (a.) et un régime innommé, en creux, sans aucune prorogation pour les clauses résolutoire et prévoyant une déchéance (b.).
L’articulation de ces deux régimes n’est cependant pas sans incohérence concernant les clauses pénales dont l’application devrait être suspendue ou non selon que leurs effets sont instantanés ou s’étalent dans le temps ainsi qu’il sera vu (c.).
4.4.2.1. La suspension des astreintes et des clauses pénales
Le régime des astreintes et clauses pénales ayant commencé à courir ou ayant pris effet avant le début de la période juridiquement protégée le 12 mars 2020 peut être illustré ainsi :
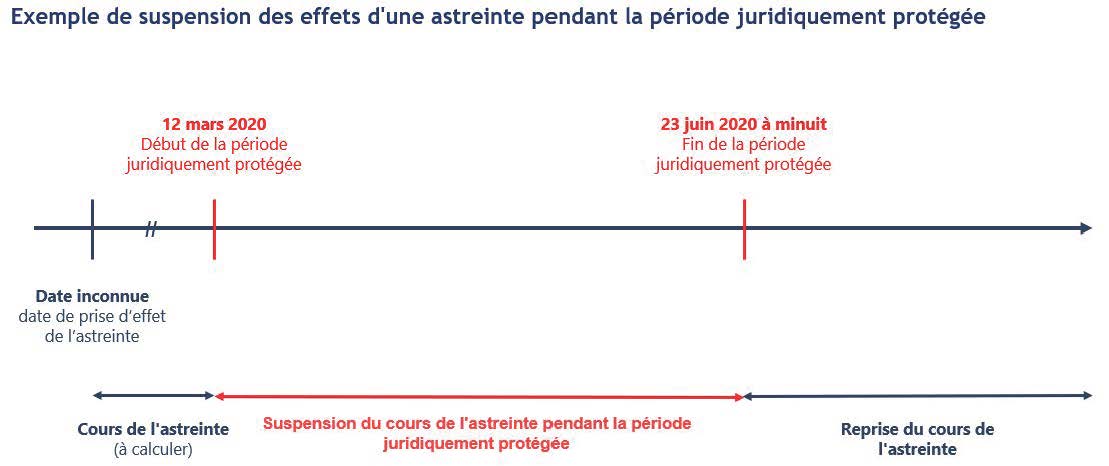
Les astreintes et les clauses pénales qui ont commencé à courir avant le début de la période juridiquement protégée le 12 mars 2020 sont suspendues pendant toute sa durée et reprennent leur cours et recommencent à être appliquées à sa fin, soit à compter du 23 juin 2020 à minuit.
Cette hypothèse ne présente pas de difficulté particulière.
4.4.2.2. L’absence de suspension des clauses résolutoires et prévoyant la déchéance
Si rien n’est dit sur les clauses résolutoires et prévoyant une déchéance qui ont pris effet avant le 12 mars 2020, la logique dicte que la période juridiquement protégée n’ait aucun effet sur elles.
En effet, elles se sont exécutées en un trait de temps avant le début de la période juridiquement protégée et tous leurs effets ont été immédiatement consommés avant elle.
Ainsi :

L’exemple ci-dessus est tiré d’une fiche technique que le ministère de la Justice a produite [10].
La clause résolutoire d’un bail a été acquise le 10 mars 2020 et le bail a cessé d’exister à cette date. La suspension des délais prévus au 4e et dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 ne peut donc pas suspendre cette résolution et faire renaître le bail le temps de la période juridiquement protégée.
La différence de traitement des astreintes et clauses pénales d’une part et des clauses résolutoire et prévoyant une déchéance d’autre part s’explique donc par la différence de nature de leurs effets : exécution successive pouvant être suspendue pour les premières ; exécution instantanée ne pouvant l’être pour les secondes.
4.4.2.3. L’incohérence du régime créé s’agissant des clauses pénales
On notera cependant une difficulté concernant les clauses pénales.
En effet, si elles s’exécutent fréquemment sur la durée, ce n’est pas toujours le cas. Les clauses pénales qui s’exécutent en un trait de temps et qui consomment immédiatement tous leurs effets sont même courantes. C’est, par exemple, le cas d’une violation contractuelle ponctuelle à laquelle le contrat attache une sanction pécuniaire forfaitaire.
Si la violation a eu lieu avant le 12 mars 2020 et a déclenché l’application d’une sanction pécuniaire instantanée sans autre effet pour le futur, on comprend mal comment l’application de la clause pénale qui a pris effet avant la période juridiquement protégée pourrait se trouver suspendue pendant la durée de celle-ci.
Ce type de clauses pénales à exécution instantanée devrait être traité comme les clauses résolutoires ou prévoyant une déchéance.
Malheureusement, il semble que le législateur ait appréhendé le problème de la suspension ou non des clauses sous le prisme de leur seule qualification plutôt que de leurs effets dans le temps, créant des incohérences.
4.4.3. Deuxième hypothèse : exemple d’astreintes et de clauses prenant effet pendant la période juridiquement protégée et faisant l’objet d’une suspension jusqu’à sa fin
Cette hypothèse est réglée par les deux premiers alinéas de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 :
- « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
- « Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. »
Ainsi :
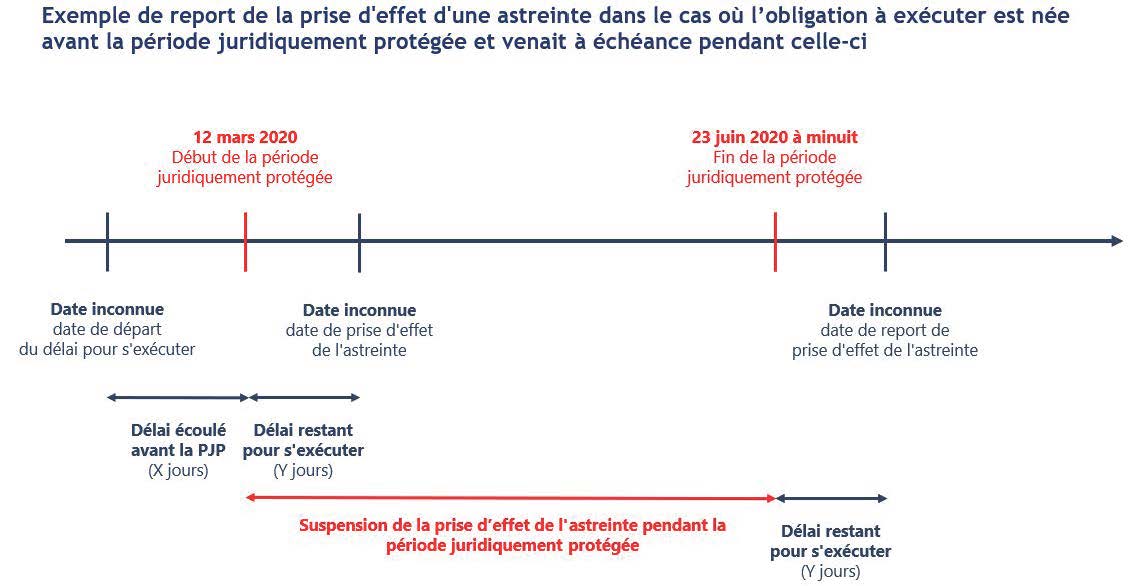
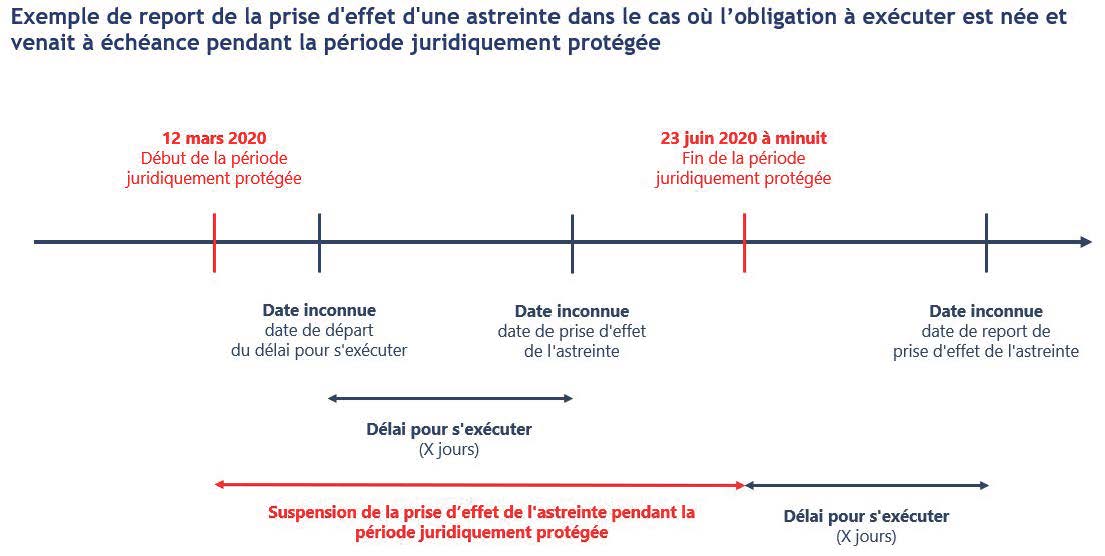
On reconnaît là, dans une formulation inutilement complexe, le mécanisme de la suspension prévue, en matière de prescription, à l’article 2230 du Code civil (N° Lexbase : L7215IAH) :
- « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. »
Pour schématiser :
- le point de départ de la suspension du délai est le début de la période juridiquement protégée le 12 mars 2020 ou la date de naissance du délai si elle est ultérieure ;
- la date de reprise du cours du délai est la fin de la période juridiquement protégée le 23 juin 2020 à minuit ;
- le délai postérieure au redémarrage ou au démarrage du délai est le solde du délai non couru au 12 mars 2020 ou l’intégralité du délai s’il a commencé à courir le 12 mars 2020 ou après.
4.4.4. Troisième hypothèse : exemples d’astreintes et de clauses prenant effet après la période juridiquement protégée et faisant l’objet d’une suspension jusqu’à sa fin, sauf astreintes et clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation de somme d’argent
Cette hypothèse est réglée par le 3e alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 :
- « la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. »
Cet alinéa crée explicitement, deux régimes distincts : un régime de suspension pour les astreintes et clauses autre que portant sur l’exécution de sommes d’argent (a.) et un régime sans aucune prorogation pour les astreintes et clauses portant sur l’exécution de sommes d’argent (b.).
4.4.4.1. La suspension des astreintes et des clauses autres que portant sur l’exécution de sommes d’argent
Le régime des astreintes et clauses autres que portant sur l’exécution de sommes d’argent lorsqu’elles prennent cours ou effet après la fin de la période juridiquement protégée le 23 juin peut être illustré de la façon suivante, selon que l’obligation à exécuter est elle-même née avant ou après le début de la période juridiquement protégée :
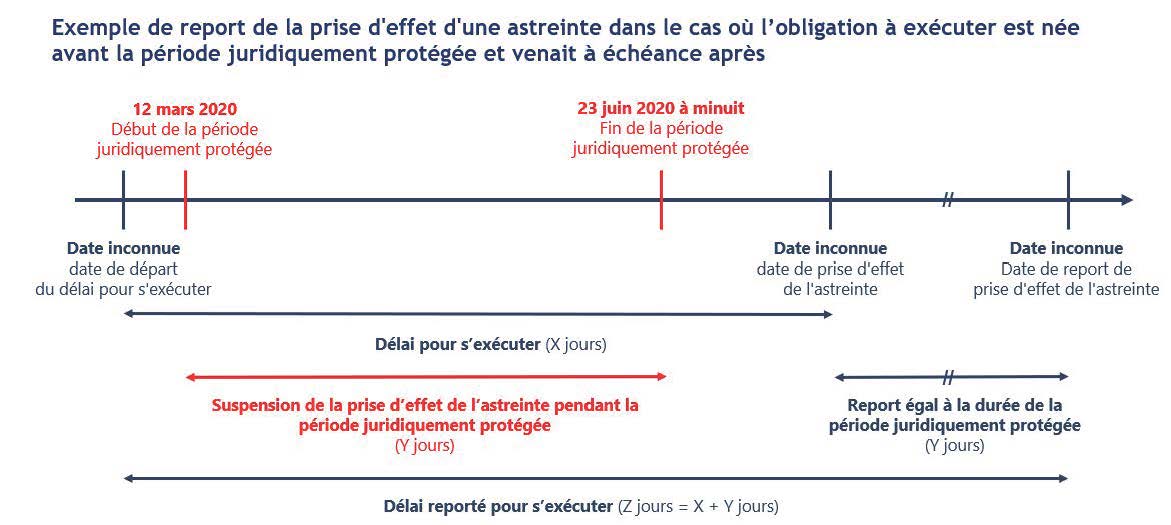
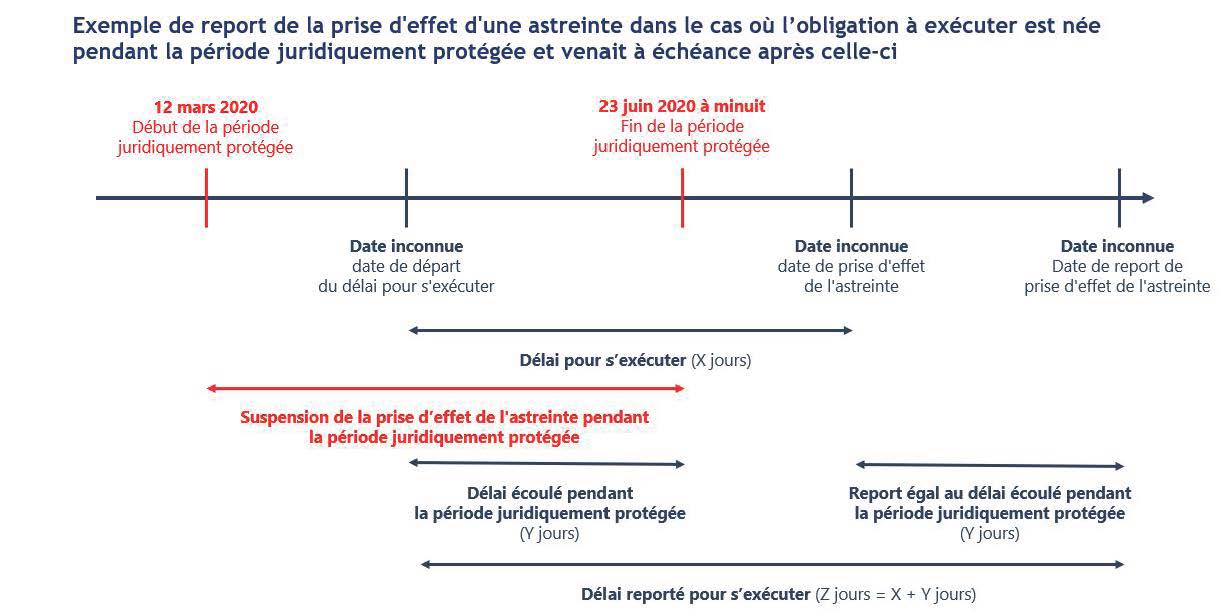
Les calculs que cette hypothèse implique sont d’une complexité d’autant plus inutile que, en analysant les schémas ci-dessus, on comprend que la formulation particulièrement tortueuse du texte masque en réalité à nouveau purement et simplement une suspension des délais pendant la période juridiquement protégée.
En effet, le délai courant après la période juridiquement protégée est augmenté d’une durée égale au temps écoulé pendant la période juridiquement protégée.
C’est-à-dire que le cours des délais a été temporairement arrêté le temps de la période juridiquement protégée puis a repris, sans effacer le délai qui avait éventuellement couru avant la période juridiquement protégée.
Si l'on reformule les exemples ci-dessus, on obtient ainsi :
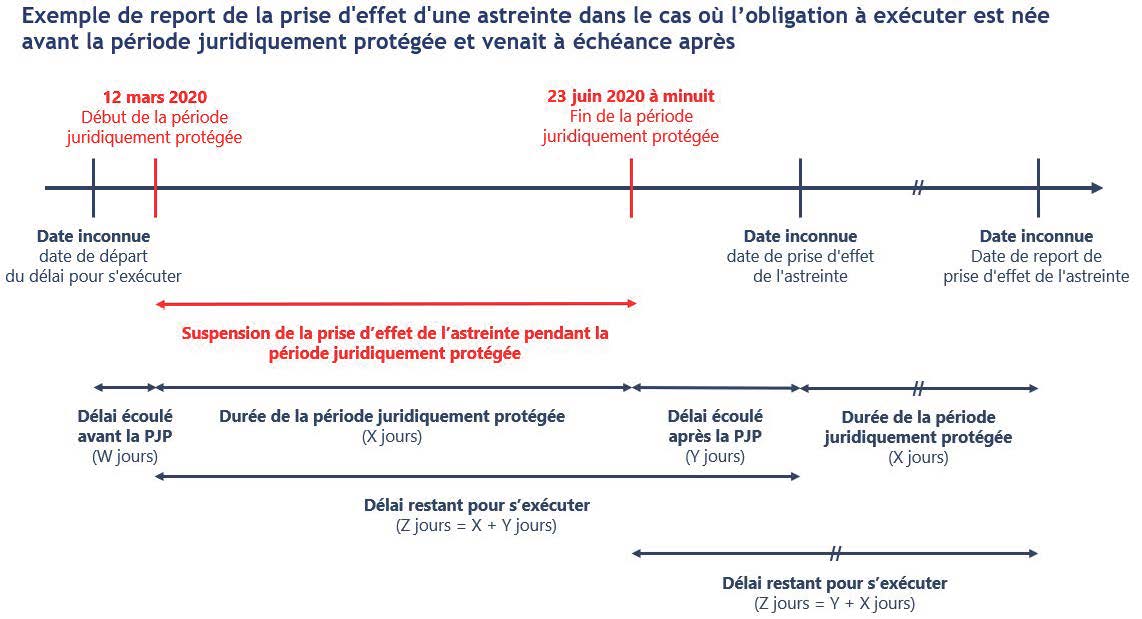
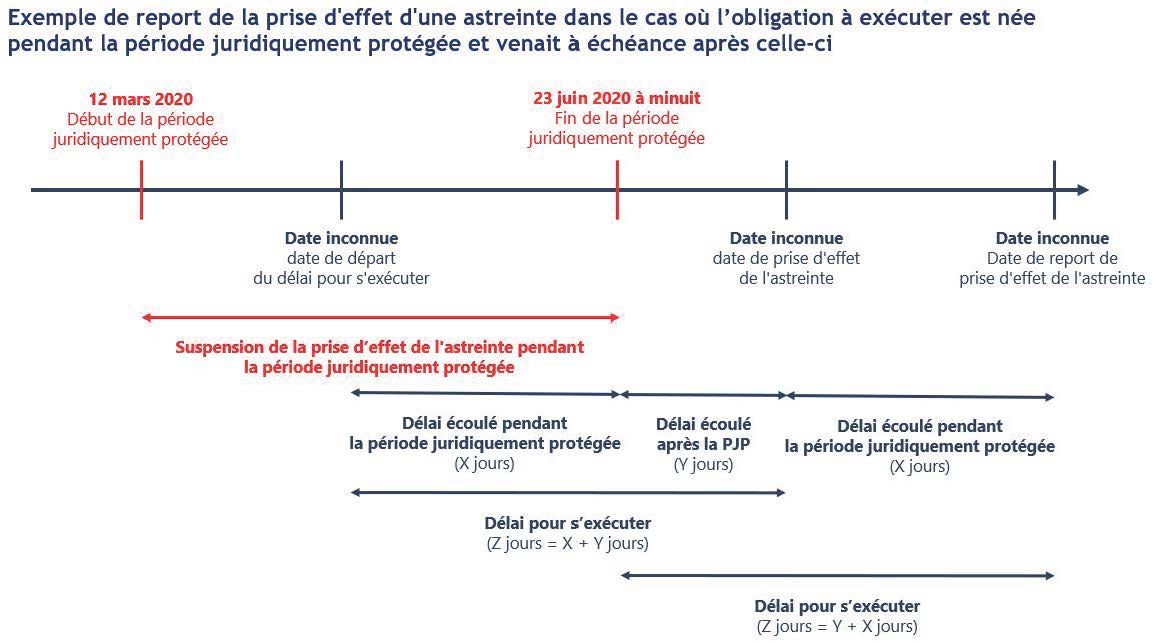
4.4.4.2. L’absence de suspension des astreintes et clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation de sommes d’argent
De façon quelque peu subreptice, le 3e alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 écarte cependant du bénéfice de la suspension des délais qu’il organise les astreintes et clauses qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation de sommes d’argent.
Il s’agit d’un choix volontaire et revendiqué par les auteurs de l’ordonnance.
Le rapport au Président de la République accompagnant l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 (N° Lexbase : Z008679T) qui a modifié l'ordonnance n° 2020-306 et introduit cette exception précise en effet que [11] : « les clauses et astreintes sanctionnant les obligations de sommes d'argent sont exclues de ce second dispositif applicable aux échéances postérieures à la fin de la période juridiquement protégée. En effet, l'incidence des mesures résultant de l'état d'urgence sanitaire sur la possibilité d'exécution des obligations de somme d'argent n'est qu'indirecte et, passé la période juridiquement protégée, les difficultés financières des débiteurs ont vocation à être prises en compte par les règles de droit commun (délais de grâce, procédure collective, surendettement). »
La date d’effet de ces astreintes et clauses ne bénéficie donc d’aucun aménagement d’aucune sorte dès lors qu’elles prennent effet postérieurement à la période juridiquement protégée le 23 juin 2020 à minuit, quand bien même leur date d’effet serait le 24 juin 2020.
Cette exception est importante car les clauses résolutoires sont très courantes en pratique : il s’agit notamment de celles introduites dans les baux d’habitation et commerciaux pour sanctionner le défaut de paiement du loyer.
L’exemple ci-après illustre le cas d’un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un bail commercial délivré le 25 mai 2020. Cette clause prend effet un mois après la délivrance du commandement resté infructueux en application de l’article L. 145-41 du Code de commerce (N° Lexbase : L1063KZE) :

Cette solution soulève le même sentiment de malaise que son équivalent pour les délais de procédure et pour agir expirant après la fin de la période juridiquement protégée et qui ne bénéficient également, pour cette raison, d’aucune prorogation (cf. 4.2.3.).
Ainsi :
- un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial qui aura été délivré le 25 mars 2020 pour non-paiement du loyer de février 2020 ne prendra effet que le 23 juillet 2020 ;
alors que :
- le même commandement de payer délivré deux mois plus tard, le 25 mai 2020, soit moins d’un mois avant la fin de la période juridiquement protégée, prendra effet dès le 25 juin 2020, soit un mois plus tôt.
Où sont ici la logique et la justice ?
Il s’agit cependant bien d’un choix volontaire, y compris dans ses conséquences prévisibles en matière de baux.
Le ministère de la Justice a en effet publié une fiche pratique concernant les baux d’habitation [12]. Elle confirme expressément qu’aucune prorogation de délai n’a vocation à s’appliquer aux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail dont la date d’expiration est postérieure au 23 juin 2020.
4.5. La prorogation des délais en matière de saisie immobilière
4.5.1. Rappel du mécanisme mis en place
Pour rappel, c’est l’article 2 II. 3° de l’ordonnance n° 2020-304 qui fixe le régime de d’aménagement des délais en matière de saisie immobilière dans les termes suivants :
- « Les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».
Les articles L. 311-1 (N° Lexbase : L5865IRN) à L. 322-14 (N° Lexbase : L5892IRN) et R.311-1 (N° Lexbase : L2387ITL) à R. 322-72 (N° Lexbase : L2491ITG) du Code des procédures civiles d’exécution correspondent à la procédure de saisie immobilière, hors distribution du prix.
Le mécanisme mis en place est clair : il s’agit d’une suspension de tous les délais pendant la période juridiquement protégée du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
À noter cependant que, alors que les autres régimes examinés jusqu’à présent renvoyaient tous à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 pour définir la période juridiquement protégée, ce n’est pas le cas ici. La fenêtre temporelle de la suspension des délais en matière de saisie immobilière est définie directement dans le texte la prévoyant.
Cela semble dû à la confusion qui paraît avoir entouré la question.
En effet, l’ordonnance n° 2020-560 qui a modifié l’ordonnance n° 2020-306 pour fixer au 23 juin 2020 inclus la fin de la période juridiquement protégée n’a pas modifié l’ordonnance n° 2020-304 portant notamment sur les délais en matière de saisie immobilière. C’est l’ordonnance ultérieure n° 2020-n° 595 qui l’a fait.
Dans l’intervalle, la suspension prévue à l’article 2 II. 3° de l’ordonnance n° 2020-304 devait durer pendant la période « mentionnée à l’article 1er » sans plus de précision.
Un débat s’est élevé pour savoir s’il s’agissait de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-304 ou 2020-306 [13], sachant que la période mentionnée à l’article 1er de ces deux ordonnances était initialement alignée puis a divergé à la suite de la modification de l’ordonnance n° 2020-306 par l’ordonnance n° 2020-560.
Plutôt que de préciser que l’article 1er dont il était question à l’article 2 II. 3° de l’ordonnance n° 2020-304 était celui de l’ordonnance n° 2020-306 comme pour les autres régimes de prorogation des délais, les dates de début et de fin de la période juridiquement protégée ont été directement mentionnés dans l’article.
Cette façon de procéder est critiquable car personne ne connaît l’évolution future de l’épidémie de covid-19. Il est parfaitement possible que la période juridiquement protégée voit sa date de fin encore modifiée à l’avenir. Dans ce cas, il faudra intervenir deux fois au lieu d’une :
- sur l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306, ce qui se répercutera, par référence, sur tous les régimes de prorogation mis en place, sauf sur celui concernant les saisies immobilières ;
- sur l’article 2 II. 3° de l’ordonnance n° 2929-304 pour le régime de prorogation des seules saisies immobilières.
La plus grande prudence est donc ici de mise dans le cas où une modification de la période juridiquement protégée devait encore intervenir.
4.5.2. Exemples de délais suspendus pendant la période juridiquement protégée
Ceci posé, le régime de suspension applicable aux saisies immobilières est a priori simple à mettre en œuvre.
La situation est ainsi la suivante dans le cas d’un commandement de payer devant être publié au service de la publicité foncière dans les deux mois de sa signification, en application de l’article R. 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L7862IUQ) :
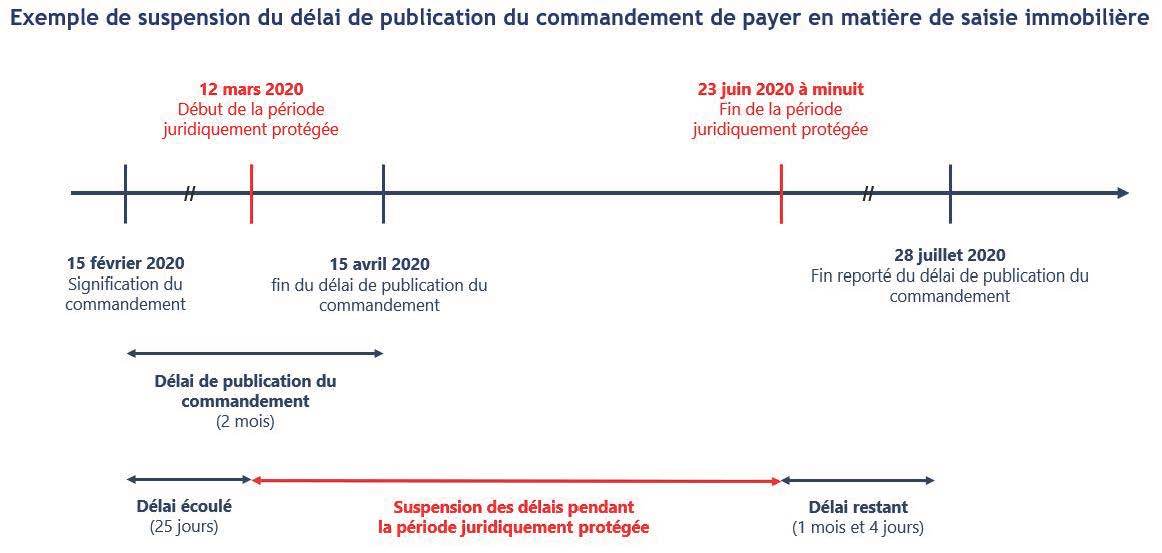
En pratique, la difficulté est cependant que la procédure de saisie immobilière se caractérise par un grand nombre de délais s’enchaînant les uns après les autres et portant sur des actes qui ne sont pas tous à la charge du créancier poursuivant à l’origine de la procédure.
La situation peut ainsi, par exemple, être la suivante à l’issue d’un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du bien et fixant la date de l’audience d’adjudication :
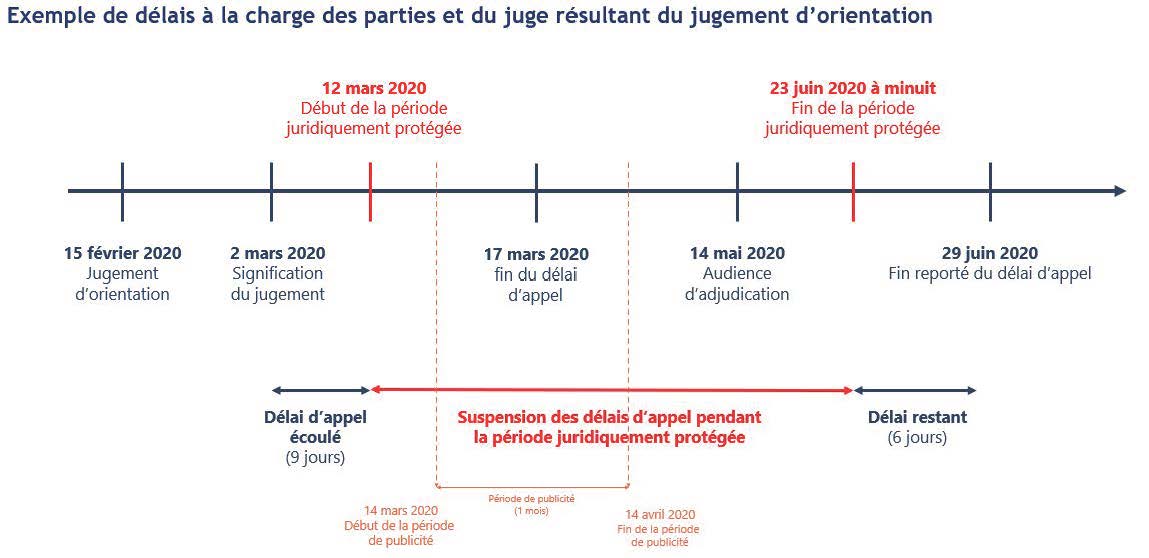
On notera une difficulté, soulevée par notre confrère Frédéric Kieffer, concernant l’aménagement du délai d’appel sur le jugement d’orientation : l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2438ITH) qui prévoit que l’appel doit être formé selon la procédure à jour fixe ne dit rien sur la durée du délai de recours [14]. Ce sont donc les dispositions de droit commun de l’article R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L7259LEL) qui s’appliquent en l’espèce, fixant le délai d’appel à quinze jours.
En conséquence, doit-on appliquer à ce délai :
- la suspension de l’article 2 II. 3° de l’ordonnance n°2020-304 qui ne concerne que les délais mentionnés aux articles R. 311-1 à R. 322-72 pour la partie réglementaire du Code des procédures civiles d'exécution ;
- ou la prorogation de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 qui vise, de façon plus générale, les délais de recours ?
Quoi qu’il en soit de la position de principe à adopter, il nous semble préférable, de façon pragmatique, d’adopter la position d’une suspension qui est moins favorable en termes de calcul des délais.
Cette solution est donc plus protectrice des intérêts de la personne devant faire appel qui ne peut ainsi être à risque de laisser expirer son délai.
Cette difficulté montre cependant les abîmes de complexité dans lesquels les régimes spéciaux mis en place par le Gouvernement plongent les praticiens.
Pour le reste, réfléchir en termes de suspension des délais a peu de sens dans le cas illustré ci-dessus : l’audience d’adjudication prévue pendant la période juridiquement protégée n’aura pas pu se tenir et les autres délais, en particulier de publicité, devront être remis à plat par rapport à la nouvelle date de l’audience d’adjudication que le tribunal fixera.
Nous avons déjà traité ce point dans un précédent article [15]. La situation est toujours confuse à ce jour, d’autant que les différentes juridictions reprennent leurs activités en ordre dispersée : certains juge de l’exécution immobilier ont déjà recommencé à traiter les dossiers de saisies immobilières dès la fin du confinement à la mi-mai 2020, d’autres annoncent qu’ils ne reprendront les ventes qu’à partir de fin septembre 2020, soit plus de quatre mois plus tard.
Il faut donc redoubler de prudence en la matière et se rapprocher de sa juridiction pour savoir ce qu’il en est du traitement de son dossier.
[1] Voir notamment, dans la même revue, R. Laher, Ch. Simon, Les délais de procédure civile face à l’épidémie de covid-19, Lexbase, éd priv n°820, avril 2020, (N° Lexbase : N2925BYY) ; A. Martinez-Ohayon, Ch. Simon, Aménagements de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 portant prorogation des délais en matière d’astreinte, Lexbase éd priv n°820, avril 2020, (N° Lexbase : N3089BY3).
[2] Direction des affaires civiles et du Sceau, ministère de la Justice, Circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020- 306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, publiée le 26 mars 2020, rectifiée le 30 mars 2020, n° NOR JUSC 2008608C.
[3] Conseil d’État, avis du 1er avril 2020 sur un projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire. Cf. en particulier le point 7. : «les dérogations au droit commun des délais] étaient justifiées par la situation d’arrêt massif de l’activité du pays provoquée par la mesure générale de confinement de la population à partir du 17 mars. Dès lors que ce confinement va être progressivement levé et que l’activité va reprendre, ces dérogations ne pourront plus se fonder sur leurs justifications initiales. Aussi le Conseil d’Etat estime-t-il que la nécessité et proportionnalité de ces dérogations doivent faire, de la part du Gouvernement, l’objet, dans les semaines qui viennent, d’un réexamen systématique et d’une appréciation au cas par cas. »
[4] Ph. Dupichot, Covid-19 | Date de fin de l'état d'urgence sanitaire : à la recherche du dies ad quem, 7 avril 2020.
[5] Cf. la position de la Direction des Affaires civiles et du Sceau dans la circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, publiée le 17 avril 2020, n° NOR JUSC2009856C.
[6] R. Laher, Ch. Simon, ibid., 3.1.3.
[7] R. Laher, Ch. Simon, ibid., en particulier 3.1.6. c. et d.
[8] R. Laher, Ch. Simon, ibid., 3.2.
[9] Ministère de l’action et des comptes publics, Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire in Journal officiel, 14 mai 2020, n° NOR CPAX2011459P.
[10] Direction des affaires civiles et du Sceau, ministère de la Justice, Conséquences de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en matière de baux d’habitation en cas de défaut de paiement du locataire, 11 mai 2020.
[11] Ministère de la Justice, rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 in Journal officiel, 16 avril 2020, n° JUSX2009567P(N° Lexbase : Z008679T).
[12] Direction des affaires civiles et du Sceau, ministère de la Justice, Conséquences de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en matière de baux d’habitation en cas de défaut de paiement du locataire, 11 mai 2020.
[13] Militant pour une référence à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-304, voir Fr.Kieffer, Nouvelle ordonnance « délai covid-19 » : impact sur la saisie immobilière in Dalloz Actualité, 18 mai 2020. En sens inverse, voir FI. Bacle , Derniers rebondissements de la crise du covid-19 sur les délais de saisie immobilière, 19 mai 2020.
[14] Fr. Kieffer, « Délais covid-19 » : L’ordonnance n° 2020-n° 595 du 20 mai 2020 et la saisie immobilière in Dalloz Actualité, 27 mai 2020.
[15] R. Laher, Ch. Simon, ibid., 4.2.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473395
[Brèves] Annulation du placement en détention provisoire à raison de l’absence de convocation de l’avocat : dans quelles conditions le juge peut-il délivrer un nouveau mandat de dépôt ?
Réf. : Cass. crim., 6 mai 2020, n° 20-81.136, F-P+B+I (N° Lexbase : A63273LW)
Lecture: 3 min
N3405BYR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 03 Juin 2020
► Il résulte des articles 803-7 (N° Lexbase : L4833K8I) et 144 (N° Lexbase : L9485IEZ) du Code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention ne peut délivrer à l’encontre d’une personne remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire, après que la chambre de l’instruction a constaté l’irrégularité de son placement en détention provisoire pour non-respect des formalités prévues, un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits, et dans la même information, que lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l’article 144 du Code de procédure pénale justifient la délivrance de ce nouveau titre d’incarcération.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mai 2020 (Cass. crim., 6 mai 2020, n° 20-81.136, F-P+B+I N° Lexbase : A63273LW).
Résumé des faits. Mis en examen des chefs de tentative de destruction volontaire par incendie en bande organisée, non-justification de ressources et association de malfaiteurs, un homme a été placé en détention provisoire par une ordonnance du même jour rendue par le JLD du tribunal judiciaire de Besançon. Sur son appel de cette décision, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon a annulé le procès-verbal de débat contradictoire au motif que l’avocat de la personne mise en examen n’avait pas été convoqué, a ordonné la mise en liberté de l’intéressé et l’a placé sous contrôle judiciaire en application de l’article 803-7 du Code de procédure pénale.
Interpellé à la porte de la maison d’arrêt le jour même sur mandat d’amener du juge d’instruction, il a été placé de nouveau en détention provisoire par ordonnance.
Il a interjeté appel de la décision du JLD en demandant son examen immédiat par le président de la chambre de l’instruction. Le président de la chambre de l’instruction, saisi de ce référé-liberté, a dit n’y avoir lieu de remettre l’intéressé en liberté et a renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction.
En cause d’appel. Pour rejeter le moyen de nullité, selon lequel l’intéressé ne pouvait être réincarcéré en l’absence de violation de son contrôle judiciaire et faute d’élément nouveau, et confirmer le nouveau placement en détention provisoire, l’arrêt relève qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit, lorsque le titre de détention a été annulé pour vice de forme, de placer à nouveau la personne mise en examen en détention provisoire, dès lors que le placement en détention a été annulé pour un vice de forme issu de l’absence de convocation de son avocat au débat contradictoire.
Selon les juges, le contrôle judiciaire, ordonné par la chambre de l’instruction, par application des dispositions de l’article 803-7 du Code de procédure pénale, dans des conditions procédurales précises faisant suite à l’annulation pour vice de forme du placement initial en détention provisoire, est sans effet sur le principe jurisprudentiel de délivrance en cas d’annulation pour vice de forme de la mesure initiale de détention provisoire, d’un nouveau titre de détention.
Un pourvoi a été formé.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt au visa des articles 803-7 et 144 du Code de procédure pénale. Elle considère qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’a pas constaté que la personne mise en examen avait méconnu les obligations du contrôle judiciaire auxquelles elle était astreinte, a violé les textes et le principe susvisé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473405
[Focus] Détentions provisoires, sur le fil du rasoir : éclairage sur les effets du nouvel article 16-1
Lecture: 35 min
N3402BYN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Benjamin Fiorini, Maître de conférences à l’Université Paris 8
Le 28 Mai 2020
Nouveau régime des détentions provisoires. Il y a du provisoire qui dure, et il est parfois nécessaire d’y mettre fin. Telle elle est en partie l’objectif de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9), en ce qu’elle organise la disparition progressive du régime exceptionnel des détentions provisoires instauré par l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5740LWI).
Dans cette optique, l’une des principales innovations de la loi du 11 mai 2020 est l’introduction dans l’ordonnance du 25 mars 2020 d’un article 16-1 venant compléter les dispositions de l’article 16 tant décrié. Comportant sept alinéas, ce nouvel article est ainsi rédigé :
« A compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire prévue à l'article 16 n'est plus applicable aux titres de détention dont l'échéance intervient à compter de cette date et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire intervenant, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 19.
Si l'échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du Code de procédure pénale, intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu'il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu'à cette décision. Cette prorogation s'impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction. En ce qui concerne les délais de détention au cours de l'instruction, cette durée est celle prévue par les dispositions de droit commun ; toutefois, s'il s'agit de la dernière échéance possible, la prolongation peut être ordonnée selon les cas pour les durées prévues à l'article 16 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne les délais d'audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues au même article 16, y compris si elle intervient après le 11 juin 2020.
La prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l'instruction avant le 11 mai 2020, en application dudit article 16, n'a pas pour effet d'allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du Code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.
Lorsque la détention provisoire au cours de l'instruction a été prolongée de plein droit en application de l'article 16 de la présente ordonnance pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu'à son terme que par une décision prise par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l'article 145 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2791KGH) et, le cas échéant, à l'article 19 de la présente ordonnance. La décision doit intervenir au moins trois mois avant le terme de la prolongation. Si une décision de prolongation n'intervient pas avant cette date, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Pour les délais de détention en matière d'audiencement, la prolongation de plein droit des délais de détention ou celle décidée en application du troisième alinéa du présent article a pour effet d'allonger la durée maximale totale de la détention possible jusqu'à la date de l'audience prévue en application des dispositions du Code de procédure pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux assignations à résidence sous surveillance électronique ».
L’objectif de notre exposé sera de présenter clairement le contenu de cet article fleuve et parfois obscur, notamment à la lumière de la nouvelle circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020 (N° Lexbase : L1891LXC), sans faire l’économie de quelques critiques quant aux modalités retenues, et en proposant deux tableaux récapitulant synthétiquement l’état du droit.
Principales innovations de l’article 16-1. Avant de procéder à une analyse plus fine, il doit d’emblée être souligné que cet article emporte deux conséquences majeures. Premièrement, d’après son premier alinéa, à partir du 11 mai 2020, aucune prolongation de détention provisoire ne peut faire l’objet d’une prolongation de plein droit sans intervention d’un juge précédée d’un débat contradictoire. Cette mise entre parenthèses des juges pour les titres de détention arrivant à expiration entre le 26 mars et le 10 mai 2020, accréditée par la fameuse circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2008571C du 26 mars 2020 (N° Lexbase : L6081LW7), a déjà fait couler beaucoup d’encre [1]. On ne peut d’ailleurs s’empêcher de remarquer que la nouvelle circulaire n° JUSD2011710C du 13 mai 2020 précise que « l’article 16-1 concilie ainsi l’objectif tendant à redonner aussi rapidement que possible aux juridictions leur compétence pour statuer, de façon contradictoire, sur les prolongations » [2], ce qui revient implicitement à affirmer que les juges qui auraient courageusement résisté à l’interprétation hasardeuse de la précédente circulaire n’étaient pas compétents pour le faire… Le monde à l’envers !
Secondement, pour tenir compte du déconfinement intervenu le 11 mai 2020 et de la reprise progressive de l’activité judiciaire qui en découle, l’article 16-1 organise un dispositif transitoire entre le 11 mai et le 10 juin 2020 permettant aux juridictions de se réorganiser, notamment en offrant aux magistrats concernés la possibilité de reporter d’un mois les débats portant sur la prolongation des détentions provisoires. Comme cela est expliqué en détail ci-après, le plein retour au droit commun ne s’effectuera qu’à compter du 11 juin 2020 s’agissant des détentions provisoires à l’instruction, et du 11 août 2020 s’agissant des détentions provisoires à l’audiencement.
Plan de l’exposé. Pour effectuer la synthèse la plus claire possible des dispositions de l’article 16-1, seront successivement présentés le régime des prolongations de plein droit appliquées entre le 26 mars et le 10 mai 2020 (I), celui des prolongations décidées entre le 11 mai et le 10 juin 2020 (II), et enfin celui des prolongations qui seront décidées à partir du 11 juin 2020 (III). Le propos sera complété par deux tableaux synthétiques, l’un concernant les titres de détention provisoire à l’instruction (tableau 1), l’autre les titres de détention provisoire à l’audiencement (tableau 2).
Avant tout développement, il convient également de préciser que tout ce qui sera dit au sujet des détentions provisoire est également applicable, d’après les termes de l’article 16-1 in fine, aux assignations à résidence sous surveillance électronique.
I - Régime des prolongations de plein droit appliquées entre le 26 mars et le 10 mai 2020
- Validité des prolongations de plein droit :
Maintien des prolongations de plein droit. Il résulte de l’économie générale de l’article 16-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 que les prolongations de plein droit de détention provisoire, appliquées entre le 26 mars et le 10 mai 2020 sur le fondement de l’article 16 de ladite ordonnance, restent pleinement acquises et n’ont donc pas vocation à être annulées ou interrompues. Cette observation est valable en toute hypothèse, quelle que soit la durée de la prolongation de plein droit (2, 3 ou 6 mois selon les cas), que celle-ci soit intervenue en cours d’instruction ou à l’audiencement.
Apports des arrêts de la Cour de cassation du 26 mai 2020. Dans deux arrêts très attendus du 26 mai 2020 [3], la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les prolongations de plein droit prévues par l’article 16, en ce qu’elles ont empêché les détenus de voir leur situation examinée par un juge, sont contraires à l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4786AQC), ce qui aurait normalement dû pousser la Haute juridiction à considérer que les personnes actuellement détenues sur ce fondement l’étaient arbitrairement.
Toutefois, pour éviter la mise en liberté systématique de personnes potentiellement dangereuses, la Cour de cassation a aménagé une porte de sortie, en donnant la possibilité aux juges qui auraient normalement dû se prononcer initialement de rectifier le tir, en examinant rapidement le cas des détenus concernés. En matière délictuelle, le délai laissé au juge pour se prononcer est d’un mois à compter de l’échéance du titre ayant été prolongé de plein droit, ou de trois mois si la procédure était en phase d’appel ; en matière criminelle, il est systématiquement de trois mois [4]. Au-delà de ces délais, les personnes dont la détention a été prolongée de plein droit doivent être remises en liberté immédiatement [5].
Au final, par cette astuce de la Haute juridiction, le nombre de détenus qui bénéficieront d’une remise en liberté sur ce fondement s’en trouve limité. Il est toutefois possible que ce nombre soit relativement important, les personnes détenues sur la base d’une prolongation de plein droit en matière délictuelle depuis plus d’un mois (trois mois en phase d’appel) ou en matière criminelle depuis plus de trois mois devant être libérées sur le champ, à moins qu’un juge ne se soit prononcé entre temps sur la validité du titre de détention [6].
- Instauration d’une clause de revoyure :
Revoyure des prolongations de plein droit de 6 mois à l’instruction. Pour éviter que les prolongations exceptionnelles fondées sur l’article 16, comprises par la circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2008571C du 26 mars 2020 comme n’exigeant pas l’examen d’un juge [7], aient pour conséquence de maintenir des personnes en détention provisoire sans contrôle d’un magistrat du siège pendant 12 ou 18 mois, le législateur a instauré une clause de revoyure lorsque, en cours d’instruction, le titre de détention a fait l’objet d’une prolongation de plein droit de 6 mois [8]. Dans cette hypothèse, le JLD doit examiner la situation en organisant un débat contradictoire, au besoin selon les modalités de l’article 19 de l’ordonnance, et se prononcer sur le maintien ou l’abandon des effets de cette prolongation, sa décision devant intervenir au moins 3 mois avant l’échéance du titre (ordonnance du 25 mars 2020, art. 16-1, al. 5).
Non-revoyure des prolongations de plein droit à l’audiencement. Cette clause de revoyure s’applique seulement lorsque la prolongation de plein droit de 6 mois est intervenue en cours d’instruction, à l’exclusion du cas où elle est intervenue à l’audiencement. D’après la nouvelle circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020, cette différence de régime entre les prolongations à l’instruction de celles à l’audiencement « se justifie par le fait que l’information est terminée, que la personne a été renvoyée devant la juridiction de jugement en raison des charges suffisantes existant à son encontre (voire, s’il s’agit des délais d’audiencement en appel, qu’elle a été condamnée en premier ressort) et que le critère de prolongation de la détention en matière d’audiencement prévu par les articles 179 (N° Lexbase : L8054LAK), 181 (N° Lexbase : L2990IZR), 380-4-1 et 509-1 (N° Lexbase : L7223LP9) du Code de procédure pénale est l’existence de “raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire” du report des audiences pendant la période de confinement et de crise sanitaire) » [9].
Analyse critique de la différence de traitement. Toutefois, s’il est juste d’affirmer que la situation d’une personne détenue dans l’attente de son procès diverge, pour toutes les raisons mentionnées dans la circulaire, de celle d’une personne détenue en cours d’instruction, il n’est pas aisé de comprendre en quoi ces raisons justifient une différence de traitement quant à l’organisation d’une revoyure. Dans les deux situations, la prolongation de plein droit concerne des personnes présumées innocentes qui bénéficient du même droit à voir le bien-fondé de leur titre de détention expressément examinée par un juge dans un délai raisonnable, en vertu de l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) prévoyant que l’autorité judiciaire, « gardienne des libertés individuelles », veille à ce que nul ne soit arbitrairement détenu [10]. En quoi le renvoi de la personne devant une juridiction de jugement change-t-elle quelque chose à cette exigence constitutionnelle ? De même, en quoi « les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire » seraient-elles un critère pouvant échapper à l’examen du juge ? La constitutionnalité de cette dichotomie nous paraît sujette à caution ; le Conseil constitutionnel ne s’étant pas prononcé spécifiquement sur ce point dans sa décision n° 2020-800 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : A32573L9), la question nous semble ouverte.
- Durée maximale totale des détentions provisoires :
Allongement exceptionnel à l’instruction. D’après l’article 16-1, alinéa 4, de l’ordonnance du 25 mars 2020, la prolongation de plein droit décidée en cours d’instruction entre le 26 mars et le 10 mai 2020, sur le fondement de l’article 16 de ladite ordonnance, n’a en principe aucun effet sur la durée maximale totale de la détention provisoire prévue par le droit commun. Par exception, la durée maximale totale de détention résultant des dispositions classiques du Code de procédure pénale se trouve augmentée de 2, 3 ou 6 mois selon les cas, lorsque c’est le dernier titre de détention possible, au regard du droit commun, qui a fait l’objet de la prolongation de plein droit.
Allongement systématique à l’audiencement. En revanche, s’agissant d’une prolongation de plein droit décidée à l’audiencement, l’article 16-1, alinéa 6, de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que la durée maximale totale de la détention provisoire se trouve toujours allongée d’une durée de 2, 3 ou 6 mois correspondant à la durée de la prolongation prononcée. La nouvelle circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020 justifie ce régime plus sévère appliqué aux détentions en cours d’audiencement par l’impossibilité « de rattraper les retards résultant des annulations et renvois d’audiences intervenus pendant la période de confinement, qui ont nécessairement des effets “en cascade” » [11].
Analyse critique de la différence de traitement. L’engorgement des juridictions résultant de l’adaptation de leur fonctionnement à la crise sanitaire a donc justifié, aux yeux du législateur, cette différence de traitement entre les prolongations de plein droit appliquées en cours d’instruction et celles intervenues à l’audiencement. Si cela peut se comprendre en fait comme en droit, on ne peut s’empêcher de réprouver la logique délétère qui, attribuant exclusivement à l’épidémie un engorgement dont l’intensité s’explique aussi par les insuffisances structurelles des juridictions en termes de moyens matériels et humains, fait payer le prix fort aux libertés individuelles. La même logique préside à l’extension programmée du champ d’expérimentation des cours criminelles (sans jury populaire) de 10 à 30 départements [12], comme si le sacrifice des libertés devait entraîner dans son sillage celui de la démocratie.
II - Régime des prolongations décidées entre le 11 mai et le 10 juin
- Réhabilitation du juge :
Exigence d’une décision judiciaire prise après débat contradictoire. Inspiré par la volonté du législateur de mettre fin aux prolongations de plein droit sans intervention d’un juge, l’article 16-1, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit qu’à compter du 11 mai 2020, plus aucune prolongation ne pourra être mise en œuvre sans décision de la juridiction compétente précédée d’un débat contradictoire, au besoin dans les conditions prévues à l’article 19 de l’ordonnance.
Il s’ensuit qu’en cours d’instruction, lorsqu’un titre de détention arrive à échéance le 11 mai 2020 ou plus tard, le juge des libertés et de la détention (JLD) doit systématiquement statuer sur la prolongation après débat, quel que soit le fondement de ce titre (détention de droit commun ou prolongation de plein droit).
De même, à l’audiencement, pour tout titre de détention arrivant à expiration à partir du 11 mai, la juridiction compétente a l’obligation de statuer contradictoirement sur la prolongation d’une détention provisoire, indépendamment du fondement du titre de détention, sauf à entraîner la remise en liberté de la personne détenue.
Si ce retour à la normale - et à la raison… - ne peut que susciter l’approbation, certaines mesures d’exception demeurent applicables aux prolongations portant sur les titres de détention arrivant à échéance entre le 11 mai et le 10 juin 2020. Et une fois de plus, les dispositions exceptionnelles concernant les détentions provisoires à l’audiencement sont davantage attentatoires aux libertés individuelles que celles concernant les détentions provisoires en cours d’instruction, que ce soit au niveau de la durée des prolongations ou de la durée maximale totale de détention.
- Durée des prolongations :
Durée des prolongations décidées à l’instruction. L’article 16-1, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit qu’en principe, s’agissant des détentions provisoires en cours d’instruction, le JLD peut seulement décider d’une prolongation pour une durée prévue par le droit commun.
Toutefois, par exception, ce même texte prévoit que si la durée maximale totale de la détention provisoire, au regard du droit commun, est atteinte entre le 11 mai et le 10 juin 2020, le JLD peut ordonner une prolongation de 2, 3 ou 6 mois sur le fondement de l’article 16 de l’ordonnance. Il faut toutefois signaler que cette exception n’est pas applicable dans le cas où une prolongation de plein droit fondée sur l’article 16 a déjà été appliquée antérieurement, le dernier alinéa de cet article prévoyant que les prolongations exceptionnelles pour de telles durées ne peuvent intervenir qu’une seule fois.
Durée des prolongations décidées à l’audiencement. La situation est différente s’agissant des prolongations décidées à l’audiencement, deux hypothèses devant être distinguées. En principe, il résulte de l’article 16-1, alinéa 3, de l’ordonnance que si un titre de détention de droit commun arrive à échéance entre le 11 mai et le 10 juin 2020, la juridiction compétente peut prolonger la détention de 2, 3 ou 6 mois selon les distinctions établies par l’article 16.
Par exception, si le titre de détention arrivant à échéance entre le 11 mai et le 10 juin 2020 a pour origine une prolongation de plein droit appliquée sur le fondement de l’article 16, la juridiction compétente ne peut prolonger la détention que pour une durée prévue par le droit commun, le dernier alinéa de cet article prohibant la mise en œuvre de plusieurs prolongations exceptionnelles.
- Durée maximale totale des détentions provisoires :
Allongement exceptionnel à l’instruction. Il résulte de l’article 16-1, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 mars 2020 qu’en principe, lorsque le JLD décide de prolonger une détention provisoire arrivant à échéance en cours d’instruction le 11 mai 2020 ou plus tard, la durée maximale totale de la détention provisoire demeure celle prévue par le droit commun.
Cependant, par exception, si la durée maximale totale de la détention provisoire au regard du droit commun est atteinte entre le 11 mai 2020 et le 10 juin 2020, permettant au JLD d’ordonner une prolongation de 2, 3 ou 6 mois sur le fondement de l’article 16 dès lors que le titre arrivant à échéance est fondé sur le droit commun, la durée maximale de la détention au cours de l’instruction est prolongée d’autant.
Allongement systématique à l’audiencement. L’article 16-1, alinéa 6, de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit qu’à l’audiencement, lorsqu’un titre de détention de droit commun arrive à échéance entre le 11 mai et le 10 juin 2020 et que la juridiction compétente décide de prolonger la détention de 2, 3 ou 6 mois sur le fondement de l’article 16, la durée maximale totale de la détention à l’audiencement s’en trouve allongée d’autant.
En revanche, lorsque le titre de détention arrivant à expiration dans cet intervalle est la résultante d’une prolongation de plein droit fondée sur l’article 16, cette prolongation de plein droit a déjà eu pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention provisoire en cours d’audiencement, et il résulte d’une lecture a contrario de l’article 16-1, alinéa 6, que toutes les prolongations décidées ultérieurement ne peuvent avoir pour effet de rééditer un tel allongement.
- Report des débats sur les prolongations :
Faculté de reporter le débat contradictoire d’un mois. Dans tous les cas, que la décision sur la prolongation de la détention intervienne à l’instruction ou à l’audiencement, le législateur a voulu offrir aux juridictions, potentiellement surprises par l’exigence soudaine d’un débat contradictoire devant un juge là où la circulaire n° JUSD2008571C du 26 mars 2020 affirmait qu’il n’en était plus question, le temps de s’organiser. A cet effet, l’article 16-1, alinéa 2, aménageant un dispositif transitoire, prévoit que si un titre de détention résultant des règles du droit commun arrive à échéance entre le 11 mai et le 10 juin 2020, les débats contradictoires peuvent être reportés jusqu’à un mois après la date d’échéance de ce titre (donc, potentiellement, postérieurement au 10 juin) ; la détention provisoire est alors prorogée jusqu’à la décision de la juridiction compétente. Le nouveau texte précise que cette prorogation s’impute, le cas échéant, sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction.
Limites à la faculté de reporter le débat contradictoire d’un mois. Il faut toutefois signaler qu’une lecture a contrario de l’article 16-1, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 mars 2020 permet de déduire que la faculté, pour la juridiction compétente, de reporter d’un mois le débat contradictoire, n’est pas ouverte lorsque le titre de détention arrivant à échéance est fondé sur une prolongation de plein droit appliquée en vertu de l’article 16 de la même ordonnance. Cette restriction est de bon sens, puisque dans un tel cas, la juridiction compétente ne saurait être surprise par l’exigence d’une décision judiciaire précédée d’un débat contradictoire, l’article 16 in fine précisant depuis l’origine que la prolongation de plein droit, comprise comme dispensant le juge d’intervenir, n’est possible qu’une seule fois. La nouvelle circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020 abonde d’ailleurs en ce sens [13].
Délai nécessaire ou délai de confort ? Il paraît utile de revenir brièvement sur le parcours parlementaire ayant abouti au choix d’une durée d’un mois pour ce report des débats contradictoires sur la prolongation de détention provisoire, celui-ci s’avérant particulièrement cocasse. Initialement, le projet de loi voté en commission des lois de l’Assemblée nationale prévoyait un report ne pouvant dépasser quinze jours, ce qui était donc plus favorable aux personnes détenues [14]. Toutefois, au cours des débats dans l’hémicycle, une députée de la majorité a soutenu un certain amendement n° 380, le présentant d’abord comme un amendement de pure forme, ensuite comme une disposition permettant d’éviter que des titres de détention ne soient prolongés au-delà du 10 juin 2020, dans un souci de préservation des libertés [15]. Problème de taille : cet amendement s’avère, en réalité, aux antipodes de cette présentation ; outre le fait qu’il augmente de quinze jours à un mois le délai de report mis à la disposition des juges, il ne s’oppose aucunement à ce que les débats contradictoires soient reportés au-delà du 10 juin 2020, finalement au-delà de ce que le texte prévoyait initialement. Ce décalage entre le discours de la députée et la réelle teneur de l’amendement est proprement stupéfiant, et prend une saveur particulière lorsque l’on sait que la députée en question n’est autre que Laetitia Avia, dont la semaine aura décidément été spécialement mordante [16]… L’amendement n° 380 a été adopté sur ces bases, le seul intervenant aux débats paraissant se rendre compte de la supercherie n’étant autre que la garde des Sceaux, qui a tenu à remercier la députée pour l’allongement à un mois de ce délai de report, lui précisant que « les grandes juridictions, notamment celle de Paris », lui en étaient « particulièrement reconnaissantes » [17]. Lorsque l’on sait que pour une personne privée de liberté, chaque jour compte, apprendre qu’une extension de quinze jours du délai de détention a été décidée sur la foi d’une présentation tronquée, dans le but d’octroyer un délai suffisamment confortable aux « grandes juridictions », cela ne laisse pas d’interroger sur le sérieux du travail parlementaire, notamment en situation d'urgence. D’un point de vue purement juridique, la réelle nécessité d’une telle extension de privation de liberté pourrait également être discutée, sauf à admettre qu’en période de crise, c’est la faculté d’organisation des grandes juridictions qui donne le tempo des libertés.
III - Régime des prolongations décidées après le 11 juin
- Détentions provisoires à l’instruction :
Rétablissement du droit commun à l’instruction. Il découle de l’article 16-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 que la date du 11 juin 2020 correspondra à une sorte de retour à la normale, du moins s’agissant des prolongations de détention décidées en cours d’instruction. En effet, la lecture a contrario de l’article 16-1, alinéa 2, révèle que tous les titres de détention arrivant à échéance à compter de cette date se verront appliquer les dispositions classiques du Code de procédure pénale, puisque seule une prolongation d’une durée prévue par le droit commun pourra être prononcée par le JLD après débat contradictoire, sans que le juge n’ait la possibilité de reporter le débat. En outre, dans cette hypothèse, seule la durée maximale de la détention prévue par le droit commun devra être prise en compte par le JLD, même si une prolongation de plein droit a été appliquée antérieurement, comme cela se déduit de l’article 16-1, alinéa 4.
Rétablissement du droit commun à l’audiencement. En revanche, pour ce qui concerne les prolongations de détention à l’audiencement, le rétablissement du droit commun sera plus progressif. Certes, lorsqu’un titre de détention à l’audiencement arrivera à échéance à compter du 11 juin 2020, la juridiction compétente en matière de prolongation n’aura plus la possibilité de reporter le débat contradictoire. Néanmoins, en vertu de l’article 16-1, alinéa 3, elle pourra toujours prolonger la détention de 2, 3 ou 6 mois selon les distinctions établies par l’article 16, la durée maximale totale de la détention à l’audiencement s’en trouvant allongée d’autant, en application de l’article 16-1, alinéa 6.
Sous réserve que la date d’expiration de l’état d’urgence sanitaire ne soit pas modifiée prochainement, ce n’est qu’à partir du 11 août 2020 que la juridiction compétente pourra seulement décider d’une prolongation pour une durée prévue par le droit commun : en effet, l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que les dispositions de cette ordonnance (notamment celles des articles 16 et 16-1, alinéa 3) sont applicables jusqu’à un mois après la date d’expiration de l’état d’urgence sanitaire fixée au 11 juillet 2020 par le I de l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. En cas de prolongation intervenant à partir du 11 août 2020, la durée maximale totale de la détention prévue par le droit commun restera inchangée, sauf si une prolongation de plein droit ou fondée sur le troisième alinéa de l’article 16 est intervenue auparavant (art. 16-1, al. 6).
Il faut toutefois noter que la nouvelle circulaire de la garde des Sceaux du n° JUSD2011710C du 13 mai 2020 retient une interprétation différente de celle que nous venons d’exposer sur ce dernier point, en indiquant que les prolongations exceptionnelles de détention à l’audiencement de 2, 3 ou 6 mois deviendront impossibles à compter du 11 juillet 2020, dans la mesure où « l’article 16 de l’ordonnance ne sera plus applicable » après la cessation de l’état d’urgence le 10 juillet 2020 [18]. Cette interprétation nous semble toutefois contraire à l’article 2 de l’ordonnance susmentionné …
Conclusion. Il résulte de tout ce qui précède, et qui se trouve résumé dans les deux tableaux ci-dessous, que le nouveau régime des détentions provisoires, quoique plus respectueux des libertés individuelles, du principe du contradictoire et de l’office du juge que celui découlant de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 dans sa version d’origine, s’avère particulièrement complexe, renvoyant à de nombreuses durées et à une profusion de dates dont le choix semble parfois éminemment contestable. Devant ces multiples découpages, le sentiment d’arbitraire se dissipe sans s’effacer complètement, renvoyant à cette idée simple et lumineuse de Gilles Deleuze : « tout ce qui est clos est artificiellement clos » [19].
Tableau n° 1 : effets de l’article 16-1 sur les titres de détention à l’instruction
| Date d'échéance du titre | Effets de l'article 16-1 sur la prolongation de la détention | Effets de l'article 16-1 sur la durée maximale de la détention |
| Entre le 26 mars et le 10 mai | • La prolongation de plein droit reste valide (art. 16, al. 1). Toutefois, sauf contrôle d’un juge intervenu entre temps, la juridiction qui aurait dû se prononcer dispose d’un délai d’un mois pour contrôler la validité de la détention en matière correctionnelle, et de 3 mois en matière criminelle (Cass. crim., 26 mai 2020). • Clause de revoyure : si la prolongation de plein droit décidée est de 6 mois, le JLD doit examiner la situation et décider ou non de maintenir les effets de la prolongation. Cet examen doit intervenir au moins 3 mois avant l’échéance du titre (art. 16-1, al. 5). | • En principe, la durée maximale totale de la détention prévue par le droit commun reste inchangée.
• Par exception, si la prolongation de plein droit de 2, 3 ou 6 mois s’est appliquée à l’issue de la dernière échéance de droit commun, la durée maximale totale de la détention augmente d’autant (art. 16-1, al. 4) |
| Entre le 11 mai et le 10 juin | • En principe, seule une prolongation d’une durée prévue par le droit commun peut être prononcée, après débat contradictoire devant le JLD. Par exception, si la durée maximale de la détention prévue par le droit commun est atteinte durant cette période, le JLD peut ordonner une prolongation de 2, 3 ou 6 mois selon les cas (art. 16-1, al. 1 et 2). • En principe, le débat contradictoire peut être reporté jusqu’à un mois après la date d’échéance du titre. Par exception, ce report d’un mois est impossible si le titre de détention est fondé sur une prolongation de plein droit (art. 16-1, al. 2). | • En principe, la durée maximale totale de la détention prévue par le droit commun reste inchangée.
• Par exception, si la durée maximale de la détention prévue par le droit commun est atteinte durant cette période et que le JLD ordonne une prolongation de 2, 3 ou 6 mois selon le cas, la durée maximale totale de détention est augmentée d’autant (art. 16-1, al. 2). |
| A partir du 11 juin | • Seule une prolongation d’une durée prévue par le droit commun peut être prononcée, après débat contradictoire devant le JLD (art. 16-1, al. 2).
• Le report d’un mois du débat contradictoire devant le JLD est impossible (art. 16-1, al. 2).
| • La durée maximale totale de la détention prévue par le droit commun reste inchangée, même si une prolongation de plein droit est intervenue auparavant (art. 16-1, al. 4). |
Tableau n° 2 : effets de l’article 16-1 sur les titres de détention à l’audiencement
| Date d'échéance du titre | Effets de l'article 16-1 sur la prolongation de la détention | Effets de l'article 16-1 sur la durée maximale de la détention |
| Entre le 26 mars et le 10 mai | • La prolongation de plein droit reste valide (art. 16, al. 1). Toutefois, sauf contrôle d’un juge intervenu entre temps la juridiction qui aurait dû se prononcer dispose d’un délai d’un mois – ou trois mois en appel – pour contrôler la validité de la détention en matière correctionnelle, et de 3 mois en matière criminelle (Cass. crim. 26 mai 2020).
• Pas de clause de revoyure (art. 16-1, al. 5).
| • Selon que la prolongation de plein droit est de 2, 3 ou 6 mois, la durée maximale totale de la détention augmente d’autant (art. 16-1, al. 6). |
| Entre le 11 mai et le 10 juin | • La juridiction compétente peut ordonner une prolongation de 2, 3 ou 6 mois selon les cas (art. 16-1, al. 3). • En principe, le débat contradictoire devant la juridiction compétente peut être reporté jusqu’à un mois après la date d’échéance du titre.
• Par exception, ce report d’un mois est impossible si le titre de détention est fondé sur une prolongation de plein droit (art. 16-1, al. 2). | • Selon que la prolongation exceptionnelle est de 2, 3 ou 6 mois, la durée maximale totale de la détention augmente d’autant (art. 16-1, al. 6). |
| Entre le 11 juin et le 10 août | • La juridiction compétente peut ordonner une prolongation de 2, 3 ou 6 mois selon les cas (art. 16-1, al. 3).
• Le report d’un mois du débat contradictoire est impossible (art. 16-1, al. 2). | • Selon que la prolongation exceptionnelle est de 2, 3 ou 6 mois, la durée maximale totale de la détention augmente d’autant (art. 16-1, al. 6). |
| A partir du 11 août | • Seule une prolongation d’une durée prévue par le droit commun peut être prononcée, après débat contradictoire devant la juridiction compétente (expiration de l’état d’urgence sanitaire). | • La durée maximale totale de la détention prévue par le droit commun reste inchangée, sauf si une prolongation de plein droit ou fondée sur le troisième alinéa de l’article 16 est intervenue auparavant (art. 16-1, al. 6). |
[1] V. notamment sur cette question : F. Nguyen, Le débat contradictoire de prolongation de détention devant le JLD et l’état d’urgence sanitaire, Lexbase Pénal, avril 2020 (N° Lexbase : N3055BYS) ; J.-B., Perrier, La prorogation de la détention provisoire, de plein droit et hors du droit, Dalloz actualité, 9 avril 2020.
[2] Circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020, p. 3.
[3] Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910 (N° Lexbase : A13833M8) et n° 20-81.971 (N° Lexbase : A13843M9).
[4] Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.971, §§ 42 et 43 ; Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910, § 37 et 38.
[5] Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.971, § 47 ; Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910, § 42.
[6] Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.971, §§ 44, 45 et 47 ; Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910, § 39, 40 et 42.
[7] Circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2008571C du 26 mars 2020, pp. 8 et 9 : « Ces prolongations s’appliquent de plein droit, donc sans qu’il soit nécessaire de prendre une décision de prolongation, aux détentions provisoires en cours de la date de publication de l’ordonnance à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ou ayant débuté pendant cette période. Elles ont ainsi pour conséquence que, pendant une durée, selon les cas rappelés plus haut, de deux mois, trois mois ou six mois, il n’est pas nécessaire que des prolongations soient ordonnées par la juridiction compétente pour prolonger la détention en cours en application des règles de droit commun ».
[8] Circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mars 2020, p. 8 : « ces dispositions sont justifiées par l’importance de la durée de la prolongation de plein droit, qui pouvait conduire à ce qu’une personne ne voit pas le bien-fondé de sa détention expressément examinée par le juge pendant une durée de dix-huit mois ou d’un an ».
[9] Ibid., p. 10.
[10] V. sur cette question : T. Bidnic, Des milliers de personnes se voient infliger une détention arbitraire par ceux dont le rôle est de les en préserver, Le Monde, 4 mai 2020 lien URL ?.
[11] Circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020, p. 9.
[12] P. Januel, Une loi gloubi-boulga qui concerne la justice, Dalloz actualité, 13 mai 2020 ; M. Lartigue, L’Assemblée nationale avalise le projet d’extension de l’expérimentation sur les cours criminelles, Gaz. Pal., 19 mai 2020, n° 379e7, p. 5.
[13] Circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020, p. 5 : « Si la détention provisoire a fait l’objet d’une prolongation de plein droit avant le 11 mai, à l’instruction comme à l’audiencement, les dispositions transitoires de l’article 16-1 ne sont pas applicables, et la décision de prolongation devra, comme prévu, intervenir avant la date d’échéance découlant de la prolongation de plein droit. Dans de tels cas en effet, l’échéance du titre de détention n’a pas été modifié par les nouvelles dispositions de l’article 16-1, cette échéance était déjà connue des juridictions, et il n’y avait dès lors pas lieu de prévoir un dispositif transitoire ».
[14] Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, texte adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale, 7 mai 2020, n° 2905 [en ligne], article 1er, III : « Si l’échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du Code de procédure pénale, intervient dans un délai d’un mois à compter de cette date, la juridiction compétente dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu’il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu’à cette décision ».
[15] Assemblée nationale, compte-rendu intégral, deuxième séance du jeudi 7 mai 2020 [en ligne], prise de parole de Mme Laetitia Avia, p. 3090 : « L’amendement no 380 vise à donner une plus grande lisibilité au dispositif en précisant que cette période arrive à échéance le 11 juin et en supprimant toute référence au report de quinze jours. Il s’agit de permettre au JLD de reprendre ses audiences le plus rapidement possible dès lors que les juridictions se sont réorganisées, sans attendre ce délai de quinze jours, faute de quoi une détention provisoire qui aurait dû arriver à échéance le 10 juin, par exemple, pourrait se prolonger jusqu’au 25 juin. Ce n’est pas le but, d’où cette date butoir du 11 juin ».
[16] D. Perrotin, Laetitia Avia, la députée LREM qui horrifie ces assistants, Mediapart, 12 mai 2020 [en ligne].
[17] Assemblée nationale, compte-rendu intégral, deuxième séance du jeudi 7 mai 2020, prise de parole de Mme Nicole Belloubet, p. 3091.
[18] Circulaire de la garde des Sceaux du n° JUSD2011710C du 13 mai 2020, p. 9.
[19] Gilles Deleuze, L’image-mouvement, Les Editions de Minuit, Coll. « Critique », 1983, p. 21.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473402
[Brèves] Accident de la circulation : preuve de l’imputabilité du dommage à l’accident lorsque le premier n’apparaît pas comme une suite naturelle du second
Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-24.095, FS-P+B+I (N° Lexbase : A06753MX)
Lecture: 4 min
N3426BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Manon Rouanne
Le 27 Mai 2020
► Doit être intégralement réparé, le dommage corporel subi par la victime d’un accident de la circulation consistant dans les conséquences de la maladie de Parkinson exclusivement révélée du fait de cet accident, qui ne peut être, alors, réduit en raison d’une prédisposition pathologique.
Telle la preuve de l’imputabilité du dommage à l’accident caractérisée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 20 mai 2020 (Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-24.095, FS-P+B+I N° Lexbase : A06753MX ; sur l’obligation de la victime d’établir que le préjudice qu’elle allègue résulte de l’accident qu’elle a subi lorsque celui-ci n’apparaît pas comme une suite naturelle de cet accident et se révèle postérieurement à sa réalisation, v. notamment : Cass. civ. 2, 8 février 2001, n° 98-22.048 N° Lexbase : A3783ARK ; Cass. civ. 2, 4 juillet 2002, n° 01-02.408 N° Lexbase : A0580AZI).
En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, la victime, se plaignant d’avoir, à la suite de la collision, ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits, a été diagnostiquée comme ayant subi un traumatisme cervical bénin. Cependant, deux jours après la survenance de l’accident, la victime invoquant des tremblements de la main droite associés à des céphalées, a fait l’objet d’examens médicaux complémentaires ayant mis en évidence un syndrome parkinsonien. Pour obtenir réparation de l’ensemble de ces préjudices, la victime a, alors, engagé une action en responsabilité à l’encontre du conducteur impliqué et de son assureur.
Afin d’obtenir l’indemnisation intégrale des préjudices subis sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, la notion d’implication du véhicule dans l’accident est établie et ne pose, ainsi, aucune difficulté dans cette affaire. En revanche, il en est autrement de la preuve de l’imputabilité du dommage à l’accident pesant sur la victime, dans la mesure où il n’est pas évident que la maladie de Parkinson dont souffre celle-ci et révélée deux jours après l’accident résulte de ce dernier.
La cour d’appel ayant condamné le conducteur de véhicule impliqué dans l’accident et son assureur à indemniser intégralement la victime de l’ensemble des préjudices subis, y compris ceux résultant de la maladie de Parkinson, le conducteur déclaré responsable ainsi que son assureur ont contesté, devant la Cour de cassation, leur condamnation à réparer les conséquences de la maladie de Parkinson en alléguant, comme moyen au pourvoi, qu’il n’était pas démontré, en l’espèce, que le dommage consistant dans les conséquences de cette maladie était en lien de causalité avec l’accident, dans la mesure où il se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur.
Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel et condamne, dès lors, le conducteur et son assureur à réparer l’intégralité des préjudices subis par la victime.
En effet, en retenant, à l’instar des juges du fond, qu’aucun symptôme de cette maladie n’avait été détecté sur la victime avant la survenance de l’accident et qu’il n'était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, la Haute juridiction affirme que cette affection n’a été révélée que par le fait dommageable et est, dès lors, imputable à celui-ci, de sorte que la réparation de la victime, ne pouvant être réduite en raison d'une prédisposition pathologique lorsque la maladie qui en est résultée n'a été révélée que du fait de l'accident, doit, alors, être intégrale.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473426
[Brèves] Fixation des tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
Réf. : Décret n° 2020-577 du 15 mai 2020 (N° Lexbase : L9922LWE) ; arrêté du 15 mai 2020, n° NOR : TREA1936908A (N° Lexbase : L9957LWP)
Lecture: 3 min
N3366BYC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Mai 2020
Un décret n° 2020-577 du 15 mai 2020 (N° Lexbase : L9922LWE), publié au Journal officiel du 17 mai 2020, abroge le décret n° 2019-687 du 1er juillet 2019 (N° Lexbase : L9922LWE) qui fixait le montant des tarifs de la taxe sur les nuisances aériennes prévue à l'article 1609 quatervicies A du Code général des impôts (N° Lexbase : L7804LUL). Cette abrogation tire les conséquences de la rédaction des dispositions de l'article 1609 quatervicies A précité, issues de l'article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L6297LNK), rétablissant la compétence des ministres chargés du Budget, de l'Aviation civile et de l'Environnement pour fixer ces tarifs par arrêté.
Un arrêté du 15 mai 2020, n° NOR : TREA1936908A, publié au Journal officiel du 15 mai 2020 (N° Lexbase : L9957LWP), fixe pour sa part, le montant du tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable aux opérations taxables effectuées sur les aérodromes relevant de ce dispositif de financement des nuisances sonores aéroportuaires. A noter que le texte prend en compte également l'entrée de l'aérodrome de Lille-Lesquin dans ce dispositif.
Les deux textes sont entrés en vigueur le 18 mai 2020.
|
L’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, de finances rectificative pour 2003 N° Lexbase : L6330DME) a institué à compter du 1er janvier 2005, une taxe sur les nuisances sonores aériennes. Cette taxe est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels :
Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage d’aéronefs de masse maximale au décollage de deux tonnes ou plus sur les aérodromes concernés. Le produit de la taxe est affecté à l’aérodrome où se situe son fait générateur au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 (N° Lexbase : L9291G8M) à L. 571-16 (N° Lexbase : L9293G8P) du Code de l’environnement, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts contractés pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores, et au remboursement des avances consenties pour le financement des travaux de réduction des nuisances sonores. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473366
