[Brèves] Dépendance économique vis-à-vis de son client : l’avocat peut se prévaloir de la nullité de l'accord d'honoraires !
Réf. : Cass. civ. 2, 9 décembre 2021, n° 20-10.096, F-P+B (N° Lexbase : A48147EZ)
Lecture: 4 min
N9748BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 15 Décembre 2021
► L'avocat doit en toutes circonstances être guidé dans l'exercice de sa profession par le respect des principes de « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » et s'il doit, en particulier, veiller à préserver son indépendance, ces règles ne sauraient priver l'avocat, qui se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son client, du droit, dont dispose tout contractant, d'invoquer un consentement vicié par la violence, et de se prévaloir ainsi de la nullité de l'accord d'honoraires conclu avec ce client.
Faits et procédure. Une délégation Unedic AGS (l'AGS) avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans une série de dossiers concernant les salariés d'une même association, l'ARAST. Alors que l'avocat avait suivi l'ensemble de ceux-ci en première instance, l'AGS l'a chargé de suivre la procédure en appel pour sept cent quatre-vingt-quinze dossiers et en a confié cent quarante à un autre avocat. Ayant été dessaisi en cours d'instance, l'avocat a demandé au Bâtonnier de son Ordre de fixer ses honoraires en faisant valoir qu'il avait droit à un complément d'honoraires pour la première instance, à des honoraires pour la procédure d'appel et à une rémunération de son intervention lors de la procédure collective de l'ARAST. Devant la Cour de cassation, l'AGS fait grief à l'ordonnance de fixer à 252 350 euros TTC la somme qu'elle reste à devoir à l'avocat, alors « que si la violence économique exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, permet de caractériser ce vice ; que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice, et que, dès lors, l'avocat exerce ses fonctions avec indépendance, dans le respect des termes de son serment ; que ces principes guident l'avocat en toutes circonstances, en sorte qu'il ne saurait se placer en situation de dépendance économique vis-à-vis de l'un de ses clients.
Réponse de la Cour. Selon l'article 1111 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1199ABZ) applicable à la cause, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité. Selon l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante et, selon son article 3, l'avocat prête serment d'exercer ses fonctions « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». S'il résulte de ces deux derniers textes que l'avocat doit en toutes circonstances être guidé dans l'exercice de sa profession par le respect de ces principes et s'il doit, en particulier, veiller à préserver son indépendance, ces dispositions ne sauraient priver l'avocat, qui se trouve dans une situation de dépendance économique vis à vis de son client, du droit, dont dispose tout contractant, d'invoquer un consentement vicié par la violence, et de se prévaloir ainsi de la nullité de l'accord d'honoraires conclu avec ce client. C'est donc sans encourir le grief du moyen que l'arrêt, ayant caractérisé l'état de dépendance économique dans lequel l'avocat se trouvait à l'égard de l'AGS, ainsi que l'avantage excessif que cette dernière en avait tiré, en déduit que cette situation de contrainte était constitutive d'un vice du consentement au sens de l'article 1111 ancien du Code civil, excluant la réalité d'un accord d'honoraires librement consenti entre les parties, et fixe les honoraires dus à l'avocat en application des critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Rejet. Pour la Cour de cassation, le moyen n'est, par conséquent, pas fondé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479748
[Brèves] Point de départ de l’action paulienne : la publication de l’acte frauduleux fait courir le délai de prescription
Réf. : Cass. civ. 3, 8 décembre 2021, n° 20-18.432, FS-B (N° Lexbase : A46157EN)
Lecture: 3 min
N9817BYA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 15 Décembre 2021
► En présence d’un acte frauduleux publié au service de la publicité foncière, cette publication fait courir le délai de prescription de l’action en inopposabilité exercée sur le fondement de l’action paulienne.
Faits et procédure. Hier (C. civ. anc. art. 1167 N° Lexbase : L1269ABM), comme aujourd’hui (C. civ. art. 1341-2 N° Lexbase : L0672KZW), le législateur ne dit mot de la prescription de l’action paulienne. Aussi est-il revenu à la jurisprudence de préciser la nature de l’action ou encore le point de départ de la prescription. Si l’arrêt rendu le 8 décembre 2021 procède à certains rappels, il apporte également une précision.
En l’espèce, après s’être portée caution mais avant d’être appelée en paiement, une personne avait consenti à ses enfants une donation-partage de la nue-propriété d’un immeuble d’habitation lui appartenant. Quelques années plus tard, et après la mise en liquidation judiciaire du débiteur, le créancier assigna la caution en inopposabilité de la donation-partage, action que la cour d’appel considéra comme étant prescrite (CA Caen, 2 avril 2020, n° 18/02906 N° Lexbase : A66923K3).
Quel est le point de départ de la prescription ? Là résidait tout l’enjeu du débat : est-ce le jour de la publicité de l’acte au service de la publicité foncière ou le jour de la connaissance effective du créancier de l’existence de l’acte ?
Solution. L’arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Il procède à des rappels de solutions désormais acquises. D’une part, l’action paulienne est de nature personnelle et est donc soumise à l’application de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). En conséquence, la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître l’existence des faits lui permettant de l’exercer. D’autre part et quant au point de départ de la prescription, l’arrêt rappelle une solution initiée il y a peu (Cass. civ. 3, 12 novembre 2020, n° 19-17.156, FS-P+B+I N° Lexbase : A524534Z) : « lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action […], le point de départ […] est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte en fraude de ses droits ». Mais ce report est-il concevable lorsque l’acte est soumis à publicité et que la publication est intervenue ? À cet égard, la Cour de cassation apporte une précision : « l’acte de donation-partage ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité foncière […], [le créancier] était réputé avoir connaissance de son existence dès cette date ». Ainsi, en présence d’un acte soumis à publicité et de régularité de la publication, il ne saurait y avoir report du point de départ de la prescription.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479817
[Brèves] Précisions sur l’amendement Charasse en cas de contrôle conjoint de la société
Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 6 décembre 2021, n° 439650, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30017EU)
Lecture: 4 min
N9758BY3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 04 Janvier 2022
► L'administration est fondée à réintégrer dans les résultats de la société mère d'un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu'une société est acquise en vue d'être intégrée par une société du groupe auprès d'une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire ;
► Ces dispositions sont applicables, compte tenu de ce que l'existence d'un tel contrôle s'apprécie par référence aux critères définis par l'article L. 233-3 du Code de commerce, non seulement dans l'hypothèse d'une identité entre le ou les actionnaires de la société cédée et le ou les actionnaires exerçant le contrôle de la société cessionnaire mais également dans le cas où l'actionnaire qui contrôlait la société cédée exerce, de concert avec d'autres actionnaires, le contrôle de la société cessionnaire ;
► Il appartient à l'administration d'établir l'existence d'une action de concert puis de vérifier si tout ou partie des personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Les faits :
- l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables des exercices clos de 2009 à 2013 d’une société une partie des frais financiers supportés par les sociétés membres de son groupe fiscal intégré ;
- le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance se pourvoit en cassation contre l'article 1er de l'arrêt du 30 janvier 2020 par lequel la CAA de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 25 octobre 2017 du tribunal administratif de Rennes qui avait prononcé la décharge de ces impositions ;
- par un pourvoi incident, la société demande l'annulation de l'article 2 de l'arrêt du 30 janvier 2020 qui rejette son appel contre le jugement du 25 octobre 2017 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à bénéficier, au titre de l'exercice clos en 2012, du dispositif de report en arrière du déficit.
🔎 Principes :
- lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5817KTM), les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe ;
- le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non-membre de ce groupe ;
- la réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants (CGI, art. 223 B N° Lexbase : L5473LQR).
⚖️ Précisions du CE :
- le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si tout ou partie des personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ;
- le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si des actionnaires de la société cédée exercent un contrôle conjoint sur la société cessionnaire.
|
💡 Le CE a apporté des précisions sur la notion de contrôle et plus précisément sur celle d’action de concert au sens de l’amendement « Charasse » (CE, 3° et 8° ch.-r., 15 mars 2019, n° 412155, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2730XC4). Le CE a ainsi jugé que les trois éléments permettant de caractériser une action de concert, en application des dispositions de l’article L. 233-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L2305INP) sont :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479758
[Jurisprudence] Le constat, le silence et l’huissier
Réf. : CA Paris, 5, 1, 23 novembre 2021, n° 21/02336 (N° Lexbase : A71997CM)
Lecture: 19 min
N9787BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sylvian Dorol - Huissier de justice associé (Vénézia & Associés) - Intervenant à l’ENM - EFB et Xavier Louise-Alexandrine - Huissier de justice associé (Calippe & Associés)
Le 13 Décembre 2022
Mots clés : huissier • constat • internet • force probante • nullité • saisie-contrefaçon
Le contentieux des constats internet dressés par les huissiers de justice évolue. Il se fixait par le passé sur les prérequis et la question du caractère obligatoire de la norme Afnor NF Z67-147 de Septembre 2010, mais se concentre aujourd’hui sur la loyauté de la preuve obtenue. Les débats ne sont donc plus techniques, mais uniquement juridiques, et les décisions rendues en la matière, en plus de contribuer à la reconnaissance du droit des constats, renforcent dans leur ensemble la force probante des constats dressés par les huissiers de justice par la création de sanctions sui generis.

Une gifle.
De celles qui réveillent plus qu’elles ne corrigent.
De celles qui blessent plus l’orgueil que l’épiderme.
De celles dont on se souvient.
Ainsi pourrait être évoqué l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 novembre dernier, aussi important que passé inaperçu. Les faits de l’espèce sont simples, mais ne seront exposés que ceux ayant attiré l’attention de l’huissier de justice puisque relatifs au constat.
Dans le cadre d’un contentieux de propriété intellectuelle, une des parties sollicite d’un huissier de justice la réalisation d’un procès-verbal de constat sur internet. L’objet de la mission est non seulement de prouver l’exploitation du site internet litigieux mais, surtout, d’établir le fait qu’il propose la réalisation d’un test de personnalité informatisé sous la forme d’une base de données, matérialisé par un questionnaire. Rien de bien méchant donc, jusqu’à ce qu’apparaisse la problématique : si l’accès au site internet est libre, il n’en est pas de même concernant le questionnaire, auquel l’internaute ne peut accéder qu’après s’être identifié et inscrit.
Puisque l'inscription sur le site ne requiert qu'une adresse électronique et un mot de passe et n'est conditionnée à aucune autorisation, ni à aucun contrôle par un webmaster, l’huissier de justice n’en fait pas un problème et crée son compte utilisateur personnel.
S’ensuit une procédure de saisie-contrefaçon, puis un procès au cours duquel le procès-verbal de constat dressé sur internet par l’huissier de justice est soumis au feu des critiques.
Ces critiques ne portent nullement sur le mode opératoire réalisé par l’huissier de justice, prérequis que d’ailleurs les juges « considèrent à raison que c’est faire preuve d’une légèreté coupable de les ignorer encore aujourd’hui », mais sur le comportement de l’officier. En effet, ce dernier, en ouvrant un compte et en remplissant le questionnaire auquel il peut ainsi accéder, a-t-il eu un comportement actif ? N’a-t-il pas dépassé les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice (N° Lexbase : L8061AIE), qui prévoit que ces derniers peuvent effectuer des constatations, purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ? Allant plus loin, ce comportement, qui n’est en réalité qu’une succession de « clics », est-il susceptible d’être qualifié de « déloyal » ? Dans cette dernière hypothèse, quel sort réserver au procès-verbal de constat ?
La cour d’appel de Paris répond à ces interrogations très clairement en jugeant que l’huissier de justice, au cours d’un procès-verbal de constat réalisé sur internet, ne peut ouvrir un compte utilisateur sans adopter ainsi un comportement actif. Plus encore, elle juge que la création dudit compte sans mentionner sa qualité d’huissier de justice est déloyal, de sorte que le procès-verbal de constat ainsi dressé doit être partiellement écarté des débats.
Afin d’analyser, comprendre et apprécier la portée de cette décision, il convient d’exposer dans la fine logique juridique ayant abouti à la sanction du procès-verbal de constat puis exposer la relative insécurité juridique de l’huissier au lendemain de cet arrêt et son remède. À bien y réfléchir, les juges parisiens n’ont en rien innové dans cette décision, laquelle demeure remarquable par la précision de sa motivation pour justifier la sanction du procès-verbal de constat (I), tout en la mesurant afin de limiter sa portée au strict minimum (II).
I. Une sanction justifiée
Pour le professionnel de terrain qu’est l’huissier de justice, l’arrêt commenté peut sembler ubuesque : en l’espèce, l’officier public et ministériel n’a fait que cliquer et enfoncer les touches de son ordinateur, seul devant son écran et sans penser à mal. À aucun moment il n’a envisagé de stratagème pour surprendre la preuve à laquelle n’importe quel quidam pouvait d’ailleurs accéder.
C’est vrai. Mais il ne faut pas oublier que l’huissier de justice n’est pas n’importe quel quidam et c’est en se faisant passer pour tel qu’il faute. Et la solution retenue par la Cour parisienne est fondée en droit comme il va l’être exposé dans les développements suivants.
A. Le comportement actif
Sans prendre la peine de répondre à l’inutile question du domicile virtuel privé [1], la cour d’appel de Paris juge que l’ouverture d’un compte pour accéder à une page internet constitue un comportement actif dépassant la mission de constatations de l’huissier. Le problème est qu’aucun texte, ni aucune décision de justice, ne définit ce qu’est « une démarche active », ni même ce qu’est « une constatation matérielle ». La doctrine a proposé de définir la constatation comme « toute situation personnellement constatée par l’huissier de justice au moyen de ses sens, et qu’il n’a pas provoquée par une opération intellectuelle de nature à troubler sa qualité de tiers neutre, indépendant et impartial » [2].
S’agissant de la démarche active, il serait possible de penser que cette expression désigne la situation où l’huissier de justice fait preuve d’initiative en effectuant un cheminement intellectuel exprès en vue d’obtenir le fait souhaité. Dès lors, un « clic » de souris peut-il constituer une démarche active ? Sur ce point, la cour d’appel de Paris a déjà jugé que non : « S'il est également soutenu que l'huissier de justice a formulé des commentaires, le simple fait d'avoir indiqué qu'il a capturé une page et constaté une absence de mention de collecte de cookies en mentionnant les clicks par lui effectués relève d'opérations matérielles de navigation dûment précisées, permettant un constat sur internet, et ne peut entacher la validité de son procès-verbal. »[3].
Ainsi, ce n’est pas en cliquant que l’huissier de justice a un rôle actif mais en ouvrant un compte, acceptant nécessairement les conditions générales d’utilisation du site internet et exprimant par là même un consentement juridique. C’est cet acquiescement qui constitue une démarche active. C’est ainsi que la Cour de cassation avait abouti à une décision similaire le 20 mars 2014 [4], qualifiant de « démarche active » l’ouverture par un huissier d’un compte client pour procéder à un achat.
Pourtant, et comme le rappelle la partie bénéficiaire du procès-verbal de constat, la Cour d’appel de Paris avait refusé d’étendre la solution de la Cour de cassation aux cas autres que ceux des constats d’achats. En 2018, les juges parisiens tendaient à admettre la création d’un compte client par l’huissier de justice voire même l’utilisation d’un compte déjà existant sans que cela ne soit constitutif d’une violation du principe de loyauté [5]. Il est néanmoins précisé dans cette décision que la solution s’applique aux sites web pour lesquels aucun contrôle n’est effectué par un webmaster au moment de l’identification et de la création du compte. La cour d’appel de Paris précise en ce sens que la jurisprudence antérieure particulièrement hostile à l’utilisation d’un compte client par l’huissier de justice concerne les « achats de marchandises sur des sites filtrés par des « Webmasters », qui opèrent un contrôle préalable des inscriptions ».
À la lecture de la décision commentée, ces considérations ne valent plus et il ne faut retenir qu’une chose : ouvrir un compte ou s’identifier personnellement pour accéder à une page internet est à proscrire pour l’huissier constatant.
B. Le comportement déloyal
Le motif de déloyauté ressort difficilement de la lecture de la décision commentée et mérite donc un éclaircissement pour le comprendre.
Pour ce faire, il convient de rappeler en détail les faits. En l’espèce, l’huissier de justice a adopté un comportement actif en créant un compte. Cela est acquis. Mais, pour ouvrir le compte, il a eu recours à sa véritable identité civile (nom, prénom, adresse électronique personnelle), et non à son identité professionnelle (nom, prénom, qualité…). En procédant de la sorte, en taisant sa qualité, l’officier public et ministériel n’a pas instrumenté en tant qu’huissier, mais sous le masque de son identité civile, comme un simple quidam. Transposé à la réalité, ce serait comme si un huissier de justice entrait dans un lieu privé en se présentant certes, mais en occultant sa qualité.
Mais, comment arguer de sa qualité d’huissier de justice au cours d’un constat internet, sachant que l’article 41 du Règlement déontologique national des huissiers impose « de justifier au préalable de sa qualité et de préciser l’objet de sa mission » lors de l’établissement d’un constat ? Plus encore, aux termes de l’article 17 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (N° Lexbase : L6897A49) et de l’article 3 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice (N° Lexbase : L9442L9L) qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022, la justification de la qualité d’huissier de justice s’effectue par la présentation d’une carte professionnelle. Or, cette présentation est numériquement impossible : il n’existe pas de « carte professionnelle numérique » pour le « monde virtuel »…
La cour d’appel de Paris ouvre cependant une piste de réflexion dans sa décision en écrivant dans sa motivation « il y a lieu en conséquence de relever qu'en effectuant le test proposé, s'engageant dans une démarche active, (…) en ne déclinant pas sa qualité d'officier ministériel, à tout le moins en utilisant une adresse internet faisant apparaître sa qualité, l' huissier de justice ne s'est pas borné à des constatations purement matérielles, et n'a pas recueilli loyalement les informations en cause (…) ». À la lire, il serait possible de penser que l’huissier de justice pourrait décliner sa qualité en usant simplement de son adresse électronique professionnelle (@huissier-justice.fr par exemple).
Cela est tentant. Si cette solution ne souscrit pas pleinement aux obligations des textes précédemment évoqués, elle représente une réelle alternative pour l’huissier torturé à la lecture de la décision commentée, déchiré entre la tentation de recourir à son adresse mail professionnelle et l’envie de recourir à un tiers selon la méthode du constat d’achat. Cependant, la solution de l’utilisation de l’adresse électronique professionnelle (@huissier-justice.fr par exemple) est insatisfaisante à la réflexion. En effet, l’identification doit porter tant sur la personne de l’huissier que sur le but de sa mission, et s’effectuer auprès d’une personne à même de la comprendre. Cette exigence exclut donc que l’huissier puisse accéder à des pages Internet privées à la faveur d’un traitement automatique des données incapable de distinguer l’internaute lambda de l’officier public et ministériel. Pourtant, la partie bénéficiaire du procès-verbal avait en l’espèce tenté de démontrer un cas de force majeure ayant empêché l’huissier de souscrire à ses obligations en prouvant qu’aucun procédé n’avait été mis en place sur le site internet pour indiquer à l'administrateur ses qualité et objet des constatations menées. Las, l’argument de fait est vain face à la froideur du raisonnement juridique.
L’arrêt commenté procède donc d’une logique juridique implacable, difficilement compatible avec les contraintes matérielles auxquelles sont confrontés les huissiers de justice lesquels, pour se rassurer, non d’autres choix que de recourir à un tiers dès lors que la page internet à constater requiert une identification préalable.
La méthode utilisée en pratique par un huissier de justice pour accéder à un lieu virtuel privé repose sur un raisonnement simple : s’il est interdit à cet officier public et ministériel d’accéder à un lieu privé virtuel, un tiers peut cependant y accéder. Donc, l’huissier de justice peut constater qu’un tiers accède au lieu privé virtuel. Même s’il s’agit d’un artifice juridique, cette solution est admise en jurisprudence, bien qu’elle soit critiquée par une partie de la doctrine [6].
L’analyse de l’arrêt serait cependant incomplète s’il n’était pas envisagé la sanction appliquée au procès-verbal de critiqué.
II. Une sanction mesurée
En l’espèce, le procès-verbal de constat est sanctionné par une nullité partielle qui, bien que contestable dans sa dénomination, n’en est pas moins compréhensible juridiquement (A). Cette solution contribue à la naissance d’un régime de sanctions sui generis des constats internet (B).
A. Une sanction partielle
La cour d’appel juge qu’ « il convient, cependant, de préciser que la nullité du procès-verbal de constat du 2 novembre 2017 n'est encourue que pour la page 16 concernant uniquement les mentions apposées par l' huissier de justice après qu'il a créé son compte sur le site (..) soit à compter de la mention je clique ensuite sur utiliser un compte local jusqu'à la mention je procède à une impression écran sur 2 pages (pièce numéro 20), ainsi que pour les pièces recueillies dans ce cadre, soit les annexes 15 à 20, et d'infirmer les décisions entreprises de ce chef, seule la partie de la page 16 visée et les annexes ci-dessus mentionnées devant être écartées des débats ». C’est donc là une sanction partielle, très ciblée, et isole le comportement actif et déloyal du restant des constatations qui n’étaient pas critiquées.
La rédaction de l’arrêt appelle deux observations.
La première observation concerne la nature de la sanction. La cour utilise improprement le terme « nullité » alors même que le procès-verbal de constat, n’étant pas un acte de procédure, n’est pas soumis au régime des nullités. La sanction est en réalité une perte de force probante en ce que la constatation ne lie plus le juge et est écarté des débats. Cette erreur de dénomination n’est pas heureusement pas préjudiciable.
La seconde observation porte sur le fait que la sanction ne vise pas la totalité de l’acte, mais uniquement les mentions querellées. Cela peut étonner, mais ce n’est pas une nouveauté : plusieurs décisions ont annulé des constats [7] (ou des saisies-contrefaçon [8]) à l’exclusion expresse des photographies qui y étaient jointes.
La solution retenue par la cour d’appel de Paris est fondée en droit, même si les magistrats ne motivent pas ce point.
En effet, la sanction partielle est tout à fait compréhensible en droit à partir du moment où est retenue une distinction entre le procès-verbal de constat et les constatations qu’il contient : « le procès-verbal de constat est l’acte, alors que les constatations sont l’action. Le procès-verbal de constat est l’enveloppe des constatations » [9]. En d’autres termes, le procès-verbal du constat peut être assimilé à l’instrumentum et les constatations au negotium.
Or, l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit en son article 1er que les huissiers de justice « peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ». Dans la mesure où chaque constatation reçoit individuellement cette force probante, et que le procès-verbal n’est que l’addition de ces constatations sous la forme d’un acte, il est logique qu’il puisse exister une sanction individualisée à chaque constatation, et non une sanction globale qui affecterait la totalité du procès-verbal.
Cette sanction partielle permet d’éviter une cristallisation des débats autour de la preuve aux dépens du fond de l’affaire. En adoptant cette sanction, la cour d’appel de Paris permet au contentieux de se poursuivre sans se perdre dans les chicanes de la contestation de la preuve.
B. Un régime de sanctions sui generis
La solution de la cour d’appel de Paris est opportune et contribue à l’apparition d’un régime de sanction des constats internet sui generis, composé de la théorie de la dévaluation de la force probante et de la perte partielle de la force probante.
Pour mémoire, l’objectif premier de la théorie de la dévaluation de la force probante du constat internet est de diminuer, voire annihiler, le contentieux stérile autour de la forme du constat dressé par huissier de justice sur internet lorsque le fait litigieux n’est pas contesté. Elle ne vise à sanctionner que le constat internet imparfait en ce que les prérequis ne sont pas respectés. Elle nécessite la réunion de trois conditions cumulatives pour recevoir application.
La première condition, dite matérielle, réside dans le fait que le procès-verbal dressé par l’huissier de justice sur Internet ne remplit pas tous les critères de validité posés par la jurisprudence.
La deuxième condition, dite réelle, consiste à ce que la partie à qui est opposée le procès-verbal de constat ne conteste pas l’existence du fait litigieux. Autrement formulé, il faut que la critique porte sur les conditions d’établissement de la preuve, et non sur le fait prouvé.
La troisième et dernière condition, dite juridictionnelle, est que l’acte irrégulier dans un contentieux autre que pénal.
En vertu de la théorie de la dévaluation de la force probante du constat, le constat Internet dressé par huissier de justice fait donc foi jusqu’à preuve contraire, sauf s’il a été établi non conformément aux exigences jurisprudentielles, auquel cas il ne vaut qu’à titre de simple renseignement.
La dévaluation de la force probante n’est plus une théorie, mais une réalité jurisprudentielle.
Cette sanction a été retenue par la cour d’appel de Colmar le 18 décembre 2020 [10] qui retient que « la juridiction peut user de son pouvoir d'appréciation pour évaluer la force probante qui s'attache à cette pièce sans qu'il soit pour autant nécessaire de l'écarter des débats, aucun motif d'irrecevabilité n'étant invoqué”. En vertu de ce pouvoir souverain d’appréciation, la cour d’appel de Colmar estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le constat critiqué, même s’il ne respecte pas le protocole prétorien. Elle précise cependant en revanche que le constat d'huissier ne présente pas en l’espèce les garanties exigées aujourd'hui en matière de constatations sur internet, ce qui a pour conséquence d'amoindrir sa force probante, sans préciser quelle force elle lui attribue exactement. Elle ne réforme pas le jugement attaqué pour des motifs de fond.
Cette théorie a également reçu application par la cour d’appel de Douai le 14 octobre 2021 [11] : « le jugement attaqué, tout en relevant que l' huissier de justice a manqué à certaines précautions élémentaires préalables à l'établissement des deux constats a, à juste titre, considéré que certes ces manquements doivent conduire la juridiction à faire preuve de circonspection dans l'évaluation de la qualité probante des constatations effectuées par l' huissier dans de telles conditions, mais que cependant lesdits manquements ne peuvent conduire à écarter systématiquement les procès-verbaux litigieux ».
La dévaluation de la force probante permet donc de « sauver » le constat internet réalisé au mépris du protocole prétorien, lequel ne doit pas être confondu avec la norme Afnor NF Z67-147 de Septembre 2010 qui n’est en rien obligatoire en plus d’être victime d’une obsolescence programmée [12].
La sanction de la perte partielle de la force probante du procès-verbal de constat ne vise pas le même type d’erreur, mais prétend corriger le comportement actif et déloyal de l’huissier de justice, en distinguant les constatations qu’il a ainsi réalisées du restant. Elle tend à apprécier individuellement chaque constatation, à séparer le bon grain de l’ivraie pour conserver celles qui ne sont pas contestées et contestables. En adoptant cette sanction, la cour d’appel de Paris fait œuvre de pragmatisme, permettant aux débats de se poursuivre. Il serait possible d’objecter qu’elle fait erreur et qu’il conviendrait de faire usage du fameux adage fraus omnia corrumpit, ce qui justifierait une remise en question du procès-verbal en intégralité. Ce serait cependant ne pas s’apercevoir qu’elle a appliqué cet adage sans le citer en écartant toutes les constatations réalisées à l’aide du comportement actif. Mais elle a appliqué cet adage avec discernement, refusant de le transformer en tsunami procédural suffisamment puissant pour décrédibiliser des constatations qui n’étaient pas critiquées.
L’arrêt commenté, bien qu’il n’ait pas été remarqué, n’en est donc pas moins remarquable : il constitue autant une gifle sanctionnant un comportement actif et déloyal, qu’une gifle réveillant ceux qui pensent qu’il suffit de contester une ligne pour annihiler la force probante d’un constat entier.
[1] Très tôt, il a été admis qu’un site Internet ne constituait pas un domicile virtuel (TGI Paris, ord. réf., 14 août 1996 : JCP G 1996, 11, n° 22727 ; JCP E 1996, p. 259, B. Edelman.). Cette solution fut d’ailleurs rappelée récemment par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 28 février 2018, n° 16/0226 N° Lexbase : A7198XEC) auquel se référaient les parties. En conséquence, l’huissier de justice n’a à demander à personne une autorisation pour accéder à un site publiquement et librement accessible. C’est ce que rappelle P.-Y. Gautier lorsqu’il écrit « l’inviolabilité du domicile suppose la volonté du sujet de refuser à la fois de faire connaître le lieu de son habitation et d’y laisser pénétrer autrui. Si l’agent assermenté obtient légalement l’adresse du serveur, non confidentielle, et que comme tout usager, de “clic en clic”, il parvient aux œuvres mises en ligne, sans barrière, ni “mot de passe” (équivalent du verrou ou de la clé de la porte d’entrée du site), il semble que ce ne puisse être que du consentement de son propriétaire qui a ouvert sa porte sur le “Web” à un public indéterminé, la planète entière »( P.-Y. Gautier, Les œuvres du crooner dans la « maison » de l’internaute : promenade collective, mais non autorisée, sur un site numérique : D. 1996, p. 490.).
[2] S. Dorol : JCl. Encyclopédie des Huissiers de Justice, Bloc Preuve, Fasc. 30, V° Les constats, n° 4.
[3] CA Paris, 5 juillet 2019, n° 17/03974 (N° Lexbase : A2432ZIW), in Bull. Inf. Vénézia & Ass., 2019, n°11, p.2 [en ligne].
[4] Cass. civ.1, 20 mars 2014, n° 12-18.518, FS-P+B (N° Lexbase : A7370MHG).
[5] CA Paris, 28 février 2018, n° 16/02263, (N° Lexbase : A7198XEC).
[6] V. Vigneau, Les constats d’achats : Procédures 2008, étude 10, n° 8. – S. Dorol, Le tiers acheteur dans le procès-verbal de constat : Propr. industr. 2015, étude 17, p. 13.
[7] CA Rouen, 8 novembre 2007, n° 05/02624 (N° Lexbase : A3609G33).
[8] CA Paris, 2 juillet 2008, n° 07/06442 (N° Lexbase : A5940D9U).
[9] S. Dorol, L’image dans le constat : Procédures 2015, étude 11, p. 9.
[10] CA Colmar, 18 décembre 2020, n° 19/00548 (N° Lexbase : A06694BE) ; S.Dorol, Sanction du constat internet imparfait : application de la dévaluation, Lexbase, Droit privé, février 2021, n° 854 (N° Lexbase : N6397BYL).
[11] CA Douai, 14 octobre 2021, n° 19/05389 (N° Lexbase : A282149D) in Bull. inf. Vénézia & Associés, 2022, n°20, à paraître.
[12] En ce sens : S. Dorol, Norme Afnor et constat Internet : Vade mecum ou vade retro , Gaz. Pal. 2016, n° 37, p. 16. – S. Dorol et S. Racine, La nouvelle ère des constats d’huissier sur Internet, Propriété Industrielle, 2019, n°10, ét. 21, p12.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479787
[Jurisprudence] L’abrogation juridictionnelle aux mains du juge de l’excès de pouvoir, une adaptation dans l’air du temps ?
Réf. : CE Sect., 19 novembre 2021, n°s 437141, 437142, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A48067CY)
Lecture: 22 min
N9751BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Raphaël Maurel, Maître de conférences en droit public à l’Université de Bourgogne, membre du CREDIMI (EA 7532), associé au CEDIN (EA 382) et au CMH (EA 4232)
Le 15 Décembre 2021
Mots clés : acte réglementaire • abrogation
Le juge de l’excès de pouvoir peut désormais, s'il est saisi de conclusions en ce sens, prononcer l’abrogation d’un acte réglementaire devenu illégal en raison d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
« Sera-t-il dans la prochaine édition du GAJA » [1] ? Telle fut l’interrogation de plusieurs chercheurs et praticiens à la lecture de l’arrêt « Association ELENA France », rendu par la section du Conseil d’État le 19 novembre dernier. Sans prétendre ici proposer une analyse exhaustive de cette décision importante – bien que la rapporteure publique Sophie Roussel ait souhaité « insister sur la modestie de l’évolution proposée » [2] – on peut brièvement relever les points les plus significatifs de cette décision – que l’on qualifiera d’« ELENA France 2 ».
La requérante principale, l’Association des avocats ELENA, est bien connue du juge administratif, qui s’est prononcé plus d’une fois sur ses demandes d’annulation relative à la liste des pays considérés par le Conseil d’administration de l’Ofpra – Office français de protection des réfugiés et des apatrides – comme « sûrs » [3]. En l’espèce, il était une fois de plus question de cette liste, introduite en droit positif du fait du droit de l’Union européenne – le Conseil d’État y était initialement hostile (v. CE, Ass., 16 janvier 1981, n° 20527 N° Lexbase : A6534AK9). Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 531-24 du CESEDA (N° Lexbase : L3448LZQ) (ancien L. 723-2 I) précise à son propos que « [l]’office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr ». Il en est d’ailleurs de même devant la CNDA, l’article L. 532-6 (N° Lexbase : L3459LZ7) (ancien L. 731-2) du CESEDA prévoyant que lorsque l’Office a statué en procédure accélérée, « le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin statue [en juge unique] dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine ». Dans de nombreux cas, l’affaire est d’ailleurs traitée par ordonnance et ne fait même pas l’objet d’une audience, conformément à l’article L. 532-8 (N° Lexbase : L3461LZ9) (ancien L. 733-2) du même code. Autrement dit, lorsque le requérant provient d’un pays considéré comme « sûr », la procédure est d’emblée accélérée, bien que des garde-fous tendant au renvoi en audience collégiale soient prévus lorsque le dossier apparaît particulièrement sérieux [4]. Il est donc compréhensible que les décisions d’inscrire tel ou tel pays sur la liste comme celles de ne pas la modifier soient régulièrement contestées.
Tel fut le cas de la délibération du Conseil d’administration de l’Ofpra du 5 novembre 2019, par laquelle il a été décidé de ne pas modifier la liste des pays considérés comme étant des pays d'origine sûrs fixée depuis 9 octobre 2015 [5]. C’est cette délibération de 2019, qui entérine de nouveau la liste de 2015 sans modification qui était contestée par les associations requérantes. Celles-ci faisaient valoir des situations au Bénin, au Sénégal, au Ghana, en Albanie, en Géorgie, en Inde, au Kosovo, en Arménie, et dans l'ensemble les autres pays de la liste. Dans un arrêt du 2 juillet 2021 que l’on désignera ici « ELENA France 1 », les 2ème et 7ème chambres réunies ont relevé que la situation au Bénin « s’était dégradée de façon préoccupante » [6], et que la décision de maintien du Sénégal et du Ghana ne tenait manifestement pas compte de l’évolution introduite, par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée (N° Lexbase : L9696LLP), un droit d'asile effectif et une intégration réussie, par laquelle « le législateur a entendu qu’une attention particulière soit accordée, pour l’établissement et la révision de la liste des pays d’origine sûrs, aux risques de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants en raison de l’orientation sexuelle des ressortissants de ce pays » [7]. Dans cet arrêt peu remarqué [8], le juge administratif a annulé la délibération du 5 novembre 2019 en ce qui concerne ces trois États, mais rejeté les moyens relatifs aux autres États.
Cependant, comme l'a relevé la rapporteure publique, la formation n'en avait « pas terminé avec ces affaires pour autant » [9]. De manière originale, deux associations requérantes avaient en effet présenté, à titre subsidiaire, des conclusions à fin d'abrogation de la délibération sur l'Arménie, la Géorgie et le Sénégal fondées non sur la situation à la date de son adoption (le 5 novembre 2019), mais postérieurement. Autrement dit, il était demandé au Conseil d'État de tenir compte de circonstances postérieures, qu'étaient des manifestations violentes au Sénégal en 2021, le conflit du Haut-Karabagh en 2020 pour l'Arménie, et les tensions en Géorgie depuis les élections législatives d'octobre 2020. Jugeant prudemment que « [l]’enjeu dépasse très certainement [la] formation de jugement » [10], les 2ème et 7ème chambres réunies ont renvoyé la question de l’éventuelle reconnaissance d’un nouveau pouvoir d’abrogation juridictionnel à une formation plus solennelle, donnant lieu à l’arrêt « ELENA France 2 » commenté (I). Ce pouvoir qui n’a, en tout état de cause, pas été utilisé en l’espèce puisque le juge rejette la requête des requérants, est à la fois limité aux actes réglementaires et adjoint d’une capacité de modulation de ses effets dans le temps (II).
I. La reconnaissance cohérente du pouvoir d’abrogation du juge de l’excès de pouvoir
Les moyens présentés, qualifiés de « conclusions inhabituelles en excès de pouvoir, tendant à ce que vous abrogiez, en vous plaçant à la date d’aujourd’hui, une décision dont l’annulation rétroactive vous est par ailleurs demandée » [11], ont manifestement surpris le juge administratif. Pourtant, ils s’appuient sur une évolution jurisprudentielle continue qui rendait logique la solution adoptée [12]. Certes, il était jusqu’ici bien établi, en matière d’excès de pouvoir, que les pouvoirs du juge administratif étaient limités et surtout cantonnés dans une temporalité restreinte : celle de la date d’édiction de l’acte attaqué. Autrement dit, l’excès de pouvoir ne pouvait naître après la date de la décision attaquée. Cela entraîne un certain nombre de difficulté de longue date résolues par la jurisprudence, mais qui confient tous un pouvoir significatif, sinon une responsabilité, à l’Administration.
Le principe a été posé par l’arrêt « Despujols » [13] de 1930 : la survenance de nouvelles circonstances, de fait comme de droit, ouvre la possibilité de demander à l’Administration l’abrogation ou la modification d’un règlement y compris à l’issue de l’expiration du délai de recours. Seule la décision de l’Administration – surtout si elle est de refus – est susceptible d’être contestée en excès de pouvoir.
Plusieurs pierres sont depuis venues fragiliser l’édifice, qui reposait sur l’idée selon laquelle le contrôle du juge de l’excès de pouvoir demeure un contrôle. Au-delà de la diversification des pouvoirs du juge administratif – l’on pense au pouvoir d’injonction [14], ou à l’introduction du référé [15] – la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises, mais à demi-mots, que la « temporalité » dans laquelle s’inscrit l’acte administratif contesté pouvait être source de problématiques, voire de paradoxes si l’on s’en tient aux pouvoirs traditionnellement dévolus au juge de l’excès de pouvoir. L’office du juge a parfois pu, notamment dans les situations d’urgence, être réduit à celui d’avertisseur d’illégalité ; ainsi le cas des assignations administratives à résidences illégales dont l’abrogation pouvait intervenir, à l’initiative de l’administration, au moment même où le juge des référés rédigeait sa décision [16]. Le juge de l’excès de pouvoir ne statuant que sur les conclusions à des fins d’annulation du fait de l’illégalité initiale de l’acte, des avertissements relatifs à la légalité postérieure ont parfois pris la forme d’obiter dicta dans les motifs des décisions [17]. De manière plus claire encore, le juge a pu rappeler à l’administration son devoir de procéder dans un délai raisonnable aux modifications réglementaires rendues nécessaires par la survenance d’une nouvelle loi, lorsque cette dernière ne les rendait pas inapplicables [18]. Autrement dit, le pouvoir d’annulation rétroactive des actes administratifs illégaux ab initio est parfois insuffisant pour régler l’ensemble des difficultés que soulèvent les évolutions des circonstances : la balle est bien souvent renvoyée à l’administration, ou à l’administré qui doit formuler la demande d’abrogation directement à l’administration.
Plusieurs indices, dans la jurisprudence récente, tendaient en néanmoins à laisser penser qu’une ouverture était possible en faveur de la reconnaissance d’un pouvoir d’abrogation juridictionnel du juge de l’excès de pouvoir. Plusieurs exemples sont rappelés par la rapporteure publique. D’abord, dans l’arrêt « Association des Américains accidentels » en 2019, le juge avait d’abord, en point d’orgue de l’évolution mentionnée plus haut, reconnu « clairement que le contentieux des décisions de refus [d’abroger] s'appréci[ait] au regard des règles applicables non plus à la date des faits mais à la date de l'arrêt » [19] ; demeurait à étendre cette solution à d’autres contentieux. Dans l’arrêt « Stassen » [20] en 2020, la même formation de jugement que celle saisie dans l’affaire « ELENA France 1 » avait surtout lancé un « ballon d’essai dans ce sens » [21] en considérant que le juge de l’excès de pouvoir pouvait apprécier non seulement la légalité à la date de l’édiction d’une suspension conservatoire d’un joueur de rugby par l’Agence de lutte contre le dopage dans l’attente d’une décision disciplinaire, mais également, s’il était saisi en ce sens, « la légalité de la décision à la date où il statue et, s’il juge qu’elle est devenue illégale, […] en prononcer l’abrogation » [22]. Mais ce choix, motivé par l’effet utile du recours – ce qui peut être discuté [23] – demeurait a priori cantonné au contentieux sportif, et spécifiquement de la suspension « provisoire » qui induit une temporalité réduite susceptible de justifier ce nouveau pouvoir.
Il était donc proposé de généraliser cette solution et, ainsi, de « mettre à jour » le recours pour excès de pouvoir, dont la sclérose relative – le juge ayant déjà fait évoluer ses pouvoirs dans le passé [24] – menaçait effectivement la survie ou, plus précisément, l’utilité puisqu’ils risquait se de voir concurrencé par d’autres procédures pourtant moins protectrices. La rapporteure publique ne s’y est d’ailleurs pas trompée en soulignant le « risque [qui] est celui d’une démonétisation du recours pour excès de pouvoir, au profit notamment des procédures de référé » [25]. Le juge n’y a pas manqué en développant trois considérants de principe : « [s]aisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation » [26].
II. Une reconnaissance encadrée et limitée aux actes réglementaires
Ce nouveau pouvoir d’abrogation juridictionnelle en cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à l'acte contesté, dont on peut saluer la reconnaissance puisqu’il comble un vide devenu difficilement compréhensible à une époque où la densité de la production réglementaire et législative est proche de l’abusif, n’est cependant pas illimité. Il est, d’abord, subsidiaire à l’annulation [27].
Le juge limite d’autre part la portée de sa décision aux actes réglementaires, excluant de jure les actes individuels. On peut s’en étonner, notamment à la lecture des conclusions dans lesquelles Sophie Roussel rappelle que « [n]i les actes individuels, ni les actes réglementaires ne sont par nature imperméables au temps qui passe. La frontière entre actes réglementaires et non réglementaires n’est d’ailleurs pas toujours évidente à tracer » [28]. Ce sont des considérations de « politique jurisprudentielle » [29] qui semblent finalement avoir emporté la conviction de la rapporteure comme de la formation de jugement : « il est toujours périlleux, voire hasardeux, de tenter d’embrasser toutes les situations possibles à partir d’un seul cas d’espèce » [30].
On retrouve ici la traditionnelle frilosité du juge administratif à trop en dire ou à adopter des solutions trop tranchées pour l’avenir – frilosité confinant parfois à la procrastination, lorsqu’il est évident que la question reviendra devant son prétoire et qu’il faudra ultérieurement la trancher [31]. Il reste loisible de s’interroger sur l’utilité d’une telle distinction entre actes réglementaires et actes individuels, qui ne semble en l’espèce devoir son existence qu’au hasard de la saisine des associations requérantes. Cette volonté discutable de distinguer, qui conduit essentiellement à complexifier, le contentieux des actes administratif, est un héritage jurisprudentiel bien établi, comme l’a montré il y a quelques années l'arrêt « CFDT » [32], dont on peut penser que la solution a également été également quelque peu artificiellement limitée aux actes réglementaires. Comme l'indiquait Aurélie Bretonneau dans ses conclusions sous ce célèbre arrêt, « [c]’est l’aura particulière de l’acte réglementaire qui justifie pour lui une forme de contestation perpétuelle par voie d’exception, et c’est parce que cette contestation dérivée est perpétuelle qu’il est souhaitable de la centrer sur les illégalités de fond. L’argument ne vaut donc pas pour les actes individuels, dont la contestabilité continuera d’obéir à une logique propre » [33]. Il en découle une sorte de compensation globalement défavorable à l’usager contestant un acte administratif individuel : « [l’]encadrement assez strict de ce régime de contestation directe – plus strict en tout cas, en principe, que pour les actes individuels – est compensé par un régime de contestation indirecte beaucoup plus favorable à l'administré que pour les actes non-réglementaires » [34], régime comprenant notamment la solution de l’arrêt « Despujols ». Il n’en demeure pas moins qu'on a, justement, du mal à identifier précisément l'utilité de cette logique propre, dont l'histoire jurisprudentielle a souvent montré qu'elle finissait par céder le pas à la nécessaire harmonisation au sein de la même branche de contentieux – et on pense ici, dans un tout autre domaine et les exemples pourraient être multipliés, à la solution peu motivée de l'arrêt « Cohn-Bendit » [35], dont les critiques récurrentes ont fini par porter leurs fruits. Certes, donc, « [l]a jurisprudence, si ardente qu'elle ait été à vouloir garantir la légalité, n'a jamais été insensible à la nécessité de ne pas perturber inconsidérément l'ordre juridique » [36].
À la lecture des conclusions, on ne voit dès lors ni ce qui empêchait le juge de l’excès de pouvoir de se reconnaître le pouvoir d’abrogation juridictionnel de tous les actes administratifs, ni de motif de croire que la question ne sera pas prochainement portée devant lui.
Il faut également relever que le juge administratif a entendu se ménager d’emblée la possibilité de moduler les effets de ce nouveau pouvoir d’abrogation juridictionnelle dans le temps. L’arrêt indique ainsi que le juge de l’excès de pouvoir « peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine » [37]. De prime abord, il est tentant y voir une extension de la jurisprudence « Association AC ! » – qui, elle, n’a jamais été limitée à un type d’acte en particulier [38]. La lecture des conclusions de Sophie Roussel y invite d’ailleurs, puisque la rapporteure publique estime qu’il n’y a « pas de raison d’exclure d’appliquer votre jurisprudence « AC ! », non pas dans son volet dérogation au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses, qui est sans objet […], mais en tant qu’elle permet au juge de décider que l’abrogation qu’il prononce ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ». Dans la mesure où le cœur de l’arrêt « AC ! » nous semble justement résider dans la modulation des effets de la rétroactivité, il est néanmoins peut-être préférable – cette fois ! – de continuer à distinguer l’annulation de l’abrogation, et de voir plutôt dans le paragraphe 5 de l’arrêt « ELENA France 2 » soit un nouveau pouvoir du juge administratif, fondé certes sur la même logique mais en pratique différent, soit un accessoire indispensable du pouvoir d’abrogation juridictionnel. Au demeurant, la mention de ce pouvoir de modulation nous paraît purger les dernières réserves qu’il aurait été possible d’entretenir quant à l’extension du pouvoir d’abrogation juridictionnelle aux actes non réglementaires.
Un second argument plaide pour distinguer le présent pouvoir de modulation de celui reconnu en matière d’annulation. On sait que l’exercice de ce pouvoir, dans son volet « annulation » issu «d’AC ! », est soumis à des conditions, mais que ses conséquences sont importantes et seraient même, si son utilisation se voyait banalisée, « désastreuses pour l’avenir du recours pour excès de pouvoir » [39]. Le juge de l’excès de pouvoir peut en effet soit « confirmer les effets que l’acte annulé a produits dans le passé, empêchant leur remise en cause, soit […] différer dans le temps l’annulation prononcée, en la privant de tout effet rétroactif […], laissant ainsi le temps à l’Administration de prendre un nouvel acte légal avant que l’annulation ne prenne effet » [40]. L’encadrement strict du pouvoir de modulation, exposé dans un considérant de principe dense, paraît dès lors bien justifié – et il ne nous appartient pas de le commenter ici. Cependant, la formulation du paragraphe 5 de l’arrêt commenté est très différente de celle d’« AC ! ». Elle est d’abord lapidaire, mais surtout imprécise, puisque revient au juge la vaste charge d’examiner les motifs tendant « à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence » pour décider d’une éventuelle modulation. Rien, dans les conclusions, ne permet d’identifier clairement le contenu de cet exercice d’appréciation jurisprudentiel, qui dépasse pourtant les simples « ajustements de rédaction nécessaires » [41] au considérant de principe d’« AC ! ».
Il est donc permis de penser que la latitude que s’octroie le juge administratif est particulièrement large, contrairement aux restrictions posées – à raison – dans l’arrêt « AC ! ». Est-ce à dire que la persistance, même temporaire, d’un acte règlementaire devenu illégal du fait d’un changement des circonstances dans l’ordre juridique interne est moins gênante, et donc soumise à moins de contraintes, que le report de l’effet d’une annulation rétroactive du même acte si son illégalité s’avère être initiale, de sorte que le second doit être spécifiquement encadré et pas le premier ? Cela peut être défendu. Il nous semble cependant qu’un tel maintien ne devrait pas être envisagé à la légère, et qu’une meilleure précision des modalités du pouvoir de modulation des effets d’une abrogation juridictionnelle aurait été ici bienvenue.
***
La conclusion de ce bref commentaire invite, il faut le regretter, à revenir à un classique du contentieux administratif : « [c]omme souvent, les requérants qui ont obtenu une évolution de jurisprudence n'en bénéficient pas » [42]. De manière qui ne peut que surprendre l’internationaliste au fait du contentieux violent opposant cet État à l’Azerbaïdjan [43], l’Arménie, qui déplore quelques 6000 décès du fait de la guerre au Haut-Karabagh ces derniers mois, reste considérée comme un pays d’origine « sûr ». En d’autres termes, « d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et […] il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne » [44]. Si la rapporteure souligne que « [s]ans doute la situation politique de la Géorgie s’est […] tendue depuis un an » [45], la comparaison avec le Ghana ou le Sénégal quant à la pénalisation de l’homosexualité, dont l’on pourrait douter de la pertinence – les situations devraient-elles être appréciées de manière comparative ou autonome ? –, ne permet pas d’emporter sa conviction : le maintien de la Géorgie sur liste n’est pas illégal. Il est sans doute regrettable que ce nouveau pouvoir, qui s’inscrit résolument dans l’adaptation de l’office du juge de l’excès de pouvoir à son temps, n’ait pas été utilisé pour tenir compte de la violence actuelles dans ces pays, que l’on persiste à considérer comme parfaitement « sûrs » pour des raisons peu compréhensibles – si ce n’est peut-être le nombre de demandeurs d’asile qui en proviennent, lequel invite à soupçonner une crainte de submersion des formations collégiales à la CNDA voire de l’Ofpra si ces États étaient retirés de la liste [46] . On peut ainsi se risquer à supposer qu’il poursuit, directement ou indirectement et au-delà de l’image d’un juge vivant en décalage avec son temps, un objectif de temporisation les risques de flux migratoires massifs et incontrôlés en provenance d’États en conflits.
Comme le notait Jean-Marc Sauvé s’agissant des abrogations administratives survenant pendant le contentieux, « il y a le temps de l'action administrative et il y a le temps du juge qui doivent demeurer distincts » [47]. Il n’est pas sûr que cette décision contribue à restaurer cette distinction ; on peut toutefois espérer que, maniée avec précaution, elle permettra une plus grande protection des administrés face à la latence, qui n’est pas d’école, de l’Administration à abroger certains actes illégaux. Sans conclure que la classification des recours « avec laquelle nous continuons, par habitude et par commodité, à vivre aujourd’hui » [48] n’a plus de raison d’être, il est en revanche et en tout cas certain que la définition du juge de l’excès de pouvoir par sa limitation à la seule annulation peut être définitivement abandonnée.
[1] M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 23ème éd., Dalloz, 2021, la prochaine édition de ce précieux outil pour les étudiants et praticiens sera publiée fin 2022. L’interrogation est notamment soulevée par R. Letteron, « L'arrêt Association Elena : le retour des "Grands Arrêts" », Blog Libertés, Libertés chéries, 20 novembre 2021.
[2] Conclusions de S. Roussel, p. 18.
[3] V. notamment CE, 10 octobre 2014, n°s 375474, 375920 (N° Lexbase : A2284MYA) ; CE, 30 décembre 2016, n°s 395058, 395075, 395133, 395383 (N° Lexbase : A0405SYN).
[4] Sur cette procédure et son articulation complexe avec le droit des étrangers en situation irrégulière, v. R. Maurel, La neutralisation du droit au maintien sur le territoire d’un demandeur d’asile provenant d’un « pays sûr » à l’épreuve du juge administratif , note sous CAA Lyon, 3 novembre 2020, n° 19LY04138 (N° Lexbase : A510733K), Rev. Jurisp. ALYODA, 2021, n° 2.
[5] La liste adoptée comporte 16 pays : l’Albanie, l’Arménie, le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap-Vert, la Géorgie, le Ghana, l’Inde, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, l’Ile Maurice, la Moldavie, la Mongolie, le Monténégro, le Sénégal, la Serbie et le Kosovo.
[6] CE, 2 juillet 2021, nos 437141, 437142, 437365 (N° Lexbase : A21974YZ), §11.
[7] Ibid., §12.
[8] À notre connaissance, peu d'analyses de cet arrêt ont été produites, peut-être dans l'attente de l'arrêt commenté qui en constitue le second volet. V. cependant C. Biget, Le Bénin, le Sénégal et le Ghana ne sont plus des pays d'origine sûrs, Dalloz Actualité, 9 juillet 2021 et AJDA, 2021, p. 1418 ; sur la technique du renvoi en section employée, A. Courrèges, Le dessous des cartes, DA, n° 10, octobre 2021, repère 9.
[9] S. Roussel, Conclusions sous « ELENA France 1 », p. 13.
[10] Ibid., p. 14.
[11] Idem.
[12] Voir les nombreuses jurisprudences invoquées dans les riches conclusions de S. Roussel.
[13] CE, 10 janvier 1939, n° 97623, Despujols.
[14] Loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (N° Lexbase : L1139ATD).
[15] Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives (N° Lexbase : L0703AIU).
[16] Dans le cadre de l’état d’urgence terroriste, voir sur ce point et par ex. l’audition de Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur le 19 janvier 2016, dans le Rapport fait en application de l’article 145-5 du Règlement au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, sur le contrôle parlementaire présenté par MM. Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson, 25 mai 2016, p. 156.
[17] S. Roussel, conclusions sous « ELENA France 2 », p. 8.
[18] V. notamment CE, 28 juin 2002, n° 220361 (N° Lexbase : A0211AZT) : « lorsque, sans pour autant rendre par elle-même inapplicables des dispositions réglementaires incompatibles avec elle, une loi crée une situation juridique nouvelle, il appartient au pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité ». L’arrêt est cité par S. Roussel, p. 8 des conclusions sous « Elena France 2 ».
[19] R. Letteron, L'arrêt Association Elena : le retour des "Grands Arrêts" , op. cit..
[20] CE, 28 février 2020, n° 433886 (N° Lexbase : A93003GK).
[21] S. Roussel, Conclusions sous « ELENA France 2 », p. 10.
[22] CE, 28 février 2020, n° 433886.
[23] V. les conclusions de S. Roussel, p. 10, qui indique en note 31 qu’il aurait été plus pertinent de s’appuyer sur l’effet utile de l’intervention du juge administratif, plutôt que sur celui du recours, le choix opéré accréditant « l’idée que cet effet utile est exclusivement apprécié à l’aune des intérêts du requérant ».
[24] L’on pense surtout à la décision CE, Ass., 11 mai 2004, n° 255886 (N° Lexbase : A1829DCQ), par laquelle le juge de l’excès de pouvoir s’autorise à moduler dans le temps les effets de l’annulation (par nature rétroactive) juridictionnelle, afin de préserver la sécurité juridique.
[25] S. Roussel, Conclusions sous « ELENA France 2 », p. 6.
[26] CE, 19 novembre 2021, n°s 437141et 434712, §§ 3-5.
[27] Sur la question de la subsidiarité que nous ne développons pas ici, v. M. Charité, Étrangère au pouvoir du juge administratif, l’abrogation pourquoi le serait-elle ?, Le blog Droit administratif, 3 décembre 2021.
[28] S. Roussel, Conclusions sous « ELENA France 2 », p. 16.
[29] Idem.
[30] Ibid., p. 17.
[31] V. pour un exemple sur la question du géoblocage, CE, 27 mars 2020, n° 399922 (N° Lexbase : A2056WNH), et notre commentaire L’affaire Google Inc. sur le droit au déréférencement : remarques critiques sur un épilogue en queue de poisson, Droit administratif, octobre 2020, n° 10, comm. n° 41, pp. 40-44.
[32] Par exemple, dans l’arrêt CE, Ass, 18 mai 2018, n° 414583 (N° Lexbase : A4722XN9).
[33] A. Bretonneau, Conclusions sous CE, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, ibid., p. 12.
[34] G. Éveillard, La limitation du contrôle de la légalité externe des actes réglementaires, Droit Administratif, n° 10, octobre 2018, comm. 45.
[35] CE, Ass., 22 déc. 1978, n° 11604 (N° Lexbase : A4001AIZ).
[36] P. Delvolvé, La limitation dans le temps de l'invocation des vices de forme et de procédure affectant les actes réglementaires – Des arguments pour ?, RFDA, 2018, n° 4, p. 665.
[37] Arrêt commenté, §5.
[38] V. O. Mamoudy, D’AC ! à M6 en passant par Danthony. 10 ans d’application de la jurisprudence AC ! – Bilan et perspectives, AJDA, 2014, p. 501.
[39] Ibid.
[40] B. Plessix, Droit administratif général, 3ème éd., LGDJ, 2020, p. 1551.
[41] Voir le paragraphe dédié des conclusions de S. Roussel, p. 15.
[42] M.-C. De Monteclerc, Un nouvel outil dans la boîte du juge de l'excès de pouvoir, AJDA, 2021, p. 2303.
[43] Le 7 décembre 2021, la Cour internationale de justice a d’ailleurs rendu une ordonnance en indication de mesures conservatoires dans l’affaire l’opposant à l’Azerbaïdjan concernant l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; la Cour a notamment conclu que « La République d’Arménie doit, conformément aux obligations que lui impose la convention […], prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et l’encouragement à la haine raciale, y compris par des organisations ou des personnes privées sur son territoire, contre les personnes d’origine nationale ou ethnique azerbaïdjanaise » (CIJ, Application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Azerbaïdjan c. Arménie), ordonnance du 7 décembre 2021, mesures conservatoires, § 76).
[44] CESEDA, art. L. 531-15 (nouveau) (N° Lexbase : L3446LZN).
[45] S. Roussel, conclusions sous « ELENA France 2 », p. 26.
[46] En 2019, la Géorgie était le deuxième pays de provenance des demandeurs d’asile requérants devant la CNDA (5245 recours) après l’Albanie. L’Arménie se situe dans le « top 20 » (16ème position en 2020). V. le tableau récapitulatif dans le Rapport d’activité 2020 de la CNDA, p. 58.
[47] Audition de M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, 7 janvier 2016, à l’Assemblée nationale, dans Rapport fait en application de l’article 145-5 du Règlement au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, sur le contrôle parlementaire présenté par MM. Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson, 25 mai 2016, préc.
[48] S. Roussel, conclusions sous « ELENA France 2 », p. 27.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479751
[Jurisprudence] Marché de l'art : la simple mention « REPRODUCTION » sur une œuvre contrefaisante est-elle suffisante, voire opportune ?
Réf. : Cass. civ. 1, 24 novembre 2021, n° 19-19.942, FS-B (N° Lexbase : A78287CW).
Lecture: 11 min
N9756BYY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la Cour
Le 29 Mars 2022
Mots-clés : marché de l’art • œuvre contrefaisante • apposition de la mention « REPRODUCTION » • mesures coercitives pour mettre un terme à la contrefaçon • proportionnalité de la mesure ordonnée
Aux termes d'un arrêt du 24 novembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir ordonné l'apposition de la mention « REPRODUCTION » au dos d'une œuvre d'art jugée contrefaisante. Les conseillers d'appel avaient en effet jugé que la mesure de destruction sollicitée par les demandeurs aurait été disproportionnée au regard des circonstances de la cause. Cette affaire est ainsi l'occasion de revenir sur l'arsenal des mesures correctives dont disposent les juges du fond pour mettre un terme à la contrefaçon d'œuvre d'art.
Les ayants droit du peintre Marc Chagall, ainsi que l'Association pour la défense et la promotion de l'œuvre de Marc Chagall [1] qu'ils ont constituée ont fait procéder en 2012 à la saisie réelle d'un tableau intitulé « femmes nues à l'éventail » qui leur avait été présenté, pour certification, par un particulier tchèque. Dans la foulée, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Paris [2] d'une action en contrefaçon de droit d'auteur et sollicité la destruction du tableau apocryphe.
Une mesure d'expertise ayant été ordonnée par le tribunal, le résultat était sans appel : à l'issue d'une analyse comparative avec l'œuvre originale (Nu à l'éventail) peinte en 1910 par Marc Chagall et conservée au Centre Georges Pompidou, l'expert a conclu à « l'impossibilité d'émettre l'opinion selon laquelle l'œuvre litigieuse aurait été peinte de mémoire, les deux œuvres étant trop proches pour que l'œuvre litigieuse ne soit pas une copie de l'œuvre de référence ». Il s'agissait donc d'un « mauvais double » voire d'un « plagiat ».
En conséquence, le tribunal a jugé que le tableau litigieux n'était pas de la main du maître et constituait une œuvre contrefaisante [3]. Saisie d'un appel, la cour de Paris a statué dans le même sens ; son arrêt du 15 février 2019 [4] est devenu définitif sur ce point.
I. Les mesures correctives mettant fin à la contrefaçon
L'article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1773H33) dispose que, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets contrefaisants soient « rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée » ; ces mesures sont alors ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.
Ainsi, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du fond ont la possibilité d'ordonner un certain nombre de mesures permettant d'assurer le retrait effectif des contrefaçons des circuits commerciaux ; la plus rigoureuse en est évidemment la destruction pure et simple des supports de la contrefaçon [5], de manière alternative à la confiscation [6]. L'objectif de ces mesures correctives est alors d'empêcher la poursuite des actes de contrefaçon.
Dans l'affaire objet du présent commentaire, infirmant le jugement de première instance à cet égard [7], la cour d'appel de Paris a refusé de faire droit à la demande de destruction du tableau contrefaisant formulée par les requérants. Les conseillers parisiens ont estimé que la mesure de remise du tableau aux fins de destruction aurait présenté « au regard des circonstances de la cause » un caractère disproportionné. Il convenait donc de lui préférer la restitution du tableau litigieux à son propriétaire, après apposition de la mention « REPRODUCTION » au dos du tableau, « une telle disposition suffisant à garantir une éviction de ce tableau des circuits commerciaux ».
Saisie d'un pourvoi à l'initiative des ayants droit de Marc Chagall et du Comité Marc Chagall, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé les juges d'appel d'avoir retenu, « dans l'exercice de [leur] pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation de l'atteinte retenue », que l'apposition de la mention « REPRODUCTION » au dos de l'œuvre litigieuse, de manière visible à l'œil nu et indélébile, suffisait à garantir une éviction de ce tableau des circuits commerciaux. Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de mise en balance des intérêts en présence [8] n'ayant pas été valablement invoqué devant la cour d'appel par les demandeurs au pourvoi, il a été jugé nouveau et comme tel irrecevable [9].
II. L'apposition de la mention « REPRODUCTION » sur le support contrefaisant
Il est intéressant de constater que le libellé de l'article L.331-1-4 précité est identique à celui qui prévaut en matière de brevets, de marques et de dessins et modèles [10], étant issu de la loi du n° 2007-1544, 29 octobre 2007, de lutte contre la contrefaçon transposant en droit interne la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : A78287CW) [11]. Toutefois, alors que, pour ces autres droits de propriété industrielle, la contrefaçon est intimement liée à la mise dans le commerce des supports de la contrefaçon, il en va en partie différemment en matière de droit d'auteur. En effet, la simple représentation non autorisée de l'œuvre (dans le cadre d'une exposition, par exemple) peut constituer en tant que telle un acte de contrefaçon, indépendamment d'une éventuelle finalité commerciale. Cette dimension supplémentaire de la contrefaçon nous semble devoir être prise en considération par les juges du fond lorsqu'ils ordonnent des mesures correctives complémentaires.
Dans ce contexte, il est permis de s'interroger sur la pertinence de la mesure qui a été retenue par la cour d'appel de Paris, consistant à apposer « de manière visible à l'œil nu et indélébile, au dos de la contrefaisante » la mention « REPRODUCTION » aux frais du propriétaire de ce tableau, préalable indispensable à sa restitution.
Sur un plan simplement pratique, la mention « REPRODUCTION » au dos du tableau [12] ne permet pas à un spectateur qui fait face à cette peinture de prendre immédiatement connaissance de son caractère inauthentique. Cette mesure permet donc certes de rendre impossible la commercialisation du support matériel de la contrefaçon ; pour autant, elle n'empêche pas que ce tableau continue à être exposé au public et que ce dernier lui associe alors indûment le nom du peintre Marc Chagall.
Si la mise en retrait des circuits commerciaux est évidemment nécessaire, elle nous semble devoir prendre la forme de mesures permettant également de mettre un terme définitif à de potentielles atteintes au droit d'auteur. Pour cette raison, l'apposition de la mention « REPRODUCTION » – bien que respectueuse du droit de propriété du support matériel – ne nous semble pas totalement satisfaisante, plus particulièrement au regard des prérogatives extra-patrimoniales du droit au nom et du droit au respect de l'œuvre.
Également à l'initiative du Comité Marc Chagall, une autre solution avait été retenue par la cour d'appel de Paris aux termes d'un arrêt du 5 juin 2013 [13] : le découpage de la signature, avant restitution du tableau à son propre prioritaire. En l'espèce, elle aurait présenté l'avantage de faire comprendre immédiatement aux spectateurs la nature contrefaisante du tableau exposé.
C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que la Chambre criminelle de la Cour de cassation [14] a approuvé une cour d'appel d'avoir jugé que la copie de la signature qui fait partie d'un tableau dont la reproduction est licite (dès lors qu'il est tombé dans le domaine public) ne méconnaît pas le droit moral de son auteur ; les juges du fond avaient par ailleurs souligné que tout risque de confusion avec l'œuvre originale était écarté puisque le format de la toile différait et que la mention « copie » avait été spontanément apposée au dos de celle-ci.
En définitive, il nous semble que la confiscation voire la destruction du support de la contrefaçon auraient représenté des mesures correctives plus cohérentes au regard du droit d'auteur et des finalités mêmes de l'article L. 333-1-4 précité, de manière à faire cesser les atteintes aux droits privatifs de l'auteur. L'article 3 de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique [15] autorise d'ailleurs une juridiction pénale à prononcer la confiscation ou la remise au plaignant, y compris en cas de non-lieu ou de relaxe, à l'encontre d'œuvres saisies qui constituent des faux artistiques ; ainsi que la cour d'appel de Paris a eu l'occasion de le rappeler, la mesure de destruction a alors le caractère « d'une véritable mesure de sûreté ayant un caractère réel et destiné non à punir mais à mettre fin à une situation de nature à troubler l'ordre public » [16].
Au demeurant, l'on comprend mal les raisons pour lesquelles, « au regard des circonstances de la cause », la destruction aurait pu paraître disproportionnée. Outre que cette mesure corrective est expressément prévue par les textes, aucun argument de droit ou de fait ne nous semble pouvoir justifier qu'un support définitivement jugé contrefaisant soit ménagé de la sorte ; à l'instar du tribunal en première instance, de nombreuses juridictions ont d'ailleurs jugé qu'il s'agit de la seule mesure « de nature à prévenir tout risque de remise de l'œuvre contrefaisante dans les circuits commerciaux » [17]. Si la nature contrefaisante du tableau en cause avait dû faire l'objet d'un doute quelconque, il aurait appartenu aux juridictions de débouter purement et simplement les demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve de la contrefaçon. Enfin, s'agissant du propriétaire lésé, il est vraisemblable qu'il serait recevable et bien fondé à solliciter l'annulation de la vente en raison d'une erreur sur la chose au regard de la législation locale [18].
III. La mention « REPRODUCTION » également en question
La cour d'appel de Paris précise que la mention « REPRODUCTION » devra être apposée « de manière visible à l'œil nu et indélébile » au dos du tableau jugé contrefaisant. Cette expression constitue un emprunt manifeste aux dispositions de l'article 9 du décret du 3 mars 1981, dit « Marcus » [19] aux termes duquel « tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une œuvre d'art originale […], exécuté postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention "Reproduction" ». L'article 6.4 « REPRODUCTION » du Code déontologique des fonderies d'art précise quant à lui que « toute reproduction exécutée conformément aux dispositions [du] décret [Marcus] devra obligatoirement comporter, de façon visible, lisible et indélébile, sur une partie apparente de la pièce, la mention "REPRODUCTION", suivi du millésime de la fonte en quatre chiffres ». Dès lors, à défaut d'apposition de la mention « REPRODUCTION » de manière visible et immédiatement lisible sur une statue, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation au titre de la contrefaçon [20].
En l'espèce, il reste néanmoins permis de s'interroger sur l'opportunité de recourir à la mention « REPRODUCTION », s'agissant d'une œuvre d'art picturale. En effet, en matière de fonderie d'art, la notion de « reproduction » s'entend par opposition aux appellations « PIÈCE UNIQUE », « ORIGINAL » et « MULTIPLES » : la « reproduction » désigne ainsi un exemplaire qui a été réalisé au-delà du tirage prévu mais reste conforme au support initial de l'œuvre. Cette notion peut donc désigner une sculpture authentique et conforme au modèle original mais qui a été réalisée en surnuméraire.
Or, en l'espèce, la motivation retenue par l'arrêt du 15 février 2019 rendu par la cour d'appel de Paris laisse peu de doute quant au fait que le tableau litigieux est, au mieux, une « mauvaise copie ». Il n'est certainement pas authentique et ne constitue pas la reproduction fidèle de l'œuvre originale conservée au Centre Georges Pompidou. Pour cette raison, l'appellation « REPRODUCTION » nous semble devoir être considérée comme potentiellement déceptive, comme renvoyant à une notion en vigueur dans le marché de l'art ; polysémique et relativement neutre, elle n'informe pas suffisamment clairement les tiers que l'œuvre sur laquelle elle est apposée n'est ni plus ni moins qu'une contrefaçon. Afin d'éviter toute confusion avec les usages en matière de fontes d'art, il aurait pu lui être préféré des appellations plus explicites telles que « COPIE », « FAUX ARTISTIQUE » [21] voire « CONTREFAÇON ».
Plus généralement, il nous aurait semblé bienvenu que les références de la décision ayant définitivement retenu son caractère contrefaisant soient également mentionnées de manière visible et indélébile au dos du tableau litigieux. Après tout, le procès ne fait-il pas désormais partie intégrante de son histoire ? Il est en tout cas important que les tiers puissent prendre aisément connaissance des décisions de justice dont il a fait l'objet.
NDLR : Les auteurs tiennent à remercier Thibaud Pont-Nourat pour ses recherches.
[1] Dit Comité Marc Chagall.
[2] Devenu entre-temps le tribunal judiciaire de Paris.
[3] TGI Paris, 3ème, 23 mars 2017, n° 13/00100 (N° Lexbase : A8670U9Y). Le même jour, le même tribunal a prononcé une mesure identique à l'encontre d'un autre tableau faussement attribué à Marc Chagall : TGI Paris, 3ème ch., 23 mars 2017, n° 10/00800 (N° Lexbase : A8659U9L).
[4] CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 15 février 2019, n° 17/15550 (N° Lexbase : A2452YX4), ayant infirmé sur ce point le jugement rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris.
[5] Pour des exemples de destructions de tableaux : TGI Paris, 3ème ch., 15 février 2008, n° 06/01101 (N° Lexbase : A2320EEN) – TGI Paris, 3ème ch., 8 octobre 2010, n° 08/10520 (N° Lexbase : A7417GPE) – TGI Paris, 3ème ch., 26 février 2016, n° 13/01053 (N° Lexbase : A1055Q79).
[6] Pour un exemple, CA Paris, 4ème ch., sect. A, 9 décembre 1998, n° 1997/19457 (N° Lexbase : A9097IIR).
[7] TGI Paris, 3ème ch., 23 mars 2017, n° 13/0100, préc., ayant ordonné la remise de l'œuvre aux ayants droit « en vue de sa destruction par huissier sauf meilleur accord entre les parties ».
[8] Entre, d'une part, les droits licites des ayants droit de Marc Chagall et la protection des œuvres artistiques et, d'autre part, le droit de propriété sur le support matériel du tableau litigieux.
[9] Toutefois, il reste permis de s'interroger sur le point de savoir si une telle mise en balance des intérêts ne relève pas par nature de l'office et de la mission du juge dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de la proportionnalité des mesures qu'il est amené à prononcer…
[10] CPI, art. L. 615-7-1 (N° Lexbase : L1825H3Y), L. 722-7 (N° Lexbase : L0367LTR) et L. 521-8 (N° Lexbase : L1800H33).
[11] Cf. article 10 (mesures correctives).
[12] C'est-à-dire invisible.
[13] CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 5 juin 2013, n° 09/14183 (N° Lexbase : A1287KGR).
[14] Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-82.682, inédit (N° Lexbase : A5285CR8).
[15] Loi incriminant le fait d'apposer frauduleusement le nom ou la signature d'un artiste sur une œuvre de peinture, sculpture, de dessin, de gravure et de musique dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur.
[16] CA Paris, 24 juin 1988 – Également concernant une mesure de destruction sur le fondement des dispositions de la loi du 9 février 1895 : Cass. crim., 26 octobre 1965, n° 64-92.130, publié (N° Lexbase : A1046CKX).
[17] CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 12 juin 2013, n° 11/17461 (N° Lexbase : A5352MTE) – CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 26 juin 2013, n° 12/00602 (N° Lexbase : A7675KHQ) – TGI Paris, 26 mai 2016, n° 15/07167 (N° Lexbase : A6932RR8) – TGI Paris, 23 mars 2017, n° 10/00800, préc..
[18] Sous réserve de prescription évidemment.
[19] Décret n° 81-255, du 3 mars 1981, sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection (N° Lexbase : L1604AZG).
[20] CA Paris, 4ème ch., sect. B, 5 mars 2004, n° 2003/12231 (N° Lexbase : A6621DC9).
[21] Au sens de la loi précitée du 9 février 1895 même si, s'agissant d'une incrimination pénale, elle n'a pas été tranchée par le juge civil.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479756
[Pratique professionnelle] Indemnité inflation : modalités de versement
Lecture: 1 min
N9798BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Quentin Frisoni, Avocat associé et Estelle Belhassen, Apprentie, cabinet Factorhy Avocats
Le 16 Décembre 2021


© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479798
[Focus] L’indemnisation du Déficit fonctionnel permanent au prisme de la jurimétrie
Lecture: 16 min
N9792BYC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Quézel-Ambrunaz, Professeur à l’Université Savoie Mont Blanc, Centre de recherches en droit Antoine Favre, membre de l’Institut Universitaire de France
Le 16 Décembre 2021
Mots-clés : dommage corporel • poste de préjudice • déficit fonctionnel permanent (DFP) • nomenclature « Dintilhac » • jurimétrie • étude mathématique et statistique
Le présent article se propose de donner des repères et offrir des recommandations quant à l’évaluation d’un poste de préjudice en matière de dommage corporel, le déficit fonctionnel permanent, du point de vue de la jurimétrie, c’est-à-dire de l’emploi de méthodes mathématiques, notamment statistiques, d’étude des phénomènes juridiques. En particulier, il exploite et approfondit les données d’une étude intitulée « Demandes, Offres, décisions en matière de dommage corporel », librement accessible, à laquelle il est renvoyé pour les aspects méthodologiques (Ch. Quézel-Ambrunaz. Demandes, offres, décisions en matière de dommage corporel : étude statistique, 2021, 〈hal-03246155〉). Il peut simplement être rappelé qu’elle s’appuie sur l’analyse manuelle de 307 décisions de première instance des années 2019, 2020, et des premiers mois de 2021.
La présentation, poste par poste, des résultats de cette étude, par son propre auteur, à travers une série de focus intégrant chacun des analyses et des graphiques inédits, se poursuivra, selon un rythme mensuel, dans les prochaines publications de la revue Lexbase Droit privé.
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) est un poste subi après la date de consolidation, et de nature extrapatrimoniale. La nomenclature dite « Dintilhac » donne trois aspects à ce poste — c’est une « trinité » [1] :
- les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime ;
- la douleur permanente qu’elle ressent ;
- la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien.
Lorsque l’on compare, comme dans le graphique ci-dessous, l’indemnisation moyenne pour les différents postes de préjudice extrapatrimoniaux de la victime directe, il apparaît nettement que le DFP est le poste pour lequel l’indemnisation est la plus élevée : raison de plus pour lui porter une grande attention [2].

Au-delà de la moyenne, il s’agit d’un poste dans lequel les indemnisations, comme les offres et les demandes, peuvent être extrêmement élevées, et atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. En revanche, pour ce poste, la conflictualité n’est pas très intense, si l’on entend par là que les offres sont assez satisfaisantes par rapport aux demandes, de même que les décisions.
Le graphique ci-dessous utilise des « boîtes à moustaches » permettant d’illustrer ces deux constats. Cette représentation procède par répartition des décisions en quatre quartiles, selon le montant d’indemnisation alloué. Le rectangle (la boîte), représente les deux quartiles centraux, autour de la ligne horizontale, figurant la médiane. Les « moustaches » prolongent l’étendue de la boîte au maximum de 1,5 fois. Les points « hors moustaches » sont donc remarquablement éloignés de ce qui est habituellement observé.
Sur ce graphique, il est possible de remarquer tout d’abord que les boîtes liées aux demandes, aux offres, et aux décisions, se recoupent largement : nombre de demandes trouvent pleine satisfaction, si ce n’est dans l’offre, au moins dans la décision. En observant le sommet des boîtes, traçant la frontière entre le troisième et le quatrième quartile (en-dessous se placent les trois quarts des décisions), il est possible de remarquer qu’il se situe à un niveau relativement modeste, mais qui est multiplié par 7 voire par 10 pour les demandes, offres, ou décisions les plus élevées. Le poste du DFP admet donc une amplitude considérable dans son chiffrage.

Ces faits s’expliquent par le mode de chiffrage du DFP, qui invite, malgré une apparente personnalisation selon la sévérité de l’atteinte et l’âge de la victime, à une standardisation de la manière d’évaluer son préjudice.
En pratique, le médecin expert fixe, à l’aide d’un barème médico-légal, un taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP). Cette AIPP est définie, selon la mission d’expertise type de l’AREDOC et selon le comité scientifique du barème du concours médical [3], comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Ainsi, le barème du Concours médical indique un taux de 85 % pour la cécité absolue, de 45 à 50 % pour l’amputation haute de cuisse bien appareillée, de 15 à 20 % pour un diabète simple bien équilibré par le traitement…
En apparence, la définition de l’AIPP apparaît donc cohérente avec le contenu du DFP, ce qui amène les assureurs à affirmer que tout est dans le taux, et notamment les souffrances permanentes [4]. Pourtant, un hiatus semble évident : par les adverbes « normalement », « habituellement », et « objectivement », la définition de l’AIPP indique une appréciation in abstracto ; alors que les deux derniers aspects du DFP supposent une évaluation in concreto. Dès lors, le taux d’AIPP ne peut être le véritable étalon médico-légal de toutes les victimes, pour ce qui est de l’évaluation du DFP [5].
Deux solutions sont envisageables pour préserver les principes, notamment celui de la réparation intégrale : soit l’expert majore le score du DFP pour tenir compte de son appréciation in concreto des répercussions de l’atteinte sur la victime, soit il décrit indépendamment douleurs, perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence, et le jugement ou la transaction devront en tenir compte — ou, du moins, pour le jugement, répondre aux conclusions de la victime en ce sens [6]. Il est donc absolument essentiel, et les avocats gagneraient à demander à ce que cela soit inscrit dans les missions d’expertise, que l’expert détaille ce qu’il inclut, ou non, dans le taux qu’il retient.
Le référentiel d’indemnisation des cours d’appel propose une méthode pour traduire le pourcentage retenu par l’expert. Un tableau à double entrée indique, par plages d’âge de la victime au jour de la consolidation et de taux de DFP, un « prix du point ». Multiplié par le nombre de points de DFP, ce prix donne une indication du montant pouvant être alloué pour cette victime. Le prix du point augmente avec la sévérité de l’atteinte, et diminue avec l’âge de la victime : à âge égal, la victime la plus lourdement handicapée est mieux indemnisée, et à séquelles identiques, la victime la plus jeune reçoit l’indemnisation la plus importante.
Tableau du prix, en euros, des points d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent [7] :
| 2020 | 0 à 10 ans | 11 à 20 ans | 21 à 30 ans | 31 à 40 ans | 41 à 50 ans | 51 à 60 ans | 61 à 70 ans | 71 à 80 ans | ≥ 81 ans |
| 1 à 5 % | 2310 | 2150 | 1960 | 1770 | 1580 | 1400 | 1210 | 1050 | 880 |
| 6 à 10 % | 2670 | 2475 | 2255 | 2035 | 1800 | 1560 | 1320 | 1130 | 935 |
| 11 à 15 % | 3025 | 2800 | 2550 | 2300 | 2025 | 1730 | 1430 | 1210 | 990 |
| 16 à 20 % | 3380 | 3135 | 2850 | 2560 | 2245 | 1890 | 1540 | 1290 | 1045 |
| 21 à 25 % | 3740 | 3465 | 3145 | 2830 | 2465 | 2060 | 1650 | 1375 | 1100 |
| 26 à 30 % | 4100 | 3795 | 3445 | 3090 | 2685 | 2220 | 1760 | 1455 | 1155 |
| 31 à 35 % | 4455 | 4125 | 3740 | 3355 | 2905 | 2390 | 1870 | 1540 | 1210 |
| 36 à 40 % | 4810 | 4455 | 4035 | 3620 | 3125 | 2550 | 1980 | 1620 | 1265 |
| 41 à 45 % | 5170 | 4785 | 4335 | 3885 | 3345 | 2715 | 2090 | 1705 | 1320 |
| 46 à 50 % | 5530 | 5115 | 4630 | 4150 | 3565 | 2880 | 2200 | 1790 | 1375 |
| 51 à 55 % | 5885 | 5445 | 4930 | 4410 | 3785 | 3045 | 2310 | 1870 | 1430 |
| 56 à 60 % | 6240 | 5775 | 5225 | 4675 | 4005 | 3210 | 2420 | 1950 | 1485 |
| 61 à 65 % | 6600 | 6105 | 5520 | 4940 | 4225 | 3375 | 2530 | 2035 | 1540 |
| 66 à 70 % | 6955 | 6435 | 5820 | 5205 | 4445 | 3540 | 2640 | 2115 | 1595 |
| 71 à 75 % | 7315 | 6765 | 6115 | 5470 | 4665 | 3705 | 2750 | 2200 | 1650 |
| 76 à 80 % | 7670 | 7095 | 6415 | 5730 | 4885 | 3870 | 2860 | 2280 | 1705 |
| 81 à 85 % | 8030 | 7425 | 6710 | 5995 | 5105 | 4035 | 2970 | 2365 | 1760 |
| 86 à 90 % | 8385 | 7755 | 7005 | 6260 | 5325 | 4200 | 3080 | 2445 | 1815 |
| 91 à 95 % | 8745 | 8085 | 7305 | 6525 | 5545 | 4365 | 3190 | 2530 | 1870 |
| 96 % plus | 9020 | 8415 | 7600 | 6785 | 5765 | 4530 | 3300 | 2610 | 1925 |
Ainsi, pour une victime de 41 ans au jour de la consolidation, avec un DFP de 64 %, le référentiel, dans sa version actuelle, donne un prix du point à 4225 euros, soit une indemnisation de 4225 x 64 = 270 400 euros.
Cette estimation n’est qu’indicative, dans la mesure où le référentiel lui-même a cette caractéristique — d’ailleurs, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond n’ont pas à s’expliquer sur la valeur du point qu’ils retiennent [8]. La qualité de cette évaluation dépend de la qualité du référentiel lui-même, et de la qualité de la détermination du taux de DFP. Pour ce qui est du taux de DFP, il a déjà été souligné qu’il est dépourvu de sens s’il n’intègre pas une appréciation in concreto des retentissements sur la sphère personnelle de la victime. Pour ce qui est du référentiel, il a pu lui être reproché des effets de seuil (selon les âges comme selon les taux), et une mauvaise prise en compte de la durée prévisionnelle de la vie de la victime — donc du temps pendant lequel le préjudice sera subi [9].
Au crible des statistiques, il s’avère que le référentiel a un potentiel prescriptif extrêmement élevé [10]. Le tableau suivant représente la répartition des décisions étudiées selon le rapport entre le montant alloué, et le référentiel. À 100 %, le juge a donné exactement ce que prévoyait le référentiel.
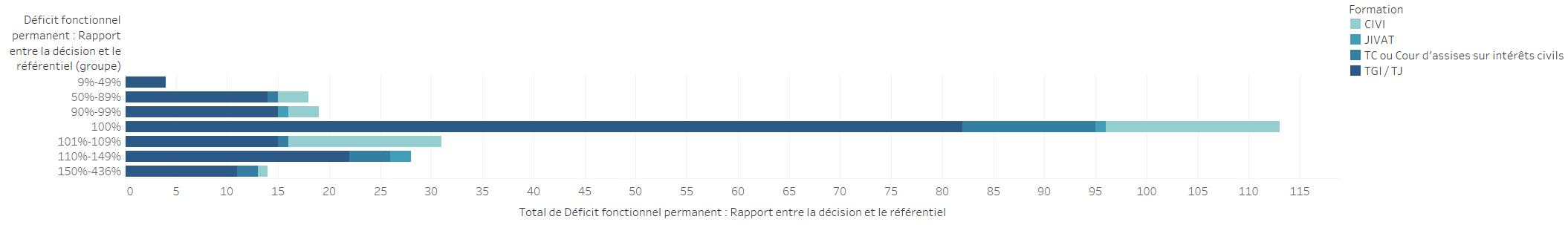
Il s’avère que l’indemnisation au point selon le référentiel — qui est prévu pour les cours d’appel — est très pratiquée en première instance, quelle que soit la juridiction. Les quelques décisions statuant très en-dessous le font souvent pour cause de décès de la victime entre la consolidation et la décision, ce qui amène à une proratisation de l’indemnisation. Certaines des décisions proches de 110 % ont intégré la revalorisation de 10 % de l’ensemble des points de DFP à l’automne 2020. Cette revalorisation a été justifiée par l’évolution des pratiques indemnitaires des cours d’appel ; néanmoins, lorsqu’un outil prétend s’appuyer sur une pratique qu’il contribue lui-même à définir, une circularité s’installe, de telle sorte que toute évolution suppose soit que la pratique s’émancipe de l’outil — ce qui ne semble pas être le cas ici — soit que l’outil évolue de manière arbitraire. L’attention des plaideurs doit être attirée sur la nécessité d’utiliser des référentiels à jour, et sur le fait que, le juge ne pouvant statuer ultra petita, une demande formulée au niveau d’un référentiel dans les dernières conclusions ne peut être réévaluée à la hausse par le juge si le référentiel évolue avant le jugement — toutefois, alors même que pleine satisfaction aurait été obtenue en première instance, la demande peut être réévaluée en cause d’appel en raison de l’évolution du prix du point [11].
La raison de cette attraction de la jurisprudence vers le calcul au point n’est peut-être pas tant à rechercher dans la psychologie du juge, que dans le comportement des conseils de victimes. Une part de ceux-ci, en effet, choisissent de formuler leurs demandes sur les données du référentiel.
Le graphique suivant place, sur l’axe horizontal, le rapport entre la demande et le référentiel, et sur l’axe vertical, le rapport entre la décision et le référentiel. Chaque cercle représente une décision, les chiffres les accompagnant indiquant le taux de DFP retenu par la décision. Les bandes grisées représentent les deux quartiles centraux, des demandes comme des décisions.

Apparaît un amas de décisions autour, ou exactement sur le point où convergent demandes et décisions à 100 % du référentiel. En s’éloignant vers la droite, les offres excèdent de plus en plus le référentiel : les cercles qui sont alors sur l’axe horizontal indiquent les décisions dans lesquelles le juge n’a fait droit à la demande qu’à hauteur du référentiel ; dans le cadrant supérieur droit, se trouvent les décisions qui accordent plus que le référentiel — pour peu que cela ait été demandé. Ces décisions concernent surtout des taux modestes de DFP.
En tout état de cause, une demande excédant le calcul du référentiel ne semble pas avoir fréquemment d’effets adverses, en ce sens qu’il est très rare que les juges allouent moins que ce qu’offrirait le référentiel, alors qu’une somme plus conséquente était demandée.
En affinant l’étude par ressort de tribunal, il est possible de constater que le critère géographique est important, pour l’adéquation des décisions au référentiel — mais ce n’est pas tant une politique de ressort de tribunal, qu’une politique de barreau ou de cabinets d’avocats implantés sur la place !
Le graphique ci-dessous reprend pour les ressorts de tribunaux les mieux documentés dans l’étude précitée (présentés par ordre décroissant de décisions étudiées), les rapports entre la demande et le référentiel d’une part, entre la décision et le référentiel d’autre part. Devant les tribunaux de Lyon, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Créteil, Grenoble, Nice, l’indemnisation du DFP est plaidée à la hauteur du point du référentiel. Les juges, qui ne sauraient statuer ultra petita, accordent donc souvent exactement le référentiel. À Caen, à Toulon, ou à Bourges, les demandes vont au-delà du référentiel, ce qui permet aux décisions de faire de même. En d’autres termes, les juges sont enclins à indemniser au-delà du référentiel, pour peu qu’on ne leur demande de procéder ainsi !
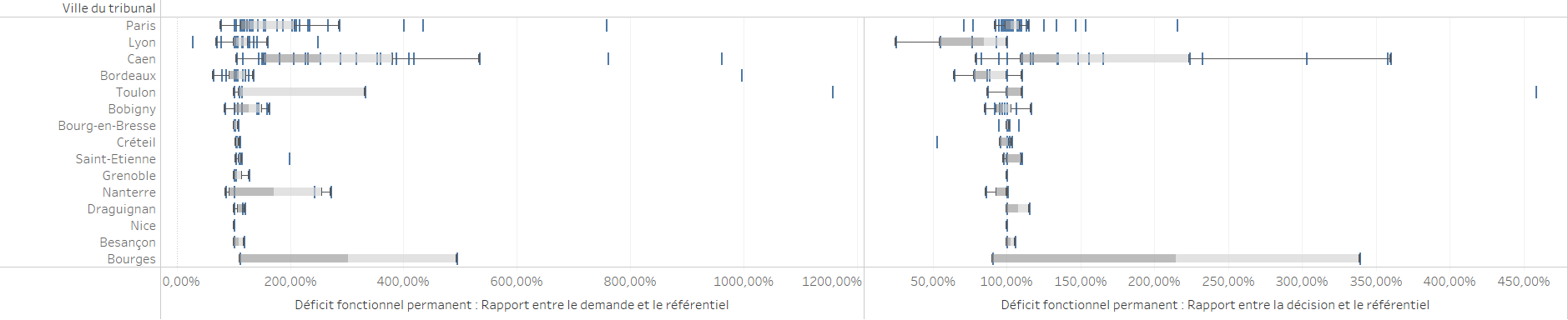
L’impression de dérogation plus aisée pour les faibles taux de DFP se confirme si l’on met en regard le taux de DFP, et le rapport entre la décision et le référentiel. En faisant apparaître une distinction selon le genre de la victime, il s’avère que, sur l’échantillon étudié, les hommes obtiennent plus facilement une décision excédant le référentiel que les femmes : toutes choses égales par ailleurs (et les cas dans lesquels les victimes sont décédées avant la décision ont été volontairement retirés), les femmes sont donc moins bien indemnisées que les hommes sur ce poste.

À la lecture des décisions, il apparaît que les arguments présentés au soutien d’une indemnisation supérieure au référentiel sont de deux ordres. Certains demandeurs font valoir que l’évaluation au point du déficit fonctionnel permanent ne permet d’indemniser que les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, et que les souffrances endurées, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, nécessitent une indemnisation allant au-delà de cette évaluation au point. D’autres établissent un prix de journée, qu’ils capitalisent pour la vie entière de la victime, à compter de la décision.
Cet argument d’un prix de journée est intéressant, car il permet la comparaison avec le Déficit fonctionnel temporaire, le DFT, qui est l’équivalent du DFP pour la période précédent la consolidation. Encore faut-il souligner que cette équivalence n’est pas terme à terme : sans sa version temporaire, le déficit fonctionnel intègre le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément, mais pas les souffrances endurées, qui sont indemnisées séparément [12]. Le prix de journée du DFT total oscille souvent entre 25 et 35 euros. A été calculé, et est reporté sur ce tableau, le prix du point du DFP par jour d’espérance de vie — il convient de le multiplier par 100 pour avoir une idée proche d’un DFP « total », quoique l’opération soit délicate puisque, ainsi que le montre le graphique et le suppose le tableau du référentiel, le prix du point augmente avec la sévérité de l’atteinte. Il apparaît néanmoins que seul un quart des décisions excède 0,17 euros par point et par jour d’espérance de vie. Là encore, revient, dans la courbe de tendance, la sous-indemnisation des femmes par rapport aux hommes. Elle est ici exacerbée, dans la mesure où le tableau du référentiel n’est pas genré, alors que les femmes ont une espérance de vie plus longue que celle des hommes.

Lorsque ce prix du point de DFP par jour d’espérance de vie est mis en rapport avec l’âge de la victime directe au jour de la consolidation, comme dans le graphique ci-dessous, il apparaît que cette valeur croît avec l’âge de la victime. Il faut tout de suite préciser que la sévérité des atteintes, en termes de taux de DFP, décroît au contraire avec l’âge de la victime, dans l’échantillon étudié — en intégrant le fait que le prix du point s’élève avec la sévérité de l’atteinte, le constat est donc renforcé : toutes choses égales par ailleurs, les victimes âgées sont mieux indemnisées que les victimes jeunes, par rapport à leur espérance de vie résiduelle.

| Pour résumer, il peut être déduit de cette étude jurimétrique les points suivants.
|
[1] C. Bernfeld, F. Bibal, Présentation : le déficit fonctionnel permanent, une trinité, Gaz. Pal. 3 déc. 2011, p. 6.
[2] Pour un panorama des questions essentielles : C. Bernfeld, Fiche pratique XV : Le déficit fonctionnel permanent, Gaz. Pal. 31 janv. 2009, p. 43.
[3] Mission d’expertise type de l’AREDOC [en ligne] ; Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, Le concours médical, 2003, p. 11.
[4] Djadoun W., Bessieres-Roques I., De l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) au Déficit fonctionnel permanent (DFP), La Revue Française du Dommage Corporel 2020, | N° 3 | Page(s) : 251-66
[5] Voyez aussi les réflexions de G. Wester, Les principes de la réparation confrontés au dommage corporel, th. Lyon III, 2021, n° 140, et du Docteur E. Tordjman, Pour une épistémologie de l’expertise médicale : de Galilée aux barèmes médicaux d’invalidité, Gaz. Pal., 14 mai 2019, p. 76.
[6] Cass. civ. 2, 29 juin 2017, n° 16-17.864, F-D (N° Lexbase : A7020WLL) : cassation d’un arrêt qui a statué sans répondre aux conclusions de la victime qui faisait valoir que l’expert avait fixé le taux de déficit fonctionnel permanent sans tenir compte des souffrances permanentes qu’il avait par ailleurs évaluées.
[7] B. Mornet, L’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès, Septembre 2021.
[8] Cass. crim., 13 juin 2017, n° 15-84.845, FS-D (N° Lexbase : A2307WIB).
[9] Alice Barrellier. Le DFP est mal en point. État des lieux critique des outils d’évaluation des préjudices consécutifs à un dommage corporel, Déc. 2020, Chambéry (visioconférence), France. 〈halshs-03118680〉.
[10] Voyez aussi la réflexion sur la standardisation induite par le référentiel, G. Wester, Les principes de la réparation confrontés au dommage corporel, th. Lyon III, 2021, n° 190 et s..
[11] Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-24.220, F-D (N° Lexbase : A1402WX9).
[12] A. Guégan, La distinction de préjudices temporaires et permanents : l’exemple du déficit fonctionnel, Gaz. Pal. 27 décembre 2014, n° 203e9, p. 28.
[13] Proposant une indemnisation distincte des souffrances permanentes, C. Bernfeld, Le DFP inclut-il toujours les souffrances endurées post-consolidation ?, Gaz. Pal. 19 janv. 2021, n° 395a5, p. 69. Voyez aussi S. Van Teslaar, L’évaluation du déficit fonctionnel permanent, Gaz. Pal. 7 nov. 2017, n° 306j2, p. 65. Il semble prudent de ne pas en faire un poste autonome, mais bien un sous-poste : l’indemnisation en tant que poste autonome a pu être refusée, Cass. civ. 2, 5 février 2015, n° 14-10.097, F-P+B (N° Lexbase : A2429NBL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479792
[Brèves] Inapplication de la loi du 5 juillet 1985 à l’accident causé par une moissonneuse-batteuse à l’arrêt, en position de maintenance
Réf. : Cass. civ. 2, 9 décembre 2021, n° 20-14.254, FS-B (N° Lexbase : A48167E4)
Lecture: 3 min
N9819BYC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 21 Décembre 2021
► Ne relève pas de la loi du 5 juillet 1985, l’accident causé par une moissonneuse-batteuse qui, au moment de l’accident, ne circulait pas, et qui ne se trouvait plus en fonction de fauchage, mais en position de maintenance.
Faits et procédure. Consacrant un véritable droit à indemnisation au profit des victimes d’un accident de la circulation, l’application de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) constitue indéniablement un avantage pour la victime de l’accident. L’identification du domaine d’application de cette loi, fixé par l’article 1er de cette dernière, a donc une importance majeure. Or, la jurisprudence opte pour une approche extensive de ce domaine d’application, en retenant une définition large de la notion de « circulation ». C’est ainsi que la loi a vocation à s’appliquer lorsque le véhicule est en mouvement, est à l’arrêt ou en stationnement lors de l’accident. Mais qu’en est-il lorsqu’au moment de l’accident, le véhicule n’est pas position de déplacement mais que le moteur fonctionne afin de permettre l’usage d’autres fonctions ? Connue, la question vient de se poser s’agissant d’une moissonneuse-batteuse dont le moteur, au moment de l’accident, fonctionnait mais non pour permettre à l’engin de faucher et de se déplacer, mais exclusivement pour faire fonctionner une vis, laquelle était seule à l’origine de l’accident.
Solution. L’arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la deuxième chambre civile rejette le pourvoi avec luxe de détails et exclut ainsi l’application de la loi du 5 juillet 1985. Quant aux principes dont il se fait l’écho, ceux-ci sont connus : au moment de l’accident le véhicule ne circulait pas, ne procédait à aucune coupe, il « ne se trouvait manifestement plus en action de fauchage, mais en position de maintenance de l’un de ses outils et […] la fonction de déplacement de l’engin était totalement étrangère à la survenue de l’accident, peu important à cet égard que le moteur ait été en fonctionnement ou que le conducteur ait été présent sur son siège ». Ce faisant, la cour d’appel ayant, dans son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve, mis en évidence que « l’accident était exclusivement en lien avec la fonction d’outil de la moissonneuse-batteuse et aucunement avec sa fonction de circulation, dès lors que la machine ne se trouvait plus en action de fauchage, mais en position de maintenance de la vis sans fin », doit être approuvée d’avoir exclu l’application de la loi de 1985. Ainsi, cette dernière ne s’applique pas lorsqu’au moment de l’accident, le véhicule était utilisé pour une autre fonction que la fonction de déplacement (v. M. Bacache-Gibeili, Les obligations. – La responsabilité civile extracontractuelle, Economica, 3e éd., 2016, n° 678). La solution ainsi retenue en rappelle d’autres : la jurisprudence avait déjà considéré que ne constituait pas un accident de la circulation le dommage causé par la benne basculante d’un camion à l’arrêt (Cass. civ. 2, 9 juin 1993, n° 91-12.452, publié au bulletin N° Lexbase : A5588ABL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479819
[Brèves] De la force probante d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice permettant de prouver l’existence d’une faute d’une gravité suffisante d’un salarié protégé
Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 8 décembre 2021, n° 439631, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95917EX)
Lecture: 2 min
N9802BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 21 Décembre 2021
► Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; la constatation des faits reprochés au salarié par un procès-verbal établi par un huissier de justice fait foi jusqu’à preuve contraire et des attestations de salariés en confrontation de ce procès-verbal ne sauraient créer un doute profitant au salarié.
Les faits et procédure. Un inspecteur du travail a refusé d’accorder une autorisation de licenciement d’un salarié qui détenait des mandats de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel d’une unité économique et sociale. La décision a été annulée par la ministre du Travail et le salarié a alors porté le litige devant la juridiction administrative.
La cour administrative d’appel (CAA Paris, 8ème ch., 30 janvier 2020, n° 18PA03654 N° Lexbase : A87193CW), pour annuler la décision de la ministre a retenu, après avoir confronté un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 20 février 2017 produit par la société, duquel il résultait que le salarié avait participé aux incidents survenus lors du dépouillement d'un scrutin professionnel portant sur la révocation du mandat de certains élus organisé sur le fondement des articles L. 2314-29 (N° Lexbase : L8481LG9) et L. 2324-27 (N° Lexbase : L9785H8W) du Code du travail, aux attestations de salariés fournies par le salarié, qu'un doute subsistait quant à sa participation aux incidents litigieux et que ce doute devait lui profiter.
Annulation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel. En statuant ainsi, alors pourtant qu'il résultait des termes mêmes de son arrêt que la preuve contraire au sens des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers (N° Lexbase : L8061AIE), n'était pas rapportée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
| Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, La vérification de la réalité et du sérieux des motifs du licenciement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9573ESD). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479802
[Jurisprudence] Refus de la déduction des frais d’avocat et d’instance relatifs à la cession de titres sociaux
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 28 septembre 2021, n° 440987, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6508478)
Lecture: 10 min
N9767BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sabrina Le Normand-Caillère, Maître de conférences HDR en droit privé à l’Université d’Orléans, Co-directrice du Master 2 Droit des affaires et fiscalité et du DU « Fiducie : former les acteurs de demain »
Le 15 Décembre 2021
Mots-clés : TVA • holding mixte • frais d'avocat
À l’occasion d’une décision rendue le 28 septembre 2021, le Conseil d’État est revenu sur la délicate question de la notion de frais généraux en matière de TVA déductible. Publié au recueil Lebon, cet arrêt mérite attention.
En l’espèce, une personne physique, substituée par la suite par une société (SARL Saint-Exupéry Holding) s’est engagée à céder ses parts sociales, représentant l’intégralité du capital social de la société Westwings, à la société Metland, filiale de la société PSP, pour un prix de 2 400 000 euros. Cette contrepartie s’est réalisée en deux temps : d’une part, par la remise de 1 800 actions de la société Metland d’une valeur de 960 000 euros en contrepartie de l’apport à cette dernière de 400 actions de la société Westwings, la société PSP s’étant engagée à racheter les actions au terme d’un délai de trois années ou immédiatement après la rupture du contrat de travail de celui-ci ; d’autre part, par le versement d’une somme de 1 400 000 euros, correspondant à la vente des 600 autres actions de la société Westwings, en partie sous forme de distributions de dividendes par la société Metland pour un paiement de 800 000 euros payable en douze mensualités. À l’occasion de ces opérations, la société a exposé des frais d’avocats et d’instance. L’administration fiscale a remis en cause la déduction de la TVA ayant grevé ces frais, position confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg mais annulée par la cour administrative d’appel de Nancy. Le ministre de l’Économie et du Budget s’est donc pourvu en cassation.
Saisi du litige, le Conseil d’État a ainsi dû rechercher si les frais d’avocats et d’instance occasionnés lors des différentes cessions de titres sociaux pouvaient ou non ouvrir droit à déduction.
Sur le fondement de l’article 168 de la Directive TVA et de l’article 271 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8605LZQ), les hauts magistrats ont rappelé dans un premier temps que la caractérisation d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est en principe nécessaire pour qu’un droit à déduction à la TVA soit reconnu à l’assujetti à la TVA. Ce droit à déduction grevant l’acquisition des biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, l’assujetti est toutefois autorisé à déduire de la TVA lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que tels, constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.
Dans un second temps, les hauts magistrats ont appliqué ces principes relatifs à l’ouverture du droit à déduction à l’affaire litigieuse. Ils ont annulé la décision de la cour administrative d’appel de Nancy. Celle-ci avait considéré que non seulement la cession des titres avait le caractère d’une opération purement patrimoniale mais également que cette société établissait que les frais d’avocat et d’instance qu’elle avait engagés en vue d’obtenir le paiement du solde du prix de cession de cette cession n’avaient pas été incorporés dans ce prix et partant, qu’elle était en droit de déduire la taxe ayant grevé ces dépenses au titre des frais généraux. Or, pour les hauts magistrats, elle ne pouvait admettre la déduction de ces frais alors qu’elle avait jugé que ces dépenses se rattachaient à une opération à caractère purement patrimonial située par nature hors du champ d’application de la TVA. Cela impliquait que par nature elles pouvaient présenter un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de la société holding assujettie à cette taxe. La cour d’appel a donc commis une erreur de droit en concluant à la déductibilité de la TVA qui a grevé les frais d’avocat et d’instance au seul motif qu’ils avaient été incorporés dans le prix de cession. En conséquence, l'arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.
Que faut-il en penser ?
Dans cette affaire, le Conseil d’État sanctionne les juges administratifs d’appel de ne pas avoir déduit les bonnes conséquences de leurs constatations. Selon les hauts magistrats, ces derniers ne pouvaient d’un côté reconnaître un caractère purement patrimonial à l’opération de cession de titres sociaux et d’un autre considérer que la TVA ayant grevé les dépenses était déductible au titre des frais généraux au motif que celles-ci n’avaient pu être incorporées dans le prix de cession des titres sociaux et qu’elle classait ces dépenses dans les frais préparatoires.
Pour bien comprendre la cassation, encore faut-il revenir sur la jurisprudence traditionnelle en la matière. Dans un arrêt de principe, la Cour de justice de l’Union européenne avait souligné la nécessité de caractériser l’existence d’un lien direct avec les opérations pour que le droit à déduction puisse s’exercer [1]. Ainsi, une cession de droits sociaux exonérée de TVA était en soi exclue du droit à déduction en dépit de l’affectation in fine de ces opérations à des opérations imposables. Ce n’est que 5 ans après que la Cour de justice a assoupli son analyse en autorisant la déduction des frais d’avocats engendrés par l’échec d’un rachat d’entreprise [2]. Pour les juges européens, ces dépenses constituaient des frais généraux faisant partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées. Cette dernière notion de « frais généraux » ouvrant droit à déduction a été par la suite appliquée aux opérations réalisées par des sociétés holdings dans le cadre de prise de participations dans une filiale [3], puis aux frais de cessions d’actions [4] et de restructurations du capital [5].
En l’espèce, les juges de la cour administrative d’appel avaient qualifié le caractère patrimonial de l’opération. Cela excluait de facto le caractère déductible des frais préparatoires à la cession aux opérations exposés par la société holding. En conséquence, aucun lien direct et immédiat avec l’activité économique ne pouvait donc être caractérisé entre l’activité taxable et la dépense réalisée. La qualification en opération patrimoniale de cette activité n’étonne guère en l’espèce : les frais exposés lors de la cession avaient été réalisés dans le cadre d’un litige visant à obtenir en justice l’exécution d’un protocole d’accord consistant non seulement au paiement des dividendes mais également l’exécution de la promesse de rachat de titres. L’opération de perception des dividendes étant hors du champ d’application de la TVA, cela excluait de facto toute déduction. Il en est de même de l’exécution de la promesse de rachat de titres sociaux, laquelle se rattache par nature à la qualité de simple détenteur de droits sociaux. L’objectif poursuivi par la société holding étant purement patrimonial, les dépenses de frais de cession de titres ne pouvaient donc en tant que telles ouvrir droit à déduction. L’objectif recherché par les parties étant en conséquence purement patrimonial, les dépenses en lien direct et immédiat ne pouvaient ouvrir droit à déduction de la TVA d’amont.
Dans sa décision, le Conseil d’État a pris position en faveur à l’absence d’immixtion de la société holding pour justifier la non-déduction des frais de cession de titres sociaux, et ce, contrairement à celle des juges du fond. En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de distinguer les holdings pures, non assujetties à la TVA, des holdings mixtes s’immisçant dans la gestion de leurs filiales car la cession s’inscrit dans le prolongement de son activité taxable. Dans l’arrêt AB SKF [6], la Cour de justice de l’Union européenne a toutefois neutralisé la portée de cette distinction en rendant déterminant le critère en amont de l’incorporation dans le prix de cession. Ainsi deux hypothèses distinctes peuvent se présenter : d’une part, si le prix de cession est incorporé dans le prix de cession, il ne peut être déduit dans la mesure où l’opération en aval n’est pas taxable ; d’autre part, si le prix de cession est une composante du prix de l’ensemble des services offerts par la holding dans le cadre de son activité économique, les frais de cessions de titres peuvent être déduits au titre des frais généraux.
En l’espèce, les éléments de preuve rapportés par les parties étaient insuffisants afin de caractériser l’immixtion de la société holding. Or, il est relevé que cette dernière avait engagé des frais d’avocat et d’instance en vue d’obtenir en justice le paiement du solde du prix de la cession de titres pour préserver les actifs nécessaires à la réalisation de son objet social. Pour les hauts magistrats, cet élément reste insuffisant pour caractériser une immixtion. En conséquence, les sociétés holdings doivent se montrer vigilantes quant aux preuves à rapporter en cas de contestation par l’administration fiscale de leur caractère animateur. Il faut qu’elles vérifient que ces éléments soient suffisants pour justifier une immixtion effective dans la gestion de leurs filiales.
Le motif relevé par la cour administrative d’appel tenant à la non-incorporation des dépenses dans le prix de cession des titres reste en pratique inopérant. Le caractère patrimonial de l’approche suivie par la holding l’emporte : si le fait que ces frais ne soient pas incorporés dans prix de cession est une condition nécessaire, elle reste néanmoins en pratique insuffisante. Traditionnellement, le Conseil d’État distingue en la matière entre les frais préparatoires de la cession et ceux de la transaction [7] : les premiers sont présumés faire partie des frais généraux mais l’administration fiscale a la possibilité de renverser cette présomption non seulement lorsque l’opération revêt un caractère patrimonial ou lorsque les dépenses litigieuses ont été incorporées dans le prix de cession ; quant aux seconds, ils sont présumés présenter un lien direct avec l’opération de cession mais cette présomption peut être renversée par la société holding s’il est établi que les dépenses litigieuses n’ont pas été incorporées dans le prix de cession.
En l’espèce, les dépenses supportées par la société holding n’intégraient aucune de ces deux catégories. Comme il a été mentionné par les hauts magistrats, les frais engagés sont intervenus a posteriori de la cession des titres sociaux et avaient pour seule finalité de permettre l’exécution de l’opération conformément aux clauses prévues dans le protocole d’accord. Ils en ont déduit très justement l’exclusion de la théorie des frais généraux dans cette affaire.
[1] CJCE, 6 avril 1995, aff. C-4/94, pt 19, BLP Group plc c/ Commissioners of Customs & Excise ([LXB=A9796AUD) : Rec. CJCE, 1995, I, p. 4177 ; Dr. fisc., 1995, n° 38, comm.1779 ; RJF, 6/1995, n° 804, concl. C. O. Lenz, p. 408. V. Ph. Derouin, Droit à déduction de la TVA et règle de l'affectation ; Dr. fisc., 1995, n° 38, comm. 100060.
[2] CJCE, 8 juin 2000, aff. C. 98/98, Midland bank.
[3] V. not. CJCE, 27 septembre 2001, aff. C-16/00, Cibo Participations SA (N° Lexbase : A5734AWB) : Dr. fisc. 2001, n° 47, comm. 1083 ; RJF, 12/2001, n° 1611.
[4] CJCE, 26 mai 2005, aff. C-465/03, Kretztechnik AG c/ Finanzamt Linz (N° Lexbase : A3969DIT) : Rec. CJCE, I, p. 4357 ; Dr. fisc. 2005, n° 44-45, comm. 720 ; RJF, 8-9/2005, n° 982 ; BDCF, 8-9/2002, n° 105, concl. F. G. Jacobs.
[5] CJCE, 29 octobre 2009, aff. C-29/08, AB SKF (N° Lexbase : A5614EMU) : Dr. fisc. 2009, n° 50, comm. 578, note Ph. Tournès ; RJF, 1/2010, n° 90.
[6] CJCE, 29 octobre 2009, aff. C-29/08, AB SKF précité : Dr. fisc. 2009, n° 50, comm. 578, note Ph. Tournès ; RJF 1/2010, n° 90.
[7] CE 3° et 8° ssr., 23 décembre 2010, n° 307698, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6971GNI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479767
[Brèves] Nouveau barème des saisies et cessions des rémunérations applicable à compter du 1er janvier 2022
Réf. : Décret n° 2021-1607, du 8 décembre 2021, révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations (N° Lexbase : L9036L9K)
Lecture: 1 min
N9753BYU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 15 Décembre 2021
► Un décret, publié au Journal officiel du 10 décembre 2021, revalorise le barème des saisies et cessions des rémunérations à compter du 1er janvier 2022.
L’article L. 3552-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0920H9X) fixe les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations.
Le présent décret modifie cet article et fixe cette fraction, à compter du 1er janvier 2022, de la manière suivante :
- 1/20, sur la tranche inférieure ou égale à 3 940 euros ;
- 1/10, sur la tranche supérieure à 3 940 euros et inférieure ou égale à 7 690 euros ;
- 1/5, sur la tranche supérieure à 7 690 euros et inférieure ou égale à 11 460 euros ;
- 1/4, sur la tranche supérieure à 11 460 euros et inférieure ou égale à 15 200 euros ;
- 1/3, sur la tranche supérieure à 15 200 euros et inférieure ou égale à 18 950 euros ;
- 2/3, sur la tranche supérieure à 18 950 euros et inférieure ou égale à 22 770 euros ;
- la totalité, sur la tranche supérieure à 22 770 euros.
Il convient de noter que ces tranches sont modifiées en fonction du nombre de personnes à la charge du débiteur.
Ces seuils, déterminés à l’article R. 3252-2 du Code du travail (N° Lexbase : L4254LU4), sont augmentés d’un montant de 1 520 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur présentation d’un justificatif présenté par l'intéressé.
Enfin, rappelons qu’il existe une fraction insaisissable ou incessible qui est égale au montant du revenu de solidarité active (RSA), dont le montant est fixé à 565,34 euros depuis le 1er avril 2021.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479753
