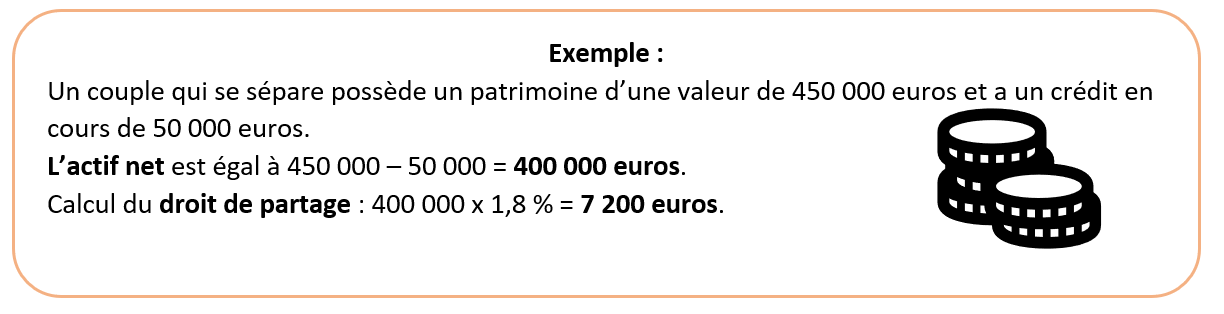[Brèves] Préjudice d’anxiété : application du revirement de jurisprudence de 2019 aux salariés déboutés en application de l’ancienne jurisprudence
Réf. : Ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814, P+R (N° Lexbase : A17864NH)
Lecture: 4 min
N7077BYR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 07 Avril 2021
► La prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, relève de l’office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours ; L’exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme ;
Cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l’effectivité de l’accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement ;
Partant, un moyen de cassation qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation l’ayant saisi est recevable lorsqu’un changement de norme est intervenu postérieurement à cet arrêt de cassation ;
En application de ce changement de position de la Cour de cassation, des salariés déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice d’anxiété en application de l’ancienne « jurisprudence amiante » pourront se voir appliquer les effets du revirement de jurisprudence opéré le 5 avril 2019 par l’Assemblée plénière.
Les faits et procédure. Un salarié, faisant valoir qu’il avait travaillé sur différents sites où il aurait été exposé à l’amiante, a présenté une demande additionnelle en paiement de dommages-intérêt en réparation d’un préjudice d’anxiété.
Par un arrêt du 1er avril 2015, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 1er avril 2015, n° 12/09368 N° Lexbase : A8712NEE) a accueilli cette demande et condamné la société à des dommages-intérêts. La Cour de cassation a cassé cette décision, faute pour la cour d’appel d’avoir recherché si les établissements dans lesquels le salarié avait été affecté figuraient sur la liste des établissements éligibles au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, mentionnée à l’article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L5411AS9) (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-19.031, F-D N° Lexbase : A7312R4L).
Constatant que les conditions n’étaient pas réunies, la cour d’appel de renvoi a rejeté la demande d’indemnisation par un arrêt du 5 juillet 2018, se conformant ainsi à ce qui était la doctrine de la Cour de cassation.
Concernant une autre affaire, l’Assemblée plénière a opéré un revirement de jurisprudence, le 5 avril 2019, en reconnaissant à tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, la possibilité d’agir contre son employeur sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précitée (Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 N° Lexbase : A1652Y8P, lire Ch. Willmann, Préjudice d’anxiété : un revirement attendu, beaucoup d’inconnues, La lettre juridique, avril 2019, n° 780 N° Lexbase : N8642BXD).
Le salarié se trouvant encore dans les conditions de délai pour exercer un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de renvoi du 5 juillet 2018, celui-ci ne lui ayant pas été signifié, il a formé un nouveau pourvoi en se prévalant du revirement intervenu.
Annulation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule la solution de la cour d’appel, dit qu’il y a lieu d’admettre la recevabilité d’un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, lorsqu’est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.
|
À lire :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477077
[Brèves] Rejet des demandes de délégation-partage d’autorité parentale et de DVH présentées par l’ex-partenaire de PACS de la mère
Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 19-19.275, F-D (N° Lexbase : A46704NB)
Lecture: 4 min
N7099BYL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 13 Avril 2021
► L’opposition de la mère biologique constitue, en soi, un obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de délégation-partage d'autorité parentale présentée par son ex-compagne de PACS ;
► L’intérêt supérieur de l’enfant commandait également, en l’état des constatations et appréciations de la cour, de refuser l'octroi d'un droit de visite et d’hébergement (DVH) à l’ex-compagne de PACS de la mère.
Faits et procédure. Deux femmes ont conclu le 8 juillet 2009 un pacte civil de solidarité. De l’une d’elles sont nés deux enfants sans filiation paternelle déclarée, A., le 30 juillet 2010, sur lequel l’autre femme bénéficie d’un jugement de délégation d’exercice partiel de l’autorité parentale, et B., le 5 août 2014. Après la séparation du couple, qui a conduit à la dénonciation du pacte civil de solidarité le 25 février 2015, la mère d’intention a assigné la mère biologique devant le juge aux affaires familiales afin, notamment, d'obtenir l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur B. et la fixation des modalités de ses relations avec lui.
Concernant la délégation d’autorité parentale. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 377-1, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2925ABX), le partage total ou partiel de l'autorité parentale entre les père et mère ou l’un d’eux, d’une part, et un tiers, d’autre part, nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale.
L'arrêt de la cour d’appel relève que la mère biologique s'oppose à la délégation d'autorité parentale sur B..
Il en résulte que les conditions nécessaires à l'octroi d'une délégation avec partage de l'autorité parentale n'étaient pas réunies.
La première chambre civile de la Cour de cassation retient que, par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l’article 620, alinéa 1, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6779H79), l’arrêt de la cour d’appel se trouve légalement justifié de ce chef.
Concernant le droit de visite et d’hébergement. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8011IWM), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7926IWH), si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que la conception de B. procède d'un choix délibéré et conjoint de deux femmes, l’arrêt de la cour d’appel retient qu'il résulte du rapport d'expertise que le projet initial est en partie déconstruit par la séparation et l'attitude dénigrante de la demanderesse. Il ajoute que l'équilibre de B. ne doit pas être perturbé par des projections faites sur lui et que cette dernière n'est pas en mesure de lui apporter une protection morale suffisante. Il ajoute que l'intérêt de l'enfant commande d'attendre pour l'octroi d'un droit de visite que celui-ci grandisse afin qu'il puisse lui être expliqué l'implication de la demanderesse dans son histoire de vie.
La première chambre civile de la Cour de cassation conclut qu’en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, et qui a statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant qu'elle a souverainement apprécié, a fait une exacte application de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil.
Rejet. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la demanderesse.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, L'étendue de la délégation de l'autorité parentale (N° Lexbase : E5844EY4) et L'entretien de relations personnelles des enfants avec leurs ascendants ou autres personnes, parents ou non (N° Lexbase : E5810EYT), in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477099
[Jurisprudence] Définition de la « propriété commerciale » du preneur !
Réf. : Cass. civ. 3, 11 mars 2021, n° 20-13.639, FS-P+L (N° Lexbase : A01574LE)
Lecture: 13 min
N7105BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Bastien Brignon, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, Directeur du master professionnel ingénierie des sociétés
Le 07 Avril 2021
Mots-clés : propriété commerciale • droit de propriété • CESDH • acquisition de plein droit de la clause résolutoire • mauvaise foi du bailleur • frais de poursuite des commandements • référé • allocation d’une provision au créancier
La « propriété commerciale » du preneur d'un bail commercial protégée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales s'entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du Code de commerce et non de l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire convenue entre les parties.
1. Le 11 mars 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts en matière de baux commerciaux, tous inédits, à l’exception d’un seul, frappé des mentions « FS-P+L ». Cet arrêt [1], relatif à la clause résolutoire, est fondamental. Outre le fait qu’il concerne la société DG Holidays, dirigée par Bernard Bensaid, acteur bien connu des résidences de tourisme, assigné par un collectif de propriétaires (80 parties !), il précise que la « propriété commerciale » du preneur d’un bail commercial protégée par l’article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) s’entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 (N° Lexbase : L5735IS9) à L. 145-30 du Code de commerce et ne s’applique pas à l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire convenue entre les parties. C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation donne une telle définition et apporte pareille précision.
2. En l’occurrence, plusieurs propriétaires de locaux au sein d’une résidence de tourisme donnés à bail commercial à la SARL DG Holidays, lui ont, chacun, délivré successivement plusieurs commandements de payer des loyers, visant la clause résolutoire inscrite aux baux. La locataire s’est acquittée des loyers impayés dans le mois suivant la signification des commandements, mais pas des frais de poursuite des commandements pourtant visés à la clause résolutoire. Se prévalant du non-paiement des frais de poursuite dans le délai imparti, les bailleurs ont alors assigné en référé la locataire en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en paiement. La locataire s’est acquittée des frais de poursuite auprès des bailleurs au jour où le juge des référés statuait, soit trois jours après l’assignation. En appel, les bailleurs ont sollicité la condamnation de leur locataire à leur payer, à titre d’indemnité d’occupation une indemnité trimestrielle, égale au loyer majorée de 50 %. La cour d’appel de Grenoble [2] a fait droit à leur demande en constatant l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les baux, ordonnant l’expulsion de la locataire et la condamnant à payer à chaque bailleur, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif, une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer avec majoration de 50 % et indexation selon le bail (environ 240 000 euros). En réaction, la locataire a contesté cette décision par un pourvoi en cassation. Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire et son expulsion, la locataire a soulevé trois argumentations : la mauvaise foi des bailleurs (I), l’atteinte à la propriété commerciale du preneur protégée par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CESDH (II) et la condamnation à verser l’indemnité d’occupation (III).
I. La mise en œuvre de bonne foi de la clause résolutoire
3. Dans le premier moyen de son pourvoi (première branche), la SARL DG Holidays soutenait que la mauvaise foi des bailleurs venait faire obstacle à l’application de la clause résolutoire. Ainsi, en l’espèce, la locataire faisait valoir que le fait de se prévaloir du défaut de paiement de frais de poursuite des commandements dérisoires (80/90 euros), alors que ces frais avaient été acquittés, certes pas dans le délai légal, mais quelques jours seulement après qu’elle en eut été avisée, caractérisait la mauvaise foi des bailleurs, d’autant que les loyers, dont le montant était plus important, avaient été payés dans le délai légal. Elle soutenait en outre que la véritable intention des bailleurs de faire constater la clause résolutoire était d’échapper à leur obligation de verser l’indemnité d’éviction à laquelle elle avait droit à la fin du bail [3].
4. Cet argument du pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui considère que la cour d’appel a, sans trancher de contestation sérieuse, légalement justifié sa décision en constatant que, dans la mesure où la locataire n’avait pas payé les frais de poursuite dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement, la clause résolutoire avait été mise en œuvre de bonne foi par les bailleurs. Ce faisant, les juges, des faits et du droit, font ici, simplement, application de la loi : il est de principe que lorsque le commandement de payer est resté infructueux à l’expiration du délai d’un mois après sa signification [4], le juge doit constater l’acquisition de la clause résolutoire, à la condition que l’obligation inexécutée soit expressément stipulée au contrat et que le manquement à cette obligation soit expressément sanctionné par la clause résolutoire, peu important la gravité du manquement allégué [5] et le fait que le locataire se soit acquitté de son obligation au jour où le juge statue [6].
5. On rappellera également qu’il est constant que le bailleur doit invoquer la clause résolutoire de bonne foi pour faire constater la résiliation du contrat (C. civ., art. 1104 N° Lexbase : L0821KZG et 1112-1 N° Lexbase : L0598KZ8) [7]. Le commandement doit être par conséquent délivré de bonne foi [8]. Le juge ne peut constater l’acquisition de la clause résolutoire sans rechercher si la clause n’a pas été mise en œuvre de mauvaise foi [9]. La recherche ayant été faite en l’occurrence, l’arrêt d’appel n’encourait pas la censure de ce chef.
II. L’atteinte à la propriété commerciale du preneur protégée par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CESDH
6. Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la locataire invoquait un argument fort intéressant tenant à l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit à la propriété commerciale au regard de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (cinquième branche du premier moyen) [10]. Elle estimait que son droit à la propriété commerciale, garanti par la Cour européenne des droits de l’Homme, était violé par la mise en œuvre de la clause résolutoire qui reposait sur un défaut de paiement de frais de procédure s’élevant à un montant dérisoire, lesquels frais, de surcroît, avaient été réglés trois jours seulement après l’assignation. Au fond, le preneur invoquait la même argumentation – avec la contestation sérieuse en moins – que pour la mauvaise foi des bailleurs, à savoir une mise en œuvre de ladite clause résolutoire très sévère, très rigoureuse, pour des frais de procédure dérisoires impayés à la date à laquelle ils auraient dû l’être mais finalement régularisés in fine.
7. Ce n’est pas la première fois que l’atteinte au droit de propriété et l’article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH sont invoqués par un preneur en matière de baux commerciaux. L’on en veut pour preuve, par exemple, la décision récente du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution, et notamment au droit de propriété, les dispositions de l’article L. 145-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L5742AII) relatives à la détermination de l’indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement du bail [11]. Cependant, c’est la première fois qu’un preneur invoque un tel argument concernant la mise en œuvre de la clause résolutoire. C’est d’ailleurs ce qui fait toute l’originalité et l’intérêt de l’affaire. Au visa de la clause résolutoire, inscrite au bail et clairement expliquée et détaillée, la locataire avait donc été mise en demeure de payer les loyers en retard ainsi que les frais de poursuite. Si elle s’était bien exécutée, dans le délai mentionné au commandement, elle avait néanmoins oublié de régler les frais de poursuite de l’ordre de 80 à 90 euros… Or, la clause résolutoire et le commandement précisaient qu'en sus de la créance principale, celle-ci concernait « les frais de poursuite qui en constituent l'accessoire et notamment (ceux) du commandement destiné à faire jouer la clause ». On aurait alors pu penser que, dans le fond, il n’y avait rien de grave. Mais les relations entre bailleurs et preneur étaient telles que le collectif de propriétaires, se prévalant du défaut d'exécution totale du commandement, demandait en référé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation au paiement des sommes dues. Bien que celui-ci fut fait avec quelques jours de retard, trois jours seulement, les juges en appel estiment qu’il était trop tard.
8. Et, de la même manière que la Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges du fond sur la bonne foi des bailleurs, elle considère qu’il n’y a pas, en l’occurrence, atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH : « La propriété commerciale du preneur […] s'entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du Code de commerce ». Or, « l'atteinte alléguée par la société locataire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er précité, qui ne s'applique pas lorsqu'est en cause, non pas le droit au renouvellement du bail commercial, mais, comme en l'espèce, l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire convenue entre les parties. Dès lors, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le moyen n'est donc pas fondé ».
9. L’apport de l’arrêt est ici, dans la définition de la propriété commerciale : La « propriété commerciale » du preneur d'un bail commercial protégée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH s'entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du Code de commerce, mais non pas de l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire convenue entre les parties. La mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment l’appréciation de son caractère proportionné ou disproportionné au regard des fautes du preneur, n’est pas couverte par ce texte. La propriété commerciale du preneur c’est autre chose que l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire convenue entre les parties. C’est cela qu’il faut retenir. C’est cela que l’on retiendra de l’arrêt sous commentaire.
10. La solution aurait-elle pu être différente ? Certainement oui si le preneur avait demandé des délais de paiement qui lui auraient permis d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire. Et l’on peut vraiment se demander pourquoi, en l’occurrence, le preneur n’avait pas sollicité de tels délais… Certainement pensait-il, peut-être par excès de confiance, que le non-paiement du prix dérisoire des frais de poursuites ne pourrait, en aucune circonstance, aboutir à la rupture du contrat. L’issue du litige montre l’inverse… Certainement aussi que la rédaction de la clause résolutoire et du commandement – la clause résolutoire et le commandement précisaient qu'en sus de la créance principale, celle-ci concernait « les frais de poursuite qui en constituent l'accessoire et notamment (ceux) du commandement destiné à faire jouer la clause » – invitent à se demander si la solution est généralisable à toutes les situations. La réponse est peut-être ici négative, mais il faut avouer que, pour sévère qu’elle puisse paraître, la solution est incontestable sur un plan strictement juridique. Dura lex sed lex…
III. La condamnation à verser l’indemnité d’occupation
11. Il reste que l’arrêt d’appel est finalement partiellement cassé, pour des raisons de procédure. En effet, la locataire faisait grief à cet arrêt de la condamner à payer à chaque copropriétaire, à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif, une indemnité d'occupation trimestrielle égale au loyer majorée de 50 %, alors que, soutenait-elle, « le juge des référés ne peut condamner une partie à verser des dommages et intérêts à son adversaire qu'à titre provisionnel ; qu'en condamnant la société preneuse à indemniser à titre définitif les bailleurs du préjudice résultant de son maintien dans les lieux, la cour d'appel, qui a statué sur une demande de dommages-intérêts et non de provision, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K) ».
12. La cassation était inévitable. Au visa de l’article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (N° Lexbase : L8421LT3), selon lequel « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (cf. CPC, art. 835, nouv. N° Lexbase : L8607LYG), la Cour de cassation, qui constate que la cour d’appel, saisie en référé, condamne la société locataire à payer à chaque bailleur à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer avec majoration de 50 % et indexation selon le bail, au lieu de n’allouer qu’une provision, viole la loi précitée, pour avoir excéder ses pouvoirs.
13. Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence. Il ne peut donc pas allouer des dommages et intérêts mais seulement une provision [12], ce qui ne l’empêche pas, au demeurant, d’allouer une provision d’un montant égal aux dommages et intérêts souhaités. D’où, peut-être, la confusion. Mais, juridiquement, ce ne peut être qu’une provision. En référé, les dommages et intérêts sont impossibles. Pour avoir omis cette évidence, l’arrêt d’appel est partiellement cassé, la Cour de cassation statuant, comme elle en a désormais le droit, au fond.
[1] Sur lequel : Dalloz Actualité, 1er avril 2021, note S. Andjechaïri-Tribillacle ; V. Téchené, Lexbase Affaures, mars 2021, n° 669 (N° Lexbase : N6825BYG). Adde J. Monéger, Enfin, on sait ce qu'est la « propriété commerciale » !, Loyers et Copropriété n° 4, avril 2021, repère 4.
[2] CA Grenoble, 9 janvier 2020, n° 19/01436 (N° Lexbase : A36713A9).
[3] Cass. civ. 3, 15 septembre 2009, n° 08-17.472, F-D (N° Lexbase : A1022ELG) – Cass. civ. 3, 25 février 2016, n° 14-25.087, F-D (N° Lexbase : A4447QD3), D., 2016, p. 1613, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; AJDI, 2016, p. 509, obs. D. Lipman-W. Boccara ; Loyers et copr., 2016, n° 121, note E. Chavance.
[4] Cass civ. 3, 7 décembre 2004, n° 03-18.144, F-P+B (N° Lexbase : A3691DEG), JCP E, 2005, n° 36, p. 863, obs. J. Monéger.
[5] Cass. civ. 3, 9 novembre 2004, n° 03-11.139, F-D (N° Lexbase : A8482DDI), AJDI, 2005, p. 382, obs. C. Denizot.
[6] Cass. civ. 3, 12 décembre 2006, n° 05-20.403, F-D (N° Lexbase : A9099DSS).
[7] N. Balat, Le juge contrôlera-t-il d'office la bonne foi des contractants ?, D., 2018, p. 2099 ; J.-P. Blatter et W. Blatter-Hodara, Traité des baux commerciaux, 6ème éd., Le Moniteur, 2017, n° 512 et s..
[8] Cass. civ. 3, 10 novembre 2010, n° 09-15.937, FS-P+B (N° Lexbase : A8992GG7), D., 2010, p. 2769, obs. Y. Rouquet ; D., 2010, p. 1786, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; RTD com., 2011, p. 57, obs. F. Kendérian – Cass. civ. 3, 1er février 2018, n° 16-28.684, F-D (N° Lexbase : A4866XC9), Loyers et copr., 2018, n° 93, obs. P.-H. Brault.
[9] Cass. civ. 3, 29 septembre 2009, n° 08-16.960, F-D (N° Lexbase : A5851ELB) – Cass. civ. 3, 8 septembre 2016, n° 13-28.063, F-D (N° Lexbase : A5088RZH).
[10] Selon ce texte relatif au « Droit de propriété :
« 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
[11] Cons. constit., décision n° 2020-887 QPC, du 5 mars 2021 (N° Lexbase : A80334ID), J.-P. Dumur, Lexbase Affaires, mars 2021, n° 669 (N° Lexbase : N6826BYH). Adde J. Monéger, L'indemnité d'éviction n'est pas plafonnée à la valeur de l'immeuble loué, Loyers et copr., 2021, alerte n° 32.
[12] V. également, un arrêt du même jour, Cass. civ. 3, 11 mars 2021, n° 20-10.556, F-D (N° Lexbase : A00984L9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477105
[Le point sur...] Rénovation énergétique et responsabilité des constructeurs
Lecture: 12 min
N7107BYU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 07 Avril 2021
Mots-clés : transition énergétique • constructeur • responsabilité • décennale • rénovation • écologie • Grenelle • 1792 • ouvrage • éléments d’équipement • travaux sur existant
La valeur verte ne craint pas l’inflation. Dans toutes les bouches, sur tous les projets, il faut mieux construire, d’une part et améliorer l’existant, d’autre part. La lutte contre ce qu’il est commun d’appeler les « passoires thermiques » est une figure de proue. Mais comment l’imposer au constructeur ? Et, surtout, comment rechercher sa responsabilité si les travaux sont insuffisants ? Les outils juridiques existants offrent de nombreuses réponses.
La transition énergétique, initiée notamment par les lois « Grenelle I » et « Grenelle II » n° 2009-967 du 3 août 2009 et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ainsi que la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, est en cours. Réemploi des matériaux [1], construction d’immeubles à basse consommation d’énergies [2], diminution de l’emprunte carbone dans la construction [3], aides à la rénovation énergétique des logements pour les particuliers [4] et autres incitations financières… L’objectif est de participer, autant que possible à ce qu’il est fréquent de résumer par le « développement durable » et ce, dans toutes les étapes de la construction : de la conception à la réalisation de travaux neufs en passant par la transformation de l’existant. Or, c’est bien pour cette dernière catégorie de travaux que les enjeux sont les plus importants puisque, par définition, le bâti existant est bien plus important que le bâti à créer. La Convention citoyenne pour le climat de 2020 ambitionne même de rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments d’ici 2021, c’est dire.
Les enjeux sont immenses et leurs applications prennent parfois les allures de positions de principe, lénifiantes mais sans réelles portées pratiques.
L’article L. 171-1 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L1210LWQ) est topique. Il dispose que :
« La construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du Code de l'énergie.
Elles limitent les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie, afin qu'ils soient les plus faibles possible, sans préjudicier au respect des objectifs de qualité sanitaire et au confort thermique. Le respect de ces objectifs tient compte du confort d'usage ainsi que de la qualité sanitaire mentionnés au titre V.
Pour la construction et la rénovation de bâtiments, un décret en Conseil d'Etat fixe les résultats minimaux :
1° De performance énergétique pour des conditions de fonctionnement définies, évaluée en tenant compte du recours aux énergies renouvelables au sens de l'article L. 111-1 ;
2° De limitation de l'impact sur le changement climatique, évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment ;
3° De performance environnementale, évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets liées à la fabrication des composants des bâtiments, à leur édification, leur entretien, leur rénovation et leur démolition, ainsi que du recours à des matériaux issus de ressources renouvelables et de l'incorporation de matériaux issus du recyclage ».
Les travaux de rénovation doivent ainsi respecter des « résultats minimaux » de performance énergétique, de limitation de l’impact sur le changement climatique et de performance environnementale.
L’article L. 100-4 du Code de l’énergie (N° Lexbase : L5422LTY) visé prévoit, notamment, de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant l’objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ainsi que de disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes bâtiment basse consommation ou assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements.
D’aucuns ne pourront s’en offusquer mais ces beaux principes manquent de traductions pratiques concrètes. Autrement dit, au-delà des mesures incitatives qui prennent principalement la forme d’aides financières, il n’existe que très peu de dispositions contraignantes applicables aux constructeurs hormis les dispositions propres aux bâtiments à usage tertiaire. L’article L. 111-10 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L3110KGB) dispose laconiquement que tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d’atteindre un niveau de performance énergétique comparable à celui visé à l’article L. 100-4 précité.
C’est donc par le truchement du contrat que sont définies les performances énergétiques que la rénovation devra atteindre. L’outil contractuel est suffisamment souple pour s’adapter aux finalités les plus variées des maîtres d’ouvrage. Il apparaît ainsi comme l’instrument principal de la mise en œuvre de la transition énergétique dans le domaine de la construction [5].
Le constructeur, tenu, pour simplifier, d’une obligation de résultat, sera responsable d’une éventuelle insuffisance des performances requises par le dispositif légal et règlementaire mais, surtout, par le contrat qui autorise le développement de nouvelles obligations contractuelles, amplifiées par la jurisprudence.
Mais, depuis que la jurisprudence autorise l’application de la responsabilité civile décennale aux défauts de conformité, se pose la question de savoir si le défaut de performance énergétique peut caractériser un dommage de nature décennale, potentiellement garanti par l’assureur de responsabilité civile décennale du constructeur. La réponse n’est pas systématiquement positive, heureusement.
Il s’agira alors d’examiner les cas dans lesquels la responsabilité décennale des constructeurs peut être engagée (I) de ceux dans lesquels le droit commun à vocation à s’appliquer (II).
I. La responsabilité décennale des constructeurs
Alors que la lettre de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) vise le vice caché qui affecte l’ouvrage ou l’élément d’équipement, depuis longtemps, la jurisprudence admet la réparation des défauts de conformité, sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs [6]. Le manquement à une règlementation ou à une stipulation contractuelle peut entraîner l’application de cette responsabilité, qui n’est donc plus cantonnée à la réparation des vices. Encore faut-il que les travaux de rénovation énergétique caractérisent un ouvrage ou un élément d’équipement (A) et que l’insuffisance des performances soit de gravité décennale (B).
A. L’élargissement par l’objet de la responsabilité décennale
La responsabilité civile décennale des constructeurs est conditionnée à ce que les travaux de rénovation soient constitutifs d’un ouvrage ou d’un élément d’équipement. À première vue, cette démonstration devrait restreindre l’application de la décennale en cas de rénovation énergétique. La compréhension large de la jurisprudence, notamment en cas de travaux sur existants, démontre tout le contraire.
Depuis sa fameuse jurisprudence du 15 juin 2017 [7], la troisième chambre civile de la Cour de cassation admet que la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur puissent être éligibles à la responsabilité décennale du vendeur/poseur qui se retrouve ainsi constructeur, par la formule de principe, depuis largement reprise [8], selon laquelle les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
L’élargissement s’opère également par une compréhension extensive de la notion d’ouvrage, comme par exemple pour un système de chauffage [9] ou encore une pompe à chaleur [10].
Les juges disposent ainsi d’un instrument souple pour entrer en voie de condamnation contre l’auteur du dommage sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
B. L’élargissement par le centre de gravité décennale
L’article L. 111-13-1 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L2932KGP) dispose qu’en matière de performance énergétique, l’impropriété à destination ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements conduisant, toute condition d’usage prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. Ces conditions paraissent, en première approche, plus compliquées à démontrer que la notion d’impropriété à destination visée à l’article 1792 du Code civil [11]. Certains y ont vu une volonté de restreindre le champ d’application de la garantie décennale en cas de défaut de performance énergétique. Ce n’est pas si certain.
Si le premier cas de gravité décennale est donc celui dans lequel les conditions de l’article L. 111-13 (N° Lexbase : L7127ABL) sont remplies, se pose, toutefois, la question de savoir si, indépendamment de cet article, le dommage consécutif à une insuffisance de performances peut caractériser une impropriété à la destination.
La réponse est positive dès lors que tout n’entre dans le champ d’application de l’article L.111-13-1 précité. Il faut dire qu’avant cet article, issue de la loi de 2015 précitée, l’impropriété énergétique à la destination de l’ouvrage était largement reconnue par les juges [12]. Il est, par exemple, tentant d’essayer de déplacer les débats sur l’isolation thermique plutôt que sur celui de la surconsommation énergétique [13].
La loi dite « Grenelle II » a instauré une obligation, dans certains secteurs du bâtiment à usage tertiaire, la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique dont la première échéance est fixée à l’horizon 2030. Il ne fait nul doute que les dommages aux travaux initiés sur ce fondement puissent relever de la responsabilité décennale des constructeurs.
L’exemple du contrat de performance énergétique instauré par l’arrêté du 24 juillet 2020 [14] va sans doute également conduire à un élargissement de la responsabilité civile décennale du constructeur. Défini comme le contrat conclu entre un donneur d’ordre et une société de services d’efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d’ouvrage, vérifié et mesuré par rapport à une situation de référence contractuelle, il ne fait pas de doute que le non-respect de cet objectif puisse entraîner une impropriété à la destination de l’ouvrage.
II. La responsabilité de droit commun des constructeurs
Mais, à l’instar des autres dommages consécutifs à des travaux, toutes les insuffisances de performances énergétiques ne vont pas entraîner l’application de la responsabilité civile décennale, pas plus que l’obligation de souscrire une assurance outre la mobilisation des garanties souscrites. Le droit commun de la responsabilité conserve toute sa place, que ce soit sur le fondement contractuel (A) ou extra-contractuel (B).
A. Responsabilité contractuelle
Parce que les travaux de rénovation énergétique ne constituent, pas tous, des ouvrages ou des éléments d’équipement, et que les dommages causés ne revêtent, pas tous, le critère de gravité décennale, le droit commun de la responsabilité contractuelle conserve un champ d’application qui n’est pas si résiduel.
Pour exemple, la Haute juridiction a pu considérer que n’entre pas dans le domaine de la garantie décennale, le non-respect de la règlementation thermique 2005 qui ne constitue pas une impropriété à destination mais un manquement à son obligation de conseil s’analysant en une perte de chance du maître d’ouvrage de ne pouvoir obtenir une maison conforme à cette règlementation [15].
La responsabilité du constructeur peut être ainsi engagée pour défaut de conseil.
Mais ce n’est pas tout. Il faut, également penser à la qualification de dommage intermédiaire. Ainsi en est-il, notamment, lorsque le dommage est purement esthétique. Nombreux sont ceux qui dénoncent les nouvelles mesures incitatives prises pour inciter les particuliers à réaliser des travaux d’isolation. Pour eux, il s’agit simplement de doubler les cloisons des immeubles avec un isolant pour bénéficier des aides [16].
La responsabilité de droit commun fondée sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8) pourrait, également, être utilisée contre le vendeur du produit qui a été utilisé dans le cadre de la rénovation énergétique.
B. Responsabilité non-contractuelle
En application des articles 1245 (N° Lexbase : L0945KZZ) et suivants du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par le défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec sa victime. Il semblerait ainsi que le dommage causé par une insuffisance des performances énergétiques puisse rentrer dans le champ d’application du droit de la responsabilité du fait des produit défectueux. En théorie, cela ne fait nul doute. En pratique, il reste à remarquer que les contentieux sont à ce point marginaux que l’outil semble peu adapté. D’un côté, parce que les conditions semblent difficiles à remplir, notamment celle relative à la dangerosité du produit. Le contentieux des panneaux photovoltaïques pourrait néanmoins remplir cette première condition. De l’autre, l’action doit être exercée dans le court délai de trois ans.
Il faut, également, penser à la responsabilité des constructeurs fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Depuis longtemps admise à l’encontre des constructeurs, l’application de la théorie selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est sans rapport avec le respect de la règlementation. Les exemples donnés dans le cadre des nuisances sonores sont assez saisissant » [17]. Est-ce qu’une « nuisance écologique » pourrait être caractérisée ? La question trouve un écho dans les dispositions de l’article 1246 du Code civil (N° Lexbase : L7607K9M) qui dispose, en termes très généraux, que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».
| À retenir :
|
[1] Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la Directive n° 2008/98/CE relative aux déchets (N° Lexbase : L7059LKN).
[2] Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, dite « ESSOC II » (N° Lexbase : L2549LXP), traite de la performance environnementale des bâtiments neufs et de la RE 2020.
[3] P. Dessuet, Les dispositions applicables en matière de développement durable dans la construction et leurs conséquences en matière de responsabilité et d’assurance, RGDA, mars 2021, p. 6.
[4] MaPrimRénov’, décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 (N° Lexbase : Z002919P) modifié par le décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 (N° Lexbase : L9055LZE) ; décret n° 2021-58 du 25 janvier 2021 (N° Lexbase : L9056LZG). M. Peisse, Avec le Covid-19, déraison et subterfuges d’Etat, Gaz.Pal. 15 septembre 2020, p. 42.
[5] M. Lamoureux, Le droit privé des contrats au service de la transition énergétique, EEI, septembre 2019, étude 12.
[6] G. Durand-Pasquier, Premières réflexions rapides sur l’encadrement de la notion d’impropriété à la .destination consécutive à un défaut de performance énergétique, Constr. Urb. novembre 2015.
[7] Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6831WHH).
[8] V. notamment, Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-16.637, F-D (N° Lexbase : A6934WLE) ; Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-17.323, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6554WR8) ; Cass. civ. 3, 14 décembre 2017, n° 16-10.820, FS-D (N° Lexbase : A1265W8D) ; Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.741, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8809YZB).
[9] Cass. civ. 3, 21 janvier 2021, n° 20-14.068, F-D (N° Lexbase : A24204ED).
[10] Cass. civ. 3, 4 mai 2016, n° 15-15.379, FS-D (N° Lexbase : A3502RNZ).
[11] G. Durand-Pasquier, Des conditions restrictives de la garantie décennale en cas de défaut de performance énergétique, RDI, 2016, p. 120.
[12] Pour exemple, Cass. civ. 3, 27 septembre 2000, n° 98-22.243 (N° Lexbase : A4225ZL3). V. également Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-21.163, F-D (N° Lexbase : A9556XX9) ou encore Cass. civ. 3, 8 octobre 2013, n° 12-25.370, F-D (N° Lexbase : A6843KME) dans lequel la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché si les désordres engendrés par les défauts d’isolation thermique ne rendaient pas l’ouvrage (une maison en ossature bois) impropre à sa destination.
[13] Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-21.163, F-D (N° Lexbase : A9556XX9), RGDA, 2018, p. 412 obs. P. Dessuet.
[14] JORF 31 juillet 2020.
[15] Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-16.751, F-D (N° Lexbase : A3285ZKU).
[16] V. notamment M. Peisse, Avec le Covid-19, déraison et subturfuges d’Etat, Gaz. Pal. 2020, n° 387.
[17] Pour exemples CAA Bordeaux, 10 mars 2020, n° 17BX03727 (N° Lexbase : A20203IN). TJ Paris, 15 janvier 2021, Village de la Justice, note C. Sanson « la réalisation de travaux au sein d’un appartement peut entraîner la dégradation de l’isolement acoustique initial d’un bien immobilier, donnant lieu à réparation pour le voisin victime de nuisances sonores qui en découlent » [en ligne].
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477107
[Jurisprudence] Le droit à la participation en matière d’environnement, un droit personnel
Réf. : Cons. const., décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021, Association Générations futures et autres (N° Lexbase : A59554L7)
Lecture: 11 min
N7068BYG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Amandine Capitani, Avocat associé SCP Capitani & Moritz, docteur en droit
Le 07 Avril 2021
Mots clés : environnement • participation du public • pesticides
Les modalités retenues par le législateur pour l'élaboration des chartes d'engagement départementales relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sont contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Par décision en date du 31 décembre 2021, le Conseil d’État a décidé de soumettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la constitutionnalité du III de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1256LZK), dans sa rédaction issue de la loi du 30 octobre 2018 [1].
Cette disposition précise qu’ « à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique.
Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III.
Un décret précise les conditions d'application du présent III ».
Les associations requérantes ont soutenu que ces dispositions méconnaîtraient l’article 7 de la Charte de l’environnement (N° Lexbase : L8859IUN), qui prévoit que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».
Le Conseil d’État, estimant que les conditions à la transmission de la QPC étaient réunies, a saisi le Conseil constitutionnel de la question de savoir si le III de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime est conforme à l’article 7 de la Charte de l’environnement, faute de prévoir des modalités suffisantes de participation du public à l’élaboration des chartes d’engagement des utilisateurs. Plus précisément, le Conseil constitutionnel a estimé que la question de constitutionnalité portait sur les mots « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique ».
Dans cette décision du 19 mars 2021 [2], la onzième censure sur le fondement de l’article 7 de la Charte de l’environnement depuis son entrée en vigueur le 3 mars 2005, le Conseil constitutionnel est venu apporter des précisions utiles sur la nature des chartes d’engagement départementales (I) et sur la notion de participation au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement (II). Sur ce dernier point, le Conseil constitutionnel est venu rappeler l’importance de la notion de « toute personne » énoncée à l’article 7 précité, et le degré de précision attendu dans le détail des procédures de participation du public en dehors de celles déjà codifiées.
I. Sur la nature de « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » des chartes d’engagement départementales
L’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime impose aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, c’est-à-dire une gamme de pesticides destinés à protéger les végétaux et les produits de culture [3], de formaliser dans une charte d’engagement les mesures de protection prises pour protéger les habitants des zones contiguës où ont lieu ces épandages. Elles doivent tenir compte « des techniques et matériels d'application employés » et doivent être « adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire ». La Charte est élaborée à l’échelle départementale après concertation avec les personnes habitant à proximité ou leur représentant. À défaut ou en cas d’insuffisance, une interdiction d’utilisation peut être prononcée.
Le Conseil constitutionnel estime que ces chartes, qui font l’objet d’un contrôle et d’une approbation par l’autorité administrative, « doivent nécessairement faire l’objet d’une décision de l’autorité administrative pour produire des effets juridiques ». Il en découle qu’il s’agit d’une « décision publique » au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Ces chartes régissant les conditions d’utilisation de produits phytopharmaceutiques, il considère qu’elles ont nécessairement des conséquences sur « la biodiversité et la santé humaine » et donc une « incidence directe et significative sur l’environnement ».
Ce n’est pas la première fois que le Conseil constitutionnel se réfère aux incidences sur la biodiversité pour considérer que la décision est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement. Ainsi, dans la décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 (N° Lexbase : A5119MMK), il avait retenu « que l'inscription sur l'une ou l'autre de ces listes a pour conséquence d'imposer des obligations particulières qui tendent à préserver la continuité écologique sur des cours d'eau à valeur écologique reconnue » (§ 5). Quelques années auparavant, il avait également retenu la notion de « patrimoine biologique » [4]. À cette occasion, il avait également fait référence à la santé humaine, qui était alors visée par la disposition examinée. Il en fut de même dans la décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 (N° Lexbase : A7387HYA).
Dans le cadre de la présente décision, le Conseil constitutionnel fait explicitement référence à la santé, mais cette fois sans que les dispositions examinées n’en fassent mention. Une telle évolution était attendue eu égard au mouvement protecteur qui s’est amorcé en 2020 dans la décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : A85123CA), relative également aux produits phytopharmaceutiques [5]. En effet, dans le cadre de cette décision, le Conseil constitutionnel a déduit du préambule de la Charte de l’environnement un objectif de valeur constitutionnelle « de protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains » [6], là où, jusqu’à présent, il évoquait un objectif d’intérêt général [7].
Il a, en outre, dans la suite de son raisonnement, adopté une formule nouvelle pour la protection de la santé [8], en faisant également référence à un objectif de valeur constitutionnelle basé sur le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU), alors que, depuis 1991 [9], il faisait majoritairement référence à un principe constitutionnel. Une telle évolution traduit, nous semble-t-il, une volonté de donner plus de latitude au législateur, qui sous réserve de la poursuite de ces objectifs de valeur constitutionnelle, pourra porter atteinte à d’autres exigences et/ou droits constitutionnels qui viendraient en conflit.
Ainsi, les chartes d’engagement départementales sont des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement et relèvent donc de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Cette décision vient compléter la liste relativement longue des décisions ayant été identifiées comme ayant une incidence sur l’environnement, telle que la celle autorisant l'exploitation d'une installation de production d'électricité [10] pour n'en citer qu’une récente.
II. Sur la procédure de participation du public au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement
Cette décision est particulièrement intéressante car elle vient préciser que si le législateur fait le choix de déroger aux procédures codifiées de participation prévues par le Code de l’environnement, en l’espèce son article L. 123-19-1 (N° Lexbase : L8061K9G), des précisions suffisantes doivent être apportées.
Ainsi, à partir du moment où le législateur opte pour une procédure particulière de participation du public, il ne peut se borner à définir son échelon territorial. Il doit préciser les conditions et limites d’exercice de ce droit à la participation, conformément à la lettre de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Ce faisant, il s’agit d’un simple rappel d’une position de principe déjà énoncée dans le cadre des décisions QPC [11] mais également dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori. Le Conseil constitutionnel indiquait ainsi dans la première décision rendue au visa de l’article 7 de la Charte de l’environnement, soit trois ans après son entrée en vigueur, « qu'il ressort de leurs termes mêmes qu'il n'appartient qu'au législateur de préciser “les conditions et les limites” dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ; que ne relèvent du pouvoir réglementaire que les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur » [12]. En l’espèce, les modalités pratiques de la concertation figurent uniquement dans un décret [13] et un arrêté [14], méconnaissant ainsi la compétence du législateur.
Enfin, et c’est l’un des apports majeurs de cette décision, le Conseil constitutionnel juge que le fait que la concertation puisse se tenir avec les représentants des personnes résidant à proximité des zones d’épandage ne « satisfait pas les exigences d’une participation de “toute personne” visée par l’article 7 de la Charte de l’environnement. » En l’espèce, la formulation critiquée laisse un choix aux organisateurs de la concertation, à savoir consulter les personnes ou leurs représentants, ce qui implique la possibilité de ne pas consulter directement les riverains mais seulement leurs représentants, les privant ainsi des zones d’épandage du droit de participer.
Au regard du libellé de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de la finalité de la procédure de participation, à savoir une participation effective du public [15], permettre une concertation impliquant les seuls représentants des personnes concernées est contraire aux exigences constitutionnelles.
Cette position traduit une volonté d’assurer une véritable effectivité au droit à la participation, recherche d’effectivité procédurale que l’on retrouve également, de plus en plus fréquemment, chez le juge administratif dans de nombreux domaines.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité induit que les dispositions examinées ne sont plus en vigueur. Elle est applicable à toutes les décisions non jugées définitivement à la date du 19 mars 2021. Contrairement à certaines décisions rendues sur ce fondement [16], le Conseil constitutionnel n’a pas distingué différentes périodes. Toutefois, cette formule n’est pas sans poser de difficultés.
En effet, l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime a fait l’objet de modifications législatives depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2018 de sorte que, conformément à la position habituelle du Conseil constitutionnel, la déclaration d’inconstitutionnalité ne porte que sur la version de l’article en vigueur entre octobre 2018 et décembre 2020. L’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime post-modification législative de décembre 2020 [17] demeure donc dans l’ordonnancement juridique, alors même que le libellé du III du dit article est resté identique. Il conviendra néanmoins de ne pas l’appliquer en ce qu’il est contraire à la loi [18] et à la Constitution. La transmission d’une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité sur cette disposition semble néanmoins peu probable eu égard à la nécessité pour la QPC de présenter un caractère « nouveau ».
Il appartient donc désormais au législateur de légiférer, de nouveau, dans ce domaine. Le fait que la France finalise actuellement son rapport d’application de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement, pourrait favoriser l’adoption rapide d’une procédure suffisamment détaillée et ouverte à toutes les personnes susceptibles d’être concernées.
[1] Loi n° 2018-938, du 30 octobre 2018, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (N° Lexbase : L6488LMA).
[2] Cons. const., décision n° 2021-891 QPC, du 19 mars 2021, Association Générations futures et autres (N° Lexbase : A59554L7).
[3] Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, art. 2 (N° Lexbase : L9336IEI).
[4] Cons. const., décision n° 2012-269 QPC, du 27 juillet 2012 (N° Lexbase : A0585IR4).
[5] La décision portait sur la constitutionnalité du IV de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime.
[6] « Aux termes du préambule de la Charte de l'environnement : l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel … l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation … afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Il en découle que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle » (§ 4).
[7] Cons. const., décision n° 2019-808 QPC, du 11 octobre 2019 (N° Lexbase : A7486ZQC).
[8] « Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation “garantit à tous […] la protection de la santé” », Cons. const., décision n° 2019-823 QPC, préc., § 5.
[9] Cons. const., décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991 (N° Lexbase : A8239AC7).
[10] Cons. const., décision n° 2020-843 QPC, du 28 mai 2020 (N° Lexbase : A22923MT).
[11] Voir par exemple : Cons. const., décision n° 2020-843 QPC, du 28 mai 2020, préc. ; Cons. const., décision n° 2014-396 QPC, du 23 mai 2014 (N° Lexbase : A5119MMK).
[12] Cons. const., décision n° 2008-564 DC, du 19 juin 2008 (N° Lexbase : A2111D93), § 48.
[13] Décret n° 2019-1500, du 27 décembre 2019, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation (N° Lexbase : L2128LUD).
[14] Arrêté du 27 décembre 2019, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L2210LUE).
[15] Le 3 de l’article 6 relatif à la participation du public aux décisions relatives à des activités particulières de la Convention d’Aarhus précise que : « Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement ».
[16] Voir par exemple : Cons. const., décisions n° 2014-396 QPC, du 23 mai 2014 et n° 2016-595 QPC, du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : A3267SHH).
[17] Loi n° 2020-1578, du 14 décembre 2020, relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (N° Lexbase : L1025LZY).
[18] C. env, art. L. 110-1, II, 5° (N° Lexbase : L0336L3T).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477068
[Brèves] Plus-values sur parts sociales dont la propriété est démembrée : précisions sur les redevables de l’imposition (cas de la donation-partage)
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 avril 2021, 429187, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50324NP)
Lecture: 5 min
N7123BYH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 08 Avril 2021
► Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur les règles d’imposition dans le cadre d’une plus-value sur parts sociales dont la propriété est démembrée.
Les faits
⇒ par un acte authentique de donation-partage les requérants ont cédé à leurs deux enfants la nue-propriété de 20 000 actions d’une société, dont ils ont conservé l'usufruit
⇒ la société a procédé, dans le cadre d'une réduction de son capital, au rachat de ces actions, l'usufruit et la nue-propriété étant cédés simultanément
⇒ à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié aux requérants des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de la plus-value afférente à la cession des 20 000 titres dont ils détenaient l'usufruit, en retenant que la plus-value était intégralement imposable entre leurs mains et non, ainsi que l'affirmaient les contribuables, entre les mains des nus-propriétaires
⇒ le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande des requérants tendant à la décharge de ces impositions
⇒ la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et prononcé la décharge demandée (CAA Versailles, 29 janvier 2019, n° 16VE02602)
📌 Précisions du Conseil d’État
✔ L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.
✔ Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier.
✔ Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.
✔ Lorsque l'usufruitier conserve la faculté de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l'usufruit, le droit d'usufruit doit être regardé, pour l'imposition des plus-values résultant de la cession, comme reporté sur le produit de cette cession, rendant ainsi l'usufruitier intégralement redevable de l'imposition.
📌 Solution applicable en l’espèce
Ici nous sommes en présence un acte de donation partage ayant fait donation entre vifs de la nue-propriété des titres d'une société, une stipulation faisant interdiction aux nus-propriétaires d'aliéner ou de nantir ces titres sans l'accord des usufruitiers, à peine de nullité des aliénations et nantissements.
Un mandat exclusif a été donné aux usufruitiers pour gérer les fonds issus de la cession des titres qui serait décidée avec l'accord des nus-propriétaires, en l'absence de remploi pour acquérir de nouveaux titres.
En cas d'aliénation des titres, les nus-propriétaires s'interdisent, sauf accord exprès du ou des usufruitiers, à demander le partage en toute propriété du prix représentatif de ceux-ci, le droit d'usufruit est ainsi, en cas de cession, reporté sur le prix issu de celle-ci,
Le remploi du prix de vente des titres ne constitue qu'une simple faculté à la main des seuls usufruitiers.
👉 Dès lors, le Conseil d’État en conclut que les usufruitiers doivent être regardés comme redevables de l'intégralité de l'imposition assise sur la plus-value résultant de la cession de ces titres.
| 💡 Imposition de la plus-value de cession d’un bien démembré : jurisprudences antérieures ✔ Si le prix de vente est attribué à l'usufruitier sous forme d'un quasi-usufruit, seul ce dernier est imposable sur la totalité de la plus-value (CE 3° et 8° ssr., 18 décembre 2002, n° 230605, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4709A7K). ✔ En cas de cession en pleine propriété d'un bien démembré, le prix de cession commun se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. Il en résulte que la plus-value se répartit entre l'usufruitier et le nu-propriétaire (CE 9° et 10° ssr., 30 décembre 2009, n° 307165, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0324EQ3). ✔ Si l’usufruitier et le nu-propriétaire conviennent de reporter l’usufruit sur un bien lui-même démembré acquis en remploi du prix de vente, la plus-value est imposable exclusivement entre les mains du nu-propriétaire (CE 3° et 8° ssr., 17 avril 2015, n° 371551, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9567NGG). ✔ Enfin, en cas de remploi, la plus-value est imposable au seul nom du nu-propriétaire et en cas de quasi-usufruit elle sera imposable au nom de l’usufruitier lorsque la convention de quasi-usufruit est conclue antérieurement ou concomitamment à la cession des titres sociaux (CE 3° et 8° ch.-r., 11 mai 2017, n° 402479, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3850WCL). Lire en ce sens, J-M. Garinot, Cession de titres : déduction par le nu-propriétaire des frais payés par l'usufruitier, Lexbase Fiscal, juin 2017, n° 703 (N° Lexbase : N8893BWB). |
Cf. le BOFiP-Impôt annoté (N° Lexbase : X8241ALS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477123
[Brèves] Partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation : précisions sur le nouveau taux du droit de partage
Lecture: 3 min
N7080BYU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 08 Avril 2021
► La fiscalité relative à une séparation de corps, à un divorce ou à la rupture d’un pacte civil de solidarité (PACS) a été sensiblement allégée. Depuis le 1er janvier 2021, le droit de partage est abaissé à 1,8 % contre 2,5 % auparavant.
📌 Qu’est-ce que le droit de partage ?
Un droit de partage est dû lorsqu'un acte constate le partage de biens issus d'une succession, d'une communauté conjugale, ou d'une indivision de n'importe quelle origine.
Plus spécifiquement, lorsque des conjoints se séparent dans le cadre d’un divorce, d’une séparation de corps ou de rupture d’un PACS, ils doivent se partager les biens (mobiliers et immobiliers) qu’ils ont acquis ensemble. Une imposition s’applique alors sur la valeur du patrimoine partagé.
La valeur du patrimoine comprend :
- la valeur de tous les biens « meubles » (biens qui peuvent être déplacés) partagés en France et à l’étranger ;
- la valeur de tous les biens « immeubles » (appartement, maison, terrain) partagés en France et à l’étranger ;
- le montant des récompenses dues par les époux à la communauté (sommes dues par les époux après la reprise des biens propres ou des biens communs, afin de compenser l’enrichissement ou l’appauvrissement de l’autre).
Sont ensuite déduites les dettes et les charges des conjoints, afin d’obtenir la base du droit de partage.
📌 Le taux du droit de partage
Depuis la loi de finances rectificative de 2011 (loi n° 2011-900, du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011, art. 7 N° Lexbase : L0278IRQ), le taux du droit de partage s’élevait à 2,50 %.
L’article 108 de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 108 N° Lexbase : L5870LUX) a diminué en deux temps le taux du droit de partage :
- 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
- 1,10 % à compter du 1er janvier 2022.
Lorsqu'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle, il peut être exonéré du droit de partage.
L’article 746 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6243LUR) est ainsi rédigé : « Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité ».
|
💡 Bon à savoir :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477080
[Le point sur...] Référents harcèlement sexuel et agissements sexistes : illustrations conventionnelles
Lecture: 29 min
N7120BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jonathan Cadot et Anne-Marie Skuratko, avocats au Barreau de Paris, Lepany & Associés
Le 07 Avril 2021
Mots-clés : référents harcèlement sexuel et agissements sexistes • obligation de prévention • santé et sécurité au travail • risques • désignation • CSE • employeur • obligation de formation accord d’entreprise
Introduit par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW), les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes sont des outils de prévention des risques au sein de l’entreprise.
Pour autant, le législateur s’est bien gardé de définir leurs attributions ainsi que les moyens mis à leur disposition.
Sans qu’il s’agisse d’une obligation, il reviendra aux partenaires sociaux de leur construire un véritable statut.
I. La désignation du réfèrent harcèlement sexuel et agissements sexistes
En matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, l’employeur est tenu de respecter :
- une obligation générale de prévention afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav., art. L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY) ;
- une obligation d’information dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche en communiquant et affichant de l’adresse et du numéro d’appel du référent harcèlement sexuel et agissements sexistes (C. trav., art. L. 1153-5 N° Lexbase : L0338LMH et D. 1151-1 N° Lexbase : L0527LP9).
La loi du 5 septembre 2018 a renforcé le dispositif législatif et a instauré un dispositif d’accompagnement, par la désignation de référents harcèlement sexuel et agissements sexistes.
La désignation du référent est faite :
- par le CSE (quel que soit l’effectif de l’entreprise) ;
- par l’employeur (dans les entreprises de plus de 250 salariés).
A. La désignation d’un référent par le CSE
Les CSE, quel que soit l'effectif de l'entreprise, doivent désigner parmi leurs membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (C. trav., art. L. 2314-1).
Le nombre de référents. Si la loi prévoit uniquement la désignation « d’un » référent, il apparaît que certains accords d’entreprise ont prévu de nommer plusieurs référents harcèlement sexuel et agissements sexistes et notamment :
→ La désignation d’une équipe mixte :
« Une CSSCT est mise en place, à titre de démarche volontaire des parties signataires, au sein du CSE.
Deux référents harcèlement sexuel et agissements sexistes, un homme, une femme, sont nommés par la CSSCT. » (Accord collectif d’entreprise relatif au fonctionnement du CSE - Société Getinge la Calhene, 15/10/2019)
« Aussi, il sera désigné deux (2) référents HS / AS au sein du CSE, une femme et un homme.
La Direction organisera et prendra en charge la formation spécifique pour tenir ce rôle auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise. » (Accord portant sur la représentation du personnel et le droit syndical - Société Silec Cable, 16/07/2019)
→ La désignation de plusieurs acteurs, dont un, extérieur à l’entreprise :
« Pour ce faire, des référents harcèlement sexuel et agissement sexiste sont nommés en la personne du :
- directeur général ;
- de deux membres du CSE ;
- d’un cabinet extérieur » (Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes - Association jeunesse et avenir, 06/11/2020)
La désignation de ce référent fait l'objet d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Le crédit d’heures. L’élu titulaire nommé référent par le CSE pourra utiliser son crédit d’heures de délégation en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE (C. trav., art. L. 2315-7 N° Lexbase : L8515LGH et R. 2314-1 N° Lexbase : L0635LID).
Toutefois, afin de ne pas pénaliser l’élu nommé référent du CSE et lui permettre d’exercer pleinement ses fonctions, il pourrait être prévu, dans le cadre d’un accord ou du règlement intérieur :
- l’octroi d’un crédit d’heures supplémentaire dédié à l’exercice de ses missions ;
- la possibilité de considérer comme temps de travail effectif certaines missions du référent CSE qui pourraient s’avérer chronophages ou solliciter une importante implication de sa part (étude du signalement, instruction de l’enquête, permanences…).
S’il s’agit d’un élu suppléant, pour qu’il soit en mesure d’assumer sa mission, cela suppose qu’il dispose d’un crédit d’heures de délégation, du fait de son statut d’élu, ou en sa qualité de référent, ce qui suppose l’accord de l’employeur.
Il sera désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Ainsi, à chaque renouvellement de l’instance, il conviendra de procéder à une nouvelle désignation.
Il peut être envisagé de désigner un référent suppléant pour pallier les absences du référent CSE. Pour autant, cela supposera l’accord de l’employeur.
B. La désignation d’un référent par l’employeur
Dans les entreprises d'au moins 250 salariés, l'employeur est dans l’obligation de désigner un salarié comme référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (C. trav., art. L. 1153-5-1 N° Lexbase : L9804LLP).
Contrairement à la désignation faite par le CSE, l’employeur est libre de choisir la personne qui occupera la fonction de référent harcèlement sexuel et agissement sexistes.
Les missions du référent désigné par l’employeur n’ont pas de durée, à l’inverse de celles du référent CSE qui prend fin avec celle du mandat des membres.
Lorsque l'entreprise compte simultanément un référent d'employeur et un référent CSE, leurs missions doivent s'articuler notamment dans le cadre de la réalisation d'enquêtes ou de médiation auprès des salariés.
Cette articulation est prévue par certains accords entreprise :
« Dans ce cadre, les missions du référent harcèlement au CSE doivent s'articuler avec celles du référent harcèlement sexuel désigné par l’entreprise. Ainsi, ce dernier est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. » (UGITECH - Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prévention de la pénibilité et la gestion du handicap, 15/11/2019)
II. La formation des référents
A. Le référent désigné par le CSE
L’objet de la formation. Les dispositions légales prévoient explicitement que le référent désigné par le CSE puisse bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-28 N° Lexbase : L8339LGX).
Ce référent ainsi que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique doivent bénéficier d'une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur (C ; trav., art. L. 2315-18 N° Lexbase : L0336LME).
La formation du référent CSE a pour objet de :
- développer son aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
- l’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail (C. trav., art. R. 2315-9 N° Lexbase : L0508LIN).
Il paraît donc important de prévoir deux types de formations :
→ Une formation générale relative à la santé, sécurité et aux conditions de travail :
« 10-2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres du CSE, titulaires et suppléants, effectuant leur premier mandat en tant que tel, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficient de la formation initiale nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée de 3 jours. Cette formation est entièrement prise en charge par l’employeur. » (Accord sur la composition, le fonctionnement, les prérogatives et les moyens du CSE - Caisse régionale du crédit mutuel MAS, 24/04/2020)
→ Une formation plus spécifique concernant les missions du référent :
« Construire et mettre à disposition une formation pour les référents harcèlement sexuel groupe, société et CSE.
Cette formation pourra être élargie aux bienveilleurs, correspondants SSCT, correspondants diversité, managers. » (Casino Guichard-Perrachon - Accord relatif à la santé à la sécurité et à la qualité de vie au travail, 03/12/2019)
« Afin d’assurer ces missions conjointement avec le référent harcèlement sexuel de l’entreprise, le référent du CSE-C bénéficie des moyens suivants :
Une formation spécifique sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes identique à celle du référent de l’entreprise organisée et prise en charge par l’entreprise. » (UGITECH - Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prévention de la pénibilité et la gestion du handicap, 15/11/2019)
La formation du référent doit tenir compte :
- des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;
- des caractères spécifiques de l’entreprise ;
- du rôle du représentant au CSE ;
Il peut être recommandé de la dispenser préalablement à l’exercice des missions du référent.
En effet, les dispositions légales précisent qu’elle est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du CSE (C. trav., art. R. 2315-10 N° Lexbase : L0509LIP). Les membres de la délégation du personnel du CSE et donc le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste bénéficie également du renouvellement de leur formation, permettant d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner (C. trav., art. R. 2315-11 N° Lexbase : L0510LIQ).
La demande de formation. Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail en fait la demande à l'employeur.
Cette demande précise :
- la date à laquelle il souhaite prendre son congé ;
- la durée de celui-ci ;
- le prix du stage ;
- et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
La demande de congé est présentée au moins 30 jours avant le début du stage (C. trav., art. R. 2315-17 N° Lexbase : L0516LIX).
Le congé de formation est pris :
- en une seule fois ;
- en deux fois lorsque le bénéficiaire et l'employeur en ont convenu d'un commun accord (C. trav., art. R. 2315-18 N° Lexbase : L0517LIY).
L’employeur peut :
- accepter la demande de formation ;
- refuser, estimant que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande (C. trav., art. R. 2315-19 N° Lexbase : L0518LIZ).
En cas de refus, le congé de formation sera reporté dans la limite de six mois.
Le financement de la formation. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur ainsi que les frais de déplacement et les frais de séjour ne dépassant pas certains seuils (C. trav., art. R. 2315-20 N° Lexbase : L0519LI3 à R. 2315-22 N° Lexbase : L0521LI7).
En outre, certains accords prévoient l’octroi d’heures de délégations supplémentaires en vue d’effectuer sa formation :
« Ce référent bénéficiera de la formation nécessaire à l’exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il bénéficiera à ce titre d’un crédit d’heures de 4 heures par trimestre. » (SAS O-I France - Accord relatif au fonctionnement des CSE, 10/09/2019)
Enfin, même si cela n’est pas explicitement prévu par les dispositions légales, il apparaît que certains accords d’entreprise prévoient que, lorsque plusieurs référents sont désignés par le CSE, la formation sera prise en charge, pour ces deux référents, par l’entreprise (Accord portant sur la représentation du personnel et le droit syndical - Société Silec Cable, 16/07/2019).
B. Le référent désigné par l’employeur
Si les dispositions légales ne prévoient pas explicitement la formation du référent désigné par l’employeur, ce dernier doit cependant s’assurer au préalable que le salarié désigné sera en mesure d’accomplir les missions qui lui seront dévolues, disposant des compétences suffisantes.
En effet, dans le cadre de ses missions, le ministère du Travail recommande, dans son Guide « Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir, agir, sanctionner », le pilotage, par le référent désigné par l’employeur, des formations du personnel encadrant à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
L’employeur doit donc, à ce titre, lui dispenser une formation, indispensable à l’exercice de ses missions qui pourra s’articuler, comme pour le référent CSE, autour :
- d’une formation plus générale en matière de gestion des ressources humaines, d’hygiène et de prévention de la santé et de la sécurité des salariés ;
- d’une formation spécifique afin de fournir les connaissances nécessaires en matière de traitement de situations de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes au sein de la société.
C. La formation commune des référents CSE et employeur
Lorsque l'entreprise compte simultanément un référent d'employeur et un référent CSE, il paraît indispensable que leurs missions s’articulent, notamment dans le cadre de la réalisation d'enquêtes ou de médiation auprès des salariés.
À ce titre, dans le cadre de la conférence de Miroir Social : « Référent(e) harcèlement : quelles convergences entre les actions des CSE et des directions ? », a pu être conseillé la formation commune de ces deux référents, ainsi que de l’ensemble des membres du CSE, sur certaines problématiques :
- l’identification de la place de chacun des référents dans la chaîne de traitement des signalements ;
- l’identification du rôle de chacun des référents parmi les acteurs œuvrant pour la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Cette formation ne pourra cependant pas se faire intégralement de la même manière concernant les référents CSE et celui désigné par l’employeur, du fait notamment de leurs différentes responsabilités, l’un étant représentant du personnel, l’autre pouvant exercer des fonctions dans les ressources humaines.
En outre, il paraît important de rappeler aux référents certaines règles et protections :
- la protection dont bénéficie le référent CSE au titre de membre élu du CSE, le référent employeur ne bénéficiant malheureusement pas de cette protection ;
- le rôle de référent n’étant qu’un « relai » interne visible et qualifié dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, l’employeur n’a pas la possibilité de lui déléguer sa responsabilité en matière de santé et de sécurité ;
- la confidentialité et l’anonymat devant être mis au cœur de toute procédure en lien avec la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
III. Les missions et les moyens mis à la disposition des référents harcèlement sexuel et agissements sexistes
A. Le rôle des référents CSE et employeur
Le Code du travail vient préciser que le référent désigné par l’employeur est en charge d’orienter, d’informer d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Dans son Guide « Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir, agir, sanctionner », le ministère du Travail précise les missions attribuées au référent employeur qui peuvent notamment être les suivantes :
- la réalisation d’actions de sensibilisation et de formation auprès des salariés et du personnel encadrant ;
- l’orientation des salariés vers les autorités compétentes que sont l’inspection du travail, la médecine du travail et le Défenseur des droits ;
- la mise en œuvre de procédures internes visant à favoriser le signalement et le traitement des situations de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes (modalités de signalement, d’enquête…) ;
- la réalisation d’une enquête interne suite au signalement de faits de harcèlement sexuel dans l’entreprise.
Quant au référent du CSE, il est prévu qu’il a pour objectif la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sans plus de précision.
Il y a lieu de considérer qu’il aura la charge du suivi des situations, d’informer les autres membres du CSE et de coordonner les actions de lutte contre les agissements.
Il apparait logique que le référent CSE soit partie prenante de l’ensemble des démarches portant sur la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes qui pourraient être mis en place au sein de l’entreprise.
Certains accords d’entreprise ont développé le rôle des référents CSE et employeur :
« Le rôle du référent harcèlement désigné par la Direction est de :
- décliner les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre les harcèlements (actions de sensibilisation, actions de formation…) ;
- recevoir les demandes et les signalements des salariés ;
- accompagner les salariés et les managers dans la gestion de ces situations de harcèlement, situations avérées ou supposées ;
- conseiller la Direction sur les mesures à prendre en cas de harcèlement supposé ou avéré ;
- travailler en étroite collaboration avec le référent désigné par le CSE.
Le rôle du référent harcèlement désigné par le CSE est de :
- décliner les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre les harcèlements (actions de sensibilisation, actions de formation…) ;
- recevoir les demandes et les signalements des salariés ;
- orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
- conseiller la Direction sur les mesures à prendre en cas de harcèlement supposé ou avéré ;
- travailler en étroite collaboration avec le référent désigné par la Direction. » (Crédit Agricole Payments Services - Accord relatif à la prévention et au traitement des risques psychosociaux et du harcèlement, 18/12/2019)
B. Les moyens des référents CSE et employeur
Le Code du travail prévoit aucun moyen d’action propre aux référents harcèlements sexuels et agissements sexistes.
Il sera toujours possible de définir des moyens d’action dans le cadre d’un accord collectif ou dans le règlement intérieur du CSE pour le référent CSE.
En tout état de cause, le référent CSE pourra mobiliser les moyens d’action dont il dispose en sa qualité de membre du CSE :
- circuler librement et se déplacer pour s’entretenir avec les salariés (C. trav., art. L. 2315-14 N° Lexbase : L8325LGG) ;
- échanger avec l’inspecteur du travail ;
- utiliser son crédit d’heures de délégation ;
- exercer son droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale (C. trav., art. L. 2312-59 N° Lexbase : L1771LRZ) ;
- exercer son droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4132-1 N° Lexbase : L1472H9E à L. 4132-5 N° Lexbase : L1481H9Q) ;
Cependant, il est possible de définir plusieurs « étapes » dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au cours desquelles les référents harcèlement sexuel devront intervenir et disposer de moyens suffisants.
La prévention et la formation.
→ Prévention et formation des salariés :
« Le référent doit être associé et si besoin peut contribuer à l’élaboration de projets d’actions de prévention dans l’entreprise. Il doit être au fait de ce que l’employeur met en place pour prévenir les actes de harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il s’assure que les salariés sont bien informés sur les sanctions encourues et sur les dispositifs de prise en charge des victimes.
Il peut être sollicité lors de l’élaboration de modules de sensibilisation/formation ou en participant à des forums sur la prévention des risques. » (Air France - Accord Prévenir et Agir contre les violences et harcèlements au travail, 15/09/2020)
→ Formation du personnel encadrant :
« La formation des responsables hiérarchiques et la sensibilisation des collaborateurs devraient permettre de limiter et de prévenir toute situation de harcèlement.
Cette sensibilisation est assurée par les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes désignés à cet effet (article 5.2 du présent accord). » (Orange Bank, 25/06/2019)
→ L’élaboration de propositions en vue de l’amélioration du dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes :
« Le référent identifie les axes d’amélioration pour renforcer le dispositif de prévention et les soumet au conseiller QVT/Diversité de l’établissement concerné pour analyse. » (Air France - Accord Prévenir et Agir contre les violences et harcèlements au travail, 15/09/2020)
→ L’élaboration d’état des lieux, de bilans semestriels ou trimestriels sur la situation en matière de harcèlement et agissements sexistes dans l’entreprise : les signalements, le nombre de cas traités au sein de l’entreprise (Conférence Miroir Social - Référent(e) harcèlement : quelles convergences entre les actions des CSE et des directions ?, 12/01/2021)
L’information et l’orientation.
→ La communication obligatoire auprès des salariés des identités et des coordonnées des référents ;
L’affichage des identités et coordonnées des référents dans les locaux ;
L'information et orientation des salariés :
« Il informe ces personnes des démarches à entreprendre, les oriente selon le cas vers le manager, RRH, conseiller QVT/Diversité de l’entité ou vers les acteurs inclus dans le dispositif de traitement des signalements prévu dans l’accord « Prévenir et agir contre les incivilités internes, les violences et harcèlements au travail » (médecine du travail, psychiatre d’entreprise, assistant social, manager…). » (Air France - Accord Prévenir et Agir contre les violences et harcèlements au travail, 15/09/2020)
La mise en œuvre de procédures internes visant à favoriser le signalement et le traitement des situations de harcèlement sexuel ou d’agissement sexiste.
→ La création de supports/de guides :
« Guide pratique pour prévenir et agir contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes au travail - Bosch – 4/07/2019 » ;
« Guide pratique pour mener une enquête interne objective lors de la dénonciation de faits éventuels de harcèlement moral ou sexuel au travail – Bosch – 4/10/2019 ».
→ La mise en place de dispositifs favorisant la remontée d’informations :
- boite mail dédiée au signalement de faits de harcèlement sexuel ou d’agissement sexiste ;
- ligne téléphonique ;
- permanence au sein du service de ressources humaines ou parmi les représentants du personnel dédiée à ce type de remontées ;
- questions à ce sujet lors des entretiens avec les managers (Guide du ministère du Travail).
→ L’aide du salarié victime de harcèlement sexuel ou agissements sexistes à la constitution de son dossier de signalement :
- récit chronologique et détaillé des faits ;
- tout élément susceptibles de constituer une preuve comme des mails, textos, photographies, des certificats médicaux et avis de la médecine du travail ;
- attestations de collègues témoins des faits ;
- attestations de toutes personnes ayant reçu des confidences circonstanciées comme l’inspection du travail, des collègues, des représentants du personnel ;
- le nom des salariés victimes du même harceleur ;
- la copie de plaintes ou de mains courantes.
« Le référent, en cas de sollicitation, apporte un appui aux personnes qui auraient subi des actes de harcèlement sexuel ou des agissements sexistes au sein de leur environnement de travail. Il peut apporter un soutien dans la rédaction du signalement. » (Air France - Accord Prévenir et Agir contre les violences et harcèlements au travail, 15/09/2020)
→ Le rôle d’alerte :
« Le référent joue le rôle d’alerte dans son établissement en faisant remonter auprès des acteurs concernés les situations nécessitant leur contribution.
Afin d’avoir un suivi pertinent des situations de harcèlement sexuel et agissements sexistes, il est destinataire des différents indicateurs prévus être partagés en CSSCT. » (Air France - Accord Prévenir et Agir contre les violences et harcèlements au travail, 15/09/2020)
→ La création d’une procédure en cas de signalement d’une situation de harcèlement/agissements sexistes :
« En cas de harcèlement sexuel :
Les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes doivent être systématiquement, et dans les meilleurs délais, alertés de toute situation supposée de harcèlement. Il est du devoir de chaque collaborateur de la banque, quel que soit son statut, de procéder à cette alerte. Lors de cet échange, les référents rappellent les droits du collaborateur et la procédure ci-après. Les référents se chargent ensuite d’informer la Directrice des ressources humaines dans les plus brefs délais de cette situation supposée de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes » (Accord Orange Bank - 25/06/2019)
« Les différentes étapes à suivre pour réagir à une situation de harcèlement sexuel et/ou agissement sexiste - Cabinet Sextant - 13/02/2020 :
- réception du signalement : référent CSE
- saisie de l’employeur : référent CSE
- réalisation d’une quête : référent CSE + représentant de la Direction
- élaboration d’un rapport : référent CSE + représentant de la direction
- poursuite es relations de travail : employeur
- suite de l’enquête : employeur »
« Le salarié s’estimant victime de harcèlement peut dans un premier temps, se rapprocher de l’interlocuteur de son choix notamment de l’un des interlocuteurs privilégiés (cf. Partie 1, article 2).
La personne sollicitée devra proposer à la personne s’estimant victime de saisir le(s) référent(s) harcèlement.
Indépendamment, le salarié peut saisir à tout moment les référents.
Les deux référents harcèlement (Direction et CSE) peuvent être saisis par tout salarié soit de façon concomitante soit de façon individuelle. Cette saisine est confidentielle.
Si la saisine se fait de façon concomitante, les deux référents se concerteront sur la suite à donner à la saisine dont ils font l’objet. Cette rencontre se fera dans les 48 heures de la saisine initiale. Ils feront, sans attendre, un retour à la Direction de la situation signalée qui pourra prendre les mesures conservatoires qui s’imposent.
Si la saisine se fait auprès de l’un ou l’autre des référents, celui qui est saisi informera dans les 48 heures l’autre référent harcèlement et ils décideront, d’un commun accord, des suites à donner à cette saisine. La Direction sera informée sans tarder de la situation. Elle pourra également prendre les mesures conservatoires qui s’imposent.
Les deux référents procéderont à l’examen et à l’instruction du dossier, ils pourront réaliser des entretiens avec les parties concernées. Et devront écouter les éléments factuels que le salarié, qui s’estime victime, apporte à l’appui de cette plainte (actes, gestes, paroles ou attitudes qui semblent caractériser, selon lui, le harcèlement dont il est victime dans le cadre de son travail).
Le supposé auteur des faits sera également entendu. Des témoins peuvent également être entendus.
Cette procédure devra respecter les principes suivants :
- principe de discrétion ;
- principe d’anonymat dans la communication ;
- écoute neutre et impartiale des différentes parties ;
- une assistance des services de santé au travail pourra être utile.
Dans un délai maximum d’un mois à compter de la saisine, les deux référents feront part de leurs propositions d’action à la Direction, à qui il appartiendra de décider des suites à donner.
À la vue des conclusions, la Direction prendra les mesures appropriées pour chacune des personnes concernées. » (Crédit Agricole Payments Services - Accord relatif à la prévention et au traitement des risques psychosociaux et du harcèlement, 18/12/2019)
→ La vérification par le référent du respect des procédures internes :
« Le référent veille au respect des procédures internes permettant le signalement et le traitement des situations de harcèlement sexuel ou d’agissement sexiste. » (Air France - Accord Prévenir et Agir contre les violences et harcèlements au travail, 15/09/2020)
→ La participation et l’information des référents aux instances mises en place dans le cadre de la prévention de la santé et sécurité des salariés :
La participation du référent désigné par l’employeur aux réunions de la CSSCT (URSSAF de Picardie - Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE, 11/07/2019)
« L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail, l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le salarié Référent Santé Sécurité au Travail (RSST), du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. » (Association service santé au travail Vienne - Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE, 21/05/2019)
La participation des référents à la commission de prévention des risques psycho-sociaux.
(Accord de méthode en vue de la démarche de prévention des risques psychosociaux au sein de l’UES LE GOUESSANT, 04/08/2020)
→ L’accompagnement spécifique de certains salariés :
« Accompagnement spécifique pendant la maternité et paternité
Dès connaissance de la grossesse, un entretien sera organisé avec le responsable hiérarchique afin d’envisager d’éventuels aménagements du poste et si besoin, avec le référent ressources humaines. La salariée pourra ainsi demander, si nécessaire et possible, à faire du télétravail dans la limite de 3 à 4 jours, notamment pour réduire son temps de trajet domicile-travail. » (Bosch - Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la vie au travail, 16/12/2020)
→ La réalisation d’une enquête interne à la suite du signalement de faits de harcèlement sexuel dans l’entreprise :
- le déclenchement de la procédure du droit d’alerte : le signalement du harcèlement sexuel au référent CSE (C. trav., art. L. 2312-5 et L. 2312-59) ;
- la participation du référent à la réunion préparatoire à l’enclenchement de l’enquête :
- La réception du signalement et la première analyse de la situation par le référent CSE ou le référent désigné par l’employeur (Guide du ministère du Travail) ;
- Pour les entreprises de moins de 250 salariés : le référent CSE peut mener cette enquête conjointement avec un membre de la Direction ;
- Pour les entreprises de plus de 250 salariés : le référent désigné par l’employeur, en qualité de représentant de la Direction, peut mener conjointement cette enquête avec le référent CSE, en qualité de représentant du personnel (Guide du ministère du Travail) ;
- « La Direction des ressources humaines accompagnée des deux référents en cas de harcèlement sexuel ou de collaborateurs de la Direction des ressources humaines en cas de harcèlement moral et de discrimination conduisent une première investigation informelle et confidentielle où ils examinent les éléments présentés. Ils interrogent notamment le collaborateur, en lui rappelant systématiquement que de fausses accusations délibérées ne peuvent être tolérées et relèvent de sanctions disciplinaires.
S’ils le jugent utile, la Direction des ressources humaines et les deux référents pourront, dans les mêmes conditions, investiguer auprès de tout autre collaborateur.
À l’issue de cette investigation, si les trois protagonistes concluent :
a) qu’il existe des éléments suffisants établissant une suspicion de harcèlement, une enquête sera diligentée.
b) à l’absence d’élément probant pour suspecter un harcèlement (ex : exercice normal du pouvoir d’organisation ou de direction), ils en avisent par écrit et dans la mesure du possible oralement les parties concernées. La Directrice des ressources humaines met en place la (ou les) action(s) adaptée(s) à la situation qui pourrai(en)t permettre de revenir à des relations de travail apaisées (ex : médiation, entretiens individuels, suivi périodique …)
Des éléments complémentaires qui seraient portés à la connaissance de la Direction des ressources humaines ou des deux référents pourraient conduire à décider » (Accord Orange Bank, 25/06/2019)
→ L’instruction de l’enquête :
« L’enquête est menée par le référent de la Direction des ressources humaines et le référent du Comité Social et Economique (en cas de harcèlement sexuel) ou par les deux collaborateurs désignés au sein de la Direction des Ressources Humaines (en cas de harcèlement moral et de discrimination) afin de garantir une objectivité sur les faits remontés. Dans ce cadre, l’employeur peut décider de prendre toute mesure conservatoire appropriée.
La décision de qualifier ou non les faits de harcèlement est prise conjointement par la Direction des ressources humaines et les référents en concertation avec la Direction générale. » (Accord Orange Bank, 25/06/2019)
« Les deux référents procéderont à l’examen et à l’instruction du dossier, ils pourront réaliser des entretiens avec les parties concernées. Et devront écouter les éléments factuels que le salarié, qui s’estime victime, apporte à l’appui de cette plainte (actes, gestes, paroles ou attitudes qui semblent caractériser, selon lui, le harcèlement dont il est victime dans le cadre de son travail).
Le supposé auteur des faits sera également entendu. Des témoins peuvent également être entendus ». (Crédit Agricole Payments Services - Accord relatif à la prévention et au traitement des risques psychosociaux et du harcèlement, 18/12/2019)
Enfin, il conviendra de rappeler trois points majeurs dans la lutte contre harcèlement sexuel et les agissements sexistes :
- l’importance de l’engagement de la part de l’employeur ;
- la création de procédures claires, homogènes et connues de tous : intégrant le règlement intérieur, structurée et garantissant l’impartialité ;
- le respect des différents interlocuteurs : les plaignants, les personnes mises en cause, les « relais » internes de l’entreprise comme les référents.
Il paraît primordial que l’entreprise communique et confirme auprès de chacun des interlocuteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexiste la politique qu’elle entend mener.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477120
[Brèves] Modifications du Code de la commande publique post-loi « ASAP » : montant prévisionnel du marché confié à une PME, marchés de services juridiques, dispenses de jury…
Réf. : Décret n° 2021-357, du 30 mars 2021, portant diverses dispositions en matière de commande publique (N° Lexbase : L9047L3H)
Lecture: 2 min
N7066BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 07 Avril 2021
► Le décret n° 2021-357 du 30 mars 2021, portant diverses dispositions en matière de commande publique (N° Lexbase : L9047L3H), pris pour l'application des articles 131 et 140 de loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, d'accélération et de simplification de l'action publique (N° Lexbase : L9872LYB), intéressera spécialement les acheteurs publics, les opérateurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises et artisans et les avocats.
Le décret fixe à 10 % du montant prévisionnel du marché la part minimale que le titulaire d'un marché global, qui n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise (PME) ou un artisan, s'engage à confier, directement ou indirectement, à une PME ou à un artisan, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Il abroge ensuite les dispositions relatives à la procédure de passation des marchés de services juridiques de représentation en justice par un avocat et de consultation juridique qui se rapportent à un contentieux.
Il a également pour objet de mettre en cohérence les hypothèses de dispense de jury pour l'attribution des marchés globaux avec les hypothèses de dispense de concours pour l'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre.
Le décret précise enfin le point de départ du délai de paiement du solde des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour tenir compte du mécanisme de décompte général et définitif prévu par le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables à ces marchés, approuvé par arrêté du 30 mars 2021 (N° Lexbase : L9095L3A).
Enfin, le nouvel article R. 2123-2 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L2632LRW) prévoit que lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 (N° Lexbase : L2631LRU) et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services.
Ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477066
[Brèves] Qui dispose du pouvoir d’écarter des pièces des débats ? Le juge de la mise en état ou le TGI devenu le TJ ?
Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-16.216 , F-P (N° Lexbase : A66884MN)
Lecture: 3 min
N7125BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 09 Avril 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 mars 2021, après avoir énoncé que les attributions du juge de la mise en état sont fixées de façon limitative par les articles 763 (N° Lexbase : L8601LY9) à 772-1 (N° Lexbase : L7046LEP) du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (N° Lexbase : L8421LT3), précise que seul le tribunal de grande instance dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie.
Faits et procédure. Dans cette affaire, pendante devant le tribunal de grande instance, opposant une société à des époux, le juge de la mise en état, par ordonnance rendue le 12 juin 2018, s’est déclaré compétent pour connaître d’une demande de la société tendant à voir écarter des pièces produites par les défendeurs, puis a écarté des débats deux pièces, au motif qu’elles étaient couvertes par le secret professionnel.
Les défendeurs ont interjeté appel à l’encontre de cette décision, en vue de voir prononcer son annulation pour excès de pouvoir.
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense. La recevabilité du pourvoi a été contestée par la défenderesse, au motif que les décisions rendues en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation si elles ne tranchent pas, au moins en partie, le principal. La Haute juridiction énonce qu’il est dérogé à cette règle lorsque la décision attaquée a commis ou consacré un excès de pouvoir. Elle rappelle que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées dans le Code de procédure civile, et qu’aucune de ces dispositions, en particulier l’article 770 (N° Lexbase : L6995H79), devenu l’article 788 (N° Lexbase : L9247LTN) du Code de procédure civile, selon lequel le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie.
Les Hauts magistrats déclarent le pourvoi recevable.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt (CA Lyon, 28 mars 2019, n° 18/04723 N° Lexbase : A7790Y7N), d’avoir violé l’article 770 du Code de procédure civile, ensemble les principes régissant l’excès de pouvoir, en déclarant leur appel irrecevable. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’ordonnance du juge de la mise en état, étant insusceptible de recours immédiat, les appelants sont recevables en leur appel-nullité, mais qu’il leur appartient d’établir que ce juge a commis un excès de pouvoir en écartant des pièces des débats, sans que la nature de ces dernières soit importante. Les juges d’appel ont retenu la défaillance des appelants dans l’administration de cette preuve. En l’espèce, les demandeurs avaient soulevé la compétence du juge de la mise en état, et non pas la demande dont il était saisi qui excéderait ses pouvoirs. La cour d’appel énonce que le juge de la mise en état ne s’est pas attribué un pouvoir qu’il n’avait pas, mais qu’il a éventuellement exercé une compétence qu’il n’avait pas.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant la violation des textes précités dans sa solution.
La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
|
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les procédures devant le tribunal judiciaire, Les pouvoirs du juge de la mise en état, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E3937EUD). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477125
[Brèves] Garde à vue supplétive et auditions sur les faits nouveaux : l’absence d’information du procureur de la République dès le début de la mesure fait nécessairement grief à l’intéressé
Réf. : Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-86.407, FS-D (N° Lexbase : A47644NR)
Lecture: 7 min
N7096BYH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
Le 28 Avril 2021
► L’audition d’une personne gardée à vue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime suppose soit qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission de l’infraction, soit, si tel n’est pas le cas, que les nécessités de l’enquête l’exigent ;
Il appartient à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur de la République, dès le début de la mesure, tant des soupçons pesant sur l’intéressé que de la qualification susceptible d’être notifiée à celui-ci ; Le défaut d’un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts du gardé à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition portant sur les nouveaux faits et des actes subséquents qui trouvent dans cette nullité leur support nécessaire et exclusif.
Rappel préliminaire. L’article 65 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3161I3H) prévoit que lorsqu’il apparaît, au cours d’une garde à vue, que la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues au 1° (qualification, date et lieux présumés de l’infraction), 3° (droit d’être assisté par un interprète) et 4° (droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire) de l’article 61-1 du même code (N° Lexbase : L7280LZN) et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 (N° Lexbase : L4969K8K) et 63-4-3 (N° Lexbase : L9632IPG) du Code de procédure pénale.
Rappel de la procédure. Par une demande d’avis, en date du 17 novembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la Chambre criminelle de questions relatives à la garde à vue supplétive, ne visant pas l’article 65 du Code de procédure pénale et indiquant que la personne gardée à vue est informée des nouveaux faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis et qu’il lui est notifié le bénéfice des droits prévus aux articles 63-1 (N° Lexbase : L4971K8M) et 63-4 (N° Lexbase : L9746IPN) du Code de procédure pénale, tout en mentionnant que celle-ci prend acte uniquement de son droit au silence et de son droit d’être assistée d’un avocat.
Questions. Les questions suivantes étaient posées à la Chambre criminelle :
- Doit-il être considéré qu’il a été fait application par les services de police de l’article 65 ou qu’il s’agit d’une nouvelle garde à vue ?
- Dans l’une ou l’autre hypothèse, le procureur de la République, avisé du placement en garde à vue initial, conformément à l’article 63, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7438LP8) doit-il recevoir un nouvel avis en application de ce texte ?
- Dans l’affirmative, l’absence d’un tel avis fait-elle nécessairement grief aux intérêts du gardé à vue ?
- À supposerque la nullité soit encourue, quelle serait l’étendue de celle-ci ?
Avis. À la première question, la Chambre criminelle répond que, dans les circonstances évoquées, la réalisation des notifications exigées par l’article 65 du Code de procédure pénale conduit à considérer qu’il a été fait application de cet article par les services de police, peu important que le procès-verbal n’ait pas visé ledit article et que le gardé à vue ait uniquement pris acte de son droit au silence et de son droit d’être assisté d’un avocat. La Chambre criminelle précise par ailleurs que la notification d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, n’a pas pour conséquence de générer une garde à vue distincte au cours de laquelle la notification est réalisée. En l’absence de nouveau placement en garde à vue, l’article 63, alinéa 2, du Code de procédure pénale, prévoyant l’information du procureur de la République à l’occasion du placement en garde à vue, n’est pas applicable.
Le procureur de la République n’est toutefois pas dénué de tout rôle à l’occasion d’une extension de la garde à vue. En effet, la Cour précise que la personne entendue sur des faits autres que ceux ayant motivé le placement initial en garde à vue demeure soumise, à l’occasion de son audition, à une mesure de contrainte. Or, cette mesure s’exécute sous le contrôle du procureur de la République en sa qualité de gardien de la liberté individuelle (C. proc. pén., art. 62-3 N° Lexbase : L9628IPB). Il appartient donc à ce magistrat de s’assurer que le gardé à vue n’est pas entendu sur des faits pour lesquels il ne pourrait légalement l’être qu’en audition libre.
Pour préciser le rôle du magistrat, la Chambre criminelle se réfère donc aux conditions légales de la garde à vue et plus largement de l’audition sous contrainte. Pour s’assurer qu’un gardé à vue peut être valablement entendu sur des faits étrangers à ceux ayant motivé son placement en garde à vue, le procureur de la République doit donc s’assurer que les faits sur lesquels porte l’audition sont incriminés pénalement et susceptibles d’être sanctionnés d’une peine d’emprisonnement. Par ailleurs, la Cour précise que ne peut être entendue sous contrainte, sauf lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, une personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle ait commis ou tenté de commettre une infraction.
La Chambre criminelle conclut qu’il appartient, pour permettre l’effectivité de ce contrôle, aux officiers de police judiciaire d’informer le procureur de la République, dès le début de la mesure, des soupçons pesant sur l’intéressé et de la qualification susceptible d’être retenue.
La Cour précise enfin que le défaut d’un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts du gardé à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition portant sur les nouveaux faits et des actes subséquents qui trouvent dans cette nullité leur support nécessaire et exclusif.
Contexte. À l’approche des dix ans de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN), c’est la deuxième fois en moins d’un mois que la Chambre criminelle apporte une précision en matière d’extension de la poursuite initiale en cours de garde à vue. Ainsi, dans un arrêt du 2 mars 2021, elle jugeait que la personne gardée à vue entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une infraction autre que celle ayant justifié son placement en garde à vue et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction doit bénéficier, après avoir été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et si elle a déclaré vouloir l’exercer, du droit de communiquer avec celui-ci lors d’un entretien confidentiel, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits (Cass. crim., 2 mars 2021, n° 20-85.491, FS-P+I N° Lexbase : A49974IW).
| Pour aller plus loin : v. C. Lanta de Bérard, ÉTUDE : La garde à vue et les auditions, Les auditions et confrontations, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E56693CX). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477096
[Brèves] Obligation de supporter les frais d’obsèques de ses parents : possibilité de décharge en cas de comportement gravement fautif du défunt à l’égard de l’enfant
Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 20-14.107, FS-P (N° Lexbase : A47104NR)
Lecture: 2 min
N7145BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 12 Avril 2021
► Il résulte de la combinaison des articles 205 (N° Lexbase : L2270ABP), 207 (N° Lexbase : L8537LXH), 371 (N° Lexbase : L2893ABR) et 806 (N° Lexbase : L9881HNB) du Code civil que, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources ;
► il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.
Dans cette affaire, selon un jugement rendu en dernier ressort, le frère du défunt avait chargé une société de pompes funèbres de l'organisation des funérailles de son frère. N'ayant pas été réglée de ses prestations, la société avait assigné le frère du défunt, lequel avait, sur le fondement des articles 205 et 371 du Code civil, appelé en garantie le fils du défunt. Il faisait grief au jugement rendu par le tribunal d’instance de Châteauroux, statuant en dernier ressort, de rejeter sa demande.
Parmi les arguments avancés, il soutenait notamment que l’héritier, même renonçant, était tenu au paiement des frais funéraires de son ascendant, obligation distincte, selon lui, de l’obligation alimentaire.
Il n’obtiendra pas gain de cause.
La Haute juridiction approuve le jugement ayant énoncé à bon droit que l'exception d’indignité de l'article 207 du Code civil permet à l'enfant d’être affranchi de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du même code, s’il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard.
On comprend, dès lors, que la Cour de cassation assimile l’obligation de supporter les frais d’obsèques au rang des obligations alimentaires.
En l’espèce, le jugement avait retenu qu'il résultait des attestations produites que le défunt n’avait jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu'il s’était désintéressé de celui-ci et s'était abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui.
Selon la Cour suprême, le tribunal avait pu déduire de ces énonciations et appréciations que l’intéressé devait être déchargé de son obligation envers le défunt.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477145