[Textes] Les difficultés liées à l’application de la nouvelle obligation d’information en cas d’accident du travail mortel
Réf. : Décret n° 2023-452, du 9 juin 2023, relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier N° Lexbase : L8634MHA
Lecture: 10 min
N6100BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Naouele Benhaddou, Avocate, Directrice de mission, BDO Avocats
Le 03 Juillet 2023
Mots-clés : accident mortel du travail • obligation • déclaration • délai de douze heures • inspection du travail • affichage • chantier
Le décret n° 2023-452 du 9 juin 2023, publié au Journal officiel du 11 juin 2023, relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier a, dans le cadre du plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels, précisé les obligations d’information de l’Inspection du travail qui incombent aux entreprises en cas d’accident du travail mortel, assortissant cette obligation d’une sanction pénale en cas de non-respect.
De plus, il permet aux entrepreneurs travaillant sur un chantier de recourir à un QR-code, plutôt qu’un panneau d’affichage classique, pour afficher les informations obligatoires.
I. Obligation d’information de l’inspection du travail par l’employeur en cas d’accident mortel
En cas d’accident du travail mortel, l’employeur a l’obligation, dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur, d’effectuer une information auprès de l’inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l’accident.
Si le ministère du Travail a pris ce texte dans un souci d’efficacité des enquêtes en cas d’accident mortel du travail (A.), il convient de souligner des difficultés quant aux modalités d’application (B.) et de la sanction encourue (C.).
A. Objectif et contenu de l’obligation d’information
1) L’objectif poursuivi par cette nouvelle obligation
Avant l’entrée en vigueur de ce texte, en cas d’accident du travail mortel, une enquête était réalisée par les services de l’inspection du travail afin de vérifier si un manquement dans l’application de la réglementation était ou non à l’origine de cet accident.
En pratique, les services de police ou de gendarmerie se chargeaient de prévenir l’inspection du travail de l’accident puisqu’aucune disposition légale ne faisait obligation à l’employeur d’avertir l’inspection du travail de la survenance d’un tel accident.
Avec ce décret, l’employeur a une obligation déclarative auprès de l’inspection du travail, encadrée dans un délai relativement court (C. trav., art. R. 4121-5 N° Lexbase : L8766MH7).
L’objectif poursuivi est, d’après le Ministère du travail (communiqué de presse du 11 juin 2023), de parvenir à déterminer au mieux les circonstances de l’accident en permettant à l’inspection du travail d’arriver sur les lieux dans un temps extrêmement proche de l’accident et de garantir au mieux l’efficacité de l’enquête menée sur l’accident
En effet, selon le Ministère du travail, « des constats trop tardifs sont susceptibles de nuire à la manifestation de la vérité, compte tenu du risque d’altération des preuves ».
2) Le contenu de cette information
Cette information, effectuée par tout moyen conférant date certaine, auprès de l’inspection du travail territorialement compétente, devra comprendre (C. trav., art. R. 4121-5, al. 3) :
« Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie le travailleur au moment de l’accident ;
Le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’accident s’est produit si celui-ci est différent de l’entreprise ou établissement employeur ;
Les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
Les date, heure, lieu et circonstances de l’accident ;
L’identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant ».
Il convient de préciser que le non-respect de cette obligation constitue une contravention de 5ème classe (C. trav., art. R. 4741-2 N° Lexbase : L8767MH8).
Cette obligation ne dispense bien entendu pas l’employeur d’établir la déclaration d’accident du travail dans un délai de 48 heures suivant sa connaissance (CSS, art. R. 441-3 N° Lexbase : L0580LQK).
B. Une obligation aux modalités d’applications complexes
Cette nouvelle obligation, en apparence relativement simple, est toutefois source de nombreuses interrogations pratiques.
Il apparaît en effet que la rédaction de l’article R. 4121-5 du Code du travail, qui instaure cette nouvelle obligation, suscite des difficultés pratiques.
Ce nouvel article dispose, dans ses deux premiers alinéas, que :
« Lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail ayant entraîné son décès, l’employeur informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l’accident immédiatement et au plus tard dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur, sauf s’il établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l’expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de douze heures imparti à l’employeur pour informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail court à compter du moment où l’employeur a connaissance du décès du travailleur.
Cette information est communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi ».
Deux difficultés se posent alors.
1) Une difficulté quant au délai applicable
Comme il l’a été évoqué, l’article R. 4121-5 du Code du travail précise que l’employeur doit informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail immédiatement et au plus tard dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur, sauf s’il établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l’expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de douze heures imparti à l’employeur pour informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail court à compter du moment où l’employeur a connaissance du décès du travailleur.
Il apparaît, à la lecture de cet article, que l’employeur dispose d’un délai de douze heures à compter de l’accident, pour remplir son obligation informative.
Ce n’est que s’il a eu connaissance de l’accident postérieurement à l’expiration de ce délai de douze heures, qu’un nouveau délai de douze heures suivant sa connaissance de l’accident lui est ouvert pour remplir son obligation d’information auprès de l’inspection du travail.
Dès lors, l’employeur qui aurait connaissance de l’accident après sa survenance mais avant l’expiration du délai de douze heures, ne disposerait que du temps restant à courir jusqu’à l’expiration de ces douze heures pour informer l’inspection du travail de cet accident.
Cette rédaction laisse perplexe puisque cela signifie que l’employeur qui aurait eu connaissance l’accident onze heures trente après sa survenance ne disposerait que de trente minutes pour remplir son obligation informative auprès de l’inspection du travail.
En revanche, l’employeur qui aurait été informé de l’accident douze heures trente après sa survenance, voir trente heures après, disposerait d’un nouveau délai de douze heures pour effectuer l’information auprès de l’inspection du travail.
Une telle rédaction est absurde est incitera, à coup sûr, les employeurs qui n’ont pas été avisés immédiatement de l’accident, d’indiquer n’en avoir eu connaissance que postérieurement au délai de douze heures.
Peut-être aurait-il été plus logique de prévoir que cette obligation d’information devait être effectuée dans les douze heures suivant la connaissance par l’employeur de l’accident, peu importe qu’il en ait eu connaissance avant ou après l’expiration d’un délai de douze heures suivant la survenance de cet accident.
Il n’est d’ailleurs pas à exclure que cette lecture soit retenue en pratique.
2) Une difficulté quant aux modalités d’information
L’article R. 4121-5 du Code du Travail dispose, en son alinéa 2, que « cette information est communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi ».
Il apparaît toutefois que la preuve de cette information dans le délai de douze heures sera difficile à rapporter.
N’oublions en effet pas que le recommandé, tout comme l’acte signifié par huissier de justice – seuls actes permettant de conférer date certaine à l’envoi – ne précisent que la date à laquelle l’envoi a été effectué et non l’heure.
En effet, et comme le nouvel article le précise, ces modalités confèrent date certaine et non heure certaine !
Comment alors démontrer que l’information a été faite dans le délai de douze heures ?
Cela semble très difficile, voire impossible, en pratique.
C. Sanction en cas de non-respect de cette obligation
Il convient de préciser que le non-respect de cette obligation constitue une infraction pénale, l’employeur encourant une amende de cinquième classe conformément aux dispositions de l’article R. 4741-2 du Code du travail, soit 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Cette peine est doublée en cas de récidive dans un délai de « un an à compter de la prescription de la précédente peine ».
Il est légitime, au vu des difficultés d’application de cette obligation, de s’interroger sur les possibilités pour l’employeur d’échapper à la peine s’il ne parvient pas à démontrer avoir respecter les délais impartis par les textes.
Il semble raisonnable de penser que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale permettra à l’employeur d’échapper à la sanction, celui-ci ne pouvant matériellement prouver avoir effectuer l’information dans les délais impartis, les modes d’envoi conférant date certaine ne permettant en effet pas de s’assurer de l’heure d’envoi.
Force est donc de constater que cette obligation suscite de nombreuses difficultés dans ces modalités d’application pratique.
II. Nouvelles modalités d’affichage sur les chantiers
Le décret renforce l’obligation de transparence et de visibilité des entreprises intervenantes sur les chantiers du bâtiment (C. trav., art. R. 8221-1 N° Lexbase : L8768MH9).
L’objectif poursuivi par cette mesure est, selon le ministère du Travail, d’améliorer l’efficacité des moyens de lutte contre le travail dissimulé, qui serait un facteur de survenance d’accidents du travail.
C’est ainsi qu’avant l’entrée en vigueur de ce décret, l’article R. 8221-1 du Code du travail disposait que :
« L'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique ».
Cet article a été complété et dispose désormais que :
« L'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. Les informations mentionnées au premier alinéa peuvent également être affichées de manière synthétique sous la forme d'un code bi-dimensionnel visible depuis la voie publique, gratuit pour toute personne appelée à le consulter et généré par un dispositif numérique sécurisé ».
Avec l’entrée en vigueur du décret, il est donc possible de mettre en place un espace numérique partagé sur lequel les entreprises intervenantes sont invitées à renseigner les informations prévues par la réglementation (nom, raison ou dénomination sociale, adresse). Une fois ces données renseignées sur l’espace numérique, celles-ci sont rendues accessibles à toute personne, par le scan du QR Code visible depuis la voie publique.
Pour les professionnels intervenant sur le chantier, cette solution permet de :
- simplifier la collecte d’informations relatives aux entreprises et la mise à jour des coordonnées des intervenants sur le panneau ;
- faciliter la déclaration de l’entreprise en toute autonomie.
Pour les organismes de contrôle, cette solution permet de disposer en temps réel des informations liées à tous leurs chantiers (nom, coordonnées, numéro SIRET des entreprises intervenantes) soit en se connectant gratuitement à une plateforme, soit sur le chantier en scannant le QR code.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486100
[Brèves] Interprétation stricte de la liste des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance
Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2023, n° 21-10.256, FS-B N° Lexbase : A1493943
Lecture: 2 min
N6120BZP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 29 Juin 2023
► Les exceptions sont d’interprétation stricte ; la liste des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurances est une exception, aussi, il n’est pas fait application de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal.
La conciliation des principes applicables donne l’occasion aux juges de préciser l’interprétation de certains textes. En l’espèce, il s’agissait de savoir si l’exception à l’obligation d’assurance est d’interprétation stricte ainsi que de savoir s’il pouvait être fait application de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal.
Au présent cas, un maître d’ouvrage entreprend la construction d’un bâtiment de stockage des déchets. Se plaignant de dysfonctionnements des réseaux d’évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, le maître d’ouvrage assigne les constructeurs et leurs assureurs.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 22 octobre 2020 (CA Rennes, 22 octobre 2020, n° 18/00915 N° Lexbase : A54283YP), rejette l’appel en garantie formé à l’encontre d’un assureur, au motif que le bassin d’orage en litige serait l’accessoire des ouvrages de stockage de déchets, non-soumis à l’obligation d’assurance.
Un pourvoi est formé mais il est rejeté. Selon sa plus si nouvelle technique de motivation enrichie, la Haute juridiction se livre à une interprétation claire des dispositions de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2007IBX.
Elle rappelle que ce texte liste :
- en son premier alinéa, des ouvrages qui sont exclus de l’obligation d’assurance ;
- en son second alinéa, des ouvrages qui n’en sont exclus que s’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à obligation.
Elle expose encore que, s’agissant d’une exception, ce texte est d’interprétation stricte.
Il en résulte qu’un ouvrage non visé expressément à l’article L. 243-1-1 précité reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui est exclu.
Les juges du fond ne pouvaient donc pas considérer que l’opération portait sur la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d’assurance et que le bassin d’orage en était l’accessoire.
Un ouvrage accessoire à un ouvrage non soumis est soumis.
Ainsi, un ouvrage peut être soumis à la responsabilité civile décennale mais non soumis à l’assurance obligatoire, ce qui contrevient à l’esprit du Législateur qui souhaite que le constructeur soit assuré pour les dommages de gravité décennale, raison pour laquelle ces exceptions sont interprétées strictement.
Ce n’est pas la première fois que la Haute juridiction se livre à une interprétation restrictive du texte (pour exemple, Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-23.020, F-D N° Lexbase : A0749WSK même si antérieur à la réforme de 2005).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486120
[Brèves] En matière d’assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d’ordre public sont applicables
Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2023, n° 21-20.538, F-B N° Lexbase : A99409Z8
Lecture: 3 min
N6006BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 22 Juin 2023
► Les dispositions d’ordre public sont applicables :
- même en cas d’assurance de dommages non-obligatoire ;
- quelle que soit la loi régissant le contrat ;
L’assureur de droit étranger doit en avoir connaissance.
L’arrêt rapporté concerne une assurance de dommages donc reste parfaitement transposable au domaine de la construction et ce d’autant que le litige est relatif à des panneaux photovoltaïques dont chacun sait qu’ils peuvent être qualifiés d’ouvrage.
En l’espèce, un particulier a fait installer sur la toiture de bâtiments abritant son élevage de lapins, des panneaux photovoltaïques, affectés de dommages sériels que tous connaissent. En raison de la présence de fumées au niveau d’un module, l’installation est mise hors service et le particulier fait procéder au remplacement de la totalité des panneaux. Ils assignent l’installateur et les différents assureurs du fabricant en indemnisation des frais de remplacement des panneaux et pertes de recettes causés par les pertes de production.
L’un des assureurs de droit étranger oppose un refus de garantie en raison du caractère sériel des panneaux. Il se fonde, à cet égard, sur une clause d’exclusion de sa police et expose, aussi, que la loi applicable serait la loi du pays de l’assureur.
La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 6 avril 2021, fait application de cette clause d’exclusion, qu’elle considère comme claire et précise. Les conseillers rejettent ainsi l’appel en garantie formé par les assureurs français contre cet assureur néerlandais. Ils forment un pourvoi en cassation.
Ils exposent, d’une part, qu’en application de l’article L. 181-3 du Code des assurances N° Lexbase : L0242AA9, les dispositions d’ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d’assurance. La Haute juridiction censure. En matière d’assurance de dommages non-obligatoire, les dispositions d’ordre public des articles L. 111-2 N° Lexbase : L9555LGY et L. 181-3 du Code des assurances sont applicables peu importe la loi régissant le contrat.
Ils exposent, d’autre part, que la clause d’exclusion ne répondrait pas aux exigences d’ordre public des articles L. 112-4 N° Lexbase : L0055AAB et L. 113-1 N° Lexbase : L0060AAH du même code. Là encore, la Haute juridiction censure. Le deuxième texte rappelle qu’il y a deux types d’exclusions : légales et conventionnelles. S’agissant des dernières, leur validité est strictement encadrée puisqu’elles doivent être écrites en caractères gras et apparent, mais encore, formelles, limitées et ne pas vider la police de sa substance.
La jurisprudence est d’ailleurs très stricte pour admettre la validité de ces clauses.
L’objectif est de permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie convenue (pour exemple, Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-22.412, FS-D N° Lexbase : A1162IZ3)
Les juges du fond doivent vérifier ces conditions quand bien même il s’agit d’une police étrangère.
Cette décision est une invitation à suivre attentivement l’analyse faite par la Cour de renvoi. Le droit de la construction connaît lui aussi pas mal d’assureurs de droit étranger.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486006
[Chronique] Chronique de droit des assurances – Juin 2023
Lecture: 12 min
N6053BZ9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Rodolphe Bigot - Maître de conférences en droit privé et codirecteur de la Licence Assurance Banque Finance à l’Université du Mans et Amandine Cayol - Maître de conférences en droit privé et codirectrice du Master Assurances de l’Université Caen Normandie
Le 28 Juin 2023
Mots-clés : contrats d’assurance collective • assurance de groupe • adhésion obligatoire • adhésion facultative • obligation d’information • notice d’information • adhérent • modification • clause d’exclusion
Lexbase Droit privé vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique en droit des assurances dirigée par Rodolphe Bigot, Maître de conférences en droit privé et codirecteur de la Licence Assurance Banque Finance à l’Université du Mans et par Amandine Cayol, Maître de conférences en droit privé et codirectrice du Master Assurances de l’Université Caen Normandie. Au sommaire de cette chronique, sera abordé un thème complexe du droit des assurances, relatif aux contrats d’assurance collective et à leur régime.
Les obligations des parties à l’assurance collective ont été interrogées. Le souscripteur d’une assurance de groupe obligatoire doit informer par écrit ses adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur (C. assur., art. L. 141-4 N° Lexbase : L9846HEE). Le souscripteur d’un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en remettant à l’adhérent une notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application (Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 20-22.503, F-D N° Lexbase : A517689L). Sont donc inopposables à l’adhérent les modifications de la notice par avenant que l’assureur ne démontre pas avoir adressées à l’employeur souscripteur afin que ce dernier les remette à son tour à ses adhérents (TJ Paris, 5e ch., 2e sect., 16 juin 2022, RG n° 19/12819). L’article L. 141-4, qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu'obligatoire, ne prévoit pas d'exception à cette obligation d'information lorsque la modification apportée aux droits et obligations des adhérents au contrat résulte d'un accord collectif (Cass. civ. 2, 25 mai 2023, n° 21-15.842, FS-B N° Lexbase : A59779WB, pt 13). De même, l’assureur ne peut se prévaloir à l’encontre de l’adhérent de la clause d’exclusion qui n’a pas été portée à la connaissance de ce dernier (Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-21.008, F-B N° Lexbase : A53129LC).
Information des adhérents au sein des contrats d’assurance collective
Les schémas et les mécanismes de l’assurance collective sont complexes [1]. La notice préalablement rédigée par l’assureur doit être remise à l’adhérent par le souscripteur, lequel respecte ainsi son obligation d’information à l’égard de l’adhérent et lui rend les conditions de garantie opposables [2]. Cette opposabilité ne résulte pas du consentement de l’adhérent mais d’un processus légal. Il s’agit d’une « chaîne » ou d’une « rivière » d’informations, dont l’assureur se trouve principalement à la source, laquelle irrigue le souscripteur qui, à son tour, alimente l’adhérent.
Détenteurs d’un pouvoir souverain, les juges du fond apprécient librement les éléments de preuve de remise de la notice aux adhérents, dont le fardeau repose classiquement sur les épaules du souscripteur [3]. Tous les moyens de preuve sont recevables [4]. Une telle notice doit être rédigée par l’assureur [5] et peut apparaître sous la forme d’un document séparé ou être imprimée au verso du bulletin d’adhésion à la condition qu’un renvoi explicite figure au recto [6]. À défaut, le souscripteur est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète [7].
La deuxième chambre civile a ainsi rappelé, dans un arrêt du 30 mars 2023 (Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-21.008, F-B N° Lexbase : A53129LC), que l’assureur ne peut se prévaloir à l’encontre de l’adhérent de la clause d’exclusion qui n’a pas été portée à la connaissance de ce dernier [8].
De même, un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 19 janvier 2023 (Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 20-22.503, F-D N° Lexbase : A517689L) souligne que le souscripteur d’un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en remettant à l’adhérent une notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application [9].
L’obligation d’information et de conseil du souscripteur perdure tout au long de la vie du contrat, l’assuré (et/ou adhérent) devant être informé en temps utile des modifications apportées à son contrat [10]. Concernant la modification des garanties d’une assurance de groupe, deux régimes ont, plus précisément, été institués : l’un de droit commun [11], l’autre spécial [12]. Dans le droit commun, pour rendre opposables erga omnes les modifications de la police collective envisagées avec l’assureur (même celles qui diminuent les garanties), le souscripteur n’est pas tenu d’obtenir l’accord de chaque adhérent. Il doit seulement en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur [13].
Une décision de 2018 avait déjà rappelé que l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d’en informer par écrit [14] les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur ; une telle modification étant alors opposable aux adhérents sous réserve d’un abus de droit, lequel ne saurait être présumé [15]. Un tel abus reste difficile à établir concrètement [16]. Depuis peu, le défaut d’information peut également être constitutif d’une pratique commerciale déloyale [17].
Notons que « si la chaîne de transmission a été rompue par le souscripteur employeur et que c’est à celui-ci qu’est imputable le défaut de remise de la notice d’information, l’organisme assureur oppose valablement au salarié adhérent les dispositions de la notice d’information que ce dernier n’a jamais eue en main (Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-20.369, F-D N° Lexbase : A172938K) : la solution peut paraître dure pour le salarié adhérent peu au fait de ces subtilités, elle n’en est pas moins tout à fait rigoureuse dès lors que, en matière de couverture collective des salariés, le souscripteur n’est pas le mandataire de l’organisme assureur (C. assur., art. L. 141-6 N° Lexbase : L2669IX7). Le salarié-adhérent ne peut alors que se retourner contre le souscripteur employeur, cette fois-ci devant le conseil de prud’hommes, dans le cadre d’une action en responsabilité normale : le salarié y obtiendra l’indemnisation du préjudice subi à raison du défaut d’information dont il a été victime » [18].
En revanche, si l’assureur ne transmet pas au souscripteur les éléments essentiels du contrat, comment le souscripteur pourrait-il les remettre utilement à l’adhérent ? L’informateur légal n’étant lui-même pas – officiellement du moins [19] – informé, quelle sanction choisir pour espérer une amélioration des pratiques ?
Un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2022 (TJ Paris, 5e ch., 2e sect., 16 juin 2022, RG n° 19/12819) [20] rappelle que sont inopposables à l’adhérent les modifications de la notice par avenant que l’assureur ne démontre pas avoir adressées à l’employeur souscripteur afin que ce dernier les remette à son tour à ses adhérents.
En l’espèce, un pilote professionnel est embauché en 1991 par une compagnie aérienne. En 2009, l’employeur souscrit un contrat d’assurance collective [21] à adhésion obligatoire auprès d’une société d’assurance vie ayant pour objet de garantir l’ensemble de son personnel navigant technique contre les risques « décès et perte définitive de licence ». Par avenant du 26 mai 2016, à effet du 1er janvier 2016, l’employeur et l’assureur conviennent de modifier l’article 9 de ce contrat en instituant une dégressivité du capital en cas de perte définitive de licence des assurés âgés de 57 ans et plus. Par une décision d’août 2019, le Conseil médical de l’aéronautique civile déclare le pilote inapte définitivement à exercer sa profession de navigant à compter de décembre 2016. L’assureur lui règle alors la somme de 69 142,90 euros en application du contrat d’assurance de groupe. Un litige survient alors concernant le montant de l’indemnité. L’assuré conteste que l’avenant lui soit applicable et agit en paiement d’un complément d’indemnité contre l’assureur. Ce dernier forme à son tour une demande en garantie contre le souscripteur. Soulignons que l’assureur n’avait pas adressé la notice, telle que modifiée par l’avenant du 26 mai 2016, à la compagnie aérienne souscriptrice afin que cette dernière la remette à son tour à ses adhérents.
Le tribunal judiciaire de Paris était amené à répondre à trois questions, dont seules les deux dernières intéressent directement notre sujet. Primo, le souscripteur d’une assurance de groupe obligatoire doit-il informer par écrit ses adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur ? Oui, retient la juridiction du fond qui précise la nature de la sanction applicable. Secundo, la demande subsidiaire en garantie formée par l’assureur contre la souscriptrice est-elle recevable ? Non, nous dit le juge du fond, compte tenu de sa propre faute en amont.
Si la loi « DDAC » du 15 décembre 2005 a précisé, à l’article L. 141-4 du Code des assurances N° Lexbase : L9846HEE (et non pas l’article L. 114-1, manifestement visé par erreur dans le jugement commenté ; p. 6, in fine), le délai durant lequel l’information doit être délivrée à l’adhérent, elle n’a regrettablement rien dit sur les conséquences d’un défaut d’information ou d’une information tardive en cas de modification apportées à ses droits et obligations. Deux sanctions sont envisageables – responsabilité civile ou inopposabilité des modifications –la doctrine semblant distinguer selon la nature du contrat envisagé – à adhésion obligatoire ou facultative – et retenant des qualifications juridiques variables (stipulation pour autrui, voire stipulation de contrat pour autrui [22], ou contrat-cadre) [23]. Ainsi, on peut regretter que « le législateur n’ait pas précisé la nature de la sanction, ce qui aurait permis d’éviter une incertitude juridique supplémentaire, ni déterminé les modes de preuve de l’exécution de l’information dans les délais impartis, ce que laisse présager de conflits futurs » [24].
Une allusion est faite, dans le jugement commenté, à la rétroactivité de la prise d’effet de la modification négociée entre le souscripteur et l’assureur (jugement préc., p. 3). Pour rappel, au plus tôt à l’égard des adhérents la loi (d’ordre public : C. assur., art L. 111-2 N° Lexbase : L9555LGY) impose trois mois à partir de l’information par le support indiqué. Dès lors, l’effet rétroactif est forcément inopposable. Le présent jugement laisse aussi à penser que les deux sanctions peuvent être cumulatives – et non alternatives – : inopposabilité des modifications à l’adhérent (côté assureur) et mise en œuvre de la responsabilité par l’assureur (côté souscripteur). Cette dernière sanction est toutefois écartée en l’espèce compte tenu de la propre faute de l’assureur. Un tel cumul possible des sanctions est bien pensé. Il garantit la sécurité juridique pour l’adhérent, partie faible de l’opération, et établit un équilibre en considération des fautes respectives des deux principaux cocontractants à l’opération, l’assureur et le souscripteur. En l’espèce, l’inopposabilité de ces changements contractuels est donc légitimement retenue, peu importe le degré d’obligatoriété de l’assurance collective – facultative ou obligatoire –, le juge n’ayant pas à distinguer là où la loi ne distingue pas. À l’inverse, si l’obligation d'information avait été bien remplie, faute pour l’adhérent d’avoir véritablement « adhéré », puisqu’il intègre de plein droit le groupe assuré dans une assurance collective à adhésion obligatoire, la modification du contrat lui aurait été opposable, sans qu’il puisse résilier le contrat [25] ou prétendre à l’ancienne version des clauses. Compte tenu de certaines pratiques liées au manque d’indépendance du souscripteur par rapport à l’assureur et ruinant « la confiance dans ce type de contrats » [26], avec « une forme d’irénisme du législateur » [27], on comprend que les magistrats puissent œuvrer à rééquilibrer ce mécanisme contractuel et à maintenir ainsi l’inopposabilité dans l’air du temps [28].
La Cour de cassation a consolidé sa propre construction jurisprudentielle dernièrement. Un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la deuxième chambre civile retient à nouveau qu’il résulte de l’article L. 141-4 du Code des assurances N° Lexbase : L9846HEE que l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur (Cass. civ. 2, 25 mai 2023, n° 21-15.842, FS-B N° Lexbase : A59779WB, pt. 12). La Haute juridiction précise que ce texte, « qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu'obligatoire, ne prévoit pas d'exception à cette obligation d'information lorsque la modification apportée aux droits et obligations des adhérents au contrat résulte d'un accord collectif » (pt. 13). La Cour de cassation rappelle qu’« il est jugé que la remise de la notice définissant les nouvelles garanties résultant d'une modification du contrat initial d'assurance collective obligatoire, est une condition de leur opposabilité à l'adhérent (Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10- 22.780, F-P+B N° Lexbase : A7414HTR et Cass. civ. 2, 7 mars 2019, n° 18-10.735, F-D N° Lexbase : A0064Y3R) » (pt. 14). La deuxième chambre civile en déduit que la cour d’appel a violé l’article L. 141-4 en décidant que « nonobstant leur absence de notification préalable, les modifications du contrat entre l'assureur et le souscripteur d'une assurance de groupe produisent de plein droit effet à l'égard des adhérents » [29].
[1] D. Cocteau-Senn, L’effet relatif du contrat d’assurance à l’égard des tiers ?, in R. Bigot et A. Cayol (dir.), Le droit des assurances en tableaux, préface D. Noguéro, Ellipses, 1re éd., 2020, p. 158 : « Il existe par ailleurs des schémas plus complexes, où un contrat est conclu entre le souscripteur et l’assureur dans le but de permettre à un ensemble de personnes tierces d’y « adhérer », et de nouer par là-même un ensemble de droits et d’obligations à l’égard de l’assureur. On parlera, dans ce dernier cas, de contrat d’assurance de groupe ou d’assurance collective ».
[2] Cass. civ. 1, 26 novembre 1996, n° 94-20.690 N° Lexbase : A8340C3B.
[3] Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-11.273, F-P+B N° Lexbase : A6087DB3.
[4] Cass. civ. 1, 28 avril 1998, n° 96-10.001, inédit au bulletin N° Lexbase : A5965C4P ; RGDA 1998, p. 763, note L. Fonlladosa.
[5] Cass. civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-16.455, F-D N° Lexbase : A7017MK4.
[6] Cass. civ. 1, 13 janvier 1987, n° 85-16.198, inédit au bulletin N° Lexbase : A3098CSK, RGAT 1987. 127.
[7] Cass. soc., 14 janvier 2004, n° 01-46.617 N° Lexbase : A7801DA8 ; 17 mars 2010, n° 08-45.329 N° Lexbase : A8138ETL ; 26 septembre 2018, n° 16-28.110, F-D N° Lexbase : A1935X88.
[8] V. Roulet, Assurance de groupe : inopposabilité à l’adhérent de la clause d’exclusion qui n’a pas été portée à sa connaissance, Dalloz actualité, 18 avril 2023.
[9] V. Roulet, Prévoyance d’entreprise et remise de la notice d’information : l’incontournable obligation de l’employeur, Dalloz actualité, 17 février 2023.
[10] Cass. civ. 2, 7 mars. 2019, n° 18-10.735, F-D N° Lexbase : A0064Y3R ; idem pour le devoir de conseil : Cass. civ. 1, 12 janvier 1999, n° 96-21.973, inédit au bulletin N° Lexbase : A7856CRE.
[11] C. assur., art. L. 141-4 N° Lexbase : L9846HEE ; anc. art. L. 140-4 ; loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, mod. loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 N° Lexbase : L5277HDS.
[12] Loi n° 89-1009, du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques N° Lexbase : L5011E4D, art. 12, al. 2.
[13] Cass. soc., 3 mars 2016, n° 15-13.027, FS-P+B N° Lexbase : A0662QY8.
[14] Sur la charge de la preuve, cf. dernièrement Cass. civ. 2., 26 novembre 2020, n° 19-20.369, F-D N° Lexbase : A172938K ; RGDA janvier 2021, 118c1, p. 17, note A. Pimbert ; Gaz. Pal. 2 mars 2021, n° 9, Actualité, Brève, 398m1, p. 42, obs. D. Noguéro ; Cass. civ. 2., 24 octobre 2019, n° 18-20.016, F-D N° Lexbase : A6536ZSU ; bjda.fr (nov.-déc.) 2019, n° 66, obs. B. Néraudau et P. Guillot ; Gaz. Pal. 3 mars 2020, n° 9, 371w8, p. 74-75, note D. Noguéro.
[15] Abus non prouvé en l’espèce : Cass. civ. 1, 4 octobre 2018, n° 17-22.207, F-D N° Lexbase : A5406YEX, bjda.fr 2018, n° 60, obs. A. Astegiano-La Rizza. – Comp. l’abus et la résiliation de l’assurance collective : Cass. civ. 2, 18 janvier 2018, n° 16-26.494, F-D N° Lexbase : A8727XAH ; RCA avril 2018, n° 120, note H. Groutel ; RDI juin 2018, p. 349, obs. D. Noguéro ; D. 2018 (21 juin ; n° 23), Pan., p. 1279, spéc. p. 1283, obs. D. Noguéro ; RLDC janvier 2019, n° 166, 6533, Actualité du droit des assurances (septembre 2017 – septembre 2018), p. 30, n° 7, obs. B. Beignier.
[16] Vérification de l’information donnée : Cass. civ. 2, 7 mars 2019, n° 18-10.735, F-D N° Lexbase : A0064Y3R ; RGDA juillet 2019, 116r8, p. 15, note A. Pélissier ; RCA juillet-août 2019, n° 202 ; RCA juin 2020, chron. Un an de droit des assurances (janvier – décembre 2019), n° 1, n° 8, obs. H. Groutel.
[17] CJUE, 9e ch., 2 février 2023, aff. C-208/21, K. D. c/ Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A. N° Lexbase : A18279BB, Dalloz actualité, 7 février 2023, obs. C. Hélaine ; Dalloz actualité, 15 février 2023, note D. Bazin-Beust ; D. 2023 (n° 6, 16 février), AJ, p. 292 ; JCP N 2023 (n° 7, 17 février), Veille, act. 320, obs. D. Berlin ; LEDC mars 2023, DCO201k3, p. 5, obs. Cl.-M. Péglion-Zika.
[18] V. Roulet, Assurance de groupe : inopposabilité à l’adhérent de la clause d’exclusion qui n’a pas été portée à sa connaissance, Dalloz actualité, 18 avril 2023.
[19] On pourrait « l’excuser » si l’assureur a convenu d’une prochaine transmission non respectée.
[20] Sont remerciées pour leur autorisation de republication les éditions LexisNexis, Madame Hélène Béranger, rédactrice en chef de la Revue La Semaine Juridique Edition générale et Monsieur Rémi Ferreira, directeur de la chronique de Jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, dans laquelle le commentaire de cette décision, dans sa version abrégée, est paru : R. Bigot, Les obligations du souscripteur d’une assurance de groupe obligatoire vis-à-vis des adhérents, JCP G n° 17-18, 01 mai 2023, doctr. 552.
[21] Cf. Les assurances collectives, Colloque du 19 novembre 1997, Paris, par l’Association Internationale de Droit des Assurances AIDA, RGDA 1998, n° 3 spécial, dont L. Mayaux, Les modifications du contrat, p. 592 ; E. Roueil, Essai sur le contrat d’assurance collective, thèse Orléans, 1998, dir. M.-L. Demeester-Morançais ; Y. Pagnerre et D. Coudreau, La modification de l’assurance groupe imposée par le souscripteur et l’assureur, RGDA novembre 2020, doctr., 117y6, p. 6. – Adde Dossier : Assurances de groupe et assurances collectives de dommages : des solutions législatives et prétoriennes, bjda.fr, avr. 2018.
[22] D. R. Martin, La stipulation de contrat pour autrui, D. 94. 145.
[23] L. Mayaux, in J. Bigot (dir.), Traité de droit des assurances, t. 4, Les assurances de personnes, préf. G. Durry, LGDJ, EJA, 2007, n° 912. – Comp. G. Courtieu, Assurance sur la vie : nouveaux ajustements législatifs, RCA 2006, étude 2, spéc. n° 12.
[24] M. Bigot-Gonçalves, Les assurances de groupe, préf. G. Wiederkehr, th. PUAM, 2009, n° 524, in fine.
[25] J. Bigot, Traité de droit des assurances, t. 5, Les assurances de dommages, préf. G. Durry, LGDJ, Lextenso, 2017, n° 2256.
[26] L. Mayaux, in J. Bigot (dir.), Traité de droit des assurances, t. 4, Les assurances de personnes, préf. G. Durry, LGDJ, EJA, 2007, n° 911, p. 741, in fine.
[27] Ibid.
[28] H. Groutel, L’information de l’assuré : de nouvelles avancées, RCA 2005, étude 11, spéc. n° 17. – Adde sur la prescription : l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances N° Lexbase : L4048IMU, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut prétendre à l’application de la prescription de droit commun : Cass. civ. 2, 24 novembre 2022, n° 21-17.327, F-B N° Lexbase : A35948UN ; comp. Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-19.498, FS-B N° Lexbase : A44809CW.
[29] Cass. civ. 2, 25 mai 2023, n° 21-15.842 N° Lexbase : A59779WB, pts 15 & 16.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486053
[Brèves] Procédure de flagrance sociale : possible saisie conservatoire sans saisine préalable du juge de l’exécution
Réf. : Cass. civ. 2, 22 juin 2023, n° 21-19.179, F-B N° Lexbase : A148794T
Lecture: 2 min
N6044BZU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 28 Juin 2023
► Par dérogation aux articles L. 511-1 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », n'est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l'organisme de recouvrement, lequel n'est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle de la société A, l’URSSAF a dressé un procès-verbal de travail dissimulé, puis a émis à son encontre un avis de redressement de cotisations. Il a ensuite pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société.
La société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité et mainlevée de la saisie conservatoire.
La cour d’appel. Pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l’URSSAF, la cour d’appel retient que les textes spécifiques au Code de la Sécurité sociale ne dérogent aux dispositions générales du Code des procédures civiles d'exécution que dans les hypothèses expressément prévues et qu'en dehors de la dispense d'autorisation du juge de l'exécution en l'absence de titre exécutoire, les autres dispositions de ce code sont applicables. Elle retient également que l’URSSAF ne justifie pas qu’elle a sollicité l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois à compter de la saisie conservatoire ainsi que l’exige l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4396MA3.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Cour conclue à la violation des articles L. 133-1 N° Lexbase : L2606LWG et R. 133-1-1 N° Lexbase : L4347LNC du Code de la Sécurité sociale. En l’absence de production par l’entreprise des éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués, le directeur de l’URSSAF peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution.
| Pour aller plus loin : F. Taquet, ÉTUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, Le travail dissimulé, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28093ND. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486044
[Brèves] De l’interpellation déloyale d’un étranger convoqué en préfecture par courriel
Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2023, n° 22-16.198, F-B N° Lexbase : A79839ZP
Lecture: 1 min
N6000BZA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 28 Juin 2023
► Constitue une interpellation déloyale le fait d'inviter par courriel l'étranger à se présenter à un rendez-vous en préfecture pour examiner sa situation.
Rappel. Il résulte des articles 5, § 1, f), de la CESDH N° Lexbase : L4786AQC et L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3356LZC qu'est irrégulier le placement en rétention administrative d'un étranger lorsqu'il a été procédé, dans les locaux de la préfecture, à son interpellation de manière déloyale au regard de l'objet de sa convocation.
En cause d’appel. Pour rejeter la contestation du placement en rétention de l’intéressée, fondée sur le caractère déloyal de son interpellation, l'ordonnance (CA Paris, 13 décembre 2021, n° 21/03874 N° Lexbase : A90767EU) relève que celui-ci a été convoqué par l'intermédiaire de son avocat à la préfecture pour procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, qu'à cette occasion les services préfectoraux ont vérifié sa situation administrative et constaté qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 26 juillet 2021, et que les services de police, informés de cette situation, l'ont interpellé.
Décision Ccass. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à écarter le caractère déloyal de l'interpellation invoqué au regard de l'objet de la convocation, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision. L’ordonnance est donc cassée et annulée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486000
[Brèves] Expulsion d’un imam controversé vers le Maroc : irrecevabilité de la requête devant la CESDH
Réf. : CEDH, 25 mai 2023, Req. 37550/22, Hassan Iquioussen c/ France N° Lexbase : A204893A
Lecture: 3 min
N5964BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 21 Juin 2023
► La requête devant la CEDH d’un imam controversé, expulsé par la Belgique vers son pays d’origine (le Maroc) à la suite de sa fuite du territoire français, est irrecevable.
Rappel. Le requérant, de nationalité marocaine, résidait régulièrement en France depuis sa naissance, bénéficiant d'une carte de résident de 1982 jusqu'à l'expiration de son dernier titre de séjour le 2 juin 2022. Il officiait en tant qu'imam et était également conférencier, notamment sur YouTube. Il est marié à une compatriote en situation régulière sur le territoire français avec laquelle il a eu cinq enfants et seize petits-enfants, de nationalité française.
Le 23 juin 2022, la commission d'expulsion de Lille saisie après engagement d'une procédure d'expulsion, rendit, après audition du requérant, un avis favorable à son expulsion.
Griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention. La Cour considère que les atteintes alléguées aux articles 3 N° Lexbase : L4764AQI (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) et 8 N° Lexbase : L4798AQR (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention du fait de son renvoi au Maroc ne sont pas imputables aux autorités de l’État défendeur, compte tenu de son départ volontaire vers la Belgique et de la décision d’éloignement vers le Maroc prise par l’Office des Étrangers du Royaume de Belgique (voir, pour la responsabilité de l’État qui renvoie, CEDH, 23 février 2016, Req. 44883/09, Nasr et Ghali c/ Italie N° Lexbase : A5130PZZ).
Griefs tirés des articles 9 N° Lexbase : L4799AQS et 10 N° Lexbase : L4743AQQ de la Convention. La Cour rappelle que le requérant est tenu d’épuiser le recours en annulation à l’encontre des arrêtés ministériels pris par les autorités françaises portant expulsion, retrait de la carte de résident et fixant le pays de destination (CEDH, 19 avril 2018, Req. 46240/15, A.S. c/ France N° Lexbase : A3328XLT).
Ce recours au fond étant actuellement pendant devant le tribunal administratif de Paris, la Cour juge que, contrairement à ce qu’exige l’article 35 § 1 de la Convention N° Lexbase : L4770AQQ, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées.
Grief tiré de l’article 13 N° Lexbase : L4746AQT combiné à l’article 8 de la Convention. Le grief tiré de l’article 8 de la Convention ayant été déclaré incompatible avec les dispositions de la Convention, la Cour constate que le grief tiré de l’article 13 combiné à l’article 8 se trouve également incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a).
Enfin, la Cour observe que les griefs du requérant tirés de l’article 6 de la Convention (droit à un procès équitable) N° Lexbase : L7558AIR ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition et sont de ce fait également incompatibles avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a).
Décision. La requête est donc déclarée irrecevable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485964
[Conclusions] La non-extradition de l'étranger exposé à un risque de dégradation de son état de santé - conclusions du rapporteur public
Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 19 juin 2023, n° 469722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A094394P
Lecture: 33 min
N6072BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Clément Malverti, rapporteur public au Conseil d'État
Le 28 Juin 2023
Mots clés : étrangers • extradition • état de santé • traitements inhumains et dégradants • édiction d'un décret
La circonstance que l’exécution d’un décret d’extradition exposerait un étranger à des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé ainsi qu’au risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CESDH en raison d’une grave pathologie survenue après l’intervention du décret, qui est sans influence sur la légalité de ce décret, laquelle s’apprécie à la date de son édiction, est de nature à faire obstacle à l’exécution du décret d’extradition. Lexbase Public vous propose de découvrir les conclusions de Clément Malverti, rapporteur public au Conseil d'État.
M. X, ressortissant turc né en 1965, est entré en France en 1976, à l’âge de 11 ans, et y réside depuis.
Au cours d’un séjour à Antalya en août 2002, il a été arrêté puis placé en garde à vue, avant d’être libéré deux jours plus tard.
En 2006, les autorités turques ont délivré à son encontre une commission rogatoire internationale, pour des faits de terrorisme.
En mai de la même année, il a comparu devant un juge d’instruction français, qui l’a placé sous le statut de témoin assisté.
Par une décision du 28 juillet 2009 de la 8e chambre de la cour d’assises d’Izmir, confirmée le 22 mai 2022 par la Cour de cassation turque, M. X a été condamné, par contumace, à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois pour des faits d’appartenance à une organisation terroriste armée commis en août 2002 à Antalya.
Il lui est reproché d’avoir procédé au recrutement en France et en Turquie de personnes pour le compte d’une organisation terroriste armée proche du mouvement Kaplan et visant à instaurer en Turquie un État islamique.
Sur le fondement d’un mandat d’arrêt délivré le 6 mars 2019 par le procureur de la République d’Izmir, une demande d’extradition aux fins d’exécution de cette peine a été formée par le gouvernement de Turquie, à laquelle la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a donné un avis favorable le 12 mai 2021, le pourvoi contre cet avis n’ayant pas été admis par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Par un décret du 3 octobre 2022, le Premier ministre a accordé aux autorités turques l’extradition de M. X.
M. X vous demande l’annulation de ce décret.
1. Les deux premiers moyens de la requête ne vous retiendront pas.
1.1. D’une part, le décret attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L1818KNN.
1.2. D’autre part, M. X, qui est père de deux enfants majeurs, soutient que l’exécution du décret porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CESDH N° Lexbase : L4798AQR, dans la mesure où la Turquie, qui a été condamnée pour ce motif par la Cour de Strasbourg, refuserait aux détenus le droit de recevoir la visite de leurs enfants et de passer des appels téléphoniques le week-end.
Mais dans l’affaire « Subaşı » mentionnée par la requête [1], la Turquie a été condamnée non pas en raison d’une impossibilité générale pour les condamnés d’entrer en contact avec leurs proches le week-end, mais de la pratique de certains établissements pénitentiaires.
De sorte qu’en l’absence de toute autre précision, cette seule condamnation ne suffit pas à nous convaincre qu’en cas d’extradition, une atteinte disproportionnée serait portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X.
2. Par ses deux autres moyens, articulés sur les terrains des article 3 de la CESDH N° Lexbase : L4764AQI et premier des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d’extradition, M. X soutient que son extradition risquerait d’entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur son état de santé dès lors qu’il est actuellement pris en charge par le service d’oncologie médicale des Hospices civils de Lyon (HCL) pour un cancer du côlon métastasique.
Après un bref rappel de la portée des exigences issues des stipulations invoquées, nous examinerons le bien-fondé du moyen puis, par une inversion logique du traitement des questions qui nous paraît nécessaire à la clarté du propos, nous vous entretiendrons de la question délicate de son opérance.
1.1. Les deux terrains invoqués par la requête – celui de la CESDH et celui de la convention européenne extradition – font peser des obligations similaires sur l’État requis.
1.1.1. a) L’article 3 de la convention CESDH, vous le savez, fait obstacle à ce que le Gouvernement accorde l’extradition d’une personne lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne réclamée risque, en cas de remise à l’État requérant, d’être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants [2].
La Cour juge ainsi qu’un État ne peut sans méconnaître ces stipulations éloigner une personne qui, sans pour autant courir de « risque imminent de mourir en cas d’éloignement, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie » [3].
b) Le second alinéa de l'article premier des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition prévoit quant à lui que « l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ».
Vous jugez que cette réserve, qui s’incorpore à la convention européenne d’extradition [4], est pleinement invocable devant vous [5].
En outre, lorsqu’aucune convention d’extradition n’est applicable et que l’extradition est accordée sur le seul fondement des dispositions du code de procédure pénal issues de la loi du 10 mars 1927, vous avez jugé par votre décision « Kozirev » du 13 octobre 2000 qu’il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition que l'extradition d'un étranger peut être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge et de son état de santé [6].
1.1.2. Bien que ces deux textes revêtent une portée équivalente, leur respect fait, en l’état de votre jurisprudence, l’objet de contrôles différents.
Parce que la protection contre les traitements prohibés par l’article 3 de la CESDH est absolue [7], votre contrôle est entier sur le respect par le Gouvernement français de ces stipulations.
En revanche, le respect de la réserve humanitaire, qu’elle soit contenue dans une convention d’extradition [8] ou qu’elle résulte des principes généraux du droit de l’extradition [9], fait l’objet d’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
Nous peinons à adhérer au choix d’un tel contrôle restreint.
D’abord, il repose sur la prémisse que la réserve humanitaire, qu’elle figure dans une convention d’extradition ou qu’elle se déduise des principes généraux du droit de l’extradition, pose une simple faculté pour l’État requis, et non une obligation de ne pas extrader.
Or, lorsque l’extradition est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge et de son état de santé, l’État requis ne dispose d’aucune marge d’appréciation, mais est bien tenu de refuser l’extradition sollicitée. À cet égard, la formulation permissive de la réserve humanitaire à la convention européenne d’extradition ne saurait être interprétée comme « une simple mesure de faveur » [10], mais s’explique à nos yeux par la circonstance que l’article premier de cette convention fait peser sur les États parties une obligation d’extrader. Autrement dit, c’est uniquement parce que les États se sont engagés à se livrer réciproquement les individus poursuivis ou recherché par les autres États parties à la convention que la réserve française est rédigée sous la forme permissive, afin d’indiquer que lorsque l’extradition est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé, l’État requis est délié de son obligation à l’égard de l’État requérant. Mais dans le rapport entretenu entre l’État requis et la personne extradable, au prisme duquel la décision d’extrader n’est que la manifestation du pouvoir de police d'un gouvernement à l'égard d'un ressortissant étranger présent sur son territoire [11], la réserve humanitaire revêt à nos yeux le caractère d’une véritable obligation, au demeurant de portée absolue, similaire à celle de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants issue de l’article 3 de la CESDH.
Ensuite, force est de constater qu’en pratique, et c’est heureux, votre contrôle déborde largement le cadre classique du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Non seulement vous appréciez de manière très serrée l’état de santé de la personne requise afin d’évaluer la gravité des conséquences que son extradition serait susceptibles d’entraîner, mais vous exigez du gouvernement une action positive consistant à rechercher des « garanties appropriées » à la situation personnelle de l’intéressé [12]. Si cela confirme que la détermination d’un degré de contrôle revêt une dimension essentiellement rhétorique, celui qui l’exerce demeurant libre d’en accroître l’intensité effective, reste que cette dimension a son importance, notamment en termes de signal envoyé à l'administration quant à l'étendue de la marge de manœuvre dont elle dispose. Or, compte tenu du caractère absolu de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants qui sous-tend les réserves humanitaires, nous pensons peu opportun de laisser croire à l’administration qu’elle dispose d’une quelconque marge d’appréciation en la matière et peut compter sur la mansuétude du juge qui ne viendrait censurer que ses erreurs les plus grossières.
Enfin, et en tout état de cause, le maintien d’un contrôle restreint sur le respect des réserves humanitaires s’avère passablement vain tant il est aisé pour le requérant à contourner. Il lui suffit en effet d’articuler son argumentation, comme en l’espèce d’ailleurs, sur le terrain des stipulations de l’article 3 de la CESDH, lesquelles, on l’a dit, donnent nécessairement lieu à un contrôle entier du juge de l’extradition. Or, à s’en tenir à la jurisprudence de la Cour mentionnée plus haut, le standard de protection garanti par ces stipulations en matière d’extradition est en tous points identiques à celui des réserves humanitaires.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à exercer un contrôle normal sur le respect de la réserve humanitaire à la convention européenne d’extradition, étant en tout état de cause précisé qu’un tel degré de contrôle s’appliquera nécessairement au titre de l’examen du respect des exigences issues de l’article 3 de la CESDH.
1.2. Sur le fond, nous sommes d’avis qu’en l’espèce, l’extradition aux fins d’exécution de la peine de prison prononcée à l’encontre de M. X serait susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur son état de santé ou, pour le dire avec les mots de la Cour de Strasbourg, l’exposerait à un « risque réel [de] déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ».
Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment des trois certificats médicaux produits par le requérant, que celui-ci, nous l’avons dit, est en cours de traitement pour un cancer du côlon métastatique hépatique. Il fait l’objet depuis janvier dernier d’une chimiothérapie, a subi une intervention chirurgicale en mars dernier et est actuellement encore sous chimiothérapie post-opératoire, laquelle devrait durer au moins jusqu’à la fin de l’été.
Dans ces conditions, votre 2e chambre a ordonné une mesure supplémentaire d’instruction afin que le Garde des Sceaux sollicite des autorités turques des garanties sur les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être apportés à M. X ainsi que sur la possibilité pour lui d’être détenu dans des conditions appropriées à son état de santé.
En réponse, le ministre a produit une note du directeur général adjoint turc des prisons et des maisons d’arrêt.
Cette note indique qu’en Turquie les soins aux détenus et aux condamnés sont dispensés par des médecins affectés aux centres pénitentiaires, que l’accueil hospitalier de la personne condamnée peut être organisé au besoin, qu’il existe un dossier médical individuel et un service d’urgence de l’État, que les soins sont gratuits et, enfin, qu’il peut être sursis à l’exécution de la peine s’il existe un danger absolu pour la vie du condamné.
S’agissant du cas particulier de M. X, la note indique qu’il « pourrait être hébergé dans l’établissement pénitentiaire (…) de Yalvaç », dans lequel « un médecin de famille » est présent « un jour par semaine » et qui comprend un service de santé composé de « deux officiers de santé et trois gardiens », et que si un traitement plus approfondi s’avérait nécessaire, le requérant serait transféré vers l’hôpital le plus proche disposant d’un service d’oncologie.
A nos yeux, et compte tenu de la gravité de la pathologie dont souffre M. X, ces garanties ne sont pas suffisantes.
En effet, la note se borne pour l’essentiel à rappeler, dans des termes généraux, que M. X bénéficiera du dispositif valable pour les prisonniers malades en Turquie. Les seuls développements consacrés au cas particulier du requérant sont la mention, au conditionnel, de l’établissement pénitentiaire dans lequel l’intéressé pourrait être incarcéré, établissement qui au demeurant comporte un service médical loin d’être adapté à la prise en charge d’un détenu souffrant d’un cancer du côlon métastasique. La note ne dit notamment rien des aménagements d’emprisonnement spécifiques dont pourrait bénéficier M. X et qui, en l’espèce, sont indispensables compte tenu de l’état de santé du requérant.
Relevons à cet égard que les garanties apportées par les autorités turques sont dans leur substance très proches que celles que ces autorités avaient fournis dans une affaire « Ucar » dont vous avez eu à connaître en 2011, laquelle concernait l’extradition d’une personne présentant des troubles psychiatriques graves qui nécessitait un suivi sans interruption et n’étaient pas compatibles avec un maintien en détention sans surveillance médicale adaptée. Or, vous avez jugé que de telles garanties, qui se bornaient à faire état d’informations générales sur le suivi médical des détenus en Turquie, n’étaient pas suffisamment précises pour donner l'assurance que la personne serait traitée, en détention, de manière compatible avec son état de santé [13].
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, c’est une conclusion identique que nous vous proposons de tirer en l’espèce.
1.3. Mais si vous nous suivez, encore vous faudra-t-il au préalable surmonter la délicate question de l’opérance du moyen.
La difficulté en l’espèce tient à ce que la pathologie dont souffre M. X est apparue, ou du moins s’est révélée, postérieurement au décret attaqué, la question de son état de santé n’ayant en tous cas jamais été évoquée durant la phase judiciaire et l’auteur du décret n’ayant pas été en mesure de l’examiner. De sorte qu’à s’en tenir aux canons de l’excès de pouvoir, dont relève bien le contentieux de l’extradition, la circonstance invoquée par M. X serait inopérante car postérieure à l’acte dont il s’agit de faire le procès (v. en ce sens, CE, 14 février 1986, n° 74143 N° Lexbase : A4907AMP, T. p. 532).
1.3.1. Précisons d’emblée que si vous avez déjà été confrontée à une difficulté de cette nature, votre jurisprudence est toujours parvenue, de manière plus ou moins heureuse, à la contourner.
Dans l’affaire d’assemblée « Mme Aylor » du 15 octobre 1993 [14], la question se posait de savoir s’il était possible, pour apprécier le respect de l’interdiction d’extrader un individu susceptible d’encourir la peine de mort, de tenir compte de garanties diplomatique fournies par l’État requérant postérieurement à l’édiction du décret d’extradition.
Dans ses conclusions sur cette décision, C. Vigouroux, tout en défendant le principe de l’appréciation de la légalité du décret d’extradition à la date de son édiction, proposait à l’assemblée de tenir compte de l’ensemble des assurances diplomatiques, y compris celles fournies postérieurement au décret, en faisant valoir qu’il était de toutes façons difficile de « distinguer [celles] totalement nouvelles et celles qui auraient été formellement exprimées postérieurement mais données antérieurement ».
Il fût sur ce point apparemment suivi par l’assemblée qui, sans théoriser davantage, accepta de tenir compte des garanties diplomatiques obtenues au cours de l’instruction de la requête contre le décret d’extradition, appréhendant sans doute ces dernières comme « des éléments supplémentaires apportés à l'appui d'assurances qui s'étaient révélées suffisantes à la date du décret »[15].
Plus proches de notre cas d’espèce, on mentionnera trois affaires dans lesquelles étaient invoquées une méconnaissance de la réserve humanitaire au motif que l’état de santé de l’intéressé s’était significativement dégradé depuis l’édiction du décret d’extradition.
Dans une affaire « Mouhoub » de 2008, vous avez opportunément évité de trancher la question au terme d’une rédaction ambigüe, en jugeant « que la circonstance que [l’]état de santé se soit brutalement détérioré peu après [l’édiction du décret d’extradition] est sans incidence sur la légalité de ce décret » avant toutefois d’ajouter, par « au surplus » énigmatique, que les autorités françaises avaient obtenu de l’État requérant postérieurement au décret des garanties diplomatiques appropriées[16].
Dans l’affaire « Ucar » mentionnée tout à l’heure, vous avez totalement gommé la difficulté, en ne faisant apparaître aucune date dans votre décision, tout en tenant compte des éléments révélés postérieurement au décret attaqué, vous laissant sans doute convaincre par votre rapporteur public Damien Botteghi qui vous indiquait qu’au moins un document au dossier prouvait que l’état de santé du requérant s’était déjà dégradé avant l’édiction du décret [17].
Enfin, dans une affaire « Andric » du 28 février 2019, vous avez une fois de plus tenu compte d’éléments postérieurs au décret d’extradition pour apprécier l’état de santé du requérant, cette fois en faisant nettement apparaître dans votre décision qu’ils étaient apparus « après l’intervention du décret litigieux » [18]. Mais dès lors que vous avez jugé que ces éléments ne suffisaient pas pour considérer que l’exécution du décret d’extradition serait susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne vous est pas paru nécessaire de trancher explicitement la question de leur opérance.
1.3.2. Dans notre affaire, il n’y a aucun élément au dossier dont il pourrait être déduit que l’état de santé de M. X était déjà dégradé quand le décret attaqué est intervenu, étant rappelé que cette question a été soulevée pour la première fois devant vous.
Dans ces conditions, nous pensons que le cas d’espèce doit vous conduire à vous prononcer explicitement sur la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier les conséquences que l’exécution d’un décret d’extradition est susceptible d’entraîner sur la situation personnelle de l’intéressé.
1.3.2.1. Précisons d’emblée qu’il est à nos yeux exclu de s’en tenir à l’approche orthodoxe de l’excès de pouvoir en jugeant qu’une telle circonstance, dès lors qu’elle est postérieure au décret attaqué, n’a aucune incidence sur l’issue du litige.
En effet, une telle solution exposerait la France à une condamnation certaine de la CEDH dans l’hypothèse où cette dernière partageait notre appréciation sur le fond, car la Cour juge que « la responsabilité que l’article 3 fait peser sur les États contractants (…) tient à l’acte consistant à exposer un individu au risque de subir des mauvais traitements » et en déduit que «l’existence de ce risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment du renvoi »[19].
Certes objectera-t-on que l’intéressé n’est pas dépourvu de voies de recours pour faire échec à l’exécution du décret d’extradition car il peut, d’une part, introduire un recours contre la décision de remise du Garde des Sceaux [20], d’autre part, solliciter l’abrogation du décret et attaquer devant vous le refus qui lui est opposé [21].
Mais ces voies de recours ne sont pas de nature à garantir l’absence d’exécution d’un décret d’extradition susceptible d’emporter des conséquences d’une particulière gravité pour l’intéressé.
Le recours contre la décision de remise du Garde des Sceaux, outre qu’il constitue une voie de droit peu connue des requérants et ne relève sans doute pas de votre compétence en premier et dernier ressort, n’a pas, en l’état de votre jurisprudence, d’effet suspensif. Si bien que pour agir en temps utile, l’intéressé devrait exercer un référé contre cette décision, en espérant que l’exécution n’intervienne pas avant que le juge des référés se prononce.
Quant au recours contre le refus d’abroger un décret d’extradition, il suppose par définition d’avoir fait préalablement naître un tel refus, et donc, une fois de plus, risque d’être trop lent pour faire obstacle à l’exécution d’une extradition emportant des conséquences d’une particulière gravité pour l’intéressé.
1.3.2.2. Dans ces conditions, il vous faut donc trouver une voie à même de permettre au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte de la dégradation de l’état de santé de l’intéressé postérieurement au décret attaqué.
1.3.2.2.1. Or, depuis les affaires dont il a été question tout à l’heure, votre jurisprudence a fait significativement évolué l’office du juge de l’excès de pouvoir afin précisément de lui fournir les moyens de tenir compte d’un tel changement de circonstances.
Vous le savez, le mouvement a été initié par votre décision d’assemblée « Association des Américains accidentels » du 19 juillet 2019 [22] qui, constatant que « l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation (…) de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique », a permis au juge saisi d’un tel refus d’apprécier sa légalité « au regard des règles applicables à la date de sa décision ».
Ce nouvel office du juge de l'excès de pouvoir, initialement cantonné au contentieux des refus d'abroger un acte réglementaire, a été rapidement étendu à celui de nombreuses décisions individuelles de refus [23], notamment celui d’abroger un décret d’extradition [24], avec toujours en ligne de mire l'effet utile de l'intervention du juge consistant dans sa faculté d'enjoindre à l'administration de faire ce qu'elle a illégalement refusé.
Une nouvelle étape fut franchie par votre décision « Stassen » du 28 février 2020, qui étendit la démarche cette fois non pas à un refus, mais à une décision positive, en l'occurrence celle de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) prononçant la suspension provisoire d'un sportif. A la différence de la lignée « Américains accidentels » qui fait du présent le seul horizon temporel du juge, la décision « Stassen » consacre une appréciation de la légalité en deux temps, en jugeant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir saisi d'une telle décision, d'une part, d'examiner sa légalité « à la date de son édiction et, s'il la juge illégale, [d']en prononce[r] l'annulation », d'autre part, et à condition d'être saisi de conclusions en ce sens, « d'apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s'il juge qu'elle est devenue illégale, d'en prononcer l'abrogation » [25]. Ainsi, la décision complète l'office du juge de l'excès de pouvoir en lui permettant d'abroger lui-même une décision devenue illégale entre le moment où elle a été édictée et celui auquel le juge statue, offrant ainsi au requérant un circuit court lui permettant de s’épargner la peine de saisir l'administration d’une demande tendant à l’abrogation de la décision qu’il conteste.
Ce contrôle à double détente du juge de l’excès de pouvoir a enfin été consacré par votre décision de Section « Elena France » du 19 novembre 2021, qui l’a néanmoins circonscrit au contentieux des seuls actes réglementaires, tout en en précisant les modalités de mise en œuvre[26].
Mais comme l’indique son fichage, cette décision n’a nullement entendu revenir sur la solution « Stassen ». De sorte que si elle n’a pour l’heure été appliquée qu’à l’hypothèse qui lui a donné naissance des décisions de suspensions provisoires des sportifs prononcées par le président de l’AFLD, la solution « Stassen », qui a eu les honneurs d’une publication au Recueil, a selon nous vocation à être étendue à d’autres types de contentieux dont les contours le justifierait.
1.3.2.2.2. Or, tel est assurément le cas de celui de l’extradition.
Tout d’abord, ce contentieux est sensible à l’écoulement du temps, car il n’est pas rare que durant les quelques mois de l’instruction d’une requête devant vous, des circonstances nouvelles apparaissent, touchant notamment à l’état de santé du requérant, à sa situation familiale ou aux conditions de détention dans l’État requérant, et de nature à faire obstacle à l’extradition.
Ensuite, un décret d’extradition est essentiellement tourné vers son exécution, son seul objet étant d’autoriser la remise de l’intéressé aux autorités de l’État requérant. C’est au regard d’une telle caractéristique que vous avez d’ailleurs jugé par votre décision « Comparoé » du 31 décembre 2021 qu’« un décret d'extradition ne saurait être mis à exécution tant que le délai de recours n'est pas expiré et, le cas échéant, tant que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours dans ce délai, n'a pas statué » [27]. Il en résulte que l’effet utile d’un recours contre un tel décret réside moins dans sa disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique que, dans l’hypothèse où le décret serait devenu illégal avant d’avoir exécuté du fait d’un changement de circonstances, son abrogation pour l’avenir. Dans ces conditions, le juge de l’extradition doit pouvoir « regarder devant lui, en se préoccupant directement et immédiatement des conséquences s’attachant, à compter de demain, à la décision prise au regard de la situation qui s’était cristallisée hier » [28], ce que la solution « Stassen » lui permet précisément de faire.
En outre, comme vous l’avez jugé par votre décision « Zdancewitz » du 10 juin 2020, l’administration est tenue d’abroger un décret d’extradition devenu illégal, et ce, sans condition de délai [29]. C’est que, comme vous l’indiquait Sophie Roussel dans ses conclusions sur cette décision, « un décret d’extradition ne crée (…), par lui-même, aucun droit que le principe de sécurité juridique imposerait de protéger (…). Si obligation juridique il y a – et c’est le cas dans le cadre de la convention européenne d’extradition applicable au litige qui consacre à son article premier une obligation d’extrader – celle-ci trouve uniquement sa source dans la convention, et non dans l’acte pris pour son exécution ». Il en résulte que permettre au juge de l’excès de pouvoir de prononcer l’abrogation d’un décret d’extradition devenu illégal n’est susceptible de heurter aucun droit acquis et donc que, de ce point de vue, l’extension de la solution « Stassen » au contentieux de l’extradition ne pose pas de difficulté.
Enfin, à l’instar de celui des décisions de suspension provisoire des sportifs [30], le contentieux de l’extradition est limité en volume et relève de votre compétence en premier et dernier ressort, de sorte que l’adaptation de l’office du juge de l’extradition aura une incidence très faible sur la gestion des flux contentieux et peut être conçue sans intégrer la complexité inhérente à un contentieux à degrés de juridiction multiples. Ce contentieux est en outre suffisamment spécifique pour que la solution que nous vous proposons ne préjuge en rien de l’extension de la solution « Stassen » à d’autres contentieux.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de transposer la solution « Stassen » au contentieux de l’extradition, et de juger qu’eu égard à l’effet utile d’un recours contre un décret d’extradition, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d’apprécier la légalité de cet acte à la date où il statue et d’en prononcer l’abrogation s’il juge qu’il est devenu illégal, à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
1.3.2. Malheureusement, vous ne pourrez faire application de cette démarche en l’espèce car la requête ne contient pas de conclusions à fin d’abrogation, mais se borne à solliciter l’annulation rétroactive du décret.
Dans ce contexte, il ne vous est pas possible de prononcer l’abrogation du décret attaqué en faisant jouer la jurisprudence « Stassen », laquelle suppose, pour être mise en œuvre, que le juge soit effectivement saisi de conclusions à fin d’abrogation, lesquelles, au demeurant, peuvent être présentées même après l’expiration du délai de recours.
Parce qu’il est exclu, pour les raisons mentionnées plus haut, que vous rejetiez sèchement la requête, ce qui permettrait la remise de l’intéressé aux autorités turques et donc conduirait à une méconnaissance des exigences issues de l’article 3 de la CESDH, il vous faut trouver une autre voie de repli de nature à faire obstacle à l’exécution du décret attaqué.
a) La mise en œuvre d’un contrôle dynamique de la légalité du décret d’extradition, qui, compte tenu des particularités de ce contentieux, pourrait se concevoir, nous paraît toutefois difficile à retenir dans cette formation de jugement.
D’une part en effet, en l’état de votre jurisprudence, un tel contrôle est, dans la lignée de la décision « Américains accidentels », réservé aux seules décisions de refus, et repose sur l’idée que la contestation de celles-ci n'a pas d'autre objet – ou d’autre « effet utile » – que l'obtention d'une injonction de prendre la mesure qui a été refusée. Pour les décisions positives, tel un décret d’extradition, c’est la solution « Stassen » qui a vocation à s’appliquer.
Si bien que faire basculer le contentieux de l’extradition dans l’appréciation dynamique de la légalité constituerait une innovation majeure en l’état de votre jurisprudence, et reviendrait à mettre à distance l’approche en deux temps que vous avez entendu privilégier dans vos décisions « Stassen » et « Elena France » pour tenir compte d’un changement de circonstances de nature à affecter la légalité d’une décision positive.
D’autre part, il y aurait à nos yeux quelque difficulté, pour une décision positive, à articuler l’appréciation dynamique de sa légalité avec le caractère nécessairement rétroactif de son annulation. Car si une telle articulation est aisée s’agissant des décisions de refus, le recours contre ces dernières n’ayant d’autre objet que d’obtenir du juge le prononcé d’une injonction dont la nécessité s’apprécie en tenant compte des circonstances de droit et de fait contemporaines[31], on peut davantage hésiter à apprécier de manière exclusivement dynamique la légalité d’une décision positive dont le contentieux ne s’accompagne pas de conclusions à fin d’injonction.
b) Vous pourriez en revanche, vous inspirant de la solution « Mathio Eassaka » applicable aux décisions d’éloignement du territoire [32], constater dans votre décision que du fait de la dégradation de l’état de santé de M. X postérieurement à l’éduction du décret attaqué, celui-ci, bien que légal à la date à laquelle il a été pris, n’est plus susceptible d’être exécuté.
Précisons que si nous ne vous avons pas proposé cette solution d’emblée, c’est qu’elle ne nous paraît pas pleinement satisfaisante.
En effet, lorsque le juge, en application de la jurisprudence « Mathio Essaka », constate le caractère inexécutable de la mesure d’éloignement, ce constat ne trouve aucune traduction dans le dispositif de sa décision. Il en résulte, d’une part, que la décision juridictionnelle est sur ce point dépourvue de toute autorité de chose jugée (laquelle s’apprécie au regard du dispositif, éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire), d’autre part, que le juge ne peut s’appuyer sur le constat du caractère inexécutable de la mesure pour prononcer une injonction[33]. De sorte que comme le soulignait Sophie Roussel dans ses conclusions sur la décision « ELENA France », la solution « Mathio Essaka » ne permet pas d’assurer pleinement « l’effectivité du principe de légalité que le recours pour excès de pouvoir vise à garantir ».
Conscient de ces limites, Frédéric Lenica vous avait proposé, dans ses conclusions sur l’affaire « M. Mouhoub » évoquée tout à l’heure, d’aller un cran plus loin en annulant l’article d’exécution du décret d’extradition.
Vous ne l’aviez pas suivi sur ce point, au profit, nous l’avons dit, d’une formulation ambigüe permettant de réaffirmer le principe de l’appréciation de la légalité d’un décret d’extradition à la date de son édiction tout en tenant néanmoins compte de circonstances postérieures à celle-ci.
Nous ne vous proposons pas de franchir le pas aujourd’hui.
D’une part parce que, outre qu’elle est susceptible d’avoir des effets de bord difficiles à mesurer, la solution imaginée par notre prédécesseur nous semble théoriquement fragile car dès lors que l’article d’exécution d’un décret d’extradition ne constitue pas une décision autonome, rien ne justifie de distinguer la date d’appréciation de la légalité d’un acte et celle de son article d’exécution.
D’autre part et surtout, dès lors que la solution adéquate pour traiter la difficulté est à nos yeux celle issue de la décision « Stassen », il serait à nos yeux inutilement constructif de dégager une solution innovante qui, à condition naturellement que les justiciables de saisissent pleinement des nouveaux outils attribués au juge de l’excès de pouvoir, n’aura pas vocation à recevoir application.
Par ces motifs nous concluons à ce que vous rejetiez la requête, après avoir néanmoins indiqué dans votre décision, d’une part, que la démarche définie par votre décision « Stassen » est applicable au contentieux de l’extradition, d’autre part, et faute de conclusions à fin d’abrogation, que le décret attaqué ne peut être mis à exécution dès lors que l’extradition de M. X l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé et au risque de subir des traitements inhumains et dégradants.
[1] CEDH, 6 décembre 2022, Req. 3468/20, Subaşı et autres.
[2] v. CE, 15 février 1999, n° 196667 N° Lexbase : A4232AXZ ; CE, 9 novembre 2015, n° 387245 N° Lexbase : A3622NW3.
[3] CEDH, 13 décembre 2016, Req. 41738/10, Paposhvili c/ Belgique N° Lexbase : A4990SPI.
[4] v. concl. R. Abraham sur CE 27 octobre 1989, n° 107711 N° Lexbase : A1710AQE.
[5] CE, 6 juillet 1992, n° 122874 N° Lexbase : A7368ARC.
[6] CE, 13 octobre 2000, n° 212865 N° Lexbase : A9036AH7.
[7] Depuis l'arrêt « Soering c/ Royaume-Uni » du 7 juillet 1989 (Req. 14038/88 N° Lexbase : A6141IAP), la Cour juge que l'article 3 de la CESDH « ne ménage aucune exception ». Elle a par la suite précisé que cette interdiction « est tout aussi absolue en matière [d’éloignement]. Ainsi, chaque fois qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'une personne courra un risque réel d'être soumise à des traitements contraires à l'article 3 si elle est [éloignée] vers un autre État, la responsabilité de l'État contractant - la protéger de tels traitements - est engagée en cas [d’éloignement] (...). Dans ces conditions, les agissements de la personne considérée, aussi indésirables ou dangereux soient-ils, ne sauraient entrer en ligne de compte (…) » (CEDH, 15 novembre 1996, Req. 22414/93, Chahal c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A8422AWT ; v. dans le même sens, CEDH, Gr. ch., 28 févier 2008, Req. 37201/06, Saadi c/ Italie N° Lexbase : A0713D7K). Une portée similaire a été attribuée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) aux articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union (CJUE, 5 avril 2016, aff. C-404/15, Aranyosi N° Lexbase : A2442RB3, pts 86 à 88).
[8] V. s’agissant de la Convention européenne d’extradition, CE, 6 juillet 1992, n° 122874, préc. ; s’agissant du traité d’extradition entre la France et les États-Unis (art. 6), CE, 29 octobre 2008, n° 311800 N° Lexbase : A1032EBT.
[9] CE, 10 février 2006, n° 284771 N° Lexbase : A8357DMH.
[10] Concl. F. Lenica sur CE, 29 octobre 2008, n° 311800, préc.
[11] C’est ce qui a notamment conduit à ce que vous regardiez, depuis votre décision « Decerf » (CE 28 mai 1937, n° 54631, Lebon 534), les décrets d'extradition comme des actes détachables de la conduite des relations internationales, justiciables d'un recours pour excès de pouvoir.
[12] V. pour une illustration, CE, 10 février 2006, n° 284771, préc.
[13] CE, 14 novembre 2011, n° 345258 N° Lexbase : A9299HZG.
[14] CE, ass., 15 octobre 1993, n° 144590 N° Lexbase : A0945ANC.
[15] C. Maugüé et L. Touvet, Le contrôle du Conseil d’État sur le décisions d’extradition, AJDA 1993.848.
[16] CE, 29 octobre 2008, n° 313645 N° Lexbase : A1041EB8.
[17] CE, 14 novembre 2011, Ucar, n° 345258, préc.
[18] CE, 28 février 2019, n° 425105 N° Lexbase : A4714YZM.
[19] CEDH, 6 janvier 2023, Req. 18207/21, S. c/ France N° Lexbase : A70878MG.
[20] CE, 29 juillet 1994, n° 156288 N° Lexbase : A2406ASW.
[21] CE, 10 juin 2020, n° 435348 N° Lexbase : A27853NH.
[22] CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216 N° Lexbase : A7275ZKN.
[23] V. not., s'agissant du refus de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de mettre en demeure l'exploitant d'un moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens vers des pages web, CE, 6 décembre 2019, n° 391000 N° Lexbase : A3023Z74 ; s'agissant d'un refus de récupération d'aides d'État, CE 18 mars 2020, n° 396651 N° Lexbase : A95743IG ; s’agissant de la décision de l'ARCEP de s'abstenir de demander à des opérateurs la modification d'une convention de partage de réseaux mobiles (C. P et T, art. L. 34-8-1-1 N° Lexbase : L9854LSR), CE, 15 décembre 2021, n°s 448067, 448101 N° Lexbase : A558274I.
[24] CE, 10 juin 2020, n° 435348, préc.
[25] CE, 28 février 2020, n° 433886 N° Lexbase : A93003GK.
[26] CE, Sect., 19 novembre 2011, n°s 437141, 437142 N° Lexbase : A48067CY.
[27] CE, 31 décembre 2020, n° 439436 N° Lexbase : A35304BD.
[28] J-H. Stahl, Mutations, Droit administratif, n°s 8-9, août 2020.
[29] CE, 10 juin 2020, n° 435348, préc.
[30] v. sur ce point G. Odinet, Le juge de l’excès de pouvoir peut abroger la suspension d’un sportif si elle est devenue illégale à la date où il statue, Droit administratif, n° 10, 2020, comm. 43.
[31] CE, 4 juillet 1997, n° 156298 N° Lexbase : A0804AEI.
[32] CE, 21 mars 2001, n° 208541 N° Lexbase : A2193ATE, qui juge qu’un arrêté de reconduite à la frontière, légal à la date à laquelle il a été pris, est devenu inexécutable en raison du mariage, postérieur, de l’intéressé avec un ressortissant français.
[33] CE, 20 juin 2012, n° 346073 N° Lexbase : A5177IPG.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486072
[Focus] L’argument écologiste dans le discours du législateur pénal
Lecture: 18 min
N5789BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jacques-Henri Robert, Professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas
Le 28 Juin 2023
| Cet article est issu du dossier spécial de publication des actes du colloque « Écologisme et droit pénal » qui s’est tenu à Agen le jeudi 6 avril 2023 sous la direction scientifique de Julien Lagoutte. Le sommaire de ce dossier et les enregistrements audio du colloque sont à retrouver en intégralité sous ce lien : N° Lexbase : N5892BZA |
Mots clés : Charte de l’environnement • Écocide • Urbanisme • Déchets • Installations classées
Le législateur contemporain assied l’autorité de son discours sur l’effroi qu’inspire le changement climatique, il est centré sur la protection de l’humanité. Il n’en a pas toujours été ainsi : en des temps où la consommation n’était pas aussi massive qu’aujourd’hui, le législateur s’appliquait à protéger la nature pour elle-même sans s’embarrasser de considérations sanitaires ou économiques.
Grâce à mon grand âge, j’ai vécu sous le régime socio-économique que décrit M. Carbou dans un article qui formera la base de nos échanges [1]. C’était dans un village de huit cent cinquante habitants et, puisqu’il est situé en Normandie, ses constructions sont faites de bois, de paille, de terre et de bouse de vache. J’allais chercher le lait à la ferme, dans un pot au lait en fer blanc, et il était tout chaud du pis de la vache. Il y avait trois bouchers qui abattaient les animaux à la sortie du village, un peu malproprement au milieu des mouches attirées par le sang, et ils se fournissaient dans les fermes proches. Le nombre des bistrots était considérable et ils assuraient des liens sociaux intenses. Bien que ma famille soit bourgeoise, nous n’avions pas l’eau courante dans toutes les pièces, ma mère rinçait son linge dans une mare, et le chauffage était assuré par des poêles à bois. Les automobiles étaient rares et constituaient un signe de grande richesse.
Si le législateur avait été inspiré, en ce temps-là, par un discours écologiste, il aurait conservé les choses en cet état, au moins en dehors de villes corruptrices. De bons auteurs le lui recommandaient, comme Baudelaire et Bernanos et aussi un écrivain de moins bonne réputation comme Édouard Drumont qui publia, en 1889, La fin d’un monde. Mais le législateur des Trente Glorieuses fut inspiré par tous les démons, capitalistes et communistes, que dénonce M. Carbou [2]. Grâce aux engrais, les herbages de ce pays de bocage aux terres pauvres ont été labourés, le remembrement a détruit les haies et concentré les exploitations agricoles qui sont passées de dix à cent cinquante hectares. Les lotissements ont augmenté la population de mon village jusqu’à mille habitants qui ont perdu, au profit des grandes surfaces, la plupart de leurs commerçants et aussi de leurs débits de boissons ; ils ont, en revanche acquis des automobiles, au moyen desquelles, chaque jour ouvrable, ils se rendent à la gare pour travailler à Caen ou à Paris.
Les nombreux chercheurs que cite M. Carbou [3] pleurent donc sur le lait répandu qu’on ne boira jamais plus.
Le sujet que M. Lagoutte me propose semble donc manquer d’objet : le législateur français contemporain paraît ne pas avoir de discours écologiste du tout et si on étend la curiosité au-delà de nos frontières, on ne trouve guère que le Costa Rica qui fasse bonne figure ; la Nouvelle-Zélande mérite un accessit malgré son attachement au capitalisme. Notre législateur a manqué l’occasion de créer un crime d’écocide qui n’est devenu qu’une pollution assortie de circonstances aggravantes, et jamais criminelle [4].
Faute de mieux, cette communication portera donc sur les discours par lequel le législateur français et européen tend ou a tendu vers l’écologisme au sens où l’entend M. Carbou [5], sans jamais l’atteindre.
Ce sera une sorte de taxinomie de ces discours à tendance plutôt qu’à objet, écologiste. Elle sera suivie d’une appréciation de leur autorité.
I. La taxinomie des discours du législateur
Le critère choisi pour mesurer l’écologisme des discours du législateur est l’absence d’égoïsme humain, la mise à l’écart de considérations sanitaires ou économiques, bref le reniement de l’anthropomorphique.
La présence la plus ancienne de ce signe, au moins à l’époque moderne, se trouve dans les lois protectrices des animaux. On ne se lasse pas de célébrer la loi Grammont du 2 juillet 1850 qui réprimait les mauvais traitements envers les animaux domestiques, mais à condition qu’ils soient exercés publiquement et abusivement, ce qui gâte un peu l’effet.
L’activité réglementaire du XIXe siècle offre des exemples beaucoup plus convaincants d’une tendance non anthropomorphique par l’encouragement des activités associatives désintéressées et l’adoption concrète de leurs propositions. La routine a fait oublier le sens de la dénomination du Jardin d’acclimatation de Paris : or, elle exprime officiellement le désir de rendre le moins désagréable possible l’exil des animaux exotiques élevés dans des zoos. C’est l’œuvre d’une société savante qui s’appelait Société zoologique d’acclimatation, fondée en 1854 par Geoffroy Saint-Hilaire, reconnue d’utilité publique en 1857, sous Napoléon III et devenue, en 1960, la Société de protection de la nature et d'acclimatation de France ; on lui doit la création, en 1912, de la Ligue pour la protection des oiseaux, l’installation, à partir de 1927, de plusieurs réserves naturelles et elle est cofondatrice de France Nature Environnement.
Ce sont ces initiatives mêmes qui furent consacrées par la loi n° 76-629, du 10 juillet 1976, sobrement dénommée relative à la protection de la nature N° Lexbase : L4214HKB. Elle comprend trois chapitres intitulés « Faune et flore », « Animal » « Réserves naturelles » et « Espaces boisés ». C’est dans son article 9 qu’on trouve la célèbre formule : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce », qui est répétée à l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3263IK3 et évoquée dans l’article 515-14 du Code civil N° Lexbase : L9450I77. Et l’article 1er de la même loi, toujours en vigueur, affirme avec générosité : « La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général ».
« Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences ». Une remarque clôt tout de même cet article : « La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux ».
Tel est le monument le plus proche de l’écologisme dans le droit contemporain. Il ne doit pas jeter dans l’ombre d’autres instruments issus de la même pensée et qui sont désintéressés, et même coûteux pour l’économie : la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques N° Lexbase : L4485A8M (codifiée dans le Code du patrimoine), la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque [6], et celle du 22 juillet 1960 sur les parcs nationaux [7] (codifiées dans le Code de l’environnement).
Il ne faut donc pas désespérer. Le législateur s’est affranchi de discours qu’on trouverait aujourd’hui navrants, comme l’intitulé du décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode [8], ou celui de la loi du 19 décembre 1917 qui lui succéda et portait réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes [9].
Mais ses discours postérieurs aux années 1970 n’ont plus la même pureté écologiste au sens où nous l’entendons dans cette enceinte. Au lieu d’appeler au respect de la nature pour elle-même, ils se fondent sur la terreur qu’inspire aux citoyens le changement climatique ; cet effroi est un moyen plus efficace de leur faire accepter des contraintes écologiques que ne le seraient des arguments purement écologistes et qui sont aujourd’hui plus douloureuses qu’elles ne l’auraient été dans une société moins consumériste que la nôtre. Proscrire les emballages en plastique n’aurait eu aucune conséquence dans mon village d’autrefois dont les commerçants utilisaient du papier journal, et l’augmentation du prix de l’essence aurait réjoui les jaloux privés d’automobile, plus nombreux que ceux qui en possédaient une.
Revenant aux discours contemporains, lisons les considérants du texte le plus élevé dans la hiérarchie des normes, ceux de la Charte de l’environnement qui ont vivement déçu M. Prieur : « Considérant, - Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ; - Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ; - Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ».
La loi n° 2021-1104, du 22 août 2021 N° Lexbase : L6065L7R en est la conséquence qui révèle les mobiles du législateur dans son titre : « Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ». Et l’exposé des motifs qui en a présenté le projet contient cette affirmation : « Alors que la planète est déjà confrontée aux impacts du dérèglement climatique, et ainsi que les États s’y sont engagés lors de l’accord de Paris, il est de notre responsabilité morale, politique, humaine et historique d’agir pour transformer en profondeur notre modèle économique et préparer la France au monde de demain ».
Même dans des textes qui ne sont pas faits pour effrayer les populations et qui ont pour objet des éléments autres que la survie des humains, on trouve encore des motifs égoïstes.
Ainsi, qui s’attendrait à des sentiments plus purs dans les motifs de la loi n° 2016-1087, du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N° Lexbase : L8435K9B, serait déçu en lisant ceci dans l’exposé des motifs : « La biodiversité est aussi une force économique pour la France. D’une part, elle assure des services qui contribuent aux activités humaines, dit services écosystémiques. Si l’évaluation complète des services rendus et donc le coût de leur disparition ne sont pas encore connus, plusieurs études ont montré l’importance de la biodiversité en tant que capital économique extrêmement important. D’autre part, la biodiversité est une source d’innovation (biomimétisme, substances actives, etc.) et représente dès une lors une valeur potentielle importante [10] ».
On aurait pu croire que le législateur européen, à l’abri des électeurs, serait plus hypocrite. Mais non. La Directive (UE) n° 2009/147 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages N° Lexbase : L4317IGY est précédée de ces considérants :
« (4) Les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres sont en grande partie des espèces migratrices. De telles espèces constituent un patrimoine commun et la protection efficace des oiseaux est un problème d’environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités communes.
(5) La conservation des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres est nécessaire à la réalisation des objectifs de la Communauté dans les domaines de l’amélioration des conditions de vie et du développement durable ».
On doit craindre que ce mélange de sentiments et la variété des discours différents tenus à l’occasion de chaque loi, Directive ou Règlement ne nuisent à leur autorité
II. L’autorité des discours écologistes du législateur
Il y a deux occasions de mesurer l’autorité des discours plus ou moins écologistes du législateur : tantôt il faut apprécier leurs effets sur le domaine qu’ils sont supposés régir (effectivité interne), tantôt leur application les met en concurrence avec d’autres principes supérieurs, notamment ceux qui protègent les droits de l’homme (effectivité externe).
A. L’effectivité interne
La plupart des lois environnementales sont des lois de police qui définissent le domaine dans lequel agit l’autorité administrative compétente (installations classées, eau, déchets etc.) ; d’avance, elles prévoient une sanction contre les manquements aux règlements, nationaux ou européens, qui seront, à l’avenir, publiés pour leur exécution. Or, ce système engendre un grand danger de stérilité du discours. Le péril prend deux formes opposées : soit la sécheresse, soit l’inondation.
L’application de la loi relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, offre l’exemple de ces deux événements successifs. Elle fut promulguée le 15 juillet 1975 sous le numéro 75-633 N° Lexbase : L6874AGP, le même jour que la Directive n° 75/442 du Conseil N° Lexbase : L9219AUY qui employait des termes voisins, mais l’administration chargée de son application négligea longtemps de préparer les décrets nécessaires. Il y avait à cela un motif politique, le soupçon selon lequel les lois écologiques des années 1975 et 1976, celle précitée sur la nature et l’autre sur les installations classées [11], étaient insincères. L’écologie n’était alors qu’une mode d’intellectuels, inspirée par la candidature de René Dumont à la présidence de la République, et les politicologues soutenaient que ces lois étaient destinées à amuser le Parlement en détournant son attention de questions économiques et sociales jugées plus sérieuses après le premier choc pétrolier de 1973. Les ingénieurs des ministères, chargés de préparer les décrets et arrêtés pour l’application de la loi de 1975, nourrissaient ce soupçon d’insincérité car ils pensaient que la réglementation des installations classées offrait un support suffisant pour encadrer l’élimination des déchets. Il fallut attendre 1979 pour qu’un premier décret ayant cet objet [12] soit publié sur un objet très particulier, l’élimination des huiles usagées.
Mais ultérieurement, l’activité administrative française fut intense, et l’inondation survint avec l’absorption, par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du Code de l’environnement N° Lexbase : L3190KGA, du Règlement de la Communauté européenne n° 1013/2006, du 14 juin 2006, relatif aux transferts internationaux de déchets N° Lexbase : L3231HKU : il contient quarante-deux considérants, soixante-quatre articles et treize longues annexes très techniques et des renvois à la convention de Bâle, du 22 mars 1989, sur le contrôle des déchets dangereux et leur élimination N° Lexbase : L4341ITX, et à la Directive n° 91/689, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux N° Lexbase : L7572AUY. Les conseillers de la cour d’appel de Poitiers avaient jugé que puisqu’eux-mêmes, quoique juristes, ne savaient pas sur quelle base condamner un prévenu, c’est que la norme répressive manquait de la clarté et de la précision qui conviennent à des lois pénales. Le règlement détruit la loi. L’arrêt anarchiste fut cassé [13].
Un autre exemple de stérilisation par inondation est fourni par la réglementation des produits chimiques : les articles L. 521-1 à L. 521-24 du Code de l’environnement N° Lexbase : L5048L8H intègrent au droit interne français le Règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, dit « REACH » N° Lexbase : L0078HUG, qui comprend cent quarante et un articles, dix-sept annexes et dix appendices, tous fréquemment modifiés. Il n’a donné lieu à aucune décision judiciaire française et le contentieux de son application est confiné au prétoire de la Cour de justice de l’Union européenne, dont les arrêts inspirent de très subtils commentaires aux spécialistes sans aucun impact sur le droit national.
Beaucoup plus intéressante est la rencontre entre les discours écologistes et la protection des droits de l’homme.
B. L’effectivité externe
Des militants ont soutenu qu’il fallait placer la protection de l’environnement au-dessus des droits de l’Homme, puisque ceux-ci seront inutiles quand l’espèce humaine sera éteinte par l’effet de son propre mépris de la nature. C’est un des arguments de la deep ecology qui n’a pas encore prospéré dans le droit positif.
Des rencontres entre les normes écologiques et les droits de l’Homme ont néanmoins été observées, avec tantôt des défaites et tantôt des victoires du discours écologique.
La situation est confuse et les décisions nombreuses lorsque sont aux prises d’une part le droit à l’inviolabilité du domicile et à une vie de famille [14], et d’autre part les objectifs écologiques énoncés par le Code de l’urbanisme, et en particulier celui du 6° de son article L. 101-2 N° Lexbase : L7076L79 (qui est un bric-à-brac) : « La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ». La règle est qu’est disproportionnée la condamnation à la démolition si elle sanctionne la seule inobservation d’un permis de construire ou d’un règlement local d’urbanisme [15], mais qu’elle est permise quand le bâtisseur élit domicile en zone inondable, non constructible ou autour d’un monument classé [16] ; et un peu de souplesse est accordée aux gens du voyage qui ont le droit, fondé sur l’article L. 151-13, 2°, du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L9977LMH et que n’ont pas les autres citoyens, de s’installer, moyennant autorisation, dans des « zones naturelles, agricoles ou forestières ». Le très complexe article L. 480-13 du même code N° Lexbase : L5016LUC fait la même distinction à propos d’une situation rare : celle de l’annulation, par la juridiction administrative, d’un permis de construire contraire aux règles de l’urbanisme : malgré cette irrégularité, le juge judiciaire est privé du droit de prononcer la démolition, sauf si la zone affectée est protégée comme figurant dans l’une des quatorze entrées du 1° de cet article.
La protection de l’environnement, en revanche, triomphe facilement de droits de l’homme qui supportent de nombreuses atteintes, c’est-à-dire le droit de propriété et la liberté du commerce : depuis longtemps, ils cèdent devant les règlements de police donc a fortiori devant la protection de l’environnement. On a beaucoup célébré la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a refusé de censurer l’interdiction de l’exportation de produits phytopharmaceutiques vers des pays non européens qui n’en interdiraient pas l’emploi [17] : mais l’émerveillement tient surtout au fait que le Conseil s’est fondé sur les considérants de la Charte de l’environnement [18] pour décider que la protection de l’environnement des pays étrangers était un objectif de valeur constitutionnelle, alors qu’il avait à sa disposition des moyens plus simples et plus évidents, comme le droit à la santé. Le même Conseil a, peu de temps après, tempéré son ardeur lorsqu’il n’a pas cru que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé protégé par l'article 1er de la Charte de l'environnement [19] obligeait le législateur à ne jamais alléger les règles protectrices de l’environnement, bien que ce principe de non-régression, inscrit dans l’article L. 110-1, II, 9°, du Code de l’environnement N° Lexbase : L6857L74, s’impose au pouvoir réglementaire [20].
Loin de contrarier la protection de l’environnement, les droits de l’Homme peuvent aussi lui fournir un point d’appui. C’est le cas du droit à réparation des dommages causés par une faute délictuelle [21], du droit au juge, qui est octroyé aussi avec générosité aux associations, sauf quelques fléchissements [22].
Le droit à l’information et à l’expression est consacré par l’article 7 de la Charte de l’environnement [23] qui impose une information du public préalablement à une « décision ayant une incidence sur l’environnement » ; mais il est aussi à l’origine d’un accident juridique que l’on a qualifié de « côté obscur de la Charte de l’environnement [24] » : en effet, le défaut d’information du public concernant la loi environnementale est invoqué à leur profit par les industriels qui contestent l’excès des obligations qu’une loi leur impose [25]. En pratique, c’est eux qui ont intérêt à agir quand ils sont poursuivis devant les juridictions pénales et, en revanche, les défenseurs de l’environnement se heurtent à une interprétation très restrictive ce de qu’est « une incidence sur l’environnement [26] ».
On frémit à la pensée d’un autre conflit qui s’élèverait entre la liberté d’expression et la protection de l’environnement : aujourd’hui, l’apologie des actes attentatoires à l’environnement n’est pas punissable comme l’est celle des crimes et délits contre la vie et l’intégrité des personnes et contre l’humanité [27] et celle des infractions de terrorisme [28]. Faudrait-il l’incriminer et punir les climatosceptiques ? Voilà un beau ring pour un catch juridique.
[1] G. Carbou, L’écologie politique, repères pour une cartographie, Alternatives économiques, 2021-2, p. 36.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] J. Lagoutte et J.H. Robert, Le principal et l’accessoire des dispositions pénales de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, Droit pénal, 2021, Étude 20.
[5] G. Carbou, op. cit.
[6] Loi du 2 mai 1930, ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque [en ligne].
[8] Décret impérial du 15 octobre 1810, relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode [en ligne].
[9] Loi du 19 décembre 1917, modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes [en ligne].
[10] Loi n° 2016-1087, du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, exposé des motifs [en ligne].
[11] Loi n° 76-663, du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement N° Lexbase : L6346AG7.
[12] Décret n° 79-981, du 21 novembre 1979 du 21 novembre 1979, portant réglementation de la récupération des huiles usagées [en ligne].
[13] Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-80.944, F-P+B N° Lexbase : A3693RAZ.
[14] CESDH, art. 8 N° Lexbase : L4798AQR.
[15] Cass. crim., 31 janvier 2017, n° 16-82.945, FS-P+B N° Lexbase : A4124TBD : Dr. pén., 2017, comm. 59.
[16] Cass. crim., 19 mars 2019, n° 18-80.613, F-D N° Lexbase : A8846Y4E : Dr. pén., 2019, comm. 92 ; Cass. crim., 21 juin 2022, n° 21-81.392, F-D N° Lexbase : A285578A : Dr. pén., 2022, comm. 168.
[17] Cons. const., décision n° 2019-823 QPC, du 31 janvier 2020 N° Lexbase : A85123CA : L. Fonbaustier, note, Dr. adm., 2020, comm. 17 ; Ph. Billet, JCP A, 2020, 2156.
[20] Cons. const., décision n° 2020-809 DC, du 10 décembre 2020 N° Lexbase : A385439M. C’était à propos de la question sensible des néonicotinoïdes ; CE, 2e-7e ch. réunies, 9 juillet 2020, n° 439195 N° Lexbase : A63964YK : J.-S. Boda, note, JCP A, 2020, 2387, depuis lors réglée par la CJUE le 19 janvier 2023, qui a condamné le laxisme français (CJUE, 19 janvier 2023, aff. C-162/21 N° Lexbase : A930288Z).
[22] Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3030ITE : exclusion de Robin des Bois dans l’affaire Erika ; Cons. const., décision n° 2022-986 QPC, du 1er avril 2022 N° Lexbase : A77857RR : A. Meynaud-Zeroual, note, Dr. adm., 2022, comm. 39 : exclusion des associations trop jeunes.
[24] L. Fonbaustier, Env. et développement durable, 2012, Étude 3.
[25] Cons. const., décision n° 2011-183/184 QPC, du 14 octobre 2011 N° Lexbase : A7387HYA : Dr. pén., 2011, comm. 155 ; Cons. const., décision n° 2016-595 QPC, du 18 novembre 2016 N° Lexbase : A3267SHH : Dr. pén., 2017, comm. 10.
[26] A. Farinetti, Env. et développement durable, 2014, Étude 17.
[27] Loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse N° Lexbase : L7589AIW, art. 24, al. 4.
[28] C. pén., art. 421-2-5 N° Lexbase : L8378I43.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485789
[Focus] Pour une écologisation de l’état de nécessité et de la légitime défense
Lecture: 24 min
N5788BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Julien Lagoutte, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Bordeaux, Institut de sciences criminelles et de la justice
Le 21 Juin 2023
| Cet article est issu du dossier spécial de publication des actes du colloque « Écologisme et droit pénal » qui s’est tenu à Agen le jeudi 6 avril 2023 sous la direction scientifique de Julien Lagoutte. Le sommaire de ce dossier et les enregistrements audio du colloque sont à retrouver en intégralité sous ce lien : N° Lexbase : N5892BZA |
Mots-clés : droit pénal de l’environnement • état de nécessité • faits justificatifs • légitime défense • infraction écologiste
Poursuivis pour des infractions écologistes, les militants adoptent souvent une stratégie consistant à invoquer l’état de nécessité mais qui, en l’état du droit positif, est vouée à l’échec. Une réforme s’impose donc en faveur d’une écologisation de l’état de nécessité mais aussi de la légitime défense, et ce, aux fins d’une mise en cohérence du droit pénal avec les enjeux de notre temps, d’une part, et pour sécuriser l’action militante des écologistes, d’autre part, compte tenu de l’anathème outrancière dont ils font l’objet aujourd’hui.
1. Responsabilité ou irresponsabilité ? – « Nous sommes la Dernière Génération de l'ancien monde… et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger notre génération et toutes celles à venir… Nous ne sommes pas là pour sensibiliser, supplier ou divertir. Nous sommes là pour forcer le changement requis pour que ce monde advienne… Nous sommes là pour des actions, pas des mots… Si nous ne sommes pas entendus, nous perturberons, semaine après semaine, comme l’ont fait maintes fois celles et ceux qui nous ont précédés dans leur lutte pour les droits humains… Nous nous engageons à désobéir… Nous sommes ouverts et non violents… Nous accepterons les conséquences de nos actions. » [1] Voilà quelques extraits, allégés des envolées lyriques et romantiques qu’on y retrouve aussi, de l’appel du Réseau A22, auquel adhère, notamment et pour la France, le groupe Dernière Rénovation. Un manifeste écologiste en quelque sorte, tel celui rédigé par Marx et Engels pour le parti communiste ; le manifeste, en tous cas, d’un certain écologisme international, bien qu’ancré localement, le manifeste de ceux que certains appellent la Blocadie [2].
Les mots employés sont éloquents ; ils résonnent en tout cas particulièrement à l’oreille des juristes. Outre la référence évidente à Malcolm X [3], qui n’étonne pas puisqu’il s’agit bien de désobéissance civile [4] !, on devine que l’infraction écologiste est une option qui n’est pas exclue, voire qui est privilégiée [5]… dès lors qu’elle semblera nécessaire. « Nous accepterons les conséquences de nos actions » : ces militants acceptent une éventuelle responsabilité, y compris pénale ! Il est pourtant question ici de justification, de légitime défense, d’état de nécessité : s’agit-il alors de vouloir sauver ceux qui ne le souhaitent pas et qui, pour rester fidèles à leur engagement, devraient se résoudre à être réprimés ? Pas forcément, car, en prenant les faits tels qu’ils sont, il faut bien admettre que là où il y a des infractions écologistes, il y a en pratique une recherche d’irresponsabilité pénale. Et d’ailleurs, si vraiment il pouvait ou devait y avoir irresponsabilité pénale en cas d’infraction écologiste, ce serait que le droit lui-même n’attache aucune conséquence pénale à une telle action !
2. Infractions écologistes. Les infractions écologistes, infractions commises aux fins de défense de l’environnement, sont on ne peut plus actuelles et pourtant fort anciennes – l’histoire moderne ne se résumant pas à celle d’une longue inertie face aux désastres de l’industrialisation et de la mondialisation [6]. Elles peuvent être réparties en deux catégories [7].
D’un côté, certaines actions ont pour objectif de faire véritablement obstacle à une atteinte qui menace concrètement une entité naturelle (écosystème, animal, arbre, cours d’eau, etc.). C’est le cas de zadistes protégeant une zone humide sensible, de faucheurs d’OGM craignant un ensemencement de champs voisins, de militants bloquant les travaux d’extension d’une mine à ciel ouvert, de promeneurs obstruant le passage des chevaux d’amateurs de chasse à courre. D’un autre côté, on trouve des opérations consistant exclusivement à alerter les pouvoirs publics, les médias, les citoyens, à propos d’une menace écologique plus ou moins connue, diffuse ou actuelle. Ainsi des décrocheurs de portraits, des jets de peinture de Dernière Rénovation sur des œuvres d’art, des intrusions de Greenpeace dans des enceintes nucléaires ou des campagnes de sensibilisation de ceux qui aspergeaient de faux sang les manteaux de fourrure, il y a longtemps déjà.
3. Moyens de défense. Ces infractions sont assez globalement poursuivies et les prévenus ne manquent pas alors d’invoquer des moyens de défense. S’ils sont prêts à accepter les conséquences pénales de leurs actions, c’est donc à la condition, toutefois, qu’ils ne puissent pas bénéficier de légitimes causes d’irresponsabilité pénale ! Car en leur présence, le droit prive précisément la commission d’une infraction de toutes conséquences.
Ces moyens de défense sont multiples. On ne reviendra pas sur la liberté d’expression, qui semble aujourd’hui être la seule – et étroite [8] – porte de sortie des militants écologistes [9] : l’invoquer n’a pas été le premier réflexe des auteurs d’infractions écologistes. Ils ont, d’abord, pensé à de très classiques faits justificatifs : la légitime défense de l’article 122-5 du Code pénal N° Lexbase : L2171AMD, très rarement [10], alors pourtant que ce sont bien des attaques que subit l’environnement [11] ; et l’état de nécessité de l’article 122-7 du même code N° Lexbase : L2248AM9, trop souvent [12], la question étant dès lors envisagée sous le prisme de ce seul fondement en doctrine [13]. Ces faits justificatifs sont presque systématiquement invoqués en défense avec toujours le même résultat : un inévitable échec [14] ! Le droit positif est trop restrictif pour que les militants puissent échapper aux conséquences pénales de leurs actions sur le fondement de ces textes.
4. État de nécessité environnemental et légitime défense environnementale. Ce qu’il faudrait pour que l’on reconnaisse une légitime défense environnementale ou un état de nécessité environnemental, c’est donc une réforme. Mais précisément : faut-il une réforme ? Faut-il une écologisation de l’état de la légitime défense et de l’état de nécessité ?
Sans même évoquer le caractère inhérent, voire salvateur de la désobéissance civile à toute vraie démocratie [15], on peut soutenir qu’une telle évolution s’impose, ne serait-ce que pour sécuriser juridiquement les actions militantes, pour inverser le rapport de force qui fait qu’alors que seuls 24 % des quelques infractions contre l’environnement constatées font l’objet de procès pénaux en bonne et due forme [16], la poursuite des infractions pour l’environnement, certes beaucoup moins insidieuses et clandestines, semble presque systématique [17]. Il faut une écologisation de la légitime défense et de l’état de nécessité ! Il en sera ici défendu le principe et proposé des modalités.
I. Le principe d'écologisation de l’état de nécessité et de la légitime défense
5. Pourquoi défendre l’écologisation de la légitime défense et de l’état de nécessité ? Pour des raisons simples répondant à deux exigences classiques en droit : cela serait juste et utile.
A. Justice de l’évolution
6. Nécessité.
L’écologisation de la légitime défense et de l’état de nécessité apparaît conforme à une exigence de justice, de légitimité. C’est ce que l’on peut conclure en mettant les choses en perspectives avec un certain nombre de principes du droit pénal.
Au regard, d’abord, du principe de nécessité, la légitimité d’un état de nécessité ou d’une légitime défense environnementale se justifie pleinement au regard des menaces qui pèsent sur l’environnement [18], d’un côté, et de la valeur juridique que ce dernier, ainsi que sa protection, se voient reconnaître aujourd’hui, d’un autre côté . Sur ce dernier point, il suffit de citer quelques grands textes internationaux [19] – des premières conventions utilitaristes, comme celle de 1883 sur la protection des phoques à fourrure, au récent traité sur la conservation de la biodiversité marine en haute mer en cours de finalisation [20], en passant par la Déclaration de Stockholm en 1972 – et européens [21], complétés de sources tirées de notre droit constitutionnel, la Charte de l’environnement inspirant de plus en plus le Conseil constitutionnel [22].
Plus spécifiquement, l’environnement est aussi valorisé par des normes pénales, et ce, à l’échelle globale [23], régionale [24] et nationale. Le Code pénal lui-même, en effet, fait de « l’équilibre de son milieu naturel et son environnement » un des « intérêts fondamentaux de la nation » [25]. C’est l’ériger en bien juridico-pénal méritant que l’on incrimine des comportements qui pourraient lui nuire et, par là même, qu’on puisse commettre des infractions en son nom. Question de cohérence.
7. Proportionnalité. La cohérence du système répressif est encore en cause lorsqu’il est question, ensuite, du principe de proportionnalité de la loi pénale. On admet déjà aujourd’hui que des infractions puissent être commises pour sauvegarder non seulement des personnes mais aussi des biens. Il semblerait logique, proportionné, qu’il puisse en être de même pour l’environnement.
S’agissant des biens – soit de la propriété – pour commencer, on peut sans doute concéder aujourd’hui, en dépit de l’équivalence des valeurs juridiques de cette dernière et de l’environnement, que celui-ci est plus important que les biens que nous possédons. De quoi sommes-nous propriétaires ? De quoi sont faits nos biens, si ce n’est d’entités naturelles transformées ou à l’état brut ? Pour le dire clairement : sans l’environnement, sans les éléments qui le composent, pas de biens, pas de propriété. La seconde est forcément ordonnée à la première. Qui peut le plus peut le moins : le système répressif qui autorise la légitime défense de la propriété privée peut – doit ! – autoriser celle de l’environnement !
Quant aux personnes, pour finir, on pourrait tenir le même raisonnement : sans biosphère équilibrée, climat suffisamment modéré ou ressources naturelles en quantité suffisante, pas de vie possible, pas d’humanité, pas d'êtres humains… Mais on ne le fera pas par attachement à l’idée que les personnes sont des fins en soi et qu’il n’est ni possible ni souhaitable de les subordonner à d’autres valeurs. Deux précisions, en revanche. Premièrement, lorsque l’on envisage la personne dans les articles 122-5 N° Lexbase : L2171AMD et 122-7 N° Lexbase : L2248AM9, on ne se réfère pas seulement à leur vie ou leur intégrité corporelle mais à l’ensemble de leurs intérêts extrapatrimoniaux – vie privée, liberté sexuelle, intégrité morale. Or s’il est difficile d’admettre qu’on mette l’environnement au-dessus de la vie d’une personne, on peut avoir moins de scrupule à le placer au-dessus de son honneur ou de son image… Secondement, il suffit, pour ne vexer personne, de considérer que l’environnement a au moins autant de valeur que la personne humaine pour tenir pour juste et proportionnée l’écologisation de la légitime défense et de l’état de nécessité.
8. Légalité. Enfin, une telle évolution serait légitime au regard du principe de légalité, simplement car il ne le violerait pas – à l’inverse de ce qui est couramment dit sur la contrariété de principe de la matière environnementale à ses exigences.
Le terme « environnement » lui-même, polysémique et renvoyant à des représentations et des réalités diverses [26], n’est peut-être – la nuance est importante ! – pas conforme à la légalité. Mais le plus souvent, c’est à d’autres notions, plus précises, que se réfèrent les textes : les eaux, l’air, l’atmosphère, le sol et le sous-sol, les bois, forêts, landes ou maquis, la faune et la flore, voire les individus appartenant à telle ou telle espèce ou catégorie. Elles ne heurtent aucunement les exigences de précisions et de clarté de la loi pénale... pour qui veut s’instruire ou, au moins, s’informer.
La justice commande donc l’écologisation de la légitime défense et de l’état de nécessité.
B. Utilité de l’évolution
9. Inadéquation de l’état de nécessité et de la légitime défense actuels. L’écologisation de la légitime défense et de l’état de nécessité peut encore sembler utile, voire nécessaire au regard de l’insuffisance du droit positif.
Cette insuffisance, c’est évidemment, pour commencer, celle de la légitime défense et de l’état de nécessité, lesquels sont envisagés de manière trop stricte pour être invocables par les militants écologistes.
Tout d’abord, ces faits justificatifs supposent que l’infraction réponde à un danger actuel. Cela conduit la jurisprudence à exclure la justification d’infractions écologistes commises pour éviter la réalisation d’un risque incertain : quant au moment de sa survenance – ce qui fonde le refus de l’état de nécessité aux militants agissant contre l’inaction climatique [27] ou pour alerter de la vulnérabilité de sites nucléaires à des attaques terroristes [28] ; voire quant au principe même de son existence – impliquant un rejet du risque de précaution, ne faisant pas l’objet d’un consensus scientifique, au détriment des faucheurs d’OGM [29], par exemple.
Ensuite, l’état de nécessité et la légitime défense ne peuvent être invoqués que pour sauver une personne ou un bien concrètement menacé et non l’environnement [30]. On plaide ainsi en vain en affirmant que les conséquences du réchauffement climatique se font déjà sentir, que la modification de la composition de l’atmosphère peut être analysée comme un préjudice écologique d’ores et déjà caractérisé. On ne peut, en droit positif, agir pour sauver le climat mais seulement pour sauver une personne ou un bien qui serait actuellement mis en danger par le changement climatique. Il n’existe qu’une possibilité : admettre ces faits justificatifs au profit de celui qui aura agi pour sauver une entité naturelle appropriée, ayant le statut juridique de bien, tel un animal domestique [31], une parcelle de terrain. Mais une autre limite se révèle alors : on ne saurait défendre un bien contre son propriétaire ! Celui qui bat son chien ou défriche entièrement son terrain ne peut subir d’infraction commise en légitime défense ou en état de nécessité [32].
Ensuite encore, la Chambre criminelle juge que l’infraction n’est commise en état de nécessité ou de légitime défense qu’autant qu’elle a été nécessaire, c’est-à-dire qu’elle a constitué le seul moyen d’éviter effectivement la réalisation du danger qui l’a motivée [33]. L’infraction, seul moyen : cela avait déjà conduit la Chambre criminelle à ne pas justifier le fauchage d’OGM [34] ; c’est ce qu’elle vient de juger à propos de militants ayant enduit de peinture des bidons de glyphosate dans un magasin de jardinage : « ils avaient accès à de nombreux moyens d’action, politiques, militants, institutionnels qui existent dans tout État démocratique » [35]. L’infraction, moyen utile : c’est ce que n’est pas le décrochage d’un portrait présidentiel affirme aussi la Cour de cassation [36]. Elle en dirait autant du fait d’asperger de soupe ou de peinture un tableau.
Enfin, la loi, pour la légitime défense, la jurisprudence, pour l’état de nécessité, ne justifient que les infractions commises contre des attaques ou des dangers injustes [37]. Cela interdit la justification d’infractions écologistes commises pour empêcher l’exercice d’activités peut-être dangereuses pour l’environnement mais néanmoins autorisées par l’administration. On ne saurait ni faucher les plants transgéniques de celui qui détient l’agrément requis pour les cultiver ni commettre des dégradations pour empêcher l’extension d’une mine dont l’exploitation a été autorisée.
10. Insuffisance de l’article 73 du Code de procédure pénale. Pour finir, l’insuffisance du droit positif tient à l’absence de palliatifs ou pis-aller satisfaisants. On songe spécialement à l’article 73 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3153I38, qui autorise toute personne à interrompre la commission d’une infraction punie d’une peine privative de liberté et à appréhender son auteur afin de le conduire à un officier de police judiciaire. Cela offre une possibilité aux militants car les infractions environnementales punies d’emprisonnement sont de plus en plus nombreuses. Mais cette possibilité est limitée : d’abord, le texte n’est applicable qu’en cas d’infraction flagrante, ce qui implique, en pratique, d’en être témoin – comme en matière de légitime défense et d’état de nécessité, du reste ; ensuite, cela laisse hors d’atteinte les contraventions, certains délits [38] et, a fortiori, les atteintes non manifestement illicites à l’environnement ; enfin, les actions des militants écologistes ne s’inscrivent pas, en pratique, dans cette logique d’auxiliaire de police.
On le voit, l’écologisation de la légitime défense et de l’état de nécessité, juste et utile, peut être défendue en son principe même !
II. Les modalités de l’écologisation de l’état de nécessité et de la légitime défense
11. Comment instituer la légitime défense environnementale et l’état de nécessité environnemental ? Par une évolution du droit positif, bien entendu, spécialement sous forme d’extensions des articles 122-5 N° Lexbase : L2171AMD et 122-7 N° Lexbase : L2248AM9 du Code pénal. Dans la mesure du possible car s’il y a des extensions possibles de ces faits justificatifs, il faut bien admettre que d’autres sont impossibles à opérer. Ils existent donc des limites à rappeler.
A. Les extensions possibles
12. Objet sauvegardé. L’optimisme, d’une part, conduit à considérer qu’un certain nombre d’extensions de la légitime défense et de l’état de nécessité est possible. Elles touchent à trois éléments.
C’est le cas, d’abord, de l’objet sauvegardé par l’infraction. Les choses sont assez simples. Le problème actuel tient au fait qu’on ne peut sauvegarder par la commission d’une infraction qu’une personne ou un bien [39]. La solution, quant à elle, est facilitée par le fait que le principe de légalité ne s’oppose pas par principe à ce que l’on se réfère, dans une norme pénale, à la notion d’environnement ou à une autre plus précise représentant ce bien juridique [40]. Il suffit donc d’intégrer aux articles 122-5 et 122-7 du Code pénal une telle référence, que l’on situerait idéalement juste après les personnes et juste avant les biens.
13. Actualité du péril. S’agissant, ensuite, du caractère actuel du péril pesant sur l’environnement, une extension est également possible, par la voie de l’interprétation des textes actuels comme par celle de leur modification.
La difficulté actuelle tient en effet à ce que la jurisprudence – et parfois la doctrine [41] – concentre dans le qualificatif « actuel » deux mots au sens légèrement différents : premièrement, le mot français « actuel » dont le sens commun est « qui se produit, qui existe au moment présent » [42] ; secondement, le même mot français, mais dans une acception philosophique qui rejoint le terme anglais « actual », signifiant « effectif » ou « véritable », par opposition à ce qui n’est que pensé comme tel [43]. Alors que le premier justifie que l’on écarte du champ de la justification les infractions commises avec trop d’anticipation, le second conduit à exclure également celle des faits qui, potentiellement présents, ne sont incertains que parce que manque un consensus scientifique en faveur de la reconnaissance de leur existence. Les deux situations sont très différentes. Lorsqu’en 1633, l’Inquisition force Galilée à renier sa théorie suivant laquelle la Terre tourne, cette réalité n’est précisément qu’une opinion, qui ne fait pas encore consensus : elle n’est pas certaine, on ne sait pas si la Terre tourne effectivement. Et pourtant, elle tourne au moment où parle Galilée ! Le consensus n’a pas fait démarrer ce phénomène par la suite. Il n’a fait qu’en admettre la réalité scientifique. Savoir si l’on doit admettre ou non que l’on puisse commettre une infraction pour protéger l’environnement contre un danger incertain dans ce sens précis revient finalement à se demander s’il est possible de faire pénétrer, à ce point, le principe de précaution dans le droit pénal. Rien n’empêche de penser qu’on le puisse à condition toutefois de respecter, évidemment, le strict cadre du principe de précaution [44]. Sous réserve, autrement dit, qu’en dépit de l’absence de consensus scientifique, une minorité de scientifiques sérieux soutiennent la thèse de l’existence du risque en question et qu’il s’agisse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou la santé publique. Ainsi cantonnée – et textuellement encadrée – une telle évolution paraît à la fois nécessaire et raisonnable du double point de vue de la gravité des dommages environnementaux et des libertés individuelles.
14. Nécessité de l’infraction. C’est aussi par la voie de l’interprétation, enfin, que l’on peut faire évoluer l’appréciation du caractère nécessaire de l’infraction. Car exiger qu’elle constitue le seul moyen est une lecture très rigide et restrictive des articles 122-5 et 122-7 du Code pénal. Une lecture que l’on n’a pas toujours. On considère parfois qu’il suffit que l’infraction constitue le ou l’un des meilleurs moyens de mettre un terme à l’attaque ou au péril [45]. C’est sur ce fondement que les anciens enseignaient que, face à une attaque, une victime peut se défendre, y compris si elle aurait pu s’échapper [46]. Il ne semble pas qu’à celui qui se fait agresser, on rétorque qu’après tout, « il avait accès à d’autres moyens de se protéger, telle que la fuite ou la dissimulation ». Lorsque le danger est véritablement imminent ou actuel, les voies légales sont précisément insuffisantes. Si vraiment des plantations ou des personnes sont exposées à une substance telle que le glyphosate, manifester ou former des recours n’est plus utile ; la dégradation peut s’imposer. Dans l’arrêt du 29 mars 2023, c’est peut-être davantage l’actualité du péril qui faisait défaut…
B. Les extensions impossibles
15. Injustice du péril. Il faut cependant faire preuve de réalisme, d’autre part, en reconnaissant que certaines extensions de la légitime défense et de l’état de nécessité sont impossibles. Les difficultés sont, cela dit, variables, l’impossibilité étant tantôt relative, tantôt absolue.
L’impossibilité n’est, dans un premier temps, que relative pour ce qui est du caractère injuste de la menace pesant sur l’environnement.
D’un côté, aujourd’hui déjà, les atteintes illicites à l’environnement sont d’ores et déjà suffisamment nombreuses pour que les militants écologistes aient tout le loisir de commettre des infractions satisfaisant les exigences de la loi et de la jurisprudence en matière de légitime défense et d’état de nécessité. Empêcher l’exploitation d’un élevage industriel n’ayant pas obtenu d’autorisation administrative, bloquer un transport de déchets radioactifs si le transporteur n’est pas porteur du document requis par le Code de l’environnement, empêcher des chasseurs landais de chasser l’ortolan ou à la glu, faire cesser le fonctionnement de mégabassines jugées illégales : tout cela est possible dès lors, bien entendu, que le reste des conditions de la justification – spécialement la nécessité et la proportionnalité de l’infraction commise – sont réunies !
D’un autre côté, dans une perspective prospective, le caractère injuste de la menace n’est un obstacle pratique important que parce que le droit pénal français de l’environnement est, dans sa très grande majorité, une discipline accessoire, dépendante du droit administratif et, donc, des autorisations et dérogations distribuées par l’autorité administrative ou des mises en demeure qu’elle ne délivre pas. L’évolution de la matière vers un modèle autonome, protégeant l’environnement en tant que tel et non pas le droit administratif de l’environnement, aurait, entre autres intérêts, l’avantage de diminuer les occurrences d’atteintes licites à l’environnement.
16. Utilité de l’infraction. L’impossibilité, dans un second temps, est en revanche absolue si l’on s’intéresse au caractère utile de l’infraction commise.
Lorsque, d’un côté, l’acte militant consistera à faire véritablement obstacle à une atteinte qui menace concrètement l’environnement, l’infraction commise présentera une véritable utilité. S’il n’existe immédiatement aucun meilleur moyen d’empêcher sa réalisation, elle sera donc nécessaire. Elle pourra aussi être proportionnée, au moins dans la même mesure – c’est une question de cohérence, encore ! – que la légitime défense des biens : autrement dit, sauf le cas de l’homicide volontaire.
D’un autre côté, lorsque l’infraction aura, en revanche, pour seul but de lancer l’alerte, alors, il ne pourra y avoir état de nécessité ou légitime défense environnementales. Jamais une infraction ne pourra empêcher le réchauffement climatique ou l’attaque terroriste simplement crainte d’une centrale nucléaire ! Dans ce cas, seule la liberté d’expression [47] paraît un moyen de défense adapté.
17. Dernières rénovations du Code pénal ? En conclusion, voici ce que pourrait donner concrètement l’écologisation de la légitime défense et de l’état de nécessité :
Article 122-5, alinéa 2, nouveau, du Code pénal [48] :
« N’est pas pénalement responsable, la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers l’eau, l’air, l’atmosphère, le sol et le sous-sol, la faune et la flore, un animal ou une plante, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'atteinte. »
Article 122-7, nouveau, du Code pénal :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui, un bien, l’eau, l’air, l’atmosphère, le sol et le sous-sol, la faune et la flore, un animal ou une plante, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne, du bien ou de l’environnement, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
Article 122-7-1, nouveau, du Code pénal :
« Lorsque l’atteinte visée à l’article 122-5 du Code pénal ou le danger mentionné à l’article 122-7 du même code, bien qu’incertains en l’état des connaissances scientifiques, pourraient affecter de manière grave et irréversible l’eau, l’air, l’atmosphère, le sol et le sous-sol, la faune ou la flore [49], est également pénalement irresponsable celui qui accomplit un acte de défense ou un acte nécessaire à la sauvegarde de l’environnement dans les conditions posées aux articles susvisés. »
Dernières rénovations pour un nouveau monde ?
[2] N. Klein, Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique, trad. G. Boulanger et N. Calvé, Babel Lux, 2015, p. 433 et s.
[3] Et à son « by any means necessary » prononcé lors d’un de ses discours, en 1964. L’expression est elle-même reprise de la conférence « Pourquoi nous employons la violence » prononcée par le grand Fanon à Accra en 1960 et employée, encore avant, par Sartre dans Les mains sales (1948).
[4] D. Bourg, C. Demay et B. Favre (dir.), Désobéir pour la Terre. Défense de l’état de nécessité, PUF, 2021, passim. ; P.-F. Laslier, La légitimation pénale des actions écologistes : une liberté de la désobéissance civile écologiste ?, Dr. pénal, 2023, Étude à paraître.
[5] « Nous nous engageons à désobéir ». V. à cet égard, D. Porchon et B. Villalba, Jusqu’où assumer la contre-violence en Anthropocène ?, AOC, 22 mai 2023.
[6] A.-C. Ambroise-Rendu, S. Hagimont, Ch.-F. Mathis et A. Vrignon (dir.), Une histoire des luttes pour l’environnement. 18e-20e Trois siècles de débats et de combats, Textuel, 2021.
[7] A. Dejean de la Bâtie, Droit pénal et mobiles militants : de l'indifférence à la déférence, AJ Pénal, 2020, p. 21.
[8] Encore que tout ne tient peut-être qu’à une question d’effort de motivation des juges du fond. V. Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.458, FS-B N° Lexbase : A53059L3. Sur la prédominance, en la matière, de la méthode des juges du fond sur le fond de ce qui est jugé, v. A. Costes, Décrochage des portraits officiels du Président de la République : quelques précisions à propos du contrôle de conventionnalité en droit pénal, obs. sous Cass. crim., 30 novembre 2022, n° 22-80.959, F-D N° Lexbase : A34938XN, Lexbase Pénal, février 2023, n° 57 N° Lexbase : N4391BZN.
[9] P. Roujou de Boubée, L’argument conventionnel de la légitimité : les décrocheurs de portraits sont-ils des « criminels légaux » ?, ce numéro. Adde S. Detraz, Le contrôle de proportionnalité en droit pénal environnemental, à paraître ; P.-F. Laslier, op. cit.
[10] Le seul exemple trouvé – et encore le moyen de défense est-il sous-exploité – est Cass. crim., 7 février 2007, n° 06-80.108, F-D N° Lexbase : A3018D9N.
[11] J. Lagoutte, La légitime défense environnementale : inspirations puisées dans l’œuvre d’Hayao Miyazaki (et d’Isao Takahata), in Miyazaki et le droit. Du rêve à la réalité, PUAM, coll. Inter normes, 2023, à paraître.
[12] Cass. crim., 19 novembre 2002, n° 02-80.788, inédit N° Lexbase : A2434CXG ; Cass. crim., 7 février 2007, préc. ; Cass. crim., 3 mai 2011, n° 10-81.529, FS-D N° Lexbase : A2474HQP ; Cass. crim., 15 juin 2021, n° 20-83.749, F-B N° Lexbase : A00954WG ; Cass. crim., 22 septembre 2021, n° 20-80.489, FS-B N° Lexbase : A134647Y, n° 20-80.895, FS-D N° Lexbase : A442447Y et n° 20-85.434, FS-B N° Lexbase : A134747Z ; Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.911, F-B N° Lexbase : A39239LU.
[13] D. Bourg, C. Demay et B. Favre, op. cit. ; S. Detraz, op. cit. ; P.-F. Laslier, op. cit.
[14] Si l’on excepte quelques décisions hasardeuses de juridictions audacieuses.
[15] D. Bourg, C. Demay et B. Favre, Introduction. La désobéissance civile environnementale en état de nécessité ?, p. 7 et s., et D. Bourg, Des fondements et fonctions de la désobéissance civile, p. 15 et s., in D. Bourg, C. Demay et B. Favre, préc.
[16] M. Bouhoute et M. Diakhaté, Le traitement du contentieux de l’environnement par la justice pénale entre 2015 et 2019, Infostat Justice, 2021, n° 182.
[17] Et il ne s’agit que de l’une des asymétries – des iniquités : – caractérisant la manière dont est traité le militantisme, écologiste en particulier. La violence de la répression policière (S. Foucart, Mégabassines : « La débauche de moyens dépêchés par l’État contre les opposants contraste avec la tranquillité dont jouissent les tenants de l’agro-industrie », Le Monde, 26 mars 2023 [en ligne] ; M. Kokoreff, Raconter Sainte-Soline : mégabassines et violences d’État, AOC, 4 avril 2023 [en ligne]), du discours politique (G. d’Allens, « Écoterrorisme », un mot prétexte contre la lutte écologique, Reporterre, 3 novembre 2022 [en ligne]) mais aussi des pratiques, telles que la cellule Demeter (A. Massiot, «Agribashing» : enquête sur la cellule Demeter, dispositif politique contre une menace fantôme, Libération, 8 septembre 2020 [en ligne] ; Cellule Demeter : enquête sur les dérives de la lutte contre les violences agricoles, France Culture, 30 octobre 2021 [en ligne]) ou le marquage par PMC (F. Buisson, Sainte-Soline ou la politique de la zone, AOC, 24 avril 2023 [en ligne]), voire des politiques publiques n’ayant, a priori, aucun rapport avec la question environnementale, comme celle des contrats d’engagement républicain issus de la loi du 24 août 2021 N° Lexbase : L6128L74 (J. Talpin, Loi séparatisme : la critique associative face au contrat d’engagement républicain, AOC, 17 février 2023 [en ligne]) en sont d’autres. Et, comme le rappelle Maxime Brenaut (in « La qualification des "infractions écologistes" », ce numéro), cela n’est pas une nouveauté…
[18] À cet égard, v. simplement Giec, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Longer Report, 20 mars 2023.
[19] J.-M. Lavieille, H. Delzangles et C. Le Bris, Droit international et européen de l’environnement, Ellipses, 4e, 2018.
[20] Communications des Nations Unies relatives à l'élaboration d'un texte sur la conservation de la biodiversité marine au-delà des zones de juridiction nationale [en ligne]. V. D. Bailly, P.-Y. Cadalen, B. Guilloux et alii, Biodiversité marine, vers un nouveau traité de l’ONU, AOC, 4 avril 2023 [en ligne].
[21] Sans même détailler la jurisprudence de la Cour europénne des droits de l’Homme (v. pour une synthèse, CEDH, Guide sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Environnement, mise à jour 31 août 2022) et les mille et cent règlements et directives de l’Union européenne en la matière, on citera l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne N° Lexbase : L2497IP8 et l’article 37 de sa Charte des droits fondamentaux N° Lexbase : L0230LGM.
[22] Jusqu’à le mener à considérer la protection de l’environnement comme un objectif à valeur constitutionnelle pouvant limiter la liberté d’entreprendre (Cons. const., décision n° 2019-823 QPC, du 31 janvier 2020 N° Lexbase : A85123CA).
[23] V. ainsi les conventions Marpol, relative aux pollutions maritimes, et CITES, sur le commerce des espèces protégées, de 1973. Pour d’autres exemples, v. J. Lagoutte, L’apport du droit pénal international à la réaction aux risques et dommages environnementaux, in L’apport du droit privé à la protection de l’environnement, dir. J. Lagoutte, Mare & Martin, 2022.
[24] Où l’on retrouve spécialement la Directive du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal N° Lexbase : L1148ICI, actuellement en pleine révision. V. J. Lagoutte, L’influence (toute relative) du droit de l’Union européenne sur le droit pénal de l’environnement, in L’influence du droit de l’Union européenne sur le droit pénal spécial, dir. M. Bardet et T. Herran, IFJD, 2023, à paraître.
[25] C. pén., art. 410-1 N° Lexbase : L1980AMB.
[26] L. Fonbaustier, Environnement, Anamosa, coll. Le mot est faible, 2021.
[27] Cass. crim., 3 mai 2011, préc.
[28] Cass. crim., 15 juin 2021, préc.
[29] Cass. crim., 19 novembre 2002, préc. ; Cass. crim., 7 février 2007, préc.
[30] Comme l’a très tôt remarqué le Professeur Jacques-Henri Robert, in Droit pénal général, 3e, PUF, 1998, p. 250, et 258.
[31] V. not. Cass. crim., 8 mars 2011, n° 10-82.078, F-D N° Lexbase : A4085HMA cité à tort (A. Vouland, Portrait de l’état de nécessité en droit français, in D. Bourg, C. Demay et B. Favre, op. cit., p. 207 et s.) comme témoignant d’une approche large de l’état de nécessité en droit français…
[32] Quoi qu’en dise le site du ministère de l’Intérieur… [en ligne]. Précisons que cela est sans incidence sur la responsabilité pénale du propriétaire lui-même au titre de la contravention de mauvais traitement envers un animal (C. pén., art. R. 654-1) ou du délit de défrichement non autorisé (C. for., art. L. 363-1).
[33] Cass. crim., 22 septembre 2021, préc.
[34] Cass. crim., 19 novembre 2002, préc. ; Cass. crim., 7 février 2007, préc. ; Cass. crim., 3 mai 2011, préc. ;
[35] Cass. crim., 29 mars 2023, préc.
[36] Cass. crim., 3 mai 2011, préc. Adde Cass. crim., 15 juin 2021, préc.
[37] S. Detraz, op. cit.
[38] Ainsi de certains délits forestiers (C. for., not. art. L. 163-2 N° Lexbase : L0408MDH, L. 163-5 N° Lexbase : L0410MDK, L. 163-6 N° Lexbase : L0308MDR, L. 163-9 N° Lexbase : L0309MDS) ou des pollutions maritimes commises au-delà de la mer territoriale (C. env., art. L. 218-22 N° Lexbase : L2133IBM).
[39] Supra, n° 9.
[40] Supra, n° 8.
[41] S. Detraz, op. cit. ; P.-F. Laslier, op. cit. ; J.-Ch. Saint-Pau, op. cit.
[42] TLFi, V° « Actuel ».
[43] Ibid.
[44] Ph. Kourilsky et G. Viney, Le principe de précaution, Odile Jacob, 2000.
[45] Not. P.-F. Laslier, op. cit. ; X. Pin, Droit pénal général, Dalloz, 14e, 2023, n° 260 ; J. Pradel, Droit pénal général, 21e, Cujas, 2016, n° 344 ; F. Rousseau, L’imputation dans la responsabilité pénale, Dalloz, NBT, 2009, n° 128.
[46] H. Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparée, Sirey, 1947, n° 397 ; R. Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. 2, Sirey, 3e, 1914 n° 446 ; G. Vidal et J. Magnol, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, Arthur Rousseau, 9e, 1947 n° 203.
[47] Ou, dans le cadre des strictes limites qu’il pose, l’article 122-9 du Code pénal N° Lexbase : L0902MCE.
[48] À glisser entre les deux alinéas existants, l’environnement devant primer au moins la propriété.
[49] Il s’agit des termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485788
[Brèves] Conduite sous stupéfiant : qu’importe le taux, l’usage seul caractérise l’infraction
Réf. : Cass. crim., 21 juin 2023, n° 22-85.530, F-B N° Lexbase : A9823939
Lecture: 4 min
N6032BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
Le 26 Juillet 2023
► L’incrimination de conduite après usage de stupéfiants est constituée dès lors qu’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée. Cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, il est indifférent que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination.
Rappel de la procédure. Le 8 mars 2020, un individu a été contrôlé circulant à 164 km/h et, un sachet portant l’inscription CBD ayant été découvert dans le véhicule, a fait l’objet d’un test de dépistage salivaire qui s’est révélé positif.
Déclaré coupable de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, et excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50km/h, le conducteur a été condamné par le tribunal correctionnel à deux mois d’emprisonnement avec sursis, six mois de suspension du permis de conduire ainsi qu’à 50 euros d’amende.
L’intéressé a relevé appel de cet décision, suivi par le ministère public à titre incident.
En cause d’appel. La cour d’appel a relaxé le prévenu du délit de conduite après usage de stupéfiants au motif que l’expertise toxicologique ne mentionnait pas de taux de THC. En outre, les juges soulignaient qu’aucune investigation n’avait été menée afin de savoir si le CBD consommé par l’intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol, fixée à moins de 0,20% à la date des faits.
Aux termes de ces constatation, la cour d’appel a jugé que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel de l’infraction n’étaient établis avec certitude.
Le procureur général a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que l’article L. 235-1 du Code de la route N° Lexbase : L3215LSU incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants. Selon le pourvoi, la loi ne fait aucune référence à un dosage de stupéfiants à établir lors des analyses biologiques du contrevenant.
Les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants en vigueur au moment des faits étaient décrites dans l’arrêté du 13 décembre 2016 N° Lexbase : L7353LBX. Or, ce texte mentionne un seuil de détection et non un seuil d’incrimination.
Enfin, le pourvoi soutenait que conformément à l’article L. 235-2 du Code de la route N° Lexbase : L7448LPK, l’usage de stupéfiants ne peut être établi qu’au moyen d’analyses sanguine ou salivaire ce qui exclue toute autre vérifications telle que la recherche et le dosage de tétrahydrocannabinol pouvant être contenu dans le CBD retrouvé à l’occasion du contrôle routier du contrevenant et pouvant être celui qu’il déclarait avoir consommé.
Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa de deux textes.
Toute d’abord, l’article L. 235-1 du Code de la route qui incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants peu important que le taux révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l’arrêté qui, en vigueur au moment des faits, fixe les modalités du dépistage, lequel est un seuil de détection et non d’incrimination.
La Haute juridiction vise ensuite l’annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990 N° Lexbase : O8565B8Q modifié, pris pour l’application de l’article L. 5132-7 du Code de la santé publique N° Lexbase : L0695LZR laquelle classe le tétrahydrocannabinol dans les stupéfiants.
Pour la Cour de cassation, peu importe la dose absorbée et le taux détecté, l’infraction est constituée dès lors qu’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant.
L’absence de détermination du taux de THC présent dans le CBD prétendument consommé par le contrevenant était donc sans incidence sur la caractérisation matérielle de l’infraction établie par la simple consommation de stupéfiant. De même, l’autorisation de commercialiser des produits comportant du THC sous un certain seuil est sans conséquence sur le statut de stupéfiant de cette substance.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486032
[Brèves] Fiscalité des management packages : la requalification des gains du dirigeant salarié lors de la levée d’option
Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juin 2023, n° 467546, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70719YK
Lecture: 4 min
N6063BZL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 28 Juin 2023
► Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 5 juin 2023, relatif aux modalités d’imposition du gain résultant d’une levée d’option à la suite d'une opération de rachat avec effet de levier (LBO).
Le contentieux relatif au gain réalisé par un dirigeant salarié lors de la levée d’une option d’achat a fait l’objet d’une jurisprudence abondante. Dans trois arrêts rendus en 2021 (CE Plénière, 13 juillet 2021 n° 428506, n° 435452 et n° 437498, publiés au recueil Lebon N° Lexbase : A79804Y9), le Conseil d’État a notamment rappelé que les gains issus de la cession de bons de souscription d’actions sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu’ils constituent la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant.
| Lire sur ces arrêts :
|
En conséquence, la faculté pour le bénéficiaire de bons de souscription d’actions de disposer de la garantie de pouvoir revendre à la société les bons à un prix fixé en amont, n’est pas de nature à exclure les gains tirés de la cession de l’imposition au titre du complément de salaire.
Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 17 novembre 2021 (CE, 8e ch., 17 novembre 2021, n° 439609 N° Lexbase : A03797CZ), le Conseil d’État a estimé que les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers, institué par l’article 150-0 A du CGI, y compris lorsque ces titres ont été acquis ou souscrits auprès d’une société dont le contribuable était dirigeant ou salarié, ou auprès d’une société du même groupe.
| Lire en ce sens, M.-C. Sgarra, Nouvelle décision du Conseil d’État sur la requalification des gains dans le cadre d’un management package, Lexbase Fiscal, décembre 2021, n° 886 N° Lexbase : N9592BYW. |
Toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit essentiellement être regardé comme acquis, en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 N° Lexbase : L1669IPI et 82 N° Lexbase : L1172ITL du CGI.
Rappel des faits et procédure
- La société Mécatherm a fait l’objet en 2006 d’une opération de rachat avec effet de levier, dite LBO, par le groupe Alpha. À l’issue de l’opération, le capital de la société se partageait entre le groupe Alpha, actionnaire majoritaire et l’équipe de direction.
- Le groupe Alpha a consenti en 2008 une promesse d’achat lui garantissant un prix de rachat minimum, assorti de clauses d’ajustement pour une partie des actions qu’il détenait.
- À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a estimé que les sommes acquittées par le groupe Alpha devaient être considérées comme une rémunération occulte taxable entre les mains du dirigeant, sur le fondement de l’article 111 c) du Code général des impôts.
- À la suite du rejet de sa réclamation portée à l’administration fiscale, le dirigeant a engagé une action devant les juges du fond afin d’obtenir la décharge des sommes auxquelles il était assujetti.
- En première instance et en appel, les juges du fond du tribunal administratif de Strasbourg et les juges d’appel de la cour administrative d’appel de Nancy ont débouté le dirigeant de ses prétentions (CAA Nancy, 13 juillet 2022, n° 20NC03789 N° Lexbase : A91408CI). En conséquence, le requérant a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit. Le Conseil d’État était amené à trancher la question suivante : Les gains obtenus par un dirigeant d’entreprise à raison de ses « management packages » sont-ils imposables au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ?
Solution
Le Conseil d’État casse et annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 13 juillet 2022. Les juges du Conseil d’État rappellent le principe selon lequel le gain réalisé par un dirigeant salarié lors de la levée d’une option d’achat et vente d’actions est imposable au titre de la plus-value de cession mobilière dès lors qu’il ne trouve pas sa source dans les fonctions exercées.
Toutefois, lorsqu’il trouve sa source dans l’exercice par l’intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, un tel gain constitue un avantage en argent, au sens de l’article 85 du CGI, imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
Ainsi, l’administration a commis une erreur de droit en jugeant que le profit réalisé par le salarié dans le cadre de l’exécution de la promesse d’achat constituait la contrepartie à ses fonctions de dirigeants et un complément à sa rémunération.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486063
[Focus] Plus-values professionnelles : l’exclusion des régimes d’exonération en présence d’un mandat de gestion
Lecture: 11 min
N5941BZ3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jérôme Mazeres, Fiscaliste - Diplômé en gestion de patrimoine, Les fourmis du patrimoine
Le 21 Juin 2023
Mots-clés : plus-value professionnelle • actif immobilisé • mandat de gestion • sociétés
1.- Lors de la cession d’un élément d’actif immobilisé, affecté à l’exercice d’une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, il est possible de bénéficier de plusieurs régimes d’exonération de la plus-value professionnelle. Certains régimes peuvent se cumuler entre eux. Ces régimes trouvent à s’appliquent lorsque l’activité opérationnelle est exercée par une entreprise individuelle, ou une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu. Ces régimes ne trouvent pas à s’appliquer en présence d’une entreprise ou d’une société relevant de l’impôt sur les sociétés.
Nous pouvons notamment citer les régimes suivants :
- article 238 quindecies du Code général des impôts N° Lexbase : L8929MCP (exonération en fonction de la valeur des éléments cédés) ;
- article 151 septies A du Code général des impôts N° Lexbase : L0305MGE (exonération en cas de départ à la retraite) ;
- article 151 septies B du Code général des impôts N° Lexbase : L1142IEZ (exonération des plus-values immobilières professionnelles à long terme).
2.- L’article 151 septies du Code général des impôts permet quant à lui de bénéficier d’un régime d’exonération en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. Plusieurs conditions cumulatives doivent être respectées :
- exercice d’une activité artisanale, commerciale, industrielle, agricole ou libérale ;
- à titre professionnel,
- durant à minima 5 ans ;
- le chiffre d’affaires doit être en deçà d’un certain seuil :
- Inférieur à 250 000 euros pour des activités de vente, afin de bénéficier d’une exonération totale de plus-values. Entre 250 000 euros et 350 000 euros de chiffre d’affaires, l’exonération sera partielle ;
- Inférieur à 90 000 euros pour des activités de service, afin de bénéficier d’une exonération totale des plus-values. Entre 90 000 euros et 126 000 euros de chiffres d’affaires, l’exonération sera partielle.
I. L’activité doit être exercée à titre professionnel
3.- Parmi les conditions devant être remplies pour l’application de ce régime, il est nécessaire que l’activité soit exercée à titre professionnel. Les commentaires administratifs [1] précisent pour le cas de l’entreprise individuelle : « L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. En revanche, le volume de l'activité déployée est sans incidence sur son exercice à titre professionnel, sans préjudice, notamment, de la condition tenant à une participation continue à cette activité ».
4.- Les contrats déléguant l’exercice de l’activité opérationnelle de l’entreprise à un tiers sont susceptibles de remettre en cause l’exercice de l’activité à titre professionnel, et notamment l’exigence d’une participation personnelle, directe et continue. À ce titre, les commentaires administratifs précisent [2] : « La notion de participation directe exige du contribuable qu'il s'implique dans la gestion opérationnelle de l'activité. Les contribuables qui se bornent à exercer leurs seules prérogatives d'associés ou de propriétaires de l'entreprise en participant aux conseils de direction ou aux assemblées générales, ou en exerçant un contrôle a posteriori de la gestion, ne peuvent pas être considérés comme participant directement à l'activité de l'entreprise ».
À titre d’exemple, les propriétaires d’un fonds de commerce donnant celui-ci en location-gérance [3] ne peuvent pas bénéficier du régime d’exonération en fonction du chiffre d’affaires.
5.- Lorsque l’activité opérationnelle est exercée par une société, les commentaires administratifs semblent poser une présomption relative à l’exercice à titre professionnel. Ceux-ci précisent [4] : « Les sociétés ou groupements qui exercent une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole de manière continue sont réputés exercer une activité professionnelle ».
Cependant, elle tempère celle-ci en indiquant : « Cela étant, les activités qui ne requièrent pas le déploiement de diligences régulières ou continues ne sont pas éligibles à la présente exonération. Les entités qui se bornent à exercer leurs seules prérogatives d'associés ou de propriétaires d'une entreprise en participant aux conseils de direction ou aux assemblées générales, ou en exerçant un contrôle a posteriori de la gestion, ne peuvent pas être considérés comme participant directement à l'activité de l'entreprise au sens des dispositions de l'article 151 septies du CGI ».
6.- Ainsi, l’activité doit être poursuivie par le contribuable lui-même, ce qui explique que la location-gérance ne permet pas au bailleur de bénéficier du régime prévu à l’article 151 septies du Code général des impôts [5].
Par ailleurs, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser, qu’en cas de cession d’un élément d’actif par une société, la notion d’exercice de l’activité à titre professionnel s’apprécie au niveau de la société de personnes et non au niveau de ces associés [6]. En effet, la société de personnes dispose d’une personnalité distincte de celle de ses membres [7].
II. L’appréciation de la condition relative à l’activité à titre professionnel est appréciée différemment au cas de la location meublée
7.- L’analyse de la condition relative à l’exercice de l’activité à titre professionnel s’apprécie de manière différente pour les activités de location en meublé.
En effet, l’article 155 du Code général des impôts N° Lexbase : L6174LU9 précise pour ce type d’activité, que celle-ci est exercée à titre professionnel, dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont respectées :
- les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 euros ;
- les recettes issues de la location meublée excèdent les autres revenus professionnels du foyer.
Si l’activité est qualifiée de professionnelle, la plus-value portant sur l’immeuble ouvre droit au régime des plus-values professionnelles, et notamment à l’application de l’article 151 septies du Code général des impôts. Si tel n’est pas le cas, c’est le régime des plus-values immobilières privées qui s’applique [8].
III. Les conséquences liées à la mise en place d’un mandat de gestion: le risque de perte du régime de faveur !
8.- La cour administrative d’appel de Lyon vient de rendre un arrêt [9] publié au recueil Lebon, le 20 avril 2023, concernant les risques liés à la mise en place d’un mandat de gestion pour l’application de l’article 151 septies du Code général des impôts.
9.- Dans cette affaire, une EURL était propriétaire de plusieurs lots d’un ensemble immobilier. Ceux-ci étaient affectés à une activité hôtelière. L’EURL ainsi que les autres investisseurs avaient délégué la gestion de l’hôtel à une SNC. En outre, l’EURL était associée d’une société en participation. La gérance de la société en participation avait été confiée à la SNC.
L’EURL a cédé les lots qu’elle détenait, et a fait application de l’article 151 septies du Code général des impôts.
L’administration fiscale a remis en cause l’application du régime d’exonération, considérant que l’EURL n’exerçait pas une activité professionnelle d’exploitant hôtelier.
10.- L’interrogation portait ainsi sur le fait de savoir si le mandat de gestion est susceptible de déqualifier l’exercice à titre professionnel.
Si la doctrine administrative pose une présomption d’exercice d’activité à titre professionnel, lorsque l’activité est exercée par une société, il ne s’agit que d’une présomption simple.
Le fait de déléguer la gestion d’une activité à un tiers est susceptible de déqualifier l’exercice de l’activité à titre professionnel.
La cour administrative d’appel de Lyon s’inscrit ainsi complètement dans cette logique, lorsqu’elle précise : « Pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées, le contribuable doit justifier que le bien dont la cession a dégagé une plus-value a été affecté à l'une des activités professionnelles visées à cet article, que celle-ci a été exercée pendant cinq ans avant la cession et que sa participation à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité a été personnelle, directe et continue.
Si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux doit être présumé y exercer une activité professionnelle, il en va, en revanche, différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'intéressé, qu'il s'agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société. Dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l'activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie ».
11.- Dans cette affaire, la juridiction administrative lyonnaise relève l’existence d’un mandat de gestion. On comprend que c’est la SNC qui gérait l’hôtel.
On rappellera que la participation doit être effective, et qu’elle ne peut pas se cantonner à l’exercice de ses droits d’associés. Il faut aller au-delà.
Cela explique également pourquoi l’attestation du gérant de la société en participation, attestant de la présence du gérant de l’EURL à chaque réunion, et son intervention sur chaque décision n’avait que peu de chance de prospérer.
La jurisprudence [10] considère être en présence d’une activité à titre professionnel lorsque des tâches d’exécution sont réalisées comme par exemple : l’accueil téléphonique de la clientèle, l’accueil des clients, la réception des commandes, la préparation des livraisons…
Au cas présent, il semble que l’associé unique de l’EURL n’ait pas cherché à démontrer l’exercice de tâches spécifiques à la gestion de l’hôtel, comme la gestion des clients ou des fournisseurs par exemple.
On peut cependant penser que si de tels éléments de preuve avaient été apportés, que la solution n’aurait certainement pas été la même.
12.- Cependant, un point peut surprendre quant au raisonnement mis en œuvre par la cour administrative d’appel de Lyon. En effet, celle-ci considère que « c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’EURL, ainsi que son associé » n’exerçaient pas une activité professionnelle » au sens des articles 151 septies et 155, IV du Code général des impôts.
On doit avouer que l’on a un peu de mal à comprendre pourquoi l’associé est visé. Il s’agit ici de la cession de lots d’immeubles détenus par l’EURL.
Ce point surprend dans la mesure où, en cas de cessions des éléments d’actif par l’EURL, il nous semble, conformément à la jurisprudence citée précédemment, que dans la mesure où celle-ci dispose d’une personne morale distincte de ses membres, c’est à son niveau que doit être caractérisé l’exercice à titre professionnel.
Ce type de raisonnement amenant à s’interroger sur la participation de l’associé nous semble plutôt découler de l’article 151 nonies du Code général des impôts N° Lexbase : L9116LKT (voir de l’article 70 du même Code pour les sociétés agricoles).
La position de la CAA de Lyon nous semble être une référence à la position du Conseil d’Etat [11], notamment sur la participation de l’associé d’une société en participation. Cette affaire concernait là encore le secteur hôtelier. La problématique portait sur la déduction des intérêts de l’emprunt contracté par l’associé pour acquérir des parts.
13.- Au final, cet arrêt qui est susceptible de poser certaines questions entraine la perte des régimes d’exonération des contribuables.
Autant dire, qu’il convient de bien mesurer les conséquences liées à la conclusion d’un mandat de gestion, et ceux d’autant plus que la CAA de Lyon a écarté l’application du régime des plus-values immobilières privées.
[1] BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10 n° 90 et suivants, du 9 janvier 2013 N° Lexbase : X6643ALM.
[2] BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10 n° 180 et suivants.
[3] Pour un exemple voir CAA de Paris, 9 novembre 2011, n° 10PA05595 N° Lexbase : A5404H8N.
[4] BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10 n° 230.
[5] CAA de Nantes, 12 décembre 2019, n° 17NT03228 N° Lexbase : A9094Z9P.
[6] TA Toulouse, 19 mars 2019, n° 1705932 et n° 1706034.
[7] CE Contentieux, 11 juillet 2011, n° 317024, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0239HWR.
[8] BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 240 et suivant, du 3 mai 2023 N° Lexbase : X6921ALW.
[9] CAA Lyon, 20 avril 2023, n° 21LY03722 N° Lexbase : A67419SH.
[10] CE 9° et 10° ch.-r., 8 juin 2016, n° 387826 N° Lexbase : A2415RSA.
[11] CE 3° et 8° ssr., 9 juillet 2003, n° 230116 N° Lexbase : A1935C9K.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485941
[Jurisprudence] Dutreil et holding animatrice : remise en cause du dispositif confirmée par la Cour de cassation en cas d’animation insuffisamment préparée avant une donation
Réf. : Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-16.924, F-D N° Lexbase : A34069UP
Lecture: 10 min
N6033BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jérôme Bissardon, Avocat Fiscaliste – FBT AVOCATS SA
Le 27 Juin 2023
Mots-clés : patrimoine • donation • pacte Dutreil • holding animatrice
La Cour de cassation rappelle que l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 B du CGI dans le cadre d'une donation-partage de titres d'une société holding animatrice de son groupe, nécessite que la preuve de l’animation effective soit rapportée au jour de la donation.
I. L’exposé du litige et de la procédure
En l'espèce, une société holding dénommée Natyce, est immatriculée le 10 juin 2011. Une donation-partage est consentie par une associée à son petit-fils, mineur au moment de la donation, aux termes d’un acte en date du 27 juin 2011. La donation a porté sur 498 actions pour une valeur globale de 480 000 euros. Le dispositif prévu à l’article 787 B du CGI N° Lexbase : L8080MHQ est revendiqué sur les titres donnés.
La constitution de cette société holding Natyce était intervenue dans un contexte de réorganisation des activités hôtelières de la société Cybe dont la donatrice était également associée. La société Natyce avait acquis, le 15 juin 2011, une participation majoritaire d’une filiale hôtelière de la société Cybe en vue de son animation. Une convention dénommée « convention d'animation stratégique, de management de gestion et d'animation commerciale » est alors signée le même jour.
Le 26 mars 2014, l’administration fiscale a remis en cause l’application du dispositif Dutreil, au motif que la société holding Natyce n'avait pas la qualité d'animatrice de son groupe, en notifiant à la représentante légale de l’enfant mineur, une proposition de rectification des droits de mutation dus. L’administration fiscale est assignée devant le TGI de Clermont-Ferrand en décharge des rappels d'imposition réclamés, après le rejet d’une réclamation contentieuse. Débouté en première instance, le donataire interjette appel du jugement rendu le 30 avril 2019.
Les juges de la cour d’appel de Riom relèvent que selon l’extrait k bis de la société Natyce, la date de son début d'exploitation a été fixée au 1er juin 2011. Ils relèvent en outre qu’aucun acte n'a été accompli au nom ou par la société Natyce avant la date de conclusion de la convention, mais par la société Cybe. D’ailleurs, les juges soulignent que cette convention « ne fait mention d'aucune situation préexistante qu'elle aurait vocation à régulariser » et que la société Natyce « ne produit aucune comptabilité ni aucun acte matériel qui aurait révélé l'existence de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers qu'elle aurait accomplis au nom de la société en formation », ou « […] justifiant une volonté d'organiser l'animation du groupe ».
La cour conclue que « la concomitance de la transmission et de la constitution de la SAS NATYCE holding animatrice ne permet pas de rapporter la preuve que la société holding exerçait une activité éligible antérieurement à la réalisation de la donation, fait générateur de l'imposition. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'avantage fiscal et que le tribunal a rejeté la demande […] »
Le donataire, devenu majeur, a alors formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la juridiction d'appel (CA Riom, 26 janvier 2021, n° 19/01183, Confirmation N° Lexbase : A60844DP).
Devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, il est fait état de courriers, courriels, mémos internes, devis, contrats, à l’appui de la démonstration selon laquelle la société Natyce avait initié l’animation de ses deux futures filiales hôtelières dès 2010 en réalité « en donnant des directives […], en supervisant les opérations de modernisation des locaux de ces hôtels, en définissant la stratégie commerciale, en contactant des prestataires et fournisseurs et en assurant le suivi des comptes […] », de sorte que cette société était effectivement animatrice au jour de la donation et qu’il ne résulte nullement des dispositions du texte légal, une condition qui tient au respect d’une certaine durée pour caractériser l’animation avant la donation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
II. La motivation de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
| Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle en premier lieu la définition d’une société holding animatrice : « Est assimilée à une telle société la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, cette activité d'animation de son groupe par la société holding s'appréciant au jour du fait générateur de l'imposition. » Cette définition est rappelée régulièrement par la chambre commerciale depuis son arrêt du 14 octobre 2020 (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955, FS-P+B N° Lexbase : A95613XE). |
La Cour rappelle que la condition qui tient à l’activité éligible doit être respectée au jour de la donation ; et que s’agissant des sociétés holding animatrices, « l'animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de l'acte pour permettre l'accumulation des actes et des faits sur la période considérée afin de pouvoir démontrer l'effectivité et la réalité du schéma présenté pour revendiquer l'application du régime de faveur au jour de la donation ».
La Cour constate que la société Natyce n'avait aucune filiale avant le 15 juin 2011 et qu’elle n’est donc devenue une société holding qu'à compter de cette date.
Malgré la conclusion d’une convention d’animation, la Cour précise qu’« aucune preuve n'est rapportée au 27 juin 2011, jour de la donation-partage, d'une animation effective de cette société par la société Natyce ».
III. La portée de cet arrêt
La Cour de cassation rappelle une fois de plus que l’animation stratégique ne s’improvise pas à quelques jours d’une donation.
Cette décision intervient dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie. Rappelons à cet égard l’arrêt de cette même chambre du 15 mars 2023 rendu en matière d’ISF pour l’exonération de l’outil professionnel. Au cas d’espèce, l’animation était documentée par une convention d’animation et des rapports de gestion sans précision sur les orientations stratégiques. Les emails produits pour justifier le rôle effectif d’animation étaient lacunaires et ne concernaient pas toute la période d’appréciation de l’animation (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-10.244, F-D [A71229IM]).
Dans une autre affaire, la Cour de cassation souligne qu’une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut pas être qualifiée de société holding animatrice (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-22.397, FS-P+R N° Lexbase : A01484KP). La portée de l’arrêt du 11 mai 2023 n’est pas très éloignée au sens où avant la prise de participation dans la filiale hôtelière, la société Natyce n’était pas une société holding. Rappelons qu’elle est devenue une société holding le 15 juin 2011, douze jours avant la donation.
D’autres arrêts illustrent la nécessité de caractériser effectivement l’animation au jour de la transmission (notamment : Cass. com., 23 juin 2021 n°19-16.351 F-D N° Lexbase : A40864XM ; Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-31.233, F-D N° Lexbase : A49123K7 ; Cass. com., 24 octobre 2018, nº 17-15.023, F-D N° Lexbase : A5406YI3).
Nous soulignons que les diligences préparatoires ou d’animation réalisées par la société Natyce avant l’acquisition de sa filiale, durant sa période de constitution, ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du caractère animateur, y compris pour les engagements repris par la société lors de son immatriculation.
| Cet arrêt confirme que l’animation par une société holding de son groupe doit être effective sur une durée significative, laquelle ne peut donc aucunement inclure les périodes durant lesquelles elle n’est pas une société « holding », quand bien même elle serait en mesure de justifier de diligences antérieures d’animation. L’animation doit être « préparée suffisamment en amont » avant une donation, comme le rappelle la Cour de cassation. Tel n’est donc pas le cas d’une société holding immatriculée quelques jours avant une donation. Il en sera de même pour celle qui devient une société holding animatrice de son groupe à une date proche de la transmission. |
IV. La grille de lecture de l’animation s’affine au gré des jurisprudences et des évolutions législatives
Nous retiendrons en synthèse à cet égard, que sur une durée suffisamment longue avant la date de la transmission bénéficiant du dispositif Dutreil et durant toute la période d’engagement collectif et individuel de conservation des titres :
- La société holding doit exercer le contrôle de ses filiales animées (ou de sa filiale animée),
- La société holding doit participer à la conduite du groupe, ce qui suppose :
- Une formalisation de l’animation stratégique (exemples : convention d’animation dûment enregistrée, mention de l’animation dans l’objet social de la société holding, mandat social de la société holding au sein des filiales lorsque cela est possible, procès-verbaux d’assemblées et rapports de gestion précisant les orientations stratégiques, conventions d’assistance intragroupe, etc),
- Une effectivité de l’animation nécessitant pour la société holding :
- de disposer du savoir-faire nécessaire pour assister les filiales, du personnel dédié à sa direction stratégique et à la réalisation de prestations de services le cas échéant (phases de conception et d’ajustement du plan de développement stratégique),
- de pouvoir justifier des modalités d’exécution par ces filiales des orientations stratégiques arrêtées, ce qui suppose de communiquer périodiquement aux filiales le plan de développement stratégique défini pour l’animation du groupe (phases de diffusion du plan de développement stratégique),
- de contrôler la bonne exécution du plan. Les filiales animées devront fournir régulièrement à la société holding tout document de nature à justifier de la mise en œuvre du plan stratégique (phases de contrôle du plan de développement stratégique).
En conclusion, revendiquer le caractère animateur d’une société holding dépend largement de la capacité à produire une documentation établissant l'exercice effectif de l’animation sur une période suffisante. L’arrêt du 11 mai 2023 nous incite une fois de plus à préparer l’animation en amont, étape indispensable pour revendiquer sereinement le dispositif Dutreil lors d’une transmission à titre gratuit des titres d’une société holding animatrice.
Dans les situations où il semble difficile de caractériser l’animation compte tenu notamment des contraintes qu’elle peut représenter, il pourrait être envisagé alternativement d’appliquer le dispositif Dutreil directement sur les titres des filiales éligibles. Cela supposerait que la société holding établisse des engagements de conservation sur chacune des filiales éligibles pour l’exonération partielle de droits lors de la transmission des titres de la société holding, toutes conditions devant être réunies par ailleurs. Bien évidemment, l’assiette des droits de mutation à titre gratuit bénéficiant de l’exonération serait rapportée à la seule valeur des titres faisant l’objet des engagements. L’économie fiscale en résultant serait donc moins élevée selon cette hypothèse alternative. Lorsque l’animation est caractérisée, l’exonération s’applique même sur la valeur des actifs patrimoniaux de la société holding, pourvu qu’elle exerce de manière prépondérante l’animation et éventuellement d’autres activités éligibles.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486033
[Brèves] Déclaration d’ISF et respect des droits de la défense du contribuable
Réf. : Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.311, FS-B N° Lexbase : A63879XT
Lecture: 4 min
N5992BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 27 Juin 2023
► Par un arrêt rendu le 1er juin 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation était amenée à apprécier un litige relatif à l’étendue des pouvoirs de l’administration fiscale relatif aux demandes d’éclaircissements ou de justifications en matière d’ISF.
Rappel des faits et procédure :
- un contribuable monégasque est porteur de 99,9 % des parts d’une société civile immobilière française. À cet effet, il souscrit chaque année une déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ;
- à la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a demandé au contribuable la fourniture de justificatifs relatifs au passif déclaré sous l’intitulé « capital non libéré ». Face à l’absence de réponse de celui-ci, elle lui a adressé une proposition de rectification au titre des années 2012 à 2014 ;
- le contribuable a assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des impositions et pénalités contestées. En première instance, les juges du fond ont débouté le contribuable de ses prétentions. Par conséquent, celui-ci a interjeté appel ;
- en appel, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 11 mai 2021, n° 18/16830 N° Lexbase : A47204RA) a débouté le requérant de ses prétentions. Elle a notamment estimé que les dispositions de l’article L. 23 A du LPF N° Lexbase : L9087LKR ne faisaient pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de contrôle prévue par l’article L10, eu égard à son caractère facultatif. Dès lors, elle en déduit une absence de détournement de procédure et d’irrégularité de la procédure d’imposition.
- en conséquence, le contribuable a formé un pourvoi en cassation. Au soutien de ses prétentions, il faisait notamment valoir que la Cour d’appel aurait méconnu l’article L. 10 du LPF N° Lexbase : L3156KWS, L. 23 du même Code et l’article 768 du CGI N° Lexbase : L8137HLX dès lors que le passif déductible de l’assiette de l’ISF pouvait être justifié par tous modes de preuves. Ainsi, il estimait que la preuve pouvait être valablement rapportée par le biais de la production du grand livre de la SCI faisant état d’un capital non libéré.
Question de droit. Était posée à la Chambre commerciale de la Cour de cassation la question suivante : L’erreur consistant pour l'administration à fonder sa demande sur l'article L. 10 du LPF, au lieu de l'article L. 23 A du même Livre, emporte-t-elle décharge des droits mis en recouvrement à la suite d’une rectification de la déclaration d’ISF?
Solution
La Chambre commerciale de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet. Elle rappelle tout d’abord que l’administration a la faculté de demander aux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations qu’ils ont souscrites sur le fondement de l’article L. 10 du LPF.
Toutefois, c'est sur le fondement de l'article L. 23 A du même Livre qu'elle doit, si elle l'estime nécessaire, leur adresser une demande d'éclaircissements et de justifications portant sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine ou sur le caractère insuffisant de la réponse à cette demande.
Or, en l’espèce, si selon l’administration fiscale la preuve de l'existence d'une dette a bien été rapportée par la production de la page du bilan de la SCI correspondante, il restait à l'administration de s'assurer que cette dette n'avait pas déjà été prise en compte dans la valorisation de la SCI, soit en la mettant au passif de la SCI, soit en minorant l’actif.
Les juges de la Haute Cour en déduisent que la production d’un extrait du grand livre général portant la somme litigieuse sous l’intitulé « capital non libéré », ne permettait pas de procéder à un examen global de la situation comptable de la SCI.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485992
[Le point sur...] L’article 750-1 du Code de procédure civile ou le phénix de l’amiable préalable obligatoire – À propos du décret n° 2023-357, du 11 mai 2023
Réf. : Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile N° Lexbase : N5723BZY
Lecture: 26 min
N5723BZY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Corinne Bléry, Professeur de droit privé à l’Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes), Directrice du Master Justice, procès et procédures, Membre du conseil scientifique de Droit & Procédure
Le 31 Juillet 2023
Mots-clés : CPC, art. 750-1 • amiable préalable • saisine du tribunal judiciaire • irrecevabilité • dispense • conciliateur • indisponibilité
Le décret n° 2023-357, du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, rétablit l’article 750-1 du Code de procédure civile, à compter du 1er octobre 2023. Sa rédaction, peu modifiée, tient compte des motifs du Conseil d’État pour annuler la version précédente, le 22 septembre 2022.
1. « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution ».
2. C’est ce que prévoira l’article 750-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6401MHK, à compter du 1er octobre 2023 [1] : tel un phénix, cet oiseau fabuleux qui renaît de ses cendres, l’article, annulé par le Conseil d’État le 22 septembre 2022 [2], est « rétabli » en ces termes par le décret n° 2023-357, du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile N° Lexbase : L6288MHD.
Comme l’ancienne version, la nouvelle impose au justiciable qui veut former une action en justice de tenter de s’accorder avec l’éventuel défendeur sous peine que son action soit déclarée irrecevable, au besoin d’office par le juge. Cette obligation substantielle ne concerne que certaines actions relevant de la compétence du tribunal judiciaire, mais le demandeur en est dispensé dans certains cas, eux aussi prévus au texte.
3. L’obligation substantielle est complétée par une obligation formelle, qui l’a précédée.
Cette obligation formelle issue du décret n° 2015-282, du 11 mars 2015 [3] N° Lexbase : L1333I8U était unique à l’origine ; elle n’est plus que la suite de l’obligation substantielle, depuis le décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3. Depuis le 1er janvier 2020, l’acte introductif d’instance précise les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative (art. 54, 5° N° Lexbase : L8645LYT), lorsque la demande initiale doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Cette mention existait antérieurement, sans être prescrite à peine de nullité ; c’est désormais le cas, mais elle ne concerne plus que les domaines dans lesquels la demande initiale doit être précédée d’une tentative d’accord.
Obligations formelle et substantielle ne doivent pas être mélangées, chacune ayant sa place et son régime, mais au contraire articulées correctement tant par les justiciables que par le juge. Autrement dit, « il y a deux étapes à distinguer : l’une substantielle, l’autre formelle qui n’a de sens que dans le prolongement de la première. Le demandeur doit les respecter sous peine d’encourir deux sanctions distinctes, qui s’appliquent distributivement : l’absence de tentative de MARD est sanctionnée par une FNR, l’absence de mention de l’échec de la tentative ou de la dispense est passible de nullité de forme. Le juge doit tout autant distinguer les deux obligations et la sanction de leur non-respect » [4].
Notons que le 5° de l’article 54 est actuellement vidé de sa substance, mais qu’il retrouvera son sens avec le décret du 11 mai 2023.
4. Le décret du 11 mai 2023 constitue donc une renaissance du phénix « article 750-1 », mort après un premier cycle de vie [5] (I) ; il ouvre un nouveau cycle non dépourvu d’incertitudes (II).
I. Premier cycle de vie du phénix « 750-1 »
5. L’article 750-1 du Code de procédure civile est le décret d’application (B) d’un texte de loi (A). Cette loi, c’est la loi n° 2016-1547, du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle N° Lexbase : L1605LB3 […], dont l’article 4 non codifié impose une tentative de résolution amiable du litige préalablement à certaines actions.
A. Loi
6. Initialement, en 2016, cette obligation concernait la déclaration au greffe, formule procédurale utilisable pour introduire l’instance devant le tribunal d’instance, à côté, notamment de l’assignation (à toutes fins), lorsque le montant de la demande n’excédait pas 4 000 euros [6].
Selon l’article 4 de la loi « JXXI », qui n’appelait pas de décret d’application spécifique, le juge pouvait déclarer d’office irrecevable la déclaration au greffe du tribunal d’instance, non précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ; ceci sauf si le demandeur se trouvait dans un des trois cas de dispense prévus par le même texte : « 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige [7] ; 3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ».
7. Cet article a été modifié, d’abord par la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC (art. 3. II), puis par la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T : ce sont trois modes amiables qui peuvent être choisis pour une tentative d’accord, étant rappelé que parmi eux, seule la conciliation est gratuite, donc choisie plus volontiers que les modalités payantes ; les cas de dispense ont été étendus.
L’article 4 de la loi « JXXI », en son dernier état, dispose ainsi que :
« Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage [loi « Confiance »], la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances [loi « Confiance »] ».
8. Depuis 2019, l’article 4 ajoute encore qu’« un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du Code de la consommation [8] ». Cet alinéa a été rédigé en conséquence de la décision prise par le Conseil constitutionnel en 2019, saisi de la contitutionalité de la loi « Belloubet ». Par sa décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019 N° Lexbase : A5079Y4U, le Conseil a en effet imposé d’expliciter les notions de motif légitime et de délai raisonnable, trop imprécis eu égard à l’accès au juge. C’est là l’origine de l’article 750-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6401MHK – placé dans les dispositions communes du tribunal judiciaire : créé par le décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3, il a ensuite été retouché par le décret n° 2022-245, du 25 février 2022.
B. Décret
9. L’article 750-1, alinéa 1er, consolidé en 2022, reproduisait le principe de l’obligation et sa sanction tels qu’énoncés à l’article 4 de la loi. En outre, il définissait plus précisément le domaine de la tentative préalable obligatoire de règlement amiable, afin d’être conforme aux prescriptions du Conseil constitutionnel : il chiffrait le montant de l’obligation à 5 000 euros et renvoyait aux articles R. 211-3-4 N° Lexbase : L0421LSE et R. 211-3-8 N° Lexbase : L0425LSK du Code de l’organisation judiciaire pour les conflits de voisinage. Si les conflits de voisinage étaient entendus strictement dans un premier temps – les articles du Code de l’organisation judiciaire visés évoquent les actions en bornage, les actions relatives au curage des fossés, les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice de certaines servitudes… qui relèvent de la compétence des chambres de proximité des tribunaux judiciaires, à savoir les tribunaux de proximité, successeurs des tribunaux d’instance –, l’ajout des troubles anormaux de voisinage, par un amendement en commission (CL387) avait étendu en revanche considérablement la notion [9] : l’amendement avait aussi pleinement fait de l’article 750-1 N° Lexbase : L6401MHK une disposition commune au tribunal judiciaire, et non plus spéciale à la procédure orale ordinaire, car les TAV peuvent en effet relever de la procédure écrite ordinaire – héritière de la procédure du tribunal de grande instance.
L’article 750-1, alinéa 2, reprenait aussi les cinq cas de dispense de l’article 4 de la loi « JXXI », consolidé, mais développait le troisième.
10. Or, le 22 septembre 2022 [10], le Conseil d’État a annulé l’article 750-1. Il reprochait l’imprécision du motif légitime justifiant une dispense de préalable amiable obligatoire tenant au délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux de l’affaire pour obtenir un premier rendez-vous avec un conciliateur de justice. L’annulation jouait sans rétroactivité, « sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision », c’est-à-dire sous réserve des instances en cours. Les effets du texte jusqu’au jour de sa décision n’étaient pas remis en cause [11], mais les demandes en cours, qui n’auraient pas été précédées d’une tentative de résolution amiable, ne pouvaient plus être déclarées irrecevables (et les actes introductifs ne mentionnant pas la tentative ne pouvaient plus être annulés pour vice de forme [12]).
11. Le préalable obligatoire a donc disparu pour les demandes introduites depuis le 22 septembre 2022, mais il était certain que la Chancellerie allait réécrire le texte. Alors que celle-ci aurait pu être englobée dans une réforme plus ambitieuse des MARD [13], elle n’est qu’un simple « petit pas » – selon la politique actuelle en matière de procédure civile –, en ce sens qu’elle est à peu près le seul objet du décret n° 2023-357, du 11 mai 2023 N° Lexbase : L6288MHD : ce texte rétablit l’article 750-1 en tenant compte des motifs de l’annulation [14].
II. Nouveau cycle de vie du phénix « 750-1 »
12. L’article 750-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6401MHK est réécrit, il imposera de nouveau de chercher à s’entendre avant de saisir le tribunal judiciaire, dans certains cas, à compter du 1er octobre 2023. Si le phénix qui renaîtra de ses cendres à cette date a fait peau neuve (A), il demeure la même « créature », le même article 750-1, qui avait suscité des questions – qui n’ont pas toutes trouvé une réponse (B).
A. « Peau neuve »
13. La comparaison des deux versions, celle de 2019 consolidée en 2022, et celle de 2023, débouche sur le constat qu’elles sont très proches.
Une nouveauté, assez théorique, provient de l’invocation expresse de la loi « JXXI », en ouverture de l’article 750-1 dans sa version de 2023. S’agit-il d’un « bouclier », afin de rappeler que la loi a été déclarée constitutionnelle [15] et que, tenter de mettre le phénix à mort une nouvelle fois, ne l’empêchera pas de renaître puisque la loi le protège. En réalité, il nous semble que la nouvelle formulation ne fait que montrer davantage la redontance des dispositions de la loi et du décret, redondance qui interroge quant à la répartition entre ces deux normes [16]… même si la codification de la règle a le mérite de la rendre plus accessible ; la mention de la loi « JXXI » attire peut-être aussi davantage l’attention sur le fait que celle-ci est paralysée lorsque son décret d’application est invalidé, ainsi qu’il en est depuis le 22 septembre 2022 et qu’il en sera jusqu’au 1er octobre 2023.
14. La différence pratique résulte dans l’abandon d’un délai imprécis au profit d’un délai chiffré, une nouvelle fois en conséquence de la décision d’annulation du 22 septembre dernier. Le phénix doit quitter un de ses vieux oripeaux pour renaitre : la dispense de tentative préalable de MARD sera justifiée en cas d’« indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur », étant en outre précisé que « le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ».
Il a été relevé [17] que « ce délai est suffisamment long pour permettre aux conciliateurs eux-mêmes contraints par des jours voire des demi-journées de permanence hebdomadaire de s’organiser et de recevoir le plus grand nombre possible de justiciables. Mais il n’est pas trop long, pour ne pas trop retarder l’éventuelle procédure contentieuse en cas d’indisponibilité. Il ne saurait ainsi constituer un obstacle substantiel à l’accès au juge, encore qu’il ne délimite que le temps de la mise en œuvre de la conciliation, pas la durée de celle-ci ». C’est aussi un délai « connu des modes de résolution amiable des différends », puisqu’« il fixe généralement, la durée maximale de la tentative de résolution. Ainsi, la durée maximale de la mission du conciliateur de justice dans une conciliation déléguée est de trois mois, renouvelable une fois pour une même durée (CPC, art. 129-1 N° Lexbase : L1447I84). Il en est de même de la durée du médiateur dans le cadre d’une médiation de justice (CPC, art. 131-3 N° Lexbase : L5934MBE) ».
15. Délai précis, pas trop long et connu ? Il n’est pas certain que cette fixation consiste en un progrès pour le justiciable. Il nous semble au contraire que « c’est assez regrettable car cela laissait une certaine souplesse aux magistrats qui pouvaient tenir compte de la situation des parties et de la nature de l’affaire » [18], sans parler du fait qu’un délai de trois mois avant de pouvoir saisir un juge est, en réalité, très long surtout pour qui se heurte à un adversaire qui « joue la montre » et qui souvent déjà attendu.
Il faudra prouver la saisine du conciliateur et ses suites. Certes, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, mais cela n’est pas forcément simple [19] : faudra-t-il penser à enregistrer un appel téléphonique au conciliateur, par exemple, pour attester qu’il a accepté de s’occuper du cas du justiciable… mais que la première réunion n’est organisée que plus de trois mois après cet appel ? Quid si ledit justiciable ne sait pas enregistrer ou n’y pense pas. Et d’ailleurs quelle validité pour un enregistrement qui serait occulte? Un échange de courriels serait sans doute plus sûr, permettant plus facilement de garder une trace de la « saisine ».
Que « désigne concrètement “l’organisation de la première réunion de conciliation” » [20] ? Une réunion d’information des parties qui ne serait pas suivie d’autres démarches faute de volonté des parties est-elle suffisante ? Il faut l’espérer.
Qu’est-ce que la « saisine » du conciliateur ? Est-ce le moment où il accepte la mission ? Le conciliateur est un bénévole, il n’est pas obligé d’accepter. Il est dès lors envisageable qu’un justiciable se heurte à plusieurs refus.
Plutôt que d’ériger « les suites de la saisine » en événement, c’est « l’absence de suites » qui devrait être prise en compte : l’impossibilité – ou la difficulté (pendant trois longs mois) – d’obtenir une conciliation devrait permettre d’être dispensé de ce préalable obligatoire [21] : il est vrai qu’il faudrait alors prouver l’existence de démarches infructueuses pour approcher un conciliateur.
Il n’est pas sûr que cet aspect de la nouvelle rédaction du « phénix » ne le conduise pas vers une nouvelle mort – une nouvelle annulation – qui pourrait être suivie d’une deuxième renaissance…
16. Le remplacement de l’impératif « doit être précéd[é] » par l’indicatif « est précéd[é] » ne change rien au caractère obligatoire de la tentative de MARD préalable (sauf dispense).
17. Pour le reste, c’est le même phénix qui renait, ce qui est assez surprenant au regard des difficultés suscitées par l’« oiseau », dans son premier cycle de vie… En outre, comme hier [22], l’assignation délivrée doit mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, qui ont été vaines, ou la justification de la dispense ; à défaut, l’acte de procédure serait nul (nullité de forme) pour non-respect de l’article 54, 5° du Code de procédure civile N° Lexbase : L8645LYT.
B. Même « créature »
18. L’article 750-1 N° Lexbase : L5912MBL, ancienne(s) version(s), avait suscité des interrogations, dont certaines avaient donné lieu à des arrêts ; les leçons ainsi données par la jurisprudence sur le texte ancien (voire sur l’article 4 de la loi « JXXI ») ne doivent donc pas être oubliées. Des questions demeurent en suspens…
19. Pas plus que précédemment, l’article 750-1 ne précise comment calculer le « taux de conciliation », qu’il fixe à 5 000 euros. Il a déjà été constaté que l’article 750-1 ne renvoie pas expressément au droit commun de l’évaluation de la demande, prévue au titre de la compétence d’attribution et du taux de ressort (CPC, art. 35 et s. N° Lexbase : L1182H4K), à la différence des articles 761 N° Lexbase : L8600LY8 et 853 N° Lexbase : L5414L8Z, qui prévoient désormais un « taux de procédure » : ce taux permet de savoir si la représentation est obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce, et si la procédure est écrite ou orale devant le tribunal judiciaire [23].
Des cours d’appel ont cependant appliqué les règles des articles 35 et suivants, par exemple en additionnant le demandes connexes [24] ; ce qui est de bon sens. En outre, il n’est pas discuté que les sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM ne doivent pas être prises en compte en raison de leur nature [25] ; pas plus que les dépens, dont ni le montant ni la partie qui en aura la charge ne sont définis lors de la demande, doivent logiquement être exclus du calcul. Il est sans doute permis de voir une confirmation de cette jurisprudence dans la reprise de la rédaction du « phénix ».
20. Par ailleurs, les cas de dispense [26] sont reconduits à l’identique sous la réserve du délai du 3°. Or au-delà de la question du motif légitime réécrit en 2023, le 3° a posé et continue de poser des difficultés.
Rappelons que ce 3° dispose : « Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ».
Des réponses ont été apportées, au moins par analogique, dont on peut aussi penser qu’elles n’ont pas été condamnées à défaut d’avoir été consacrées en 2023.
21. Comment apprécier le motif légitime tenant aux « circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative [de résolution amiable] » ? La généralité de la formule laisse, autant en 2023 qu’auparavant, aux juges du fond une large marge d’appréciation. Il a ainsi pu être jugé que « la situation financière que traverse le requérant depuis le non-paiement des loyers par la société preneuse constitue un motif légitime au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile » [27].
22. Il nous semble aussi que la formule englobe le cas de dispense prévu au 2° en 2016, et qui n’est plus mentionné en l’état ni dans la loi « JXXI » consolidée ni dans l’article 750-1 – ancien et rétabli : dès lors, l’existence de « pourparlers » antérieurs et vains – pas forcément formalisés par une conciliation, une médiation ou une convention de procédure participative – serait bien un tel motif de dispense. Un jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 24 juillet 2020 [28] a pu aller en ce sens : à la suite d’une mise en demeure d’avocat, l’adversaire s’est opposée de façon catégorique aux demandes. Le tribunal judiciaire en déduit que « compte tenu de cette opposition ferme et sans appel, il est manifeste que la résolution amiable du litige était impossible. Dès lors, [le demandeur] justifie d’un motif légitime pour s’exonérer de la tentative de résolution amiable mentionnée à l’article 750-1 du Code de procédure civile » [29].
Mais une cour d’appel a considéré qu’un courrier de l’huissier de justice « ne constitue pas la tentative de règlement amiable prévue par ce texte, d’une part, parce qu’il ne contient aucune allusion aux diverses possibilités de résolution amiable prévues par la loi mais une mise en demeure peu compatible avec une telle démarche, d’autre part, en raison de son ancienneté puisque l’arriéré de charges réclamé par le syndicat de copropriétaires correspond aux appels de fonds postérieurs » [30]. Une autre a estimé que « de manière erronée […], pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les [défendeurs] tirée de l’absence de recours à l’une des tentatives visées à l’article 750-1 susvisé, ce juge a tout d’abord relevé qu’il résultait des pièces communiquées par les [demandeurs] qu’ils avaient, […], accompli des démarches épistolaires en vue de trouver une solution amiable au litige, alors qu’une telle circonstance n’est pas visée par l’article 750-1 comme pouvant justifier une dispense de l’obligation mentionnée au premier alinéa de ce texte » [31]...
En l’absence d’arrêt de la Cour de cassation sous l’empire du régime de 2019, les justiciables, leurs avocats et les juges devront être prudents…
23. Qu’est-ce que l’« urgence manifeste » ? Un cour d’appel avait jugé que les demandes, devant la juridiction des référés, d’expertises et provisionnelles, au visa des articles 834 N° Lexbase : L8604LYC, 835 N° Lexbase : L8607LYG et 145 N° Lexbase : L1497H49, « n’entrent pas dans les cas énoncés à l’article 750-1 » [32].
En revanche, la Cour de cassation a estimé, le 14 février 2022, que celui qui délivre une assignation en référé n’est pas, par principe, dispensé d’avoir cherché un accord avec le défendeur, préalablement [33]. Dès lors, comme pour une action au fond, ce n’est qu’en cas d’échec de la tentative de MARD ou en cas de dispense de MARD préalable, que le juge peut être saisi ; à défaut, la demande serait irrecevable pour non-respect de l’article 750-1. Dans l’affaire en question, le fondement était l’évidence – il s’agissait d’un référé provision dont la seule condition d’ouverture est l’absence de contestation sérieuse ; cependant, la présence du terme « manifeste » dans l’article 750-1 et la généralité de l’attendu de l’arrêt de 2022 exclut une dispense automatique dans tous les cas de référé. C’est sévère, mais pas étonnant…
24. La question de la preuve s’est aussi posée, à propos de l’article 4 ancien de la loi « JXXI » et la Haute juridiction a fourni des indications à propos du 2° qui nous paraissent transposables au 3° de l’article 750-1 – tant dans la première vie du phénix que dans sa nouvelle existence. Il résulte ainsi de deux arrêts du 15 avril et du 1er juillet 2021 [34] que les juges doivent analyser concrètement les éléments apportés par le demandeur, les examiner pour vérifier si le demandeur justifie de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sans s’abriter derrière un formalisme non prévu aux textes… Ainsi, par exemple d’un courrier adressé à l’adversaire en vue d’un accord pour mettre un terme au litige (arrêt du 15 avril) ou d’écritures dans lesquelles le demandeur fait valoir diverses tentatives de résolutions amiables et offre de les prouver (arrêt du 1er juillet).
Même si la Cour de cassation devait ne plus admettre que des pourparlers antérieurs vains soient un motif de dispense [35] – ce qui semblerait contraire à l’esprit du texte –, les indications des deux arrêts quant au rôle des juges eu égard à la preuve continueraient d’être utiles, au moins pour la tentative de conciliation [36].
25. Notons, enfin, que la compétence du juge pour connaître de l’article 750-1 s’est posée qui n’a pas changé avec le rétablissement du texte : il a été jugé, par la cour d’appel de Metz, que « l’irrecevabilité des demandes des appelants fondée sur leur prescription et le non-respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile relatives à la conciliation préalable, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause les dispositions au fond du jugement, de sorte que l’examen de cette fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état »[37].
26. La renaissance du phénix de ses cendres a été saluée par les partisans de l’amiable, qui déploraient la disparition de la fin de non-recevoir de l’article 750-1. De notre côté, nous sommes beaucoup plus dubitatifs, pour ne pas dire critiques… comme pendant le premier cycle de vie de l’oiseau fabuleux : « l’amiable consenti, l’amiable “amiable” (!) est évidemment une bonne chose, l’amiable imposé ne l’est pas du tout, “d’une part, parce qu’on ne fait pas s’entendre des personnes qui ne le souhaitent pas, d’autre part, parce qu’il est source lui-même de contentieux !”… » [38] En outre, il n’est pas certain que notre phénix ne mourra pas à nouveau si sa nouvelle mouture est à nouveau attaquée devant le Conseil d’État.
[1] V. décret n° 2023-357, art. 4 N° Lexbase : Z38404UT. Les articles 2 N° Lexbase : Z38398UT et 3 N° Lexbase : Z38402UT du décret sont des dispositions de coordination ou de correction.
[2] CE, 22 septembre 2022, n° 437002 N° Lexbase : Z352792I ; M. Barba, Gaz. Pal., 15 novembre 2022, p. 15, obs. N. Reichling ; S. Amrani Mekki, JCP G, 2022, act. 1186.
[3] C. Bléry et J.-P. Teboul, Une nouvelle ère pour la procédure civile (suite et sans doute pas fin). – À propos du décret no 2015-282 du 11 mars 2015, Gaz. Pal., 17-18 avril 2015, p. 7, spéc. n° 6 et s. ; C. Bléry, D. actu., 10 mai 2021.
[4] C. Bléry, D. actu., 12 mai 2022.
[5] V. G. Maugain, D. actu., 20 janvier 2020 et D. actu., 23 mai 2023 ; C. Bléry, D. actu., 10 mai 2021, 15 juillet 2021 et 12 mai 2022 ; V. Egéa, JCP G, 2023, act. 596 – adde C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 36e éd., 2022, n° 2241 ; É. Vergès, Étude : La procédure devant le tribunal judiciaire, in Procédure civile, Lexbase, sp. n° 3-1 N° Lexbase : E91567G9.
[6] V. CPC, art. 843 N° Lexbase : L8610LYK, issu du décret n° 2010-1165, du 1er octobre 2010 N° Lexbase : L0992IN3 et abrogé par le décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3.
[7] V. infra, n° 22.
[8] C’est-à-dire aux litiges concernant les crédits à la consommation et aux crédits immobiliers.
[9] F.-X. Berger, D. actu., 3 mars 2022. Cette extension nous semble être « l’aveu flagrant d’un déni de justice assumé », l’auteur de l’amendement ayant estimé, sans suscité d’objection, que « ces contentieux du quotidien, qui empoisonnent la vie de nos concitoyens, peuvent souvent être résolus par la voie de la médiation, sans passer par des procédures longues, lourdes et coûteuses » (v. déjà D. actu., 12 mai 2022).
[10] V. supra, n° 2.
[11] CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 9 mars 2023, n° 22/07041 N° Lexbase : A57989H9.
[12] Par exemple, CA Reims, 1re ch., sect. civ., 15 novembre 2022, n° 22/01225 N° Lexbase : A54598UQ.
[13] Le garde des Sceaux a annoncé une recodification des MARD, une audience de règlement amiable (ARA) devrait être créée dans un article 750-2 du Code de procédure civile et une « césure » du procès civil, au stade de la mise en état devrait aussi voir le jour.
[14] V. la nouvelle version supra, n° 1.
[15] G. Maugain, D. actu., 23 mai 2023.
[16] C. Bléry, D. actu., 12 mai 2022 ; dans le même sens, S. Amrani-Mekki, JCP G, 2022, étude 436, sp. n° 10.
[17] G. Maugain, D. actu., 17 mai 2023.
[18] S. Amrani-Mekki, JCP G, 2022, act. 1186.
[19] Sur les difficultés de preuve déjà induites par l’ancien article 750-1, v. infra.
[20] G. Maugain, D. actu., 23 mai 2023.
[21] G. Maugain, D. actu., 23 mai 2023.
[22] V. supra.
[23] C. Bléry, D. actu., 12 mai 2022 ; v. le sujet du CRFPA 2021 ! – Adde C. Bahurel, N. Kilgus, R. Laher et T. de Ravel d’Esclapon, Épreuves écrites – Spécialité Droit civil, Dalloz, 2022, Spécial CRFPA 2022, sp. p. 370. – Sur les taux de procédure ou de conciliation, notions non inscrites dans les textes, v. C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 36e éd., 2022, n° 1504 et 1505.
[24] CA Toulouse, 1re ch., 15 novembre 2021, n° 21/00102 N° Lexbase : A89297BC. De même, l’article 750-1 n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la demande est indéterminée, par analogie avec l’article 40 N° Lexbase : L1192H4W (CA Fort-de-France, ch. civ., 19 juillet 2022, n° 22/00053 N° Lexbase : A52788E9 ; CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 4 avril 2022, n° 21/01058 N° Lexbase : A15707SX).
[25] Cass. civ. 3, 6 janvier 1981, n° 79-10.651, publié au bulletin N° Lexbase : A8495AH4 ou Cass. civ. 2, 20 novembre 1991, n° 90-15.838, publié au bulletin N° Lexbase : A5369AHC.
[26] Sur ces cas, qui laissent parfois « perplexes », v. nos notes précitées.
[27] TJ Nanterre, 8e, 24 janvier 2022, n° 20/08660 N° Lexbase : A28377SU.
[28] TJ Amiens, 24 juillet 2020, n° 11-20-000327.
[29] D. actu., 12 mai 2022, C. Bléry. Dans le même sens É. Vergès, Panorama 2021 des arrêts de la Cour de cassation en procédure civile (1re partie), Lexbase Droit privé, janvier 2022, n° 891 N° Lexbase : N0103BZT.
[30] CA Rennes, 4e ch., 27 octobre 2022, n° 22/02355 N° Lexbase : A81958RX.
[31] CA Douai, ch. 1, sect. 1, 24 février 2022, n° 21/01821 N° Lexbase : A96597N3.
[32] CA Riom, 17 mars 2021, n° 20/01181 N° Lexbase : A39734LQ.
[33] Cass. civ. 2, 14 avril 2022, n° 20-22.886, F-B N° Lexbase : A44707TQ.
[34] Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 20-14.106, F-P N° Lexbase : A80914PD ; Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-12.303, F-B N° Lexbase : A21064YN. Sur les deux, É. Vergès, Panorama 2021 des arrêts de la Cour de cassation en procédure civile (1re partie), Lexbase Droit privé, janvier 2022, n° 891 N° Lexbase : N0103BZT.
[35] V. supra, n° 22.
[36] V. supra, n° 22.
[37] CA Metz, 3e ch., 23 juin 2022, n° 21/00948 N° Lexbase : A623678H.
[38] D. actu., 12 mai 2022.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485723
[Jurisprudence] Rappel d’une évidence : l’entreprise de manutention maritime peut être responsable sur le fondement du droit commun
Réf. : Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-22.184, F-B N° Lexbase : A49929WS
Lecture: 5 min
N6038BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Gaël Piette, Professeur à l’Université de Bordeaux, CRDEI, Directeur scientifique de l’ouvrage Lexbase Droit des sûretés
Le 28 Juin 2023
Mots-clés : transport maritime • entreprise de manutention • responsabilité extra-contractuelle • titulaire de l’action • prescription
Lorsque la faute de l’entreprise de manutention a causé un dommage, non à la marchandise transportée, mais à des biens appartenant à des tiers, sa responsabilité relève des articles 1240 et suivants du Code civil. L’action n’est donc pas limitée à celui qui a requis les services de l’entreprise de manutention, et la prescription annale ne reçoit pas application.
La société Aswood, spécialisée dans l’affinage de sciure de bois, a confié à un entrepreneur de manutention maritime le déchargement et le transfert d'une cargaison de pellets de bois d'un navire à un local de stockage qu’elle loue dans un hangar portuaire. Durant ces opérations, une quantité excessive de marchandise a été stockée contre un mur séparant ledit local d’un local loué par une autre société. Sous le poids, le mur s’est effondré, occasionnant des dommages à la marchandise stockée dans le local adjacent.
La société Aswood et la société propriétaire du local ont assigné l’entrepreneur de manutention, avant que le locataire du local adjacent endommagé n’assigne ces trois sociétés et leurs assureurs.
En première instance puis en appel [1], la société de manutention a été condamnée à réparer les préjudices subis par la société Aswood, par le propriétaire du local (pour le mur détruit) et par le locataire adjacent (pour sa marchandise endommagée). Le pourvoi examiné par la Cour de cassation dans le présent arrêt contestait la responsabilité de l’entreprise de manutention envers ces deux dernières entreprises. Schématiquement, le requérant estimait que sa responsabilité envers le propriétaire du local et le locataire adjacent ne pouvait être engagée, en raison de l’article L. 5422-20 du Code des transports N° Lexbase : L6832IND. Ce texte en question dispose que « L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers cette personne qui seule peut agir contre lui ». En l’espèce, c’est la société Aswood qui avait requis les services de l’entreprise de manutention. Seule cette société pourrait donc agir contre elle. Un second argument porte sur la prescription de l’action en responsabilité. Celle-ci ayant été engagée plus d’un an après les faits, elle serait irrecevable du fait de l’article L. 5422-25 du Code des transports N° Lexbase : L6827IN8, aux termes duquel les actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites par un délai d’un an.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi, par un raisonnement difficilement contestable.
Le problème juridique posé à la Cour pouvait en réalité pouvait se résumer à la question suivante : sur quel fondement textuel la responsabilité de l’entreprise de manutention pouvait/devait-elle être engagée ?
À cette question, il n’y avait que deux réponses envisageables : soit sur le fondement « maritimiste » des articles L. 5422-19 N° Lexbase : L6833INE et suivants du Code des transports, soit sur le fondement du droit commun, c’est-à-dire des articles 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 et suivants du Code civil. Selon le fondement retenu, le régime de l’action en responsabilité diffère considérablement. Dans la première hypothèse, l’action est réservée à celui qui a requis les services de l’entreprise de manutention, et elle est enfermée dans un délai de prescription d’un an. Dans la seconde hypothèse, l’action est ouverte à toute victime, dans un délai de cinq ans (délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC).
Ainsi présentée, la question pourrait sembler devoir facilement se régler par le recours à l’adage « Specialia generalibus derogant ». Par définition, le droit maritime est spécial par rapport au droit commun. Ses dispositions devraient donc prévaloir.
Ce serait pourtant une erreur. Les articles L. 5422-19 et suivants du Code des transports, lorsqu’ils organisent la responsabilité de l’entreprise de manutention, envisagent les dommages causés à la marchandise manutentionnée. Ces textes ne trouvent donc à s’appliquer que lorsque le fait reproché à l’entreprise de manutention a causé un dommage à la marchandise.
Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. Le propriétaire du local et le locataire adjacent ne se plaignaient pas de dommages causés à la marchandise manutentionnée. Ils n’avaient d’ailleurs pas d’intérêt à le faire, n’étant pas ayants droit à celle-ci. Le propriétaire du local se plaignait des dégâts causés à ce dernier. Le locataire adjacent se plaignait des dommages subis par sa propre marchandise. Il en résulte que les articles L. 5422-19 et suivants ne pouvaient recevoir application. La seule solution était donc de revenir au droit commun. L’action se fondait à juste titre sur l’article 1240 du Code civil. Par conséquent, toute victime, dès lors que son préjudice a un lien de causalité avec le fait du responsable, peut agir en réparation. Et cette action est enfermée dans le délai de prescription quinquennale du droit commun.
La solution est parfaitement logique et mérite l’approbation. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la Cour de cassation fait application du droit commun pour engager la responsabilité d’une entreprise de manutention. En 2018, dans un arrêt fort remarqué, la deuxième chambre civile avait à examiner le cas d’une entreprise qui se plaignait des dommages causés aux véhicules qu'elle stockait sur un quai de déchargement par des poussières provenant du soja en vrac déchargé par la société de manutention sur le quai voisin [2]. Certes, le problème dans cette affaire est principalement celui de savoir si l’on pouvait considérer que l’entreprise de manutention pouvait être qualifiée de gardienne de la poussière de soja (et la Cour de cassation a répondu par l’affirmative). Mais en appliquant l’article 1242 du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7, la Cour reconnaissait déjà qu’un tiers peut engager la responsabilité d’une entreprise de manutention sur le fondement du droit commun.
L’arrêt du 24 mai 2023 constitue ainsi une pierre supplémentaire à la jurisprudence relative à la « pure » responsabilité extra-contractuelle des entreprises de manutention. Les exemples en sont assez rares et cet arrêt mérite donc l’attention.
[1] CA Caen, 29 juin 2021, n° 19/00109 N° Lexbase : A57864XL
[2] Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-23.163, F-D N° Lexbase : A7758X44, DMF, 2019, n° 809, p. 21, obs. Ph. Delebecque.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486038
[Brèves] Liquidation-partage : absence de fixation de la date de jouissance divise = recevabilité de la demande de réévaluation d’une créance ou récompense
Réf. : Cass. civ. 1, 21 juin 2023, n° 21-24.851, FS-B N° Lexbase : A983793Q
Lecture: 5 min
N6079BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 28 Juin 2023
► La décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant, sans fixer la date de jouissance divise, est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette récompense ;
► il en est de même concernant la décision qui se prononce sur une créance d'un époux à l'encontre de l'indivision au titre de dépenses de conservation, sans fixer la date de jouissance divise.
Les solutions ainsi dégagées dans l’arrêt rendu le 21 juin 2023 méritent une attention particulière en ce qu’elles révèlent toute l’importance de la fixation de la date de jouissance divise en matière de liquidation-partage, en mettant en évidence les conséquences de l’absence de fixation de cette date, à savoir la recevabilité des demandes de réévaluation des récompenses ou créances alors fixées.
Dans cette affaire, un jugement du 15 janvier 2003 avait prononcé le divorce des époux, mariés sans contrat préalable. Un jugement définitif en date du 26 août 2011 avait été rendu dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
L’époux avait par la suite engagé une nouvelle procédure concernant les opérations de liquidation-partage, par laquelle il demandait notamment, d’une part la réévaluation d'une récompense fixée à son profit au titre d'un solde de prêt ayant financé des travaux ; d’autre part la réévaluation d'une créance fixée à son profit envers l'indivision post-communautaire.
La cour d’appel de Rennes avait déclaré ces demandes irrecevables, au regard de l’autorité de la chose jugée, au motif que le jugement du 26 août 2011 avait définitivement statué sur la valeur de ces créance et récompense.
L’époux obtient finalement gain de cause devant la Cour suprême, qui censure la décision des juges rennais, au visa des articles 829 N° Lexbase : L9961HNA, et 1351, devenu 1355 N° Lexbase : L1011KZH, du Code civil, combinés d’une part, avec l’article 1469, alinéas 1 et 3, du même code N° Lexbase : L1606AB4 à propos de l’évaluation de la récompense, et d’autre part l’article 815-13, alinéa 1er, à propos de l’évaluation de la créance de l’époux sur l’indivision post-communautaire.
En effet, pour rappel, l’article 829 du Code civil dispose « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. »
Par ailleurs, pour l’évaluation des récompenses entre époux, aux termes de l’article 1469, alinéas 1 et 3 : « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Enfin, selon l’article 1351, devenu 1355, du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
Selon la Haute juridiction, il en résulte que la décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette récompense.
L’arrêt est donc censuré en ce qu’il avait déclaré irrecevable la demande tendant à la réévaluation de la récompense au titre du remboursement d'un emprunt afférent à un immeuble commun, au motif que le jugement du 26 août 2011 avait définitivement statué sur la valeur de cette récompense, alors que, comme le relève la Haute juridiction, le jugement du 26 août 2011 n'avait pas fixé la date de la jouissance divise.
De la même manière, s’agissant de l’évaluation d'une créance envers une indivision (en l’espèce, indivision post-communautaire), la Haute juridiction vise l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1747IEG selon lequel : « Lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
C’est donc pareillement, au visa des articles 829, 815-13, alinéa 1er, et 1351, devenu 1355, du Code civil, que la Haute juridiction censure l’arrêt en ce qu’il avait déclaré irrecevable la demande de l’époux tendant à la réévaluation d'une créance à son profit envers l'indivision post-communautaire au titre du remboursement d'emprunts souscrits pour l'acquisition d'un immeuble commun, au motif que le jugement du 26 août 2011 avait définitivement statué sur la valeur de cette créance, alors que, comme le relève la Cour suprême, le jugement du 26 août 2011 n'avait pas fixé la date de la jouissance divise.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486079
[Brèves] Inaptitude : l’employeur doit vérifier la compatibilité du poste créé pour le reclassement du salarié avec les préconisations du médecin du travail
Réf. : Cass. soc., 21 juin 2023, n° 21-24.279 N° Lexbase : A983393L
Lecture: 3 min
N6058BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 28 Juin 2023
► Lorsque l'employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s'assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l'avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement.
Faits et procédure. Un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail. Son employeur lui propose un nouveau poste, créé pour les besoins du reclassement.
Après avoir refusé la proposition de reclassement, le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. En l'espèce, l'avis d'inaptitude précisait l'interdiction de maintien long du salarié dans une même position et l'employeur avait proposé un poste qui impliquait la conduite d'un véhicule, dans des conditions et un périmètre non précisés.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.
La cour d’appel (CA Rouen, 16 septembre 2021, n° 19/00764 N° Lexbase : A701044E) juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, elle constate que :
- l'employeur a proposé au salarié un poste d'assistant administratif créé pour lui ;
- que ce poste impliquait la conduite d'un véhicule dans des conditions et un périmètre non précisés ;
- que le médecin du travail, sans exclure les déplacements, avait exclu un maintien long dans une même position ;
- et que le salarié, qui a refusé le poste, avait évoqué l'incompatibilité du poste avec son état de santé.
La cour d’appel relève ensuite que l'employeur n'a pas pris en compte le motif du refus du salarié et ne s'est pas assuré auprès du médecin du travail de la compatibilité de ce poste avec l'état de santé du salarié ou des possibilités d'aménagements qui auraient pu lui être apportées.
Les juges du fond en ont déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale.
L’employeur forme un pourvoi en cassation. Il relève notamment que l'obligation légale de reclassement n'implique pas l'obligation d'envisager la création d'un nouveau poste conforme aux prescriptions du médecin du travail. Ainsi, lorsque l'employeur décide, au-delà de son obligation légale de reclassement, de proposer un poste qu'il envisage de créer pour le salarié déclaré inapte, le fait qu'il n'ait pas soumis ce poste à l'appréciation du médecin du travail est, selon lui, sans incidence sur le bien-fondé du licenciement.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation donne raison à la cour d’appel.
L’employeur aurait dû prendre le soin de s’assurer auprès du médecin du travail de la compatibilité du poste qu’il proposait avec l’état de santé du salarié, ou des possibilités d’aménagements qui auraient pu lui être apportées.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, Le refus légitime de l'emploi proposé par le salarié devenu inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3127ETY. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486058
[Brèves] Disproportion du cautionnement : le dirigeant cédant de droits sociaux est-il un créancier professionnel ?
Réf. : Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-24.691, F-B N° Lexbase : A982593B
Lecture: 4 min
N6094BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 29 Juin 2023
► La cession par un associé des droits qu'il détient dans le capital d'une société ou le remboursement des avances qu'il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée.
Faits et procédure. Un actionnaire a cédé les actions qu'il détenait dans le capital d’une société. Le prix de cession était payable à hauteur de 300 000 euros dans les trois jours ouvrés à compter de la date de la cession, puis en 24 mensualités de 50 000 euros, à compter du 1er avril 2015.
Par le même acte, le dirigeant de la société cessionnaire s'est rendu caution solidaire en garantie du paiement du prix de cession.
Alléguant l'existence d'un dol, la société cessionnaire et le dirigeant caution ont assigné le cédant aux fins de le voir condamner à leur payer des dommages et intérêts. Ce dernier a demandé reconventionnellement la condamnation de la caution à lui payer, en sa qualité de caution, le solde du prix de cession des actions.
Arrêt d’appel. La cour d’appel de Bourges a rejeté la demande de l’associé cédant (CA Bourges, 5 août 2021, n° 17/01652 N° Lexbase : A64174ZP).
Pour ce faire, elle a considéré que les dispositions de l'ancien article L. 341-4 du Code de la consommation N° Lexbase : L8753A7C étaient applicables au cautionnement litigieux. Selon la cour, le cédant, bénéficiaire du cautionnement, était associé et dirigeant de la société. Ainsi, en cédant les parts sociales de sa société en consentant un crédit-vendeur garanti par le cautionnement, il doit être considéré comme un créancier professionnel. Ce dernier a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte l’article L. 341-4 du Code de la consommation que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale (v. déjà, Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-15.910, FS-P+B+I N° Lexbase : A7351EI4).
Or, selon elle, la cession par un associé des droits qu'il détient dans le capital d'une société ou le remboursement des avances qu'il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée.
La Cour en conclut qu’en statuant comme elle l'a fait, alors que la créance du cédant n'était pas née dans l'exercice de sa profession ni ne se trouvait en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même accessoire, de sorte que les règles du Code de la consommation relatives à la disproportion manifeste ne lui étaient pas applicables, la cour d'appel a violé l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
Observations. L’ordonnance de réforme du droit des sûretés (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D) a inséré dans le Code civil, à l’article 2300 N° Lexbase : L0174L8X, l’exigence de proportionnalité qui prévoit toujours son application aux seuls créanciers professionnels. Ainsi, la précision donnée par l’arrêt du 21 juin 2023 est-elle transposable aux cautionnements conclus après le 1er janvier 2022.
On rappellera à toutes fins utiles que la sanction du cautionnement disproportionné a néanmoins été modifiée : il s’agit désormais de la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager. Le pouvoir d’appréciation du juge est en quelque sorte doublé. Sous l’ancien texte, il devait déterminer si le cautionnement était ou non manifestement disproportionné. Désormais, il doit en plus déterminer ce qu’est un cautionnement qui n’est pas manifestement disproportionné, avec le risque de contestations que cela engendrera à coup sûr.
| Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486094
[Brèves] Conditions de levée de la suspension de l’exécution d’un permis de construire régularisé par un permis modificatif
Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 16 juin 2023, n° 470160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A203993W
Lecture: 2 min
N6022BZ3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 28 Juin 2023
► Peut être levée la suspension de l’exécution d’un permis de construire régularisé par un permis modificatif après prise en compte de la portée de ce dernier et si celui-ci n’est pas, lui-même, entaché de vices allégués ou d'ordre public.
Principe. Le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
S’il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code N° Lexbase : L3060ALW, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il lui appartient, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés.
Il doit aussi tenir compte des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
Décision CE. En estimant qu'il ne lui appartenait pas de tenir compte des moyens soulevés devant lui tirés de ce que le permis de construire modificatif, délivré le 31 octobre 2022 afin de purger les trois vices ayant conduit à la suspension de l'exécution du permis de construire du 15 juin 2021, avait été pris par une autorité incompétente, sur la base d'un dossier incomplet et d'un avis irrégulier de l'architecte des bâtiments de France, le juge des référés (TA Grenoble, 19 décembre 2022, n° 2207367 N° Lexbase : A634483D) a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486022
[Le point sur...] La saisie des rémunérations : relooking extrême
Réf. : Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, déposé au Sénat le 3 mai 2023
Lecture: 10 min
N6057BZD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Xavier Louise-Alexandrine, Commissaire de justice associé (Calippe & Associés)
Le 30 Juin 2023
Mots-clés : saisie des rémunérations • commissaire de justice
La saisie des rémunérations est actuellement au cœur de l’actualité des praticiens de l’exécution. Le projet actuellement en discussion témoigne d’avancées majeures, mais n’est pas exempt de reproches, invitant à explorer quelques pistes d’amélioration.
Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 du 3 mai 2023, dans son article 17, a pour ambition de faire mentir le vieil adage « C’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleurs soupes ».
Cette proposition de réforme est guidée par le souhait d’améliorer la procédure de saisie des rémunérations en augmentant son efficience en la recentrant dans les mains des commissaires de justice (ex huissiers de justice) pour, in fine, soulager les magistrats et leurs greffes. C’est ainsi qu’il serait tentant d’utiliser le mot « déjudiciarisation » pour expliquer cette réforme, mais ce serait occulter le fait que le juge y tient toujours sa place, non pour autoriser la saisie des rémunérations, mais pour en trancher les contestations uniquement. La saisie des rémunérations telle que projetée est donc bel et bien judiciaire puisqu’elle doit être fondée sur un titre exécutoire et validée par le juge en cas de contestation. Ce n’est que sa mise en branle qui ne nécessite plus l’aval du magistrat, et la réserve de temps qui pouvait aller de pair.
Si le comité national des barreaux, dans sa résolution du 12 mai dernier, s’est opposé au transfert de la procédure de saisie des rémunérations des greffes des tribunaux vers les seuls commissaires de justice, il n’en demeure pas moins que cette procédure est bien souvent utilisée en dernier recours par les créanciers, qui aujourd’hui se découragent à obtenir leur dû par cette procédure… L’échange commissaire de justice/créancier se résume donc à : « Oui j’ai identifié un employeur »/« Non non retournez-moi le dossier, c’est trop long ».
La question qui se pose est de savoir si l’utilisation d’un nouveau look garantira la nouvelle vie de la saisie des rémunérations.
En cette période de Fashion Week parisienne, le législateur entend redorer la saisie des rémunérations en envisageant un relooking extrême (I) et en instaurant un nouveau « directeur artistique » en la personne du commissaire de justice (II).
I. Un nouveau look
Fashion Week oblige, la nouvelle procédure de saisie des rémunérations naît d’un patron (A) inédit (B).
A. Le « patron » de la nouvelle procédure
Si nous fêtions en début d’année 2023 le dixième anniversaire du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure de saisie des rémunérations n’avait pas été réellement affectée depuis la loi du 9 juillet 1991 N° Lexbase : L9124AGZ. En effet, le transfert de compétence vers le juge de l’exécution n’avait pas à l’époque concerné cette procédure.
Afin d’exposer cette réforme, il faut rappeler quelle est la procédure actuellement suivie, voir l’infographie, Saisie des rémunérations, n° 139, Voies d'exécution N° Lexbase : X9586APQ.
Il s ‘agit donc d’une procédure longue, remplie d’aléas, et qui subit les créanciers concurrents….
La réforme, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2025, prévoit notamment la délivrance d’un commandement de payer au débiteur, préalable à la saisie des rémunérations. Le projet de loi prévoit également que le débiteur disposera d’un délai d’un mois pour contester la mesure. En cas de contestation, le juge de l’exécution sera amené à contrôler la proportionnalité de la mise en œuvre de la procédure ainsi que les frais d’exécution du commissaire de justice, comme c’est le cas aujourd’hui.
Il est à préciser que la possibilité pour le débiteur de contester sera ouverte à tout moment de la procédure mais que celle-ci perdra son effet suspensif à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du commandement préalable.
Dans la volonté de concilier les parties, il sera encore possible pour le débiteur, afin d’éviter une saisie de ses rémunérations, de conclure un accord avec son créancier sur les modalités de paiement, entraînant la signature d’un procès-verbal d’accord. Celui-ci devra intervenir dans les mois suivant la délivrance du commandement et avant la signification du procès-verbal de saisie entre les mains de son employeur.
La signature d’un procès-verbal d’accord suspend la saisie des rémunérations, mais il est néanmoins prévu qu’elle pourra reprendre en cas de non-respect par le débiteur de l’accord ou en cas de signification au premier saisissant d’un acte d’intervention, ce qui à ce jour n’est pas le cas puisque la signature d’un procès-verbal de conciliation empêche la mise en place d’une intervention sans conciliation préalable pour un nouveau créancier.
La procédure de saisie des rémunérations s’opérera par la signification au tiers saisi – employeur d’un procès-verbal de saisie qui devra faire l’objet d’une dénonciation au débiteur.
Les obligations (déclarations des informations, etc..) et les sanctions pesant sur les employeurs demeurent inchangées.
SCHÉMA NOUVELLE PROCÉDURE
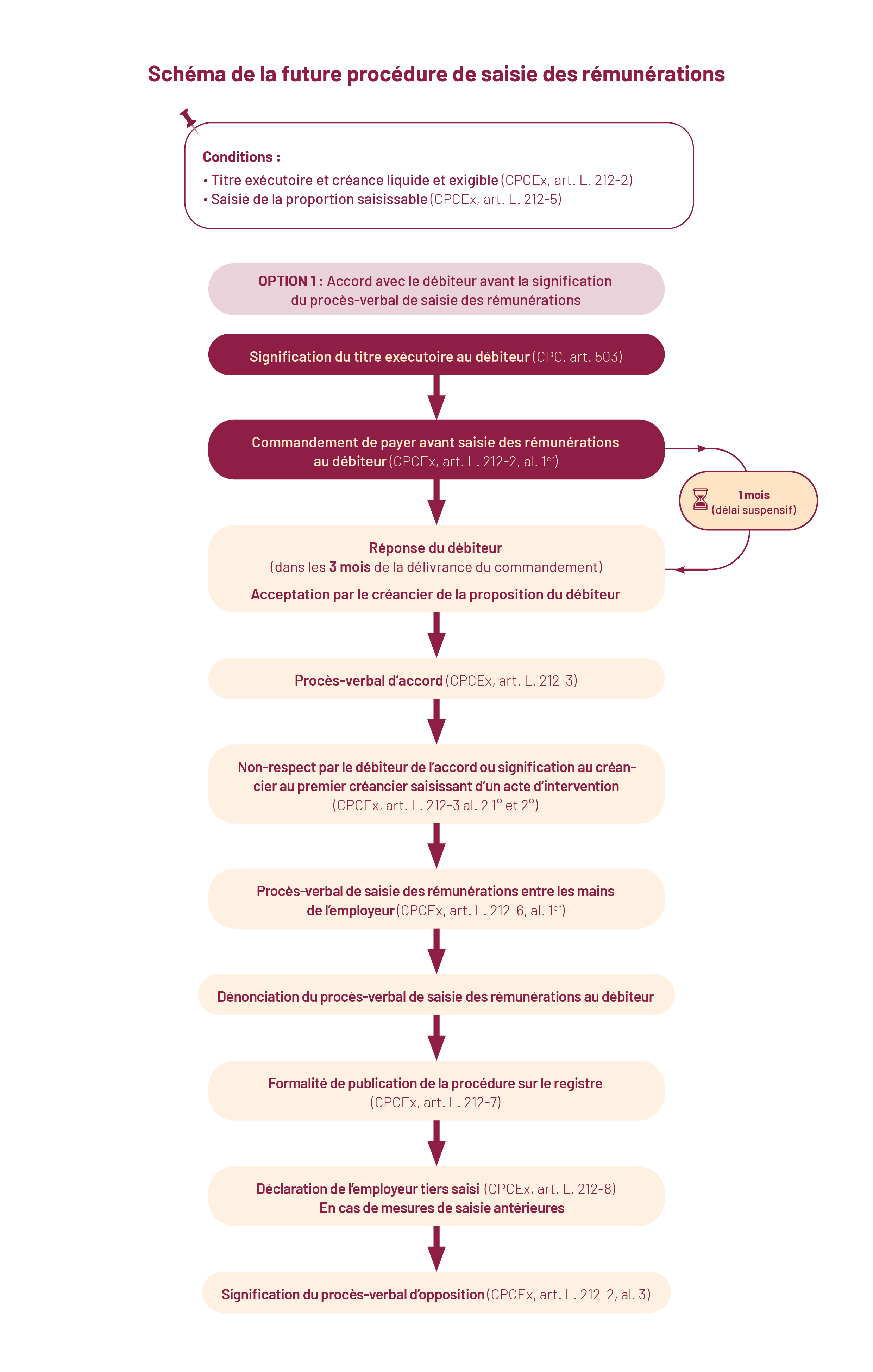
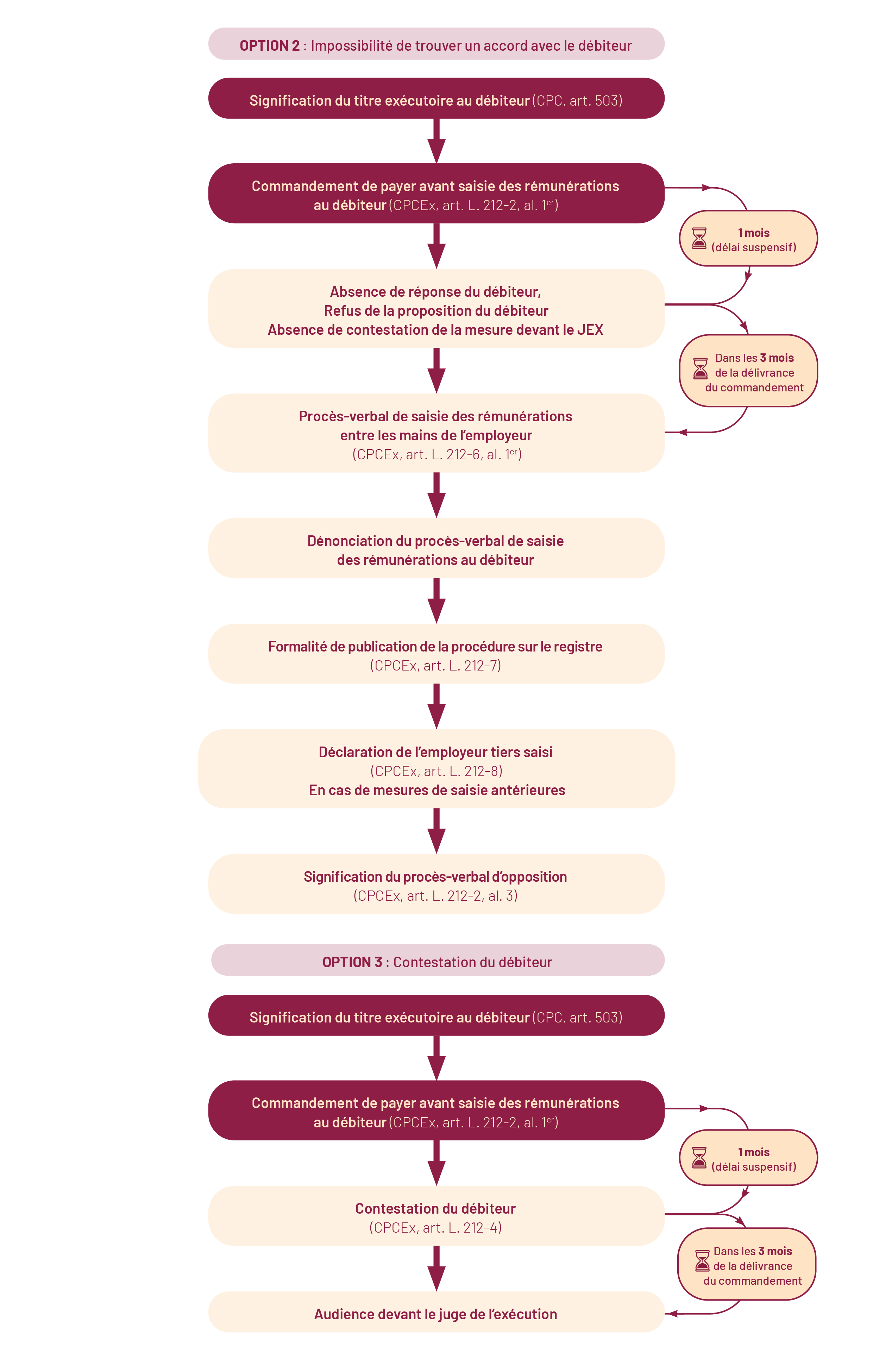
B. Du « neuf » dans le positionnement
Les textes qui lui sont applicables figurent dans de nombreux textes du code du travail (C. trav., art, L. 3252-1 N° Lexbase : L0945H9U et suivants, R. 3252-1 N° Lexbase : L8965H9W et suivants) et trois articles du Code des procédures civiles d’exécution (CPCEx, art, L. 212-1 N° Lexbase : L5842IRS, L. 212-2 N° Lexbase : L0731L79 et L. 212-3 N° Lexbase : L5847IRY) renvoyant eux-mêmes au code du travail : elle n’a jamais trouvé sa place dans le « rayon » des voies d’exécution.
Un des objectifs du projet de loi est, en plus de transférer la gestion aux commissaires de justice et de faire des économies en masse salariale et en frais de notification pour l’Etat, de l’intégrer au « catalogue » des mesures d’exécution par la création des nouveaux articles L. 212-1 à L. 212-16 du Code des procédures civiles d’exécution.
Si l’esprit de la loi de 1991 était de faire évoluer les mesures d’exécution pour les rendre « au gout du jour », la procédure de saisie des rémunérations était restée au fond de l'armoire.
Les principes de subsidiarité et de proportionnalité avaient voulu en faire un « indispensable » aux côtés de la saisie-attribution mais n’a jamais connu le succès escompté, reléguée au rang de procédure, peu couteuse certes, mais lente et inefficace.
La réforme entend la rendre plus rapide en réduisant les délais de mise en place et en faisant une mesure d’exécution premier choix.
Il est à noter l’étrange amendement présenté le 26 mai 2023 par Mesdames Verien et Canayer prévoit néanmoins d’insérer une phrase à l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice N° Lexbase : L4070K8A : « Dès la signification du commandement de payer en vue d’une saisie des rémunérations, le commissaire de justice informe le débiteur qu’il entre dans sa mission de lui permettre de parvenir à un accord avec le créancier, dans le respect de ses obligations déontologiques. »
S’il est possible de percevoir dans cet amendement que la réforme, bien que supprimant l’audience de conciliation, entend conserver l’esprit de la recherche d’un accord entre les parties, il apparaît inopportun. Le mandat du commissaire de justice est d’obtenir le paiement de la créance et il ne dispose de moyens autre que le devoir de conseil pour inviter le créancier à accepter un échéancier. Cet amendement crée une nouvelle obligation du commissaire de justice envers le débiteur, presque contractuelle, alors que même sa responsabilité vis-à-vis du débiteur est statutaire, liée à sa fonction. En matière de saisie-vente, le commissaire de justice transmet l’éventuelle offre d’achat amiable des biens saisis au créancier, sans qu’une telle formule n’apparaisse dans l’acte…
II. Pour une nouvelle vie
Si la réforme est ambitieuse, elle promet une mise en œuvre complexe (A) qui peut laisser place à des espoirs d’amélioration (B).
A. Changement de « propriétaire »
Les missions en matière de saisie des rémunérations, pour les greffiers et les régisseurs, s’articulent autour de la tenue des fiches individuelles spéciales (C. trav., art. R. 3252-9 N° Lexbase : L4752LT8), la gestion comptable (COJ, art. R. 123-20 N° Lexbase : L0409LSX) et les envois de fonds ou répartitions en fonction du nombre de créanciers participant à la procédure de saisie des rémunérations (C. trav., art. R. 3252-9).
Il est prévu que ses tâches soient désormais dans les missions relevant du monopole des commissaires de justice.
Le texte prévoit également la création d’une nouvelle fonction, celle de commissaire de justice répartiteur, qui hérite de la « double casquette » du greffe et la régie. Compte tenu de l’importance de cette mission et la lourde charge qu’elle représente, les commissaires de justice devront certainement suivre une formation spécifique pour ensuite solliciter une inscription sur la liste des commissaires de justice répartiteurs auprès de la Chambre Nationale des commissaires de justice (CNCJ). Il est également prévu la création d’un registre numérique des saisies des rémunérations auprès de la CNCJ, permettant d’y retrouver toutes les données nécessaires concernant les commissaires de justice répartiteurs, les débiteurs saisis, les créanciers saisissants, les employeurs tiers saisis. Une avancée à saluer, d’autant que ce « cloud » de la saisie des rémunérations ne sera sans aucun doute accessible qu’aux commissaires de justice porteur d’un titre exécutoire et ne permettra d’accéder aux informations concernant uniquement le débiteur poursuivi, comme pour les fichiers d’informations accessible par voie numérique aujourd’hui (Ficoba, Siv).
B. La nécessité d’un design plus audacieux
« Plongé dans la tourmente quand les fonds manquent, à force de m’plaindre, j’attends plus l’argent, j’vais l’prendre. » rappait Booba à ses débuts… C’est dans cet état d’esprit qu’aurait pu être rêvée la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Sur le canevas de la saisie-attribution à exécution successive, il aurait été intéressant de permettre au commissaire de justice de saisir directement les rémunérations du débiteur entre les mains de son employeur par la délivrance d’un procès-verbal de saisie-attribution des rémunérations, pourquoi pas par voie électronique.
De plus, si les articles L. 152-1 N° Lexbase : L1721MAY et suivants du Code des procédures civiles d’exécution permettent au commissaire de justice d’interroger les « tiers » pouvant communiquer des renseignements permettant la mise en place d’une procédure de saisie des rémunérations, seul l’accès au fichier des déclarations d’embauche permettrait d’identifier les changements d’employeurs. En effet, de nombreux dossiers sont ralentis faute par les créanciers d’obtenir des informations en temps réel sur la situation du débiteur.
Pour finir, il sera utile de relever que les rémunérations demeurent insaisissables par voie de saisie conservatoire et donner aux commissaires de justice la possibilité de saisir en urgence les rémunérations des débiteurs d’aliments, ce permettrait d’éviter qu’ils aient le temps d’organiser leur insolvabilité.
Un jour peut-être on entendra prononcer au sujet de cette procédure qu’elle est « à la mode ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486057
[Brèves] Mainlevée de mesure conservatoire : quid de la conséquence sur l’effet interruptif de prescription ?
Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-11.987, F-B N° Lexbase : A39579U4
Lecture: 2 min
N5499BZP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 28 Juin 2023
► La décision de mainlevée, prise en application de l'article L. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, n'a pas d'effet rétroactif ; par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription.
Faits et procédure. Dans cette affaire, sur le fondement d’un jugement et de deux arrêts de cour d’appel, une société a fait pratiquer le 11 juin 2018 un nantissement provisoire des parts sociales détenues par M. X dans son capital social dont la mainlevée a été ordonnée par un jugement du 12 novembre 2018, puis confirmé par un arrêt du 20 juin 2019. Par la suite se fondant sur les mêmes titres exécutoires, la société a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente au débiteur. Ce dernier a saisi le juge de l’exécution en contestation.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Paris, 4-8, 19 novembre 2020, n° 19/15654 N° Lexbase : A072437X), d’avoir confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, sauf sur le quantum. Il fait valoir notamment la violation des articles L. 511-1 N° Lexbase : L5913IRG et L. 512-1 N° Lexbase : L5917IRL du Code des procédures civiles d'exécution et 2244 du Code civil N° Lexbase : L4838IRM. Il soutient que la mesure conservatoire ayant fait l’objet d’une mainlevée, elle ne pouvait avoir interrompu le délai de prescription de la créance.
En l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'effet interruptif du nantissement provisoire des parts sociales était resté intact. La décision de mainlevée de cette mesure conservatoire n'a pas d'effet rétroactif, et par conséquent, la mesure conservatoire conserve son effet interruptif de prescription même après sa mainlevée.
Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions des articles 2244 du Code civil et L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485499