[Jurisprudence] Séquestrée à l’insu des malfaiteurs ?
Réf. : Cass. crim., 15 mars 2023, n° 22-87.278, F-B N° Lexbase : A71559IT
Lecture: 17 min
N5366BZR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Benoît Auroy, Maître de conférences à l’Université de Rennes, membre de l’IODE
Le 26 Mai 2023
Mots-clés : séquestration • élément moral • élément matériel • victime inconnue • intention
Crime aujourd’hui puni de vingt ans de réclusion sous sa forme simple par l’article 224-1 du Code pénal N° Lexbase : L6579IXX, la séquestration semble aller naturellement de pair avec une répression sévère, tant l’une et l’autre apparaissent comme un couple inséparable à travers les époques. Sous le droit romain comme sous l’Ancien droit, la « chartre privée » – pour reprendre la dénomination désuète adoptée par l’Ordonnance criminelle de 1670, laquelle imposait aux prévôts des maréchaux de conduire en prison un accusé dès l’instant de sa capture et leur défendait « d’en faire chartre privée dans leurs maisons ni ailleurs » [1] – était érigée au rang des crimes de lèse-majesté [2]. À ce titre, elle était punie de mort sous le premier [3] et était, sous le second, sanctionnée d’une peine arbitraire lorsqu’elle était le fait d’un particulier [4]. Si le crime était puni aussi sévèrement, c’est qu’il « renfermait une usurpation de pouvoir, parce que c’était offenser le prince que d’exercer un acte que lui seul avait le droit d’accomplir, celui de priver les citoyens de leur liberté » [5]. Depuis les Lumières et la Révolution, la séquestration est d’autant plus grave qu’elle est (aussi) une atteinte à cette liberté désormais érigée en bien suprême des individus. Mais sa filiation avec la souveraineté – associée hier à la personne du prince et aujourd’hui à la lettre de la loi en tant qu’expression de la volonté générale – n’a pas disparu. C’est bien pour cela que l’article 224-1 du Code pénal prend soin, comme le faisait déjà l’article 341 de l’ancien code, de préciser que la séquestration n’est punissable que si elle est faite « sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi » [6]. Présente de longue date dans la législation répressive, la séquestration est ainsi un crime emblématique en droit pénal spécial. Mais elle est aussi une illustration commode en droit pénal général, pour constituer, avec le recel, l’archétype des infractions continues – ces infractions que la loi dote d’une consommation susceptible de se prolonger dans le temps « par la réitération constante de la volonté coupable de l’auteur après l’acte initial » [7] et par une matérialité linéaire [8]. C’est dire à quel point cette infraction peut sembler familière. Et pourtant, son incrimination ne se laisse pas aisément saisir. Annoncée en tant qu’ « enlèvement » et « séquestration » par le plan du Code pénal, elle peut en réalité prendre quatre formes différentes : l’arrestation ou la détention, en plus des deux précitées [9]. Leurs frontières elles-mêmes sont difficiles à tracer – en particulier entre détention et séquestration [10] –, tandis que l’adjonction de l’enlèvement peut sembler maladroite pour « englober à la fois l’arrestation et la détention » [11]. Sous la forme de l’arrestation encore, l’infraction est assurément instantanée, alors qu’elle peut s’inscrire dans la durée sous ses autres formes. Sans doute l’incrimination n’a-t-elle pas fini de dévoiler tous ses mystères, ainsi qu’en témoigne une nouvelle fois un arrêt rendu le 15 mars 2023 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une affaire largement relayée par les médias.
En l’espèce, cinq personnes cagoulées s’étaient introduites dans un hôtel parisien et avaient contraint, sous la menace d’une arme, le réceptionniste à les mener jusqu’à la suite où séjournait leur future victime [12]. Deux d’entre elles s’y étaient alors introduites pour y dérober des biens de valeur (bijoux et numéraires), tout en ligotant leur propriétaire. Une fois leur méfait accompli, elles prirent également soin de laisser le réceptionniste à son poste de travail, menotté et les chevilles entravées. Mais – et c’est là toute l’originalité juridique de cette affaire –, les malfaiteurs firent malgré eux une troisième victime : pendant les faits, la styliste de la personne visée s’était secrètement réfugiée dans la salle de bain. Après l’ouverture d’une instruction préparatoire, deux accusés (au moins) furent alors renvoyés devant la cour d’assises des chefs, notamment, de complicité de vol en bande organisée et de complicité de séquestration aggravée commise à l’égard des trois victimes : la propriétaire des biens dérobés – victime « principale » visée par les malfaiteurs – et le réceptionniste – victime « collatérale » en quelque sorte – bien sûr, mais aussi la styliste – victime « inconnue » des malfaiteurs. Ceux-ci contestèrent leur mise en accusation pour séquestration à l’égard de cette dernière, mais la chambre de l’instruction – statuant sur renvoi après cassation pour un motif procédural [13] – confirma les qualifications retenues. Ils formèrent donc un nouveau pourvoi en cassation fondé sur la nature intentionnelle de l’infraction reprochée : comment auraient-ils pu vouloir séquestrer la styliste, alors qu’ils ignoraient tout de sa présence sur les lieux ?
L’argument n’a cependant pas convaincu la Chambre criminelle, laquelle rejette leur pourvoi en l’espèce. Elle commence par rappeler que « l’infraction de détention ou de séquestration ne peut être caractérisée que si l’auteur a agi avec l’intention de porter atteinte à la liberté d’aller et venir d’une personne ». Mais elle ajoute aussitôt que, « lorsque cette intention est établie à l’égard d’une victime, elle peut caractériser l’élément moral de l’infraction à l’égard de toutes les personnes qui ont été, de fait, privées de leur liberté en conséquence des agissements matériels volontaires de l’auteur des faits ».
De prime abord, il est vrai que la solution peut sembler déconcertante, pour permettre de reprocher à un accusé d’avoir commis une séquestration intentionnelle à l’égard d’une victime qu’il ne pouvait avoir voulu séquestrer. Mais la contradiction n’est, en réalité, qu’apparente, de sorte que la solution dégagée par la Cour de cassation paraît convaincante au regard de l’élément moral de l’infraction (§ I). Mais qu’en est-il de l’élément matériel de cette dernière ? C’est probablement là que se situe, en réalité, le point d’achoppement de la qualification à l’égard de la victime inconnue des malfaiteurs, de sorte qu’un doute subsiste quant à la pertinence de la solution adoptée (§ II).
I. Victime inconnue et élément moral de l’infraction, une solution convaincante
Au regard de l’élément moral de l’infraction, la Cour de cassation reconnaît clairement que le fait, pour l’une des victimes, d’être demeurée cachée importe peu. Dès lors que les malfaiteurs avaient bien l’intention de séquestrer une personne au moins, cet élément moral serait satisfait à l’égard de toutes les victimes privées de leur liberté. Partant, il serait donc possible, pour les magistrats, de retenir l’existence d’une séquestration commise à l’encontre de chacune d’entre elles. Certes, l’infraction prévue par l’article 224-1 du Code pénal est assurément de nature intentionnelle. Si le texte n’en dit rien, il s’agit là d’une stricte application de l’article 121-3 du même code N° Lexbase : L2053AMY [14] à l’endroit d’une infraction tantôt criminelle, tantôt délictuelle en cas de libération volontaire avant le septième jour. En quoi consiste alors précisément cette intention requise chez l’agent ? En admettant que les quatre faits incriminés renvoient à des réalités matérielles distinctes, l’élément moral de l’infraction doit naturellement varier en conséquence. Lorsqu’une séquestration est reprochée à l’agent, il faut s’assurer que celui-ci a bien voulu retenir une personne contre son gré, et non pas simplement l’appréhender d’une manière très ponctuelle comme en matière d’arrestation. Néanmoins, ces différents faits que sont l’arrestation, l’enlèvement, la détention et la séquestration consistent tous à priver une personne de sa liberté d’aller et venir. Le troisième alinéa de l’article 224-1 le confirme du reste, en opposant à l’infraction la libération volontaire de la victime, c’est-à-dire le fait de lui rendre sa liberté de mouvement [15]. Parallèlement, l’infraction ne peut être consommée que si son auteur a agi « avec l’intention de porter atteinte à la liberté d’aller et venir d’une personne ». En d’autres termes, cette intention rappelée par la Cour de cassation en l’espèce ne suffit peut-être pas à caractériser l’élément moral de l’infraction sous toutes ses formes, mais elle en est le dénominateur commun. C’est pour cela que la doctrine enseigne notamment que ne saurait être punissable pénalement « celui qui, sortant d’une maison qu’il croit inhabitée, ferme la porte et enferme une personne à son insu » [16].
L’affaire présentait cependant une différence de taille avec cette précédente hypothèse. En l’espèce, si ni les auteurs des faits ni leurs complices [17] ne connaissaient la présence de la styliste réfugiée dans la salle de bain, ils avaient bien l’intention de séquestrer deux autres personnes, à savoir la propriétaire des biens dérobés et le réceptionniste de l’hôtel. Or, la figure n’est pas sans en rappeler une autre bien connue, celle du meurtre et de l’aberratio ictus. Soit un agent qui, voulant ôter la vie à une personne déterminée, en tue une autre parce qu’il s’est trompé sur son identité ou parce qu’il a manqué sa cible. Le meurtre est-il dans ce cas consommé ? Ou faut-il, au contraire, retenir l’existence d’une tentative de meurtre sur la personne visée d’une part, et d’un homicide involontaire sur la victime non voulue d’autre part ? La jurisprudence opte pour la première solution et tient pour radicalement indifférente une telle erreur de fait : dès lors qu’il avait l’intention de tuer, l’agent est coupable de meurtre même si la victime finalement décédée n’est pas celle qu’il visait. Constante [18] et particulièrement ancienne [19], la solution paraît trouver un appui dans la lettre du Code pénal comme dans son esprit [20]. Dans sa lettre, car il semble définir de manière abstraite la victime, sous le terme d’ « autrui » [21]. Dans son esprit également, tant il faut bien reconnaître que la criminalité de l’agent « est la même que s’il eût réussi dans son projet, car il ne peut même offrir comme une excuse l’erreur qui l’a trompé, puisqu’il a fait une victime » [22]. Or, si l’agent commet bien un meurtre lorsqu’il tue une personne qui n’est pas celle qu’il visait, il devient inévitable de retenir sa culpabilité pour cette même infraction, mais commise à l’égard de deux personnes cette fois, lorsqu’il parvient en plus à atteindre sa cible : le fait que l’agent ait atteint son but ne justifierait en rien que le décès de l’autre victime – constitutif du meurtre dans le premier cas – soit finalement ignoré dans le second [23].
Dans une certaine mesure, le raisonnement est transposable à la séquestration. Ici aussi, le visage de la victime qui se dessine à la lecture de l’incrimination paraît abstrait – elle y est évoquée comme « une personne » – et la méprise de l’agent ne diminue en rien sa criminalité dès lors qu’il avait bien l’intention de priver autrui de sa liberté. La cohérence avec la jurisprudence relative au meurtre impose donc de reconnaître la culpabilité de celui qui se trompe sur l’identité de sa victime et en retient finalement une autre. En conséquence, il faut tout autant admettre que, « lorsque cette intention est établie à l’égard d’une victime, elle peut caractériser l’élément moral de l’infraction à l’égard de toutes les personnes qui ont été, de fait, privées de leur liberté ». Au regard de l’élément moral de l’infraction donc, le fait que la styliste se soit réfugiée dans la salle de bain n’empêchait, effectivement, en rien de retenir l’existence d’une infraction commise également à son encontre. Est-ce à dire, pour autant, que la qualification retenue par la mise en accusation soit pleinement satisfaisante ? Probablement pas, tant paraît douteuse la caractérisation de l’élément matériel de l’infraction.
II. Victime inconnue et élément matériel de l’infraction, un doute persistant
À la réflexion, ce n’est peut-être pas tant l’élément moral de l’infraction que la matérialité de celle-ci qui aurait pu constituer un obstacle à la caractérisation de la séquestration envers la styliste. Il ne suffit pas, en effet, de relever que les malfaiteurs avaient bien l’intention de priver une personne de sa liberté. Il faut encore s’assurer que l’élément matériel de l’infraction est caractérisé à l’encontre de chaque victime. Autrement dit, des faits constitutifs d’une séquestration doivent avoir été commis également sur la victime dont les agents et leurs complices ignoraient l’existence [24]. Or était-ce bien le cas en l’espèce ? Certes, le pourvoi s’était focalisé sur la question de l’intention, de sorte que la Cour de cassation ne répond pas directement – et n’était pas tenue de le faire – à cette seconde interrogation. À la lecture de l’arrêt cependant, il est permis de penser que la Haute juridiction n’y a vu aucune difficulté. Plus encore, la formule employée par les magistrats révèle une certaine confusion à l’égard de la matérialité de l’infraction reprochée. Afin de désigner le cas de la styliste, ils visent « toutes les personnes qui ont été, de fait, privées de leur liberté en conséquence des agissements matériels volontaires de l’auteur des faits ». Mais la description ne correspond pas strictement à l’élément matériel de l’infraction et procède sans doute d’un rapprochement excessif – cette fois – avec le meurtre. On sait bien que ce dernier crime repose sur l’incrimination de deux faits constitutifs distincts : un acte positif d’une part, un résultat tenant au décès d’autrui d’autre part. Lorsque l’agent tire sur sa cible et tue une autre personne, la réunion de ces deux composantes envers la seconde victime ne fait aucune difficulté : son décès – résultat pénal caractérisé en sa personne même – a bien été causé par le coup de feu – acte positif exigé.
La structure de la séquestration est cependant différente. L’article 224-1 du Code pénal incrimine « le fait […] d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne ». De cette définition lapidaire, il ressort, tout d’abord, que l’infraction est de commission. Ce sont bien quatre verbes d’action qui sont incriminés, de sorte qu’une simple omission ne peut suffire [25]. Il apparaît, ensuite, que ce crime se compose d’un unique fait constitutif (lequel peut prendre des formes différentes et peut, le cas échéant, durer dans le temps). En particulier, aucun résultat n’est ici formellement exigé par la loi, de sorte que la consommation de l’infraction repose tout entière sur cet acte positif commis par l’agent. Contrairement à ce que semble affirmer la Cour de cassation, il ne suffit donc pas que la privation de liberté apparaisse comme la « conséquence » des agissements de l’auteur. Parce que la séquestration est – dans sa nature même – une atteinte à la liberté, cette dernière doit être inhérente aux agissements de l’auteur [26]. En d’autres termes, l’article 224-1 du Code pénal ne réprime pas tout acte qui cause une privation de liberté, mais seulement certains faits qui constituent autant de formes de privation de liberté. Celle dont a été victime la styliste en se cachant a-t-elle alors été plus qu’une simple « conséquence » des agissements des malfaiteurs ? On peut en douter, dès lors qu’aucun des faits positifs commis par eux n’a directement été exercé à son encontre [27].
Quels étaient, alors, les enjeux entourant cette qualification incertaine ? Manifestement, ceux-ci étaient limités puisque la caractérisation de la séquestration à l’encontre des autres victimes ne faisait guère de doute. En outre, il est vrai qu’il existe une circonstance aggravante tenant au nombre de victimes. L’article 224-3 du Code pénal N° Lexbase : L6577IXU prévoit ainsi, dans son premier alinéa, que « l’infraction prévue par l’article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise à l’égard de plusieurs personnes ». Au risque d’en retenir une application systématique et de lui faire perdre toute cohérence, ce texte ne saurait être étendu à toutes les personnes à qui l’infraction a pu causer un préjudice. Certainement la répression ne doit-elle être aggravée sur le fondement de cette disposition que lorsqu’une pluralité de personnes a effectivement été séquestrée. En l’espèce cependant, l’application de la circonstance aggravante était assurée du fait de la commission de l’infraction à l’égard de la victime « principale » et du réceptionniste. Il reste l’éventuelle question de la recevabilité de l’action civile de la victime « inconnue » des malfaiteurs. Sans doute la constitution de partie civile de la personne qui se cache des malfaiteurs durant les faits est-elle subordonnée à la possibilité de caractériser l’infraction également à son égard [28]. Mais le fond devrait-il dépendre ainsi de la procédure ? En outre, la styliste ne semblait même pas être partie au procès pénal en l’espèce.
Finalement, si la réponse apportée par la Cour de cassation quant à l’élément moral de l’infraction paraît convaincante, on peut regretter que les magistrats ne répondent pas directement à toutes les interrogations soulevées par cette affaire singulière. Sans doute la solution adoptée illustre-t-elle, une fois encore, la conception extensive que doctrine et jurisprudence retiennent parfois de la notion de résultat pénal, au risque de reléguer au second plan le fait coupable de l’agent – acte ou omission – et de remodeler ainsi la consommation de l’infraction [29].
[1] Ord. crim., titre II, art. 10.
[2] Pour le droit romain, v. not. C. th., IX, 11 (de private carceris custodia), 1 : si quis posthac reum private carcere destinarit, reus Majestatis habeatur (in J. Gothofredi, Codex theodosianus, Weidmann, 1738, p. 84). Pour l’Ancien droit, v. not. P.-F. Muyart De Vouglans, Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Merigot, Crapart, Morin, 1780, p. 155.
[3] V. not. C. just., IV, 5, 1 : « il est évident, d’après les constitutions impériales et même le droit ancien, que les particuliers convaincus du crime [relatif aux prisons privées] doivent être condamnés au dernier supplice, comme criminels de lèse-majesté » (P.-A. Tissot (trad.), Les douze livres du Code de l’empereur Justinien, C. Lamort, 1810, tome 4, p. 20).
[4] D. Jousse, Traité de la justice criminelle de France, Debure père, 1771, tome 3, p. 284, n° 3. Relevant de la catégorie des crimes « atroces », elle obéissait aussi à un régime répressif sévère. Commise par un prévôt, la « chartre privée » était punie d’une amende mille livres et d’une privation de charge par l’Ordonnance criminelle de 1670 (titre II, art. 10 et titre X, art. 16).
[5] A. Chauveau et F. Hélie, Théorie du Code pénal, 3e éd., de Cosse, 1852, tome 4, p. 332. V. également P.-F. Muyart de Vouglans, loc. cit. : « nous mettons la chartre privée au nombre des crimes de lèse-majesté ; parce que c’est au Souverain seul qu’il appartient de faire justice à ses sujets, et de punir, par la perte de leur liberté, ceux qui en ont abusé, en se rendant réfractaire à ses Lois ».
[6] D’un point de vue purement théorique, la précision ne s’imposait pas dès lors que le commandement de l’autorité légitime et l’autorisation de la loi constituent des faits justificatifs en application de l’article 122-4 du Code pénal N° Lexbase : L7158ALP (v. cependant E. Dreyer, Droit pénal spécial, LGDJ, 2020, n° 420, p. 251, qui relève que « ce rappel joue essentiellement un rôle sur le terrain de la preuve puisqu’il en renverse la charge : c’est au ministère public d’établir ici que le comportement était injuste et non à la personne poursuivie d’établir qu’il était justifié »).
[7] B. Bouloc, Droit pénal général, 27e éd., Dalloz, 2021, n° 239, p. 237.
[8] Y. Mayaud, Droit pénal général, 7e éd., PUF, 2021, n° 204, p. 252.
[9] Sur la critique de la présentation du Code pénal, v. not. M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, 8e éd., Dalloz, 2018, n° 427, p. 500.
[10] Sur cette question, v. not. É. Garçon, Code pénal annoté, nouvelle édition par M. Rousselet, M. Patin et M. Ancel, Sirey, 1956, tome 2, p. 316, n° 6 : « peut-être définirait-on plus exactement ces expressions en disant que détenir une personne, c’est la garder à vue ; que la séquestrer, c’est l’enfermer dans un lieu quelconque, prison ou maison privée ».
[11] V. Malabat, Droit pénal spécial, 10e éd., Dalloz, 2022, n° 450, p. 286.
[12] La notoriété de la victime leur avait en effet permis de connaître sa résidence au sein de l’hôtel.
[13] Cass. crim., 24 août 2022, n° 22-83.533, F-D N° Lexbase : A55188GH, la Haute juridiction ayant censuré un premier arrêt de mise en accusation au motif que ses mentions ne permettaient pas de s’assurer que les mis en examen et leurs avocats avaient eu la parole en dernier lors de l’audience.
[14] Lequel énonce qu’ « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre », avant de prévoir la possibilité d’exceptions en matière délictuelle « lorsque la loi le prévoit », ce qui n’est pas le cas ici.
[15] S’il en était besoin, le plan du Code pénal le confirme encore, puisque l’article 224-1 se situe dans un chapitre IV dédié aux « atteintes aux libertés de la personne ».
[16] É. Garçon, op. cit., p. 320, n° 39. V. aussi, reprenant le même exemple, E. Dreyer, op. cit., n° 417, p. 250.
[17] Pour cette raison, il n’aurait pas été envisageable de contourner la difficulté par la solution jurisprudentielle qui admet de retenir la culpabilité du complice malgré l’absence d’élément moral chez l’auteur du fait principal punissable (Cass. crim., 8 janvier 2003, n° 01-88.065, F-P+F N° Lexbase : A5987A4I). En pareil cas en effet, il semble nécessaire que le complice ait, lui, eu l’intention de voir le fait principal être commis.
[18] V. not. Cass. crim., 31 janvier 1835 : S. 1835, I, 564 [en ligne] : « peu importe qu’au lieu de donner la mort à celui qu’il voulait pour victime, [l’accusé] ait atteint la femme au lieu du mari ; il n’en reste pas moins constant qu’il a donné la mort avec intention de tuer » ; Cass. crim., 18 février 1922 : S. 1922, I, 329 : « attendu que l’homicide commis avec l’intention de donner la mort est qualifié meurtre par l’art. 295 C. pén. ; que l’intention homicide est caractérisée, dès lors que le coupable a la volonté de donner la mort, et alors même qu’il a tué une personne autre que celle qu’il se proposait d’atteindre » ; Cass. crim., 4 janvier 1978, n° 77-90.947 N° Lexbase : A9646CEY.
[19] Elle semblait déjà admise sous l’Ancien droit (v. D. Jousse, op. cit., p. 508, n° 65).
[20] Mais elle n’est sans doute pas exempte de toute critique sur un plan strictement juridique : pour une approche très critique, v. M.-L. Rassat, op. cit., n° 317, p. 380-381.
[21] C. pén., art. 221-1 N° Lexbase : L2260AMN.
[22] A. Chauveau et F. Hélie, op. cit., p. 420.
[23] Précisons néanmoins que si l’agent ne voulait tuer qu’une personne tout en commettant un seul acte à cette fin, un unique meurtre peut lui être reproché – le cas échéant consommé dans la personne de plusieurs victimes – puisqu’il n’a voulu en commettre qu’un seul, qu’une seule fois.
[24] Par exemple, l’agent ferme à clé une pièce dans laquelle se trouvent la personne qu’il veut séquestrer, mais aussi une autre victime en train de se cacher.
[25] En ce sens, v. not. Cass. crim., 13 novembre 2014, n° 13-84.826, F-D N° Lexbase : A3074M3A.
[26] En d’autres termes, l’article 224-1 du Code pénal ne réprime pas tout acte qui cause une privation de liberté, mais seulement certains faits qui constituent autant de formes d’atteinte à la liberté.
[27] Dans le même sens, v. M. Recotillet, Précisions sur l’élément moral de la séquestration, Dalloz actualité, 5 avril 2023 [en ligne], note ss. Cass. crim.,15 mars 2023 préc. Certes, leur présence elle-même était tout à fait menaçante. Mais suffit-elle pour caractériser un acte privatif de liberté, alors qu’elle n’était nullement destinée à cela ?
[28] En prévoyant qu’elle appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, l’article 2 du Code de procédure pénale semble limiter le cercle des titulaires de l’action civile aux seules personnes qui ont été le siège des faits constitutifs de l’infraction. Et si la jurisprudence n’en retient pas une conception aussi stricte et admet largement la recevabilité des constitutions de partie civile des victimes « par ricochet » – qui subissent un préjudice en raison de celui causé à une autre personne –, c’est lorsque celles-ci sont des proches de la victime première, des membres de sa famille (v. par ex. Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.119, FS-P+B+I N° Lexbase : A40003GA). Tel n’est pas nécessairement le cas de la personne qui se cache des malfaiteurs durant les faits. Sa constitution de partie civile se trouve alors subordonnée à la possibilité de caractériser l’infraction également à son égard. Mais le fond devrait-il dépendre ainsi de la procédure ?
[29] Car plus qu’un résultat ou une simple « conséquence », l’infraction n’est-elle pas d’abord un fait de l’homme ?
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485366
[Questions à...] Le régime d'abrogation des actes non réglementaires appliqué à un décret prononçant la dissolution d'une association - Questions à Stéphanie Renard, Maître de conférences HDR en droit public à l’Université Bretagne Sud
Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 avril 2023, n° 458602, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A23399QP
Lecture: 15 min
N5505BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 25 Mai 2023
Mots clés : actes législatifs • disparition de l'acte • abrogation • abrogation des actes non réglementaires • dissolution
Dans une décision rendue le 20 avril 2023, la Haute juridiction administrative a dit pour droit qu'une demande d’abrogation ultérieure d’un acte produisant tous ses effets directs dès son entrée en vigueur est sans objet. Appliquant ce principe à un décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait, elle en conclut que la demande d’abrogation présentée par l’association, dirigée contre ce décret qui n’avait pas perdu son objet mais qui avait épuisé ses effets, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée. Pour éclairer cette thématique, Lexbase Public a interrogé Stéphanie Renard, Maître de conférences HDR en droit public à l’Université Bretagne Sud – Lab-LEX EA 7480.
Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler le régime des actes non créateurs de droits ?
Stéphanie Renard : Avant d’évoquer le régime de ces actes, il parait nécessaire d’en rappeler la définition car c’est la nature de l'acte qui décide de son régime, notamment des règles de sa sortie de vigueur.
Déjà, un acte non créateur de droits est une décision administrative, par opposition aux actes non décisoires (non normateurs) qui ne modifient pas l’ordonnancement juridique et ont, pour cette raison, été longtemps exclus du champ du recours pour excès de pouvoir. Ensuite, cet acte se caractérise par sa portée concrète et catégorielle, ce qui le distingue des actes réglementaires, et, plus encore, par sa dimension « nominative », ce qui le détache des décisions d’espèce. Pour le dire plus simplement, un acte non créateur de droits correspond à une décision individuelle (tout comme les décisions créatrices de droits). Enfin, et l’on touche ici à l’essentiel, un acte non créateur de droits, s’il peut parfois accorder un avantage à un administré, ne présente pas de caractère attributif, c’est-à-dire qu’il ne crée pas de droits subjectifs dont l’administré pourrait par la suite se prévaloir comme relevant de droits « acquis » [1]. Le pluriel utilisé est important, en ce qu’il permet d’éviter toute confusion entre le caractère décisoire, normateur, de l’acte (décision créant du droit objectif) et son caractère attributif (décision créant des droits, sous-entendu « subjectifs »).
Cette typologie classique des actes administratifs unilatéraux est reprise par le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Parmi les actes administratifs unilatéraux décisoires, celui-ci distingue « les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires » [2] avant de dissocier les décisions individuelles créatrices de droits des décisions non créatrices de droits [3]. Pour autant, le CRPA ne précise pas le contenu de ces différentes catégories. Les décisions non créatrices de droits recouvrent assurément les décisions recognitives et les décisions purement défavorables qui, par définition, n’accordent aucun avantage à leur destinataire [4]. La doctrine y ajoute classiquement les décisions conditionnelles et les décisions obtenues par fraude, non sans soulever un certain nombre de discussions. Le régime de ces dernières, même s’il en fait des actes toujours précaires et révocables, présente en effet certaines particularités qui les rattachent aux actes créateurs de droits, ne serait-ce que parce qu’elles accordent des avantages à leur destinataire [5].
En tout état de cause, le régime des actes non créateurs de droits épouse les impératifs liés à leur nature : leur adoption et leur entrée en vigueur sont subordonnées aux exigences valant pour l’ensemble des décisions individuelles, les décisions défavorables étant de surcroît soumises à des règles de procédure préalable et de motivation particulières destinées à protéger les intérêts des administrés concernés. Leur sortie de vigueur suit quant à elle des règles propres aux décisions non créatrices de droits – les mêmes, ou à peu de chose près, que celles qui dirigent la révocation des actes réglementaires. Sauf cas particuliers, leur anéantissement rétroactif, soit leur retrait que le CRPA a largement aligné sur le retrait des décisions créatrices de droits, est subordonné à une double condition, de fond (l’illégalité de l’acte) et de temps (le respect d’un délai de quatre mois à compter de l’édiction). Leur abrogation, qui ne conduit qu’à leur disparition pour l’avenir, se rapproche du régime défini pour la révocation des actes réglementaires auxquels le CRPA les associe [6]. Comme ces derniers, les décisions individuelles non créatrices de droits sont librement modifiées ou abrogées par l’administration, nul ne pouvant se prévaloir de droits acquis à leur maintien. Cette liberté se transforme en obligation dès lors que l’acte concerné est devenu illégal en raison de circonstances de fait ou de droit postérieures à son édiction [7].
Le Code ne mentionne pas l’obligation d’abroger un acte non réglementaire non créateur de droits entaché d’une illégalité initiale, auparavant admise par la jurisprudence dans le délai de recours contentieux. En revanche, il étend à ces actes l’obligation d’abrogation des règlements sans objet définie par l’article 1er de la loi de simplification du droit du 20 décembre 2007 [8]. Cette dernière disposition vise à toiletter le corpus juridique des actes anachroniques ou obsolètes, devenus inutiles avec le temps.
Lexbase : Comment le juge administratif appréhende-t-il la question de leur éventuelle abrogation ?
Stéphanie Renard : La jurisprudence n’est guère foisonnante ici, le juge administratif étant assez rarement saisi de recours dirigés contre la révocation d’un tel acte ou, à l’inverse, le refus de l’abroger. Comme nous le disions à l’instant, les règles d’abrogation d’un acte non créateur de droits sont alignées sur le régime d’abrogation des actes réglementaires, à ceci près qu’elles n’incluent pas les décisions illégales ab initio dans le champ de l’obligation imposée à l’administration.
Le juge administratif est classiquement guidé par trois principes qu’il s’efforce de concilier de manière équilibrée : en premier lieu, le principe de mutabilité, principe d’adaptation nécessaire du droit aux circonstances ; en deuxième lieu, le principe de légalité, principe directeur de l’État de droit, qui soumet l’administration au respect de la règle de droit ; en troisième lieu, le principe de sécurité juridique exigeant notamment la prévisibilité du droit et une certaine stabilité des situations juridiques constituées. Il rejoint à certains égards le principe de non-rétroactivité des actes administratifs qui, sauf exceptions, interdit à l’administration de décider pour le passé.
Le principe de mutabilité supporte la liberté laissée à l’administration pour modifier ou abroger à tout moment et pour tout motif, même d’opportunité, celles de ses décisions qui n’ont pas directement créé de droits acquis à leur maintien – à la condition bien sûr que l’exercice de cette liberté ne conduise pas à méconnaitre la légalité. Le principe de légalité qui, ne l’oublions pas, permet de contester toute décision illégale au contentieux, détermine le cadre général de l’action administrative : il limite les possibilités d’abrogation de l’acte, qui sont subordonnées au respect des règles en vigueur au moment de la révocation, et fonde l’obligation faite à l’administration d’abroger les décisions non créatrices de droit devenues illégales. Le principe de sécurité juridique associé au principe de non-rétroactivité précise le champ des prérogatives accordées à l’administration pour décider de la sortie de vigueur de l’acte : il oblige l’administration à passer par la voie de l’abrogation une fois consolidée la situation juridique créée par l’acte – soit à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son édiction – et l’enferme dans une compétence liée pour abroger les actes non créateurs de droits devenus illégaux ou sans objet. Cette obligation, on le disait, ne concerne pas les décisions individuelles non créatrices de droits affectées d’une illégalité ab initio, à l’inverse de ce qui est prévu pour les règlements. Cela s’explique très probablement par le fait que l’exception d’illégalité est ici enfermée dans le délai du recours contentieux.
À cela s’ajoute une dernière condition, de bon sens : que la demande d’abrogation, tout comme la contestation contentieuse de son refus, ait un objet. L’acte qu’il s’agit d’abroger doit non seulement exister mais aussi être en vigueur et applicable au moment où se décide son abrogation. Par extension, cette règle « d’utilité » de l’abrogation suppose également que l’acte concerné n’ait pas déjà produit tous ses effets. Il serait aussi inutile que vain d’exiger de l’administration qu’elle abroge un acte dont la prescription a d’ores et déjà été entièrement exécutée et n’est donc plus susceptible d’application. Cela frôlerait même l’absurde au regard de l’article L. 243-2 du CRPA N° Lexbase : L1860KN9. Dès lors que l’acte a été entièrement exécuté et que ses conséquences sont épuisées, son abrogation ne peut avoir aucune utilité. Dans un tel cas, l’administré ayant subi un préjudice du fait de cet acte pourra toutefois arguer de son illégalité devant le juge de la responsabilité, l’idée étant alors de réparer les dommages causés par la prescription illégale, à défaut de pouvoir les prévenir ou les faire cesser. Il s’agit là d’un point important car il souligne nettement la différence de but et de fonction de l’obligation d’abrogation imposée à l’administration (mettre fin à une situation illégale) et de l’annulation contentieuse (rétablir la légalité) [9]. Le juge de l’excès de pouvoir, qui statue au regard des circonstances existant à la date où a été prise la décision, ne s’intéresse pas à l’exécution d’un acte, même non créateur de droits, pour décider de son annulation (on se souvient tous de l’affaire « Benjamin » qui avait conduit à l’annulation d’un arrêté municipal entièrement exécuté [10]). À l’inverse, l’obligation d’abrogation, qui ne vaut que pour l’avenir, n’a pas de caractère « restaurateur ». Elle est d’ailleurs appréciée au regard des circonstances qui prévalent au moment où se pose la question [11].
Cela conduit parfois à dissocier les actes instantanés ou temporaires, ayant une durée d’application limitée, des actes continus dont les effets persistent. Mais sans doute faut-il avoir une approche extrêmement précise et subtile, une décision dite instantanée (l’exclusion temporaire d’un agent public, par exemple, ou le placement en cellule disciplinaire d’un détenu) pouvant produire des effets au-delà de son exécution (une mention au dossier dans les exemples cités précédemment).
Il y a à tout le moins un problème de vocabulaire, la question étant celle des effets dans le temps des décisions administratives.
Lexbase : Comment l'applique-t-il en l'espèce au décret de dissolution d'une association ?
Stéphanie Renard : Le Conseil d’État devait ici apprécier la légalité d’un refus d’abrogation du décret de dissolution du parti dit « Rassemblement Démocratique des Populations Tahitiennes » (RDPT) datant du 5 novembre 1963. L’association requérante s’appuyait sur la réhabilitation de son fondateur, Pouvana’a Tetuaapua dit a Oopa, dont la condamnation pénale avait fait l’objet d’une révision en 2018, à l’initiative du Garde des Sceaux. Cette révision suffisait, selon elle, à démontrer l’illégalité « actuelle » de la dissolution. Dans un premier temps, l’association avait demandé le retrait du décret de dissolution, en se prévalant du bénéfice des règles applicables avant le 1er juin 2016, date d’entrée en vigueur du régime de retrait tel qu’il est défini par le CRPA. Un décret de dissolution étant un acte non réglementaire non créateur de droits et l’acte contesté datant de 1963, il pouvait certainement être retiré à tout moment. Une liberté laissée à l’administration ne peut toutefois équivaloir à une obligation. Et le Conseil d’État avait décidé de rejeter le recours dirigé contre le refus implicite du retrait demandé par l’association, en faisant valoir, qu’en l’absence de fraude, une telle démarche administrative ne pouvait conduire à rouvrir le délai de recours contentieux [12]. L’association s’est alors rabattue sur l’abrogation, non pas tant pour faire revivre le groupement dissout, que pour contribuer à la réhabilitation de Pouvana’a Tetuaapua dit a Oopa.
On l’a dit, dès lors qu’un décret prononçant la dissolution d’une association n’est pas un acte créateur de droits, son abrogation ne peut se heurter au principe de sécurité juridique. L’administration, en l’occurrence le Président de la République, pouvait donc parfaitement le révoquer si elle le souhaitait. Mais, manifestement, le chef de l’État ne le souhaitait pas, et cette demande, comme la première, avait été laissée sans suite, ce dont il fallait tirer une décision implicite de rejet, objet du recours pour excès de pouvoir ici examiné. L’idée de l’association était en effet de contester le refus d’abrogation pour contraindre le Président de la République à abroger le décret de dissolution sur le fondement de l’article L. 243-2 du CRPA.
Le Conseil d’État aurait sans doute pu ici s’intéresser au fond du recours en recherchant l’existence d’une illégalité nouvelle. Il a toutefois préféré s’en tenir à la recevabilité du recours pour préciser le champ et la portée de la compétence liée posée par l’article L 243-2 du CRPA. Après avoir indiqué qu’« il appartient à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu'un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction », il a alors rejeté le recours en considérant que le décret du 5 novembre 1963 avait déjà produit tous ses effets directs et que la demande tendant à son abrogation était sans objet.
Cette référence aux « effets directs » de l’acte est importante pour deux raisons. La première est qu’elle permet d’écarter toute protestation fondée sur l’article 431-15 du Code pénal N° Lexbase : L7591L7B qui réprime « le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous ». Il s’agit là d’un effet « indirect » de l’acte de dissolution qui n’entre donc pas en ligne de compte. La seconde raison est que cette mention permet de préciser l’étendue de la compétence liée de l’administration, désormais expressément contenue par les effets de l’acte non créateur de droits devenu illégal ou sans objet. Si cela semblait aller de soi, cela n’avait pas encore été clairement précisé. Et les choses vont toujours mieux en les disant…
Lexbase : Quel est l'apport majeur de l'arrêt en la matière selon vous ?
Stéphanie Renard : Il est sans doute encore un peu trop tôt pour le dire. On peut toutefois gager que l’appel aux « effets directs » de l’acte sera abondamment commenté dans l’attente d’une confirmation.
En exemptant l’administration de toute obligation d’abrogation d’un acte non créateur de droits, certes entièrement exécuté, mais qui n’en continue pas moins de produire des effets « indirects », le Conseil d’État réduit le champ théorique de la compétence liée définie à l’article L. 243-2 du CRPA. Il reste à savoir s’il s’agit là d’une appréciation d’espèce (la dissolution datait tout de même de 1963) et, dans le cas contraire, comment le juge appréciera et appliquera cette condition.
Certes, la jurisprudence offre des exemples de rejets antérieurs de toute obligation d’abrogation pour défaut d’objet lié à l’épuisement des effets de l’acte, mais la question est ici légèrement différente. À ma connaissance (mais il faudrait sans doute creuser), étaient jusqu’à présent concernés des actes dont l’abrogation était dépourvue d’objet parce que la prescription contenue par l’acte, entièrement exécuté, n’avait plus vocation à être appliquée (ou inappliquée). Ici l’acte de dissolution a été entièrement exécuté (le RDPT n’existe plus depuis soixante ans), son abrogation ne pouvant avoir par elle-même pour effet de faire revivre le groupement. Mais la prescription qu’il contient a toujours vocation à être appliquée puisque c’est elle qui, précisément, détermine l’applicabilité de l’article 413-15 du Code pénal. Le Conseil d’État est d’ailleurs très clair : la dissolution prescrite par le décret contesté est toujours applicable et produit des effets (elle interdit la reconstitution du parti) mais ces effets ne sont pas les effets « directs » de l’acte (ledit parti est bien dissout). Ils sont tout autant, sinon davantage, liés à une autre norme : celle contenue par l’article 413-5 du Code pénal. Cela ouvre le champ des réflexions sur la distinction entre « exécution » et « application », « application » et « applicabilité », « effets directs » et « indirects » que la séparation classique entre les « actes instantanés » et les « actes continus » ne parait pas pouvoir embrasser.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.
[1] V. A. Lebrun, Les décisions créatrices de droits, Dalloz, 2023, 904 p.
[2] CRPA, art. L. 200-1 N° Lexbase : L1813KNH.
[3] CRPA, art. L. 241-1 N° Lexbase : L1852KNW et s.
[4] Exception faite des situations dans lesquelles une telle mesure prémunit son destinataire d’une autre mesure encore plus défavorable : CE, 27 janvier 1971, n° 80827, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0758ARI.
[5] V. S. Renard, L’acte administratif obtenu par fraude. Acte créateur de droits précaires, AJDA, 2014, n° 14, p. 782-789 et, surtout, A. Lebrun, op. cit.
[6] CRPA, art. L. 241-1 et s..
[7] CE, Sect., 30 novembre 1990, n° 103889, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5713AQN.
[8] Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, relative à la simplification du droit N° Lexbase : L5483H3H, JO, 21 décembre 2007 ; CRPA, art. L. 243-2.
[9] En ce sens, v. également CE, Sect., 19 novembre 2021, n° 437141, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A48067CY.
[10] CE, 19 mai 1933, n°s 17413 et 17520, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3106B8K.
[11] V. CE, ass., 19 juillet 2019, n°s 424216 et 424217 N° Lexbase : A7275ZKN (pour les actes réglementaires) ou CE, ass., 12 juin 2020, n°s 422327 et 431026 N° Lexbase : A43403N3.
[12] CE, 27 mai 2021, n° 439927 N° Lexbase : A16454T4.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485505
[Jurisprudence] Crédit à la consommation : le juge de l’exécution doit relever d’office les clauses abusives
Réf. : CJUE, 4 mai 2023, aff. C-200/21, TU c/ BRD Groupe Société Générale SA N° Lexbase : A70519SX
Lecture: 13 min
N5457BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Ghislain Poissonnier, Magistrat
Le 28 Juillet 2023
Mots-clés : crédit à la consommation • CJUE • clauses abusives • Directive n° 93/13 du 5 avril 1993 • office du juge de l’exécution • bref délai pour la saisine du juge • limitation des pouvoirs du juge
Dans un arrêt du 4 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a une nouvelle fois conforté l’office du juge de l’exécution dans son contrôle de l’existence éventuelle de clauses abusives dans les contrats de consommation, en jugeant que la Directive n° 93/13 s’opposait à une réglementation nationale imposant un bref délai pour la saisine du juge et limitant ses pouvoirs en la matière.
La lutte contre les clauses abusives contenues dans les contrats de consommation (dont les contrats de crédit à la consommation et de crédit immobilier) impose que le juge en charge de l’exécution procède, comme le juge du fond, à un examen de ces contrats et annule lesdites clauses. Le juge européen rappelle régulièrement cette obligation et écarte, un à un, les obstacles procéduraux susceptibles de limiter cette mission du juge. Tel est à nouveau le cas à l’occasion d’un arrêt BRD Groupe Société Générale rendu le 4 mai 2023.
En 2007, deux particuliers concluent un contrat de prêt à la consommation avec une banque en Roumanie. En 2015, la banque saisit un huissier de justice aux fins du recouvrement forcé de la créance, sur la base du contrat de prêt, valant titre exécutoire en droit roumain. L’huissier délivre une injonction de payer, sommant l’un des particuliers de s’acquitter des montants restant dus en vertu du contrat de prêt ainsi que des frais d’exécution forcée. L’huissier ordonne la saisie des avoirs financiers sur des comptes détenus auprès de plusieurs établissements bancaires et pratique une saisie sur salaire entre les mains de l’employeur d’un des particuliers. En 2018, l’huissier émet une nouvelle injonction de payer les sommes restant dues, augmentées des frais d’exécution, sous peine de la saisie de la quote-part de propriété du particulier dans un immeuble à Bucarest.
Le particulier forme opposition à cette exécution forcée devant le tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest, en invoquant la prescription du droit de demander l’exécution forcée. Par jugement du 18 avril 2019, cette juridiction écarte l’opposition, en retenant le caractère tardif de la contestation. En 2020, les deux particuliers saisissent la juridiction d’une nouvelle opposition à l’exécution forcée en arguant cette fois-ci du caractère abusif de deux clauses du contrat de prêt relatives à la perception d’une commission d’ouverture de dossier de prêt ainsi que d’une commission mensuelle de traitement et de gestion du crédit. Ils demandent également l’annulation des actes d’exécution forcée et la restitution des sommes indûment perçues en raison du caractère abusif de ces clauses. Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest retient à nouveau le caractère tardif de cette opposition. Les particuliers interjettent appel de ce jugement devant le tribunal de grande instance de Bucarest qui, ayant des doutes sur la conformité des dispositions de droit roumain au droit européen, décide de surseoir à statuer et d’interroger à titre préjudiciel la CJUE.
D’un côté, le droit roumain prévoit que l’opposition à l’exécution forcée d’un titre exécutoire ne peut se faire que dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte d’exécution forcée [1], une voie de recours pouvant cependant toujours être exercée devant le juge du fond. De l’autre, la Directive n° 93/13, du 5 avril 1993, sur les clauses abusives N° Lexbase : L7468AU7 ne soumet à aucun délai l’action en constatation de l’existence de clauses abusives contenue dans un contrat formant titre exécutoire. Les deux normes semblent donc incompatibles. Par son arrêt du 4 mai 2023, la CJUE indique que la Directive européenne n° 93/13 ne permet pas qu’une loi nationale limite dans un délai le droit du juge d’apprécier d’office ou à la demande des parties le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat formant titre exécutoire et ce même si un droit de recours devant le juge du fond ayant le pouvoir de suspendre les voies d’exécution engagées est possible.
I. Le cadre général de la lutte contre les clauses abusives et l’office du juge
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre général résultant d’une jurisprudence constante de la CJUE tendant à rendre plus efficace le système de protection du consommateur contre les clauses abusives mis en œuvre par la Directive n° 93/13, en s’appuyant notamment sur le rôle que peut y jouer le juge.
Ce système, brièvement rappelé [2], repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information [3]. Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, § 1, de cette Directive prévoit que les clauses abusives contenues dans les contrats ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers [4]. Dans ce contexte, la Cour a déjà considéré à plusieurs reprises que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la Directive n° 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet [5].
En outre, la Directive n° 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, § 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel [6].
La Cour a ainsi déjà encadré, à plusieurs reprises et en tenant compte des exigences des articles 6, § 1 et 7, § 1, de la Directive n° 93/13, la manière dont le juge national doit assurer la protection des droits que les consommateurs tirent de cette Directive. Cette mission du juge ne peut être effective que si son office est réellement exercé : il relève donc du devoir et non du simple pouvoir du juge [7]. Il s’exerce tant dans le relevé de moyens de droit [8] que dans des mesures d’instruction [9]. Il ne se heurte à aucun délai de forclusion [10] ou de prescription [11]. Il s’exerce tant dans les procédures contradictoires que dans celles écrites et non contradictoires qui régissent les injonctions de payer [12]. Son périmètre d’action est le plus large possible : le rôle actif du juge concerne tant la phase du litige jusqu’au prononcé de la décision que celle d’exécution de la décision de justice rendue. La Cour de cassation a, sur ce point, déjà dit que l’office du juge en droit de la consommation concerne l’exécution des décisions de justice [13].
Il n’en reste pas moins que, en principe, le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle, et que celles-ci relèvent, dès lors, de l’ordre juridique interne des États membres. À condition toutefois que ces procédures ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) [14].
En outre, la Cour a précisé que l’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit européen implique, notamment, s’agissant des droits découlant de la Directive n° 93/13, une exigence de protection juridictionnelle effective, réaffirmée à l’article 7, § 1, de cette Directive et consacrée également à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui s’applique, entre autres, à la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits [15]. C’est au regard de ces éléments que la Cour a étendu sa jurisprudence reconnaissant un office du juge actif dans la recherche, l’identification et la sanction des clauses abusives dans les contrats de consommation à la phase d’exécution de titres exécutoires reconnaissant des créances fondées sur ces contrats. Cette extension est la bienvenue, car le contrôle effectué par le juge du fond sur la légalité des contrats au regard de l’interdiction des clauses abusives peut se révéler peu approfondi ou trop rapide. Ce contrôle par le juge de l’exécution peut-il donner lieu à l’annulation des clauses abusives contenues dans le contrat ?
II. L’application aux procédures d’exécution
La Cour a estimé que, dans l’hypothèse où une procédure d’exécution forcée aboutit avant le prononcé de la décision du juge du fond déclarant le caractère abusif de la clause contractuelle à l’origine de cette exécution forcée, cette décision ne permettrait d’assurer au consommateur qu’une protection indemnitaire a posteriori, qui se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de cette même clause, contrairement à ce que prévoit l’article 7, § 1, de la Directive [16].
Il est donc important que le juge de l’exécution, tout comme le juge du fond, ne soit pas limité dans son office de recherche et de constatation des clauses abusives contenues dans les contrats dont l’exécution forcée a commencée. La Cour a ainsi jugé que l’autorité de la chose jugée attachée à un titre exécutoire [17], l’écoulement d’un délai de forclusion [18] ou l’existence d’une voie de recours spécifique au fond [19] ne peuvent être opposés au juge de l’exécution dans son droit et même son obligation à relever l’existence de clauses abusives contenues dans un contrat de consommation.
Dans cette lignée, la CJUE s’était déjà en partie prononcée sur le cas d’espèce soumis par le juge roumain. Elle a jugé que la Directive n° 93/13 [20] s’oppose à une législation nationale qui ne permet pas au juge de l’exécution, saisi d’une opposition à l’exécution forcée, d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif des clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel formant titre exécutoire, dès lors que le juge du fond, susceptible d’être saisi d’une action distincte de droit commun en vue de faire examiner le caractère éventuellement abusif des clauses d’un tel contrat, ne peut suspendre la procédure d’exécution jusqu’à ce qu’il se prononce sur le fond que moyennant le versement d’une caution dont le niveau du montant est susceptible de décourager le consommateur d’introduire et de maintenir un tel recours [21].
Toutefois, dans cette affaire jugée en 2022, le juge saisi de l’opposition à l’exécution forcée n’avait pas la faculté de contrôler le caractère potentiellement abusif des clauses du contrat servant de fondement à cette exécution avant que le juge du fond ne tranche le litige. Autrement dit, le recours pouvait demeurer un temps sans effet tant que la décision du juge du fond n’était pas rendue. Or, dans les circonstances de l’affaire « BRD Groupe Société Générale » ayant donné lieu à l’arrêt du 4 mai 2023, le juge de l’exécution en avait la possibilité, mais pour autant qu’il ait été saisi dans un délai de quinze jours, à l’expiration duquel le consommateur est forclos. Les conditions de saisine du juge de l’exécution étaient donc restrictives. Ainsi, dans les deux cas de figure, la question essentielle était bien celle de savoir si la possibilité, pour le consommateur, d’introduire un recours au fond dans le cadre duquel il peut demander la suspension de l’exécution forcée est, compte tenu des modalités d’une telle suspension, de nature à assurer l’effectivité de la protection voulue par la Directive n° 93/13.
La réponse de la CJUE est là encore en faveur d’un élargissement des conditions de saisine du juge de l’exécution et d’un renforcement de son office [22]. Certes, note la Cour, la possibilité, pour le consommateur, d’introduire devant le juge du fond une action de droit commun visant à faire contrôler le caractère potentiellement abusif des clauses du contrat dont l’exécution forcée est poursuivie dans le cadre de laquelle il peut obtenir de ce juge qu’il suspende cette exécution, est susceptible, en principe, de permettre de parer au risque que la procédure d’exécution forcée soit menée à son terme avant l’issue de l’action en constatation de l’existence de clauses abusives. Toutefois, deux points font que la Directive s’oppose à la règle de droit national roumain.
D’une part, l’existence d’un délai de forclusion de quinze jours, délai courant à compter de la notification des premiers actes d’exécution et susceptible d’être opposé au consommateur invoquant l’existence de clauses abusives pour s’opposer à la procédure, constitue une restriction trop forte. Et cela même si ce consommateur dispose, en application du droit national, d’une action en justice devant le juge du fond aux fins de constatation de l’existence de clauses abusives, dont la mise en œuvre n’est soumise à aucun délai [23].
Et d’autre part, en cas de recours distinct devant le juge du fond, le consommateur sollicitant la suspension de la procédure d’exécution forcée est tenu de verser une caution qui est calculée sur la base de la valeur de l’objet du recours. La Cour rappelle ici sa jurisprudence habituelle selon laquelle les frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée ne doivent pas être de nature à décourager le consommateur de saisir le juge aux fins de l’examen de la nature potentiellement abusive de clauses contractuelles. Elle a constaté qu’il est vraisemblable qu’un débiteur en défaut de paiement ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour constituer la garantie requise [24].
Au regard de ces éléments, force est de constater que la possibilité dont dispose le consommateur d’introduire, sans être tenu au respect d’un délai, un recours au fond dans le cadre duquel il peut demander la suspension de la procédure d’exécution forcée moyennant la constitution d’une garantie n’est pas de nature à assurer l’effectivité de la protection voulue par la Directive n° 93/13 si le niveau du montant exigé pour la constitution de cette garantie est susceptible de décourager ce consommateur d’introduire et de maintenir un tel recours.
Restait à déterminer l’attitude à adopter par le juge national en cas d’impossibilité pour celui-ci de donner du droit national une interprétation conforme au droit de l’Union. La CJUE rappelle que, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de la Directive n° 93/13, les juridictions nationales ont l’obligation d’examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s’opposent à un tel examen [25]. Voilà un nouveau rappel qui devrait donner de l’espace au juge de l’exécution pour exercer un office dynamique en faveur d’une meilleure application de la législation consumériste.
[1] Articles 713 et 715 du Code de procédure civile roumain.
[2] CJUE, 4 mai 2023, aff. C-200/21, points 24 à 28.
[3] Il s’agit d’un point mis en avant par la Cour de manière constante depuis l’arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial : CJCE, 27 juin 2000, aff. C‑240/98 à C‑244/98, point 25 N° Lexbase : A5920AYW.
[4] CJUE, 21 décembre 2016, aff. C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, points 53 et 55 N° Lexbase : A7086SXQ – CJUE, 26 janvier 2017, aff. C‑421/14, point 41 N° Lexbase : A9995TM7.
[5] CJUE, 14 mars 2013, aff. C‑415/11, point 46 N° Lexbase : A6627I9C – CJUE, 21 décembre 2016, aff. C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, préc., point 58.
[6] CJUE, 26 juin 2019, aff. C‑407/18, point 44 N° Lexbase : A5455ZG7.
[7] CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08, point 32 N° Lexbase : A9620EHR – CJUE, 14 mars 2013, aff. C-415/11, préc., point 41.
[8] Comme le prévoit l’article R. 632-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L0942K9R.
[9] CJUE, 11 mars 2020, aff. C-511/17, points 36 à 38 N° Lexbase : A09573IB.
[10] CJCE, 21 novembre 2002, aff. C-473/00, point 38 N° Lexbase : A0407A79 – CJUE, 9 juillet 2020, aff. C-698/18 et C-699/18, point 55 N° Lexbase : A80993QZ.
[11] CJUE, 10 juin 2021, aff. C‑776/19 à C‑782/19, point 38 N° Lexbase : A00904WA.
[12] CJUE 14 juin 2012, aff. C-618/10 N° Lexbase : A7221INR – CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-176/17 N° Lexbase : A3599X43 – CJUE, 20 septembre 2018, aff. C-448/17 N° Lexbase : A6895X7I – CJUE, ord. 20 novembre 2020, C-807/2019.
[13] Cass., avis, 4 juillet 2016, n° 16-70.004 N° Lexbase : A6160RW3.
[14] CJUE, 26 juin 2019, aff. C‑407/18, préc., points 45 et 46.
[15] CJUE, 10 juin 2021, aff. C‑776/19 à C‑782/1, préc., point 29 – CJUE, 31 mai 2018, aff. C‑483/16, point 49 N° Lexbase : A7145XPC.
[16] CJUE, ord. 6 novembre 2019, aff. C‑75/19, non publiée, point 32 – CJUE, 14 mars 2013, aff. C‑415/11, préc., point 60.
[17] CJUE, 17 mai 2022, aff. C-693/19 N° Lexbase : A16667XY.
[18] CJUE, 17 mai 2022, aff. C-600/19 N° Lexbase : A16647XW.
[19] CJUE, 17 mai 2022, aff. C-725/19 N° Lexbase : A16697X4.
[20] Notamment ses articles 6, § 1 et 7, § 1.
[21] CJUE, 17 mai 2022, aff. C‑725/19, préc., points 58 à 60 – CJUE, 14 juin 2012, aff. C‑618/10, point 54 N° Lexbase : A7221INR – CJUE, 18 février 2016, aff. C‑49/14, points 52 et 54 N° Lexbase : A4164PLS.
[22] CJUE, 4 mai 2023, aff. C-200/21, points 32 à 41.
[23] CJUE, ord. 6 novembre 2019, aff. C‑75/19, préc., point 34.
[24] CJUE, 26 juin 2019, aff. C-407/18, préc., point 60.
[25] CJUE, 7 novembre 2019, aff. C‑419/18 et C‑483/18, point 76 N° Lexbase : A9980ZTS – CJUE, 4 juin 2009, aff. C‑243/08, points 32, 34 et 35 N° Lexbase : A9620EHR – CJUE, 14 juin 2012, aff. C-618/10, préc., point 42.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485457
[Brèves] Point de départ du délai de rétractation d’un contrat mixte conclu hors établissement
Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 21-25.670, FS-B N° Lexbase : A39399UG
Lecture: 2 min
N5572BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 24 Mai 2023
► Le contrat mixte, portant sur la livraison de biens et la fourniture de services destinée à l’installation et la mise en services de ces biens, doit être qualifié de contrat de vente, en conséquence de quoi, le point de départ du délai de rétractation prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation est fixé au jour de la livraison des biens.
Le contentieux relatif aux dispositions visant à protéger le consommateur lorsque celui-ci conclut un contrat hors établissement continue d’occuper le devant de la scène.
En témoigne l’arrêt rendu le 17 mai 2023 dont l’enjeu résidait dans la détermination du point de départ du délai de rétractation prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation N° Lexbase : L1567K78.
Le texte distingue en effet selon la qualification du contrat : en présence d’un contrat de prestation de services, le délai commence à courir à compter de la conclusion du contrat (article L. 221-18, 1°), alors qu’il ne commence à courir qu’à compter de la livraison du bien si la qualification de contrat de vente est retenue (article L. 221-18, 2°). L’enjeu n’est donc pas anodin. Mais quelle qualification retenir lorsqu’est en cause un contrat impliquant non seulement la livraison de biens mais également une fourniture de services destinée à l’installation et la mise en service de ces biens, en l’espèce des panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau thermodynamique ?
La cour d’appel avait retenu la qualification de contrat de vente, ce que contestait le pourvoi, lequel optait pour la qualification de contrat de service (CA Nîmes, 30 septembre 2021, n° 19/02902).
La Cour de cassation l’en approuve et rejette ainsi le pourvoi. Elle considère que « le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente ». Ce faisant, ce contrat mixte doit être qualifié de contrat de vente (rappr. CA Lyon, 18 mars 2021, n° 19/05346 N° Lexbase : A59514LY). Par conséquent, le point de départ du délai de rétractation est fixé au jour de la livraison des biens en cause.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485572
[Jurisprudence] L’intention frauduleuse du mandataire et la validité du contrat de vente
Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2023, n° 22-10.001, FS-B N° Lexbase : A39219LS
Lecture: 12 min
N5508BZZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Quentin Prim, Docteur en droit privé
Le 25 Mai 2023
Mots-clés : mandat • vente • détournement • abus de confiance • terme du mandat • dépassement de pouvoir • obligations du vendeur • consentement • nullité
Dès lors que les parties sont convenues du prix et de l’objet de la vente, celle-ci est parfaite quand bien même le mandataire n’aurait eu aucune intention d’exécuter le contrat. La Cour de cassation rappelle la place de la volonté au sein du contrat de vente et en profite pour consacrer la règle du nouvel article 1157 du Code civil en matière de détournement de pouvoir.
1. - « Qui fait ses affaires par commission, va à l’hôpital en personne. » [1] Cette maxime ne saurait trouver meilleure illustration que les faits ayant donné lieu à la décision prise par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2023.
2. - Dans cette affaire, le propriétaire d’une Lamborghini conclut un contrat de mandat avec le représentant de la société Carclassic. Ce dernier doit vendre sa voiture pour la somme de 160 000 euros. Quelques mois plus tard, une personne inconnue contacte le mandant pour lui dire qu’il a acquis la voiture par l’intermédiaire de la société Carclassic. Il apprend par la suite que la société Carclassic est placée en faillite en Suisse (lieu de son siège social) et que son dirigeant est mis en examen pour abus de confiance aggravé et escroquerie. Il lui est reproché d’avoir adopté un mode opératoire consistant à conclure des ventes de voitures avec plusieurs personnes différentes sans jamais livrer la chose promise ni la rendre à son propriétaire, mais n’oubliant pas d’empocher le paiement du prix. L’enquête est toujours en cours et aucun jugement n’a eu lieu en l’état.
La voiture ayant été saisie, son propriétaire initial demande au juge d’instruction qu’elle lui soit restituée. Ce dernier refuse, en raison du litige existant entre le vendeur dupé et l’acheteur floué au sujet de la propriété de la Lamborghini.
La cour d’appel de Paris donne raison au premier d’entre eux, estimant que la vente n’a pas pu avoir lieu entre la société Carclassic et l’acheteur, le représentant de la société n’ayant jamais eu l’intention de livrer la chose. Elle l’analyse comme une violation de l’article 1582 du Code civil N° Lexbase : L1668ABE, autrement dit un défaut de consentement au contrat de la part du vendeur.
3. - La Cour de cassation ne souscrit pas à ce raisonnement. S’appuyant sur les articles 1583 N° Lexbase : L1669ABG et 1998 N° Lexbase : L2221ABU du Code civil, elle déclare que la nature consensuelle du contrat de vente implique que celle-ci est parfaite dès lors que les parties s’entendent sur la chose et le prix, quand bien même le mandataire du vendeur aurait détourné ses pouvoirs, à moins que le tiers acquéreur ait connaissance du détournement ou ne pourrait l’ignorer. Elle en déduit que les intentions réelles du mandataire quant à la livraison du véhicule sont indifférentes.
4. - Les lecteurs les plus attentifs auront reconnu la règle fixée à l’article 1157 du Code civil N° Lexbase : L0873KZD, intégrée au droit positif par la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, et par conséquent inapplicable en l’espèce. Cette application pose néanmoins question au regard des faits : s’agissait-il véritablement d’un détournement de pouvoir, ou plutôt d’un dépassement ? C’est l’avis de l’avocat général près la Cour de cassation, qui préconisait une cassation pour défaut de motif fondée sur le raisonnement alambiqué de la cour d’appel de Paris : après avoir constaté que la vente avait été conclue après la fin du terme du mandat, elle se contente de déclarer lapidairement qu’une prorogation tacite avait eu lieu, alors que ce point était contesté par le vendeur. Or, la prorogation tacite du contrat de mandat n’est pas évidente en droit positif, et cette question aurait mérité une réponse de la Cour de cassation [2].
La Cour de cassation préfère se concentrer sur d’autres points. Elle rappelle d’une part la place de la volonté en matière de contrat de vente (I), et d’autre part statue sur l’influence du détournement de pouvoir sur le contrat conclu (II).
I. Le rappel de la place de la volonté dans la conclusion du contrat de vente
5. - Comme tout contrat, la vente nécessite, pour être parfaite, l’expression du consentement des parties à l’acte. La règle de principe en droit français est celle du consensualisme : aucune forme particulière n’est exigée dans l’expression de ce consentement. Elle est rappelée explicitement à l’article 1583 du Code civil N° Lexbase : L1669ABG : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
En cas de représentation de l’une des parties, l’articulation se fait aisément. Le représentant est considéré comme exprimant le consentement du représenté. Par conséquent, son consentement au contrat suffit à rendre la vente parfaite. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation vise dans sa décision l’article 1998 du Code civil N° Lexbase : L2221ABU : la force obligatoire du contrat impose son respect par le mandant.
6. - La notion de consentement est néanmoins spécifique. Elle se distingue de la volonté et de l’intention, qui sont subjectives. Le consentement est l’expression objective d’un accord, il consacre l’engagement d’une partie à l’acte. Une fois délivré, le consentement ne peut être repris : il est invariable. La volonté, au contraire, est subjective et mouvante. Elle est de l’ordre du for intérieur et ne peut servir de fondement à un engagement. Le consentement permet d’objectiver la volonté, de lui faire produire des effets juridiques en la rendant stable [3]. L’intention renvoie aux motifs de l’engagement, à sa « cause subjective ». Il s’agit du but visé par la partie qui s’engage, le contrat constituant le moyen d’atteindre ce but. Les motifs ne sont pris en compte que lorsqu’ils sont intégrés au contrat en tant que conditions au consentement, sinon, ils sont comme la volonté hors du champ contractuel [4].
7. - Le tort de la cour d’appel de Paris a été de confondre ces différentes notions. En effet, elle explique que le mode opératoire utilisé par la société Carclassic démontrait son intention malveillante et l’absence de volonté de délivrer la chose à l’issue du contrat de vente. Elle fonde sa décision sur le défaut de preuve de la volonté du vendeur de livrer le véhicule à l’acheteur, preuve qui est selon elle à la charge de ce dernier. Or, l’intention de livrer la chose ne se confond pas avec le consentement au contrat de vente, qui nécessite uniquement la preuve d’un accord sur la chose et le prix.
Ce faisant, la cour d’appel impose une condition au contrat de vente qui n’est pas exigée par les textes et qui est même contraire à leur esprit. La Cour de cassation rappelle à juste titre que l’intention du vendeur ne produit pas d’effet quant à la validité du contrat. Si mauvaise foi du vendeur il y a, elle se constatera au stade de l’exécution du contrat en démontrant simplement que l’obligation de délivrance n’a pas été satisfaite.
C’est in fine ce que sous-entend la motivation de la cour d’appel en reprochant à l’acquéreur de ne pas produire de « certificat de cession » et de ne pas avoir la « possession effective » du véhicule. Ces éléments ne font que démontrer l’inexécution de l’obligation de délivrance du vendeur, et ne disent rien de la validité du contrat.
8. - L’existence d’un mandat va cependant influer sur l’appréciation de la volonté des parties et ses effets sur le contrat de vente.
II. L’effet du détournement de pouvoir sur le contrat conclu
9. - La règle de l’article 1157 du Code civil N° Lexbase : L0873KZD, reprise en substance par la Cour de cassation, dispose que le contrat conclu est nul en cas de détournement de pouvoir de la part du représentant associé à une connaissance (effective ou présumée) du tiers contractant.
Il s’agit d’une extension des effets de la représentation par application de la théorie de l’apparence [5]. Le détournement consiste en un dépassement des limites subjectives des pouvoirs du représentant [6]. Le représentant agit alors dans un intérêt distinct de celui du représenté, mais dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés [7]. Or, le tiers contractant ne peut apprécier l’intérêt du représenté, et donc avoir connaissance du détournement a priori. Ainsi, de son point de vue, le contrat ne peut être que valide, et il serait attentatoire à la sécurité juridique d’en contester la conformité sur ce fondement, à moins d’une connaissance par le tiers de la situation [8].
Le concert frauduleux entre le représentant et le tiers n’est plus la seule situation sanctionnée : l’ignorance fautive du tiers contractant peut suffire à remettre en cause l’acte [9]. Il peut néanmoins être difficile pour le mandant de prouver l’intention frauduleuse animant à la fois le mandataire et le tiers contractant [10]. De plus, la charge de la preuve pèse dans cette situation sur le représenté, contrairement à la règle de principe issue de la théorie de l’apparence qui fait peser la charge de la preuve de la croyance légitime sur le tiers qui se prévaut du contrat [11].
10. - La nature de la sanction à appliquer au détournement de pouvoir a fait l’objet de débats jusqu’à l’adoption de la réforme du droit des obligations. La solution antérieure était l’inopposabilité : en cas de concert frauduleux, l’acte restait valide mais inopposable au représenté, qui pouvait refuser son exécution [12]. Toutefois, l’inopposabilité fait perdurer le contrat, ce qui peut être de l’intérêt du représentant et du tiers qui ont commis la fraude aux droits du représenté [13].
Désormais, l’article 1157 du Code civil N° Lexbase : L0873KZD dispose que la sanction applicable est la nullité relative. Le représenté peut ainsi contester la validité du contrat lui-même.
En l’espèce, le mandant soulevait une autre sanction possible : l’inexistence du contrat [14]. L’inexistence vise à compléter la théorie des nullités en permettant d’en étendre les effets au-delà des cas prévus par les textes. Elle ne doit par conséquent s’appliquer que si la nullité du contrat ne peut l’être. Or, en matière de détournement de pouvoir, la nullité paraît être la sanction la plus évidente, d’autant plus depuis l’intégration de l’article 1157 précité. Le choix de l’inexistence paraissait dès lors peu pertinent, d’autant plus que l’autonomie et le champ d’application de cette notion sont fortement contestés [15].
11. - Si le détournement est reconnu mais que le contrat reste valide à défaut de connaissance par le tiers, il reste au mandant la solution de l’engagement de la responsabilité contractuelle du mandataire. Si, à l’inverse, le contrat est annulé, le tiers contractant peut également engager la responsabilité du mandataire, mais il s’agit alors de sa responsabilité délictuelle [16], le contrat n’ayant pu être formé.
À la sanction civile du mandataire peut s’ajouter une sanction pénale, l’abus de confiance. Les deux ont vocation à punir la déloyauté du représentant, et constituent des sanctions générales s’appliquant en principe à toutes les situations d’action dans l’intérêt d’autrui [17].
12. - En l’espèce, la pertinence de la qualification de détournement de pouvoir est néanmoins douteuse. En effet, le représentant n’a pas fait l’objet d’une sanction pénale, qui aurait consacré le détournement. Il reste donc présumé innocent et il n’existe aucune preuve formelle de sa déloyauté, qui implique un élément subjectif (l’intention de satisfaire un autre intérêt que celui du représenté). Les faits permettent simplement de constater qu’il n’a pas respecté son obligation de délivrer la chose à l’acheteur, ni son obligation de reddition de comptes en reversant le prix de vente au mandant.
La Cour de cassation choisit pourtant de rappeler la règle applicable en matière de détournement de pouvoir, ce qui semble exprimer une volonté de consacrer sa généralité et son contenu.
13. - Ce faisant, elle occulte néanmoins la question du dépassement de pouvoir commis par le mandataire qui a conclu la vente postérieurement au terme du mandat. Ce point méritait pourtant d’attirer l’attention de la Cour et aurait également pu justifier la cassation. La cour d’appel a déduit des faits d’espèce une tacite prorogation de la durée du contrat de mandat, mais cette faculté n’est pas évidente, à tel point que l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux prévoit explicitement son impossibilité sauf clause contraire insérée au mandat [18]. L’avocat général préconisait d’ailleurs ce choix de solution. Peut-être la Cour attend-elle l’action du législateur avant de prendre position sur le sujet.
Le résultat aurait alors pu être différent. D’après le texte de l’article 1156 du Code civil (conforme à la jurisprudence applicable au moment des faits [19]), en cas de dépassement de pouvoir, il aurait appartenu à l’acquéreur de démontrer qu’il pouvait légitimement croire que la société Carclassic avait la faculté de conclure le contrat au nom du vendeur. Le rapprochement entre dépassement et détournement de pouvoir montre ici ses limites, alors qu’ils résultent tous deux d’un franchissement des frontières (respectivement objectives et subjectives) des pouvoirs du mandataire.
14. - En choisissant de se placer sur le terrain du détournement de pouvoir, en réaffirmant solennellement la théorie de l’apparence et en faisant peser la charge de la preuve du détournement sur le mandant, la Cour de cassation confirme vouloir accompagner l’orientation prise par le législateur en faveur d’une « sécurité juridique dynamique » [20], protectrice des intérêts des tiers, et au-delà de la stabilité des conventions conclues, au détriment du représenté. Cette tendance est conforme aux tentatives de rapprochement des droits civils européens et à l’objectif de sécurisation des échanges économiques [21].
| À retenir. L’intention du mandataire de ne pas exécuter le contrat de vente conclu n’a pas d’influence sur la validité du contrat. Par conséquent, le mandant est engagé par le contrat conclu même en cas de détournement de pouvoir de la part de son représentant. |
[1] J. Savary, Le parfait négociant, Lyon, Jac. Lyon, t. 1, 1697, p. 104.
[2] Dans ce sens également : N. Allix, Le sort de la vente conclue par un mandataire animé d'une intention frauduleuse, Dalloz Actu, 11 mai 2023.
[3] M.-A. Frison-Roche, Remarques sur la distinction entre volonté et consentement en droit des contrats, RTD civ., 1995, p. 573.
[4] G. Wicker, De la survie des fonctions de la cause : Ébauche d’une théorie des motifs, D. 2020, p. 1906.
[5] G. Chantepie, M. Latina, Le nouveau droit des obligations : Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, Paris, Dalloz, 2018, n° 393
[6] D. Veaux, L’abus de pouvoirs ou de fonctions en droit civil français, in L’abus de pouvoirs ou de fonctions (Journées grecques), Travaux de l’Association Henri Capitant, Paris, Economica, 1980, p. 77-94, n° 4.
[7] O. Deshayes, T. Genicon, Y-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Commentaire article par article, 2e éd. LexisNexis, 2018, p. 285.
[8] G. Wicker, Le nouveau droit commun de la représentation dans le Code civil, D. 2016, p. 1942, n° 36 ; P. Didier, La représentation dans le nouveau droit des obligations, JCP G, 2016, n° 20-21, 580 ; G. Chantepie, M. Latina, op. cit., n° 393 ; J. François, L’acte accompli par le mandataire en dehors de ses pouvoirs et le mécanisme du contrat de mandat, D. 2018, p. 1215.
[9] G. Chantepie, M. Latina, ibid.
[10] Des auteurs ont proposé pour cette raison l’instauration d’une présomption de déloyauté sous certaines conditions : P. Didier, De la représentation en droit privé, Paris, LGDJ, coll. BDP, 2000, n° 233 (fondée sur le caractère lésionnaire de l’acte) ; T. Douville, Les conflits d’intérêts en droit privé, Nanterre, Institut Universitaire Varenne, coll. des Thèses, 2014, n° 121 (limitée aux cas de conflits d’intérêts) ; J. Valiergue, Les conflits d’intérêts en droit privé : Contribution à la théorie juridique du pouvoir, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, coll. BDP, 2019,, n° 862 (lorsque le représentant retire une contrepartie de l’acte).
[11] A. Danis-Fatôme, Proposition de modification de l’article 1156 du Code civil : le défaut de pouvoir du représentant, RDC, 2017, n° 23, p. 177.
[12] Cass. civ. 3, 29 novembre 1972, n° 71-12.554, publié au bulletin N° Lexbase : A4962CKY.
[13] A. Danis-Fatôme, art. préc. L’auteur propose par ailleurs la possibilité pour le tiers contractant de bonne foi de demander lui aussi la nullité du contrat s’il constate que le représenté a été trompé.
[14] Sur cette notion, v. L. Mayer, « Nullité », Rép. proc. civ. Dalloz, 2023, n° 70 et s.
[15] V. à ce sujet A. Posez, L’inexistence du contrat, Panthéon-Assas, 2010.
[16] À moins que le mandataire ait conclu une promesse de porte-fort et se soit porté garant de la validité du contrat (C. civ., art. 1203).
[17] Q. Prim, La gestion des biens d’autrui, Bordeaux, 2021, n° 303.
[18] Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, 2022, art. 1994. Plus précisément, le texte prévoit d’interdire la tacite reconduction du mandat après son terme, pas la prorogation tacite de sa durée. Les deux situations restent néanmoins très proches dans leurs effets.
[19] Ass. plén., 13 décembre 1962, n° 57-11.569.
[20] Sur l’opposition entre « sécurité juridique statique » et « sécurité juridique dynamique », v. R. Demogue, Les notions fondamentales du droit privé (1911), Paris, Editions La Mémoire du Droit, coll. Références, 2001, p. 67 et s.
[21] Les droits anglais et allemand favorisent plus facilement le tiers au détriment du représenté (M. Elland-Goldsmith, La notion de représentation en droit anglais, Droits, 1987, n° 6, p. 99-106 ; G. Reiner, La théorie de la représentation dans les actes juridiques en droit allemand, in La représentation en droit privé, 6èmes Journées Franco-Allemandes, Paris, Société de législation comparée, 2016, p. 19-45). Cette orientation est également préconisée pour l’unification des droits nationaux autour d’un droit commun de la représentation (K. Grönfors, Unification of Agency as a Legislative Challenge, Revue de droit uniforme, 1998-2/3, p. 467-474 ; R. Cabrillac, La théorie générale de la représentation dans le projet de réforme du droit des contrats français, in Mélanges en l’honneur du professeur Didier Martin, Paris, Lextenso, 2015, p. 111-119).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485508
[Brèves] Statut d’agent commercial : les conditions d’application aux personnes morales
Réf. : Cass. com., 17 mai 2023, n° 21-23.533, FS-B N° Lexbase : A39329U8
Lecture: 4 min
N5524BZM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
Le 31 Mai 2023
► Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du Code de commerce, 4, alinéas 1er et 2, de la loi n° 70-9, du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et 9 du décret n° 72-678, du 20 juillet 1972, fixant les conditions d'application de cette loi, que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.
Faits et procédure. Une SAS qui commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs a conclu un partenariat avec deux banques, par lequel celles-ci lui confiaient la mission de vendre une sélection de biens immobiliers à des clients qu’elles lui adressaient.
Le 31 octobre 2005, la SAS a confié à une SARL un premier « mandat commercial » pour une durée d’une année, ensuite reconduit. Le 1er janvier 2013, elle lui a confié un second mandat.
En mars 2018, la SAS a informé la SARL de sa décision de mettre unilatéralement fin à ces deux mandats. Cette résiliation a été confirmée par lettres recommandées du 20 avril suivant, avec prise d’effet respectivement les 31 octobre et 31 décembre 2018. La SARL a alors sollicité l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce N° Lexbase : L5660AIH.
La SAS ayant contesté à la SARL le bénéfice du statut d’agent commercial, celle-ci l’a assignée en paiement d’une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Par décision du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 30 septembre 2021, n° 19/08586 N° Lexbase : A852147Q) a rejeté la demande tendant à dire que le statut d’agent commercial fixé par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce N° Lexbase : L9693L77 n’est pas applicable à la SARL et condamné la SAS a lui verser certaines sommes au titre de l’indemnité compensatrice prévue par le statut des agents commerciaux.
La SAS a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction commence par rejeter le premier moyen, pris en sa première branche, par lequel la SAS soutenait que le statut des agents commerciaux ne pouvait pas s’appliquer à une personne morale exerçant une activité soumise à la loi « Hoguet » (loi n° 70-9, du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce N° Lexbase : L7536AIX) dans le cadre d’un mandat confié par le titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier.
Au contraire, la Cour affirme qu’il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du Code de commerce, 4, alinéas 1er et 2 de la loi « Hoguet » et 9 du décret n° 72-678, du 20 juillet 1972, fixant les conditions d’application de cette loi N° Lexbase : L8042AIP que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.
La Chambre commerciale finit tout de même par censurer l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation reproche en particulier aux juges du fond d’avoir déduit l’application du statut d’agent commercial de la qualification contractuelle exprimée par les parties dans les contrats de mandats, alors que l’application de ce statut dépend des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée et non pas de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-11.298, F-D N° Lexbase : A28179WA).
| Pour en savoir plus : v. V. Téchené, Les conditions d’application du statut d’agent commercial aux négociateurs immobiliers, Lexbase Affaires, novembre 2011, n° 272 N° Lexbase : N8664BSP. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485524
[Brèves] Recevabilité de l’apport de la preuve de la nationalité française par filiation
Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 21-50.068, FS-B N° Lexbase : A39379UD
Lecture: 2 min
N5493BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 25 Mai 2023
► Est admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation toute personne dont les ascendants ont eu la possession d'état de Français.
Principe. Il résulte de l'article 30-3 du Code civil N° Lexbase : L2716AB9 que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français (sur l’appréciation de ce délai cinquantenaire, CA Paris, pôle 1 - chambre 1, 6 septembre 2016, n° 15/13630 N° Lexbase : A9885RYR).
Faits. Mme X, née en Algérie, à laquelle un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être la descendante, par filiation paternelle, d'un admis à la qualité de citoyen français.
Application. La grand-mère paternelle de la demandeuse a résidé en France pendant plusieurs années à partir de l'année 2005 et a obtenu sur le territoire français, antérieurement à l'expiration des cinquante années suivant l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 3 juillet 1962, la délivrance d'un certificat de nationalité française auprès du tribunal d'instance du lieu de son domicile, l'émission d'une carte d'assurance maladie « Vitale » et deux abonnements relatifs à l'utilisation des transports en commun.
Décision. La cour d'appel (CA Paris, pôle 3- chambre 5, 7 décembre 2021, n° 20/02129 N° Lexbase : A36707EN) en a exactement déduit que l’intéressée était recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485493
[Brèves] Détention provisoire des mineurs : le RRSE demeure-t-il obligatoire lorsque l’intéressé est devenu majeur au jour de l’exercice des poursuites ?
Réf. : Cass. crim., 16 mai 2023, n° 23-80.982, F-B N° Lexbase : A39449UM
Lecture: 4 min
N5514BZA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
Le 25 Mai 2023
► Lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement. Cette obligation s’applique même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans.
Rappel de la procédure. Pour des faits commis entre courant janvier 2021 et le 17 janvier 2023, un individu né en 2003 a été mis en examen le 20 janvier 2023 des chefs d’homicide involontaire, infractions à la législation sur les stupéfiants, violence et vol et placé en détention provisoire.
L’intéressé a relevé appel de l’ordonnance de placement invoquant sa nullité en raison de l’absence de recueil de renseignements socio-éducatif (RRSE) ; lequel est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté l’exception de nullité tirée de l’absence de RRSE au motif que l’intéressé était majeur au moment d’une partie des faits reprochés et qu’il a fait l’objet d’une enquête sociale rapide.
La juridiction a ordonné à titre exceptionnel la détention provisoire du mis en examen et l’a placé sous mandat de dépôt.
L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté l’exception de nullité et ordonné la détention provisoire du mis en examen alors que l’obligation de RRSE s’applique même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint ses vingt-et-un ans. Le pourvoi ajoute que ne fait pas obstacle à cette règle le fait que l’intéressé serait mis en examen pour des faits commis lorsqu’il était majeur.
Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles L. 322-4 N° Lexbase : L2578L8Y, L. 322-5 N° Lexbase : L2890L8K et L. 322-6 N° Lexbase : L3020L8D du Code de la justice pénale des mineurs.
La Cour souligne qu’en vertu des deux premiers, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire, lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d’instruction ou le tribunal pour enfants, avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.
Qu'en est-il lorsque, comme en l’espèce, un individu majeur est mis en examen pour des faits commis lorsqu’il était mineur ?
Le troisième et dernier article visé par la Chambre criminelle précise justement que cette obligation s’applique même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans.
En l’espèce, le mis en examen était mineur lors de la commission d’une partie des faits et n’avait pas atteint l’âge de vingt-et-un ans le jour où les poursuites ont été exercées. Le RRSE était donc obligatoire.
La Chambre criminelle affirme que la cassation de l’arrêt doit entraîner la remise en liberté du mis en examen, sauf si celui-ci est détenu pour autre cause. Toutefois, elle constate qu’en l’espèce, il existe par ailleurs des indices graves et concordants rendant vraisemblable que l’intéressé ait pu participer, comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi. Faisant application des dispositions de l’article 803-7 du Code de procédure pénale {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 107265905, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "803-7", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L4833K8I"}}, la Cour ordonne donc le placement de l’individu sous contrôle judiciaire et le soumet à diverses obligations.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485514
[Chronique] Chronique de droit du travail et entreprises en difficulté (janvier 2022 – décembre 2022)
Lecture: 1 heure, 17 min
N5495BZK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Hélène Nasom-Tissandier, Maitre de conférences HDR à l’Université Paris Dauphine-PSL, Membre du CR2D
Le 01 Juin 2023
Mots-clés : licenciement pour motif économique • transferts d’entreprise • contentieux • créances salariales
La question des rapports qu’entretiennent le droit du travail et le droit des entreprises en difficulté est ancienne et complexe. Au fil des réformes, une certaine convergence entre les disciplines a été organisée même si elle ne va pas de soi, tant les sujets comme les catégories juridiques qui les fondent sont distincts. Cette chronique propose de recenser les décisions de justice et les évolutions législatives ou règlementaires qui mobilisent à la fois le droit des procédures collectives et le droit du travail, qu’il s’agisse, pour le second, du droit commun ou des règles particulières applicables dans l’entreprise en difficulté.
I. Procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire
A. Licenciements pour motif économique
Liquidation judiciaire – plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) – homologation – obligation de recherche de reclassement au sein du groupe (CE, 1e-4e ch. réunies, 1er juin 2022 n° 434225, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67917Y8). L'administration peut-elle homologuer un PSE malgré un défaut de réponse des autres entreprises du groupe aux recherches de reclassement ? Le 27 septembre 2018, une société d’assurances appartenant à un groupe établi en Europe est placée en liquidation judiciaire. Les liquidateurs élaborent un PSE prévoyant la suppression des 140 postes de l'entreprise. Aucun reclassement n'est possible dans l'entreprise, qui est en cessation totale et définitive d'activité. Mais une autre société du groupe, située en France, est susceptible de proposer des postes. Le liquidateur l'interroge le 8 octobre, par courrier postal, parvenu le 12 octobre à son destinataire. Il dépose, le 9 octobre, une demande d'homologation du PSE auprès de l'administration, sans attendre les réponses de la société qu'il a sollicitée. L'administration homologue le PSE le 12 octobre. Il ressort de la jurisprudence antérieure du Conseil d'État que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation [1]. Dans l'affaire en cause, cette obligation de recherche sérieuse a-t-elle été respectée ? Cette obligation est sanctionnée moins strictement dans deux hypothèses. D'abord, à l'égard des postes de reclassement dans les autres entreprises du groupe présentes sur le territoire national -l'employeur doit établir qu'il a procédé à une recherche sérieuse [2]. Ensuite, à l'égard des entreprises placées en liquidation judiciaire dans lesquelles la procédure doit être rapide afin que les salariés puissent bénéficier de la garantie des créances salariales [3] : la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession, de quinze ou vingt-et-un jours suivant le jugement de liquidation lorsqu'un PSE est élaboré et de quinze ou vingt-et-un jours suivant la fin du maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation [4].
Suivant les conclusions du rapporteur public [5], le Conseil d'État, pour la première fois, énonce que « la seule circonstance que, dans une entreprise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire, alors qu'il a utilement saisi les autres entreprises du groupe en vue d'une recherche des postes de reclassement disponibles sur le territoire national, n'ait pas obtenu les réponses de tout ou partie de ces entreprises, ne fait pas obstacle à ce que le plan de reclassement soit regardé comme satisfaisant les exigences figurant aux dispositions des articles L. 1233-61 N° Lexbase : L7291LHI à L. 1233-62 N° Lexbase : L7290LHH du Code du travail et à ce que l'administration, le cas échéant, estime, dans le cadre du contrôle global qui lui incombe, que le plan de sauvegarde de l'emploi est suffisant, eu égard aux moyens de l'entreprise ». Le PSE peut donc être homologué même sans aucune réponse des entreprises du groupe aux recherches de reclassements, ce qui réduit considérablement la portée de l’obligation de reclassement. Cette solution ne semble toutefois valoir que pour l'entreprise en liquidation judiciaire, voire en redressement judiciaire, le Conseil d'État insistant sur la circonstance que l'entreprise est en liquidation judiciaire. Elle ne vaut donc pas pour l’entreprise in bonis. Elle ne se comprend d’ailleurs que dans cette hypothèse parce que toute autre interprétation aurait conduit à priver les salariés de la garantie des créances salariales, tant les délais sont contraints pour rompre les contrats de travail lorsqu'une procédure de liquidation (ou de redressement) est ouverte.
En revanche, le Conseil d'État était ensuite interrogé sur le caractère suffisant du PSE au regard des moyens dont disposait l'entreprise. Selon l'article L. 1233-58, II du Code du travail N° Lexbase : L8650LGH, « l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 N° Lexbase : L8596LGH au regard des moyens dont dispose l'entreprise ». En l'occurrence, le PSE est jugé proportionné aux moyens de l'entreprise : « le document unilatéral comporte diverses mesures, correspondant à des dispositifs légaux ou financés sur fonds publics, quant au reclassement externe des salariés » [6].
Enfin, le Conseil d'État considère que « dans ces circonstances très particulières la circonstance que les liquidateurs aient tardé à saisir la société (…) en vue de l'identification de postes de reclassement a été en l'espèce sans influence sur le caractère sérieux de la recherche de reclassement qu'ils ont opérée et sur le contenu du plan de reclassement figurant au plan de sauvegarde de l'emploi de la société ». Cette solution surprend. En l'espèce, le liquidateur avait envoyé un courrier de recherche de reclassement la veille de la demande d'homologation. Le rapporteur public soulignait au contraire qu' « en interrogeant aussi tardivement la seule entreprise du groupe susceptible d'offrir des postes de reclassement, le liquidateur ne peut être regardé comme ayant effectué une recherche sérieuse de reclassement, le caractère sérieux de cette recherche devant s'apprécier tant au regard du contenu de la recherche qu'au regard de sa diligence et de son effectivité (…). Si donc la recherche de reclassement menée par le liquidateur n'a pas été sérieuse, ce n'est pas en raison de l'absence de réponse des entreprises du groupe, (…), mais c'est en raison de l'absence de question posée à celle-ci en temps utile ». Fort heureusement, le Conseil d'État souligne qu'une telle interprétation n'est justifiée que « dans les circonstances particulières de l'espèce ». En effet, la seule entreprise du groupe qui disposait d'un établissement sur le territoire national, rencontrait elle-même des difficultés financières de nature à faire obstacle à ce qu'elle procède à des recrutements, difficultés qu'elle avait indiquées le 15 octobre suivant en précisant n'avoir aucun poste de reclassement [7]. Il n’en demeure pas moins que le Conseil d’État semble surtout sensible aux exigences de célérité de la procédure et à la difficulté pratique à respecter l’obligation de rechercher des postes de reclassements du fait de l’ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation a élaboré une jurisprudence plus protectrice des salariés lorsqu’est en cause l’obligation individuelle de reclassement. Elle a ainsi refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été posée en considérant que l’employeur en liquidation judiciaire est tenu à la même obligation de reclassement qu’un employeur in bonis, même si le salarié doit être licencié dans les quinze jours de la liquidation judiciaire [8]. La différence de traitement qui en résulte est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par l’AGS et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d’intérêt général. Les délais réduits ne peuvent donc pas être invoqués [9], par exemple pour justifier le caractère insuffisamment sérieux des démarches tenant à l’envoi d’une lettre-type à certaines sociétés du groupe mentionnant le licenciement de 58 salariés, sans précision des postes occupés, la recherche limitée de recherche de reclassement externe, omettant des entreprises importantes de la région [10]. De même, le liquidateur manque à son obligation de reclassement s’il notifie les licenciements sans attendre les réponses des sociétés du groupe sur les postes disponibles. Le Conseil d’État se contente, en revanche, du constat que les circonstances de l’espèce (et notamment le fait qu’ultérieurement l’absence de possibilité de reclassement ait été constatée), suffise à justifier du caractère sérieux de la recherche, qui était pourtant fort contestable. N’aurait-il pas au moins fallu exiger du liquidateur qu’il démontre sa connaissance de l’impossibilité de reclassement ? À défaut, cette obligation devient purement formelle.
Liquidation judiciaire - salarié protégé - obligation de recherche de reclassement (CAA Versailles, 8 novembre 2022, n° 22VE01293 N° Lexbase : A28768SC). Un mandataire liquidateur s’était contenté d’envoyer aux entreprises du groupe des lettres leur demandant de lui signaler les postes disponibles aux fins de reclasser un salarié protégé, en préalable à une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique. La cour administrative d'appel a été saisie d'une demande d'annulation de la décision du ministre du Travail annulant le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail. L'un des moyens était tiré de l'insuffisance de l'effort fourni par l'employeur pour reclasser le salarié, en méconnaissance de l'article L. 1233-4 du Code du travail N° Lexbase : L7298LHR dans sa version alors en vigueur. De nouveau, est en cause le caractère sérieux de la recherche de reclassement du salarié, tant dans l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient [11]. En l'occurrence, le liquidateur avait adressé un courrier aux deux entreprises formant le « groupe de reclassement », se limitant à demander aux destinataires : « vous voudrez bien me communiquer les offres de postes disponibles, en mentionnant pour chacun d’eux toutes informations utiles soit l’intitulé, le statut, le coefficient, le descriptif du poste, les certifications et/ou diplômes requis, la durée mensuelle de travail et son organisation, les conditions de rémunération, le lieu de travail et la convention collective applicable ». Comme le souligne la rapporteure publique, « fait ainsi défaut tout effort réel de promotion des "candidats" au reclassement en l'absence de toute précision au sujet des personnes dont le reclassement est recherché, notamment au sujet de leur parcours et de leurs qualités ». Tant la Chambre sociale de la Cour de cassation [12] que le Conseil d'État [13] semblent considérer en pareille hypothèse que l'obligation de reclassement n'est pas remplie. Pourtant, la cour administrative d'appel s'écarte de cette ligne jurisprudentielle pour énoncer qu'il ne ressortait pas des réponses reçues des entreprises qu'elles « n'auraient pas été en mesure au regard des informations transmises, de procéder à une recherche de poste vacant correspondant à ceux des salariés licenciés ». C'est apporter peu de considération à l'exigence de sérieux de la recherche de reclassement. Si, dans l'arrêt ci-avant rapporté, rendu le 1er juin 2022 par le Conseil d'État, cette exigence n'est pas sévèrement encadrée, ce n'est qu'au regard des circonstances de l'espèce – et notamment la liquidation judiciaire. Or, nulle considération de cet ordre n'est invoquée par la cour administrative d'appel. N’est-ce pas alors la protection des salariés investis d’un mandat représentatif qui devrait l’emporter et conduire à renforcer l’exigence de sérieux dans la recherche de reclassements ?
Liquidation judiciaire – conversion – consultation de comité social et économique (CSE) – PSE – objet du contrôle de l'information-consultation (CE, 1e-4e ch. réunies, 27 décembre 2022, n° 452898 N° Lexbase : A4088848). Le 27 décembre 2022, le Conseil d’État s’est prononcé sur la question du contrôle de l’administration sur la régularité de la procédure d’information-consultation du CSE d’une entreprise placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, qui serait contrainte de mettre en place un PSE dans le cadre de la liquidation judiciaire. Pour valider ou homologuer un PSE, intervenant dans le cadre d’une liquidation, la DREETS doit-elle contrôler la seule procédure de consultation menée au cours de la phase liquidative ou également celle qui avait été engagée lors de la phase de redressement ? Lorsque la liquidation judiciaire d’une entreprise est prononcée après qu’elle a d’abord été placée en redressement judiciaire, l’administration doit procéder au contrôle au regard des informations transmises au CSE sur l’opération projetée et ses modalités d’application, ainsi que sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi, tels qu’ils résultent du placement de la société en liquidation judiciaire. En revanche, dès lors que l’opération projetée et ses modalités d’une part, le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi d’autre part, diffèrent nécessairement de ceux résultant du placement de la société en redressement judiciaire, il ne lui appartient pas de procéder au contrôle de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE conduite dans le cadre de la procédure collective antérieure au jugement ayant placé la société en liquidation judiciaire. Le Conseil d'État distingue donc nettement les deux phases de la procédure collective. Peu importe alors que les informations transmises au stade du redressement judiciaire aient été insuffisantes ou erronées concernant la situation économique et financière de la société. Il est également précisé que ni la circonstance que ne se soit tenue qu'une seule réunion du comité social et économique, ce qui, au demeurant, est en principe prévu par l'article L. 1233-58 du Code du travail N° Lexbase : L8650LGH en cas de liquidation judiciaire, ni celle que la base de données économiques et sociales n'a pas été renseignée, ni celle que les membres du comité social et économique aient reçu des informations complémentaires le jour même de la réunion, ni celle que l'administration a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi le jour même de sa réception ne sont de nature à entacher d'illégalité la décision d'homologation attaquée. Enfin, conformément à la jurisprudence antérieure [14], le Conseil d'État rappelle que les consultations du CSE sur les fondements des articles L. 2312-8 N° Lexbase : L6660L7S et L. 2312-53 N° Lexbase : L8286LGY du Code du travail et les articles du Code de commerce associés [15] ne relèvent pas du contrôle de l’administration : la méconnaissance de ces textes, qui imposent une consultation ou une audition des représentants du personnel dans les différentes phases de la procédure collective, ne peut être invoquée pour contester une décision d’homologation rendue par l’administration. Si la solution est respectueuse des textes, elle réduit drastiquement la portée de l’obligation d’information-consultation du CSE en niant la globalité de la procédure collective, la liquidation ne pouvant être analysée sans prendre en considération le redressement antérieur. Ce sont alors les voies de recours propres au droit des entreprises en difficulté qui pourront être exercées [16].
B. Transferts d’entreprise
Insolvabilité – transfert d'entreprise – procédure de pre-pack (CJUE, 28 avril 2022, aff. C-237/20 N° Lexbase : A66277UY, conclusion A.G. Giovanni Pitruzzella, 9 décembre 2021 ; H. Nasom-Tissandier, RJS, 8-9/22 ; D., 2022, act., p. 902 ; D., 2022, p. 1049, note R. Dammann et M. Gerrer). Par un arrêt du 28 avril 2022, la CJUE statue sur la compatibilité de la procédure de « pré-pack », qui résulte de l’application de la législation néerlandaise à la Directive n° 2001/23 dite « Transfert » N° Lexbase : L8084AUX [17]. L'article 5, § 1 de la Directive énonce que « sauf si les États membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas au transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement lorsque le cédant fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d'une autorité publique compétente ». L'interprétation de cette disposition et la délimitation du champ d'application de la dérogation font l'objet d'un contentieux important depuis 2017 dans l'hypothèse d'une procédure de pre-pack [18]. Une opération de pre-pack vise à préparer la cession d'une entreprise dans ses moindres détails afin de permettre le redémarrage rapide des unités viables de l'entreprise après le prononcé de la faillite, dans le souci d'éviter ainsi la rupture qui résulterait de la cessation brutale des activités de cette entreprise à la date du prononcé de la faillite, de manière à préserver la valeur de l'entreprise et l'emploi [19]. Le transfert de tout ou partie de l'entreprise est donc préparé, antérieurement à l'ouverture d'une procédure de faillite au cours de laquelle le transfert est réalisé. La Cour de justice s'est déjà prononcée à trois reprises [20] sur l'interprétation à retenir des trois conditions cumulatives nécessaires au bénéfice de la dérogation prévue par l'article 5, § 1 : le cédant doit faire l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue, ouverte aux fins de la liquidation des biens du cédant, et la procédure doit se trouver sous le contrôle d'une autorité publique compétente. La Cour de justice dans ce nouvel arrêt fait le choix d'une interprétation moins stricte de la directive en se fondant sur la jurisprudence antérieure et sur des « éléments factuels et procéduraux » nouveaux qui « s'opposent à une transposition dans l'affaire au principal de la réponse apportée par la Cour » dans l'arrêt Smallsteps. Dans la nouvelle affaire, lorsque la procédure de pre-pack a été engagée, l'insolvabilité du cédant était inévitable et « tant la procédure de faillite que la procédure de pre-pack l'ayant précédée visaient la liquidation des biens du cédant ». Par ailleurs, le transfert n'est intervenu qu'au cours de la procédure de faillite. La dérogation de l'article 5, § 1, « vise à écarter le risque sérieux d'une détérioration, au plan global, de la valeur de l'entreprise cédée ou des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre qui serait contraire aux objectifs du traité » (point 50). Peu importe alors que le transfert de l'entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ait été préparé avant l'ouverture d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant, « dès lors que cette disposition ne vise pas la période précédant l'ouverture des procédures de faillite ou d'insolvabilité concernées » (point 51). La Cour conclut alors que « lorsque l'objectif principal d'une procédure de pre-pack suivie d'une procédure de faillite consiste à obtenir, à la suite du constat d'insolvabilité du cédant et de sa liquidation, le remboursement le plus élevé possible pour l'ensemble de ses créanciers, ces procédures, prises ensemble, satisfont, en principe, à la deuxième condition posée à l'article 5, § 1 de la Directive n° 2001/23 ». Elle indique ensuite les points d'attention : vérifier, dans chaque situation, si la procédure de pre-pack et la procédure de faillite tendent à la liquidation en raison de l'insolvabilité du cédant et non à sa réorganisation ; établir que ces procédures ont pour objectif principal de désintéresser au mieux l'ensemble des créanciers, mais également que la mise en œuvre de la liquidation au moyen d'une cession de l'entreprise en exploitation ou d'une partie de celle-ci, telle que préparée dans la procédure de pre-pack et réalisée à la suite de la procédure de faillite, permet d'atteindre cet objectif principal.
Pour la troisième condition de l'article 5, § 1, relative aux pouvoirs de contrôle dont dispose l'autorité publique, l'interprétation est en opposition à celle de l'arrêt Smallsteps, car les circonstances sont différentes. Si l'accord organisant le transfert a été préparé durant la procédure de pre-pack, il n'a été conclu qu'après l'ouverture de la procédure de faillite, lorsque le curateur et le juge-commissaire disposaient de la plénitude de leur compétence. De plus, même durant la phase préparatoire, le curateur pressenti doit rendre compte de sa mission et peut voir sa responsabilité engagée dans les mêmes conditions que le curateur de la faillite. Enfin, « dès le prononcé de l'ouverture de la procédure de faillite, les curateurs et le juge-commissaire qui étaient chargés de suivre la procédure de faillite et ont été nommés par le tribunal à cette fin, disposaient de compétences légales en ce sens et étaient soumis aux mêmes exigences d'objectivité et d'indépendance que celles qui valent pour un curateur et un juge-commissaire désignés dans une faillite non précédée d'une procédure de pre-pack », aussi « la mise en œuvre d'une procédure de pre-pack, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, serait sans incidence sur le contrôle qui sera réalisé ultérieurement lors d'une procédure de faillite par une autorité publique compétente, à savoir par le curateur et le juge-commissaire de faillite ». Toutefois, la Cour insiste sur le fait que les dérogations à la directive transfert doivent être encadrées par des dispositions législatives ou règlementaires, ce qui n'était pas le cas en droit néerlandais.
Cette jurisprudence peut avoir un impact en droit français au regard de la deuxième condition, dans deux hypothèses : la « cession préétablie » au stade de la conciliation et la cession accompagnée de licenciements dans le cadre d'un redressement judiciaire. L'enjeu est la licéité des licenciements et le droit des salariés de réclamer la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire aux conditions antérieures. On peut penser que, dans la première hypothèse [21], lorsque la procédure prévoit des licenciements, elle est conforme au droit européen « si la cession est négociée avant l'ouverture de la procédure, mais qu'elle est réalisée après et que « ces procédures ont pour objectif principal de désintéresser au mieux l'ensemble des créanciers, mais également que la mise en œuvre de la liquidation au moyen d'une cession de l'entreprise en exploitation (going concern) ou d'une partie de celle-ci, telle que préparée dans la procédure de pre-pack et réalisée à la suite de la procédure de faillite, permet d'atteindre cet objectif principal » [22]. Dans la seconde hypothèse, certes l'article L. 1224-1 du Code du travail N° Lexbase : L0840H9Y est partiellement écarté lorsque le jugement arrêtant le plan de cession autorise des licenciements [23], mais la difficulté vient du fait que, selon l'article L. 631-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3683MBZ [24], la procédure de redressement a pour objectif premier la poursuite de l'activité et non l'apurement du passif. Il ne peut donc être soutenu que l'objectif principal demeure l'apurement du passif, en contrariété avec les exigences de la Cour de justice. Cette procédure demeure donc fragile au regard du droit européen [25].
C. Contrôle – Contentieux
Liquidation judiciaire – cession de gré à gré – transfert d'entreprise – salarié protégé – compétence du juge judiciaire (oui) (Cass. soc., 21 avril 2022, n° 20-17.496, FS-B, 1er moyen, 2nde branche N° Lexbase : A15707UP ; n° 20-17.498, FS-D N° Lexbase : A48117UQ ; n° 20-17.468, FS-D N° Lexbase : A48117UQ ; n° 19-22.327, FS-D N° Lexbase : A47527UK). Par quatre arrêts rendus le 22 avril 2022, dont l'un a été publié au bulletin, la Cour de cassation se prononce sur le droit d'un salarié protégé de contester son licenciement, autorisé par le juge-commissaire, devant le juge judiciaire lorsque par la suite l'entité économique autonome à laquelle était rattaché le salarié est transférée à un repreneur. Dans l'affaire n° 22-17.496, la société employeur a été placée en liquidation judiciaire le 1er juin 2015 avec maintien de l'activité jusqu’au 5 juin. Le 18 juin, la Direccte a validé le plan de sauvegarde de l'emploi. Un salarié protégé est inclus dans le licenciement économique de l'ensemble des salariés, après autorisation de l'inspecteur du travail. Le 19 août, une ordonnance du juge-commissaire autorise la reprise du site industriel de la société liquidée. Cette reprise du site industriel se fait le 2 mai 2016 par une vente de gré à gré [26] du fonds de commerce, de la clientèle, des stocks, des équipements, du parc machines, des actifs intellectuels et des bases de données. Le salarié protégé a alors demandé, sans succès, sa réembauche auprès de la société repreneuse de l'actif. Il a donc saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire le licenciement dépourvu d'effet en vertu de l'article L 1224-1 du Code du travail N° Lexbase : L0840H9Y et obtenir l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive. La Cour d'appel de Nancy a fait droit à sa demande. Le pourvoi invoque le principe de séparation des pouvoirs pour contester la compétence du juge judiciaire dès lors que le licenciement est intervenu en vertu d'une autorisation administrative définitive et que le salarié avait eu connaissance de la cession des actifs dans le délai de recours contre l'autorisation de licenciement.
En principe, la cession d'éléments d'actifs par une vente de gré à gré entraine l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail [27]. La Cour de cassation confirme cette jurisprudence dans le cas particulier du salarié protégé licencié avant la cession des actifs : « En l'absence de toute cession d'éléments d'actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier si la cession ultérieure d'éléments d'actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l'article L. 1224-1 du Code du travail, et rendant sans effet le licenciement prononcé, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ». Ainsi, si la vente de gré à gré remplit les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le licenciement est sans effet et le principe de séparation des pouvoirs ne peut être opposé à la compétence du conseil de prud'hommes. Celui-ci pourra se prononcer sur le non-respect du principe du transfert des contrats de travail par l'effet de la cession d'une entité économique autonome, intervenue après la notification du licenciement autorisé par l'inspecteur du travail et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité solidaire du cédant et du cessionnaire dans le cadre de la même opération. Protectrice des droits des travailleurs, cette solution doit être approuvée, car elle permet de lutter contre la pratique d'une cession tardive faisant obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail qui est d'ordre public. Seule une contestation portant sur la régularité de la procédure de licenciement, la recherche d'un repreneur et le bien-fondé de la décision rendue par l'inspecteur du travail devenue définitive serait irrecevable. La Cour de cassation rappelle utilement la différence entre la contestation du licenciement autorisé par l'inspecteur du travail, et celle de la mise en cause des effets de ce licenciement en raison du transfert de l'entité économique autonome. Cette décision permet également de mettre en lumière la dualité des procédures de cession des éléments d'actifs. Lorsque celle-ci intervient dans le cadre de l'exécution d'un plan de cession selon la procédure organisée par les articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, prévoyant un plan arrêté par le tribunal autorisant concomitamment des licenciements – y compris ceux de salariés protégés autorisés par l'inspecteur du travail-, le juge judiciaire ne peut être saisi. La procédure organisée par les articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce N° Lexbase : L4555I4H constitue donc une dérogation à l'article L. 1224-1 du Code du travail. Elle présente l'avantage pour l’entreprise d'éviter une application a posteriori de ce texte par le juge judiciaire, sauf en cas de fraude. En revanche, il n’en va pas de même pour une cession de gré à gré. Il est donc parfaitement justifié de préserver la compétence du conseil de prud’hommes, de considérer que cette cession peut constituer un transfert au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail et d’appliquer le droit commun du travail.
Liquidation judiciaire – cessation d'activité – faute de l'employeur – fraude – licenciement sans cause réelle et sérieuse – compétence du juge judiciaire (oui) (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-23.639, F-D N° Lexbase : A063579E). Dans un arrêt rendu le 29 juin 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation, visant le principe de séparation des pouvoirs, affirme qu'il n’appartient pas à l’inspecteur du travail, dans le cadre d’une procédure d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, ou plus tard aux tribunaux administratifs, de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute de l’employeur. Par conséquent, l’autorisation de licenciement n’empêche pas le salarié de mettre en cause devant le juge judiciaire la responsabilité de son ancien employeur et de demander réparation des préjudices causés par la faute de ce dernier à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte pour le salarié de son emploi. Cette décision est dans le droit fil de la jurisprudence antérieure. Le Conseil d'État [28] a jugé que, « lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, [...], que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive ». Il a également précisé la mission de l'inspecteur du travail dans une telle hypothèse, en affirmant que, « lorsque la demande [d'autorisation de licenciement] est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, [...] il ne lui appartient pas, [...] de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur » [29]. Soulignons qu’il est étonnant que le juge administratif ne contrôle pas le l’existence d’une faute ou d’une légèreté blâmable à l’origine de la cessation des paiements, alors qu’en cas de licenciement justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité, il admet que « faute de menace pesant sur cette compétitivité, le licenciement d’un salarié protégé n’est pas justifié [30]. La Cour de cassation s’est inscrite dans le sillage de cette solution de principe. Elle a déjà énoncé la solution commentée dans un arrêt rendu le 25 novembre 2020 [31] qui concernait une entreprise placée en liquidation judiciaire, comme en l'espèce.
La décision présente un intérêt particulier en ce la salariée invoquait une faute de l'employeur s'analysant en un comportement frauduleux qui serait à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise. Il semblerait en effet, qu’alors que le chiffre d’affaires était en progression, des sommes importantes ont disparu des comptes de la société, un chèque d’un montant correspondant aux sommes manquantes a été encaissé par une autre société dont le gérant (par ailleurs mis en faillite personnelle) était le même que celui de la société liquidée et que d’autres agissements frauduleux par le passé dans d’autres sociétés lui avaient été reprochés. De plus, un déstockage massif ayant affecté la société a également été à l’origine de sa mise en liquidation judiciaire. Cependant, la cour d’appel avait rejeté cette demande, notamment au motif que l’autorité administrative était seule compétente pour apprécier le bien-fondé de ce moyen et qu’aucun recours devant la juridiction administrative n’avait été entrepris [32]. Cette décision était en opposition avec la jurisprudence du Conseil d’État. Aussi est-il bienvenu que la Cour de cassation exige du juge judiciaire qu’il contrôle la faute à l’origine de la cessation des paiements. En pareille hypothèse de cessation d’activité résultant d’un comportement frauduleux, l’employeur a pu obtenir l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et l’autorisation administrative de licencier un salarié protégé parce qu’à aucun moment la fraude n’a été prise en compte. Cette stratégie trouve toutefois une limite puisque le juge judiciaire pourra apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement en cas de faute à l’origine de la cessation des paiements. Il n’en demeure pas moins que la société est liquidée, et que c’est l’AGS qui devra supporter le poids des créances salariales, sans espoir de remboursement. Peut-on s’en satisfaire ?
Liquidation judiciaire – responsabilité du liquidateur – garantie personnelle – créances salariales – compétence du conseil de prud'hommes (non) – compétence du tribunal judiciaire (oui) (Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 19-19.313, FS-B N° Lexbase : A76957IT, note C. Couëdel, D. act., 8 février 2022). Les mandataires de justice sont susceptibles d’engager leur responsabilité civile professionnelle, notamment lorsqu’il est fait état de fautes et négligences commises dans l’exécution du mandat. Un salarié peut ainsi engager cette responsabilité lorsqu'il n'a pas été licencié dans le délai lui permettant de bénéficier de la garantie de ses créances salariales par l'AGS. La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si la juridiction prud'homale peut statuer sur cette demande lorsqu'elle est formulée à titre accessoire d’une demande principale de fixation de salaires. En l'espèce, la société employeur a été placée en liquidation judiciaire le 24 juin 2015 et une salariée a été licenciée pour motif économique le 20 novembre 2015 par le liquidateur judiciaire. Elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la fixation de ses créances de salaire sur le relevé des créances de la société liquidée et a fait assigner le liquidateur en garantie personnelle du paiement de ces sommes, invoquant la faute de ce dernier en ce qu'il avait omis de la licencier pendant les périodes ouvrant droit à la garantie de l'AGS. La cour d'appel avait accueilli cette demande en retenant que l'article R. 662-3 du Code de commerce N° Lexbase : L4178LTW donne compétence au tribunal de grande instance pour statuer sur la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur, mais qu'il ne s'agit pas d'une compétence exclusive puisque ce domaine de compétence ne relève pas des matières prévues par l'article R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L0740L7K qui définit le champ de compétence exclusive de ce tribunal. Elle a donc considéré avoir compétence pour statuer sur la demande accessoire relative à la responsabilité personnelle du liquidateur. Par l'arrêt de cassation rendu, la Cour de cassation rappelle la règle de répartition des compétences entre le conseil de prud'hommes et le tribunal judiciaire dans le contentieux lié à la garantie des créances salariales. Selon l'article R. 662-3 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire). Selon l'article 51 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5777LT7, ce tribunal connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution. Enfin, selon l'article L. 625-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3315ICR, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. La Cour de cassation en déduit fort logiquement que « la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales, au passif de la liquidation ». Le salarié est alors tenu d'engager deux actions : l'une auprès du conseil de prud'hommes pour faire reconnaitre sa créance salariale, l'autre auprès du tribunal judiciaire pour mettre en cause la responsabilité personnelle du liquidateur. Cela rend l'action en justice complexe pour un salarié qui n'a pas toujours les compétences, les moyens et le temps d'affronter ainsi deux procédures alors que le droit des procédures collectives tend au contraire à simplifier les recours des salariés. Elle est toutefois conforme à la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation [33] et ne pourrait être modifiée que par une intervention du législateur, souhaitable.
Liquidation judiciaire – salarié protégé – cession d'entreprise – transfert d'entreprise – fraude – compétence du juge judiciaire (oui) (Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-11.776, n° 21-11.777 et n° 21-11.781, FS-B N° Lexbase : A10728UA). Des salariés, investis d'un mandat représentatif du personnel, ont vu leurs contrats de travail transférés à un autre employeur après autorisation de l'inspecteur du travail. La liquidation judiciaire du cessionnaire a été prononcée peu après, le liquidateur procédant dès le mois suivant au licenciement économique des salariés protégés, après autorisation de l'inspecteur du travail. Ces salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à dire que le transfert de leur contrat de travail avait été frauduleusement mis en œuvre, dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner le cédant au paiement de dommages-intérêts. Le juge judiciaire était-il compétent ? Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de changement d'employeur qui concerne un salarié investi d'un mandat protecteur, en cas de transfert partiel de l'entreprise qui l'emploie, l'administration contrôle les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail, l'application éventuelle des dispositions légales ou conventionnelles invoquées dans la demande d'autorisation de transfert, le rattachement de l'intéressé à la partie de l'entreprise cédée et l'absence de tout lien avec le mandat [34]. Par conséquent, l'inspecteur du travail ne porte pas d'appréciation sur l'origine de l'opération de transfert. Aussi est-ce fort logiquement que la Cour de cassation reconnait que « le salarié protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l'autorité administrative, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le transfert, l'existence d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail et solliciter sur ce fondement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé le transfert, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ». En l'espèce, la cour d'appel relève que « la cession n'offrait pas de perspective réaliste » et affirme que « le seul but de la cession sans avenir est d’éluder les règles relatives au licenciement, de sorte que la cession et les transferts des contrats de travail ont été effectués en fraude aux droits des salariés, lesquels sont dès lors bien fondés en leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à l’encontre de la société cédante ». Elle en déduit l’existence d’une fraude à l’article L. 1224-1 du Code du travail en l’absence de transfert d’une unité économique autonome. Cette décision illustre une forme d'instrumentalisation du droit des procédures collectives, organisée en deux temps : d'abord, un transfert frauduleux, car opéré pour contourner les règles protectrices du droit du licenciement économique et du statut protecteur des salariés investis d'un mandat, ensuite une cessation des paiements du cessionnaire entrainant sa liquidation et, par voie de conséquence des licenciements économiques – et une prise en charge des créances salariales par l'AGS. En consacrant la compétence du juge judiciaire pour connaitre de cette fraude, la Cour de cassation permet de déjouer ces stratégies afin que les salariés puissent invoquer une violation de l'article L. 1224-1 du Code du travail [35]. Dès lors que le contrôle de l'administration ne porte pas sur l'origine du transfert, le principe de séparation des pouvoirs est respecté. Dans le même sens, la Cour de cassation admet que la validation administrative d'un PSE n'interdit pas aux salariés licenciés par la suite d'invoquer une violation de l'article L 1224-1 du Code du travail pour contester la rupture de leurs contrats, parce que le contrôle administratif ne porte pas sur ce point [36].
II. Créances salariales et autres indemnités
A. Garantie des créances salariales et assurances garanties des salaires (AGS)
AGS – bénéficiaires – non-exclusion automatique des mandataires sociaux (CJUE, 5 mai 2022, aff. C-101/21 N° Lexbase : A11707WA, HJ c./ Ministerstvo práce a sociálních věcí ; H. Nasom-Tissandier, RJS, 8-9/22). La possibilité de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social est une question ancienne et bien connue, mais qui connaît un regain d'intérêt lorsqu'elle ressurgit à l'occasion d'un contentieux relatif à la garantie des créances salariales. L'arrêt de la Cour de justice rendu le 5 mai 2022 est l'occasion d'en rappeler les termes, mais également de tracer des lignes d'interprétation de la Directive n° 2008/94 N° Lexbase : L6970IBR lorsqu'elle s'applique à des salariés mandataires sociaux. Selon la Cour de justice, il est « contraire à ladite finalité sociale de priver des personnes, auxquelles la réglementation nationale reconnaît généralement la qualité de travailleurs salariés et qui disposent, en vertu de cette réglementation, de créances salariales résultant de contrats de travail ou de relations de travail à l'égard de leur employeur, visées à l'article 1, § 1, et à l'article 3, alinéa 1er de cette Directive, de la protection que ladite directive prévoit en cas d'insolvabilité de l'employeur ». Le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social ne peut à lui seul exclure la qualité de salarié et donc la garantie des créances salariales en cas d'insolvabilité, aucune présomption en ce sens ne peut être posée par le législateur ou la jurisprudence. Interrogée sur la possibilité d'abus, la Cour les définit comme « les pratiques abusives portant préjudice aux institutions de garantie en créant artificiellement une créance salariale et en déclenchant ainsi, illégalement, une obligation de paiement à charge de ces institutions ». La législation nationale en cause avait posé une présomption d'abus excluant la garantie : dès lors qu'une personne peut cumuler les fonctions de directeur et de membre du conseil d'administration d'une société commerciale, elle est « susceptible d'être en partie responsable de l’insolvabilité ». Selon la Cour, une telle présomption irréfragable et « générale d'existence d'un abus, insusceptible d'être renversée eu regard de l'ensemble des éléments caractéristiques de chaque cas particulier, ne saurait être admise ». La Cour de justice ajoute enfin que l'article 12, sous c), de la directive ne permet pas non plus de justifier l'exclusion, car ses conditions ne sont pas remplies. S'il autorise les États membres à refuser ou à réduire l'obligation de paiement ou de garantie lorsque le travailleur « exerçait une influence considérable sur ses activités » - ce qui est le cas du salarié occupant la fonction de direction, ce n'est qu'à la condition qu'il possède, « seul ou conjointement avec ses parents proches, une partie essentielle de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ». Le droit français ne pose pas de telles présomptions. On peut mentionner une jurisprudence abondante de la Cour de cassation qui témoigne d'une stratégie judiciaire de l'AGS pour exclure de sa garantie les travailleurs mandataires sociaux au motif de l'existence d'un contrat de travail apparent et de la fictivité du contrat de travail. Toutefois, dès qu'il existe une apparence de contrat de travail, c'est aux organes de la procédure et à l'AGS de supporter la charge de la preuve pour renverser la présomption de salariat [37]. Il convient, dans chaque cas d'espèce, de vérifier si les conditions du cumul sont réunies : ne pas conclure un contrat de travail dans le but de frauder à la loi, exercer des fonctions distinctes de son mandat social dans le cadre d'un contrat de travail, percevoir une rémunération distincte au titre de ce contrat de travail, être dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de son employeur [38]. Il faut donc, dans chaque cas d'espèce, prouver la fictivité du contrat de travail pour exclure la garantie des créances salariales.
AGS – intervention subsidiaire – justification de l'insuffisance des fonds – refus de payer (CA Toulouse, 9 septembre 2022, n° 22/01754 N° Lexbase : A47048UR ; CA Paris, 13 octobre 2022, n° 21/08986 N° Lexbase : A90778PU ; CA Limoges, 14 juin 2022, n° 21/01968 ; CA Poitiers, 14 juin 2022, n° 21/01968, cité par K. Burguet et F. Morel, L’intervention de l’AGS en garantie des salaires est subsidiaire et doit le rester, FRS, 18/22, n° 7 ; CA Metz, 21 juin 2022, n° 20/01915 N° Lexbase : A398178X ; CA Douai, 24 juin 2022, n° 20/01984 N° Lexbase : A71938DR). Le nombre d'arrêts rendus par les cours d'appel en un laps de temps très court montre que la question posée est importante et devrait rapidement entrainer une réponse de la Cour de cassation, saisie de plusieurs pourvois. La subsidiarité de l’intervention de l’AGS dans le paiement des créances salariales en redressement et en liquidation judiciaires fait l’objet d’un contentieux fourni lié au refus opposé par l’AGS d’avancer les fonds lorsqu’elle estime que le mandataire judiciaire détient les fonds suffisants pour payer ces créances, notamment en raison d'une cession d'actifs. L’article L. 3253-20 du Code du travail N° Lexbase : L5778IAA dispose en son 1er alinéa que : « si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19 N° Lexbase : L1000H9W, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 N° Lexbase : L5777IA9 ». La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT a introduit un second alinéa à l’article L. 3253-20 du Code du travail au terme duquel : « dans le cas d’une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée ». Dès lors, se pose la question de savoir si ce n'est que dans l'hypothèse où l’entreprise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde que s'impose l'exigence de justification de l’insuffisance des fonds disponibles par le mandataire – cette insuffisance étant alors présumée en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pourtant, depuis près de deux ans, l'AGS tente d'étendre cette exigence au redressement et à la liquidation judiciaire, créant une opposition entre cours d'appel quant à l'interprétation à retenir du texte. Plusieurs juridictions ont rendu des décisions rejetant les arguments développés par l'AGS pour refuser d'avancer aux salariés le paiement de leurs créances lorsque l'employeur n'est pas absolument exsangue. D'autres y ont fait droit. Les faits de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 9 septembre 2022 (n°22/01754) sont éclairants. Un plan de cession est arrêté par le tribunal de commerce de Toulouse, avec autorisation d'un certain nombre de licenciements. Le mandataire judiciaire, indiquant qu’il ne disposait des fonds nécessaires, a établi un relevé des créances salariales et a sollicité l’AGS. Cette dernière a refusé la prise en charge du relevé estimant que le prix de cession couvrait largement le montant du relevé. Le mandataire judiciaire n’avait d’autre choix que de saisir la juridiction compétente qui rejeta sa demande. C’est dans ces conditions que la cour d’appel infirma la décision déférée et fit injonction à l’AGS de payer entre les mains du mandataire judiciaire les sommes objets du relevé de créances. La cour d’appel de Toulouse rappelle que l’application du principe de subsidiarité ne confère pas à l’AGS de droit de contrôler les fonds disponibles, en s'appuyant sur la distinction opérée par les deux alinéas de l’article L. 3253-20 du Code du travail : « en matière de sauvegarde, le mandataire doit a priori justifier de l’insuffisance des fonds, et la réalité de cette insuffisance peut être contestée par l’AGS devant le juge-commissaire. En revanche, en matière de redressement et de liquidation judiciaires, l’insuffisance des fonds est présumée, de sorte que son appréciation est confiée à la seule appréciation du mandataire, afin de ne pas retarder le versement des sommes dues aux salariés ». La même interprétation a été retenue par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 octobre 2022 (n° 21/08986) et par la cour d’appel de Poitiers dans un arrêt en date du 14 juin 2022 (n° 21/01968). Elles ont retenu l’existence d’une présomption d’absence de fonds disponibles : « en application des dispositions du premier alinéa il n’appartient pas au mandataire judiciaire de justifier l’absence de fonds disponibles, celui-ci bénéficiant d’une présomption d’absence de fonds disponibles qui découle d’une part de l’état de cessation des paiements qui entraine l’ouverture de la procédure collective et d’autre part du mandat qui est confié par le tribunal aux organes de la procédure collective qui seuls peuvent conclure à cette indisponibilité en prenant en compte la situation de l’entreprise dans sa globalité. En l’absence de tout dispositif prévu par le texte permettant la remise en cause de cette présomption dans le cas d’une demande d’avance effectuée dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, l’AGS est mal fondée, à ce stade de la procédure de demande d’avance de fonds, à remettre en question la présomption d’absence de fonds disponibles » [39]. En revanche, la cour d'appel de Dijon [40], la cour d'appel de Pau [41], la cour d'appel de Metz [42] et celle de Douai [43] ont retenu une interprétation contraire en vertu de laquelle « la créance retenue tant par le conseil que par la cour étant de nature salariale, la délégation AGS devra garantir le paiement de cette somme dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, à défaut de paiement par le liquidateur, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement » [44].
Les juges du fond semblent majoritairement converger vers cette interprétation. Est-elle pour autant justifiée ? Elle s'appuie sur deux textes : l’article L. 625-4 du Code de commerce N° Lexbase : L3302ICB qui permet à l'AGS de régler une créance figurant sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail et l'article L. 3253-20 du Code du travail. Toutefois, plusieurs arguments s'y opposent. Contrairement à ce qui a pu être soutenu, la question à trancher ne concerne pas le principe de subsidiarité de l'intervention de l'AGS, qui n'est pas remis en cause. Il s'agit de déterminer qui, de l'AGS ou du mandataire judiciaire, doit apprécier l'insuffisance des fonds et, s'il s'agit de l'AGS, si le contrôle doit être opéré a priori (ce qui peut implique une possibilité pour l'AGS de demander la communication de documents justificatifs au mandataire et la conduire à refuser l'avance des fonds) ou a posteriori (après avance des fonds, quitte ensuite pour l'AGS à en demander le remboursement à la société in bonis). Il faut d'abord invoquer l'esprit de la loi. La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 N° Lexbase : L6622AGD a prévu que « tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ». Il s'agissait, selon les débats parlementaires, de « fonder la garantie absolue du paiement des créances salariales…le paiement des créances salariales n’étant plus lié à la valeur de l’actif de la liquidation des biens et non plus subordonné aux lenteurs de ces procédures ». Il faut ajouter que la prise en charge des créances salariales facilite le redressement de l'entreprise, qui pourrait être compromis si l'interprétation favorable à l'AGS était retenue. Une interprétation protectrice des salariés serait respectueuse de l'esprit de la loi. En revanche, l'AGS doit, en présence de fonds disponibles, se voir rembourser l’avance des créances salariales selon un rang définie par la loi -elle a droit à un remboursement, ce qui n'implique pas le droit à un refus de paiement. Il faut ensuite s'en tenir à la lettre des différents textes. Si le législateur a introduit un second alinéa à l’article L. 3253-20 du Code du travail relatif à la procédure de sauvegarde, c'est parce qu'en ce cas l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements – alors qu'en redressement ou liquidation judiciaire cet état est reconnu judiciairement, ce qui implique une présomption d'absence de fonds disponibles. Cette distinction doit être respectée. Cette présomption supporte la preuve contraire, mais par une action a posteriori. Si l'article L. 625-4 du Code de commerce évoque le refus de l'AGS de prendre en charge une créance salariale, ce droit de contestation « pour quelque cause que ce soit » ne concerne que les conditions de la garantie et non pas son mécanisme : il ne saurait en être déduit un droit de l'AGS à contester l'indisponibilité des fonds – qui n'est prévu à aucun moment de la procédure [45] et nécessiterait une modification législative. Surtout, la Directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002 N° Lexbase : L9629A4E concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur ne prévoit pas la possibilité d'un contrôle préalable de l'indisponibilité des fonds ; une question préjudicielle pourrait être utilement posée sur ce point. Si la solution venait à être adoptée, elle pourrait être vue comme une sérieuse défiance à l'égard des mandataires et administrateurs judiciaires. Enfin, de manière pragmatique, il est difficile d'accepter l'argument lié à la soutenabilité financière de l'AGS, qui serait compromise, lorsque l'on constate que le taux de cotisation demeure bas depuis 2017 (0,15 % des salaires servant de base au calcul des cotisations d'assurance chômage). Or, l’AGS Le corollaire du principe d'une intervention subsidiaire n'est donc pas le contrôle a priori de l'AGS. Notons, pour conclure, que la Cour de cassation considère que l'AGS ne peut être mise hors de cause au motif que la société, après redressement consécutif au plan adopté par le tribunal de commerce, est redevenue in bonis [46]. La Cour de cassation devra trancher, mais cette décision semble peser en faveur d’une interprétation défavorable à l’argumentation de l’AGS. Retenir l'absence de contrôle a priori de l'AGS entrainera peut-être un contentieux nouveau relatif à la mise en cause éventuelle de la responsabilité de mandataire qui aurait, à tort, estimé les fonds indisponibles [47]. Mais l'intérêt des salariés, créanciers protégés, sera préservé et avec lui, la finalité sociale du droit français et de la directive européenne.
AGS – requalification contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) – droit propre à contester sa garantie (Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-16.221, F-D N° Lexbase : A94468UE). Un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) employé par une entreprise en liquidation judiciaire se voit notifier la rupture anticipée de son contrat de travail. Il saisit le conseil de prud'hommes pour obtenir la fixation au passif de son employeur d'un rappel d'indemnités de logement, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD. Les juges du fond le déboutent de sa demande et requalifient le CDD en contrat à durée déterminée (CDI) en raison de la transmission tardive du CDD assimilée à un défaut d'écrit, lui accordent diverses indemnités fixées au passif de la liquidation judiciaire et énoncent que l'AGS sera tenue de garantir les dommages-intérêts alloués au titre de la requalification du contrat. Le pourvoi rappelle, notamment que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification du CDD en CDI. Cette solution résulte en effet d'une jurisprudence constante [48]. L'argument n'emporte cependant pas la conviction de la Cour de cassation qui se contente de constater la violation des articles L. 1242-13 N° Lexbase : L1447H9H et L. 1245-1 N° Lexbase : L7327LHT du Code du travail dans la rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN. Il est vrai que cet argument suffisait amplement à justifier la cassation : seul le salarié peut demander la requalification, ce qu’il n’avait pas fait en l’espèce – le juge ne pouvait alors pas la prononcer d’office [49].
AGS – créances garanties – liquidation judiciaire – créance née de la rupture du contrat – exigibilité de la créance – résiliation judiciaire (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-11.167, F-D N° Lexbase : A728577X ; Cass. soc., 1er juin 2022, n° 21-11.604, F-D N° Lexbase : A830374B). Après le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu le 26 janvier 2017, procédure ensuite convertie en liquidation judiciaire de la société employeur, un salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cour d'appel accueille la demande et fixe au 4 mai 2018 la résiliation du contrat, inscrit au passif de la société diverses créances de salaire et d'indemnités de préavis, de rupture et dit que l'AGS garantira, si la trésorerie de la société est défaillante, le règlement des sommes dans la limite des plafonds applicables. Pour imposer cette garantie, elle considère que l'AGS doit avancer ces sommes (rappels de salaires, indemnités de congés payés…) qui résultent de l'exécution du contrat de travail et étaient dues avant l'ouverture de la procédure collective. Il résulte toutefois de l'article L. 3253-8 du Code du travail N° Lexbase : L7959LGU qu'à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire, à l'initiative du liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. Il en découle nécessairement que, d'une part, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement naissent de la rupture du contrat de travail et d'autre part que celui-ci n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, de sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due au titre des indemnités allouées au salarié à la suite de la rupture de son contrat. Peu importe alors que la résiliation soit justifiée par l'inexécution contractuelle grave de l'employeur, antérieure au jugement d’ouverture de la procédure. Seule compte la date de la rupture du contrat de travail qui doit intervenir dans le délai précité de quinze jours. La solution est respectueuse de la loi, mais sévère pour le salarié qui ne pourra obtenir la garantie de l'AGS et devra espérer que sa créance, inscrite au passif de l’entreprise, sera désintéressée. En l’espèce, plusieurs années se sont écoulées depuis la liquidation de l’entreprise. Lorsque la procédure contentieuse est longue, il est très douteux que le salarié, certes créancier superprivilégié, obtienne le paiement de ses créances. Une réforme pourrait utilement prévoir que les délais de l’article L. 3253-8 du Code du travail ne concernent que les licenciements autorisés dans le cadre de la procédure collective. Les indemnités liées à la résiliation seraient alors des créances fixées par décision de justice, garanties par l’AGS.
AGS – créances garanties – liquidation judiciaire – créance née de la rupture du contrat – exigibilité de la créance – indemnité de travail dissimulé (Cass. soc., 1er juin 2022, n° 21-11.604, F-D N° Lexbase : A830374B). Cette même sévérité résultant du strict respect de la loi est observée dans une autre décision. L'AGS contestait devoir garantir une indemnité pour travail dissimulé. La Cour de cassation, au visa des articles L. 3253-8 N° Lexbase : L7959LGU et L. 8223-1 N° Lexbase : L7803I3E du Code du travail énonce que « l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du Code du travail N° Lexbase : L7803I3E, qui n'est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture. L'AGS n'en garantit le paiement, en application de l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail, que si la rupture intervient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement ». L'indemnité de travail dissimulé ne concerne donc pas la période d'exécution du contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture, mais naît de la rupture du contrat. Elle n'est alors garantie que si celle-ci intervient dans les limites temporelles fixées par la loi.
AGS – créances antérieures au jugement d'ouverture – société in bonis (Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 20-15.895, F-D N° Lexbase : A07658MB). L'AGS peut-elle être mise hors de cause au motif que la société, après redressement consécutif au plan adopté par le tribunal de commerce, est redevenue in bonis lorsque le conseil de prud'hommes condamne la société employeur au paiement de rappels de salaire, de congés payés afférents, de primes de 13ème mois ? De la combinaison des articles L. 625-3 du Code de commerce N° Lexbase : L3458IC3 [50] et de l'article L. 3253-8, alinéa 1, 1° du Code du travail [51] il ressort qu'il importe peu que la société ait pu être redressée. Certes, la garantie de l'AGS n'est due que si la société employeur n'a pas les fonds disponibles pour faire face aux créances salariales. Toutefois, c'est à la date du jugement d'ouverture qu'il faut se placer pour déterminer si la créance est garantie, peu important que le montant n'ait été fixé par la juridiction prud'homale qu'ultérieurement. Dès lors que les créances concernaient des rappels de salaires et de primes dus à la date de l'ouverture de la procédure collective, ces sommes restaient soumises au régime de la procédure collective et l'AGS ne pouvait être mise hors de cause.
AGS – contrat d’apprentissage – liquidation judiciaire – créances salariales – créance établie par décision de justice exécutoire – clôture de la procédure de liquidation – C. trav., art. L. 3253-15 N° Lexbase : L5780IAC (Cass. soc. 16 mars 2022, n° 19-20.658, FP-B, 2ème moyen N° Lexbase : A63827QG ; H. Nasom-Tissandier, La persistance de la garantie de l'AGS au-delà de la clôture de la procédure collective, Lexbase Social, 14 avril 2022, n° 902 N° Lexbase : N1115BZC). Sur le fondement des articles L. 625-1, alinéa 2 N° Lexbase : L3315ICR et L. 625-6 N° Lexbase : L4097HBD du Code de commerce et des articles L. 3253-8, 1° N° Lexbase : L7959LGU et L. 3253-15 N° Lexbase : L5780IAC du Code du travail, l'AGS doit garantir les sommes dues au salarié, sommes portées sur le relevé complémentaire établi à la suite de la décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire. Le raisonnement des juges d'appel conduisant à exclure de la garantie AGS les sommes dues à l'apprenti en raison de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est censuré. La clôture de la procédure collective ne met pas fin à la garantie des créances salariales, dès lors que le salarié a exercé son recours dans les délais légaux – peu important d’ailleurs que l’action du salarié ait été exercée antérieurement ou postérieurement à cette clôture [52]. La Cour de cassation combine quatre textes. En application de l’article L. 625-1, alinéa 2 du Code de commerce, le salarié dont la créance, née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne figure pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes qui doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de la procédure collective. Selon l’article L. 625-6 du même code N° Lexbase : L4097HBD, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud’homales, sont portés sur l’état des créances déposé au greffe. Ces deux textes reflètent la particularité du traitement des créances salariales lors d’une procédure collective : sont en principe garantis par l’AGS les sommes figurant sur l’état des créances qui résultent soit du relevé des créances établi par les organes de la procédure, soit d’une décision de justice. Selon l’article L. 3253-8, 1°, l’AGS couvre les créances « antérieures », c’est-à-dire les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce visa signifie que, selon la Cour de cassation, les sommes dues à l’apprenti devaient être qualifiées de créances antérieures à l’ouverture de la procédure, même si la décision de justice en matière sociale n’intervient que postérieurement à celle-ci. Aux termes de l’article L. 3253-15, l’AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l’AGS, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés. Le législateur a donc d’ores et déjà prévu l’hypothèse d’une créance établie par une décision de justice rendue après la fin des missions des organes de la procédure et donc en cas de clôture de la procédure (ou d'adoption du plan). C’est alors le greffier du tribunal de la procédure collective qui se substitue aux organes de la procédure pour établir un relevé complémentaire de créances qui sera transmis à l’AGS. La conclusion de la Cour de cassation est dès lors fort logique : « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d’une décision de la juridiction prud’homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire ». Deux conséquences peuvent être évoquées [53]. La clôture de la procédure risque de rendre difficile voire impossible - notamment en cas de liquidation judiciaire – toute recherche de recouvrement par l'AGS, subrogées dans les droits du salarié, des créances résultant de décisions de justice exécutoires postérieures à la clôture. La seconde concerne la prescription des actions en justice, car l’extension dans le temps de la garantie de l’AGS dépend de l’action prud’homale opérée. Or, les délais de prescription ont été raccourcis au fil des réformes, aussi le risque est-il désormais moindre[54] pour l’institution de devoir couvrir des créances pour lesquelles aucun remboursement des avances n’est envisageable.
AGS – procédure de sauvegarde – créances garanties – rupture du contrat – limite temporelle – C. trav., art. L. 3253-8 N° Lexbase : L7959LGU (Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-19.961, FS-B, 1ère branche du moyen N° Lexbase : A10588UQ). La décision rendue est d'abord l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler que « le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié, peu important que la rétractation ait été faite à la demande de l'inspecteur du travail d'annuler la procédure de licenciement engagée et de respecter le statut protecteur. Il en résulte que le juge judiciaire, quand bien même le licenciement ultérieur du salarié a fait l'objet d'une autorisation administrative, demeure compétent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement ». Cependant, la société ayant, dans l'intervalle, été placée en procédure de sauvegarde, l'AGS est-elle tenue de garantir certaines sommes, à titre d'indemnité en réparation intégrale du préjudice résultant du licenciement nul et pour violation du statut de salarié protégé, fixées au passif de la société employeur par la cour d'appel et déclarées opposables à l'AGS ? L'arrêt d'appel est cassé pour défaut de réponse aux conclusions. Au-delà de la violation de l'article 455 du Code procédure civile N° Lexbase : L6565H7B, il est évident que la cour d'appel ne pouvait se contenter de déclarer le jugement opposable à l'AGS. En effet, en procédure de sauvegarde, la garantie des créances salariales est limitée : seules sont garanties les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde[55]. Les créances antérieures au jugement d'ouverture ne sont donc pas garanties. En l'espèce, la rupture du contrat a eu lieu en 2010 tandis que la procédure de sauvegarde a été ouverte par un jugement du 18 octobre 2017. Les sommes considérées sont qualifiées de créances résultant de la rupture du contrat et non de créances antérieures, quelle que soit la date des faits. Or la rupture est intervenue en dehors de la limite temporelle de prise en charge par l'AGS. Le jugement n'aurait donc pas pu être opposé à l'AGS.
AGS – créances garanties – C. trav., art. L. 1233-58, II N° Lexbase : L8650LGH (Cass. soc. 16 févr. 2022, n° 20-21.516, FS-D, 1er moyen, 3ème branche N° Lexbase : A63307NR). Selon l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du Code du travail, en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Une cour d'appel avait jugé que, même si elles reposent sur des fondements juridiques différents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour licenciement résultant de l'annulation de l'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ont le même objet, à savoir la réparation du dommage résultant de la perte illégitime de l'emploi. Elle en avait conclu que la somme allouée sur le fondement de l'article L. 1233-58, II, ne présentait aucun caractère salarial et excluait la garantie de l'AGS. Un tel argument emporte la cassation, car selon la Haute cour, l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, résulte de la rupture du contrat de travail du salarié. Elle devait donc, conformément à l'article L. 3253-6 N° Lexbase : L0963H9K, être couverte par l'AGS.
AGS – instances en cours – transmission de pièces – C. com., art. R. 641-34 N° Lexbase : L1062HZD(Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-20.632, FS-D N° Lexbase : A94948U8). Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du liquidateur et de l'AGS. La question posée est alors de déterminer qui doit mettre en cause l'AGS et lui transmettre les pièces. La salariée soutenait que c'est au liquidateur ou à la juridiction qu'il appartient de mettre en cause l'AGS puis au liquidateur de transmettre à l'AGS les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs, dont les conclusions et pièces de la salariée. Or, en l'espèce, elle avait communiqué ses conclusions et pièces directement à l'AGS et non à son avocat. Cependant, aux termes de l'article R. 641-34 du Code du commerce N° Lexbase : L1062HZD, lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur à l’AGS mise en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du Code de commerce N° Lexbase : L9199L7T. La Cour de cassation s'en tient alors à la stricte application du texte dont il ne résulte pas que les conclusions et pièces de la salariée devaient être transmises à l'AGS par le liquidateur. La conséquence est sévère : la salariée, à qui il appartenait de transmettre les pièces à l’AGS, ne pouvait bénéficier de la garantie de celle-ci, malgré la condamnation en sa faveur par la juridiction prud'homale.
B. Autres garanties et indemnités (hors AGS)
Gérant de succursale – mandat social – contrat de travail – principe de non-cumul des salaires et bénéfices (Cass. soc., 12 janvier 2022, n° 20-19.386, F-D N° Lexbase : A52677IW). Si le gérant de succursale peut bénéficier de certaines dispositions du Code du travail, notamment celles relatives au salaire, encore faut-il déterminer s'il peut cumuler les salaires dus au titre du Code du travail et ceux dus au titre du commerce exploité. Si l'exploitation de l'activité commerciale est faite en nom personnel [56], une compensation doit être opérée [57]. La personne qui se voit reconnaître le statut de gérant de succursale ne peut donc pas prétendre au cumul des sommes dues au titre des salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial. C'est à bon droit que le mandataire liquidateur a rejeté la demande en paiement d'arriérés de salaires et de congés payés du gérant de succursale, dès lors que la somme perçue au titre de l'exploitation de la société était supérieure à celle sollicitée au titre des salaires restant dus.
Liquidation judiciaire – mandat social – effet – suspension contrat de travail (Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 20-14.453, F-D N° Lexbase : A08798MI). Dans cette affaire, un salarié, engagé comme ingénieur d'études, a ensuite été nommé président de la société. La société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Il était soutenu devant la Cour de cassation que la fin ou le maintien du mandat social n'a aucun effet sur le contrat de travail du mandataire social qui peut être licencié indépendamment du maintien du mandat social, et qu'en cas de liquidation judiciaire avec cessation d'activité, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans un délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire ou du terme du maintien provisoire d'activité. Le liquidateur judiciaire qui procède au licenciement de tous les salariés de l'entreprise doit-il inclure dans le licenciement économique le mandataire social dont le contrat de travail est suspendu ? Il n'en est rien selon la Cour de cassation qui rappelle qu'il résulte des articles L. 641-9, II, du Code de commerce N° Lexbase : L3693MBE et 1844-7 du Code civil N° Lexbase : L7356IZH, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 N° Lexbase : L7194IZH, que l'ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fin aux fonctions des mandataires sociaux, seule la clôture de la liquidation ayant pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants. Or, le jugement prononçant la liquidation n'a entrainé ni la dissolution de la société ni mis fin au mandat social de l'intéressé à la date de fin de poursuite d'activité. Le mandat social étant toujours en cours, en l'absence de révocation par l'assemblée générale des actionnaires, jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation, il en résulte que le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence de rupture de fait ou de licenciement par le liquidateur. L'intéressé n'était donc pas en droit de percevoir des indemnités de licenciement ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse – pas plus qu'il ne pourra faire valoir ses créances salariales.
Liquidation judiciaire – garanties collectives de prévoyance – maintien – paiement indu (non) (Cass. civ. 2, 10 mars 2022, n° 20-20.898, F-B N° Lexbase : A03537Q7). L'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0437IXH prévoit un dispositif de maintien des garanties collectives mises en place dans l'entreprise par accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l'entreprise au profit des anciens salariés pour la durée de leur indemnisation par l'assurance chômage dans la limite de douze mois. Son application est difficile lorsque l'entreprise est placée en liquidation judiciaire, car le financement du dispositif repose sur les contributions versées par l'employeur et les salariés. La difficulté tient au fait que ce texte ne dit rien des conditions de mise en œuvre du maintien des garanties dans une telle situation, le législateur ayant seulement prévu à l’article 4 de la loi du 14 juin 2013 N° Lexbase : Z48733MG la remise d’un rapport par le Gouvernement sur ce sujet, lequel n’a jamais été déposé au Parlement [58]. La Cour de cassation a dû se prononcer sur son application aux anciens salariés d'une entreprise placée en liquidation judiciaire. Par plusieurs avis rendus le 6 novembre 2017, elle a confirmé cette application, sous réserve de l'absence de résiliation du contrat ou de l'adhésion au règlement liant l'employeur à l'organisme assureur [59]. Deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile ont confirmé cette interprétation [60] : la portabilité des droits doit être assurée sous réserve que le contrat n'ait pas été ou que soit prévu « un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire ». Il n'est pas nécessaire cependant que le régime mis en place dans l'entreprise prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de résiliation judiciaire du contrat d'assurance, cette condition n'étant pas requise par la loi. Cette position est réaffirmée dans l'arrêt du 10 mars 2022, qui présente une particularité, l'organisme assureur ayant résilié le contrat d'assurance dans le délai de 3 mois suivant le placement en liquidation judiciaire. Il avait néanmoins proposé une « prolongation onéreuse du contrat » et le liquidateur judiciaire lui avait adressé à ce titre une somme afin de maintenir les garanties pendant un an. Le liquidateur assigna ensuite en justice l'institution de prévoyance afin d’obtenir le remboursement de cette somme, selon lui, indûment payée. Selon la Cour de cassation, les dispositions d'ordre public de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, permettant le maintien des garanties collectives de prévoyance en cas de cessation du contrat de travail s'appliquent aux anciens salariés d'un employeur placé en liquidation judiciaire à la condition que le contrat ou l'adhésion liant celui-ci à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Toutefois, lorsque le liquidateur a volontairement opéré un paiement après la résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance, il ne peut s'agir d'un paiement indu. Il faut toutefois relever que l'article 15 de l'ordonnance 2017-734 du 4 mai 2017 N° Lexbase : L1671LEM a supprimé la possibilité pour l'organisme assureur de résilier le contrat ou l'adhésion le liant à l'entreprise dans le délai de trois mois suivant le placement en liquidation judiciaire de cette dernière.
Liquidation judiciaire – préjudice d'anxiété – carence de l'État – compétence du juge administratif – délai de prescription (CE, 1e-4e ch. réunies, 19 avril 2022, n° 457560, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A05127UI). Le contentieux de la réparation du préjudice d'anxiété, notamment des travailleurs de l'amiante, relève en principe de la compétence du juge judiciaire. Ce principe connaît une exception notable, lorsque l'employeur est insolvable et placé en liquidation judiciaire. Dans un arrêt rendu en 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait décidé que l'AGS n'était pas tenue de garantir ce préjudice [61] lorsque le fait générateur (la connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’activité en cause sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’ACAATA) est postérieur à la clôture de la procédure. La réparation du préjudice d'anxiété peut alors relever de la compétence du juge administratif sur le fondement de la responsabilité de l'État pour carence dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante [62]. Un salarié exposé à l’amiante dispose d’un délai de quatre ans pour agir, à partir du moment où il a eu connaissance de l’existence d’un risque élevé de développer une maladie grave du fait de l'exposition à l'amiante. La réparation de ce préjudice peut être demandée à l’employeur ou à l’État. Dans l'arrêt rendu le 19 avril 2022, le Conseil d'État précise les modalités de réparation du préjudice lorsque la demande émane de bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Il énonce que le préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l'ACAATA naît de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis pour la détermination du point de départ du délai de prescription de quatre ans, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le délai de prescription peut être interrompu. C’est le cas lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile est déposée. En revanche, « les recours formés à l’encontre de l’État par des tiers tels que d’autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d’autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance », et ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription.
[1] CE, 22 mai 2015, n° 383481 N° Lexbase : A9293NM7 ; CE, 1e-4e ch. réunies, 8 décembre 2021, n° 435919 N° Lexbase : A95907EW ; CE, 1e-4e ch. réunies, 13 février 2019, n° 404556 N° Lexbase : A3041YXW.
[2] Cass. soc., 23 septembre 2008, n° 07-40.113, F-D N° Lexbase : A4972EAE : l'employeur ne peut se borner à prévoir un recensement des postes disponibles dans le groupe en renvoyant à une diffusion informatisée ultérieure de ces possibilités de reclassement.
[3] Cass. soc., 31 octobre 2007, n° 06-43.535, F-D N° Lexbase : A2438DZC : n'avait pas manqué à son obligation de reclassement le liquidateur qui avait seulement « consulté les dirigeants du groupe » pour faciliter le reclassement des salariés de l'entreprise.
[4] C. trav., art. L 3253-8, 2°, b), c) et d) N° Lexbase : L7959LGU.
[5] Conclusion F. Dieu, RJS 8-9/22.
[6] CE, 1e-4e ch. réunies, 13 avril 2018, n° 404090 N° Lexbase : A2007XLW : compte tenu des moyens limités dont disposait une entreprise en liquidation judiciaire, les mesures figurant dans le PSE pouvaient être regardées par l'administration comme suffisantes, même si elles se bornaient à mettre en œuvre des dispositifs légaux ou financés par des fonds publics.
[7] Compétence sur le caractère sérieux de la recherche de reclassement dans le groupe : Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 20-23.206, FS-B N° Lexbase : A35968UQ.
[8] Cass. soc., 6 octobre 2011, n° 11-40.056 et n° 11-40.057, F-P+B N° Lexbase : A6123HYG.
[9] V. cependant CA Orléans, 20 septembre 2012, n° 11/02570 N° Lexbase : A1366ITR.
[10] Cass. soc., 28 mai 2015, n° 14-12.015, F-D N° Lexbase : A8332NIG. v. également Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 16-21.844, F-D N° Lexbase : A5618XXD.
[11] CE, 4e-5e SSR, 9 mars 2016, n° 384175 N° Lexbase : A5428QYP.
[12] Cass. soc., 13 février 2008, n° 06-44.984 N° Lexbase : A9273D49 : « le seul envoi de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe auquel appartenait l'employeur, ne pouvait suffire à établir que ce dernier avait effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe ».
[13] CE, 29 juin 2009, n° 307964 N° Lexbase : A5630EID : « la société (…) s'est bornée à envoyer une liste de curriculum vitae à une de ses filiales (…) et n'a pas effectivement procédé à l'examen individuel de la situation de M. A en vue d'assurer son reclassement ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail était tenu de refuser la demande d'autorisation de licencier celui-ci pour motif économique présentée par cette entreprise ».
[14] CE, 1e-4e ch. réunies, 13 février 2019, n° 404556 N° Lexbase : A3041YXW ; CE, 4e-5e SSR, 21 octobre 2015, n° 382633, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8598NTM.
[15] Not. C. com., art. L. 641-1 N° Lexbase : L9188L7G et L. 642-5 N° Lexbase : L9202L7X. Le tribunal doit avoir entendu la ou les personnes désignées par le comité social et économique avant d’ouvrir la procédure ou arrêter le plan de cession.
[16] C. com., art. L. 661-10 N° Lexbase : L9212L7C.
[17] Directive n° 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, p. 16 N° Lexbase : L8084AUX.
[18] Une proposition de directive relative à l'insolvabilité des entreprises a été devoilée fin 2022. Elle prévoit notamment l'instauration d'une procédure négociée de pre-pack, v. Nouvelle proposition de directive en vue d'harmoniser certains aspects du droit de l'insolvabilité, D. actu., 4 janvier 2023.
[19] Sur cette procédure, H. Nasom-Tissandier, La cession d'une entreprise en difficulté peut-elle être un transfert d'entreprise ?, RJS, 11/2017, p. 810.
[20] L'arrêt Smallsteps, rendu le 22 juin 2017 (CJUE, 22 juin 2017, aff. C-126/16 N° Lexbase : A1276WKH, D., 2017, p. 2242, note R. Dammann et G. Podeur), concernait un transfert d'entreprise effectué à la suite d'une déclaration de faillite précédée d'un pre-pack au sens du droit néerlandais. Si la Cour de justice admet que la procédure était susceptible de relever de la notion de « procédure de faillite », elle considère que les deux autres conditions ne sont pas remplies. Dans l'arrêt Plessers (CJUE, 16 mai 2019, aff. C-509/17 N° Lexbase : A8616ZBQ, D., 2020, 588, note R. Dammann et A. Alle ; RDT, 2019, 782, obs. A. Donnette-Boissière ; RTD eur., 2020, 392, obs. S. Robin-Olivier ; Europe, juillet 2019, comm. 293, obs. L. Driguez), la Cour a jugé qu’une procédure de réorganisation judiciaire belge, destinée à maintenir tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités, n'avait pas pour finalité la liquidation des biens au sens de l'article 5, § 1. Elle a précisé qu’une telle procédure n'était pas menée sous le contrôle d'une autorité publique compétente, le contrôle effectué par le mandataire de justice chargé d'organiser la cession et de la réaliser au nom et pour le compte du débiteur ayant une portée plus restreinte que celle du contrôle exercé par l'organe correspondant dans le cadre d'une procédure de faillite. De même, dans l'arrêt TMD Friction (CJUE, 9 septembre 2020, TMD Friction et TMD Friction EsCo, aff. C‑674/18 et C‑675/18 N° Lexbase : A02193TB), la Cour a considéré que la cession de certaines activités de l'entreprise par le curateur dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité de droit allemand, ayant pour objectif « non pas la liquidation des biens du cédant, mais le maintien de ses activités suivi du transfert de celles-ci », ne constituait pas « une procédure ouverte aux fins de la liquidation des biens du cédant, au sens de l'article 5, § 1 ».
[21] En complément, v. D. Bondat, Procédure d'insolvabilité internationale, transfert d'entreprise et inapplication du règlement insolvabilité : qui va payer les pots cassés ?, Dr. soc., 2022, p. 347.
[22] La procédure se déroule en deux temps. Dans la cadre d'une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc (C. com., art. L. 611-15 N° Lexbase : L4119HB8), le conciliateur « peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » (C. com., art. L 611-7, al. 1er N° Lexbase : L9110L7K). Dans un second temps, celui de la cession, le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire avec un rythme accéléré et organise la cession préalablement préparée.
[23] Des licenciements peuvent être autorisés par le jugement arrêtant le plan de cession suivent la même procédure, selon l'article L. 642-5 du Code de commerce N° Lexbase : L9202L7X, et sur le fondement de l'article L. 631-19 du Code de commerce N° Lexbase : L9176L7Y.
[24] C. com., art. L. 631-1 N° Lexbase : L3683MBZ : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ». D’ailleurs, si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, une procédure de redressement judiciaire ne peut pas être ouverte, seule la liquidation judiciaire est possible.
[25] V. cependant H. Nasom-Tissandier, 2022, préc. sur la possibilité d'une appréciation souple par la Cour de justice pour admettre la possibilité de recourir à la dérogation de l'article 5, § 1, même dans une procédure telle celle du plan de cession en redressement judiciaire, dès lors que cela répond à la ratio legis de la Directive « Transfert ». V. également sur ce sujet : O. Buisine, Jurisprudence de la CJUE en matière de transfert d'entreprise : l'avenir incertain du prepack cession et du plan de cession, Rev. proc. coll., nov.-déc. 2019, n° 6, pp. 15-20.
[26] C. com., art. L. 642-19 N° Lexbase : L2768LB7.
[27] Par conséquent, les licenciements antérieurs autorisés par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur sont sans effet : les salariés peuvent demander la poursuite de leur contrat de travail auprès du repreneur ou demander la réparation du préjudice subi du fait de la rupture. Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-43.923, FS-P+B N° Lexbase : A9867DME ; Cass. soc., 14 octobre 2020, n° 18-24.311, F-D N° Lexbase : A96553XU : « La décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif en application des dispositions des articles L. 642-18 N° Lexbase : L7335IZP et L. 642-19 N° Lexbase : L2768LB7 du Code de commerce n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail » ; Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.950, FS-P+B+I N° Lexbase : A5259Q9N, relatif à la période d'observation du redressement judiciaire.
[28] CE, 4e-5e SSR, deux arrêts, 22 mai 2015, n° 371061 N° Lexbase : A5573NIA et n° 375897 N° Lexbase : A5581NIK, mentionné aux tables du recueil Lebon.
[29] CE, 4e-5e SSR, 8 avril 2013, n° 348559 N° Lexbase : A7203KBE. Pour une analyse critique, T. Sachs, Le Conseil d'État et le motif de la cessation d'activités de l'entreprise : emprunt ou travestissement ?, RDT, 2013, p. 406.
[30] CE, 4e-5e SSR, 8 mars 2006, n° 270857, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4876DNW.
[31] Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 18-13.771, FP-P+B+I N° Lexbase : A551237B.
[32] CA Angers, 29 octobre 2020, n° 19/00023 N° Lexbase : A99893ZY.
[33] Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-20.065, F-P+B+I N° Lexbase : A1358YPY : le tribunal en charge de la procédure collective n’est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre du liquidateur, et ce même dans le cadre de demandes reconventionnelles.
[34] CE, 3e-8e SSR, 15 juin 2005, n° 250747, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7291DIU.
[35] V. aussi Cass. soc., 8 décembre 2021, n° 20-13.680, F-D N° Lexbase : A79727EY.
[36] Cass. soc., 10 juin 2020, n° 18-26.229, FS-P+B N° Lexbase : A53843NQ. V. aussi Cass. soc., 21 avril 2022, n° 20-17.496, FS-B N° Lexbase : A15707UP.
[37] V. par ex. Cass. soc., 6 novembre 2019, n° 18-19.853, F-D N° Lexbase : A4003ZUS ; Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-21.369, F-D N° Lexbase : A158738B.
[38] C. com., art. L. 225-22 N° Lexbase : L0662IXS.
[39] V. également CA Toulouse, 21 janvier 2023, n° 2023/40, n° 22/02135 N° Lexbase : A554688W.
[40] CA Dijon, 26 janvier 2017, n° 15/00579 N° Lexbase : A2714TAR.
[41] CA Pau, 23 mars 2017, n° 14/03566 N° Lexbase : A9940UEU.
[42] CA Metz, 21 juin 2022, n° 20/01915 N° Lexbase : A398178X.
[43] CA Douai, 24 juin 2022, n° 20/01984 N° Lexbase : A71938DR.
[44] CA Pau, préc.
[45] C. com., art. L. 625-1 N° Lexbase : L3315ICR à L. 625-6 N° Lexbase : L4097HBD.
[46] Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 20-15.895 N° Lexbase : A07658MB. v. ci-avant n° 14.
[47] CA Toulouse, 21 janvier 2023, préc. : « La sanction de l’absence de respect par le liquidateur de la subsidiarité ne peut être obtenue qu’a posteriori, par le droit au remboursement de ces avances assorties du superprivilège dont elles bénéficient, ainsi que par la mise en jeu de la responsabilité du mandataire pour avoir présenté un relevé de créances aux fins d’obtenir des avances en violation de l’article L. 3253-20 du Code du travail ». Un autre contentieux se développe en parallèle, relatif à la prétention de l’AGS d’être payée avant tous les autres créanciers, alors que la loi ne prévoit pas cette possibilité.
[48] V not. Cass. soc., 4 décembre 2002, n° 00-43.750, publié N° Lexbase : A1592A4Q ; Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-40.231, publié N° Lexbase : A8402DBS ; Cass. soc., 23 mars 2005, n° 03-41.876, F-D N° Lexbase : A4233DHA.
[49] V. Cass. soc., 5 novembre 2003, n° 01-44.165, F-D N° Lexbase : A1284DAS.
[50] « Les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ».
[51] « L'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».
[52] Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 18-18.943, F-B N° Lexbase : A41394YX : aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action d'un salarié visant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une somme figurant sur un relevé des créances résultant de son contrat de travail et que, en conséquence, cette action était recevable malgré la clôture de la procédure collective. V. déjà Cass. soc., 1er février 2001, n° 97-45.009, publié N° Lexbase : A9539AS4 ; v. D. Bondat, AGS : fin de la procédure collective ne veut pas dire fin des ennuis !, Droit social, 2021, p. 1054, pour qui l’argument de l’AGS était plus subtil en ce que l’article L. 625-4 du Code de commerce N° Lexbase : L3302ICB comporterait un délai implicite sous-jacent correspondant à la durée de la procédure collective, le texte précisant que la saisine de la juridiction prud’homale doit s’accompagner de la mise en cause des organes de la procédure, ce qui implique logiquement que celle-ci ne soit pas clôturée.
[53] Pour une analyse détaillée, H. Nasom-Tissandier, Lexbase Social, 2022, préc.
[54] Comp. pour l’application des dispositions antérieures aux réformes : Cass. soc. 7 juillet 2021, n° 18-18.943, F-B N° Lexbase : A41394YX : l’AGS doit garantir la créance vingt-trois ans après l’établissement des relevés de créances salariales et treize ans après la clôture de la procédure collective.
[55] C. trav., art. L. 3253-8 N° Lexbase : L7959LGU.
[56] Sur cette condition, v. Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 09-72.836, F-D N° Lexbase : A0734HZ9.
[57] V. déjà Cass. com., 13 mars 2001, n° 99-40.193, publié N° Lexbase : A0124ATR.
[58] Notice explicative relative à Cass. avis, 6 novembre 2017, n° 17013 à n° 17017.
[59] Cass. avis, 6 novembre 2017, n° 17013 N° Lexbase : A8557WYL à n° 17017 N° Lexbase : A8561WYQ.
[60] Cass. civ. 2, 18 janvier 2018, n° 16-27.332, F-D N° Lexbase : A8881XA8 ; Cass. soc., 19 novembre 2020, n° 19-17.164, FS-P+B+I N° Lexbase : A521033D.
[61] Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.788, FS-P+B N° Lexbase : A2718MTT ; J. Bourdoiseau, Bornage de l’indemnisation du préjudice d’anxiété des salariés victimes de l’amiante, Lexbase social, 17 juillet 2014, n° 579 N° Lexbase : N3294BUK.
[62] CE, 3 mars 2004, n° 241152 N° Lexbase : A4305DB3.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485495
[Focus] Quelles sont les conséquences fiscales d’une activité exercée à titre individuel de location nue transformée en location meublée ?
Lecture: 19 min
N5529BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jérôme Mazeres, Fiscaliste - Diplômé en gestion de patrimoine, Les fourmis du patrimoine
Le 23 Mai 2023
Mots-clés : location meublée • BIC • bailleurs • revenus fonciers
1.- La location d’une habitation nue ou meublée ne reçoit pas le même traitement fiscal.
En effet, la location nue relève du régime des revenus fonciers, et la location meublée relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux.
Il n’est cependant pas rare en pratique de voir certains bailleurs transformer leur activité de location nue en location meublée.
2.- Un tel changement génère de nombreuses conséquences au regard de la fiscalité. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous pouvons tenter de ranger ces conséquences en quatre temps :
- La perte de l’intégralité du régime des revenus fonciers et de ses avantages (I)
- Les interrogations concernant la fiscalité du passage à la nouvelle modalité de détermination du résultat (II)
- Le démarrage de l’activité de loueur en meublé et ses conséquences sur les amortissements et les plus-values (III)
- L’impact sur quelques impôts connexes (IV).
I. La perte du régime des revenus fonciers
A. La perte du déficit foncier et la remise en cause de l’imputation sur le revenu global
3.- Parmi les premières conséquences liées à ce changement d’activité, on pense tout particulièrement au mécanisme d’imputation du déficit foncier.
Il existe deux mécanismes d’imputation des revenus fonciers : l’un concernant le revenu global, et l’autre les revenus fonciers des 10 années suivantes. Dans ce dernier cas on parlera de « tunnelisation des déficits fonciers ».
4.- Le revenu foncier peut être imputé sur le revenu global jusqu’à 10 700 euros. Attention, le déficit foncier imputable sur le revenu global n’est pas constitué des intérêts d’emprunt. En effet, le déficit foncier correspondant aux intérêts d’emprunt est « tunnélisé ».
5.- Il convient également de relever que la seconde loi de finances rectificative pour 2022 a accru le plafond du déficit imputable sur le revenu global. En effet, le déficit foncier généré par des travaux de rénovation énergétique pourra faire l’objet d’une imputation sur le revenu global dans la limite de 21 400 euros [1]. Rappelons que cette majoration est temporaire, celle-ci trouvant à s’appliquer entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
6.- Afin que l’imputation du déficit sur le revenu global soit définitivement acquise, il est nécessaire que le bien continue à être donné en location jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant celle de l’imputation du déficit. Cette condition trouve également à s’appliquer au « super déficit » lié au travaux de rénovation énergétique.
7.- Lorsque l’article 156, I-3° du Code général des impôts N° Lexbase : L0306MGG vise la cessation de l’activité de location, il fait référence à l’activité de location en nue.
Or, le passage de la location nue à la location meublée est considéré par la jurisprudence [2] et l’administration fiscale [3] comme un cas de perte de l’imputation du déficit sur le revenu global, lorsque cette situation se produit dans les trois ans de l’imputation du déficit.
Celui-ci n’est pas pour autant perdu dans la mesure où le déficit foncier « tunnelisé » est reconstitué.
Attention, si le bailleur ne dispose pas d’autres revenus fonciers lui permettant d’imputer le déficit reconstitué durant la période de 10 ans, alors celui-ci, au terme de la période d’imputation sera perdu.
B. La fin des questionnements concernant la qualification des travaux. Vraiment ?
La fin des interrogations concernant la qualification des travaux ?
8- Outre la perte du déficit foncier imputé sur le revenu global, c’est également l’ensemble du régime de détermination du résultat qui s’en trouve chamboulé.
En effet, le bailleur passe de l’application du régime des revenus fonciers au régime des bénéfices industriels et commerciaux.
9.- Dès lors, en cas de location en direct du bien immobilier, plusieurs points de différence apparaissent entre les deux régimes. Enfonçons une porte ouverte, les abattements forfaitaires des régimes micro sont différents, de même que les seuils d’application.
Outre cet aspect, c’est bien l’ensemble des règles applicables, et notamment celui concernant la déduction des travaux qui diffèrent. En effet, dans le cadre des revenus fonciers, sous conditions, le bailleur peut déduire les dépenses d’entretien et de réparation sauf celles indissociablement liées à des dépenses non déductibles [4]. Les dépenses d’amélioration sont déductibles pour les locaux d’habitation. Néanmoins, celles-ci ne sont pas déductibles pour à usage professionnel, sauf s’il s’agit de travaux permettant l’accueil des personnes handicapées ou destinés à protéger le local de l’amiante. Enfin, les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement ne sont pas déductibles [5].
10.- Cette distinction entre les dépenses déductibles n’existe pas au cas des bénéfices industriels et commerciaux.
Cependant, là où les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement ne sont pas déductibles en matière de revenus fonciers, ceux-ci pourront faire l’objet d’un amortissement en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
Une nouvelle discussion concernant la qualification : charge ou amortissement ?
11.- Le débat entre la qualification de travaux d’entretien/ réparation, et de travaux d’amélioration peut apparaître superflu au niveau des revenus fonciers dans la mesure où celles-ci sont déductibles pour un immeuble d’habitation.
Cependant, cette distinction peut trouver un certain intérêt pour l’application des bénéfices industriels et commerciaux. En effet, les dépenses qui ont pour effet d'augmenter la valeur d'un élément de l'actif ne peuvent pas être comptabilisées en charges et doivent être immobilisées [6]. Ainsi, le débat portera sur la qualification en charge ou en amortissement.
12.- Le Conseil d’État [7] a pu considérer que des travaux de maçonnerie et de plomberie, réalisés dans un immeuble ancien, ayant entraîné une augmentation de la valeur de celui-ci, constituent des dépenses amortissables. Au cas des revenus fonciers, le Conseil d’État [8] a pu considérer que des dépenses de plomberie et de maçonnerie peuvent, selon les cas, constituer des dépenses d’entretien et de réparation, et d’amélioration.
13.- Le changement de catégorie d’imposition ne doit pas faire oublier la problématique de l’acte anormal de gestion, certains bailleurs étant susceptibles de se réserver la jouissance du bien immobilier. Deux solutions sont susceptibles de s’appliquer :
- Soit, une limitation de la déduction des amortissements et des charges déductibles au prorata de la durée de location [9] (l’immeuble était resté dans le patrimoine privé);
- Soit, déduction de l’intégralité des charges et des amortissements, mais en contrepartie, il doit comprendre dans les revenus imposables l’avantage en nature que lui procure la jouissance du bien immobilier [10] (dans le cadre de cette affaire, l’immeuble était inscrit au bilan) ;
Au cas des revenus fonciers, lorsque le contribuable se réserve la jouissance du bien immobilier, les dépenses afférentes à cet immeuble ne sont pas déductibles [11].
C. La perte des régimes locatifs propres aux revenus fonciers et à l’impôt sur le revenu
La perte des mécanismes d’amortissement propres aux revenus fonciers
14- La plupart des régimes d’investissement locatif comportent dans leur condition d’application un engagement de donner en location nue
À titre d’exemple, tel est le cas, des régimes suivants :
15.- La doctrine administrative propre à chacun de ces régimes consacrant un avantage spécifique en matière de revenus fonciers, se traduisant notamment par un mécanisme d’amortissement, prévoit les cas de reprise de ce mécanisme [15].
Notamment, la violation de la condition relative au fait de donner en location nue le bien immobilier, durant la période de l’engagement de location expose à une reprise de l’avantage fiscal.
16.- À titre d’exemple, pour le régime Robien, la doctrine administrative précise : « la rupture par le propriétaire ou l’associé de son engagement de location ou de conservation des parts entraîne la réintégration dans le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle elle intervient, des amortissements déduits au cours de la période couverte par cet engagement.
Il pourra donc s’agir des déductions pratiquées à raison de l’investissement initial et/ou de celles pratiquées à raison de travaux ultérieurs de construction, reconstruction ou d’agrandissement ».
Celle-ci laisse notamment la possibilité d’utiliser le mécanisme du quotient visé à l’article 163-0 A du Code général des impôts N° Lexbase : L5656MAQ afin de « minorer » l’imposition.
La perte de certaines réductions d’impôt sur le revenu
17.- Outre les avantages spécifiques aux revenus fonciers, le bailleur a également pu avoir recours à une réduction d’impôt du type Pinel, Duflot ou Scellier par exemple.
Là encore, ces régimes de faveur comportent une obligation de donner en location nue le bien immobilier. Le passage à un schéma de location meublée est susceptible d’entraîner la remise en cause du régime de faveur.
18.- Il est donc nécessaire de vérifier la situation du bailleur au regard de ces différents régimes d’investissement locatif, et de vérifier le coût d’une éventuelle reprise de ceux-ci généré par un passage à un schéma de location meublée.
II. Le changement de catégorie d’imposition génère-t-il une plus-value immobilière imposable ?
19- Seules sont imposables les plus-values réalisées lors d'une cession à titre onéreux d'un bien immobilier ou d'un droit y afférent. Cette cession constitue le fait générateur de l'impôt [16].
20.- Or, en cas de passage à un régime de location meublé, et notamment de loueur en meublé non professionnel (LMNP), il n’y a pas de « cession » en tant que telle.
Dès lors, il ne devrait pas y avoir de fait générateur de plus-values privées, et encore moins de droit de mutation à titre onéreux.
A priori, il ne devrait également pas en être autrement en cas de passage d’une activité relevant du régime des revenus fonciers à une activité de loueur en meublé professionnel (LMP).
21.- En ce sens, il convient de rappeler qu’en cas d’exercice d’une activité LMNP, l’administration fiscale considère que la cession de l’immeuble relève du régime des plus-values immobilières privées. Alors qu’en cas de cession du même dans le cadre du régime LMP, l’administration fiscale considère que celle-ci relève du régime des plus-values professionnelles.
Or, le passage LMNP à LMP n’entraîne pas de cessation d’activité, et par conséquent de la plus-value immobilière latente [17].
De plus, une ancienne réponse ministérielle de 2008 [18] a également pu préciser que le passage d’une SCI à l’IR exerçant une activité de location nue à une SARL de famille exerçant une activité de location meublée ne générait pas de cessation d’activité.
III. Quelques questions concernant la fiscalité liée au démarrage de l’activité de loueur en meublé
A.Plusieurs questions concernent l’immobilisation et l’amortissement de l’immeuble
L’immeuble à usage d’habitation doit-il être nécessairement inscrit au bilan ?
22.- Les biens qui ne sont pas inscrits au bilan font en principe partie du patrimoine privé. En règle générale, quelques éléments constituent des éléments d’actif professionnel par nature, tel que le fonds de commerce. Mais qu’en est-il de l’immeuble utilisé pour une activité de loueur en meublé.
Le Conseil d’État [19] a eu l’occasion d’indiquer que des immeubles affectés à des activités de location en meublée saisonnière ne constituent pas des actifs affectés par nature au patrimoine commercial.
23.- Cependant, si ces biens ne sont pas inscrits au bilan, la doctrine administrative [20] permet de déduire une fraction des frais financiers, amortissement et frais de gestion, calculée au prorata de la durée de location.
Dans le cadre de l’arrêt cité par la doctrine administrative, l’administration fiscale avait raisonné en semaine.
À quelle valeur convient-il d’inscrire l’immeuble au bilan ?
24.- Si le bailleur choisit d’immobiliser le bien immobilier, encore faut-il déterminer la valeur à inscrire au bilan. Doit-on retenir la valeur vénale ou le prix d’origine du bien, c’est-à-dire la valeur du bien lors de son acquisition ?
25.- La doctrine administrative [21] précise, notamment dans le cas où un contribuable inscrit un bien immobilier relevant de son patrimoine privé au bilan de l’entreprise individuelle : « Les immeubles appartenant à l'exploitant soumis à un régime de bénéfice réel mais non inscrit au bilan ou sur l'annexe n° 2033 A (CERFA n° 10956) de l'entreprise, sont censés demeurer dans le patrimoine privé de l'exploitant même si celui-ci les utilise pour les besoins de l'exploitation.
Il s'ensuit qu'en cas d'inscription d'un tel immeuble au bilan ou sur l'annexe n° 2033 A (CERFA n° 10956) en cours d'exploitation, l'exploitant peut effectuer cette inscription à la valeur réelle. C'est en fonction de cette valeur réelle que seront calculés les amortissements annuels ».
26.- Ce positionnement s’inscrit dans le cadre de l’article 15 à l’annexe II [22] du Code général des impôts N° Lexbase : L9922HMG. Ainsi, au vu de la doctrine administrative, il conviendrait de partir de la valeur réelle du bien afin de déterminer les amortissements.
27.- il convient de rappeler que le terrain n’est pas amortissable.
Il est donc nécessaire de procéder à une ventilation entre la valeur du terrain et la valeur des constructions.
Le Conseil d’État [23] a dressé une méthode permettant d’opérer cette ventilation :
1. Vérifier s’il existe des cessions de terrains nus à des dates proches de celles effectuées par l’entreprise dans la même zone géographique ;
2. À défaut, évaluation du coût de la reconstruction de l’immeuble à la date de son entrée au bilan de l’entreprise, en tenant compte de sa vétusté et de son état d’entretien ;
3. En cas d’impossibilité de retenir les méthodes précédentes, possibilité de tenir compte des données comptables issues du bilan d’autres entreprises ayant acquis à des dates proches des immeubles comparables.
Faut-il reconstituer les amortissements ?
28.- La doctrine administrative [24] précise : « Dès lors que la dépréciation des immobilisations résulte principalement de l'usure provoquée par leur utilisation, le point de départ de l'amortissement linéaire est calculé à compter du jour de la mise en service effective de chaque élément amortissable ».
Cela correspond ainsi peu ou prou à la mise en location du bien en meublée.
Ce positionnement de l’administration fiscale n’est pas sans rappeler celui du Conseil d’État du 8 septembre 1999 [25] concernant l’inscription d’un bien au bilan d’une entreprise en cours de vie de celle-ci, celui-ci étant auparavant logé dans le patrimoine privé. Le Conseil d’État considéra qu’il n’y avait pas lieu de reconstituer des amortissements dans ce cas.
29.- Certains arrêts sont susceptibles de générer un certain nombre d’interrogations.
Cela est notamment le cas de l’arrêt rendu par le Conseil d’État [26], le 10 juillet 2007.
Cette affaire n’est pas si éloignée de celle du passage à une activité de location meublée. Il s’agissait d’une SCI relevant de l’impôt sur le revenu exerçant une activité relevant des revenus fonciers. Celle-ci n’avait par conséquent jamais amorti le bien immobilier donné en location nue. Cependant, les parts de celle-ci ont été acquises pas une société relevant de l’impôt sur les sociétés.
La quote-part de bénéfice de la SCI revenant à la société IS, a été déterminé selon les règles BIC/IS conformément à l’article 238 bis K du Code général des impôts N° Lexbase : L3844KWB.
Il était notamment question de savoir si la société IS devait reconstituer les amortissements, et si la durée normale de l’amortissement devait être décomptée à partir de la d’acquisition des biens ou à partir du changement des règles de détermination du résultat.
Le Conseil d’État répond assez clairement en considérant que la durée normale d’utilisation des biens doit être décomptée à partir de la date d’acquisition ou de création de ceux-ci.
30.- Les conclusions du commissaire du gouvernement Pierre Collin [27] sont par ailleurs très éclairantes sur ce sujet.
Il relève notamment que conformément à l’article 39,1-2° du CGI et de l’article 322-4, 2 du PCG, le bien immobilier étant entré dans le patrimoine de la SCI en 1974, celui-ci avait donc bien commencé à être exploité.
Il considère que le changement d’associé au sein de la SCI n’entraîne qu’un changement des modalités de calcul du bénéfice, sans créer une personne morale nouvelle ou entraîner un changement de régime fiscal.
B. Quelle imposition en cas de revente du bien immobilier, une fois le changement d’activité effectuée ?
31.- En principe, le régime applicable est le suivant :
- Cession du bien donné en location nue : application du régime des plus-values immobilières privées ;
- Cession du bien donné en location meublée non professionnelle : application du régime des plus-values immobilières privées [28]. Cela permet ainsi de bénéficier du régime des abattements pour durée de détention ;
- Cession du bien donné en location meublée professionnelle : application du régime des plus-values professionnelles. Cela permet de bénéficier de certains régimes d’exonération des plus-values professionnelles, sous réserve d’en remplir les conditions, comme celui visé à l’article 151 septies du Code général des impôts [29] (exonération en fonction du chiffre d’affaires).
32.- En outre, la doctrine administrative considère que le passage de la location meublée non professionnelle à la location meublée professionnelle n’entraîne pas de cessation d’activité [30].
En cas de cession d'un immeuble par un contribuable ayant eu alternativement la qualité de loueur en meublé professionnel et de loueur en meublé non-professionnel, la plus-value afférente à cette cession est soumise au régime d'imposition applicable lors de la cession.
33.- Mais comment traiter la cession du bien immobilier suite au passage de la location nue à un régime LMNP ou LMP ? La réponse ne résiderait-elle pas dans l’application du régime des biens migrants ?
La doctrine administrative [31] ne répond en réalité pas à cette question : « Sauf dans l'hypothèse où le bien aurait figuré successivement dans le patrimoine privé puis dans le patrimoine professionnel du loueur en meublé, l'article 151 sexies du CGI n'est pas applicable en cas de cession d'un bien par une personne ayant eu successivement la qualité de loueur en meublé non professionnel et de loueur en meublé professionnel.
Lorsque la plus-value relève du régime prévu à l'article 150 U du CGI N° Lexbase : L3577MGL et à l'article 150 VH du CGI N° Lexbase : L0458IHG, l'abattement pour durée de détention se calcule sur le nombre d'années de détention du bien depuis son acquisition. Dans cette hypothèse, une seule plus-value doit être déterminée selon les règles prévues à l'article 150 U du CGI et à l'article 150 VH du CGI que l'immeuble ait ou non fait successivement partie du patrimoine privé et du patrimoine professionnel au sens de l'article 151 sexies du CGI ».
34.- L’article 151 sexies du CGI dispose : « La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie correspondant à cette période ».
Selon les cas, la cession du bien peut ainsi générer l’imposition d’une plus-value immobilière privée et d’une plus-value professionnelle.
Schématiquement, la situation serait la suivante :
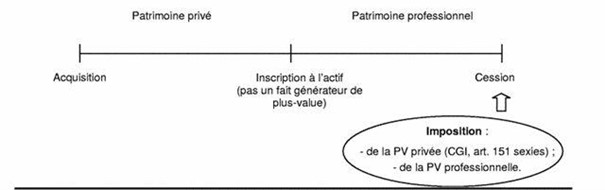
35.- La solution devrait probablement être la suivante :
- Passage location nue à location meublée non professionnelle avec cession du bien immobilier durant ce régime : application du régime des plus-values immobilières privées. L’abattement pour durée de détention est décompté à partir de la date d’acquisition du bien.
- Passage de la location nue à la location meublée professionnelle avec cession durant ce régime. Il y a une plus-value privée et une plus-value professionnelle.
IV. L’impact sur d’autres impôts : l’exemple de l’IFI et de la CFE
36.- Si, la location nue était soumise à l’IFI, le changement de mode de location pour l’exercice d’une activité de location meublée est susceptible d’impacter l’assiette de cet impôt.
En cas de passage à une activité de location meublée non professionnel, l’activité restera soumise à l’IFI.
En revanche, en cas de passage à une activité de loueur en meublée professionnel, cette activité est susceptible de bénéficier du régime d’exonération [32].
37.- Au cas de la CFE, en cas de location d’un immeuble nu à usage d’habitation générant des recettes brutes hors taxes inférieures à 100 000 euros, celle-ci était exonérée de CFE. Or, le passage à un régime de location meublée est susceptible de générer l’application de celle-ci, sauf application de régime d’exonération.
38.- En conclusion, sans prétendre à l’exhaustivité, on comprend au vu du présent article que les schémas de passages d’une activité de location en nu à une activité de location en meublée, sont susceptibles de générer un certain nombre de conséquences fiscales qui doivent être préparées et anticipées.
[1] Quelle gestion des déficits fonciers pour la période 2023-2025 – les fourmis du patrimoine – vidéo – 18 mars 2023 [en ligne].
[2] TA de Lyon, 15 mars 2011, n° 0807477.
[3] BOI-RFPI-BASE-30-20 n° 240 du 1er septembre 2017 [en ligne].
[4] Revenus fonciers : quid de la dissociabilité des travaux, Les fourmis du patrimoine, le 28 février 2023 [en ligne] ; CAA de Versailles, 20 février 2023, n° 21VE01133 N° Lexbase : A61249D8.
[5] Pour une synthèse des dépenses déductibles [en ligne].
[6] BOI-BIC-CHG-20-20-20 n° 60 du 12 septembre 2012 [en ligne].
[7] CE, 6 mai 1985, n° 43391 : RJF, 7/85, n° 1002.
[8] CE Contentieux, 28 janvier 1981, n° 17719 N° Lexbase : A7463AKM : RJF 3/81, n° 223.
[9] CE 9° et 7° ssr., 1er février 1978, n° 02838 N° Lexbase : A1051B73 – BOI-BIC-CHG-10-10-30, n° 30 du 12 septembre 2012 [en ligne].
[10] CE 9° et 7° ssr., 16 avril 1980, n° 10828 N° Lexbase : A9046AIU.
[11] BOI-RFPI-DECLA-20, n° 140, du 13 novembre 2019 [en ligne].
[12] CGI, art. 31, I-1°-o N° Lexbase : L4098MGU.
[13] BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-10, n° 10 du 18 décembre 2013 [en ligne].
[14] BOI-RFPI-SPEC-20-20-20 n° 10, du 21 mai 2015 [en ligne].
[15] BOI-RFPI-SPEC-20-20-40, n° 170, du 12 septembre 2012 – cas du Robien [en ligne].
[16] BOI-RFPI-PVI-10-30, n° 1, du 11 février 2013 [en ligne].
[17] BOI-BIC-CHAMP-40-20, n° 450, du 23 février 2022 [en ligne].
[18] QE n° 12096 de M. Kert Christian, JOANQ 4 décembre 2007 p. 7585, réponse publ. 3 juin 2008 p. 4679, 13ème législature N° Lexbase : L0670H4L.
[19] CE 9° et 8° ssr., 8 novembre 1989, n° 63967 N° Lexbase : A1493AQD
[20] BOI-BIC-CHG-10-10-30, n° 30, du 12 septembre 2012 [en ligne].
[21] BOI-BIC-AMT-10-30-30-10, n° 480, du 8 septembre 2014 [en ligne].
[22] CGI, art. 15, annexe II, version en vigueur depuis le 10 avril 2009.
[23] CE 9° et 10° ssr., 15 février 2016, n° 367467, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1004PLR.
[24] BOI-BIC-AMT-20-10, n° 120, du 12 septembre 2012 [en ligne].
[25] CE 8° et 9° ssr., 8 septembre 1999, n° 179832 N° Lexbase : A4970AXD.
[26] CE 3° et 8° ssr., 10 juillet 2007 n° 287661 N° Lexbase : A2849DXS.
[27] P. Collin, Quelles sont les incidences de la clôture de l’exercice en cours d’année et de l’arrivée d’associés passibles de l’IS, BDCF, 2007, n° 122.
[28] BOI-BIC-CHAMP-40-20, n° 270, du 23 février 2022 [en ligne].
[29] Pour une synthèse des conditions d’application de l’article 151 septies du CGI voir, Les Fourmis du patrimoine, Plus-values professionnelles et exonération en fonction du chiffre d’affaires [en ligne].
[30] BOI-BIC-CHAMP-40-20, n° 450 et suivant du 23 février 2022 [en ligne].
[31] BOI-RFPI-PVI-10-20, n° 120 et suivants du 5 août 2015 [en ligne].
[32] BOI-PAT-30-10-10-10, n° 50 et suivants du 2 mai 2019 [en ligne].
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485529
[Brèves] Procédure d’appel à jour fixe : précisions sur les éléments de saisine de la cour et de la sanction encourue
Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-20.690, FS-B N° Lexbase : A39569U3
Lecture: 2 min
N5570BZC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 25 Mai 2023
► Dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque ; les Hauts magistrats énoncent que la jurisprudence européenne et interne, l’article 922 du Code de procédure civile n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code précité, et que toute autre interprétation constituerait une entrave disproportionnée à l'accès au juge.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société, aux droits de laquelle est venu un fonds commun de titrisation, avait engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de ses débiteurs. Un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi. Les débiteurs ont interjeté appel à l’encontre du jugement d’orientation.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt (CA Paris, 1-10, 10 juin 2021, n° 20/16043 N° Lexbase : A67864UU), d’avoir déclaré leur appel irrecevable. Ils font valoir la violation par la cour d’appel des articles 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2438ITH, et 920 N° Lexbase : L6857LEP, 922 N° Lexbase : L0982H47 et 930-1 N° Lexbase : L7249LE9 du Code de procédure civile.
En l'espèce, la cour d'appel a retenu qu’elle n'a pas été valablement saisie par le dépôt au greffe d'une copie complète de l'assignation faute de comprendre la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, de l'ordonnance du premier président et d'une copie de la déclaration d'appel.
Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes articles 922 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoie l’affaire. La Haute juridiction énonce que la cour a été valablement saisie par la remise de la seule copie de l'assignation. Par ailleurs, les Hauts magistrats retiennent qu’il n’est nécessaire d'y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du Code de procédure civile et que l'absence de remise de cette assignation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485570
[Jurisprudence] Pièces communiquées à l’appelant d’une ordonnance de refus de restitution
Réf. : Cass. crim., 5 avril 2023, n° 22-80.770, F-D N° Lexbase : A32868D3
Lecture: 7 min
N5504BZU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Matthieu Hy, Avocat au Barreau de Paris, ancien secrétaire de la Conférence
Le 26 Mai 2023
Mots-clés : restitution • tiers appelant • pièces communiquées
Lors du recours contre une ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d’instruction sur le fondement de l’article 99 du Code de procédure pénale, le tiers appelant entre les mains duquel la saisie a été opérée ou qui justifie être titulaire de droits sur le bien saisi peut prétendre à la communication des procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie pénale spéciale, des réquisitions aux fins de saisie et de l’ordonnance de saisie d’une part, et des pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la chambre de l’instruction se fonde dans ces motifs décisoires d’autre part.
Contexte : Cass. crim., 21 octobre 2020, n° 19-87.071, FS-P+B+I N° Lexbase : A31933YW
À l’occasion d’une information judiciaire ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, la compagne d’un mis en examen a sollicité du juge d’instruction la restitution de deux sommes saisies en espèces à son domicile et au domicile de sa mère, prétendant, ainsi que l’exige l’article 99, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7471LPE, avoir des droits sur les biens saisis.
S’étant heurtée à un refus de restitution de la part du magistrat instructeur, la requérante a interjeté appel de l’ordonnance. Devant la chambre de l’instruction, elle a demandé la délivrance de certaines pièces. Lui a été communiquée la copie des procès-verbaux des perquisitions effectuées au domicile de sa mère ainsi qu’à son domicile et de son audition. En revanche, d’autres pièces paraissent lui avoir été refusées, dont celles relatives à une expertise des scellés. La chambre de l’instruction a confirmé le refus de restitution, d’une part, en émettant des doutes quant au fait que les espèces saisies provenaient de l’activité professionnelle de l’appelante ou de cadeaux familiaux et, d’autre part, en rappelant que son compagnon était impliqué dans un important trafic de stupéfiants et qu’il disposait d’un train de vie élevé caractérisé par le brassage d’argent en espèces et d’autres objets de valeur. Cette dernière s’est pourvue en cassation, se fondant notamment sur une violation du caractère contradictoire de la procédure.
Aux termes de l’article 99, alinéa 6, du Code de procédure pénale, « le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure ».
Si les textes prévoient la mise à disposition des « pièces de la procédure se rapportant à la saisie » en matière d’appel d’une ordonnance de saisie pénale spéciale [1], force est de constater qu’une telle règle ne figure pas à l’article 99 du Code de procédure pénale qui paraît priver le tiers appelant de toute pièce de la procédure, quelle qu’en soit la nature.
Dans la présente affaire, par arrêt en date du 27 juillet 2022 [2], la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait transmis au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de la requérante reprochant à l’article 99, alinéa 6, du Code de procédure pénale de méconnaître le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire. La Haute juridiction avait toutefois estimé la question sérieuse dans la seule mesure où l’impossibilité d’obtenir les pièces se rapportant à la saisie pourrait être susceptible de porter une atteinte excessive au droit à un recours effectif.
Par une décision en date du 28 octobre 2022 [3], rompant totalement avec les textes et la jurisprudence de la Cour de cassation déjà peu protecteurs du principe du contradictoire en matière de droit des saisies, le Conseil constitutionnel a estimé que si la chambre de l’instruction avait le loisir de communiquer certaines pièces se rapportant à la saisie au tiers, ce dernier ne pouvait exiger la communication.
Dans l’arrêt commenté, la Chambre criminelle a été contrainte d’ignorer les errements des Sages, dont il sera démontré plus loin que la solution était en tout état de cause illogique, et de se conformer à sa propre jurisprudence en instaurant un débat contradictoire dont le caractère minimaliste doit toujours être regretté.
Dans un arrêt en date du 21 octobre 2020 [4], se fondant sur l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme, les juges du Quai de l’Horloge ont décidé qu’au cours de la phase de jugement, le tiers sollicitant la restitution d’un bien placé sous main de justice devait se voir communiquer d’une part « les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie, l'ordonnance et, le cas échéant, la décision de saisie » et d’autre part, « les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles [la juridiction] se fond[ait] dans ses motifs décisoires ». Il doit être rappelé que l’article 479, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9923IQL dispose que « seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués ».
Dans l’arrêt commenté, la Chambre criminelle a repris la solution à l’identique en cas d’appel d’une ordonnance de refus de restitution devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel [5].
Cette solution désormais commune aux articles 99 et 479 du Code de procédure pénale s’aligne sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation s’agissant des pièces devant être communiquées à l’appelant d’une ordonnance de saisie pénale spéciale, aussi bien s’agissant du standard minimal exigé [6] que de la règle relative aux pièces précisément identifiées dans les motifs décisoires [7]. Une condition supplémentaire tient au fait que le requérant doit justifier être titulaire de droit sur le bien dont il sollicite la restitution ou que la saisie doit avoir été opérée entre ses mains.
Il est possible d’affirmer que, ce faisant, la Haute juridiction étend au contentieux des saisies de droit commun les règles du contentieux des saisies spéciales. Néanmoins, force est de constater que la solution exposée dans l’arrêt commenté s’applique également à l’appel des ordonnances de refus de restitution ou de mainlevée de biens initialement saisis en application des articles 706-141 N° Lexbase : L7245IMB et suivants du Code de procédure pénale. En effet, l’article 99 du Code de procédure pénale s’applique aux demandes de restitution de tous les biens placés sous main de justice, qu’ils aient fait l’objet d’une saisie de droit commun ou d’une saisie spéciale.
Ainsi comprend-on l’incohérence de la décision du Conseil constitutionnel. En effet, elle revenait à priver l’appelant d’une ordonnance de refus de restitution de pièces auxquelles il aurait pu prétendre en tant qu’appelant de l’ordonnance de saisie pénale spéciale portant sur le même bien.
À l’inverse, il aurait sans doute été incohérent d’assurer une meilleure garantie du contradictoire à l’appelant d’une ordonnance de refus de restitution en lui donnant accès à plus de pièces que celles mises à disposition de l’appelant d’une ordonnance de saisie pénale.
Pour autant, cette restriction de l’accès à la procédure demeure problématique. D’une part, ne transmettre à l’appelant que les pièces strictement liées à la saisie n’est d’aucune utilité dans l’argumentation du demandeur à la restitution. D’autre part, lui communiquer les pièces sur lesquelles la chambre de l’instruction se fonde dans ses motifs décisoires revient à faire respecter le contradictoire une fois la décision prise. Le caractère impraticable de la solution de la Cour de cassation apparaît en l’espèce lorsqu’est opposé à l’appelante le train de vie de son compagnon sans que la chambre de l’instruction ne soit contrainte de communiquer la moindre pièce à ce sujet au seul prétexte qu’elle ne s’appuie sur aucune pièce précise pour étayer son affirmation. Ainsi, plus la motivation est laconique, moins le respect du contradictoire s’impose.
[1] C. proc. pén., art. 706-148, al. 2 N° Lexbase : L5021K8H, 706-150, al. 2 N° Lexbase : L7454LPR, 706-153, al. 2 N° Lexbase : L7453LPQ, 706-154, al. 2 N° Lexbase : L6563MG8 et 706-158, al. 2 N° Lexbase : L7452LPP.
[2] Cass. crim., 27 juillet 2022, n° 22-80.770, F-D N° Lexbase : A32868D3.
[3] Const. const., décision n° 2022-1020 QPC du 28 octobre 2022 N° Lexbase : A21278R9.
[4] Cass. crim., 21 octobre 2020, n° 19-87.071, FS-P+B+I N° Lexbase : A31933YW ; également en ce sens : Cass. crim., 7 septembre 2022, n° 21-84.322, FS-B N° Lexbase : A18778HY.
[5] Outre l’arrêt commenté, dans la même affaire, à propos de la demande de la mère de la compagne : Cass. crim., 19 avril 2023, n° 22-80.883, F-D N° Lexbase : A75639Q8.
[6] Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-84.649, F-D N° Lexbase : A0290ZQS ; Cass. crim., 15 janvier 2020, n° 19-80.869, F-D N° Lexbase : A92583BI ; Cass. crim., 15 janvier 2020, n° 19-80.891, F-P+B+I N° Lexbase : A17503BG, n° 19-80.892, F-D N° Lexbase : A91623BX, n° 19-80.893, F-D N° Lexbase : A92413BU, n° 19-80.894, F-D N° Lexbase : A92023BG, n° 19-80.895, F-D N° Lexbase : A92763B8, n° 19-80.896, F-D N° Lexbase : A91503BI, n° 19-80.897, F-D N° Lexbase : A92283BE, n° 19-80.898, F-D N° Lexbase : A91893BX et n°19-80.899, F-D N° Lexbase : A91763BH ; Cass. crim., 5 mai 2021, n° 20-85.917, F-D N° Lexbase : A33494RH ;
[7] Cass. crim., 30 janvier 2019, n° 18-82.644, F-P+B N° Lexbase : A9811YUW ; Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-84.649, F-D N° Lexbase : A0290ZQS ; Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-87.097, F-P+B+I N° Lexbase : A0886ZSM ; Cass. crim., 15 janvier 2020, n° 19-80.869, F-D N° Lexbase : A92583BI ; Cass. crim., 15 janvier 2020, n° 19-80.891, préc., n° 19-80.892, préc., n° 19-80.893, préc., n° 19-80.894, préc., n° 19-80.895, préc., n° 19-80.896, préc., n° 19-80.897, préc., n° 19-80.898, préc., n° 19-80.899, préc. ; Cass. crim., 5 mai 2021, n° 20-85.917, préc. ; Cass. crim., 11 mai 2022, n° 20-80.494, F-D N° Lexbase : A09657XZ ; Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-80.896, FS-B N° Lexbase : A92229GN, n° 22-80.897 N° Lexbase : A73969IR, n° 22-80.898 N° Lexbase : A73929IM.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485504
[Brèves] Délégation du médecin du travail : confirmation sur le rôle de l'infirmier en santé au travail
Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 28 avril 2023, n° 465318, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A70239SW
Lecture: 4 min
N5521BZI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lisa Poinsot
Le 26 Mai 2023
► En cas de délégation par le médecin du travail, les infirmiers en santé au travail peuvent réaliser les visites de préreprise et de reprise du travail ainsi que la visite médicale de mi-carrière.
Faits et procédure. Une nouvelle fois, le Conseil national de l’Ordre des médecins demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-679, du 26 avril 2022, relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail N° Lexbase : L5162MC8. Il soutient que ce décret n’exclut pas, à son article 1er, les visites de préreprise et de reprise et la visite médicale de mi-carrière du champ des visites et examens pouvant être délégués par le médecin du travail à un infirmier en santé au travail.
| Rappel. Ce décret permet la délégation (C. trav., art. R. 4623-14 N° Lexbase : L5740MCL) aux infirmiers en santé au travail des visites de reprises (C. trav., art. R. 4624-31 N° Lexbase : L5761MCD) et de préreprise (C. trav., art. R. 4624-29 N° Lexbase : L0153MCN et R. 4624-30 N° Lexbase : L5764MCH) des salariés en invoquant « des risques graves pour la santé des travailleurs », un « risque de dégradation du système de prévention assuré par la médecine du travail ». |
Concernant les visites de préreprise et de reprise, le Conseil d’État relève qu’il est possible, par décret, de prévoir les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, à un infirmier en santé au travail la réalisation de visites de préreprise et de reprise. Ce décret ne méconnait pas les articles L. 4624-2-3 N° Lexbase : L4507L73 et L. 4624-2-4 N° Lexbase : L4508L74 du Code du travail, alors même que ces dispositions ne mentionnent pas expressément la possibilité d’une délégation par le médecin du travail à un infirmier en santé au travail de la réalisation des visites de préreprise et de reprise.
Par ailleurs, le Conseil d’État retient que le décret prévoit l’obligation de l’infirmier en santé au travail qui bénéficie de la délégation, de disposer de la formation et des compétences nécessaires, de les réaliser sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre de protocoles écrits, et dans le respect de leurs compétences respectives, réorienter le salarié vers le médecin du travail si nécessaire ainsi que dans les situations prévues par le protocole et que les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ne peuvent être émis que par le médecin du travail.
Sur les visites médicales de mi-carrière, le Conseil d’État affirme, au visa de l’article L. 4624-2-2 du Code du travail N° Lexbase : L4506L7Z, qu’il est possible, par décret, de permettre, dans les conditions qu'il définit, à un médecin du travail de déléguer à un infirmier en santé au travail la réalisation de la visite médicale de mi-carrière, parmi les visites et examens dont il autorise la délégation. Il n’est pas fait obstacle à la circonstance que les infirmiers en pratique avancée aient la possibilité de réaliser cette visite sans qu'ils aient reçu, au préalable et à cette fin, une délégation du médecin du travail.
La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette la requête du Conseil national de l’Ordre des médecins.
|
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485521
[Brèves] Fraude aux prestations : la réclamation de l’indu peut remonter sur vingt ans
Réf. : Ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559, B+R N° Lexbase : A39489UR
Lecture: 2 min
N5496BZL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 24 Mai 2023
► En cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.
Les faits et procédure. Un assuré est bénéficiaire d’une pension de réversion depuis le 1er septembre 2006. À la suite d’un contrôle de ses ressources, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) lui a notifié un indu de prestations pour la période allant du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2016, de fait de l’absence de déclaration de la pension de retraite complémentaire ainsi que de placements financiers.
Ce dernier a alors contesté l’indu.
La cour d’appel. Pour déclarer prescrite la créance de la caisse pour la période antérieure au 28 mai 2010, l'arrêt retient que, la demande de répétition ayant été formée le 28 mai 2015, seules les prestations indues versées à compter du 29 mai 2010 peuvent être répétées.
Un pourvoi a été formé par la CNAV et la deuxième chambre civile a renvoyé la question à l’analyse de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 20-20.559, FS-D N° Lexbase : A72968AH).
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction, dans sa formation la plus solennelle, casse et annule les arrêts rendus par la cour d’appel. Elle juge que l'action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration relève du droit commun, applicable en matière de répétition de l’indu (CSS, art. L. 355-3 N° Lexbase : L2886MGY et C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC). Elle ajoute que ce délai n’a pas d’incidence sur la prescription extinctive, dont la durée, déterminée par l’article 2232 du Code civil N° Lexbase : L7744K9P, est fixée à vingt ans. Ainsi, la caisse peut recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485496
[Brèves] Dispense de rapport des présents d’usage : oui, mais à quelle occasion ?
Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-18.616, F-D N° Lexbase : A33009UR
Lecture: 2 min
N5564BZ4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 25 Mai 2023
► Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui retient la qualification de présents d'usage, dispensés de rapport, sans préciser à l'occasion de quels événements le de cujus avait fait de tels cadeaux à son fils et conformément à quels usages.
Le présent arrêt vient utilement rappeler une solution déjà établie il y a près de dix ans (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-17.556, FS-P+B+I N° Lexbase : A6556KLE).
L'article 852 du Code civil N° Lexbase : L9993HNG dispose : « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
Pour rejeter les demandes de la sœur tendant à la condamnation de son frère, co-héritier, au rapport à la succession des sommes de 2 200 euros et de 1 300 euros retirées des comptes bancaires du de cujus les 15 mai 2004 et 9 décembre 2003 et en recel successoral correspondant, la cour d’appel de Chambéry avait retenu que ces sommes étaient compatibles avec les capacités financières de la donatrice et qu'elle avait ainsi pu effectuer ces versements au titre de présents d'usage, puisqu'elle vivait avec son fils, qui avait la charge de son entretien quotidien.
Certes, mais la motivation n’est pas suffisante. La Cour de cassation censure la décision pour défaut de base légale, reprochant aux conseillers d’appel de s’être déterminés ainsi, sans préciser à l'occasion de quels événements le défunt avait fait de tels cadeaux à son fils et conformément à quels usages.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485564
[Brèves] Exonération de TVA en matière de contrat d’affermage : une clarification du juge européen bienvenue !
Réf. : CJUE, 4 mai 2023, aff. C-516/21, Y N° Lexbase : A70559S4
Lecture: 4 min
N5527BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 24 Mai 2023
► Dans la lignée jurisprudentielle passée, la Cour de justice de l’Union européenne était amenée à trancher une question préjudicielle relative à l’exonération de TVA en matière d’affermage par un arrêt rendu le 4 mai 2023.
|
La question de l’exonération de TVA en matière de contrat d’affermage s’inscrit dans un contentieux jurisprudentiel relativement dense en la matière. En effet, par un arrêt rendu le 27 septembre 2012 (CJUE, 27 septembre 2012, aff. C-392/11, point 28, Field Fisher Waterhouse LLP c/ Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs N° Lexbase : A4353ITE), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une location de biens immeubles relevant de l’article 135,§1, sous 1), de la Directive TVA et des prestations de service liées à cette location peuvent constituer une prestation unique de location de biens immeubles au regard de la TVA. Par ailleurs, les juges européens ont également jugé dans un arrêt rendu le 18 décembre 2018 (CJUE, 19 décembre 2018, aff. C-17/18, Virgil Mailat N° Lexbase : A0691YRZ) que l'article 135, paragraphe 1, sous 1), de la Directive TVA devait être interprété en ce sens qu'un contrat de location portant sur un bien immeuble qui servait à l'exploitation commerciale d'un restaurant ainsi que sur les biens d’équipement et consommables nécessaires à cette exploitation constituait une prestation unique dans laquelle la location du bien immeuble était la prestation principale. |
Rappel des faits
- Un particulier a donné en location, dans le cadre d’un bail à ferme, un bâtiment d’élevage de dindes avec des outillages et des machines fixés à demeure.
- Par un bail à ferme, il est prévu que le bailleur perçoit une rémunération au titre de la mise à disposition du bâtiment d’élevage ainsi que des outillages et des machines. À ce titre, le bailleur estimait que la prestation d’affermage devait être exonérée de TVA.
- À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a émis des avis d’imposition rectificatifs au titre des années 2010 à 2014. Elle a notamment estimé que l’affermage des outillages et des machines ne pouvait être exonéré de TVA.
Procédure
- Le bailleur a introduit un recours contre l’avis de l’administration fiscale. Les juges du tribunal des finances allemand ont fait droit à la demande du requérant et ont jugé que la prestation d’affermage devait être exonérée totalement de TVA.
- Selon les juges allemands, la mise à disposition des outillages et des machines était constitutive d’une prestation accessoire à la mise à disposition du bâtiment d’élevage et devait être exonérée au même titre que celle-ci.
- L’administration fiscale a formé un pourvoi en révision contre ce jugement devant la Cour fédérale des finances. Les juges de la Cour fédérale des finances se sont fondés sur un arrêt de la CJUE en date du 19 décembre 2018 pour considérer que l’affermage de convoyeurs industriels à spirale, d’équipements de chauffage et de ventilation ainsi que de systèmes d’éclairage sont exonérés de TVA en vertu de l'article 135, paragraphe 1, sous 1), de la Directive TVA.
- Ainsi, la juridiction de renvoi a jugé que la prestation fournie présente un caractère unique et s’est alignée sur la décision rendue par les juges du tribunal des finances allemand. Elle décide néanmoins de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Question de droit. La Cour de Justice de l’Union européenne était amenée à trancher la question préjudicielle suivante :
L’obligation fiscale grevant la location d'outillages et de machines fixés à demeure s'applique-t-elle, en vertu de l'article 135, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la Directive TVA :
- à la seule location isolée (autonome) de ces outillages et machines ou bien également ;
- à la location (affermage) de ces outillages et machines, qui est exonérée, en vertu de l'article 135, paragraphe 1, sous 1), de la Directive TVA, sur la base (et à titre accessoire) de l'affermage de bâtiments conclu entre ces mêmes parties ?
Solution
À cette question, la Cour de Justice de l’Union européenne juge que l’article 135,§2, premier alinéa, sous c), de la Directive du 28 novembre 2006 relative à la TVA doit être interprété en ce sens qu’il ne s'applique pas à la location d'outillages et de machines fixés à demeure lorsque cette location constitue une prestation accessoire à une prestation principale d'affermage d'un bâtiment, réalisée dans le cadre d'un contrat d'affermage conclu entre les mêmes parties et exonérée en vertu de l'article 135, paragraphe 1, sous 1), de cette Directive, et que ces prestations forment une prestation économique unique.
En conséquence, en matière d’affermage, la location d’outils suit le sort de la prestation principale en ce qui concerne l’exonération de la TVA. La location d’outillages et de machines fixés à demeure constitue une prestation accessoire à une prestation principale d’affermage d’un bâtiment et doit être exonérée de TVA.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485527