[A la une] Et après...?
Lecture: 4 min
N3093BY9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Eric Morain, avocat au barreau de Paris, avocat associé, Carbonnier Lamaze Rasle & Associés
Le 29 Avril 2020
Il était tellement tentant - et aussi signifiant de nos peurs - de penser que le monde d'après serait meilleur. Le temps passant, la trésorerie s'asséchant, les mesures économiques gouvernementales passant sous nos yeux rougis de lecteurs du JO en nous oubliant allègrement, beaucoup en viennent à penser qu'il pourrait être pire. La récente enquête initiée par le CNB auprès de l'ensemble des barreaux en est l’exemple le plus frappant : 28 % des avocats déclarent vouloir changer de profession après la crise, et 11 % fermeront leur cabinet ou feront valoir leurs droits à la retraite, soit un total de plus de 27 000 avocats sur les quelques 70 000 que compte la profession en France.
Je le crois : nous allons assister en direct et impuissants à une véritable transformation majeure de l'ensemble de la profession d'avocat. Une sorte de changement d'ère. Soudaine. Brutale. Inédite. Douloureuse.
Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés... ça signifie que beaucoup mourraient quand même. Les chiffres de la profession sont là : une majorité écrasante d'exercice libéral sous forme de collaboration, ce fameux statut défendu pendant des années avec un jusqu'au-boutisme que chacun paye aujourd’hui, à commencer par les plus jeunes d'entre nous. Le "modèle" si répandu de l'avocat avec un collaborateur et demi vient d'exploser en plein vol. Et l'on peut gloser sans fin sur une poignée de grosses firmes ayant voulu baisser unilatéralement et donc abusivement les rétrocessions de leurs collaborateurs mais on ne parlera pas des centaines de nouveaux dossiers qui grossiront le rôle de la chambre des redressements civils laissant sur le carreau des milliers d'avocats. Le salariat était tellement vécu comme une infamie, survivance d'une époque où l'on posait sa plaque et où l'on était notables... Quelle modernité !
Ajoutons à cela des charges fixes d'une extrême lourdeur ponctionnant notre trésorerie aussi inexorablement qu'une échéance trimestrielle de TVA et qui sont la caractéristique commune de toutes nos structures : salaires des personnels administratifs, rétrocessions, loyers, charges sociales, abonnements. A ce premier constat cruel, s'ajoute le retard numérique de notre Justice qui est abyssal. Ayant pu échanger avec plusieurs avocats britanniques pendant cette crise, ceux-ci m'ont raconté leurs audiences quotidiennes en visio-conférence avec les magistrats, tout degrés de juridiction confondus. Alors que nos juridictions civiles, pénales, commerciales, familiales, prud’homale fonctionnent en mode dégradé et qu'il faut saluer celles et ceux, greffiers, juges, procureurs et avocats, qui ont assuré la permanence et les urgences d'un service public considéré pourtant comme non essentiel, ni même dans les 17 chantiers prioritaires du déconfinement annoncés par le Gouvernement. A quel degré de civilisation sommes-nous tombés pour considérer la Justice comme n'étant pas de première nécessité en tout temps, même et surtout par gros temps ? Alors que nos pièces jointes sont bloquées à plus de 4 Mo, qu'on commande encore des CD-ROM, qu'on reçoit des télécopies et que beaucoup de magistrats s'offusquent encore qu'on leur écrive sur leur adresse @justice.fr... Le parallèle a souvent été fait avec nos services de soins et de santé malades des coupes budgétaires et le service public de la Justice exsangue de moyens. Il n'y a pas que ça. Il a été rappelé pendant cette crise la chute vertigineuse des consultations médicales cardiaques ou neurologiques. Les médecins alertant les patients de continuer à consulter, à se rendre aux urgences et à ne pas transiger sur leur santé, au prétexte de l'épidémie. C'est ce qui se passe pour les justiciables. Ils n'ont de cesse de transiger sur leurs droits : trop loin, trop coûteux, trop lent, trop long, trop complexe. Si la transaction médicale affecte directement la santé de nos concitoyens, la transaction sur leurs droits crée un mal d'un autre ordre, plus profond et plus dangereux car il affecte directement la confiance en l'Etat de droit et en la démocratie. Et par là-même c'est la paix publique qui se trouve en danger. Nous avons à repenser non seulement le modèle économique de nos cabinets - faut-il des locaux aussi vastes ? -, repenser nos modes de travail - tiens donc, le télétravail ça fonctionne plutôt ? -, nos relations avec nos collaborateurs - qui auraient bénéficié du chômage partiel s'ils avaient été salariés, allégeant ainsi nos coûts - mais également à être les acteurs incontournables d'une réelle modernisation de la Justice entraînant dans notre sillage magistrats et greffiers qui auront, autant que nous à y gagner. Débarrassés alors de contingences, de lenteurs et de blocages techniques d'un autre siècle et indignes de la 6ème puissance mondiale mais hélas conforme au 14ème rang sur 28 en Europe s’agissant du budget alloué à la Justice, nous pourrons nous recentrer sur notre expertise en humanité et répondre à l'écho de Jacques Vergès parlant de l’avocat de demain et que chaque magistrat peut aussi faire sien :
« J'aimerais faire l'éloge de l'avocat du futur, capable de comprendre tous les hommes, [...] magicien et poète, toujours en mouvement et assumant mieux que personne l'humanité tout entière ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473093
[Brèves] Seconde loi de finances rectificative pour 2020 : mesures fiscales relatives aux abandons de loyer et accessoires
Réf. : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020, art. 3 (N° Lexbase : L7438LWE)
Lecture: 2 min
N3168BYY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Julien Prigent
Le 05 Mai 2020
► La seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7438LWE) a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020. Son article 3 fixe le sort des abandons de créances de loyers en matière de détermination des revenus imposables.
Ces dispositions concernent plus précisément les abandons de créances, dans leur intégralité, de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur, consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque (i) l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou (ii) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions prédéfinies, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. En outre, pour les revenus fonciers, lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bailleur doit pouvoir justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise.
Selon ces nouvelles dispositions, les abandons de ces créances ne constituent pas des revenus fonciers imposables (CGI, art. 14 B, nouv. N° Lexbase : L7515LWA) ou des recettes imposables au titre des bénéfices des professions non commerciales (CGI, art. 92 B, nouv. N° Lexbase : L7521LWH).
Ils constituent une charge déductible pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 39 N° Lexbase : L7516LWB) et pour la détermination des bénéfices des professions non commerciales dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 93 A, nouv. N° Lexbase : L7518LWD).
Concernant le locataire, l’article 209 du Code générale des impôts (N° Lexbase : L7520LWG) est modifié pour majorer le plafond d’un million d’euros d’imputation des déficits antérieurs du montant des abandons de ces créances de loyer et accessoires.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473168
[Point de vue...] Un virus qui contamine nos institutions et affaiblit leurs défenses immunitaires, une triste allégorie du régime des détentions provisoires en temps de crise sanitaire
Lecture: 10 min
N3034BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Romain Boulet, Avocat à la Cour, Membre de l’Association des Avocats Pénalistes (ADAP)
Le 29 Avril 2020
Face à l’épidémie de covid-19, les avocats pénalistes ont vu leur pratique bouleversée au quotidien. Il a fallu s’adapter, redéfinir nos modes de fonctionnement et de communication avec les magistrats, les greffiers et nos clients. La suppression des audiences, l’impossibilité d’accéder aux tribunaux, la difficulté de rentrer en maison d’arrêt et le nécessaire recours au télétravail ont été rapidement assimilés.
En revanche, il n’était guère attendu que nos institutions vacillent. C’est pourtant ce que les lois organiques de mars dernier ont engendré.
L’État de droit repose sur des principes fondamentaux censés résister en période de crise : c’est précisément en des temps troublés qu’ils doivent faire la preuve de leur solidité.
Ils ont volé en éclat en quelques jours.
Il y eut la loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6014LWN) suspendant les délais de traitement des questions prioritaires de constitutionnalité. Théoriquement, le Conseil d’État et la Cour de cassation avaient trois mois pour transmettre ces questions au Conseil constitutionnel, lequel avait à nouveau trois mois pour statuer.
Ces délais, indispensables garde-fou pour juger si une disposition législative est conforme à la Constitution, donc à notre socle des Droits de l’Homme, sont suspendus jusqu’au 30 juin.
C’était un premier motif d’inquiétude.
Plus concrètement, sur le fondement d’une loi d’habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT), une ordonnance n° 2020-206 du 25 mars portant adaptation des règles de procédure pénale (N° Lexbase : L5730LW7) est venue modifier notamment les dispositions relatives à la détention provisoire.
Rappelons brièvement que la détention provisoire est régie par les articles 143-1 (N° Lexbase : L9409IE9) et suivants du Code de procédure pénale qui encadrent strictement les conditions et les délais dans lesquelles un mis en examen, présumé innocent, peut être incarcéré. Cette décision ne peut être prise que par un juge des libertés et de la détention (JLD), magistrat du siège, à l’issue d’un débat contradictoire public entre le parquet et la défense. Le mandat de dépôt est de quatre mois en matière correctionnelle, un an en matière criminelle et peut être prolongé, dans certains cas définis par la loi, à l’issue de nouveaux débats contradictoires devant un magistrat du siège.
Les articles 145-1 (N° Lexbase : L4872K8X) et 145-2 (N° Lexbase : L3506AZU) du Code de procédure pénale prévoient qu’en tout état de cause, les délais maximums de détention provisoire sont de 2 ans en matière correctionnelle et 4 ans en matière criminelle, pour les infractions les plus graves.
L’ordonnance du 25 mars 2020 est venue aménager les conditions de ces débats en son article 19 : compte tenu de l’état d’urgence, les débats contradictoires relatifs aux prolongations de détentions provisoires devaient se tenir par principe en visio-conférence et, exceptionnellement, sur réquisitions écrites du procureur de la République avec observations orales du conseil.
Les avocats, peu friands de ces comparutions virtuelles, considéraient qu’il s’agissait là d’un renoncement raisonnable du fait de la situation sanitaire.
L’article 16 de l’ordonnance disposait par ailleurs que les délais maximums de détention, qu’il s’agisse des délais des détentions en cours d’instruction ou des détentions pour l’audiencement devant les juridictions de jugement, faisaient l’objet d’une prolongation de plein droit de deux mois, trois mois ou six mois en fonction de la peine encourue.
Cette disposition était en soi plus discutable, mais les avocats étaient conscients que la paralysie des audiences devait malheureusement entraîner une augmentation des délais de comparution.
Voilà un texte clair, discutable à la marge, que nous nous apprêtions à voir appliquer par les JLD.
Dès le lendemain, une circulaire d’application du garde des Sceaux venait cependant en obscurcir l’interprétation (Circ. DACG, n° 2020-12, du 26 mars 2020, Présentation des dispositions de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 N° Lexbase : L6081LW7).
Il y était indiqué, contrairement à la lettre du texte, que les mandats de dépôt en cours d’exécution faisaient l’objet d’une prolongation de plein droit.
Il en résultait, selon la Chancellerie, l’annulation pure et simple de tous les débats devant les JLD.
Pareille interprétation faisait évidemment l’objet de vifs débats au sein des juridictions et conduisait à un courriel de la directrice des Affaires criminelles et des Grâces du 27 mars 2020, courriel confirmant l’inexplicable interprétation du texte de la circulaire : tous les détenus provisoires de France voyaient la durée de leur mandat de dépôt allongée de plusieurs mois sans intervention du juge !
Ainsi, les fiches pénales étaient-elles modifiées de toute urgence dans les greffes des maisons d’arrêt [1] et des individus placés en détention provisoire dans une affaire criminelle voyaient-ils le contrôle d’un juge du siège repoussé à 18 mois !
Cette interprétation, particulièrement attentatoire aux libertés publiques, dictée par le pouvoir réglementaire, ne pouvait être approuvée par les magistrats pensions-nous. Une circulaire d’application n’étant pas une norme de droit opposable aux juges du siège, son interprétation erronée ne pouvait que rester lettre morte.
Las, malgré d’innombrables requêtes des avocats en ce sens, la très grande majorité des JLD ont souscrit à cette analyse.
Certains d’entre nous ont reçu des ordonnances disant n’y avoir lieu à prolongation (celles-là étaient au moins susceptibles d’un recours devant la chambre de l’instruction [2]), la plupart ont simplement été avertis par courriel ou par téléphone que leur débat était annulé.
Si quelques juridictions ont résisté (Créteil, Rouen, Boulogne, Coutances et Douai notamment ont continué à organiser des débats [3]…), l’immense majorité des magistrats du siège se sont inclinés devant l’interprétation de la Chancellerie.
Ce fut une terrible désillusion pour les avocats, persuadés que l’indépendance des juges du siège constituait une garantie contre ce type d’agressions institutionnelles.
Des pourvois ont été formés, c’est peu dire que leur résolution est attendue avec impatience.
Parallèlement, et très rapidement, le Conseil National des Barreaux, l’Association des Avocats pénalistes, l’Union des Jeunes Avocats, le Syndicat des Avocats de France, la Ligue des Droits de l’Homme, l’Observatoire International des prisons mais aussi le Syndicat de la Magistrature ont saisi le Conseil d’État en référé-liberté aux fins d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordonnance du 25 mars 2020 et la suspension de sa circulaire d’application.
Il y était soutenu que la prolongation de plein droit des détentions provisoires en cours était manifestement illégale :
- en ce que l’interprétation de la circulaire était contraire à la loi d’habilitation du 23 mars 2020 qui donnait au Gouvernement la possibilité d’aménager la prolongation des détentions provisoires en cours au vu des réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat : l’ordonnance interprétée comme supprimant les débats contradictoires excédait donc les termes de la loi d’habilitation ;
- elle était contraire au droit à la sûreté et au droit à un procès équitable prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et par la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui garantissent le droit de voir sa détention contrôlée par un juge et le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Le débat promettait d’être riche et passionnant… il n’eut jamais lieu.
Par une ordonnance du 3 avril 2020, le juge des référés suprême décidait que les demandes en référé n’étaient manifestement pas fondées (!) et pouvaient être rejetées par ordonnance sans qu’il soit nécessaire d’organiser une audience (CE référé, 3 avril 2020, n° 439894 N° Lexbase : A66273KN).
Loin de trancher les difficultés juridiques, le juge administratif ne les prenait même pas en compte. Il considérait que la prolongation des délais de détention maximums prévue par l’ordonnance était conforme à la loi d’habilitation et que la circulaire se contentait d’en expliciter la portée et les conséquences… sans relever la distinction entre les articles 16 et 19, ni la contradiction manifeste entre ladite circulaire et l’ordonnance !
Qu’une telle décision soit prise sans audience, sans débat contradictoire et dans le silence d’un Cabinet constituait une nouvelle gifle à la protection de nos droits fondamentaux.
Ces questions techniques, relatives à des principes essentiels de notre procédure pénale, ont cependant, ne l’oublions pas, des conséquences très concrètes pour des milliers de détenus en France [4].
En définitive, plus de 20 000 individus présumés innocents ont vu leur détention autoritairement prolongée de plusieurs mois, sans examen par un juge ni audition de leur avocat : s’ils formaient un recours devant la chambre de l’instruction, il était rejeté par ordonnance sans débat ; s’ils formaient une requête devant le Conseil d’État, elle était rejetée par ordonnance sans débat !
Au surplus, il n’a échappé à personne que les conditions de détention sont particulièrement difficiles en ce moment. Avant même l’épidémie, la France était condamnée, à nouveau, pour sa surpopulation carcérale [5].
Depuis la proclamation de l’état d’urgence, les gestes barrières et la distanciation sociale sont des vœux pieux dans un milieu où trois détenus dans une cellule de 9m² était devenu l’ordinaire.
L’insécurité est tout à la fois médicale et juridique.
Médicale parce que 76 détenus ont contracté le virus en détention, 433 en présentent les symptômes ; 204 surveillants pénitentiaires sont malades et 900 confinés à domicile ; un surveillant et deux prisonniers en sont morts [6].
Juridique parce que les magistrats ont entériné une modification arbitraire des délais de détention sans exercer leur devoir de contrôle.
A cette double insécurité s’adjoint une inégalité flagrante des citoyens devant la loi, puisque quelques juridictions éparses et isolées ont malgré tout su résister.
Comment expliquer qu’en France, en 2020, les dispositions législatives relatives à la liberté ne soient pas appliquées uniformément sur tout le territoire ?!
Toutes les digues qui doivent protéger les principes essentiels de notre droit, et notamment le recours effectif à un juge, ont cédé : cette crise sanitaire a entraîné la disparition du contrôle juridictionnel de la privation de liberté, de la première instance aux juridictions suprêmes.
Le corps judiciaire a besoin d’un remède de toute urgence, la Cour de Cassation en sera-t-elle le prescripteur ?
[1] Avec la mention ahurissante de « décision en matière pénale en date du 30/03/20 - réception mail JLD », où nous découvrions qu’un simple courriel pouvait entraîner la modification d’une fiche pénale alors qu’il nous est régulièrement répondu que nous « n’avons qu’à saisir le Tribunal Administratif » lorsque nous constatons des erreurs sur les fiches pénales de nos clients…
[2] Recours théorique puisque les présidents ont, par ordonnance insusceptible de recours, dit n’y avoir lieu à saisir la Cour sur le fondement de l’article 186 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2763KGG), une telle décision de JLD n’entrant pas dans le champ d’application des appels possibles…
[3] Deux décisions du 7 avril 2020 méritent ici d’être relevées : un jugement du tribunal correctionnel d’Epinal qui a ordonné une mise en liberté en constatant que « l’article 16 de l’ordonnance ne dispense pas d’un débat sur la prolongation » (T. corr. Epinal, 7 avril 2020) et surtout un arrêt de la chambre de l’instruction de Caen (CA Caen, 7 avril 2020) qui décide que « si la détention provisoire peut durer certes plus longtemps au total [le soulignement est de la juridiction], il appartient toujours au juge des libertés et de la détention, ou au tribunal correctionnel, ou à la chambre de l’instruction, ou au président de la chambre des appels correctionnels ou au président de la chambre de l’instruction, selon le rythme prévu par le Code de procédure pénale, de statuer sur la prolongation de la détention de l’intéressé ».
[4] Au 1er janvier 2020, sur 70 651 détenus, 21 075 étaient en détention provisoire, soit près de 30 % de la population carcérale.
[5] CEDH, 30 janvier 2020, 9671/12, JMB et autres c/ France (N° Lexbase : A83763C9), v. Y. Carpentier, Mise en demeure de la CEDH à propos du surpeuplement carcéral en France, Lexbase Pénal, mars 2020 (N° Lexbase : N2631BY4).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473034
[Brèves] Covid-19 et Québec : le CAIJ (Centre d’accès à l’information juridique) propose aux professionnels du droit un dossier spécial complet
Lecture: 1 min
N3169BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 29 Avril 2020
Dans le cadre de la pandémie causée par la covid-19, l'équipe du CAIJ (Centre d'accès à l'information juridique) a regroupé, au sein d’un dossier éditorial très complet, l’information juridique pertinente afin de vous accompagner. Elle est organisée par domaines de droit et sera régulièrement enrichie. Vous y trouverez notamment de l’information en matière de force majeure, de santé, de travail et emploi, de faillite et insolvabilité et de droit public et administratif ainsi que des liens utiles vers les principales sources du Gouvernement du Québec et du Canada.
Qu’est-ce que le CAIJ ?
Le CAIJ existe pour permettre aux membres du Barreau du Québec, à la magistrature et aux professionnels du droit d’accompagner leurs clients et pour contribuer à la réussite académique des étudiants en droit. En tant que courtier, le CAIJ fournit à ses membres toute l’information juridique dont ils ont besoin grâce à la force de son réseau.
Mémoire du droit au Québec, le CAIJ s’engage à acquérir les meilleurs contenus, à choisir les meilleurs outils technologiques et à répondre à toutes vos questions pour faciliter votre prise de décision. Comptant près de 52 000 titres en bibliothèque de cotravail et en ligne, le CAIJ est la plus grande source d’information juridique au Québec et figure parmi les plus importantes en Amérique du Nord.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473169
[Brèves] Ordonnance « Covid-19 » du 22 avril 2020 : les adaptations de la réglementation concernant la sphère publique
Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS)
Lecture: 4 min
N3092BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 29 Avril 2020
► Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS), et présente plusieurs adaptations de la réglementation en matière de domaine public, de commande publique, d’urbanisme ou encore de droit électoral.
Certains délégataires de services publics doivent fermer leurs portes en raison du confinement et des mesures de restriction de circulation, comme par exemple les structures d'accueil de la petite enfance. Pour sécuriser leur situation, l'article 20 de l’ordonnance précise d'une part, que les mesures destinées à les soutenir financièrement s'applique non seulement en cas de décision expresse de suspension prise par l'autorité concédante, mais également lorsque l'arrêt de l'activité est la conséquence nécessaire d'une mesure de fermeture d'établissement prise par l'autorité de police administrative.
Concernant les entreprises qui exercent une activité commerciale sur le domaine public, celles dont l'activité est fortement dégradée du fait de l'épidémie de covid-19 pourront voir suspendre le versement des redevances d'occupation domaniale.
Cette disposition serait applicable aux contrats de la commande publique, comme les contrats de mobilier urbain, qui ne peuvent bénéficier des autres dispositions de l'ordonnance en l'absence de suspension de leur exécution, ainsi qu'aux pures conventions domaniales, qui sont des contrats publics par détermination de la loi (CGCT, art. L. 2331-1 N° Lexbase : L9545DNT) mais ne peuvent bénéficier ni des dispositions applicables aux marchés ou aux concessions ni de la théorie de l'imprévision.
Enfin, afin de pallier les difficultés rencontrées par les collectivités locales, leurs établissements publics et leurs groupements pendant la période de confinement pour réunir les commissions d'appel d'offres et les commissions de délégation de service public et afin d'accélérer les procédures, il est proposé de déroger aux articles L. 1411-6 (N° Lexbase : L3969KYN) et L. 1414-4 (N° Lexbase : L9125KBL) du Code général des collectivités territoriales qui imposent le passage en commission pour les avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent une augmentation du montant du contrat de plus de 5 %.
L'article 23 de l'ordonnance procède à un ajustement de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), concernant, notamment, le régime spécifique de suspension des délais pour l'instruction de certaines procédures (autorisations d'urbanisme, préemption). La suspension de ces délais pour une période plus brève doit s'accompagner de la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer par décret la reprise du cours des délais dans les conditions fixées par l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020. C'est la raison pour laquelle les articles 12 ter et 12 quater de cette ordonnance sont précisés.
L'article complète également l'article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pour que les délais d'instruction des autorisations de travaux et des autorisations d'ouverture et d'occupation prises en application du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH), ainsi que ceux des autorisations de division d'immeubles, reprennent leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire et non un mois plus tard.
Enfin, à l'article 25 de l’ordonnance, la réduction de dix à cinq jours des délais de dépôts des candidatures pour l'élection des conseillers Français de l'étranger et délégués consulaires de juin 2020 prend en compte le fait que la plupart des listes des candidats ont déjà fait l'objet d'une finalisation et d'un enregistrement en mars 2020.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473092
[Brèves] Des éclairages fournis par l’Autorité de la concurrence à une association professionnelle sur ses possibilités d’action concernant les loyers de ses adhérents
Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 22 avril 2020
Lecture: 3 min
N3082BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 29 Avril 2020
► Sollicitée par une association professionnelle représentant des opticiens souhaitant intervenir au soutien de ses membres en raison des conséquences de l’épidémie de covid-19 dans leurs échanges avec les sociétés foncières concernant les loyers commerciaux, l’Autorité de la concurrence confirme que les modalités de l’intervention envisagée ne semblent pas contraires au droit de la concurrence (Aut. conc., communiqué de presse du 22 avril 2020).
Pour rappel, compte tenu de la crise exceptionnelle liée à la pandémie du covid-19, les autorités de concurrence de l’Union européenne ont indiqué qu'elles pouvaient éclairer les entreprises de façon informelle sur la compatibilité des comportements de coopération envisagés pour répondre à cette crise avec le droit de la concurrence (cf. l’annonce de l’ECN -texte en anglais-).
Le Rassemblement des opticiens de France (ROF) a sollicité, dans ce cadre, l’Autorité au sujet d’une initiative visant à envoyer un courrier à un certain nombre de bailleurs aux fins de solliciter un aménagement des loyers commerciaux de ses adhérents.
L’Autorité relève qu’une telle démarche n’entre pas dans le champ du document-cadre publié par la Commission, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une coopération destinée à « garantir la fourniture et la distribution en suffisance de produits et de services essentiels dont la disponibilité est limitée pendant la pandémie de covid-19 et, de la sorte, remédier à la pénurie de ces produits et services essentiels résultant, d’abord et avant tout, de la croissance rapide et exponentielle de la demande » (cf. § 14 de la communication de la Commission européenne « Cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de covid-19 », publié au JOUE du 8 avril 2020).
La démarche envisagée relève du champ des actions mises en œuvre par les associations professionnelles pour défendre les intérêts de leurs membres. L’Autorité retient alors, à ce titre, que le comportement consistant, pour une organisation professionnelle, à apporter des conseils, de manière générale, à ses membres, dans le contexte de la pandémie de covid-19, sur l’application de dispositions prises par les pouvoirs publics ou sur l’interprétation de contrats existants et à exprimer sa position par écrit entre, à première vue, dans le cadre de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels dont elle a la charge.
L’Autorité relève que le ROF a indiqué ne prodiguer que des recommandations générales et exposer des arguments juridiques et factuels au soutien des demandes de ses adhérents. Le ROF a par ailleurs précisé qu’il ne déterminerait pas le comportement que ses adhérents devraient adopter. Enfin, son action vise à prévenir les risques de défaillances d’entreprises en raison de la fermeture prolongée des différents points de vente ; elle ne semble pas, en l’espèce, permettre une coordination sensible des coûts des acteurs concernés. Au vu de ces éléments, la démarche envisagée, telle qu’elle a été décrite à l’Autorité, n’est pas de nature à être considérée comme une intervention anticoncurrentielle sur le marché.
L’Autorité précise, par ailleurs, que son analyse ne pourrait, en tout état de cause, concerner ni des échanges sur les prix, ni des échanges directs ou indirects d’informations sensibles entre adhérents, telles que les conditions applicables concrètement à leurs contrats respectifs.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473082
[Brèves] Seconde loi de finances rectificative pour 2020 : nouveaux aménagements du prêt garanti par l’Etat (PGE)
Réf. : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 16 (N° Lexbase : L7438LWE)
Lecture: 6 min
N3126BYG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 29 Avril 2020
► La seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7438LWE) a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020. Son article 16 procède à de nouveaux ajustements du prêt garanti par l’Etat (PGE).
Pour rappel, l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L5505LWS) a autorisé l'octroi de la garantie de l'Etat dans la limite d'un encours total de 300 milliards d'euros pour des prêts de trésorerie contractés par des entreprises non financières immatriculées en France auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 inclus. Un arrêté du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5530LWQ ; lire N° Lexbase : N2732BYT), modifié par un autre arrêté du 17 avril 2020 (N° Lexbase : L7137LWA ; lire N° Lexbase : N3064BY7) est venu préciser les conditions d'application de la garantie. L’article 16 de la seconde loi de finances rectificative du 25 avril 2020 apporte des aménagements aux prêts garantis par l’Etat.
- Elargissement des « prêteurs » pouvant demander à bénéficier de la garantie de l’Etat
Dans le texte d’origine, la garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement. La loi du 25 avril 2020, y inclus les prêts consentis par les intermédiaires en financement participatif agissant pour le compte des prêteurs (art. 16, I, 1°).
Il est néanmoins précisé que, dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si les vérifications de Bpifrance conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges, la responsabilité de l'intermédiaire est engagée, au titre d'un manquement à ses obligations professionnelles, vis-à-vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l'Etat aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli (art. 16, I, 7, c)).
- Elargissement des entreprises éligibles à la garantie de l’Etat
En premier lieu, la première loi de finances rectificative prévoyait que la garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis à des entreprises non financières immatriculées en France. Désormais ne sont exclus que les prêts consentis aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Sont donc notamment inclus dans le dispositif les établissements de paiement, les « fintechs », ou encore les établissements de monnaie électronique (art. 16, I, 2°).
En second lieu, la première loi de finances rectificative excluait de la garantie de l’Etat les prêts octroyés aux entreprises faisant l’objet de procédures collectives, ce qui rendait le dispositif français plus restrictif que les limites établies par le cadre temporaire adopté par la Commission européenne le 19 mars 2020. La seconde loi de finances rectificative du 25 avril supprime cette exclusion des entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (art., 16, I, 5°).
Ces modifications laissent une plus grande marge de manœuvre au pouvoir réglementaire, auquel il reviendra toutefois le soin de préciser le périmètre exact des entreprises éligibles, en particulier s'agissant des entreprises faisant face à des difficultés au sens du droit de l'Union européenne.
- Conditions de mise en œuvre du dispositif
Modification du périmètre des entreprises pour lesquelles la garantie est accordée de droit. La première loi de finances rectificative prévoyait que sont concernées les entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés ou qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. La loi du 25 avril 2020 rend ces conditions cumulatives et conditionne l'octroi de la garantie à un arrêté du ministre chargé de l'Economie pour les entreprises employant au moins 5 000 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros. L'arrêté du 23 mars 2020 exigeait déjà cumulativement les deux critères du nombre de salariés et de chiffre d'affaires pour l'application du plafond maximal de garantie de 90 % du montant du prêt.
Notification du refus d’octroi des plus petits prêts. La loi ajoute que tout refus de consentement d'un prêt de moins de 50 000 euros qui répond au cahier des charges par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l'entreprise à l'origine de la demande de prêt (art. 16, I, 7°). On relèvera que le texte n’exige qu’une notification et non une motivation du refus, comme cela était d’ailleurs proposé par l’amendement à l’origine de cet ajout.
Forme des prêts octroyés aux petites entreprises. La seconde loi de finances rectificative précise que jusqu'au 31 décembre 2020, les prêts octroyés à des très petites entreprises ou à des petites entreprises prennent la forme de prêts participatifs, afin de renforcer leurs fonds propres et d'assurer la pérennité de leur activité et des emplois associés (art. 16, I, 8°).
- Gestion du dispositif par Bpifrance
La loi du 25 avril 2020 élargit les recettes que l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA est amené à recouvrer dans le cadre de la gestion du dispositif (art. 16, I, 7° a)). Elle prévoit en outre que l’Etat procède à un versement à Bpifrance pour que l’établissement puisse payer les sommes dues au titre de la garantie sur la base des appels éligibles (art. 16, I, 7° b)).
- Renforcement du comité de suivi
La première loi de finances a mis en place un comité de suivi afin de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des deux principales mesures de soutien financier, à savoir la garantie de l’Etat et le fonds de solidarité aux très petites entreprises.
En premier lieu, la loi du 25 avril renforce l’information du comité de suivi. A cette fin, il doit notamment, disposer d'une statistique hebdomadaire sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse ainsi que sur les versements du fonds de solidarité (art. 16, I, 9°).
En second lieu, la loi du 25 avril étend les missions du comité de suivi. Sont désormais concernés : la garantie de l'Etat aux prêts de trésorerie et le fonds de solidarité, mais également la réassurance publique des assureurs-crédit gérés par la Caisse centrale de réassurance pour le volet « domestique » et Bpifrance Assurance Export pour le volet « export », le dispositif d'activité partielle et les prêts et avances remboursables octroyés par le fonds de développement économique et social (FDES) (art. 16, I, 9°).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473126
[Brèves] Ordonnance « Covid-19 » du 22 avril 2020 : nouvelles dispositions en matière d’AT/MP
Réf. : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS
Lecture: 3 min
N3102BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 29 Avril 2020
► Une ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 N° Lexbase : L7287LWS) a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2020.
Parmi les nombreuses dispositions qu’elle contient, certaines intéressent directement les délais en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles ainsi que le contentieux médical qui pourrait être lié.
1 / Les délais relatifs aux AT/MP
L'article 14 prolonge les délais maximaux dont les caisses de Sécurité sociale disposent pour l'instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi qu'aux contestations d'ordre médical de leurs décisions.
A noter : les dispositions suivantes sont aussi applicables aux employeurs et salariés dépendant du régime agricole.
Quelle période retenir ? prolongation des délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 au plus tard.
Ci-dessous, un tableau répertoriant l'ensemble des délais modifiés par l'ordonnance.
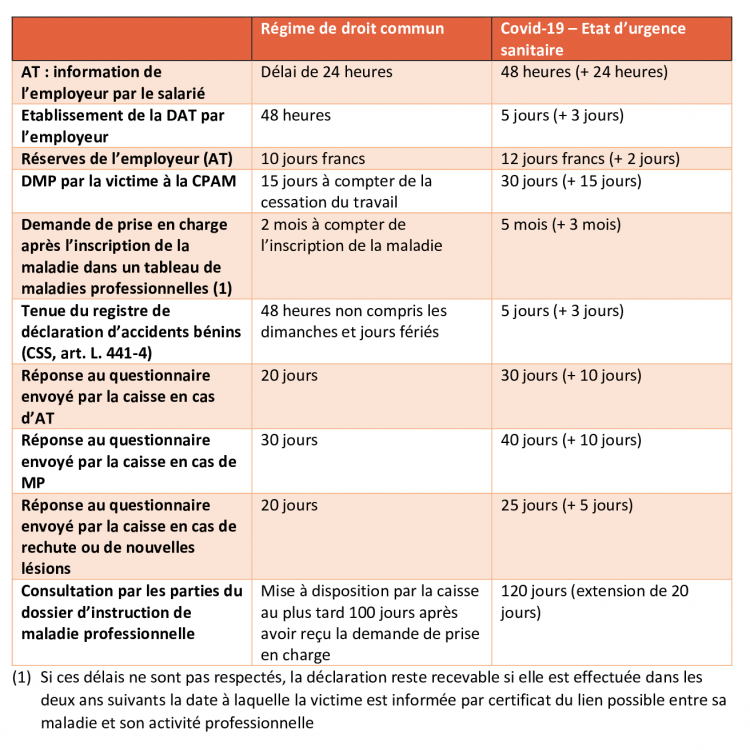
L’ordonnance assouplit aussi les délais imposés à la caisse pour instruire les dossiers et statuer sur les demandes de prises en charges reçues.
Pour rappel, la caisse dispose de :
- 30 jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident ou pour adresser des questionnaires à l’employeur et au salarié lorsqu’un complément d’instruction nécessaire (cf. notre infographie N° Lexbase : X4523CHY) ;
- 120 jours à compter de la réception du dossier complet de maladie professionnelle pour instruire et statuer ou pour transmettre le dossier au CRRMP (cf. notre infographie N° Lexbase : X4522CHX) ;
- 60 jours à compter de la réception du certificat médical initial de rechute ou de nouvelle lésion pour statuer sur leur prise en charge.
Ces délais sont prorogés par un arrêté à venir du ministre chargé de la Sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
2/ Le contentieux médical
Le contentieux médical ne concerne pas que les contentieux des AT/MP mais nous pouvons juger que ces contentieux en constituent l’essentiel, notamment les contestations des taux d’incapacité partielle.
Ces contentieux sont notamment portés devant les commissions médicales de recours amiables qui sont constitués de médecins.
Ainsi, d’après l’ordonnance, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, entre le 12 mars 2020 et une date définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et ne pouvant excéder le 12 septembre 2020, donner compétence à une commission médicale de recours amiable autre que celle compétente à la date de notification de la décision contestée, pour connaître de tout ou partie des recours qui n'ont pas donné lieu à une décision, le cas échéant implicite, au 12 mars 2020 ou qui ont été introduits entre cette date et une date fixée par arrêté et ne pouvant excéder le 12 septembre 2020.
Le requérant est informé du transfert de son recours par tout moyen.
L’ordonnance prévoit également que le délai à l’issue duquel, un assuré ou un employeur peut considérer son recours implicitement rejeté est prolongé passant ainsi de 4 mois à 8 mois.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473102
[Brèves] Liste des délais en matière sociale qui dérogent au principe de suspension des délais posé dans le cadre de la crise sanitaire
Réf. : Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020, portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi (N° Lexbase : L7382LWC)
Lecture: 6 min
N3115BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 29 Avril 2020
► Publié au Journal officiel du 25 avril 2020, le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 (N° Lexbase : L7382LWC) restaure des délais administratifs en droit du travail qui étaient suspendus par l'ordonnance du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5730LW7) afin de faire face à l'état d'urgence sanitaire.
Pour rappel, cette ordonnance a suspendu les délais de certaines procédures administratives, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire.
Le décret du 24 avril 2020 dresse la liste des catégories d'actes, de procédures et d'obligations, prévus par le Code du travail, pour lesquels, par dérogation, les délais reprennent leur cours à compter du 26 avril 2020. Ces dérogations sont fondées sur des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l'emploi et de l'activité, ainsi que sur les motifs de sauvegarde de l'emploi et de l'activité et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.
La liste des délais dont le cours a repris est reproduite dans le tableau ci-dessous.
| Actes, procédures et obligations | Textes applicables |
| Validation ou homologation par l'autorité administrative de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi |
|
|
Validation ou homologation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire
|
|
| Homologation de la rupture conventionnelle |
|
| Notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective |
|
|
Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt temporaire
| C. trav., art. R. 4731-12 |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473115
[Jurisprudence] Le risque de la poursuite d’activité dans un contexte d’état d’urgence sanitaire
Réf. : TJ Nanterre, référé, 14 avril 2020, n° 20/00503 (N° Lexbase : A79303KW) et CA Versailles, 24 avril 2020, n° 20/01993 (N° Lexbase : A99883K7)
Lecture: 14 min
N3136BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Bruno Fieschi, avocat associé, Flichy Grangé Avocats
Le 29 Avril 2020
Résumé : Par une ordonnance de référé rendue le 14 avril 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre en formation collégiale a ordonné à la société Amazon de procéder à l’évaluation des risques professionnels inhérente à l’épidémie du covid-19 sur l’ensemble de ses entrepôts, ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8043LGY). Dans l’attente de la mise en œuvre de ces mesures, la juridiction a ordonné une restriction d’activité, assortie d’une astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, en limitant dans le temps l’effet de l’astreinte. En appel, la cour a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle ordonnait à l’entreprise de procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérent à cette épidémie sur l’ensemble des entrepôts ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures prévues par l’article L. 4121-1 du Code du travail. La cour allège également le montant de l’astreinte et les modalités de liquidation de celle-ci.
L’origine du contentieux. Cette décision est rendue dans un contexte particulier. Cinq établissements de l’entreprise avaient fait l’objet de mises en demeure de différentes DIRECCTE de mettre en oeuvre des mesures de prévention du risque covid-19 telles que préconisées par le ministère de la Santé, et de respecter des principes généraux de prévention conformément aux dispositions de l'article L. 4121-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6801K9R) en mettant en place, une organisation et des moyens adaptés, notamment les mesures barrières et gestes de distanciation sociale. L’entreprise avait d’une part, exercé les voies de recours à l’encontre de ces mises en demeure, et d’autre part, cherché à adapter sa politique de prévention des risques liés au covid-19.
L’action devant le juge des référés. Une des organisations syndicales de l’entreprise a pris l’initiative de faire assigner cette dernière devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé aux fins de voir ordonner, à titre principal, l'arrêt de l'activité des entrepôts en ce qu'ils rassemblent plus de 100 salariés en un même lieu clos de manière simultanée, et à titre subsidiaire, l’arrêt de la vente et la livraison de produits non essentiels, c'est-à-dire ni alimentaires, ni d'hygiène, ni médicaux et donc de réduire le nombre de salariés présents simultanément de telle sorte qu'il ne dépasse pas 100 salariés par entrepôt, et ce, sous astreinte de 1 181 000 euros par jour et par infraction, à compter des 24 heures du prononcé de l'ordonnance à intervenir, ce tant que n'auront pas été mis en oeuvre :
- une évaluation des risques professionnels inhérents à la pandémie de covid-19 site par site ;
- des mesures de protection suffisantes et adaptées à chaque site qui découleront de cette évaluation ;
- des outils de suivi des cas d'infection avérées ou suspectées et des mesures pour protéger les salariés qui pourraient avoir été au contact des personnes concernées.
Le fondement de la saisine du juge des référés. L’article 835 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9135LTI) dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La particularité de ce référé dit conservatoire tient à l’éviction de la condition d’urgence et à l’indifférence de l’existence d’une contestation sérieuse. Pour fonder sa décision, le juge doit constater l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite. L’insuffisance de constatation du juge est de nature à justifier une cassation pour défaut de base légale. Si l’appréciation de ces critères relève du pouvoir souverain du juge des référés, la Cour de cassation se réserve le droit de contrôler le caractère manifestement illicite du trouble invoqué [1].
L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre. Avant même d’apprécier la validité de l’évaluation des risques professionnels par l’employeur, le juge relève que le CSE n’avait pas été associé à l’évaluation des risques professionnels qui aurait été menée par la direction alors que l’organisation du travail avait été modifiée. En cela, il n’est pas suffisant d’informer a posteriori les représentants des salariés des mesures prises et le juge retient que les éléments fournis ne permettaient pas d’établir la preuve de l’information et de son contenu. C’est à travers ce prisme que la juridiction a apprécié si l’employeur avait satisfait à son obligation d’évaluation des risques inhérents à l’épidémie du covid 19.
En la matière, elle a procédé à un contrôle rigoureux et en l’état des mises en demeure préalables adressées aux établissements, cette rigueur s’est clairement manifestée dans l’appréciation des éléments de preuve proposés par l’employeur puisqu’à plusieurs reprises, les juges de première instance ont considéré ces éléments comme insuffisants ou incomplets. Ainsi, la juridiction a retenu que le risque de contamination en lien avec l’utilisation de portique tournant à l’entrée de l’entrepôt n’était pas évalué. Elle relève une insuffisante évaluation des risques du fait de l’utilisation des vestiaires. Elle retient que l’entreprise ne justifie pas de l’intégralité des plans de prévention actualisés avec toutes les entreprises extérieures ; la manipulation successive des colis de main à main de la réception à la livraison n’avait pas été évaluée dans le document unique d’évaluation des risques (DUER), l’information et la formation à destination des salariés n’étaient ni suffisantes ni adaptées au regard des risques élevés de contamination lié à la nature de l’activité de l’entreprise, et une insuffisante évaluation des risques psycho-sociaux en lien avec le risque épidémique et de la réorganisation du travail induites par les mesures mises en place. Finalement, la juridiction faisait le constat que si l’entreprise « a effectué une évaluation des risques induits par l’épidémie du virus covid-19, cette dernière est insuffisante et la qualité de celle-ci ne garantit pas une mise en œuvre permettant une maîtrise appropriée des risques spécifiques à cette situation exceptionnelle ». La juridiction a alors estimé pertinent et proportionné d’assortir son injonction de procéder à une évaluation des risques d’une astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard et par infraction constatée.
L’arrêt rendu le 24 avril 2020 par la cour d’appel de Versailles. A la suite de cette décision, l’entreprise décidait de cesser l’activité de ses entrepôts, et interjetait appel de cette ordonnance. En appel, la cour confirme l’injonction prononcée en première instance. Néanmoins, la motivation de l’arrêt d’appel se veut plus précise juridiquement et en même temps plus pédagogique.
Dans un premier temps, la cour retient que la pertinence de l’évaluation des risques repose en grande partie sur la prise en compte des situations concrètes de travail, dans une démarche pluridisciplinaire, et sur la consultation du CSE central sur les mesures d’adaptation communes aux six établissements, s’agissant d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ainsi que les conditions de travail. La cour ajoute que si la société doit consulter le CSE central dans le cadre de l’évaluation des risques pour la mise en œuvre des mesures appropriées, il ne faut pas occulter les CSE d’établissement lesquels devaient être également consultés. Pour justifier une telle démarche, la cour met plus particulièrement en avant la nécessité de prévenir les risques psycho-sociaux dans un contexte anxiogène en raison du risque épidémique et des réorganisations induites par les mesures mises en place pour prévenir ce risque.
Dans un second temps, elle adopte la motivation des premiers juges en relevant l’insuffisante prise en compte des risques liés à l’entrée sur le site, à l’utilisation des vestiaires, aux interventions des entreprises extérieures, à la manipulation des colis, à la nécessité de la distanciation sociale et à la formation des salariés. Si la cour convient que l’entreprise avait pris des mesures de sécurité, elle retient néanmoins que ces mesures ne s’inscrivaient pas « dans un plan d’ensemble maîtrisé » ce qui fait écho aux dispositions du 7° de l’article L. 4121-2 du Code de travail qui prévoient de planifier la prévention dans un ensemble cohérent. La cour considère, en conséquence, qu’à la date à laquelle les premiers juges ont statué, il existait donc bien un trouble manifestement illicite qui exposait les salariés de chaque site à un dommage imminent de contamination susceptible de se propager à des personnes extérieures à l’entreprise.
Dans un troisième temps, la cour devait apprécier au jour où elle statuait, si le trouble manifestement illicite demeurait. A cette fin, elle a apprécié site par site l’évolution du processus d’évaluation des risques mené par l’entreprise, et ce conformément à sa demande. Finalement, la cour constate que le processus n’avait pas été mené à son terme dans 5 établissements sur 6. Pour retenir que l’évaluation des risques avait été menée de manière satisfaisante dans l’un d’entre eux, la cour retient que :
- le médecin du travail et les représentants du personnel avaient participé à plusieurs réunions ;
- le projet de DUER avait pris en compte les préconisations du médecin du travail, et répertoriait les risques par lieu et/ou par fonction, les mesures déjà prises, les suggestions des salariés ainsi que les mesures pour y répondre, et la date de mise en œuvre de ces dernières mesures.
Autrement dit, pour cet établissement, l’entreprise arrivait à démontrer que les mesures de préventions adoptées s’inscrivaient dans un ensemble cohérent procédant d’une évaluation préalable des risques pluridisciplinaires.
Dans un quatrième temps, la cour a jugé que le CSE central et les CSE des établissements devaient être consultés et associés à l’évaluation des risques professionnels dont l’injonction était confirmée en appel. La cour d’appel a néanmoins estimé nécessaire d’être plus mesurée dans l’aménagement des mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite, étant précisé qu’en appel, le montant de l’astreinte est significativement inférieur à celui ordonné par le juge de première instance. En outre, l’astreinte n’était plus due « par jour de retard et par infractions constatées », mais due « pour chaque réception, préparation ou expédition de produits non autorisés ».
Les conséquences juridiques de ces décisions de justice. La première d’entre elles qui n’a pas été jusqu’alors évoquée, tient au rejet par le juge de première instance et d’appel de la demande de l'arrêt de l'activité des entrepôts de l’entreprise en ce qu'ils rassemblaient plus de 100 salariés en un même lieu clos, en méconnaissance de l’interdiction édictée par les articles 2 de l’arrêté du 14 mars 2020 (N° Lexbase : Z229179S) et 7 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5507LWU). Cette demande est rejetée dès lors que si le législateur a restreint la liberté de réunion des citoyens, il n’a pas entendu interdire la poursuite de l’activité des entreprises autres que celles énumérées à l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Cette motivation doit être rapprochée de celle retenue par le Conseil d’Etat [2] qui saisit en référé par la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, devait de se prononcer sur la poursuite de l’activité des industries de la métallurgie. Le Conseil d’Etat, a justifié la poursuite de l’activité des entreprises autres que celles qui accueillent du public, par l’analyse de ce qu’un confinement total n’est pas nécessaire pour combattre l’épidémie et par l’extrême difficulté de distinguer les entreprises dont la poursuite d’activité est indispensable dans la situation actuelle et celles dont la poursuite d’activité est directement ou indirectement nécessaire à ces dernières. La seconde est d’ordre général et propre à l’intervention du juge des référés dans le contexte d’une crise sanitaire majeure. Il s’agit de décisions d’espèces, mais dont la portée risque d’être décuplée en ce qu’elles peuvent faire jurisprudence, et ainsi du particulier au général, c’est un arbitrage qui est opéré entre la santé des travailleurs, l’intérêt du consommateur et les conditions sanitaires et donc économiques de la poursuite d’activité. La troisième est que l’obligation légale de prévention des risques professionnels de l’employeur ne se limite pas, dans un contexte d’épidémie, à mettre en place des outils et des procédures efficaces, comme en justifiait l’entreprise, de suivi des cas avérés ou suspectés pour protéger les salariés ayant pu avoir des contacts avec ce personnel.
La démarche de prévention à adopter. Dans le contexte actuel de l’état d’urgence sanitaire, la poursuite de l’activité doit passer par une réévaluation des risques professionnels pour tenir compte des risques inhérents au covid-19 qui se traduit par une mise à jour du DUER. Tenant compte des situations concrètes de travail, il conviendra d’anticiper les risques liés à l’épidémie de covid-19 en tenant compte des vecteurs de contagion, en appréhendant les risques générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise et par la mise en place du télétravail en incluant les risques psycho-sociaux induits. Il convient d’identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus covid-19 peuvent se trouver réunies, à l’entrée et à la sortie de l’entreprise, au poste de travail, dans les espaces collectifs de convivialité et de restauration, les vestiaires, la zone d’accueil des personnes étrangères à l’entreprise, et de l’intervention d’entreprises extérieures… Les partenaires sociaux et le CSE doivent être associés à l’analyse des situations de travail et aux mesures préconisées, étant rappelé que le CSE doit être préalablement consulté s’agissant de toutes les mesures pouvant être adoptées par l’employeur, modifiant de manière importante l’organisation du travail et concernant la santé et la sécurité des salariés [3]. Par sa compétence et sa connaissance particulière des conditions de travail dans l’entreprise, l’avis du médecin du travail [4] participe à l’élaboration des mesures pour éviter la contagion et des mesures de protection dans l’entreprise des salariés et des tiers. A la suite de cette évaluation, le DUER sera actualisé, ainsi que les plans de prévention et les protocoles de chargement et déchargement avec les transporteurs. Certaines mesures pourraient nécessiter l’élaboration d’une note de service valant adjonction au règlement intérieur [5]. L’employeur détermine les mesures organisationnelles, techniques et comportementales pour protéger la santé des salariés et veille à informer et à former les salariés sur les mesures adoptées et les équipements de protection fournis. L’employeur doit s’assurer de la parfaite compréhension de ces mesures par les salariés et de leur respect effectif.
L’employeur doit aussi veiller à transcrire par écrit toutes ses décisions et à les documenter, afin de pouvoir justifier des mesures adoptées, pour éventuellement pouvoir les mobiliser dans un bref délai en cas de procédure contentieuse.
Espace privé et espace public, interaction et questionnement sur le pouvoir du juge des référés. La spécificité du covid-19 tient au fait qu’il est à l’origine un problème de santé publique et non de santé au travail. Partout, et nulle part à la fois, l’inégale présence géographique du covid-19 sur le territoire le démontre si besoin. Aussi, une certaine mesure doit demeurer lorsqu’il s’agit d’apprécier les moyens de nature à protéger la santé des salariés par un acteur privé dans un tel contexte, et ce d’autant plus que quelques soient les mesures prises par l’entreprise, elles n’ont pas d’effet au-delà du périmètre de l’entreprise, et leur efficacité est étroitement liée aux mesures de prophylaxie médico-sanitaire préconisées par les pouvoirs publics, et à leurs respects par les individus en dehors des murs de l’entreprise.
[1] Ass. plén., 28 juin 1996, n° 94-15.935, publié au bulletin (N° Lexbase : A3534CK4) ; Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-15.305, FS-P+B (N° Lexbase : A0087ZRN) ; Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 18-15.209, FS-P+B (N° Lexbase : A59203CA) et n° 18-20.028, F-D (N° Lexbase : A58823CT).
[2] CE référé, 18 avril 2020, n° 440012, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, inédit (N° Lexbase : A89173KH).
[3] C. trav., art. L. 2312-8, 4° (N° Lexbase : L8460LGG).
[4] Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 (N° Lexbase : L6263LWU), art. 1 et 2.
[5] C. trav., art. L. 1321-5 (N° Lexbase : L8678LGI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473136
[Brèves] Publication de la seconde loi de finances rectificative pour 2020 : impact sur les finances publiques
Réf. : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE)
Lecture: 2 min
N3119BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 29 Avril 2020
►La seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE) a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020.
Pour rappel le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Action et des Comptes publics ont présenté le projet de loi de finances rectificative pour 2020 en Conseil des ministres le 15 avril 2020. Il a été adopté en première lecture par les députés le 17 avril 2020, puis par les sénateurs le 23 avril 2020. Cette seconde loi de finances rectificative complète les mesures instaurées par la première loi de finances rectificative du 23 mars 2020 (loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L5505LWS).
Le projet de loi de finances rectificative a été construit autour de 4 axes :
1) la préservation des compétences et des savoir-faire des salariés ;
2) le soutien à la trésorerie des entreprises ;
3) le soutien aux plus petites entreprises ;
4) la protection des entreprises les plus stratégiques.
En ce qui concerne les mesures relatives aux finances publiques on notera :
- le fonds de solidarité pour les très petites entreprises et indépendants augmenté à 7 milliards d'euros ;
- un fonds de 20 milliards d'euros est créé pour renforcer des participations financières de l’Etat dans les entreprises stratégiques en difficulté ;
- le plafond de l’assurance-crédit export de court terme est rehaussé de 2 à 5 milliards d'euros ;
- 500 millions d'euros supplémentaires ont été inscrits pour aider les entreprises industrielles (de 50 à 250 salariés) stratégiques au travers d'avances remboursables ou de prêts à taux bonifiés ;
- une provision de 8 milliards d’euros est prévue pour les dépenses exceptionnelles de santé pour faire face à l’épidémie, notamment pour investir dans l'achat de matériels et masques et financer les mesures sur les indemnités journalières, sur le jour de carence et pour le personnel soignant ;
- 900 000 euros d(aides d'urgence pour les ménages modestes ;
La prévision de déficit passe de -3,9 % (dans la première loi de finances rectificative pour 2020) à -9 %. Cette prévision s’explique par la révision à la baisse de la croissance (-8 % au lieu de -1 % dans la première loi de finances rectificative pour 2020), et les 42 milliards d’euros dévolus à la lutte contre le Covid-19). A la fin de l’année 2020, la dette de la France devrait atteindre 115 % du PIB selon les premières estimations du ministre de l’Action et des Comptes publics.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473119
[Brèves] Présentation des mesures fiscales de la seconde loi de finances rectificative pour 2020
Réf. : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE)
Lecture: 6 min
N3109BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 29 Avril 2020
►La seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7438LWE) a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020.
Pour rappel le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Action et des Comptes publics ont présenté le projet de loi de finances rectificative pour 2020 en Conseil des ministres le 15 avril 2020. Il a été adopté en première lecture par les députés le 17 avril 2020, puis par les sénateurs le 23 avril 2020. Cette seconde loi de finances rectificative complète les mesures instaurées par la première loi de finances rectificative du 23 mars 2020 (loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L5505LWS).
En ce qui concerne les mesures fiscales le texte prévoit :
- l’éxonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises (article 1) : les aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L5725LWX) sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0 (N° Lexbase : L9321LHP), 69 (N° Lexbase : L2416LE9), 102 ter (N° Lexbase : L6162LUR), 151 septies (N° Lexbase : L4192LI4) et 302 septies A bis (N° Lexbase : L2394LEE) du Code général des impôts ;
- la déductibilité fiscale des abandons de loyers (article 3) : les loyers qu'un bailleur abandonne ou auxquels il renonce au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne seront pas des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; ne seront pas considérés comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et entrerons dans la liste des charges à déduire du bénéfice net de l'article 39 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7516LWB). Il est créé un nouvel article 14 B du Code général des impôts aux termes duquel « ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation. Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise » ;
- l’augmentation du seuil de défiscalisation des heures supplémentaires (article 4) : la limite annuelle de 5000 euros passe à 7500 euros pour les heures supplémentaires effectuées par les salariés entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire ;
- un taux réduit de TVA pour les masques, produits d'hygiène et tenues de protection adaptés à la lutte contre le Covid-19 (articles 5 et 6) : la liste des biens pouvant bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % est complétée (CGI, art. 278-0 bis N° Lexbase : L7522LWI). Bénéficient dorénavant du taux réduit Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- l’assouplissement des conditions d'utilisation de l'épargne de la déduction pour aléas pour les exploitants agricoles (article 7) : cet article prévoit que pour les exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, l’épargne professionnelle peut être utilisée dans les conditions prévues à l’article 73-II-2 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9087LNU) ;
- l’éxonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle spécifiquement versée aux agents des administrations publiques mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (article 11) : la prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L7313LQW) et à l'article L. 6131-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6725LUM) ;
- l’augmentation de la durée de validité des timbres électroniques (article 12) : aux termes de l’article 900 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4746I7W), le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d’acquisition, quelle que soit l’évolution du tarif applicable. Le texte porte le délai de validité du timbre électronique à douze mois. Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- une hausse du plafond du dispositif « Coluche » (article 14) : le montant du dispositif « Coluche » permettant de déduire des impôts 75 % des sommes versées à des associations est porté à 1000 euros au lieu de 537 euros habituellement. Cette mesure modifie en conséquence l’article 200 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7519LWE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473109
[Brèves] Aménagements de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 portant prorogation des délais en matière d’astreinte
Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)
Lecture: 5 min
N3089BY3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charles Simon, Avocat au barreau de Paris, et Alexandra Martinez-Ohayon, Rédactrice en procédure civile
Le 29 Avril 2020
► L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX), apporte des aménagements et compléments aux dispositions des ordonnances :
- n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) ;
- n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ).
En complément de l’article publié dans notre dossier spécial relatif aux dispositions civiles face à la crise sanitaire (voir, Lexbase éd priv, avril 2020, n° 820 N° Lexbase : N2925BYY) portant sur les délais de procédure civile pour faire face à l’épidémie de covid-19, rédigé par Charles Simon, Avocat au Barreau de Paris, et Rudy Laher, Professeur à l’Université de Limoges, nous revenons sur l’article 4 de l’ordonnance n°2020-427 portant sur l’astreinte.
Il remplace le deuxième alinéa du même article de l’ordonnance du 25 mars 2020, par deux alinéas ainsi rédigés :
«Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.»
«La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.»
Les premier et dernier alinéas de cet article n’ont pas été modifiés et prévoient toujours :
«Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. »
« Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.»
Le schéma ci-dessous permet de visualiser les différentes situations possibles :
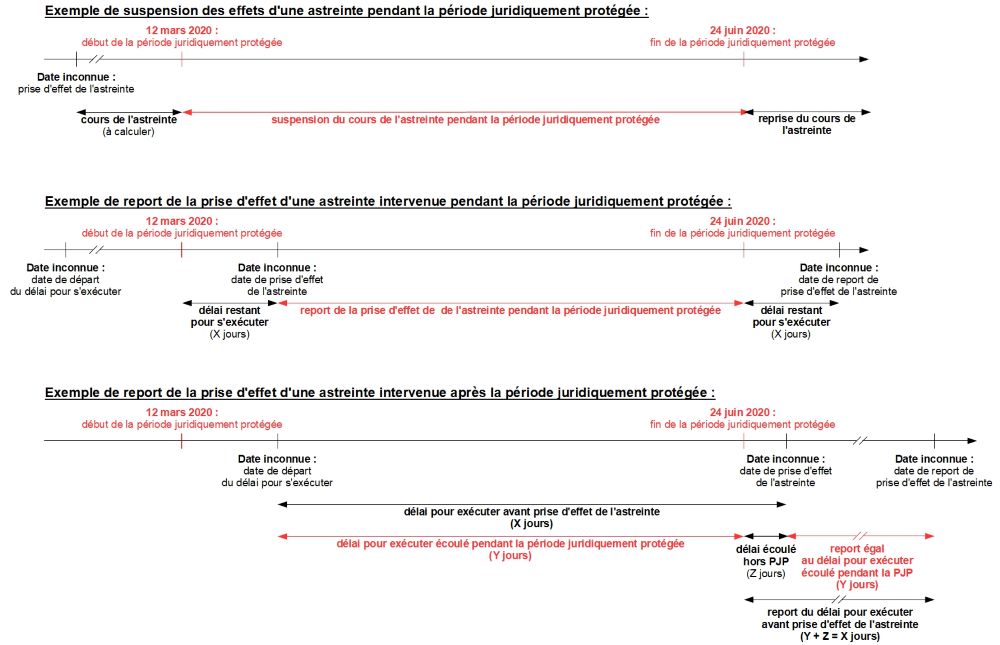
Finalement, le système mis en place s’apparente à une suspension des délais pendant la période juridiquement protégée mais la rédaction choisie complique inutilement les choses.
Pour prendre des exemples chiffrés :
- soit une astreinte ayant commencé à courir le 1er mars 2020. Son cours s’est trouvé suspendu pendant toute la période juridiquement protégée et elle recommencera à courir, en l’état, le 25 juin 2020, après la fin de la période juridiquement protégée fixée actuellement au 24 juin 2020 (il existe, cependant, un débat pour savoir si la fin de la période juridiquement protégée ne serait pas plutôt le 23 juin 2020) ;
- soit une astreinte prononcée avant le début de la période protégée le 1er mars 2020 et devant commencer à courir 1 mois plus tard, le 1er avril 2020, soit pendant celle-ci, 10 jours se sont écoulés entre le 1er et le 12 mars en appliquant le premier alinéa de l’article 641 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6802H73 ) et en comptant le délai en jours (donc sans compter le 1er et en s’arrêtant au dernier jour avant la suspension, le 11). 21 jours restaient encore à courir avant la date de prise d’effet de l’astreinte le 1er avril 2020. Ces 21 jours seront reportés à la fin de la période juridiquement protégée, ce qui donne une date de prise d’effet reportée au 15 juillet 2020 en prenant le 25 juin 2020 comme premier jour de reprise du cours du délai ; - soit une astreinte prononcée pendant la période protégée le 1er juin 2020 et devant commencer à courir 1 mois plus tard, le 1er juillet 2020, après la fin de celle-ci. 23 jours se sont écoulés entre le point de départ du délai et la fin de la période juridiquement protégée, actuellement fixée au 24 juin 2020. Il faut reporter d’autant la prise d’effet de l’astreinte à compter de sa date de prise d’effet originel du 1er juillet 2020. Cela donne une date de prise d’effet reportée au 24 juillet 2020. On se rend compte qu’il aurait été plus simple de tout simplement dire que le délai pour s’exécuter était suspendu et ne commençait à courir qu’à compter de la fin de la période juridiquement protégée.
Ces calculs ont été faits en se fondant sur la date de fin de la période juridiquement protégée telle qu’elle est connue aujourd’hui, soit un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée actuellement au 24 mai 2020 + 1 mois. La date effective de fin de l’état d’urgence sanitaire sera déterminante pour le suivi des dossiers en cours. Il convient de la surveiller.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473089
[Le point sur...] Le point sur les contentieux sociaux devant le juge administratif
Lecture: 21 min
N2800BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Lorraine et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Procédure administrative"
Le 30 Avril 2020
contentieux sociaux - juge administratif
La réforme des contentieux sociaux a longtemps été considérée comme « impossible » [1], ou comme un véritable « serpent de mer » [2]. Les enjeux posés par les contentieux sociaux sont pourtant énormes. Il suffit de comptabiliser, chaque année, par exemple, le nombre d’accidents de travail, de maladies professionnelles ou encore le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou encore les personnes percevant l’allocation aux adultes handicapés. Les appels à l’unification des contentieux et les propositions de réforme existent, pourtant, depuis longtemps [3]. Mais il n’y a jamais eu de suite faisant, au final, de ces contentieux, les « parents pauvres d’une justice pauvre » [4] et ne laissant, au final, que les plus faibles et les plus démunis dans l’embarras. C’est un ensemble complètement hétérogène et méconnu qui s’est formé au gré de l’attribution de tel contentieux à tel ordre juridictionnel (judiciaire ou administratif) ou à telle juridiction (de droit commun ou spécialisée) et au gré de l’enchevêtrement des compétences. Le tout au détriment de la justiciabilité de nombreux droits sociaux et d’une lisibilité très peu évidente pour les justiciables. Les contentieux concernant des prestations de même nature, poursuivant un même but ou une même population, pouvaient ainsi être attribués à des juges ou ordres différents sans que cela ne corresponde à une quelconque logique rationnelle, une véritable « schizophrénie judiciaire » [5].
La répartition du contentieux se faisait de la façon suivante avant la réforme. Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) traitait du contentieux général (CSS, art. L. 142-1 N° Lexbase : L7777LPQ et L. 142-2 N° Lexbase : L8303LQL) [6]. Le contentieux technique de la Sécurité sociale relevait en première instance des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) [7]. En ce qui concerne le contentieux de l’aide sociale, certains différends (RMI, aide sociale aux personnes âgées, APA, aide sociale aux personnes handicapées, attribution en urgence de la prestation de compensation handicap (PCH), recours sur succession après octroi d’aides sociales, AME, CMU-C, aide au paiement de complémentarité santé (ACS)) relevaient des juridictions de l’aide sociale (commissions départementales d’aide sociale et commission centrale d’aide sociale) qui étaient des juridictions spécialisées de l’ordre administratif. Le juge administratif de droit commun était, lui, compétent pour les litiges liés à l’APL, à l’ASE, au DALO, au RSA ou encore à l’insertion professionnelle et sociale des adultes handicapés. Enfin, le juge judiciaire de droit commun jouissait, de son côté, d’une compétence résiduelle principalement pour les litiges en matière d’aide sociale à l’enfance mettant en cause l’état des personnes et pour fixer les sommes à la charge de chacun des obligés alimentaires.
Au regard du contexte et de l’extrême précarité de certains justiciables, l’urgence d’une réforme devenait évidente. Dans le but de faciliter l’accès à la justice sociale, la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle [8] et ses textes d’application [9] ont remanié toute l’organisation juridictionnelle du traitement des contentieux concernés en supprimant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale et de l’aide sociale et du contentieux de l’incapacité et de l’aide sociale à la date du 1er janvier 2019. Leurs contentieux ont été redistribués entre les deux ordres juridictionnels et transférés ainsi vers les tribunaux judiciaires spécialement désignés ou devant les tribunaux administratifs (TA) pour une partie des contentieux portés devant les commissions départementales d’aide sociale (CDAS). Les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) ont ainsi rendu leurs dernières décisions le 31 décembre 2018.
Dans l’ordre administratif, les tribunaux administratifs, statuant en juge unique en premier et dernier ressort, sont, désormais, les seules juridictions administratives appelées à connaître des contentieux sociaux, c'est-à-dire les contentieux qui, selon le Code de justice administrative, portent sur les « requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi [...] » (CJA, art. R. 772-5 N° Lexbase : L0819IYY, étant précisé que, le contentieux du droit au logement opposable, dévolu aussi au juge administratif, est géré à travers les règles particulières de l’article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L7687LCP). Dans le volet judiciaire, seuls les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des autres contentieux de l'aide sociale (litiges relatifs à la CMU-C, à l'assurance complémentaire santé, à la prestation de compensation du handicap ainsi que les recours en récupération et les recours sur les obligés alimentaires).
Concernant les tribunaux administratifs, les règles de procédure applicables ont été unifiées [10]. Ce mouvement d'unification ne s’est néanmoins pas accompagné d'une harmonisation des contours de l'office du juge administratif statuant en matière sociale. De plus, dans le but de réguler ce contentieux de masse, le législateur a obligé les justiciables à effectuer, au préalable de leur saisine contentieuse, de nombreux recours administratifs gracieux (RAPO) [11] voire, au surplus de ces recours, des médiations préalables additionnelles [12]. Outre la maladresse de la formule [13], ces médiations constituent un préalable supplémentaire à la saisine du juge si on les ajoute au RAPO, « c'est une vraie course d'obstacles que se verraient imposer des justiciables fragiles avant d'atteindre le juge » [14]. Si cela contrebalance la volonté initiale de favoriser l’accès au juge, il faut néanmoins relever une évolution notable de la jurisprudence. Le Conseil d’Etat fait aujourd’hui preuve de souplesse dans les exigences procédurales et met en avant une approche faisant primer davantage la personne du justiciable sur la légalité de l’acte en généralisant, notamment, devant le juge administratif, le plein contentieux en matière d’aide et d’action sociale (I). Mais la simplification apparait, en définitive, assez « relative » dans la mesure où les conséquences qu'il convient d'en tirer sur les contours de l'office du juge varient selon la nature de la décision contestée. Il y a beaucoup de nuances en fonction de l’objet de la demande et l’office du juge n’est pas identique selon l’objet de la prestation (II).
I - Une volonté générale visant à faire primer la personne du justiciable sur la légalité de l’acte
Cette volonté visant à faire primer la personne du justiciable sur la légalité de l’acte a toujours existé dans les contentieux présents devant le juge administratif, avant la réforme, puisque le plein contentieux concernait déjà la plupart des contentieux sociaux devant le juge administratif (A). Mais, dans un mouvement assez libéral visant à unifier le contentieux et à rendre plus concret les droits des justiciables, le juge administratif a décidé de généraliser le plein contentieux à tous les contentieux sociaux (B).
A - Un plein contentieux déjà bien présent
C’est d’abord le contentieux des décisions de récupération d'indu, c'est-à-dire celles par lesquelles l'administration remet en cause des paiements déjà effectués, qui a relevé du plein contentieux. Il en a été ainsi à propos des aides personnalisées au logement [15] comme des sanctions infligées en matière sociale [16]. Par la suite, c’est le contentieux de l’allocation RSA qui a été confié, par le législateur, au juge administratif de droit commun alors qu’il avait, jusqu’alors, été exclu de son champ d’intervention traditionnel [17]. Alors que certains tribunaux administratifs avaient appréhendé ces recours en tant que juge de l’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a clarifié la situation en sens inverse. Inspirée par son avis contentieux « Douwens-Prats » [18], il a précisé que l’office du juge, par la nature même du contentieux social qui lui est soumis, implique que ce dernier dispose de pouvoirs larges et étendus, excédant ceux d’un juge de l’annulation.
Les recours en matière de RSA doivent donc être analysés comme des recours de plein contentieux objectif [19]. A cet égard, l’avis du Conseil d’Etat « Lavie » [20] précise qu’il appartient au juge non seulement d’apprécier la légalité de la décision relative au RSA mais aussi de se prononcer sur les droits effectifs du demandeur à l’allocation jusqu’à la date à laquelle il statue. Le Conseil d’État a ainsi confirmé l’office qu’il avait en la matière, office qui s’étend également aux demandes de remise de dette, résultant de trop perçus par les allocataires comme l’a précisé, par la suite, un second avis « Popin » [21]. Les tribunaux administratifs ont été, ensuite, amenés à prendre position sur des questions que soulève traditionnellement l’office du juge de plein contentieux, à commencer par le caractère opérant, ou non, des moyens de forme et de procédure [22]. Si certains juges du fond ont considéré que ces moyens étaient opérants et qu’ils pouvaient conduire juste à l’annulation sèche de la décision, d’autres ont jugé que de tels moyens étaient opérants sans que cette solution ne les conduise toutefois à simplement annuler et se sont déterminés autant sur la légalité des décisions litigieuses, que sur les droits du demandeur.
Le Conseil d’Etat a fini par trancher la question en 2012 par une décision de section « Mme Labachiche » [23] qui précise la portée des moyens articulés par les requérants dans le cadre des recours de plein contentieux relatifs au RSA [24]. La section du contentieux a, plus récemment, redéfini l’office du juge en faisant en sorte que celui-ci apprécie non pas tant la décision attaquée mais la situation du requérant [25]. Au final, les contentieux qui ressortissaient auparavant de la compétence des juridictions administratives spécialisées ont, ainsi, par la suite, relevé du plein contentieux mais les contentieux qui avaient toujours été jugés par les juridictions administratives de droit commun continuaient d'être jugés en excès de pouvoir que ce soit les recours contre les décisions en matière d'aide sociale à l'enfance [26], les recours contre le refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi [27], les recours contre les refus d'attribution de la carte de stationnement pour personne handicapée [28] ou encore les recours contre un refus de remise gracieuse en matière d'APL [29].
B - Un plein contentieux désormais généralisé
Quatre décisions de section rendues le 3 juin 2019 harmonisent l'office du juge administratif appelé à connaître des contentieux sociaux en faisant basculer, dans le plein contentieux, les recours contre l'ensemble des décisions déterminant les droits et des décisions de remise gracieuse en matière sociale. Il appartient désormais au juge, dans tous les contentieux sociaux définis à l'article R. 772-5 du Code de justice administrative, à l'exception du contentieux du DALO, de se prononcer sur le bénéfice de la prestation sollicitée [30] ou d'examiner si la remise gracieuse sollicitée est susceptible d'être accordée [31].
Dans les deux premières décisions, « Vainqueur » et « Ziani », le Conseil d’Etat confirme les caractéristiques de son office pour l’étendre à d’autres domaines du contentieux social : celui portant sur la détermination des droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi (en l’espèce l’allocation de solidarité spécifique, ASS) et celui portant sur la délivrance de cartes de stationnement pour personnes handicapées. Il appartient, dans ce champ et désormais, au juge administratif « […] non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits des intéressés […] » et « […] d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus […] ».
Dans ces décisions qui déterminent le droit de l'intéressé à la prestation qu'il sollicite, la généralisation du plein contentieux permet au requérant, plutôt que d'obtenir une simple annulation de la décision attaquée, de se voir reconnaître par le juge lui-même, le cas échéant, le droit à la prestation. Il permet aussi une meilleure prise en compte de la réalité de la situation de l'intéressé, sur l'ensemble des périodes concernées par une prestation. Des éléments factuels postérieurs à la date de la décision contestée peuvent être pris en compte ce qui est important dans les contentieux sociaux, où les facteurs d'éligibilité sont susceptibles d'évoluer dans le temps [32]. Dans l’arrêt Vainqueur, le juge a annulé la décision de refus de l’ASS en renvoyant à Pôle emploi le soin de déterminer les droits du requérant pour la période en cause tandis que, dans l’arrêt « Ziani », il a enjoint au président du conseil départemental de délivrer la carte de stationnement illégalement refusée.
Dans les deux autres espèces, le Conseil d’Etat a mis en cohérence son office en l’adaptant à deux autres contentieux sociaux plus spécifiques où l’administration compétente exerce un large pouvoir d’appréciation. Le premier contentieux concerné, celui de l’arrêt « Charbonnel », est celui qui concerne les recours dirigés contre les décisions refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocution versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. C’est là que le passage au plein contentieux est le plus discutable dans la mesure où le juge administratif n’a, normalement, pas le pouvoir de reconnaitre lui-même une remise gracieuse. Mais il a préféré une certaine unité en la matière dans la mesure où, concernant des indus au titre du RSA, la décision « Mme Handoura » avait déjà fait la bascule dans le plein contentieux [33]. L’idée étant de ne pas différencier l’office du juge pour les indus au titre d'une autre prestation sociale.
Le second contentieux, celui de l’arrêt « Département de l’Oise », que le juge administratif fait rentrer dans le plein contentieux, concerne la prise en charge, au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE), des mineurs de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant. Le Conseil d’Etat exerçait précédemment un contrôle restreint en la matière eu égard à la marge d’appréciation laissée au président du Conseil départemental pour accorder ou maintenir la prise en charge [34].
II - Une volonté générale qui demeure néanmoins marquée par une certaine hétérogénéité dans l’office du juge
Malgré la généralisation du plein contentieux à tous les contentieux sociaux devant le juge administratif, l'hétérogénéité continue à prévaloir dans la mesure où les contours de l'office du juge de l'aide sociale peuvent différer encore selon l’objet de la prestation au cœur du différend (A). Des jurisprudences plus récentes amènent toujours, de même, à limiter, par certains points, l’accès au contentieux pour les justiciables (B).
A - Un office qui continue à varier selon l’objet de la prestation au cœur du différend
Dans l’espèce « Département de l’Oise » sur la question de l’attribution de l’ASE par le biais d’un contrat jeune majeur, on a pu relever que l’administration disposait, en la matière, d’un large pouvoir d’appréciation ce qui heurtait directement la mise en place d’une logique de plein contentieux dans l’office du juge. Ce dernier doit en effet concilier le contrôle restreint avec le caractère inopérant des vices propres de la décision attaquée et le principe selon lequel le juge de plein contentieux statue au regard des circonstances de fait existant à la date de sa décision [35]. Dans l’arrêt en question, le juge s’autolimite dans les pouvoirs qui lui permettent notamment d’admettre l’intéressé au bénéfice de la prestation. Seule une erreur manifeste d’appréciation au regard du dossier qui lui est communiqué peut conduire le juge à réformer la décision prise [36]. Si la notion ne figure pas dans l’arrêt, il est clairement rappelé que le juge doit faire preuve de retenue en la matière et ne pas se transformer en juge administrateur [37] et [38].
L’autre question amenant à un manque d’hétérogénéité dans l’office du juge concerne les contentieux de la récupération des prestations d’aide et d’action sociales. Cela concerne, plus précisément, les recours dirigés contre des décisions déterminant les droits d'une personne ou contre des décisions refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse en matière d'aide ou d'action sociale. Pour ces deux catégories de décisions, les décisions du 3 juin 2019 amènent à ce que les moyens tirés des vices propres de la décision attaquée, notamment tout ce qui touche à la légalité externe, sont inopérants dans la mesure où ils ne présentent pas d’intérêt pour le justiciable. Dans ce cadre, le juge statue directement sur les droits du requérant.
Cette solution n’a cependant pas été étendue au contentieux de l’indu qui, relevant du plein contentieux objectif, voit les moyens tirés d’un vice propre être toujours opérants. Cela implique que le juge de l’indu doit apprécier à la fois la régularité et le bien-fondé de la décision de récupération. La règle est la même concernant les recours dirigés contre les sanctions en matière d'aide sociale pour lesquelles la régularité et le bien-fondé de la décision peuvent également être utilement invoqués par le requérant. S’il y a, dans les deux cas, un intérêt pour le requérant, cette distinction de l’office du juge dans ces contentieux est néanmoins source d’une « certaine complexité » pour certains [39].
B - Des jurisprudences qui continuent à limiter encore l’accès des justiciables au prétoire
Outre la généralisation du plein contentieux dans l’ensemble des contentieux sociaux, il y a tout un ensemble de décisions qui ont été prises par le juge administratif apportant des garanties de forme et de procédure au profit des justiciables dans les contentieux sociaux. C’est le cas notamment pour les bénéficiaires du RSA où, dans deux décisions rendues le 8 juillet 2019, le Conseil d’État a rappelé l’obligation faite aux agents de contrôle d’être assermentés et agréés [40] tout en soumettant la décision de récupération d’indu à l’obligation de motivation et en conditionnant la légalité des amendes au respect du principe du contradictoire [41].
Le Conseil d’Etat, au fil de ses décisions, a aussi assoupli, pour les contentieux sociaux, certaines contraintes de la procédure classique. Ainsi, il a considéré, en revenant sur les règles particulières applicables à l’instruction et au jugement des requêtes en matière de contentieux social (CJA, art. R. 772-5 à R. 772-10), que le juge ne pouvait pas rejeter une requête comme irrecevable sans instruction ni audience avant d’avoir informé le requérant de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à appuyer sa demande et les pièces utiles [42]. Il fait ainsi reposer sur le juge la charge relative à l’exigence de production de certaines pièces déterminantes.
De même, dans un avis du 14 octobre 2019 [43], il met en avant le fait que si la présentation de la requête par voie électronique implique qu’elle soit accompagnée d’un inventaire détaillé des pièces qui y sont jointes (CJA, art. R. 772-5 à R. 772-10), cette exigence ne s'impose pas, dans les contentieux sociaux, au défendeur tenu de communiquer les pièces en sa possession. Le défenseur, dans le cadre de ces contentieux, n’est pas tenu de communiquer l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’elles sont envoyées par Télérecours.
Pour autant, dans certaines décisions, le juge administratif se livre, à l’inverse, à une véritable « action d’apurement des contentieux sociaux » [44]. Il avait déjà considérablement minimisé la portée d'une délibération du conseil départemental du Haut-Rhin approuvant « le principe de l’instauration d’un dispositif de service individuel bénévole que pourraient effectuer les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et qui conditionnerait le versement de cette allocation ». Il avait estimé qu'elle n'obligeait pas les bénéficiaires du RSA à mener une action sociale bénévole. Le versement du RSA peut être suspendu si le bénéficiaire ne respecte pas le contrat d'insertion qu'il a conclu avec le département. En revanche, le fait que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches non requises dans le contrat d'insertion n'est pas un motif de suspension. Les engagements que peut prévoir le contrat d'insertion portent sur des actions d'insertion professionnelle, et non d'insertion sociale ou professionnelle.
Le Conseil d’Etat a, ensuite, considéré que la mise en demeure de payer l’indu de RSA constitue un acte préparatoire insusceptible de recours dans la mesure où elle intervient entre la décision de récupération et la décision de contrainte si le remboursement n’a pas eu lieu dans le délai imparti et que ces deux décisions sont toutes les deux susceptibles de recours [45]. Après la mise en demeure de payer un trop-perçu de RSA, c’est le contrat d’insertion, qui fixe les obligations du bénéficiaire et conditionne le versement des droits, qui a été qualifié d’acte insusceptible de recours devant le juge administratif [46]. Le document dénommé « contrat librement débattu » (prévu aux articles L. 262-35 N° Lexbase : L6627I7L et L. 262-36 N° Lexbase : L6628I7M du Code de l’action sociale et des familles) ne place pas le bénéficiaire du RSA dans une situation contractuelle vis-à-vis du département qui lui verse ce revenu et n'est pas un acte faisant grief. Il n'est ni un contrat de droit public, ni même un contrat tout court mais un simple « document intitulé contrat d'engagement ».
Si la qualification d’actes administratifs non susceptibles de recours est logique sur le fond dans la mesure où ces actes se bornent à formuler des recommandations dépourvues d’effet juridique ou qu’ils n’emportent aucune obligation mais la solution, qui concerne un contrat qui fixe des obligations d’insertion professionnelle dont le manquement peut être sanctionné par la suspension du versement de droits sociaux, reste plus que discutable [47].
Comme peut le noter Virginie Donier, on peut relever, en définitive, que « la généralisation du plein contentieux n’est finalement pas synonyme d’une stricte unification de l’office du juge dans le champ des contentieux sociaux : mais la question est à présent de savoir comment les juges du fond vont se saisir de ces pouvoirs plus étendus et avec quelle objectivité ils vont apprécier les différentes situations de fait qui leur sont soumises, la précarité sociale étant parfois difficilement quantifiable » [48].
[1] Cf. A. Supiot, L’impossible réforme des juridictions sociales, RDAS, 1993, n° 1, p. 97 et suiv.
[2] Y. Bernand, Approche de la réforme des juridictions sociales du point de vue du pôle social de Roanne, GP, 2019, 5 février, n° 5, p. 13 et suiv.
[3] Voir, déjà en 1954, P. Laroque, Contentieux social et juridictions sociales, Droit social, 1954, p. 271 et suiv.
[4] Y. Bernand, Approche de la réforme des juridictions sociales du point de vue du pôle social de Roanne, op.cit.
[5] M. Borghetto, Les juridictions sociales en question, Regards 2015/1, n° 47, p. 26 et suiv.
[6] Qui pouvait ensuite être porté devant les cours d’appel et la Cour de cassation.
[7] Ce contentieux technique relevait en appel de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), à l’exception du contentieux de la tarification qui était appréhendé par la CNITAAT statuant en premier et dernier ressort (CSS, art. L. 143-1 N° Lexbase : L8682LCK à L. 143-4). Un pourvoi pouvait ensuite être formé devant la Cour de cassation.
[8] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), JO, 19 novembre 2016, texte n° 1.
[9] Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la Sécurité sociale et de l'aide sociale (N° Lexbase : L6292LMY) (JO, 30 octobre 2018, texte n° 11) et ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, relative au traitement juridictionnel du contentieux de la Sécurité sociale et de l'aide sociale (N° Lexbase : L3753LK9) (JO, 17 mai 2018, texte n°6).
[10] Par exemple, l’obligation pour l'administration de transmettre l’ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande, l’obligation pour le juge d'inviter à régulariser une requête qui ne serait pas motivée, la possibilité de clore l'instruction après les observations orales des parties, voire même après l'audience et la dispense du ministère d'avocat.
[11] C’est le cas, par exemple, en matière de RSA (CASF, art. L. 262-47 N° Lexbase : L6636I7W) ou de contentieux de l’aide sociale (CASF, art. L. 134-1 N° Lexbase : L2449LBC et L. 134-2 CASF).
Pour contester un refus d’une prestation sociale relevant du contentieux administratif, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) doit avoir été effectuée auprès de la personne ayant pris la décision de refus (caisse de sécurité sociale (commission de recours amiable), conseil départemental, CDAPH de la MDPH, Etat ou autre organisme par délégation) dans le délai de 2 mois à compter de la décision explicite ou implicite contestée.
[12] Les modalités de mise en œuvre sont définies par le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 précité.
[13] La médiation est obligatoire alors que le propre d'une médiation est, à l'évidence, d'être acceptée par les parties en litige.
[14] J.-M. Belorgey, 2 RAPO pour le prix d’un, AJDA, 2016, p. 2185 et suiv.
[15] CE, 22 mars 1991, n° 110215 (N° Lexbase : A0220ARL).
[16] Depuis CE, Ass., 16 février. 2009, n° 274000 (N° Lexbase : A2581EDX), AJDA, 2009, p. 583, chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi, RFDA, 2012, p. 257, étude J. Martinez-Mehlinger ; voir, pour une application récente, CE, 24 février 2016, n° 378257 (N° Lexbase : A1614QD7).
[17] La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (N° Lexbase : L9715IBG) (JO, 3 décembre 2008, p. 18424), entrée en vigueur le 1er juin 2009.
[18] CE, Avis, 6 avril 2007, n° 93238 (N° Lexbase : A3770AQP), Rec. CE, p. 153, AJDA, 2007, p. 2049, note H. Rihal, RDSS, 2007, p. 1116, obs. A. Boujeka (avis relatif au plein contentieux des refus d’orientation ou de formation opposés par l’administration aux travailleurs handicapés).
[19] Compte tenu des contestations formées par les allocataires ou les potentiels demandeurs, il est tout autant important de savoir si la décision prise les concernant est ou non entachée d’illégalité que de connaître leurs droits à l’allocation.
[20] CE, 7 juillet 2010, n° 337411 (N° Lexbase : A1400E4M).
[21] CE, avis, 23 mai 2011, n° 344970 (N° Lexbase : A5853HSL), AJDA, 2011, p. 1642, concl. C. Landais.
[22] Même si cette interrogation n’a jamais reçu de réponse homogène en plein contentieux et encore moins en contentieux social (Cf. D. Botteghi et A. Lallet, Le plein contentieux et ses faux-semblants, AJDA 2011, p. 156).
[23] CE Sect., 27 juillet 2012, n° 347114 (N° Lexbase : A0743IRX), Rec. CE, p. 299, concl. Landais, AJDA, 2012, p. 1845, chron. X. Domino et A. Bretonneau, RFDA, 2012, p. 922, concl. C. Landais.
[24] Il juge en effet, à la différence des décisions déterminant les droits de l’allocataire, « qu’en revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation […]».
[25] CE Sect., 16 décembre 2016, n° 389642 (N° Lexbase : A2383SXK).
[26] CE, 23 janvier 1981, n° 13978 (N° Lexbase : A6987AKY).
[27] CE, 23 juin 2004, n° 259412 (N° Lexbase : A7831DCZ).
[28] CE, 30 décembre 1998, n° 155849 (N° Lexbase : A8571ASA).
[29] CE, 7 mars 2012, n° 353395 (N° Lexbase : A9489IE8), AJDA, 2012, p. 966, concl. J.-P. Thiellay.
[30] CE, 3 juin 2019, n° 423001 (N° Lexbase : A1483ZDB) ; CE, 3 juin 2019, n° 422873 (N° Lexbase : A1482ZDA) ; CE, 3 juin 2019, n° 419903 (N° Lexbase : A1480ZD8).
[31] CE, 3 juin 2019, n° 415040 (N° Lexbase : A1474ZDX).
[32] Voir, en ce sens, pour les deux arguments développés : C. Malverti et C. Beaufils, Le plein contentieux social, AJDA, 2019, p. 1568 et suiv.
[33] CE, 9 mars 2016, n° 381272 (N° Lexbase : A5422QYH).
[34] CE, 21 décembre 2018, n° 421323 (N° Lexbase : A8422YRD), JCP éd. A, 2019, n° 2077, chron. O. Le Bot.
[35] Voir, en ce sens, : C. Malverti et C. Beaufils, Le plein contentieux social, op. cit.
[36] En ce sens, V. Donier, La généralisation du plein contentieux en matière d’aide et d’action sociales : une simplification relative, RDSS, 2019, p. 1093 et suiv.
[37] En ce sens, V. Donier, La généralisation du plein contentieux en matière d’aide et d’action sociales : une simplification relative, op. cit.
[38] La décision précise que le juge est tenu « d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance [...] ».
[39] Voir, en ce sens, C. Malverti et C. Beaufils, Le plein contentieux social, op. cit., qui évoquent certains cas où le juge peut être amené à statuer deux fois sur la même question et les difficultés d’inscription d’opérance des moyens tirés des vices propres dans les contours de l’office du juge de plein contentieux.
[40] CE, 8 juillet 2019, n° 422162 (N° Lexbase : A8422YRD).
[41] CE, 8 juillet 2019, n° 420732 (N° Lexbase : A4046ZIP).
[42] CE, 4 décembre 2019, n° 420655 (N° Lexbase : A9650Z48).
[43] CE, avis, 14 octobre 2019, n° 432543 (N° Lexbase : A0709ZRP).
[44] H. Rihal, La fermeture du recours contentieux à l'encontre du contrat d'insertion du RSA, RDSS 2020, p. 177 et suiv.
[45] CE, 10 juillet 2019, n° 415427 (N° Lexbase : A7322ZKE), RDSS 2019, p. 951, obs. Y. Dagorne-Labbe où le Conseil d’Etat a précisé que la mise en demeure de payer adressée à l’allocataire du RSA, de l’aide exceptionnelle de fin d’année ou de l’APL dans le cadre d’une procédure de récupération d’indu ne constitue pas un acte susceptible de recours.
[46] CE 4 décembre 2019, n° 418975 (N° Lexbase : A9647Z43), Dalloz actualités, 11 décembre 2019, note T. Bigot.
[47] En ce sens, T. Bigot, Le Conseil d’Etat ferme à nouveau une voie de recours aux bénéficiaires du RSA, Dalloz actualités, 11 décembre 2019.
[48] V. Donier, La généralisation du plein contentieux en matière d’aide et d’action sociales : une simplification relative, op. cit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472800
[Brèves] Blanchiment d’un détournement de biens publics commis en Russie : compétence du parquet national financier et validité de la saisie pénale
Réf. : Cass. crim., 1er avril 2020, n° 19-80.875, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A90403KZ)
Lecture: 10 min
N3106BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 27 Mai 2020
► Le procureur de la République financier est compétent, en application du 6° de l’article 705 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0541LT9), pour la poursuite du délit de blanchiment des infractions citées, notamment, aux 1° à 5° du même article, parmi lesquelles figure celle de détournement de biens publics prévue par l’article 432-15 du Code pénal (N° Lexbase : L4114LS8), lorsque les faits revêtent un caractère de complexité ;
Cette complexité peut notamment être caractérisée par :
- la dimension internationale des faits,
- la présence de multiples sociétés écrans dans plusieurs pays considérés comme des paradis fiscaux,
- des circuits de blanchiment complexes.
C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er avril 2020 (Cass. crim., 1er avril 2020, n° 19-80.875, F-P+B+R+I N° Lexbase : A90403KZ).
Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient des opérations de rachats d’hôtels de luxe dans toute la France, et notamment à Courchevel, par une société de holding (SHA) détenue par un couple russe, dont l’époux était l’ancien ministre des Finances de la région de Moscou. Les fonds investis dans l’acquisition de l’hôtel Pralong étaient susceptibles de constituer le produit direct ou indirect de détournements qui auraient été commis par les époux au préjudice des municipalités de la région moscovite.
Tracfin avait effectué un signalement auprès du procureur de la République de Paris. Une enquête diligentée en Russie du chef de détournement de fonds publics laissait penser à des opérations financières liées à un processus de blanchiment de crime ou de délit. L’époux était en effet soupçonné d’avoir constitué une organisation délictuelle avec son épouse et plusieurs autres personnes, et obtenu, grâce à l’établissement de faux contrats conclus entre des sociétés gérées par eux et des structures publiques municipales, la cession, au bénéfice des premières, de droits de créance détenus par les secondes pour un montant total de 3,8 milliards de roubles.
A la suite de ce signalement, le procureur de la République de Paris a diligenté une enquête préliminaire sur les faits de blanchiment commis en France, tandis que le procureur de la République d’Albertville, saisi par les autorités judiciaires russes d’une demande d’entraide, a également ouvert une enquête préliminaire du chef de blanchiment en bande organisée aux fins de vérifier si les personnes visées dans cette demande n’avaient pas effectué d’autres investissements mobiliers ou immobiliers sur le territoire français, financés par le produit des infractions commises en Russie. Il s’est finalement dessaisi en faveur du parquet JIRS de Lyon, qui s’est dessaisi à son tour au profit du procureur de la République financier.
Les investigations réalisées dans le cadre de l’enquête préliminaire ont permis d’établir que la société de holding présidée par l’épouse avait pour objet principal l’acquisition de la société des Hôtels Pralong et Crystal 2000 (SHPC 2000) pour le compte de la RI Group LLC, société de droit américain, dirigée par elle.
En réponse à une demande d’entraide judiciaire adressée par le procureur de la République financier, le Comité d’instruction de la fédération de Russie a confirmé que l’enquête russe avait établi que le couple avait participé à une bande organisée qui s’était livrée à des infractions « classées comme graves selon le Code pénal de la Fédération de Russie » et que les intéressés avaient été renvoyés devant le tribunal russe.
Le JLD, statuant sur une requête du procureur de la République financier, a autorisé la saisie de l’hôtel Pralong. La société Pralong a interjeté appel de cette ordonnance.
En cause d’appel. Pour confirmer l’ordonnance de saisie, la chambre de l’instruction énonce qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, issus de la note Tracfin et de la requête du procureur de la République financier aux fins de saisie, que des faits, impliquant le couple, pouvant être qualifiés en droit pénal français de « détournement de fonds publics », ont été commis sur le territoire russe pour un montant de 3,6 milliards de roubles, soit environ 97 millions d’euros au cours de change moyen en vigueur à l'époque des faits et que l'acquisition de biens en France, notamment l'hôtel Pralong 2000 à Courchevel, constitue une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des délits commis en Russie. Les informations transmises par les autorités russes, exposées dans la requête aux fins de saisie, caractérisent suffisamment le lien existant entre les détournements commis en Russie et l'acquisition des deux hôtels puisqu'une partie du prix versé au vendeur de ces biens provenait d'un compte de la société Alderly Limited sise à Chypre, lui-même alimenté par des fonds provenant de la société RI Group, lui-même encore alimenté par un compte de la société Confael crédité par le montant des prêts, environ 3,8 milliards de roubles, obtenus en apportant en garantie les droits de créance détournés.
Elle énonce également que le lien existant entre cet investissement, l'achat de l'hôtel Pralong 2000, et les infractions commises en Russie est conforté par les constatations de Tracfin, qui mettent, notamment, en évidence l'opacité du circuit de financement de cette acquisition et la qualité de bénéficiaire réel de l'opération de l’épouse et que les pièces du dossier, dont la requérante a eu connaissance, sont ainsi suffisantes pour considérer que l'hôtel Pralong 2000 constitue l'objet de l'infraction de blanchiment du produit direct ou indirect du délit de détournement de fonds publics commis en Russie, pour laquelle l’épouse est susceptible d'être poursuivie et condamnée, la confiscation de ce bien étant, en cas de condamnation, encourue en application de l'article 131-21, alinéa 3, du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ).
Elle conclut que les pièces dont l'appelant a eu connaissance sont suffisantes pour justifier la saisie et que celle-ci portant sur un bien objet, dans sa totalité, du blanchiment du produit direct ou indirect de l'infraction de détournement de fonds publics commise en Russie, le principe de proportionnalité n'a pas lieu de s'appliquer.
Un pourvoi a été formé par la société Pralong, laquelle soulevait notamment l’incompétence matérielle du PNF dans cette affaire. Elle considère en effet que le PNF n’a été institué que pour veiller à la moralisation de la vie publique française et ne peut connaître du blanchiment d’infractions commises à l’étranger susceptibles de correspondre aux délits visés dans le livre IV du Code pénal, consacré aux « crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique ».
Pour contester la saisie, la société demanderesse faisait valoir qu’aucune des pièces de la procédure, postérieures à la note de Tracfin communiquée, n’avait été mise à sa disposition.
Décision. Au terme d’une motivation très précise, la Haute juridiction approuve la position des juges du fond et rejette le pourvoi de la société Pralong.
S’agissant de la compétence du PNF
La Haute juridiction énonce que le procureur de la République financier est compétent, en application du 6° de l’article 705 du Code de procédure pénale, pour la poursuite du délit de blanchiment des infractions citées, notamment, aux 1° à 5° du même article, parmi lesquelles figure celle de détournement de biens publics prévue par l’article 432-15 du Code pénal, lorsque les faits revêtent un caractère de complexité qui peut être caractérisé, notamment, par la dimension internationale des faits, la présence de multiples sociétés écrans dans plusieurs pays considérés comme des paradis fiscaux et des circuits de blanchiment complexes.
La Cour de cassation considère que les textes qui définissent le délit de blanchiment, qui est une infraction générale, distincte et autonome, n'imposent ni que l'infraction ayant permis d'obtenir les sommes blanchies ait eu lieu sur le territoire national ni que les juridictions françaises soient compétentes pour la poursuivre. Selon la Cour, l’interprétation stricte de l’article 705 opérée par la demanderesse au pourvoi, qui aboutirait à interdire à ce magistrat de connaître du délit de blanchiment de sommes provenant d’infractions commises à l’étranger et susceptibles de correspondre à celles constituant la catégorie des atteintes à la probité, va à l’encontre de la volonté du législateur qui, en votant la loi n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 (N° Lexbase : L6139IYZ), a souhaité doter l’organisation judiciaire d’un parquet hautement spécialisé dont l’objet, à la faveur d’une centralisation des moyens et des compétences, est de lutter contre les formes les plus complexes de la délinquance économique et financière à dimension, notamment, internationale.
Cette interprétation est également en contradiction avec la volonté des instances européennes et internationales qui tendent à favoriser la dimension internationale des poursuites en matière de blanchiment.
Les faits de l’espèce, qui font intervenir des sociétés écrans situées dans plusieurs États étrangers, sont complexes au sens de l’article 705 susvisé. Par ailleurs, les investigations effectuées sur le territoire français permettent de soupçonner que l’acquisition du bien saisi par la société Pralong, gérée par l’épouse, a été financée par des fonds constituant le produit des détournements susvisés.
En conséquence, la Cour de cassation étant en mesure de s’assurer que les faits constituant l’infraction d’origine du délit de blanchiment, commis en Russie et consistant dans le détournement de fonds au préjudice de personnes publiques, peuvent recevoir, en France, la qualification de détournements de biens publics, faits prévus et réprimés par l’article 432-15 du Code pénal, déjà en vigueur à la date de commission des faits par les mis en cause, c’est à bon droit que le procureur de la République financier a diligenté, en France, une enquête préliminaire sur le blanchiment de fonds qui en constituent le produit.
S’agissant de la saisie pénale immobilière
La Chambre criminelle considère qu’en prononçant ainsi, et dès lors qu’il a été communiqué à la société requérante les pièces sur la base desquelles la chambre de l’instruction s’est prononcée, et, notamment, la requête du procureur de la République financier faisant état tant du témoignage du commissaire aux comptes de la société SHA que du contenu de la demande d’entraide pénale internationale, cette juridiction a justifié sa décision.
| Pour aller plus loin : Sur la compétence du PNF, v. Eric Maurel, ETUDE : Les règles de compétences pénales, La compétence du Parquet national financier (PNF) et du tribunal judiciaire de Paris, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E19393BG) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473106
[Jurisprudence] De l’esprit à l’application de la loi « Badinter »
Réf. : Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-11.411, F-P+B+I (N° Lexbase : A04293HD)
Lecture: 20 min
N3152BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Henri Conte, enseignant-chercheur qualifié aux fonctions de maître de conférences
Le 29 Avril 2020
La loi « Badinter » du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) ne cesse de poser des difficultés dans son application pratique. Alors que cette loi excluait de son domaine les trains et les tramways, la réorganisation récente de l’espace urbain a conduit les juges à l’appliquer à ces derniers sous certaines conditions.
« Un immense gaspillage d’intelligence et de temps, c’est peut-être le bilan que l’on dressera un jour de notre célèbre jurisprudence. Une bonne loi sur les accidents d’automobiles […] aurait sans doute permis de faire l’économie d’une construction aussi ambitieuse » [1]. La citation est célèbre, elle n’en témoigne pas moins des attentes de l’époque sur la question de l’indemnisation des victimes des accidents de la route. Trente-cinq ans après sa promulgation, cette loi suscite, toutefois, toujours des controverses dans son application. Elle poursuit un double objectif difficilement conciliable entre les intérêts des victimes et ceux des assureurs qui fera dire à son rapporteur : « De façon schématique, il ne faut plus dire ‘’je suis assuré parce que je peux être responsable d'un dommage’’ mais ‘’je suis responsable parce que je suis assuré’’ » [2].
Dans l’arrêt du 5 mars 2020 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les faits sont les suivants : un piéton traverse une avenue dont la voie est partagée par celle d’un tramway. Lors de cette traversée, la personne est percutée et blessée par le véhicule circulant sur sa voie.
Elle se tourne vers le tribunal de grande instance de Bordeaux [3] et demande l’application de la loi de 1985 [4] sur les accidents de la circulation qui est particulièrement favorable aux victimes. Ce dernier la lui refuse. Les premiers juges font alors application de la responsabilité du fait des choses et retiennent la faute de la victime justifiant une exonération du gardien à hauteur de 75 %. La victime interjette appel mais le jugement est confirmé, en toutes ses dispositions, par la cour d’appel de Bordeaux. Elle forme, alors, un pourvoi devant la Cour de cassation composé de deux moyens. Dans le premier, elle reproche aux juges du fond d’avoir confirmé le jugement qui n’avait pas retenu l’application de la loi « Badinter ». Seule la première branche de ce moyen retiendra l’attention des juges du droit.
Dans le second moyen, la victime se concentre sur la faute qui lui est reprochée et qui aurait contribué à la réalisation de son dommage. La deuxième chambre civile n’en fera, cependant, pas mention.
La Cour de cassation répond, donc, seulement à la question de savoir si la loi sur les accidents de la circulation était susceptible de s’appliquer ou non.
A cette question, elle répond négativement en rejetant le pourvoi formé par la victime. Dans un attendu liminaire, elle rappelle l’article 1er de la loi de 1985 qui précise que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent […] aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Au regard de cet article qui exclut l’application de la loi aux tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, la deuxième chambre civile juge que la cour d'appel a justement relevé, qu’en l’espèce, le lieu de l’accident n’était pas ouvert à la circulation et que les voies du tramway étaient rendues distinctes des voies de circulation des véhicules.
Il existe, dans cet arrêt, un enjeu important quant à l’application de la loi « Badinter » (I) qui conduit à mener une réflexion sur son esprit (II) mais la Cour de cassation refuse de changer sa jurisprudence alors qu’elle pourrait y être, un jour, forcée (III).
I - De l’enjeu de l’application de la loi « Badinter »
1. L’avantage du régime spécial. Dans cette espèce, la victime demande le bénéfice de la loi spéciale sur les accidents de la circulation. Dans ce régime, les victimes piétonnes qui ont subi des dommages corporels ne peuvent se voir opposer leur propre faute à l’exclusion d’une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. Cela résulte de l’article 3 de la loi : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ». L’enjeu lié à l’application du régime spécial est, donc, très important puisque la victime est ici un piéton qui a subi des dommages corporels. En effet, cette dernière a été traînée sur un mètre par l’engin et a subi de nombreux préjudices. Ici, la faute de la victime n’était ni intentionnelle ni inexcusable. En effet, la faute intentionnelle peut se définir comme « la recherche des conséquences impliquant, le cas échéant, l’acceptation des suites inéluctables d’un acte voulu » [5], or ici, il est évident que la victime n’a pas recherché les conséquences de son acte. Il s’agit bien d’un accident [6] et un accident est toujours involontaire. Ce dernier peut être défini comme un « fait soudain, fortuit, imprévu et indépendant de la volonté de l’assuré » [7]. Il ne s’agissait pas non plus d’une faute inexcusable qui est définie par la Cour de cassation comme « la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » [8] et sur laquelle celle-ci opère un contrôle normatif pour violation de la loi [9].
Il s’agissait ici, plus simplement, d’une faute d’imprudence. La victime a traversé la voie sans regarder. Bien qu’une expertise médicale indiquait une prise de stupéfiants, les juges n’ont pas caractérisé le lien de causalité entre celle-ci et la faute commise.
2. L’exonération partielle. La victime demandait, donc, l’application du régime spécial pour ne pas se voir opposer sa faute d’imprudence. Sans le bénéfice de la loi, la responsabilité générale du fait des choses trouvait à s’appliquer. Or, dans ce régime, le gardien responsable du fait d’une chose peut invoquer la faute de la victime pour s’exonérer. Si cette dernière présente les caractères de la force majeure, elle sera une cause d’exonération totale. En revanche, si la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure, elle n’exonère que partiellement le gardien. Ici, pour les différentes juridictions qui ont eu à statuer, la faute d’imprudence de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure ce qui explique que le gardien ait été jugé responsable à hauteur de 25 %.
II - De l’esprit de la loi « Badinter »
3. Les trains et tramways en site propre. D’après l’article 1 de la loi du 30 juillet 1985 : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent […] aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur […] à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Le texte contient sa propre limite. La loi s’applique : « à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». S’il est vrai que « la raison de cette exclusion n’est pas précisée par le législateur » [10], on retrouve, tout de même, dans le Journal officiel du 11 avril 1985 transcrivant les débats parlementaires, une explication de l’auteur de la loi lui-même : « En revanche sont exclus les chemins de fer et les tramways circulant ‘’en site propre’’ », selon le texte de l'Assemblée nationale. Sur ce point, il nous semble, en effet, préférable d'utiliser l'expression « sur des voies qui leur sont propres », qui est plus compréhensible pour le public. Pourquoi cette exclusion ? Parce que la circulation de ces véhicules n'obéit pas, dans les cas retenus aux principes de base de ce projet de loi tels que la circulation en un même lieu d'engins dangereux et de piétons et de cyclistes […]. « A notre sens, l'exclusion ne vaudra que lorsque ces véhicules circulent sur une voie que n'emprunte normalement aucun autre usager. Il s'ensuit que la loi devrait s'appliquer si un accident survient alors, par exemple, que les rails ne sont pas isolés de la chaussée où circulent les voitures ou bien si le véhicule qui roule sur une voie isolée croise une autre voie, -c'est le cas du passage à niveau » [11].
Il apparaît donc bien que le législateur envisageait l’application de la loi dans le cas des tramways et des chemins de fer dans certains cas. Pour les tramways tout d’abord, toutes les fois où les rails ne sont pas isolés de la chaussée, ils pourraient se voir opposer la loi spéciale. C’est bien le sens du critère qui est mis en avant dans la phrase et qui est en lien avec cette affaire [12]. Pour les trains ensuite, puisque le cas du passage à niveau avait été spécifiquement envisagé par l’auteur de la loi qui souhaitait que cette dernière puisse s’appliquer. Malgré cela, dans un arrêt du 19 mars 1997 [13], les juges interpréteront la loi dans le sens contraire de celui voulu par le législateur en décidant que : « La loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à un accident survenu entre un train et une automobile à un passage à niveau dès lors que le train circulait sur une voie propre » [14] et cela donnera lieu à une jurisprudence constante [15]. Les juges considèrent que la spécificité du passage à niveau ne lui fait pas perdre son caractère propre. Pourtant, dès lors que d’autres véhicules peuvent circuler sur cette voie, c’est qu’elle est partagée -pour une partie d'elle en tout cas-. Il eut sans doute été plus logique d’appliquer la loi lorsque la barrière du passage à niveau est ouverte (la voie n’est plus propre) et de ne pas l’appliquer dans le cas contraire (la voie est restée propre) [16]. Dans le cas d’une voiture qui viendrait foncer sur la barrière, la loi ne pourrait s’appliquer car la destruction de la barrière ne serait pas de nature à ôter le caractère propre de la voie.
4. La difficulté de la voie « empruntée ». Le mot « emprunter » pose problème : « A notre sens, [disait l’auteur de la loi] l'exclusion ne vaudra que lorsque ces véhicules circulent sur une voie que n'emprunte normalement aucun autre usager ». Il est difficile de savoir si la Cour de cassation, pour interpréter la loi, s’est déjà référée aux travaux parlementaires pour rendre ses décisions. Si tel est le cas, elle a interprété le mot d’une telle façon que, pour elle, une voie n’était empruntable que lorsque l’on allait dans son sens. Ainsi, on n’emprunterait pas une voie en la traversant. C’est l’idée qui ressort de la décision rendue le 17 novembre 2016 : « […] une voie ferrée n'est pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route, ces derniers pouvant seulement la traverser à hauteur d'un passage à niveau, sans pouvoir l'emprunter ». Cependant, à la lecture des débats parlementaires il est possible de donner une tout autre interprétation. Lorsqu’il est dit que l’exclusion ne vaut pas lorsque des véhicules circulent sur une voie que n'emprunte normalement aucun autre usager, il est possible de penser que le terme « emprunter » fait plus simplement référence à l’action d’utiliser sans forcément que son utilisateur suive le sens de la voie. Cela est conforme à la définition du mot [17] et cette interprétation semble renforcée par la suite de la phrase tirée des débats parlementaires : « Il s'ensuit que la loi devrait s'appliquer si un accident survient alors, par exemple, que les rails ne sont pas isolés de la chaussée où circulent les voitures ou bien si le véhicule qui roule sur une voie isolée croise une autre voie -c'est le cas du passage à niveau- ».
Une telle analyse littérale suffirait s’il était facile d’évincer tous les enjeux en terme d’assurances qui se greffent, indubitablement, à cette loi. On sait que le législateur se préoccupait des conséquences inflationnistes sur les primes d’assurance [18] mais ce dernier était encore plus préoccupé par son efficacité [19]. Or, son efficience en sortirait grandie si la loi pouvait s’appliquer pour tous les tramways dont les voies ne sont pas isolées de la chaussée, éventualité presque inexistante à l’époque [20].
5. Les voies isolées. Il s’agissait précisément des faits de l’espèce. Concernant les piétons, les juges considèrent que la loi ne peut s’appliquer que lorsque l’accident a eu lieu sur un passage piéton et donc sur une voie partagée avec le tramway. C’est pour cette raison que le demandeur s’est efforcé de démontrer que l’accident avait bien eu lieu à une intersection. La victime se serait trouvée entre les potelets matérialisant l’intersection, elle aurait été intégralement indemnisée. L’application de la loi s’est jouée à un potelet ce qui peut être juridiquement regrettable. L’enjeu réside aussi dans le degré d’isolation des voies du tramway. Il faut reconnaître que la cour d’appel a fait un effort particulièrement important pour démontrer que la victime ne se trouvait pas là où elle le devait. Elle fait, notamment, état de la présence de barrières installées de part et d'autre du passage piéton afin d'interdire le passage de ces derniers sur la voie réservée aux véhicules et de l’existence d'un terre-plein central implanté entre les deux voies de tramway visant à interdire tout franchissement [21]. Si de tels éléments paraissent, de prime abord, convaincants, la connaissance de l’implantation des tramways dans les centres-villes nous conduit à douter de ce caractère infranchissable [22]. La présence de terre-pleins, rarement plus haut d’une dizaine de centimètres suffit, sans doute, à indiquer aux piétons l’existence d’une délimitation des voies mais ne les rends pas infranchissables et ne mentionnent même pas l’interdiction de franchissement. Quant aux barrières, leur présence se limitant aux passages piétons, elles témoignent de leur inefficacité. C’est même l’aveu qu’elles étaient absentes de l’endroit où se trouvait la victime. C’est pourtant là aussi qu’il faut isoler les voies du reste de la chaussée. La cour d’appel prend ainsi le soin de montrer que la victime ne se trouvait pas sur le passage piéton pour lui opposer l’existence d’une délimitation dont elle ne pouvait bénéficier.
6. Le refus catégorique. Il faut noter une évolution de la jurisprudence dans l’application de la loi « Badinter ». Cette dernière a, tout d’abord, fermement considéré qu’il était impossible d’appliquer la loi lorsqu’un tramway était impliqué. Les juges considéraient que, les tramways circulant sur des rails et donc des voies propres, la loi était, dès lors, inapplicable. Ils annulaient, ainsi, les arrêts qui faisaient application de la loi en se contentant de la viser dans l’incipit de leur arrêt [23]. Ce n’est que plus tard que la jurisprudence de la Haute juridiction s’est, ensuite, infléchie [24]. Concernant les chemins de fer, cette dernière est restée inflexible et aucune distinction n’est faite quant aux éventualités de voies partagées.
7. Le refus conditionné. Le 16 juin 2011 [25], la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en affirmant : « qu'un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre ». Cette décision qui ne concerne que les tramways qui traversent des carrefours ouverts aux autres usagers de la route porte atteinte à la cohérence de la jurisprudence de la Cour de cassation une fois mise en lien avec celle sur les chemins de fer [26]. Comme cela a été observé [27], la Cour de cassation a conservé sa position concernant les trains et les passages à niveau. Pour un auteur, cette décision se justifie car « le passage à niveau est aménagé pour permettre aux usagers de la route de traverser une ligne de chemin de fer » [28] alors que « le carrefour urbain ou le passage piéton où se croisent les tramways et les usagers de la route est bien davantage conçu, en sens inverse, pour permettre à un engin ferroviaire de traverser une voie de circulation destinée aux usagers de la route » [29]. Ce serait donc parce que la voie sur laquelle les tramways circulent est accessoire à celle qu’empruntent les piétons ou les voitures que ces derniers pourraient bénéficier de la loi. Pourtant la loi ne fait pas de distinction entre les voies principales et les voies accessoires. Il est aussi possible de penser que la voie perd son caractère propre dès lors qu’elle est partagée, peu importe que celui qui la partage ne va pas dans le même sens. Le demandeur indique, d’ailleurs, dans son pourvoi : « la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas relative à la nécessité que la voie de circulation du tramway soit propre au lieu de l'accident, en violation de l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ». La loi « Badinter » n’est pas une loi de priorités qui fait dépendre son application du caractère principal ou accessoire des voies que traversent les véhicules. Il s’agit surtout d’une loi d’indemnisation qui a pour ambition de s’appliquer dans le plus de cas possible pour faciliter la réparation des préjudices. L’exclusion visée dans l’article 1er se justifie par l’incapacité, bien compréhensible, du législateur de l’époque d’envisager des cas dans lesquels des piétons ou des voitures se retrouvent sur une même voie. Il y avait sans doute l’idée, derrière cela, de refuser l’application de la loi aux situations, forcément ubuesques, dans lesquelles cela se produirait. Par exemple, une voiture qui déciderait de rouler sur les rails d’un train et qui en percuterait un.
C’est donc bien l’environnement urbain d’aujourd’hui qui devrait nous conduire à appliquer la loi dans le sens que souhaitait son fondateur.
8. Les conséquences du refus. La victime est déboutée en première et deuxième instance. Son pourvoi est rejeté et les conséquences sont importantes puisque son droit à indemnisation est réduit de trois quarts. La partie de l’argumentation consistant à démontrer que l’accident avait bien eu lieu dans une zone réservée aux piétons n’avait aucune chance d’aboutir en l’état actuel de la jurisprudence. Cela revient à apprécier l’application de la loi en fonction de considérations inopportunes comme le placement géographique d’un potelet ou la localisation précise de la victime au moment de l’impact. Les parties n’ont pas eu l’indécence de faire valoir que la victime, ayant été traînée par l’engin jusqu’au passage réservé aux piétons, pouvait bénéficier de la loi. L’application d’une loi ne devrait sans doute pas se jouer à un potelet ou, dans d’autres occurrences, à la qualité d’un marchepied. On se rappelle, à ce propos, que les juges ont longtemps tergiversé pour savoir quelle responsabilité il fallait appliquer aux passagers d’un train qui subissaient un dommage. Aujourd’hui, si la victime se trouve dans le moyen de transport, elle bénéficie d’une obligation de sécurité de résultat, tandis que lorsqu’elle se trouve sur les quais ou dans l’enceinte gérée par la SNCF, la responsabilité est de nature extracontractuelle [30]. Cela signifie encore que la nature de la responsabilité dépend du lieu où l’on se trouve et qu’il suffit d’un bond pour bénéficier d’un régime différent.
Ce n’est pas, de plus, faire une appréciation téléologique de la loi que de militer pour son application en l’espèce mais au contraire se conformer à son esprit. Le législateur considérait, en effet, que lorsque les voies n’étaient pas isolées de la chaussée où circulent les voitures, la loi devait s’appliquer. Le critère d’application de la loi n’est pas géographique. Il a trait à la qualité des voies sur lesquelles circulent les VTM. Il est difficile d’expliquer pourquoi un piéton qui se fait écraser sur une voie rapide peut bénéficier de la loi « Badinter » alors que celui qui se fait écraser par un tramway circulant en centre-ville ne le peut pas. Les voies rapides sont propres aux voitures après tout et elles sont beaucoup moins accessibles que les voies qu’empruntent les tramways. Non seulement elles se trouvent loin des villes mais elles sont rendues difficilement accessibles par la présence de barrières de sécurité. Les voies des tramways d’aujourd’hui ne sont parfois mêmes plus délimitées comme en témoignent ces photos :

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063/bordeaux-reseau-tramway-fortement-impacte-par-travaux-cet-ete_17506186.html.

https://www.batiactu.com/edito/tramway-bordeaux-se-dotera-rames-supplementaires-53738.php.
III - De l’avenir de la loi « Badinter »
9. Un arrêt à contretemps. Le législateur de 1985 n’avait, pas anticipé la transformation urbaine qui allait s’opérer à la fin des années 2000 [31]. Les tramways qui sont conçus depuis cette période ont vocation à s’intégrer au mieux dans les centres-villes. Les rails sur lesquels ils se meuvent sont bien différents des anciens systèmes de voies ferrées grâce à la technologie, aujourd’hui performante [32], de l’alimentation électrique par le sol (technologie AES). Dans la plupart des villes, les rails ne sont pas isolés de la chaussée sur laquelle peuvent circuler les voitures ou les piétons. Il faut aussi souligner que ces nouveaux tramways sont particulièrement silencieux ce qui aggrave leur dangerosité [33]. Il paraît, donc, nécessaire de permettre l’application de la loi pour tous les tramways circulant dans les centres-villes et dont l’accès aux voies n’est pas rendu impossible ou extrêmement compliqué.
Cet arrêt est d’autant plus étonnant qu’un rapport de la Cour de cassation, datant de 2005, préconisait l’application de la loi spéciale dans les cas de cette espèce [34]. Il faut aussi noter que le projet de réforme de la responsabilité milite en ce sens [35]. La loi spéciale serait tout entière intégrée dans le Code civil et l’article 1285 du projet de réforme disposerait, alors, plus généralement que : « Le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur répond de plein droit du dommage causé par un accident de la circulation dans lequel son véhicule, ou une remorque ou semi-remorque, est impliqué » [36]. Des auteurs mettent toutefois en garde sur la compatibilité de cette disposition avec l’article 11 du Règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (N° Lexbase : L4837H3K) qui est en vigueur depuis le 3 décembre 2009 [37].
10. Un revirement attendu. L’application de la loi « Badinter » aux tramways en toute circonstance et aux chemins de fer sur les passages à niveau n’est pas un vœu pieux, ce n’est pas une proposition de lege ferenda mais serait la stricte application de la loi telle qu’elle a été pensée par l’auteur de la loi qui lui a donné son nom. À cet égard et sous toutes les réserves mentionnées, il n’est pas impossible que la Cour de cassation change, un jour, sa jurisprudence.
[1] J. Carbonnier, Droit civil, t. IV, 1984-1985.
[2] F. Collet, Rapport fait au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l’accélération des procédures, n° 225, 1984-1985, p. 13.
[3] Aujourd’hui, le tribunal judiciaire.
[4] Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (N° Lexbase : L7887AG9).
[5] A. Vignon-Barrault, Intention et responsabilité civile, (préf. D. Mazeaud), thèse, PUAM, 2004, t-I, p. 220.
[6] Pour qu’il y ait un accident de la circulation, il faut qu’il y ait en plus un fait de circulation. Celui-ci est apprécié très largement : Ph. le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, Régimes d’indemnisation, 11ème éd., « Dalloz action », 2017, Vis Un accident de la circulation, n° 6211.21 et s. ; V aussi : P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 5ème éd., LexisNexis, 2018, p. 486, n° 702.
[7] Cass. civ. 1, 17 mai 1961 ; Cass. civ. 3, 15 mars 1977, n° 75-14.758 (N° Lexbase : A5365CH8). V. aussi, pour la reprise de cette définition dans les moyens : Cass. civ. 3, 17 juillet 1974, n° 73-12.601 (N° Lexbase : A8867CHU) ; Cass. civ. 1, 1er décembre 1976, n° 75-11.934 (N° Lexbase : A6922CE4). V. aussi sur la notion d’accident : M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. Responsabilité civile et quasi-contrats, t. 2, 4ème éd., 2019, PUF, Thémis, Droit, p. 330, n° 288 ; B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 3ème éd., 2018, « Précis Domat, Privé », LGDJ, p. 370, n° 378.
[8] Cass. civ. 2, 30 juin 2005, n° 04-10.996, FS-P+B (N° Lexbase : A8579DIL), JCP 2006. I. 111, n° 12, obs. Stoffel-Munck, RGDA, 2005. 931, note J. Landel; RCA, 2005, n° 287.
[9] Dans l’arrêt précité, les juges de droit ont cassé sur ce point l’arrêt d’appel qui avait retenu la faute d’imprudence d’un piéton « heurté de plein fouet par une voiture, alors qu'il se trouvait au milieu de la voie de gauche sur une route départementale, hors agglomération, à 4 heures 20 du matin par temps de pluie, en un lieu dépourvu d'éclairage public, et qu'il était en état d'ivresse ».
[10] Ph. le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, Régimes d’indemnisation, 11ème éd., « Dalloz action », 2017, op. cit., n° 6211.91.
[11] Journal officiel, Débats parlementaires Sénat, 11 avril 1985, p. 192 et s..
[12] L’article premier de la loi « Badinter » exclurait donc les trains et les tramways toutes les fois que les voies sur lesquelles ils se déploient sont isolées des autres voies de la circulation.
[13] Cass. civ. 2, 19 mars 1997, n° 95-19.314 (N° Lexbase : A0695ACQ), Bull. civ. II, n° 78 ; D., 1997. 100 ; RGDA, 1997. 766, note J. Lande, citée in Dalloz Action, op. cit, n° 6211.91 ; V. aussi, Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-13.790 (N° Lexbase : A2377MIU), NP, RCA, 2014, comm. 183, obs. H. Groutel ; Cass. civ. 2, 17 mars 1986, n° 84-16.011(N° Lexbase : A3173AAR) ; Cass. civ. 2, 16 janvier 1991, n° 89-18.983 (N° Lexbase : A9603CTT).
[14] Ibid..
[15] V. par exemple : Cass. civ. 2, 8 décembre 2016, n° 15-26.265 (N° Lexbase : A3727SPQ) ; Cass. civ. 2, 17 novembre 2016, n° 15-27.832, F-P+B (N° Lexbase : A2450SIL).
[16] Et pour le seul tronçon concerné évidemment.
[17] Le mot est défini dans le dictionnaire de l’Académie française ainsi : « Dans le style administratif. Complété par un nom de voie de communication ou de moyen de transport, prendre, suivre ou utiliser. Le conducteur d’un véhicule doit emprunter la moitié droite de la chaussée. Les voyageurs sont invités à emprunter les voitures de queue. Empruntez le passage souterrain. Dans le langage courant. Pour aller plus vite, nous emprunterons l’autoroute, nous prendrons l’autoroute »
[18] F. Collet, Rapport fait au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l’accélération des procédures, n° 225, 1984-1985, p. 13.
[19] Ibid, p. 5-6. Le rapporteur rappelle que « les accidents de la circulation constituent incontestablement un fléau social et économique de première importance […] ; on citera brièvement les chiffres de l'année 1983 : 1 946 tués, 301 434 blessés ».
[20] Infra n° 9.
[21] Elle indique, par ailleurs, « que le passage piétons situé à proximité était matérialisé par des bandes blanches sur la chaussée conduisant à un revêtement gris traversant la totalité des voies du tramway et interrompant le tapis herbeux et pourvu entre les deux voies de tramway de poteaux métalliques empêchant les voitures de traverser mais permettant le passage des piétons, et retenu d'autre part que le point de choc ne se situait pas sur le passage piétons mais sur la partie de voie propre du tramway après le passage piétons ». La Cour de cassation a repris les motifs dans son arrêt.
[22] V. les photos, Infra n° 8.
[23] Cass. civ. 2, 6 mai 1987, n° 85-13.912 (N° Lexbase : A7490AAN) ; Cass. civ. 2, 18 octobre 1995, n° 93-19.146 (N° Lexbase : A6113ABZ) ; Cass. civ. 2, 29 mai 1996, n° 94-19.823 (N° Lexbase : A0070ACL).
[24] Voir tout de même, Cass. civ. 2, 6 mai 1987, n° 85-13.912 (N° Lexbase : A7490AAN), Bull. civ. II, n° 92 ; Gaz. Pal., 1987. Somm. 481, note F. Chabas.
[25] Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-19.491, FS-P+B (N° Lexbase : A7415HTS), D., 2011. 1756, obs. I. Gallmeister ; JCP, éd. G, 2011. 1333, n° 7, obs. C. Bloch.
[26] Pour une critique semblable, V. C. Bloch, in Ph. le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, Régimes d’indemnisation, 11ème éd., « Dalloz action », 2017, op. cit., n° 6211.91.
[27] V. Supra n° 6.
[28] C. Bloch, chronique de responsabilité civile, JCP, éd. G, n° 10, 6 mars 2017, Vis Accidents de la circulation, doctr., p. 257.
[29] Ibid..
[30] V. par ex : Cass. civ. 1, 6 octobre 1998, n° 96-12.540 (N° Lexbase : A3683CGI) Bull. civ. I, n° 269, RTDCom., 1999 p. 493, note B. Bouloc cité in H. Conte, Volonté et droit de la responsabilité civile, éd. PUAM, 2019, n° 279. V. aussi sur l’évolution de la question : C. Bloch, Ph. Stoffel-Munck ; M. Bacache, Responsabilité civile, chron., JCP, éd. G, n° 16, 20 avril 2020, doctr., p. 503 et plus spécialement Vis Accidents de la circulation, p. 513.
[31] A l’exception du tramway de Nantes qui a été édifié en 1985, la plupart des villes ont fait construire des rames de tramway à la fin des années 2000. V. J. Swanson et J. Smatlak, State-of-the-Art in Light Rail Alternative Power Supplies, Interfleet Technology Inc., novembre 2015.
[32] La technologie existe depuis le XIXème siècle mais n’offrait pas la sécurité attendue : v. https://www.industrie-techno.com/article/le-tramway-a-l-assaut-du-desert.34918. Ce n’est que dans les années 2000 qu’elle est devenue performante et qu’elle s’est imposée un peu partout en France.
[33] On peut lire dans les moyens annexés que la victime ne portait pas écouteurs sur ses oreilles. Cela signifie-t-il que si tel avait été le cas, cela aurait pu lui être reproché ?
[34] C. Bloch, Ph. le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, Régimes d’indemnisation, 11ème éd., « Dalloz action », 2017, op. cit., n° 6211.93.
[35] V. Article 1285 du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 ; V. sur le sujet : S. Hocquet-Berg, « Le fait des véhicules terrestres à moteur », in Avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile. Observations et propositions de modifications, JCP, 25 juillet 2016, n° spécial, p. 61, cité in C. Bloch, Ph. le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, Régimes d’indemnisation, 11ème éd., « Dalloz action », 2017, op. cit, n° 6211.93.
[36] Ibid..
[37] J. Knetsch, Réforme de la responsabilité civile : faut-il soumettre les accidents ferroviaires au régime de la loi Badinter ? D., 2019 p.138 ; C. Bloch, Dalloz action, Ibid..
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473152
[Brèves] Croisement des fichiers HOPSYWEB et des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste : le Conseil d’Etat valide le décret
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 mars 2020, n° 431350, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56923KZ)
Lecture: 3 min
N3123BYC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 29 Avril 2020
► Une mise en relation de deux traitements existants qui consiste à rapprocher des données conservées dans l'un et l'autre en vue de leur utilisation au regard de la finalité poursuivie par l'un d'entre eux ou d'une finalité propre constitue en elle-même un traitement au sens de ces dispositions ; le cadre juridique applicable à un tel traitement dépend de la finalité ainsi poursuivie ; la mise en relation des traitements HOPSYWEB et FSPRT a pour objectif de prévenir le passage à l'acte terroriste des personnes radicalisées qui présentent des troubles psychiatriques ; dès lors que ne sont mises en relation que les données strictement nécessaires à l'identification des personnes inscrites dans ces deux traitements, que seul le représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'admission en soins psychiatriques sans consentement et, le cas échéant, les agents placés sous son autorité désignés à cette fin sont informés de la correspondance révélée par cette mise en relation, alors qu'il ressort notamment du rapport d'information sur les services publics face à la radicalisation, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 juin 2019, que 12 % des personnes enregistrées dans le FSPRT présenteraient des troubles psychiatriques, le moyen tiré de ce que le traitement créé par le décret attaqué ne respecterait pas les exigences tenant à ce que les données traitées soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie et que seules en soient destinataires les personnes ayant besoin d'en connaître pour contribuer à atteindre, dans l'exercice de leurs missions, l'objectif qu'il poursuit doit être écarté.
Ainsi le Conseil d’Etat valide le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 (N° Lexbase : L1206LQQ) par une décision rendue le 27 mars 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 mars 2020, n° 431350, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56923KZ, lire not. l’éditorial de Pauline Le Monnier de Gouville, in Lexbase Pénal, juin 2019 N° Lexbase : N9410BXS).
La requête. L’association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie (CRPA), la ligue des droits de l’Homme, la MGEN, l’association Avocats, droits et psychiatrie ainsi que le Conseil national de l’Ordre des médecins ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation du décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (N° Lexbase : L6034LKP). Les requérants reprochent à ce « deuxième décret HOPSYWEB » le croisement du fichier HOPSYWEB avec celui des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).
Sur la recevabilité de la requête, seule celle de l’association CRPA et de l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques, en intervention, est déclaré recevable.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat valide le décret et rejette ainsi la requête.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473123