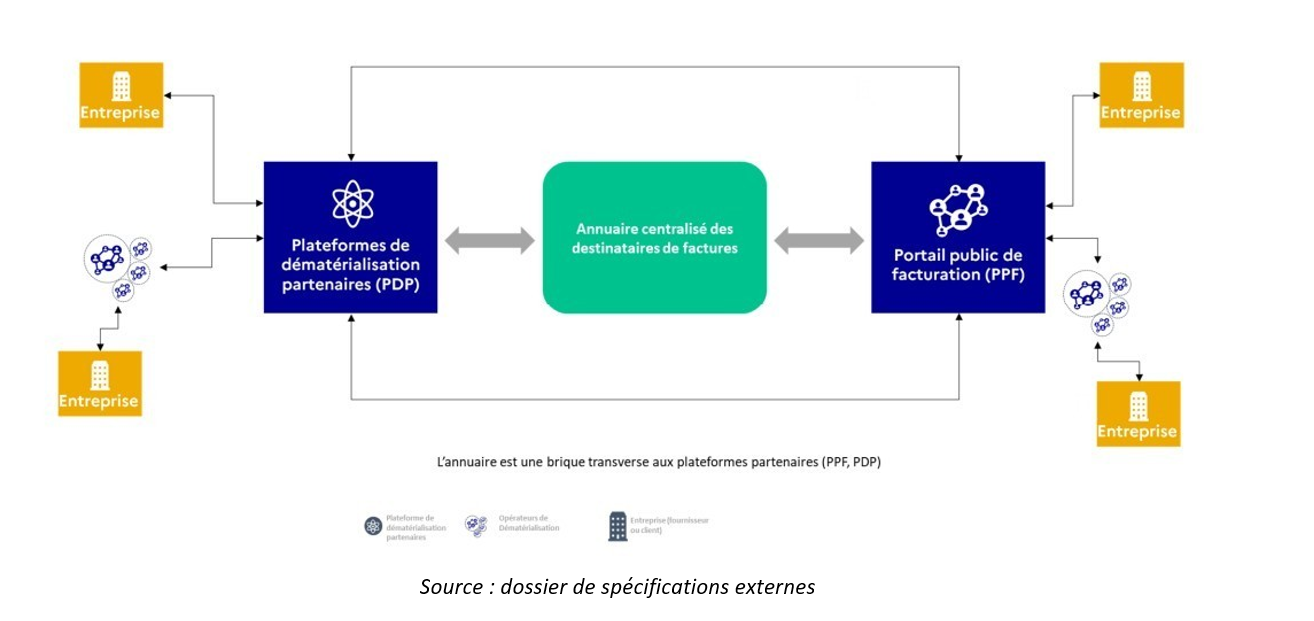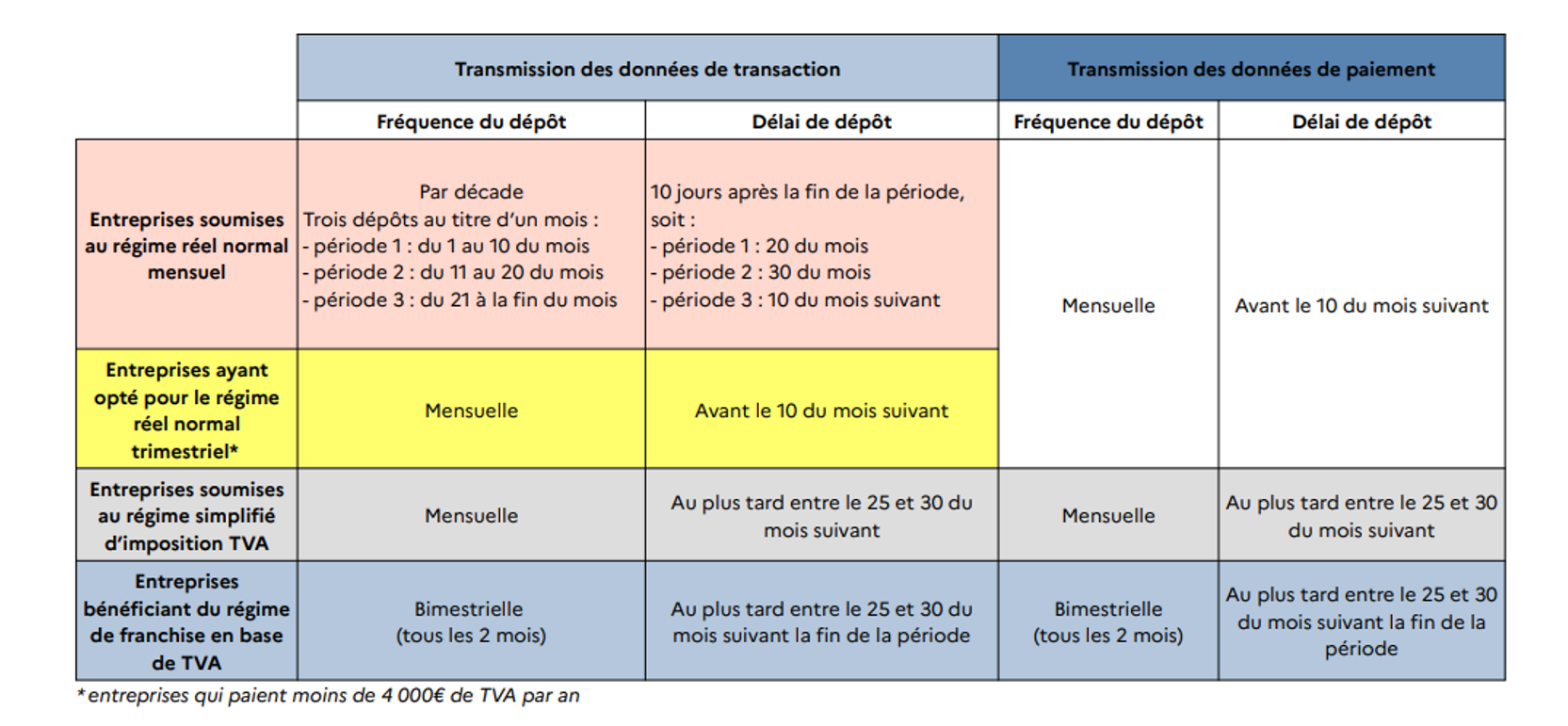[Questions à...] Jean-François Bonhert, procureur national financier : « Dire que le PNF est un organe politique est un reproche injuste... »
Lecture: 11 min
N3697BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Rédaction Lexbase
Le 15 Décembre 2022
Des locutions latines et une belle formule italienne. Voilà comment Jean-François Bonhert répond aux critiques dont ses équipes font l’objet dès qu’elles ouvrent une enquête sur un homme politique. Récemment, le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler, le nouveau patron des LR, Éric Ciotti et Emmanuel Macron lui-même sont venus allonger la liste des responsables politiques de premier plan auquel le parquet national financier (PNF) s’intéresse. Mais pas de quoi inquiéter le haut magistrat qui, du vingtième étage du tribunal judiciaire de Paris, gère sereinement près de 700 dossiers. Il s’est confié à Lexbase sur son état d’esprit actuel...
Lexbase. Le parquet national financier (PNF) existe depuis huit ans désormais. Avez-vous le sentiment de disposer des effectifs suffisants pour gérer la masse de dossiers en stock ?
Quand j’ai pris mes fonctions il y a trois ans, en octobre 2019, nous étions dix-sept magistrats. Aujourd’hui, le ministère de la Justice s’est engagé à nous doter d’un effectif de vingt magistrats. C’est une augmentation qui s’est faite progressivement, de façon positive. Elle est justifiée et exigée par l’état de nos affaires.
Nous en sommes aujourd’hui à 675 affaires en cours : 84 % d’enquêtes préliminaires et 16 % d’informations judiciaires. Pour ces dernières, ce sont les juges d’instruction qui dirigent les investigations, mais nous alimentons aussi leurs dossiers par des réquisitions ou des avis donnés en procédure.
Lorsque le PNF a été créé, par une loi de décembre 2013 [1], le Parlement avait procédé à une étude d’impact qui évoquait un effectif nécessaire de vingt-deux magistrats pour le démarrage du PNF. Pour ma part, j’observe qu’il y a au ministère une volonté de faire bouger les lignes et de continuer à nous doter d’effectifs complémentaires.
Lexbase. On le voit, la majorité de vos dossiers sont traités sous la forme d’enquêtes préliminaires. Craignez-vous que la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire votée le 22 décembre 2021 et qui limite désormais à trois ans (deux ans + un an sous certaines conditions) la durée maximale de ce type d’enquêtes ne constitue un frein à votre activité ?
C’est une inquiétude, au sens étymologique du terme, je dirais. Inquietas. En latin, cela qualifie le fait de ne pas avoir l’esprit au repos. L’inquiétude est saine parce qu’elle signifie vigilance. C’est donc quelque chose de positif.
Au vu de la complexité des contentieux que nous traitons, il va être difficile, tant pour les enquêteurs que pour nous, de nous adapter à ces nouveaux délais contraints. Cette réforme ne concerne cependant que les enquêtes ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le 24 décembre 2021. Une dérogation est également prévue le temps de l’exécution des demandes d’entraide pénale internationale, qui concernent une part substantielle de nos procédures.
Lexbase. Justement, n’êtes-vous pas tenté désormais d’ouvrir des informations judiciaires plutôt que de conserver les dossiers en enquêtes préliminaires ?
Notre réflexion est en cours sur ce point. En premier lieu, j’observe que les effectifs des magistrats instructeurs n’ont pas été réévalués pour prendre en compte les effets de la loi, l’ouverture d’une information judiciaire demeurant la seule possibilité offerte au parquet si, au terme des deux ou trois ans, des actes d’investigation sont encore nécessaires. J’observe également que les juges d’instruction saisissent les mêmes services d’enquête que nous et que, compte-tenu de leur charge actuelle, ils rencontrent des difficultés analogues aux nôtres pour faire aboutir rapidement les enquêtes.
Lexbase. L’activité principale du PNF concerne des dossiers de probité (corruption, prise illégale d’intérêts, etc.) Est-ce toujours votre priorité ? Ou bien comptez-vous mettre désormais l’accent sur d’autres dossiers tels que ceux de fraude fiscale aggravée, par exemple ?
Parmi les priorités, s’il y en a une qui doit être clairement mise en exergue, c’est la lutte contre les atteintes à la probité. Aujourd’hui, le PNF est identifié comme le parquet anti-corruption français. Cette mission, nous la portons au quotidien, haut et fort.
Dans cette lutte, nous accordons une attention toute particulière aux faits de corruption d’agents publics étrangers. Il en va de l’image de la France dans le monde. Telle est, au demeurant, la priorité que nous assigne la circulaire du garde des Sceaux du 2 juin 2020 [2]. Elle présente le PNF comme chef de file dans ce domaine. Et de fait, l’ensemble des parquets territoriaux se tournent facilement vers nous pour proposer de se dessaisir à notre profit. À notre tour, nous nous appuyons sur l’expérience accumulée en plus de huit ans d’existence et sur les réseaux de coopération que nous nous sommes créés.
S’agissant du contentieux fiscal, il fait partie de nos priorités. Il représente 43 % de nos procédures. Nous ciblons particulièrement la fraude des grandes entreprises, ainsi que l’action des intermédiaires qui conçoivent la fraude fiscale d’envergure. Nos résultats sont plutôt intéressants. En dernière date, la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) signée cette année avec la société Mc Donald’s. [Le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a validé une convention judiciaire d’intérêt public [3] fixant à 1,245 milliard d’euros le montant cumulé de l’amende d’intérêt public et des droits et pénalités fiscales dus par trois sociétés du groupe Mac Donald’s au titre de la convention pour des faits de fraude fiscale aggravée]. On le sait, il y a une attente bien compréhensible de la part de nos concitoyens quant à la répression de la fraude fiscale.
Lexbase. Justement, en 2020, une seule convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) a été validée. En 2021, elles étaient au nombre de trois. Et cette année, trois autres rien que pour le premier semestre. Comptez-vous multiplier ce type de règlement à l’avenir ?
Nominalement, il y a une progression. Mais il faut la mettre en relation avec la maturation des dossiers du PNF. En 2014, 2015 ou 2016, les affaires ne pouvaient pas encore sortir : nous venions d’être créés. Aujourd’hui, les dossiers sont mûrs pour être traités. Un signe ? La difficulté pour notre service d’audiencement de trouver des dates pour juger nos affaires. Il y a maintenant plus d’affaires qui sortent. Et donc aussi plus d’affaires qui sont éligibles à la CJIP. C’est ce qui explique l’augmentation que vous relevez.
Pour nous, la CJIP n’est qu’un mode d’orientation parmi d’autres. On ne considère pas ces conventions comme « l’alpha et l’oméga » de notre traitement pénal. Non, le PNF ne peut pas se résumer à la justice négociée. À l’heure actuelle, nous avons treize CJIP signées et validées. Rapportées à la masse de nos 675 procédures, ce n’est pas énorme. En aucun cas la CJIP n’a vocation à éclipser la comparution classique devant le tribunal correctionnel.
Lexbase. N’est-ce pas frustrant, finalement, pour un parquet tel que le vôtre de finir par “négocier” une peine avec une entreprise mise en cause, via les CJIP ?
Non, les collègues ne sont absolument pas frustrés. Je rappelle que la sanction prononcée à l’encontre des personnes morales dans le cadre d’une CJIP est souvent bien plus lourde que la peine encourue par elle devant le tribunal correctionnel. Un exemple ? La banque JP Morgan a accepté, via une CJIP [4], 133 fois le montant de l’amende encourue lors d’une audience correctionnelle...
Notre but n’est pas de nous transformer en collecteur d’argent public. Mais typiquement, pour prendre l’exemple Mc Donald’s, l’entreprise a accepté de payer une amende de 508 millions d’euros dans le cadre de la CJIP, montant auquel il faut ajouter les pénalités fiscales, comme je l’ai indiqué tout à l’heure. Si cette convention n’avait pas été conclue, nous serions toujours en train de débattre du juste taux de redevance de licence de Mc Donald’s en France.
Lexbase. À ce sujet, pouvez-vous dresser le bilan de ce que le PNF a fait entrer dans les caisses de l’État depuis sa création ?
Si l’on retient les seules amendes d’intérêt public, leur montant total s’élève à 3,7 milliards d’euros, grâce à treize CJIP. Si on y ajoute les transactions fiscales conclues parallèlement aux CJIP, on parvient à un montant total de 5,190 milliards d’euros. Au total, depuis que le PNF existe, nous avons fait rentrer un peu plus de 11 milliards d’euros dans les caisses de l’État.
Lexbase. Justement, la justice manque cruellement de moyens. Ne serait-il pas envisageable qu’une partie des fonds récupérés par vos services viennent abonder directement le budget de la Justice, comme c’est le cas, sous certaines conditions, en Grande-Bretagne, par exemple ?
Lorsque l’on met en regard, d’un côté les montants que je viens de citer et, de l’autre, notre besoin en magistrats ou l’état immobilier de certaines juridictions, on peut légitimement se poser la question. Si, en France, la règle de l’unicité budgétaire ne permet pas en l’état d’envisager un abondement direct des sommes versées au titre des CJIP au budget de la justice, il existe effectivement, dans d’autres pays tels que le Royaume-Uni, un système de frais de justice (fees) qui joue ce rôle.
Dans notre pays, nous pourrions peut-être réfléchir à la création d’un fonds de concours, qui permet de déroger à la règle de l’unicité budgétaire. Le législateur l’a encore récemment utilisé pour permettre l’affectation des sommes saisies au titre des procédures dites de « biens mal acquis » au profit des populations spoliées. Les juristes ont des esprits féconds. Mais là, c’est avant tout une question de volonté politique.
Lexbase. Le PNF est régulièrement attaqué et critiqué. Ses détracteurs l’accusent d’être un « organe politique ». Que répondez-vous à cela ?
Ce reproche me paraît très injuste. Il est tentant pour les personnes poursuivies de vouloir transformer leur procès en procès du PNF. La nature même de notre contentieux fait que nous enquêtons sur des décideurs publics qui sont, pour certains d’entre eux, des personnalités politiques. Plus le temps passe, plus nous avons mis en cause des personnalités de bords politiques différents, suscitant à chaque fois des accusations de politisation de notre action.
Lexbase. Vous le vivez mal ?
Je ne pourrai jamais accepter cette critique tant elle est éloignée de la réalité de notre fonctionnement et de nos méthodes de travail. Aucun des dix-huit magistrats du PNF ne fait de politique au seul motif qu’il engage des poursuites ou qu’il classe une procédure sans suite contre telle ou telle personnalité. Au quotidien, notre seule grille d’analyse est l’application de la loi. La loi, c’est notre boussole. Pour moi, ce qui l’emporte, c’est la belle formule que l’on trouve dans les salles d’audience italiennes : La legge e uguale per tutti : la loi est la même pour tous.
Lexbase. Il y a quand même un sentiment d’impuissance face à ces critiques dans ce que vous décrivez...
Comme le prophète, vox clamantis in deserto... j’ai parfois l’impression de prêcher dans le désert. S’il restera toujours difficile de convaincre les esprits chagrins, c’est d’abord et avant tout devant le tribunal correctionnel que nous acquérons, jour après jour, notre légitimité.
Lexbase. Mais, sur un plan plus personnel, vous vous sentez bien à la tête du PNF ?
Je suis heureux ici, oui. Je considère que ce n’est pas une fonction comme les autres mais c’est une mission porteuse de sens. C’est aussi une grande responsabilité dans une démocratie. Cette responsabilité, je la partage au quotidien avec toute une équipe, dont je suis fier. La charge de travail de chacun des magistrats est importante et leur engagement au quotidien est à la hauteur des enjeux du PNF.
[1] Ndlr : Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière N° Lexbase : L6136IYW.
[2] Ndlr : Garde des sceaux, ministre de la Justice, Circulaire de politique pénale en matière de lutte contre la corruption internationale, 2 juin 2020 [en ligne].
[3] Ndlr : PNF, Communiqué de presse du procureur de la République financier, 16 juin 2022 [en ligne].
[4] Ndlr : Convention judiciaire d'intérêt public entre le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et la société JPMorgan Chase Bank National Association, 26 août 2021 N° Lexbase : L9621L7H.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483697
[Chronique] Chronique de droit des assurances – Décembre 2022
Lecture: 19 min
N3666BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol, Maître de conférences en droit privé à l’Université du Mans, et Maître de conférences en droit privé et codirectrice du Master Assurances et personnes de l’Université de Caen Normandie
Le 15 Décembre 2022
Mots-clés : assurance • contrôle • Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) • assurance vie • intermédiaire en assurance • démarchage téléphonique • Garantie pertes d’exploitation • Covid 19
Lexbase Hebdo – Droit privé vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique en droit des assurances dirigée par Rodolphe Bigot, Maître de conférences en droit privé et codirecteur de la Licence Assurance Banque Finance à l’Université du Mans et par Amandine Cayol, Maître de conférences en droit privé et codirectrice du Master Assurances de l’Université Caen Normandie. Au sommaire de cette chronique, seront abordés deux thèmes importants : en premier lieu, la surveillance resserrée sur le secteur de l’assurance opérée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et, en second lieu, le problème des pertes d’exploitation en raison des fermetures administratives (enfin !) arrivé devant la Cour de cassation, dont la décision ressemble davantage à une opération de délestage du dense contentieux en stock – plusieurs milliers d’assurés en attente – qu’à une solution juridique convaincante.
I. Bilan annuel de l’ACPR : un contrôle resserré du secteur de l’assurance
L’année 2022 semble marquer un progrès dans la surveillance opérée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à l’égard des entreprises d’assurances et des intermédiaires d’assurances. Cette autorité administrative indépendante (AAI) doit veiller non seulement à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle, mais aussi à la préservation de la stabilité du système financier [1]. L’ACPR est ainsi l’organe de tutelle de deux secteurs : celui de la banque et celui de l’assurance. En d’autres termes, une mission de police administrative à l’égard des compagnies d’assurance lui est confiée [2]. L’entité de contrôle prend alors la forme, si l’on ose dire, d’un « dragon à trois têtes » : le collège de supervision, le collège de résolution et la commission des sanctions.
Si les établissements bancaires faisaient l’objet d’un contrôle a priori plus serré, du moins plus fréquent, depuis quelques années, les pratiques des assureurs et acteurs assimilés (au sens large : intermédiaires, mandataires, courtiers, agents généraux…) commencent également à être observées de manière plus attentives. Entre avril et octobre 2022, ce n’est pas moins de quatre sanctions qui ont été prononcées en matière d’assurances [3], les autres décisions de la commission des sanctions touchant à la partie bancaire [4], notamment la dernière en date du 1er décembre 2022 eu égard à des carences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc) [5]. Par comparaison, en 2021, de même qu’en 2020 et en 2019, deux décisions seulement concernaient l’assurance [6] sur une douzaine de décisions, le secteur bancaire faisant ainsi l’objet de l’attention prédominante.
A. Les manquements graves en matière de contrats d’assurances-vie en déshérence
Trois assureurs ont été sanctionnés – d’un blâme et de sanctions pécuniaires – par la Commission des sanctions de l’ACPR au cours du premier semestre de l’année 2022. Une résistance à l’application de la réglementation – issue de la loi « Eckert » [7] relative aux contrats d’assurance-vie en déshérence et visant à rendre efficient le paiement de la garantie – fut ainsi mise en lumière [8].
Mars 2022 - Sanction de huit millions d’euros à l’encontre de MUTEX. Une sanction pécuniaire de huit millions d’euros a été prononcée à l’encontre de MUTEX en début d’année. L’ACPR a relevé que « Les manquements aux obligations d’information sont graves, notamment quand ils ne permettent pas aux adhérents des contrats de savoir que les prestations auxquelles ils ont droit peuvent être liquidées [et que] Mutex ne pouvait ignorer l’importance de l’obligation que lui imposait la loi de se doter de dispositifs efficaces en matière de déshérence » [9].
Mai 2022 - Sanction d’un million d’euros à l’encontre de MGEN Vie. Pour des faits qui ne semblaient pourtant pas traduire une plus faible gravité que dans l’affaire précédente et qui interpellent eu égard à la communication régulière sur ses valeurs mutualistes [10], la mutuelle MGEN Vie a fait l’objet, le 12 mai 2022, d’une sanction financière d’un million d’euros infligée par la Commission des sanctions de l’ACPR [11]. Cette peine est très fortement minorée par rapport à celle de cinq millions d’euros que préconisait pourtant, compte tenu de la longue persistance dans le temps de pratiques contra legem, le représentant du Collège de supervision. L’ACPR avait pourtant annoncé, en 2014, les critères retenus pour expliquer la proportionnalité des sanctions prononcées [12]. Les trois éléments pris en compte sont habituellement, en ce qui concerne essentiellement le montant de la sanction pécuniaire, la particulière gravité des manquements commis, l’insuffisance des mesures correctives adoptées et l’impossibilité d’avoir connaissance des capacités financières des personnes sanctionnées [13]. Une voie médiane existe toutefois – qui éviterait de sanctionner la mutualité des adhérents assumant in fine concrètement la peine financière par la très probable augmentation, par report de la sanction initiale, des cotisations d’assurance – consistant, dans un contexte de forte centralisation décisionnelle de la MGEN, à suspendre temporairement, voire à démettre d’office, un ou plusieurs de ses dirigeants. À cet effet, le silence des textes n’étant pas forcément un frein [14], la doctrine de l’ACPR n’impose pas de rechercher « si une “faute détachable” de l’exercice de ses fonctions peut lui être reprochée ou si le comportement qui lui est reproché résultait d’une intention de ne pas respecter les obligations applicables à sa profession » [15].
Relevons que, parmi de multiples griefs ressortant des opérations de contrôle, outre les conflits d’intérêts majeurs [16], « MGEN Vie ne mettait pas en œuvre les modalités spécifiques d’information des adhérents de la garantie PID sur les modalités et les conséquences de la désignation de bénéficiaires prévues par la loi (grief 1) ; qu’elle n’a pas totalement respecté les obligations liées à la mise en place des dispositifs AGIRA, pour les contrats dont la gestion était déléguée et, jusqu’en 2017, pour les contrats « frais funéraires » (grief 2) ; que, dans un certain nombre de dossiers, ses diligences pour rechercher les bénéficiaires des garanties étaient encore, à la date du contrôle, insuffisantes (première partie du grief 3) ; que, dans un certain nombre d’autres dossiers, la prestation PID a été versée à la MGEN à la suite de diverses erreurs ou alors que, dans certains cas, elle aurait dû être intégrée à la succession, dans d’autres cas, l’absence de bénéficiaires de rang supérieur à la MGEN n’était pas suffisamment établie, dans d’autres cas encore, l’établissement avait, du fait d’une analyse juridique erronée, exclu par principe que des légataires universels puissent être regardés comme des héritiers (troisième partie du grief 3) ; qu’enfin, elle procédait à des prélèvements indus sur les capitaux décès en cas de cotisations impayées (grief 4) » [17].
Mai 2022 - Sanction de trois millions d’euros à l’encontre de NATIXIS INTEREPARGNE. Le 30 mai 2022, l’ACPR a condamné la société NATIXIS INTEREPAGNE au paiement de trois millions d’euros en raison de manquements « qui résultent aussi bien d’erreurs d’analyse juridique que de carences opérationnelles et d’une insuffisance du contrôle interne, traduis[ant] une adaptation insuffisante et tardive de l’établissement aux exigences de la loi Eckert » [18].
B. Les obligations d’information et de conseil bafouées par des intermédiaires en assurance usant du démarchage téléphonique
Octobre 2022 - Interdiction d’exercer pendant sept ans d’un intermédiaire en assurance (Résurgence Assurances : ex-Viva Conseil) pour non-respect des obligations d’information et de conseil. Peu de temps après que la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, pour la première fois, sur l’application de la Directive (UE) 2016/97 (dite « DDA) N° Lexbase : L3623KYT pour retenir une conception large d’intermédiaire d’assurance [19], par une décision du 17 octobre 2022, la Commission des sanctions de l’ACPR prononce une interdiction d’exercer pour une durée de sept ans pour la société et pour son dirigeant de fait-associé majoritaire, et de cinq ans pour sa dirigeante de droit [20], et inflige une sanction pécuniaire de 20 000 euros aux premiers et de 10 000 euros à la dernière, par une décision publiée sous forme nominative pendant la durée des interdictions d’exercer, puis sous une forme non nominative [21]. Simple exemplarité ou exemplarité à géométrie variable ? Il paraît plus facile de s’attaquer aux petits poissons qu’aux gros, comme le laissent penser l’absence de sanction à l’égard des dirigeants dans les décisions précédemment rappelées.
En l’espèce, « alors qu’un décret d’application de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux vient de paraître (décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée N° Lexbase : L5828MEL), la Commission des sanctions de l’ACPR fait preuve de fermeté à l’égard de certaines pratiques de vente à distance de produits d’assurance » [22]. Elle motive le prononcé d’une sanction en insistant sur le fait que « l’information et le conseil constituent le cœur même de l’activité d’intermédiation en assurance et [que] les obligations imposées par le législateur ont pour but de protéger les clients contre les risques d’abus de la part des distributeurs de produits d’assurance : manquer gravement aux obligations en matière d’information et de conseil, c’est méconnaître totalement les exigences d’une telle profession ». Selon elle, de tels manquement sont « susceptibles de préjudicier gravement aux personnes prospectées […] surtout lorsqu’elles sont, du fait de leur âge ou de leur situation, vulnérables ». Elle ajoute que « ce qui vaut pour l’activité d’intermédiation exercée selon les modalités qu’avait choisies Viva Conseil (vente à distance) vaut aussi bien pour toutes les autres modalités d’intermédiation en assurance : les obligations sont, en substance, les mêmes, leur méconnaissance est susceptible d’entraîner les mêmes conséquences ».
La Commission des sanctions a estimé fondé l’ensemble des griefs notifiés à la société par le Collège de supervision. Il s’agit, d’une part, du défaut de remise, en temps utile [23] (comme l’exigent les articles L. 222-6 du Code de la consommation N° Lexbase : L1550K7K et L. 112-2 du Code des assurances N° Lexbase : L3935LKX), de l’information précontractuelle sur support durable (en violation des articles L. 112-2 du Code des assurances et L. 222-6, al. 1er du Code de la consommation applicables à la fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur en vertu de l’article L. 112-2-1, I, 1° du Code des assurances N° Lexbase : L7820IZN) et, d’autre part, de l’inexactitude et de l’insuffisance des informations communiquées relatives à l’intermédiaire d’assurance (C. assur., art. L. 521-2 N° Lexbase : L3972LKC, I et II, R. 521-1, I N° Lexbase : L5496LKR et R. 521-1 N° Lexbase : L5495LKQ) et des informations précontractuelles devant être fournies oralement sur le fonctionnement du contrat, son contenu et les droits du client [24] (C. assur., art. L. 112-2-1, III N° Lexbase : L7820IZN et R. 112-4 N° Lexbase : L4099MEK), enfin, de divers manquements au devoir de conseil (C. assur., art. L. 521-4 N° Lexbase : L3970LKA et L. 521-6 N° Lexbase : L3968LK8 : comme l’utilisation, dans la fiche d’information et de conseil, de phrases-types non complétées par des informations propres aux clients ou encore de la non-indication des raisons motivant la proposition de contrat).
II. L’opération de délestage du contentieux des pertes d’exploitations AXA par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, 4 arrêts, n° 21-15.392 N° Lexbase : A45218WD, n° 21-19.341 N° Lexbase : A45408W3, n° 21-19.342 N° Lexbase : A54888W8, et n° 21-19.343 N° Lexbase : A54858W3, FS-B+R)
Les quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation concernant la prise en charge par les assureurs des pertes d’exploitation subies par les restaurateurs en raison de la fermeture administrative de leurs établissement pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 étaient attendus. Ils s’avèrent malheureusement fort décevants en pratique, et surprenants – pour ne pas dire discutables – en théorie au regard, tant du droit commun des contrats que du droit spécial du contrat d’assurance.
On s’attendait pourtant à ce que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation cherche à trouver une solution empreinte d’analyse économique du droit, après le tapage nocturne et diurne opéré dans les médias par certains acteurs de l’assurance lors de la dernière crise sanitaire. Rappelons les discours de faillites en série annoncées... Mais que nenni ! Une minutieuse analyse des chiffres annuels du secteur de l’assurance depuis dix ans, en particulier à la lumière des rapports de l’ACPR, a pourtant permis de mettre en lumière que « l’année 2021 est, d’abord, une année record à bien des égards et permet de constater que, si crise il y a eu, cette dernière est désormais loin derrière nous. Mis en perspective avec le rapport de 2020, ensuite, il semblerait que le secteur de l’assurance n’ait été finalement que peu affecté (au stade macro-économique encore une fois) par la crise sanitaire. Enfin, bien loin d’une image de secteur en crise, l’analyse comparée des rapports publiés depuis 2010 par l’ACPR montre que, dans une perspective de plus long terme, le secteur de l’assurance semble pris dans une spirale de croissance quasi-continue » [25]. Dès lors, si l’économie de l’assurance est à son mieux, pourquoi rendre une telle décision, étonnamment favorable à l’assureur AXA ?
Rappelons que l’assurance perte d’exploitation a pour objectif de « garantir l’entreprise pour les pertes subies suite à la réduction du chiffre d’affaires, les manques à gagner et paralysies [26]. Par une sorte de fiction, cette assurance a pour fonction d’effacer la période d’interruption de l’activité de l’entreprise » [27]. La garantie des pertes d’exploitation subies lors de la pandémie de Covid-19 a donné lieu à un abondant contentieux. Les solutions fluctuantes retenues par les juges du fond [28] ont été source d’une profonde incertitude, tant pour les assurés que pour les assureurs [29]. L’intervention de la Cour de cassation sur le sujet est donc importante, particulièrement concernant le contrat AXA litigieux, souscrit par plusieurs milliers de restaurateurs, hôteliers, ou encore gérants de club de sports ayant subi des fermetures administratives similaires.
Il est vrai que toutes les polices ne sont pas identiques [30] : l’assurance des pertes d’exploitation est celle du « sur-mesure » contractuel, qui y est « sans doute plus marqué que pour les autres garanties » [31]. Selon l’ACPR, « les conséquences d’un événement aussi exceptionnel que la pandémie actuelle ne sont, en règle générale, pas couvertes par les contrats en vigueur. Ainsi, la mise en œuvre de la garantie « pertes d’exploitation » est exclue pour 93 % des assurés au titre des contrats analysés » [32]. Ceci résulte, d’abord, souvent de la nécessité qu’une autre garantie puisse être mobilisée, l’assurance des pertes d’exploitation étant très majoritairement conçue « comme une extension de garantie, destinée à prendre en charge les suites d’un sinistre lui-même indemnisé » [33]. En effet, « les assureurs distinguent les dommages immatériels, économiques ou financiers, consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis, et les dommages immatériels purs ». S’agissant de ces derniers, « les assureurs ne les garantissent qu’avec réticence et souvent moyennant une surprime dans les assurances des entreprises » [34]. Ensuite, la garantie des pertes d’exploitation n’est, dans tous les cas, due qu’à la suite d’un évènement couvert par le contrat d’assurance souscrit. Tout dépend ici des stipulations contractuelles, certains contrats ne couvrant que les pertes consécutives à un évènement accidentel ou d’origine malveillante (et non les fermetures administratives). Enfin, aucune clause ne doit avoir prévu d’exclusion de garantie susceptible d’être invoquée par l’assureur pour refuser sa garantie. C’est sur ce point que l’essentiel du contentieux s’est focalisé, notamment concernant le contrat AXA soumis à la Cour de cassation le 1er décembre 2022.
En l’espèce, plusieurs restaurateurs avaient souscrit une extension de garantie concernant les pertes d’exploitation. AXA a refusé sa garantie en se prévalant d’une clause excluant de la garantie « les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». Les assurés l’ont donc assigné en justice, tentant d’obtenir la nullité de la clause d’exclusion de garantie pour non-respect des strictes conditions posées par le code des assurances. La validité des clauses d’exclusion de garantie suppose en effet, d’une part, qu’elles figurent en caractères très apparents dans la police (C. assur., art. L. 112-4, al. 3 N° Lexbase : L0055AAB) et, d’autre part, qu’elles soient tout à la fois formelles et limitées (C. assur., art. L. 113-1, al. 1 N° Lexbase : L0060AAH).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence (dans une décision du 25 février 2021 et trois du 20 mai 2021) [35] a fait droit à leur demande, considérant que la clause devait être réputée non écrite en application de l’article 1170 du Code civil N° Lexbase : L0876KZH et de l’article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH. Elle retient en effet, d’une part, que la clause est imprécise en l’absence de définition contractuelle des termes « épidémie », « maladie contagieuse » et « intoxication » nécessitant dès lors d’interpréter ces notions et, d’autre part, que « l’exclusion ainsi définie n’est nullement limitée puisqu’elle vise : – tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, – faisant l’objet d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique, – sur un territoire particulièrement vaste, puisque dépassant le simple cadre d’un village ou d’une ville. L’application pure et simple de cette clause d’exclusion aboutirait donc à ne pas garantir l’assuré des pertes d’exploitation subies en raison de la fermeture administrative de son restaurant pour épidémie de coronavirus, et donc, à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie » [36].
Suivant l’argumentation de l’assureur, demandeur au pourvoi, la deuxième chambre civile casse la décision des juges du fond pour violation de l’article L. 113-1 du Code des assurances, la clause étant bien, selon elle, formelle et limitée.
Elle commence par rappeler, au visa de cet article, qu’une « clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation » (pt. 12). Il est en effet de jurisprudence constante que, pour être formelle, une clause d’exclusion doit, tout à la fois, être claire et précise. Sa clarté suppose qu’elle puisse être aisément comprise, ce qui n’est pas le cas lorsque son ambiguïté nécessite une interprétation par le juge [37]. La précision de la clause requiert une définition circonscrite des situations dans lesquelles la garantie est exclue. Toute imprécision conduit la Cour de cassation à l’écarter, notamment lorsque « la clause excluant la garantie […] ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées » [38]. La deuxième chambre civile affirme, en l’espèce, que « la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait » (pt. 15).
Elle poursuit en rappelant, toujours au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances, qu’une « clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire ». Il s’agit encore là d’une solution classique : depuis 1987 [39], le caractère « limité » de la clause d’exclusion est érigé en condition autonome de validité par la Cour de cassation. Le juge saisi est tenu de vérifier que la clause ne vide pas la garantie de sa substance [40] en vérifiant « l’étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse » [41]. Pourtant, là encore, la deuxième chambre civile consacre la validité de la clause stipulée dans le contrat d’AXA. Elle affirme que « la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance » (pt 22).
L’analyse de la deuxième chambre civile sur ces différents points ne peut que surprendre en l’espèce, au regard de la sévérité de sa jurisprudence antérieure relative aux clauses d’exclusion de garantie. Il est difficile de ne pas voir dans ces décisions un vaste exercice de déjudiciarisation pour la Haute juridiction, se résumant en une opération de délestage du contentieux des pertes d’exploitation. Une telle déjudiciarisation devrait, toutefois, n’être que de courte durée, du moins pour les juridictions du fond, car le contentieux sera certainement seulement déplacé à l’encontre des intermédiaires d’assurance, lesquels se voient et se verront nécessairement reprocher des manquements à leurs obligations d’information et de conseil, pour avoir failli dans leur devoir de mise en garde en ne prévenant pas leurs clients des restrictions des garanties proposées…
[1] ACPR, Rapport annuel 2021, spéc. p. 12 et s.
[2] T. de Ravel d’Esclapon, « Le contrôle de l’ACPR », in R. Bigot et A. Cayol (dir.), Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 92.
[3] ACPR, Commission des sanctions, 30 mars 2022, n° 2021-02, MUTEX SA ; 12 mai 2022, n° 2020-10, MGEN Vie ; 30 mai 2022, n° 2021-03, NATIXIS INTEREPAGNE ; 17 octobre 2022, n° 2021-04 Résurgence Assurances (ex-Viva Conseil).
[4] Cf. ex multi X. Delpech, Dalloz actualité, 28 mars et 22 avril 2022.
[5] Décision de la Commission des sanctions n° 2020-11 du 9 février 2022 à l’égard de l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) ; Décision de la Commission des sanctions n° 2021-01 du 1er mars 2022 à l’égard de la société W-HA (émetteur de monnaie électronique – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; gel des avoirs) ; Décision de la Commission des sanctions n° 2021-05 du 1er décembre 2022 à l’égard de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (établissement de crédit – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme).
[6] Décision de la Commission des sanctions n° 2020-09 du 30 novembre 2021 à l’égard de la société MMA IARD SA (organisme d’assurance - gel des avoirs) ; Décision de la Commission des sanctions n° 2020-03 du 29 avril 2021 à égard de la société Cardif Assurance Vie (entreprise d’assurance – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme).
[7] K. Bühler-Bonafini, « Les assurances-vie », in R. Bigot et A. Cayol (dir.), Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 592 : « La loi impose à l’assureur de s’informer au moins chaque année du décès de l’assuré, et, en cas de décès dont il a pris connaissance, de rechercher le bénéficiaire du contrat (C. assur., art. L. 132-8, in fine N° Lexbase : L6141H9C). Pour compléter ce dispositif, la loi permet à toute personne de demander à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs habilités, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice par une police souscrite par une personne physique dont elle apporte la preuve du décès (C. assur., art. L 132-9 N° Lexbase : L7215IC9). L’organisme transmet alors cette demande dans les quinze jours aux entreprises agréées pour exercer les opérations d’assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne concernée est effectivement désignée dans une police en qualité de bénéficiaire ces entreprises disposent alors d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital ou d’une rente payables à son bénéfice ».
[8] S. Acedo, Une mutuelle sanctionnée par l’ACPR, L’Argus de l’assurance.com, 17 mai 2022 [en ligne] ; M. Calvo, Contrats en déshérence : l’ACPR sanctionne à nouveau, L’Argus de l’assurance.com 7 juin 2022 [en ligne].
[9] ACPR, Commission des sanctions, 30 mars 2022, procédure n° 2021-02, MUTEX SA, n° 32.
[10] MGEN, groupe VYV, Dossier de presse 2022, p. 18, [en ligne] : « Le Groupe VYV élabore une stratégie commune, pilotée au niveau de l’Union mutualiste de Groupe (UMG). Une stratégie dans laquelle les mutuelles conservent leur identité et leur lien de proximité et de confiance avec leurs adhérents [nous soulignons], tout en bénéficiant des ressources du Groupe »
[11] ACPR, Commission des sanctions, 12 mai 2022, procédure n° 2020-10, MGEN Vie. – Cf. R. Bigot et A. Cayol, Commission des sanctions de l’ACPR : des sanctions à géométrie variable en assurance, Dalloz actualité, 4 juillet 2022.
[12] ACPR, Commission des sanctions, 19 décembre 2014, procédure n° 2014-01, Allianz vie.
[13] J. Bigot (dir.), Traité de droit des assurances, t. 2, La distribution d’assurance, LGDJ, 3e éd., 2020, nos 129 et s..
[14] Comp. O. Dexant-de-Bailliencourt, Pour une consécration légale de la faute séparable des fonctions du dirigeant. Proposition d’ajout au projet de réforme de la responsabilité civile, D. 2019, p. 144.
[15] ACPR, Commission des sanctions, 17 octobre 2022, procédure n° 2021-04, Résurgence Assurances (ex-Viva Conseil).
[16] La clause-type des contrats PID désignait la MGEN comme bénéficiaire de dernier rang des prestations décès, alors qu’elle est en charge de la gestion des garanties d’assurance vie, notamment de la recherche des bénéficiaires… Jusqu’au 1er septembre 2015, la clause-type de la garantie PID était ainsi rédigée: « À défaut de désignation expresse, les prestations sont versées : / - au conjoint survivant non séparé de corps par jugement définitif passé en force de chose jugée, / - à défaut, au pacsé de l’assuré, / - à défaut, au concubin notoire de l’assuré, / - à défaut, et par parts égales, aux enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, / - à défaut, et par parts égales, aux ascendants au 1er degré de l’assuré, / - à défaut, à la MGEN ». La mention « à défaut, et par parts égales, aux héritiers de l’assuré » n’a été insérée avant la mention de la MGEN qu’à compter du 1er septembre 2015 (pt 23).
[17] ACPR, Commission des sanctions, 12 mai 2022, procédure n° 2020-10, MGEN Vie, pt 35.
[18] ACPR, Commission des sanctions, 30 mai 2022, procédure n° 2021-03, NATIXIS INTEREPARGNE, n° 39.
[19] CJUE, 29 septembre 2022, aff. C-633/20 N° Lexbase : A09968MT. – Cf. Interview de P.-G. Marly par F. Delambily, Quand la CJUE se penche sur la distribution d’assurance, 30 novembre 2022, newsassurancespro.com [en ligne].
[20] Cf. C. mon. fin., art. L. 612-41 N° Lexbase : L4087LKL.
[21] ACPR, Commission des sanctions, 17 octobre 2022, procédure n° 2021-04, Résurgence Assurances (ex-Viva Conseil).
[22] V. Tournaire, Sanction par l’ACPR d’un intermédiaire en assurance pour non-respect des obligations d’information et de conseil, Dalloz actualité, 14 novembre 2022.
[23] La Commission des sanctions relève que les documents informatifs étaient « transmis pendant la conversation entre le téléopérateur et le prospect, qui [durait] jusqu’à la souscription, de sorte que le client n[e disposait] d’aucun délai pour prendre connaissance de l’information reçue » et que « le téléopérateur ne s’assurait pas auprès du prospect de la bonne réception des documents précontractuels, ne l’invitait pas à en prendre connaissance et ne les parcourait pas avec lui ».
[24] Cf. sur cette obligation d’information et de conseil du distributeur d’assurance : B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, LGDJ, 4e éd., 2021, n° 124.
[25] J. Delayen, Rapport de l’ACPR sur le secteur de l’assurance en 2021 : vous avez dit crise ? Mais quelle crise ?, Dalloz actualité, 25 novembre 2022 : « Il ressort du rapport annuel de l’ACPR sur les chiffres du marché de l’assurance 2021 que le secteur se porte pour le mieux. La crise sanitaire de 2020 ne l’a finalement que très peu affecté. Une mise en perspective sur un temps plus long révèle même une tendance de fond : celle de la croissance continue du secteur. Cela permet de relativiser la portée de certains discours quant à la fragilité des acteurs de l’assurance. On sait que la crise de la covid-19 a conduit les assureurs à agiter de nouveau « l’épouvantail du risque de faillite sériel des compagnies » afin de créer « un tapage médiatique » (R. Bigot, Le caractère inassurable du risque pandémique : une « allégation fantaisiste » d’AXA, Dalloz actualité, 28 mai 2020) dans le but de « récolter davantage de primes à l’avenir » et de faire pression sur le législateur afin de « laisser à la solidarité́ nationale la prise en charge du risque le plus lourd » (R. Bigot et C. Rodet, Les enjeux de la pandémie sur l’assurance, in A. Cayol et R. Bigot [dir.], Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 54). Ce discours doit être mis à l’épreuve, ce qui implique un « regard postérieur, accompagné du recul nécessaire » (op. cit., p. 56). C’est ce à quoi pourrait justement contribuer, au moins sur un plan macro-économique, la publication récente du nouveau rapport annuel de l’ACPR sur l’activité de la banque et de l’assurance en 2021, en ce qu’il dresse le bilan des lendemains de la crise sanitaire ».
[26] Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-25.377, F-D N° Lexbase : A93433DE : « La clause selon laquelle sont exclues ‘les pertes indirectes de quelque nature que ce soit, manque à gagner et paralysies’ définit expressément ce qui relève du préjudice de pertes d'exploitation ».
[27] B. Beignier, et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, LGDJ, Lextenso, 4e éd., 2021, no 991.
[28] A. Zaroui, Covid-19 et pertes d’exploitations : analyses des premiers jugement rendus au fond, Editions législatives, 25 septembre 2020 ; V. Morales, La garantie pertes d’exploitation des restaurateurs en temps de covid-19 : tour de table des premières décisions !, Lexbase Droit privé, n° 840, 15 octobre 2020 (N° Lexbase : N4918BYS).
[29] R. Bigot, A. Cayol et A. Charpentier, Risque de pandémie, pertes d’exploitation et incertitudes des garanties assurantielles, RCA 16 juin 2022, p. 13.
[30] Sur la diversité des clauses susceptibles d’être stipulées en ce domaine, voir M. Mignot, Covid-19 et clauses du contrat d'assurance, RGDA novembre 2021, p. 8.
[31] M. Robineau, L’assurance des pertes d’exploitation, in R. Bigot et A. Cayol (dir.), Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 332.
[32] ACPR, Garantie « pertes d’exploitation » : l’état des lieux de l’ACPR, Communiqué de presse, 23 juin 2020 [en ligne].
[33] M. Robineau, L’assurance des pertes d’exploitation, précité.
[34] Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, 14e éd., 2017, n° 703, p. 501.
[35] CA Aix-en-Provence, 25 février 2021, n° 20/10357 N° Lexbase : A21574IQ et CA Aix-en-Provence, 20 mai 2021, n° 20/10358 N° Lexbase : A35714S3, n° 20/13305 N° Lexbase : A42144SU et n° 20/08317 N° Lexbase : A43504SW.
[36] CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 25 février 2021, n° 20/10357, préc., Dalloz actualité 11 mars 2021, obs. S. Andjechairi-Tribillac ; RGDA mars 2021, p. 1, obs. J. Kullmann ; Lexbase Droit privé, n° 861 du 8 avril 2021, Chronique de droit des assurances, par R. Bigot et A. Cayol N° Lexbase : N7115BY8).
[37] Cass. civ. 1, 22 mai 2001, n° 99-10.849, publié au bulletin N° Lexbase : A5004ATI.
[38] Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-10.001, F-P+B N° Lexbase : A6120HYC.
[39] Cass. civ. 1, 18 février 1987.
[40] Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-31.057, FS-P+B N° Lexbase : A3500ICM. Également dégagée en droit commun des contrats par la jurisprudence concernant les clauses limitatives de responsabilité (Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632 N° Lexbase : A2343ABE), une telle solution a été consacrée et généralisée par l’ordonnance du 10 février 2016 (C. civ., art. 1170 N° Lexbase : L0876KZH).
[41] Cass. civ. 1, 9 mars 2004, n° 00-21.974, F-D N° Lexbase : A4798DBC.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483666
[Focus] L’avocat et la médiation
Lecture: 23 min
N3455BZY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Valérie Lasserre, Professeur à l’Université du Mans
Le 16 Décembre 2022
Mots-clés : avocat • médiation • MARD • protocole d’accord • conseil
Les avocats sont en première ligne dans les MARD pour aider leur client à construire une solution plus globale, plus originale, plus adaptée, plus créatrice de valeur ajoutée, mutuellement satisfaisante, et par suite plus satisfaisante pour le justiciable, et enfin mieux acceptée que la solution purement juridique obtenue dans le cadre d’une procédure à rallonge. Tous les nouveaux textes de la procédure civile engendrent donc une impérieuse réforme, une modernisation des processus des avocats, à la fois pour conserver leur rôle de défense des intérêts de leur client, mais aussi pour englober dans leurs compétences la gestion amiable des conflits en tant qu’accompagnateur.
Il s’agit de montrer comment les avocats peuvent se sentir à l’aise avec l’amiable, développer leurs compétences pour s’adapter aux différents modes de gestion des conflits et accroître leurs interventions et leur légitimité dans la gestion négociée des conflits, en s’interrogeant tour à tour sur les rôles et les vertus de l’avocat dans l’amiable.
Depuis la loi n° 95-125 du 8 février 1995 N° Lexbase : L1139ATD [1] , plusieurs réformes successives ont eu pour objectif d’affirmer et d’élargir la place des modes amiables dans la procédure. L’amiable est de moins en moins considéré comme un passager clandestin ou comme un concurrent déloyal de la justice. Il est de plus en plus considéré comme un véritable droit des justiciables, leur offrant une voie légitime de gestion de leur conflit.
L’avocat est donc nécessairement aux prises avec l’amiable, qu’il accueille cette évolution favorablement ou que ce soit à son corps défendant. Être un avocat aujourd’hui, c’est savoir maîtriser la procédure, mais c’est aussi connaître son alternative, la gestion négociée du conflit, et donc savoir participer à un mode amiable, en comprendre les enjeux, les conditions, les freins, en être à l’instigation si nécessaire, savoir le gérer et en gérer les risques, savoir accompagner.
Les enjeux pour l’avocat sont immenses, car l’avocat de l’amiable est et doit absolument rester avant tout le défenseur de son client mais en s’ajoutant une casquette supplémentaire par rapport à celle de l’avocat de la seule procédure. Ce qui est demandé à l’avocat, en quelque sorte, c’est d’être un avocat encore plus complet, de détenir une expertise et un savoir-faire encore plus sophistiqués que l’avocat du seul volet procédural, et en conséquence aussi d’être riche d’autres qualités.
L’intérêt de cette évolution, c’est d’élargir le métier et de l’enrichir. Il s’agit dans ces propos de montrer comment les avocats peuvent se sentir à l’aise avec l’amiable, développer leurs compétences pour s’adapter aux différents modes de gestion des conflits et accroître leurs interventions et leur légitimité dans la gestion négociée des conflits. Il sera plus précisément question de « l’avocat et la médiation », sans toutefois traiter de l’avocat médiateur [2], mais en se concentrant sur l’avocat accompagnateur en médiation et prescripteur de la médiation.
J’essaierai de proposer quelques éléments de réponse, en m’interrogeant tour à tour sur les rôles de l’avocat dans l’amiable (I.), puis sur les vertus de l’avocat dans l’amiable (II.).
I. Le rôle de l’avocat dans l’amiable : ICARE
Quel est le rôle de l’avocat dans l’amiable ? Mieux vaudrait dire : quels sont les rôles de l’avocat dans l’amiable ? Car il y en a plusieurs.
Pour répondre on peut utiliser un acronyme : ICARE. Informer ; Conseiller, Accompagner, Rédiger le protocole d’accord et enfin, contrôler l’Exécution du protocole. Leur rôle, en effet, est d’Informer, de Conseiller, d’Accompagner, de Rédiger le protocole d’accord, enfin de contrôler l’Exécution du protocole.
Informer. Informer signifie que l’avocat doit connaître les différentes voies de résolution des conflits et les rapporter, les expliquer à son client. C’est d’ailleurs ce que prévoit le règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat puisqu’une décision portant modification de ce règlement intérieur national du 18 décembre 2020 [3], intègre un nouvel alinéa à l’article 6.1 du RIN. Celui-ci dispose que « Lorsque la loi ne l’impose pas, il est recommandé à l’avocat d’examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d’une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d’un acte juridique en introduisant une clause à cet effet ».
Le règlement intérieur national envisage un examen des voies amiables, même lorsque la loi ne l’impose pas. Mais force est de constater qu’envisager l’amiable avant d’entrer dans la bataille judiciaire, est ce que le législateur préconise de plus en plus souvent aux professionnels du droit depuis 2015.
Il y a eu, d’abord, le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends N° Lexbase : L1333I8U. Ce décret a généralisé l’obligation pour les professionnels du droit d’envisager une solution amiable avant toute saisine d’un juge. En effet, toute assignation, requête ou déclaration devait « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public » préciser « également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » (C. proc. civ., art. 56 N° Lexbase : L8646LYU et 58 N° Lexbase : L9290LTA) ; à défaut, le juge peut proposer une mesure de conciliation ou de médiation (C. proc. civ., art. 127 N° Lexbase : L8650LYZ). Les dispositions précitées des articles 56 et 58 du Code de procédure civile ont été abrogées par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3 [4]. Désormais l’article 54 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8645LYT énonce dans son cinquième alinéa que « à peine de nullité, la demande initiale mentionne… lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ». Quant à l’article 127 du même code, il dispose que « Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».
Ensuite, dans cette même ligne, il y a eu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L1605LB3 [5] qui a constitué une autre étape importante, en imposant, à peine d’irrecevabilité de la déclaration au greffe du tribunal d’instance – désormais tribunal judiciaire (lorsque l’objet du litige est inférieur à 4 000 euros) – que le juge peut soulever d’office, une tentative de conciliation devant un conciliateur de justice et en introduisant l’expérimentation de la tentative de médiation obligatoire en matière de médiation familiale dans onze tribunaux judiciaires (à propos des demandes de modification des dispositions d’une convention de divorce homologuée, ou d’une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant). Cette dernière expérimentation a été prorogée d’année en année jusqu’à aujourd’hui.
Puis, toujours dans ce sens, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC [6] a cherché à promouvoir les modes de résolution amiables des litiges en général et la médiation en particulier et à développer la « culture de l’amiable » de deux manières. Elle a, en premier lieu, autorisé le juge à enjoindre les parties à rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui pourra les informer sur l’objet et le déroulement d’une procédure de médiation « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible » (Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, art. 3, I, 2° ; Loi n° 95-125, du 8 février 1995, art. 22-1, mod.). Cette règle a été intégrée dans l’article 127-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5938MBK par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation N° Lexbase : Z45987TY [7]. Elle a, en deuxième lieu, introduit de nouvelles tentatives obligatoires d’amiable préalable qui ont été précisées par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (lorsque l’objet de la demande est inférieur à 5 000 euros et pour certains conflits du voisinage relevant du droit des biens) [8].
Enfin, la dernière étape a été réalisée récemment. L’article 750-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5912MBL, qui prévoit des cas de recours obligatoires et préalables à des modes amiables de règlement des conflits, avant toute saisine du juge, a ensuite été étendu aux troubles anormaux du voisinage par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation. Dès lors qu’une personne envisage une action en justice fondée sur les troubles anormaux du voisinage, il faudra donc qu’elle tente préalablement la voie amiable avec son voisin. Mais, par un arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d’État vient d’annuler l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2021 [9], en ce qu’il ne précise pas suffisamment les modalités selon lesquelles l’indisponibilité des conciliateurs de justice doit être regardée comme établie (indisponibilité des conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif), permettant la dispense de recours en cas de motif légitime [10].
Ce parcours législatif est clair ; il ne s’agit de rien d’autre que d’une extension continue du périmètre de la tentative d’amiable préalable obligatoire, pour résumer : à tous les petits litiges (ou litiges du quotidien), ainsi qu’à nombre de litiges entre voisins (le voisinage étant naturellement le fief de la tentative de l’amiable préalable obligatoire). Il s’agit d’une tendance générale, en dépit des vicissitudes qui viennent d’être présentées. Cette extension notoire de l’amiable redessine le cheminement de la procédure. L’amiable préalable est désormais posé comme une règle procédurale, un principe de gestion de conflit promu par la procédure civile, un droit (presque naturel) du justiciable. Ce qui correspond aussi peut-être à une nouvelle attente de l’avocat : un « besoin plus profond de modifier le rapport au litige par le recours préalable au dialogue » [11]. À ce titre, l’amiable a probablement vocation à continuer de s’étendre.
De telles réformes de la procédure civile ne peuvent être sans incidence sur la profession d’avocat. Les changements dans leur pratique sont très importants. C’est un changement de logiciel qui implique l’élargissement de leur activité professionnelle à la gestion de conflit non contentieuse. Ce qui signifie pour eux : s’adapter à cette nouvelle phase, rester crédibles aux yeux de leurs clients, tout en continuant de défendre, en même temps, les intérêts de leurs clients.
Différents enjeux de l’information. L’information suppose que l’avocat se soit formé. Il existe des diplômes universitaires de médiation, comme par exemple à l’Université du Mans. Mais des formations plus courtes sont également envisageables. Ce qui est important, c’est d’accéder à une formation, même courte, pour incorporer les sous-jacents de l’amiable.
Quant au moment de l’information, c’est une question très intéressante. Il me semble que l’information doit être communiquée très tôt, dès que l’avocat a connaissance du dossier et rencontre son client. Mais cette information est aussi utile en cours de procédure et même lorsque le contentieux se poursuit en appel.
Comme toute obligation d’information, le contenu et le niveau de l’information dépendent du créancier de cette obligation, le client, de son propre niveau de connaissance et de sa sensibilisation aux modes amiables (par exemple les chefs d’entreprise en général savent ce qu’est la négociation ; certains clients sont immédiatement favorables, d’autres farouchement contre). Ce que l’avocat est seul en mesure d’évaluer ; ces éléments sont déterminants pour évaluer les informations et les arguments à développer à l’égard du client.
Il est évident que le développement des modes amiables de règlement des différends (MARD) a des conséquences inéluctables sur le métier, sur la manière de concevoir un dossier, de le monter, sur le développement des stratégies de défense du client, sur l’analyse temporelle du dossier et sur la diversité des solutions envisageables créatrices de valeur. On remarquera que l’avocat est amené à passer d’une stratégie de défense à une stratégie de gestion de conflit et qu’il est invité à gérer des temporalités multiples : le temps du procès et la parenthèse de la médiation, laquelle peut durer assez longtemps ou être contenue dans un temps court. L’information du client doit contenir des éléments de temporalité qui relèvent d’une grande complexité à cause de leurs natures différentes (temps judiciaire, temps de la médiation, temps de la situation contractuelle, temps du conflit, temps vécu), de leurs niveaux différents, des difficultés de leur articulation.
En ce qui concerne enfin la force juridique de l’obligation d’information, c’est un point délicat. La sanction d’une absence d’information par la responsabilité professionnelle fait peur de façon tout à fait légitime. Il me semble que pour ne pas la craindre, il n’est pas inutile d’intégrer dans la gestion du dossier une fiche d’information personnalisée sur les règlements amiables, qui devrait rentrer dans les coûts rémunérés de l’avocat.
Conseiller. Conseiller relève du devoir de conseil, ce qui est plus compliqué que le devoir d’informer car la communication d’information est brute en quelque sorte, tandis que le devoir de conseil relève du jugement de l’avocat, de l’intelligence de l’affaire, de la compréhension de la psychologie des parties et de leur conseil et aussi de la stratégie de gestion de conflit. Conseiller n’est jamais facile, d’autant plus que la réussite d’une négociation dépend des deux parties (l’avocat ne connaît pas personnellement l’autre partie et n’a qu’un son de cloche) et des qualités des deux avocats. Quels sont les avocats les plus enclins à conseiller la mise en place d’un mode amiable ? D’une façon générale, on peut dire qu’il y a des avocats favorables à l’amiable et d’autres qui sont farouchement contre. Il est cependant difficile de faire une sociologie des avocats pour ou contre. L’âge n’est pas décisif. C’est la personnalité de l’avocat qui le sera davantage et son inclination naturelle vers les modes amiables. Ensuite, son expérience de la négociation ou de la médiation sera un élément important. Les mauvaises expériences ne sont pas engageantes ; tandis qu’un avocat qui aura toujours favorisé l’amiable sera plus à l’aise avec la médiation. Enfin, il y a une autre réalité pragmatique, c’est la durée du litige. Les avocats défavorables à la médiation au début du litige peuvent y devenir absolument favorables après dix ans de procès, quand les clients en ont assez et qu’ils s’ennuient de la procédure et qu’ils commencent à avoir des difficultés pour assurer le paiement des honoraires et frais de procédure ou qu’ils n’ont plus envie de payer plus longtemps.
Il faut avoir à l’esprit que l’avocat devrait conseiller la médiation toutes les fois où il lui apparaît clairement que la médiation dans une affaire permet de poursuivre trois intérêts distincts. Premièrement, permettre une meilleure solution que celle du juge (plus efficace car consentie, plus rapide et sur-mesure) ; deuxièmement, dans de meilleures conditions (en évitant la guerre procédurale), et troisièmement, sans risque de compromettre sa position devant le juge (grâce au devoir de confidentialité).
Accompagner. Accompagner son client dans la médiation est une autre facette du rôle de l’avocat dans la médiation. Il faut ici distinguer en fonction des matières. Dans les affaires familiales, les réunions de médiation se faisaient souvent sans les avocats ; mais cela tend à changer, grâce au développement d’une culture de la médiation familiale sur la base d’une convention de médiation avec les avocats [12]. Dans d’autres domaines plus techniques, comme en matière économique ou de construction ou de copropriété, les avocats sont présents. L’activité d’accompagnement est subtile et complète : c’est tout à la fois rassurer les parties par sa présence et jouer le rôle d’écran pacificateur et apaisant [13], coacher et préparer « le client à l'esprit de la médiation et aux techniques de communication non violentes, même former son client aux techniques de communication », préparer « les réunions, les documents à transmettre », aider « son client à les interpréter, les comprendre », s'entretenir « avec lui avant et après les rendez-vous de médiation pour préparer, proposer des solutions, rappeler le droit », assurer une présence physique et morale », être « présent pour voir son client évoluer » et l'aider « à faire et accepter une solution équilibrée répondant aux besoins et intérêts de l'ensemble des parties », soutenir, rassurer, écouter, éviter le découragement et amener le client à l'accord, proposer « des options adaptées aux intérêts de chacun », enfin vérifier « la conformité juridique de la solution retenue » [14].
L’avocat défend son client et la médiation ne l’engage pas à abandonner ce rôle. Mais, de surcroît, du fait qu’il entre dans le cadre de la médiation, il est amené à modifier son action et défendre d’une autre manière son client, d’une manière plus collective, plus collaborative, plus constructive, en présence des autres parties, de son ou de ses confrères et du médiateur. La médiation modifie la relation de l’avocat avec son client, en ce qu’elle n’est plus seulement un tête-à-tête avec le client. La relation bilatérale se transforme en relation multilatérale, naturellement beaucoup plus complexe, protéiforme et aléatoire. L’accompagnement est primordial. Il lui permet de prendre contact avec ses confrères, de prendre connaissance de tous les éléments du dossier et même de certains qu’il a pu ignorer, enfin de réfléchir à des solutions nouvelles.
Rédiger le protocole d’accord. Rédiger le protocole d’accord relève de l’activité classique de l’avocat. Lors de cette étape, il reprend donc son activité naturelle de rédacteur d’acte (cela sous le contrôle et avec les conseils des autres parties). Dès lors il envisage les prises de garanties et les conditions d’efficacité de l’acte. La rédaction à deux mains se transforme en une rédaction à quatre, six ou huit mains. L’esprit collaboratif doit imprégner cette mission spécifique qui suppose là encore de vouloir avancer ensemble vers une solution commune.
Contrôler l’exécution du protocole d’accord. Enfin, contrôler l’exécution du protocole d’accord permet de savoir s’il est possible de refermer la parenthèse procédurale par un désistement d’instance et d’action sans risque pour le client. Il s’agit là encore du rôle classique de l’avocat négociateur de faire homologuer le contrat auprès de la juridiction compétente et de s’assurer de son exécution. Cela suppose également que les avocats des différentes parties restent en contact étroit. À cet égard, le décret du 25 février 2022 donne une plus haute valeur aux transactions et actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties, puisqu’ils peuvent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente, sans passer par le juge.
L’ICARE permet de bien comprendre quels sont les rôles de l’avocat dans l’amiable [15]. Mais bien jouer ce rôle suppose un certain nombre de vertus de l’avocat, ce qui illustre la très grande difficulté attachée à cette mission.
II. Les vertus de l’avocat dans l’amiable
Qualités cardinales. Pour comprendre les vertus de l’avocat dans l’amiable, il n’est pas inutile de s’interroger sur les vertus de l’avocat dans sa mission classique d’avocat plaidant ou conseil. Quelles sont-elles ? La pugnacité, le courage, premièrement, la finesse de l’analyse juridique, et la connaissance de la stratégie contentieuse, deuxièmement, le sens de la justice troisièmement et la rhétorique enfin, c’est-à-dire l’art de convaincre par les écritures et dans les plaidoiries.
Ces qualités cardinales doivent être présentes dans la médiation ; mais d’autres doivent impérativement s’y ajouter. En effet, la médiation suppose des qualités spécifiques qui peuvent sembler radicalement différentes de celles qui doivent se trouver dans l’ADN de l’avocat mais que les avocats peuvent tout à fait cumuler.
Quelles sont les qualités essentielles de l’avocat dans la médiation ? Premièrement, la capacité d’écoute. Deuxièmement, la sérénité. Troisièmement, la pédagogie. Quatrièmement, l’intelligence du compromis. Ces quatre qualités supplémentaires ne sont pas du tout évidentes et peuvent sembler remettre en question les qualités classiques de l’avocat.
Il est essentiel de comprendre que le logiciel de l’amiable est différent de celui de l’avocat plaidant ou de l’avocat conseil. Le multilatéralisme qui est l’essence de l’amiable s’oppose frontalement à la relation ex-cathedra entre l’avocat et son client, qui est une relation à la fois d’autorité légitime de sachant et de protection.
Capacité d’écoute. Premièrement, la capacité d’écoute est indispensable du fait que la médiation favorise et permet l’expression des différents points de vue sur le conflit, au-delà du seul aspect juridique du litige et que l’avocat, comme son client, est amené à entendre le point de vue de l’autre partie. Cet aspect est très éloigné de sa mission classique de défenseur et de juriste confronté principalement au seul point de vue de son client, et de surcroît s’exprimant principalement à travers des écritures. Le premier écueil pour l’avocat est l’envie de rabrouer l’autre partie pour des raisons qui sont tout à fait claires et recevables : parce que celle-ci présente le conflit de façon irrationnelle à ses yeux ou parce qu’elle a du mal à s’exprimer ou parce qu’elle lui semble malhonnête à l’égard de son client. Savoir dépasser ce sentiment est parfois un acte d’héroïsme pour l’avocat qui a tendance à épouser totalement le point de vue de son client et à prendre pour argent comptant l’histoire du conflit telle qu’il lui raconte. Pourtant la médiation impose de s’écouter.
Sérénité. Deuxièmement la sérénité de l’avocat est essentielle dans la médiation. C’est la sérénité qui va permettre le débat, la discussion et la réflexion sur d’éventuelles solutions amiables. Même si elle prend appui sur une identification légitime de l’avocat aux intérêts de son client, l’agressivité est l’un des freins les plus puissants à la médiation en ce qu’elle traduit soit une incompréhension de l’espace discursif de la médiation et de son objectif, soit un rejet de la médiation comme un espace insécurisant. On rencontre plusieurs catégories d’avocats. Les avocats les plus sereins sont ceux qui y croient, ceux qui sont les plus sensibles aux avantages de l’amiable (qui ont la foi), ceux qui ont de bonnes expériences passées en matière de médiation, ceux qui ont intégré la négociation dans leurs pratiques bien antérieurement au développement de la politique de médiation, enfin les avocats au tempérament placide. Ce sont les avocats les plus à l’aise dans une médiation. L’une des grandes difficultés pour le médiateur sera de gérer l’agressivité de l’avocat qui peut se cumuler ou non d’ailleurs avec celle des parties qui peuvent montrer de la hargne tant à l’égard de l’avocat ou de l’autre partie, voire à l’égard du médiateur et souvent les trois à la fois. Force est, en effet, de constater que les parties utilisent volontiers des déviations de leur agressivité. Sachant que l’agressivité contre l’autre partie pourrait leur être reprochée, elles peuvent s’acharner contre son conseil. Concernant le devoir de l’avocat, il faut se rappeler que son agressivité à l’égard de l’autre partie est une violation de ses obligations déontologiques d’avocat ; en effet ce que lui interdit sa déontologie d’avocat, la médiation ne peut lui permettre.
Si la sérénité est indispensable c’est parce que, dans la médiation, « le travail s'y fait en équipe et en coopération, même en cas de tensions. La déontologie et la confraternité peuvent se déployer : la médiation permet aux avocats de lâcher leur posture d'hostilité, de surenchère ou d'identification à la position de leur client » [16]. Seule la sérénité permet l’écoute, le respect mutuel, le respect des règles de courtoisie, la reprise du dialogue, la coopération et la collaboration.
Pédagogie [17]. Troisièmement, l’avocat doit être pédagogue, parce qu’il lui faudra parfois convaincre le client qui souhaite en découdre de l’intérêt pour lui de s’engager dans un processus de médiation. C’est peut-être ce qui est le plus difficile pour l’avocat parce que la pédagogie peut être chronophage.
Intelligence du compromis. Quatrièmement, enfin, l’intelligence du compromis est indispensable. Cela implique, premièrement, de grandes qualités juridiques pour savoir analyser les risques juridiques et économiques de son client, ainsi que ceux assumés par l’autre partie. Deuxièmement aussi une forme de pondération dans le jugement des choses. Troisièmement, également l’honnêteté de l’avocat à l’égard de son client sur ses chances de réussite ou d’échec et le risque d’une procédure longue et coûteuse. Cela implique, enfin, qu’une liberté de communication et un lien de confiance se soient préalablement instaurés avec son client.
Pour conclure, les avocats sont en première ligne dans les MARD pour aider leur client à construire une solution plus globale, plus originale, plus adaptée, plus créatrice de valeur ajoutée, mutuellement satisfaisante, et par suite plus satisfaisante pour le justiciable, et enfin mieux acceptée que la solution purement juridique obtenue dans le cadre d’une procédure à rallonge.
Tous les nouveaux textes de la procédure civile engendrent donc une impérieuse réforme, une modernisation des processus des avocats, à la fois pour conserver leur rôle de défense des intérêts de leur client, mais aussi pour englober dans leurs compétences la gestion amiable des conflits en tant qu’accompagnateur.
[1] Loi n° 95-125, du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative N° Lexbase : L1139ATD.
[2] Tout avocat peut être médiateur, même sans être inscrit au centre national de médiation des avocats (CNMA), en application de l’article 115 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat N° Lexbase : L8168AID. En effet, par une décision du 25 octobre 2018, le Conseil d’État a jugé illégales les dispositions modifiées de l’article 6.3.1 du RIN prévoyant désormais que l’avocat peut, outre ses missions traditionnelles, « être investi d’une mission de professionnel qualifié, d’arbitre, d’expert, de médiateur (qualité dont il peut faire état dès lors qu’il est référencé auprès du Centre national de médiation des avocats -CNMA), de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire ». Il devenait dès lors interdit à un avocat non référencé de se prévaloir de sa qualité d’avocat-médiateur, y compris lors de consultations orales, ce qui a été jugé illégal (CE, 25 octobre 2018, n° 411373, Féd. Fr. des centres de médiation et a. N° Lexbase : A0709YI4 : S. Grayot-Dirx, obs., JCP G, 2018, 1196).
[3] Conseil national des barreaux, Décision du 18 décembre 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat N° Lexbase : Z947691A.
[4] Décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile N° Lexbase : L8421LT3.
[5] Loi n° 2016-1547, du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle N° Lexbase : L1605LB3.
[6] Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC.
[7] « À défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ».
[8] L’article 750-1 Code de procédure civile : « À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
[9] Décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile N° Lexbase : L8421LT3.
[10] CE 5/6 ch.-r., 22 septembre 2022, n° 436939 N° Lexbase : A16328KN.
[11] R. Carayol, 3 questions à romain Carayol, président de la FFCM, JCP G, Actualités, 2021, 1113.
[12] A.-M. De Cayeux et C. Denoit-Benteux, La pratique de l’accompagnement en médiation : modèles de convention avec avocats, Droit de la famille, dossier 31 : « Les avocats sont invités à intervenir à la table de médiation pour ajouter ou reformuler, en laissant toujours le médiateur mener les échanges.
Les avocats doivent impérativement s’abstenir d’argumenter ou plaider comme ils pourraient le faire dans une salle d’audience. La réussite du processus est inévitablement liée à la formation des avocats et à leur connaissance du processus de médiation : que ce soit son esprit, ses règles ou son déroulé ainsi que la maîtrise des outils de communication » ; N. Assuied Hodara, D. Ganancia et I. Copé Bessis, Pour une nouvelle approche des modes amiables : le partenariat entre avocats et médiateurs, AJ Famille, 2022 p. 128 ; B. Régent, Conflits familiaux : développons l'avocat de la paix, AJ Famille, 2022, p. 118 ; A. M. de Cayeux, C. Denoit-Benteux et C. Emmanuel, La médiation avec avocats en matière familiale : guide pratique et clés de réussite, AJ Famille 2017, p. 580 ; A. M. de Cayeux, C. Denoit-Benteux et C. Emmanuel, La médiation en matière familiale : pas sans mon avocat !, AJ Famille 2017 p. 570.
[13] A. M. de Cayeux, C. Denoit-Benteux et C. Emmanuel, La médiation avec avocats en matière familiale : guide pratique et clés de réussite, AJ Famille, 2017, p. 580.
[14] A. M. de Cayeux, C. Denoit-Benteux et C. Emmanuel, La médiation en matière familiale : pas sans mon avocat !, AJ Famille, 2017, p. 570.
[15] Quel est le rôle des avocats dans la médiation ? « Leur rôle est essentiel. Pour moi, les avocats sont devenus des acteurs de solutions. Ils ont une obligation déontologique d’intégrer la médiation, et les MARD en général, dans l’analyse de tous leurs dossiers pour conseiller au mieux leurs clients dans la stratégie et les objectifs à atteindre. Dans les médiations, le rôle des avocats est précieux, en soutien de leurs clients. Ils ont une place très importante pour identifier les besoins de leurs clients et les accompagner dans la recherche de solutions. Il y a une évolution notable. Les avocats se forment de plus en plus à la médiation. Pas nécessairement pour devenir médiateurs, mais pour avoir les outils leur permettant d’accompagner utilement leurs clients. Les centres adhérents de la FFCM participent, sur tout le territoire, à la promotion de la médiation auprès des avocats et des magistrats. Il y a encore du travail d’information à mener. Mais, nos centres adhérents sentent l’intérêt pour la médiation. Je dois aussi ajouter qu’une nouvelle génération de médiateurs arrive, avocats ou pas, qui a envie de développer la médiation en activité professionnelle principale. C’est un signal fort du temps qui s’ouvre à nous. La FFCM est sensible à ce mouvement. Nous allons y consacrer une partie de nos travaux avec nos adhérents » : R. Carayol, préc., JCP G Actualités, 2021, 1113.
[16] A. M. de Cayeux, C. Denoit-Benteux et C. Emmanuel, La médiation en matière familiale : pas sans mon avocat !, AJ Famille, 2017, p. 570.
[17] A. M. de Cayeux, C. Denoit-Benteux et C. Emmanuel, La médiation avec avocats en matière familiale : guide pratique et clés de réussite, AJ Famille, 2017, p. 580 : expliquer : la pérennité du lien familial, le rôle du tiers neutre, la place de l'avocat, la confidentialité, la rapidité, l'efficacité, la pérennité de la solution négociée, la liberté, la globalité, la sécurité, la rentabilité, l'ouverture.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483455
[Brèves] Précision relative au point de départ du délai de contestation du coût prévisionnel de l’expertise CSE
Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-16.996, F-B N° Lexbase : A85238XX
Lecture: 2 min
N3610BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 14 Décembre 2022
► Le point de départ du délai de dix jours pendant lequel l’employeur peut contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise votée par le CSE court à compter de la notification par l’expert du dernier cahier des charges rectifié.
Faits et procédure. En l’espèce, un CSE vote le recours à une expertise pour risque grave. Un expert adresse le 17 janvier 2021 un cahier des charges. Le 26 janvier 2021, il adresse un cahier des charges rectifié. L’employeur saisit le juge judicaire le 5 février 2021 en contestation du coût prévisionnel prévu.
|
Pour rappel. L’employeur qui souhaite contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l'expertise doit saisir le tribunal judiciaire dans un délai de dix jours (C. trav., art. R. 2315-49 N° Lexbase : L0548LI7) à compter de la notification par l’expert du cahier des charges et des informations légalement requises (C. trav., art. L. 2315-86, al. 1er, 3° N° Lexbase : L1774LR7). |
Le tribunal rejette le recours. Pour le juge, le point de départ du délai de dix jours avait démarré au jour où l'expert ayant envoyé sa lettre de mission précisant un coût et une durée prévisionnels pour cette mission. Plus de dix jours s’étant écoulés entre le 17 janvier 2021 et le 5 février 2021, le juge considère que la demande de l’employeur est irrecevable.
L’employeur forme un pourvoi en cassation. Selon lui, le point de départ du délai de contestation démarre le 26 janvier, date de la notification du cahier des charges rectifié.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision du tribunal judiciaire.
Elle considère que le délai de contestation de dix jours courait à compter du 26 janvier (notification à l'employeur du cahier des charges rectifié avec le nouveau coût prévisionnel) et non du 17 janvier. L’action était donc recevable.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le recours à l'expertise par le comité social et économique, La contestation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2027GAC. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483610
[Brèves] Ordonnance sur requête portant désignation d’un administrateur provisoire : motivation et sanction de l’absence de notification de la requête aux copropriétaires ?
Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2022, n° 21-20.264, FS-P+B N° Lexbase : A85308X9
Lecture: 4 min
N3672BZZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 14 Décembre 2022
► Selon l'article 62-5 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967, l'ordonnance rendue sur requête qui désigne l'administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire ;
► ce texte ne prévoit pas la notification de la requête aux copropriétaires ;
► l'ordonnance de désignation satisfait à l’exigence de motivation en visant la requête pour en adopter les motifs.
Faits et procédure. En l’espèce, par ordonnance du 21 décembre 2015, un administrateur provisoire a été désigné pour une durée de dix-huit mois, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4832AHG.
La mission de l'administrateur, qui a été transférée à une société, a été prolongée à plusieurs reprises et notamment par ordonnance du 15 janvier 2019, dont une SCI, copropriétaire, a demandé la rétractation, sur le fondement de l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5583IGU et de l'article 495 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6612H7Z (qui prévoit notamment, s’agissant de l’ordonnance sur requête, que « copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée »), du fait de la notification tardive de l'ordonnance et l'absence de notification de la requête.
La SCI faisait grief à l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 18 mars 2021, n° 19/18203 N° Lexbase : A59044LA) de rejeter sa demande de rétractation, faisant valoir notamment l'absence, concomitamment à la notification de l'ordonnance sur requête, de notification de la dite requête, d’une part, le non-respect de l’exigence de motivation de l’ordonnance, d’autre part.
Ces arguments sont tous deux rejetés par la Cour suprême.
- Sur l’absence de notification de la requête aux copropriétaires
Après avoir rappelé que selon l'article 62-5, du décret n° 67-223, du 17 mars 1967, « l'ordonnance rendue sur requête qui désigne l'administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire », et relevé que ce texte ne prévoit pas la notification de la requête, la Cour suprême approuve la décision de la cour d'appel qui en avait déduit, à bon droit, que la rétractation de l'ordonnance du 15 janvier 2019 ne pouvait être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile.
Autrement dit, l’absence de notification de la requête aux copropriétaires est sans incidence sur la validité de l’ordonnance sur requête. La précision est nouvelle à notre connaissance.
S’agissant de la notification aux copropriétaires de l’ordonnance sur requête portant désignation d’un administrateur provisoire, on rappellera que dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014, la Cour suprême avait été amenée à préciser l’absence de cette notification, si elle a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité des actes de l'administrateur provisoire à l'égard de ce copropriétaire (Cass. civ. 3, 24 septembre 2014, n° 13-20.169, FS-P+B N° Lexbase : A3188MXD).
- Sur l’exigence de motivation de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire
Le copropriétaire faisant le même grief à l’arrêt, faisant valoir que l'ordonnance sur requête du 15 janvier 2019, dépourvue de tout motif propre, se bornait à viser, sans en préciser ni la date ni le contenu, la requête initiale.
L’argument est là encore écarté par la Cour suprême qui approuve la cour d'appel ayant retenu, à bon droit, que l'ordonnance de prorogation de la mission de l'administrateur provisoire, qui visait l'ordonnance initiale du 21 décembre 2015, ainsi que la requête, pour en adopter les motifs, satisfaisait à l'exigence de motivation.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les copropriétés en difficulté, spéc. L'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E5581E7T. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483672
[Brèves] Possibilité pour les agents communaux rémunérés afin d'assurer le fonctionnement matériel des bureaux de poursuivre leur mission en qualité d'assesseurs
Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 2 décembre 2022, n° 461276, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36518XI
Lecture: 1 min
N3585BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 14 Décembre 2022
► Des agents communaux rémunérés pour assurer le fonctionnement matériel des bureaux de vote peuvent légalement compléter leur composition en qualité d'assesseurs.
Faits. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les résultats de plusieurs bureaux pour les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de l'élection des conseillers départementaux du canton d'Avignon-3, d'annuler ces élections et de les proclamer élus. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur protestation.
Position CE. Si des agents de la commune d'Avignon, qui étaient rémunérés par celle-ci pour assurer le bon fonctionnement matériel des bureaux de vote, ont été invités à compléter la composition de quatre bureaux de vote en y siégeant comme assesseurs, il n'est pas soutenu qu'ils n'avaient pas la qualité d'électeur dans la commune, ni que leur présence en qualité d'assesseur aurait, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin.
Décision. Dans ces conditions, le grief soulevé par les appelants, tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 44 du Code électoral N° Lexbase : L0775L34, selon lequel « les assesseurs ne sont pas rémunérés » doit être écarté.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les bureaux de vote, Les opérations de vote, in Droit électoral (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E27083EZ. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483585
[Jurisprudence] Précisions sur la question des biens échus sur succession après liquidation judiciaire
Réf. : Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-15.497, F-D N° Lexbase : A96308U9
Lecture: 10 min
N3621BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l’Université Côte d’Azur, Membre du CERDP, Directrice du Master 2 Droit des entreprises en difficulté de la faculté de droit de Nice
Le 14 Décembre 2022
Mots-clés : liquidation judiciaire • réalisation des biens échus au débiteur sur succession après sa liquidation judiciaire • soustraction de ces biens aux opérations de réalisation des actifs • application dans le temps de cette soustraction • procédure collective ouverte à compter du 1er juillet 2014
Un liquidateur peut faire désigner un technicien pour évaluer les immeubles d’un débiteur échus sur succession après sa liquidation judiciaire, dès lors que la procédure collective est ouverte avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014. En effet, l’article L. 641-9, IV en résultant et prévoyant que le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision, n’est pas applicable à une procédure collective ouverte avant le 1er juillet 2014.
Le principe classique qui était posé par le Code de commerce à l’article L. 641-9, I du Code de commerce N° Lexbase : L3951HBX était que le dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire atteignait les biens présents, mais aussi ceux à échoir après la liquidation judiciaire. La question pouvait se poser de savoir si ce principe avait été tenu en échec par une disposition introduite par l’ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326 N° Lexbase : L7194IZH), l’article L. 641-9,IV du Code de commerce N° Lexbase : L7329IZH, selon lequel le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. C’est cette disposition qui est au cœur de l’arrêt commenté, le premier de la Cour de cassation à porter sur cette disposition.
En l’espèce, le 9 mai 2006, M. C. a été mis en liquidation judiciaire. Par une ordonnance du 28 juin 2019, le juge-commissaire a désigné, à la demande du liquidateur, un technicien pour évaluer des immeubles dépendant de la succession du père de M. C., décédé en 2013, en vue de leur réalisation. M. C. a formé un recours contre cette ordonnance, qui a prospéré.
Le liquidateur a interjeté appel, se fondant sur les dispositions transitoires de l’ordonnance du 12 mars 2014, ayant créé le IV de l'article L. 641-9 du Code de commerce, duquel il résulte que le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. En effet, cette disposition issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 est, selon le liquidateur, inapplicable aux faits de l’espèce.
La Cour de cassation, s’appuyant sur l’article L. 641-9, IV du Code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et sur l’article 116 de cette ordonnance précisant les conditions de son entrée en vigueur, retient que « Il résulte du second de ces textes [ordonnance du 12 mars 2014, art. 116] que les dispositions du paragraphe IV de l'article L. 641-9 du Code de commerce, selon lesquelles le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter, ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur ». Elle en déduit que la cour d’appel [1], en refusant de faire droit à la demande de désignation du technicien pour évaluer les immeubles dépendant de la succession du père du débiteur, a violé par fausse application l’article L. 641-9, IV du Code de commerce.
La solution ne peut qu’être approuvée. L’article L. 641-9,IV du Code de commerce introduit par l’ordonnance du 12 mars 2014 n’est pas au rang des dispositions dont l’application dans le temps déroge au principe posé par l’article 116 de ladite ordonnance, principe classique selon lequel les dispositions nouvelles d’un texte modifiant le droit de entreprises en difficulté ne s’appliquent qu’aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur. Le texte de l’article L. 641-9, IV ne pouvait donc trouver application que si la procédure collective avait été ouverte à compter du 1er juillet 2014. Or tel n’avait pas été le cas, la procédure ayant été ouverte en 2006.
L’intérêt de l’arrêt ne se situe cependant pas tant sur le terrain de l’application de la loi dans le temps que sur celui de la portée du mécanisme institué en 2014 par le législateur.
Le pourvoi soutenait que « depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, de tels immeubles [ceux échus sur succession après la liquidation judiciaire] ne font plus partie de l'actif de la liquidation judiciaire par l'effet du dessaisissement et en sont exclus formellement par l'article L. 641-9 du Code de commerce, sauf accord du débiteur ». L’affirmation n’est pas rectifiée par la Cour de cassation qui aurait pu, en cas de fausseté de l’affirmation, procéder par une substitution de motifs. Or elle ne l’a pas fait. Cela accrédite donc l’idée que, pour la Cour de cassation, les biens échus au débiteur sur succession après l’ouverture de sa procédure collective, non seulement ne peuvent, sauf accord du débiteur, être réalisés par le liquidateur, ce que dit l’article L. 641-9, IV, mais encore, allant plus loin que la lettre-même du texte, considère que les biens en question ne font pas partie de l’actif de la liquidation, parce que le dessaisissement ne les atteint pas. Cela permet ainsi d’affirmer que ces biens ne sont pas soumis à l’effet réel de la procédure collective et que le dessaisissement ne s’applique pas à eux [2].
Cela n’est pas sans conséquence lorsque l’on raisonne sur des immeubles, comme cela était le cas en l’espèce. En effet, puisque le bien n’est pas soumis à l’effet réel de la procédure collective, le liquidateur n’a pas à en s’en préoccuper. Il n’a donc pas à souscrire des assurances pour assurer la conservation du bien. Économiquement, la solution est tout à fait logique. Pourquoi imposer au liquidateur d’exposer la collectivité des créanciers qu’il représente à des coûts qui ne profiteront pas à cette collectivité ? Pourquoi, en d’autres termes, diminuer le gage commun qui ne pourra être enrichi par la vente de l’immeuble ?
Faut-il aller plus loin et considérer que, puisque le dessaisissement ne frappe pas l’immeuble en question, le débiteur aurait le droit de le céder pendant sa liquidation judiciaire ?
Cette question n’est pas traitée par les textes. Rien ne nous semble interdire la vente de tels biens par le débiteur, dès lors que l’on admet que les biens ne sont pas soumis au dessaisissement. Mais la question se déplace alors : que devient le prix de leur vente pendant la durée de la liquidation judiciaire ? Il nous semble que le mécanisme de la subrogation réelle doit trouver application et qu’il y a lieu de considérer que si l’immeuble n’est pas un élément du gage commun des créanciers, en ce qu’il n’est pas un actif de la liquidation judiciaire, son prix de vente ne devient pas davantage un élément du gage commun. Il doit rester entre les mains du débiteur, sous réserve cependant que l’immeuble ne soit pas grevé de sûreté. En effet, si l’immeuble est hypothéqué, il est exclu de remettre le prix au débiteur sans se préoccuper des droits de l’hypothécaire.
Mais le créancier hypothécaire, peut-il, pour sa part, prétendre appréhender le prix de vente à concurrence de son hypothèque ? Il nous semble qu’un obstacle s’élève contre cette possibilité.
Il apparaît que les créanciers ne pourront, pendant la liquidation judiciaire, exercer leur droit de poursuites individuelles sur ces biens [3]. Cette position se recommande incontestablement d’un argument de texte. Le législateur a créé une nouvelle exception à l’interdiction du droit de reprendre ses poursuites individuelles après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, au profit des créanciers pour les biens échus sur succession pendant la liquidation judiciaire (C. com., art. L. 643-11, I, 1° N° Lexbase : L3698MBL). Or, d’évidence, pour être autorisé à reprendre ses poursuites individuelles, il faut d’abord que ce droit soit confisqué. De même, le rapport au Président de la République sur l’ordonnance du 12 mars 2014 reconnaît que ce texte ne fait pas exception à l’arrêt des poursuites individuelles ou à l’interdiction des paiements [4].
Par conséquent, pour respecter le texte qui prévoit que le créancier ne pourra exercer ses droits qu’à la clôture de la liquidation judiciaire, tout en ne préjudiciant pas au droit des créanciers, la seule solution nous semble être, pour le notaire, de reconsigner le prix de vente de l’immeuble, à concurrence de la créance garantie par l’hypothèque, jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Ces solutions issues de l’article L. 641-9, IV du Code de commerce ont peu trouvé application. Que deviennent-elles avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, qui a posé le statut de l’entrepreneur individuel ? Le I de l’article L. 641-9 du Code de commerce N° Lexbase : L3693MBE dispose désormais que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
La question des biens échus sur succession a été déplacée à l’article L. 642-22, I du Code de commerce N° Lexbase : L3695MBH. Le texte prévoit que « Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter ». Ainsi, alors que le texte initial était positionné au rang des règles du dessaisissement, il figure désormais au rang des dispositions intéressant les règles communes aux réalisations d’actifs du débiteur en liquidation judiciaire.
L’extraction de cette disposition de l’article relatif au dessaisissement est la bienvenue, car elle pouvait faussement laisser croire qu’il s’agissait d’une exception au dessaisissement, alors qu’il n’était question que d’une réduction des « pouvoirs » du liquidateur sur l’actif soumis à l’effet réel de la procédure, puisqu’il était par principe dans l’impossibilité de vendre les biens en question.
Mais, en réalité, le texte de l’article L. 642-22, I du Code de commerce aura fort peu vocation à s’appliquer. En effet, la loi du 14 février 2022 a modifié l’article L. 641-9, I du Code de commerce, en l’adaptant au statut de l’entrepreneur individuel. Désormais seuls les biens « composant le patrimoine professionnel » de l’entrepreneur sont concernés par le dessaisissement. Ainsi, le dessaisissement épouse-t-il les contours de la procédure collective elle-même, qui ne frappe que les biens professionnels. Par conséquent, la question des biens échus sur succession ne devrait plus se poser, au moins dans une procédure collective unipatrimoniale, qui ne porte que sur les biens professionnels. Cette dernière est obligatoire, en l’absence de surendettement des particuliers, au titre du patrimoine personnel. Il y a également place à une procédure collective unipatrimoniale même en cas de surendettement, dès lors que la procédure de surendettement peut être ouverte, ce qui présuppose que le débiteur ait, d’une part, respecté strictement la dissociation de ses patrimoines et, d’autre part, qu’il n’ait aucun créancier professionnel ayant le droit de se faire payer sur le patrimoine personnel. En revanche, en cas de procédure bipatrimoniale, portant à la fois sur le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel, la question des biens échus sur succession peut se poser dans la liquidation judiciaire du débiteur personne physique. C’est alors tout l’intérêt de l’article L. 642-22, I du Code de commerce.
[1] CA Agen, 24 février 2021, n° 20/00106 N° Lexbase : A16374IH
[2] F.-X. Lucas, Manuel de droit de la faillite, Droit fondamental, PUF, 2ème éd., 2018, n° 345 ; D. Sahel, Les biens qui échappent à la procédure collective, BDED, t. 27, LGDJ, 2022, n° 135, n° 276.
[3] D. Voinot, Les modifications intéressant la liquidation judiciaire issues de l’ordonnance du 12 mars 2014, Gaz. Pal., 6 avril 2014, n° 96, p. 23 et s., spéc. p. 30 ; H. Lecuyer, préc., spéc. p. 15. Adde implicitement : J. Vallansan, La situation de la personne physique en liquidation judiciaire s’améliore, Act. proc. coll., 2014/6, comm. 123 ; Ph. Roussel Galle, La réforme du droit des entreprises en difficulté par l’ordonnance du 12 mars 2014, Rev. sociétés, 2014, 360, n° 36.
[4] Rapport au président de la République sur l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, p. 12 N° Lexbase : Z19984ZY.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483621
[Brèves] Secret professionnel des avocats et lutte contre la planification fiscale agressive : carton rouge pour la Directive « DAC 6 »
Réf. : CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-694/20, Orde van Vlaamse Balies N° Lexbase : A02048Y9
Lecture: 4 min
N3628BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 04 Janvier 2023
► Épilogue heureux pour les avocats ! La CJUE a jugé, dans une décision très attendue que l’obligation imposée à l’avocat d’informer les autres intermédiaires impliqués, contenue dans la Directive « DAC 6 » n’est pas nécessaire et viole le droit au respect des communications avec son client.
|
Que prévoit la Directive « DAC 6 » ? La Directive européenne n° 2018/822, du Consei,l, du 25 mai 2018, relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, dite Directive « DAC 6 » N° Lexbase : L6279LKR vise à renforcer la coopération entre les administrations fiscales des pays de l’UE en matière des montages potentiellement agressifs de planification fiscale. La déclaration DAC 6 vise à déclarer des dispositifs transfrontières potentiellement agressifs sur le plan fiscal contenant certaines caractéristiques. La Directive a été transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2019-1068, du 21 octobre 2019, relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration N° Lexbase : L9809LS4, codifiée aux articles 1649 AD N° Lexbase : L9972LS7 à 1649 AH N° Lexbase : L9976LSB du CGI. On notera :
Consulter le tableau des marqueurs sur le site de l’administration fiscale [en ligne]. Lire en ce sens, G. Massé et A.-C. Piroth, DAC 6 : une application pratique plus complexe et incertaine, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 N° Lexbase : N3300BYU. |
Les faits. Un décret flamand transposant cette Directive prévoit ainsi que, lorsqu’un avocat impliqué dans une planification fiscale transfrontière est tenu par le secret professionnel, il doit informer les autres intermédiaires qu’il ne peut pas effectuer lui-même cette déclaration.
Deux organisations professionnelles d’avocats ont saisi la Cour constitutionnelle belge. Selon elles, il est impossible de respecter l’obligation d’informer les autres intermédiaires sans violer le secret professionnel auquel sont tenus les avocats. La Cour constitutionnelle belge a interrogé la Cour de justice à cet égard.
La Cour de justice rappelle tout d’abord que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protège la confidentialité de toute correspondance entre individus et accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Cette protection spécifique du secret professionnel des avocats se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. « Cette mission fondamentale comporte, d’une part, l’exigence, dont l’importance est reconnue dans tous les États membres, que tout justiciable doit avoir la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat, dont la profession même englobe, par essence, la tâche de donner, de façon indépendante, des avis juridiques à tous ceux qui en ont besoin et, d’autre part, celle, corrélative, de loyauté de l’avocat envers son client ».
Or, l’obligation que prévoit la Directive pour l’avocat intermédiaire soumis au secret professionnel de notifier sans retard aux autres intermédiaires les obligations de déclaration qui leur incombent implique que ces autres intermédiaires prennent connaissance de l’identité de l’avocat intermédiaire. Ils prennent également connaissance de son analyse selon laquelle le dispositif fiscal en cause doit faire l’objet d’une déclaration ainsi que du fait qu’il est consulté à son sujet. Cette obligation de notification entraîne une ingérence dans le droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients.
La Cour examine ensuite si ces ingérences sont susceptibles d’être justifiées. Elle rappelle que la modification apportée en 2018 à la Directive s’inscrit dans le cadre d’une coopération fiscale internationale ayant pour objectif de contribuer à la prévention du risque d’évasion et de fraude fiscales, qui constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union.
Toutefois que cette obligation de notification incombant à l’avocat soumis au secret professionnel n’est pas nécessaire pour réaliser cet objectif. En effet, tous les intermédiaires sont tenus de transmettre ces informations aux autorités fiscales compétentes.
La divulgation, par les tiers intermédiaires notifiés, de l’identité et de la consultation de l’avocat intermédiaire à l’administration fiscale n’apparaît pas non plus nécessaire à la poursuite des objectifs de la Directive.
L’obligation de déclaration incombant aux autres intermédiaires non soumis au secret professionnel et, à défaut de tels intermédiaires, celle incombant au contribuable concerné, garantissent, en principe, que l’administration fiscale soit informée. L’administration fiscale peut, après avoir reçu une telle information, demander des informations supplémentaires directement au contribuable concerné qui pourra alors s’adresser à son avocat pour qu’il l’assiste. L’administration fiscale pourra également effectuer un contrôle de la situation fiscale de ce contribuable.
La Cour juge dès lors que l’obligation de notification prévue par la Directive n’est pas nécessaire et viole donc le droit au respect des communications entre l’avocat et son client.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483628
[Questions à...] Peut-il exister un protectionnisme européen en matière de marchés publics ? Questions à Stéphane de La Rosa, Professeur à l’Université Paris-Est Créteil, Chaire Jean Monnet
Lecture: 17 min
N3696BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 15 Décembre 2022
Mots clés : marchés publics • protectionnisme • Union européenne • égalité de traitement des candidats • non-discrimination
À la suite de la récente visite d’État d’Emmanuel Macron aux États-Unis pour plaider une non-fermeture du marché américain aux entreprises européennes après le vote en août 2022 de l’« Inflation Reduction Act », loi dotée de 369 milliards de dollars de subventions pour les technologies « propres » américaines, et le resserrement annoncé du « Buy American Act » de 1933 qui prévoit que tous les produits achetés par l'administration fédérale soient fabriqués « de manière substantielle » aux États-Unis (avec un objectif à terme de 75 %), la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé une riposte européenne en la matière. Cependant, l’Union européenne rechigne à adopter une ligne protectionniste allant à l’encontre de ses fondamentaux historiques de facilitation de la circulation des marchandises et de concurrence libre et non faussée. Pour savoir si une telle politique pourrait néanmoins voir le joue en matière de marchés publics, Lexbase Public a interrogé Stéphane de La Rosa, Professeur à l’Université Paris-Est Créteil, Chaire Jean Monnet, Directeur du laboratoire MIL (Marchés, Institutions, Libertés)*.
Lexbase : Quelles règles régissent l'attribution des marchés publics au sein de l'UE ?
Stéphane de La Rosa : Le droit de l’Union est incontournable dans la détermination des règles qui régissent la passation des contrats de la commande publique, marchés publics ou concession. Depuis les années soixante-dix, plusieurs « paquets » de Directives (initialement Directive 71/305, puis Directives dans les années 90, en 2004 et surtout en 2014) ont substantiellement modifié le régime juridique applicable à la passation de ces contrats.
Pour aller à l’essentiel, l’apport du droit communautaire fut d’étendre le champ matériel des règles (les règles de passation des contrats ne s’appliquent pas uniquement aux personnes publiques – suivant l’approche initiale du droit français – mais plus largement aux « pouvoirs adjudicateurs » ou, pour les activités en réseau, aux « entités adjudicatrices », qui peuvent être dans certains cas des personnes de droit privé), d’unifier les seuils de passation (les mêmes seuils en Europe pour une publicité européenne des contrats) et d’harmoniser les procédures de passation. Cette construction juridique repose sur une logique d’ensemble : favoriser la possibilité pour les opérateurs de candidater à des marchés publics situés dans d’autres États et lever les restrictions à l’accès aux marchés publics nationaux.
L’application des Directives reposent sur une logique de seuil : au-delà d’un certain montant (actuellement 5 382 000 euros HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions, 140 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales, 431 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité), les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de publier un avis de marché à l’échelle européen, de même qu’ils sont tenus par la nécessité de suivre les procédures de passation définies par les Directives : appel d’offres ouvert, appel d’offres fermé, dialogue compétitif, partenariat d’innovation ou encore procédure concurrentielle.
Á la faveur de la transposition des Directives adoptées en 2014 (pour les marchés publics, la Directive (UE) n° 2014/24 du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics N° Lexbase : L8592IZA et Directive (UE) n° 2014/25 du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux N° Lexbase : L8593IZB et pour les concessions, la Directive 2014/23 du 26 février 2014, sur l’attribution des contrats de concession N° Lexbase : L8591IZ9), une vaste refonte des règles applicables fut engagée, en France, par voie d’ordonnances. Dans un premier temps, le Code des marchés publics a été abrogé au 1er avril 2016 et remplacé par des ordonnances qui transposaient les Directives (ordonnances n° 2015-899, du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics N° Lexbase : L9077KBS et n° 2016-65, du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession N° Lexbase : L3476KYE). Ces ordonnances ont permis de préparer un vaste chantier de codification, qui a débouché sur l’adoption du Code de la commande publique (CCP), en vigueur depuis le 1er avril 2019. Le CCP diffère assez largement de l’ancien Code des marchés publics. Son champ matériel est beaucoup plus large (il couvre les marchés publics et les concessions), son champ organique est plus important (il s’applique à l’ensemble des contrats de la commande publique, indépendamment de la personne qui passe le contrat), il couvre les contrats indifféremment de leur qualification de droit public ou de droit privé et il intègre toute une série de textes telles que la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance N° Lexbase : L5127A8E, les règles relatives aux délais et de paiement ou encore la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée N° Lexbase : L7908AGY. La très grande majorité des règles contenues dans ce Code sont calquées sur le droit de l’Union : cela implique qu’elles doivent être interprétées à la lumière des Directives de 2014 et de la jurisprudence de la Cour de justice.
Toutefois, l’influence du droit de l’Union ne se limite pas aux seules Directives. Elle est également essentielle à travers la reconnaissance et la mise en œuvre des principes fondamentaux de la commande publique. En effet, depuis l’arrêt de principe « Telaustria » [1], trois grands principes fondent le socle normatif de la commande publique à l’échelle européenne : l’égalité de traitement des candidats à un contrat de la commande publique, la non-discrimination à raison de la nationalité et la transparence. Ces principes sont incontournables, non seulement car ils correspondent à des exigences contenues dans le droit primaire de l’Union, mais également car ils doivent être respectés même pour la passation de contrats qui ont une valeur inférieure aux seuils des Directives. Aussi, même pour des marchés d’une taille moyenne ou modeste, le droit de l’Union trouvera à s’appliquer à travers ces principes, pour autant que le contrat présente un intérêt transfrontalier certain. On retrouve en droit interne l’énoncé de ces principes à l’article L. 3 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4460LRM, suivant lequel « les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidations à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures (…) ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
L’importance de ces principes doit être d’autant plus soulignée que ceux-ci donnent lieu à une jurisprudence dense et évolutive. Par exemple, l’exigence de transparence implique elle-même plusieurs conséquences pour les acheteurs : obligation d’assurer une publicité « adéquate » du marché (les conditions et les modalités de la procédure d’attribution doivent être formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché, ces mêmes conditions doivent être cohérentes au regard de l’objet et du montant du marché), obligation d’impartialité pour la personne publique qui conclut le marché, instauration de garanties contre l’arbitraire du pouvoir adjudicateur. De nouveaux enjeux sont progressivement couverts par les principes fondamentaux, par exemple le régime de modification des contrats en cours d’exécution (régime des avenants) ou encore les règles relatives à la sous-traitance.
Lexbase : Comment se positionnent les juges européens en la matière ?
Stéphane de La Rosa : La jurisprudence de la Cour de justice est très dense en matière de commande publique. Une cinquantaine d’affaires sont jugées chaque année et couvrent toute une diversité d’enjeux, y compris les plus contemporains, parmi lesquels le contenu des critères d’attribution d’un marché, l’insertion de clauses sociales et environnementales, l’encadrement de l’exécution des contrats en cas d’évènements imprévus, la sous-traitance, le groupement de candidats à un contrat public, l’insertion de motifs d’exclusion des soumissionnaires.
De manière générale, la matrice historique de la jurisprudence européenne consiste à privilégier la logique d’ouverture à la concurrence et d’accès au marché. Toutefois, cette approche évolue progressivement. De plus en plus, la Cour reconnaît des raisons impérieuses d’intérêt général, au regard desquelles un pouvoir adjudicateur peut prévoir des restrictions, par exemple pour limiter la sous-traitance, exiger le respect de normes sociales ou environnementales dans l’exécution du contrat, privilégier certains opérateurs pour des marchés sensibles (par exemple, les services sociaux), voire attribuer directement certains contrats pour des motifs de solidarité (par exemple pour certains marchés de transport de malades). Ces motifs ou ces raisons sont divers : sécurité dans l’exécution du marché, protection de l’environnement, protection des travailleurs, promotion des PME. L’admission de ces motifs demeure toutefois tributaire du respect du principe de proportionnalité.
Toutefois, les juges européens demeurent sensibles au respect des principes fondamentaux de la commande publique, lesquels font formellement obstacle à des clauses qui introduisent ouvertement dans les marchés publics des discriminations à raison de l’origine des produits ou du prestataire de services.
Il y a là une ligne d’équilibre qui n’est pas évidente à tenir et qui devra sans doute être clarifiée dans les années à venir, compte tenu des évolutions contemporaines de la commande publique. La prise en compte, croissante, de l’économie circulaire (recourir à des fournisseurs proches du lieu d’exécution du marché) et de la préférence européenne (privilégier des fournisseurs européens, quitte à prendre ses aises avec le principe de non-discrimination qui s’applique à l’ensemble à l’ensemble des opérateurs) nécessitera sans doute d’interpréter plus souplement les principes de transparence et de non-discrimination, voire de les écarter dans certains cas. Les mutations contemporaines de la commande publique pourraient conduire à une inflexion significative des dogmes et des principes sur lesquels s’est historiquement construit le marché intérieur.
Lexbase : Le « Joint Procurement Agreement Act » pendant la crise du covid-19 a-t-il constitué un tournant ?
Stéphane de La Rosa : Avant la crise sanitaire, le droit de l’Union prévoyait déjà des dispositifs de « marchés conjoints », à savoir la possibilité, pour des pouvoirs adjudicateurs (États, collectivités, personnes morales de droit public ou de droit privé en charge d’une activité d’intérêt général), situés dans différents États, de conclure conjointement des marchés publics.
Au plan des principes, les marchés publics conjoints (prévus à l’article 39 de la Directive (UE) n° 2014/24) présentent plusieurs avantages : ils favorisent une culture commune de l’achat public, ils permettent de réduire les coûts pour certaines fournitures ou services rares ou onéreux, ils sont adaptés à des territoires spécifiques, comme les zones frontalières.
Pour les produits médicaux, il existe depuis 2013 une forme spécifique de marchés conjoints, qualifiée de « marchés de contre mesure médicale ». Ces marchés assez spécifiques reposent sur un instrument qui fut mis en place à la suite de la grippe H1N1. En effet, l’article 5 de la décision n° 1082/2013/UE du 22 octobre 2013, relative aux menaces transfrontières graves sur la santé N° Lexbase : L8475I3B, permet le recours à des passations conjointes en vue de l'achat anticipé de contre-mesures médicales relatives à des menaces transfrontières graves sur la santé. Suivant ce dispositif, la Commission agit comme le ferait une centrale d’achat : après avoir identifié le besoin en matériel médical de plusieurs États membres (essentiellement des respirateurs artificiels), elle identifie le ou les fournisseurs susceptibles de fournir ledit matériel selon les critères préalablement indiqués, puis se charge de jouer le rôle d’intermédiaire entre ces mêmes fournisseurs et les États. Ceux-ci restent libres d’acquérir, ou non, les fournitures et contactent directement avec les entreprises sélectionnées. Le rôle de la Commission se rapproche ainsi de celui d’un intermédiaire. En privilégiant une massification des achats, elle-même rendue possible par la mutualisation des demandes des États, la Commission est en mesure de négocier un prix et des prestations pour l’ensemble des États qui sont partis à un accord.
Toutefois, l’enclenchement de ce dispositif assez spécifique d’achat nécessite que les Etats soient partis à un accord ad hoc, qualifié de « Joint Procurement Agreement to Procure Medical Countermeasures ». Cet accord a un champ assez large et dépasse le périmètre de l’Union européenne, dans la mesure où il couvre 37 États, incluant par exemple ceux des Balkans et ceux de l’espace économique européen.
La complexité de ce dispositif, mais également son inadéquation à des situations d’urgence telle que la crise sanitaire, ont conduit à n’y recourir que de manière marginale pour la fourniture d’équipements médicaux. Quelques marchés ont été passés par la Commission, notamment pour la fourniture de respirateurs et d’appareil d’assistance respiratoire.
Pour ce qui est spécifiquement des marchés de vaccins, la procédure suivie fut très spécifique. Elle s’est appuyée sur le régime de l'aide d'urgence issu du Règlement (UE) n° 2016/369 du 15 mars 2016, relatif à la fourniture d'une aide d'urgence au sein de l'Union N° Lexbase : L0374K7Y, lui-même sensiblement modifié au début de la crise sanitaire par le Règlement (UE) n° 2020/521 du 14 avril 2020, portant activation de l’aide d’urgence N° Lexbase : L6819LWH. Les marchés permettant la fourniture de vaccins sont conçus comme la mise en œuvre d’une mesure d’urgence prise par la Commission, financée sur le budget général de l’Union ou sur des contributions supplémentaires des États. Ces marchés furent assez largement dérogatoires, avec des avis d’information minimums et l’absence formelle de mise en concurrence. Leur régime est assez complexe, combinant l’application du droit de l’Union et, une application du droit belge (État de conclusion des contrats), pour l’interprétation des obligations et l’identification des juridictions compétentes en cas de désaccord. Le flou des obligations pesant les fournisseurs de vaccins, formulées en termes de « Best Reasonable Efforts », a nourri un contentieux devant les juridictions belges, dont l’issue fut dans l’ensemble favorable à la Commission. En ne sécurisant pas suffisamment les conditions d’exécution de ces contrats majeurs et en ne définissant pas avec une clarté suffisante certaines de leurs clauses, la Commission a créé, malgré elle, un contexte de défiance des États et des populations vis-à-vis des fournisseurs de vaccins, lequel, par un effet d’entraînement, se répercute sur les engagements pris par les États au titre de ces contrats.
Les institutions ont toutefois tiré les enseignements de ces difficultés. Une nouvelle direction a été créé au sein de la Commission européenne : l'HERA (service de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire). Celle-ci centralise désormais plus efficacement les contrats de fourniture conjointe, avec par exemple la signature en octobre 2022 d'un contrat cadre pour l'acquisition conjointe d'Adjupanrix, un vaccin contre la grippe pandémique. À terme, avec les propositions d’une Union de la santé portées par la Commission européenne [2], le régime d’ensemble des marchés conjoints sera simplifié, mieux centralisé et plus favorable à la constitution de stocks communs aux États.
Lexbase : Un « Buy European Act » aurait-il des chances de voir le jour ? Quels pourraient être ses effets concrets ?
Stéphane de La Rosa : L’expression de « Buy European Act » ne recouvre rien de très précis. Depuis plusieurs années, nombre de responsables, de bords politique différents, mettent en avant la nécessité d’une législation européenne qui donnerait une préférence pour l’attribution de marchés à des produits ou fabricants européens.
L’emploi de cette expression un peu attrape-tout doit être mise en perspective avec le « Buy American Act » (BAA) aux États-Unis, législation fédérale adoptée en 1933, qui s'applique aux marchés publics d'une valeur de plus de 3000 dollars conclus par l'État fédéral. Formellement, le BAA établit une préférence pour l'achat de produits nationaux, entendus comme des produits dont la fabrication ou pour lesquels la part de produits « américains » dépasse de 50 % la valeur totale du produit. Cette préférence varie elle-même selon la valeur des marchés (elle joue essentiellement pour des marchés qui sont inférieurs aux seuils de l’OMC, qui sont repris dans les seuils européens). Elle se fonde juridiquement sur un dispositif dit de « waiver » : pour ne pas porter atteinte au principe de non-discrimination inscrit dans les accords commerciaux et en droit de l’OMC, les acheteurs sont invités à écarter l’attribution préférentielle et traiter sur un pied d’égalité les entreprises américaines et celles issues d’États tiers. En pratique, toutefois, ce dispositif ne fonctionne pas toujours et l’attribution préférentielle est privilégiée.
Dans le cas de l’Union européenne, il n’existe aucunement de législation similaire. Des instruments récents, comme par exemple, le dispositif dit « IPI » (International Procurement Instrument, prévu par le Règlement (UE) n° 2022/1031 du 23 juin 2022, concernant l'accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l'Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l'accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l'Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers N° Lexbase : L3024MDD) a pu être présenté comme un « Buy European Act ».
La réalité est toutefois beaucoup plus nuancée : il s’agit d’un instrument qui permet à la Commission de prendre des contremesures lorsqu’il apparaît qu’un État tiers maintient ou développe des pratiques restrictives, excluant ou limitant très fortement l’accès des entreprises européennes aux marchés publics domestiques. L’efficacité de cet instrument demeure incertaine. Il ne s’appliquera qu’a des États tiers pour lesquels il n’existe pas d’accords commerciaux ou qui ne sont pas membres de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC (ce qui limite sa portée à des États tels que la Chine, l’Inde, la Russie, mais exclut les États-Unis ou le Canada). Par ailleurs, les mesures prises par la Commission en réaction à la fermeture des marchés seront graduées : réajustement du prix de l’offre par le soumissionnaire, voire une exclusion de l’offre.
Aussi, un authentique « Buy European Act » nécessiterait, pour être mené à bien, des ruptures, des « sauts » conceptuels par rapport aux fondamentaux du droit économique européen. La reconnaissance d’un véritable régime de préférence (qui existe marginalement pour certains marchés publics, par exemple pour les entités adjudicatrices à l’article L. 2153-2 du Code de la commande publique N° Lexbase : L7087LQK) implique une prise de distance avec les principes de non-discrimination et d’égalité, tels qu’ils figurent dans l’Accord sur les marchés publics de l’OMC, qui lie l’Union européenne et qui sert de socle aux directives.
Sans être remis en cause, la portée de ces principes devrait être pondérée, de manière rigoureuse, avec des impératifs tenant à la protection de certaines activités sensibles ou stratégiques (les règles applicables au filtrage des investissements, telles qu'elles ressortent notamment du Règlement (UE) n° 2019/452 du 19 mars 2019, établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union N° Lexbase : L6646LPT, peuvent être ici utiles en ce qu'elles identifient des activités stratégiques), à la préservation de l’environnement et à la nécessité concomitante d’une commande publique locale, ou encore tenant à la préservation de la compétitivité des entreprises européennes. Cette mise en perspective justifierait de mettre le droit de l’Union au service d’une politique industrielle et d’une politique de transition écologique. Cette voie est toutefois exigeante : elle conduit à réinterpréter les piliers conceptuels du droit du marché intérieur et du droit de la concurrence.
* Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.
[1] CJCE, 7 décembre 2000, aff. C-324/98, Telaustria N° Lexbase : A1916AWU.
[2] COM (2020) du 11 novembre 2020, 727 final, Proposition de Règlement concernant les menaces transfrontières graves pour la sante et abrogeant la décision n° 1082/2013.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483696
[Pratique professionnelle] Pour la mise en place d’une politique de rémunérations efficiente et engagée
Lecture: 17 min
N3664BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anna Ferreira, Avocate associée, Responsable nationale du Pôle protection sociale, retraite et prévoyance et Olivia Rault-Dubois, Avocate associée, Responsable nationale du Pôle épargne salariale et actionnariat salarié, cabinet Fidal
Le 11 Janvier 2023
Mots-clés : RSE • épargne salariale • protection sociale • actionnariat salarié • intéressement • motivation des salariés • fidélisation • retraite supplémentaire
À l’heure où l’entreprise est confrontée à de nouveaux enjeux économiques (hausse des coûts de production, inflation…) et RH (fidélisation, motivation de ses salariés…), agir sur la politique de rémunérations et des avantages sociaux peut être, pour elle, un excellent levier d’action s’inscrivant dans sa démarche de responsabilité sociale et environnementale.
Pourquoi une rémunération efficiente et engagée ?
Efficiente, car optimisée d’un point de vue fiscal et social aussi bien pour le salarié que pour l’entreprise. En conséquence, ne sont pas abordés les rémunérations de base, variables ou encore les primes/bonus, tous soumis à cotisations de Sécurité sociale et assujettis à l’impôt sur le revenu.
Engagée, car il s’agit de donner une autre dimension à la rémunération (entendue au sens large) et de l’inscrire dans la stratégie RSE de l’entreprise.
Pour rappel, la RSE (responsabilité sociétale/sociale et environnementale) est définie par la Commission européenne comme « l'intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ».
Or, aux côtés des fournisseurs, sous-traitants, clients, une des parties prenante clé de l’entreprise est constituée par la collectivité des salariés. La norme ISO 26000, standard international, définit le périmètre de la RSE autour de sept thématiques centrales parmi lesquelles notamment : les relations et conditions de travail. Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur pour renforcer la RSE et l'article 1833 du Code civil N° Lexbase : L8681LQL a été modifié afin que l'objet social de toutes les sociétés intègre la considération des enjeux sociaux et environnementaux.
Appréhender la politique de rémunérations par le prisme de la responsabilité sociale conduit l’entreprise à se préoccuper, dans une optique de court terme, de la préservation du pouvoir d’achat de ses salariés. Pour cela, elle dispose d’un outil très efficace à savoir la prime de partage de la valeur (PPV). En effet, jusqu’au 31 décembre 2023, l’employeur peut verser aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, une prime de partage de la valeur dans la limite de 3 000 euros (voire 6 000 euros) par bénéficiaire et par année civile intégralement exonérée de cotisations sociales (part salariale et patronale) de CSG/CRDS, de forfait social et d’impôt sur le revenu (IR). L’efficacité de la PPV, dans ce cas de figure, est de 100 % après IR.
Si l’entreprise se place dans une démarche plus pérenne, à moyen-long terme, elle peut intégrer dans sa stratégie RSE des dispositifs permettant d’associer les salariés au partage des résultats voire au capital et les aider à se constituer une épargne notamment pour leur permettre d’obtenir un complément de revenus lors de leur départ à la retraite.
Outre l’aspect de politique sociale, adopter une telle démarche a des effets bénéfiques sur les performances économiques. C’est donc un enjeu stratégique très important pour l’entreprise à une époque où la préservation de son capital humain est essentielle.
En effet, d’un point de vue RH, l’entreprise évolue dans un contexte nouveau accentué par différents facteurs. Le taux de chômage étant historiquement bas (7%), l’entreprise doit faire face à un renversement du marché du travail et à des pénuries dans certains secteurs d’activité. Il est donc impératif d’attirer les talents, fidéliser sa main d’œuvre et pour cela, se démarquer de ses concurrents.
Comment se différencier par rapport aux autres entreprises de son secteur ? Adopter une politique de rémunération efficiente et engagée peut constituer un élément de réponse. L’entreprise doit également tenir compte du changement de perception du travail par les salariés qui sont, de plus en plus, en quête de sens au travail. Il pourrait être considéré qu’il ne s’agit que d’une mode qui ne nécessite donc pas d’y prêter attention mais cela serait une lourde erreur. Il est clair que depuis la crise du covid-19, les confinements successifs accompagnés dans certaines professions d’un télétravail massif, le monde du travail a changé et les salariés aussi. Balayer d’un revers de main ces évolutions, ne pas en tenir compte, est susceptible d’être très coûteux pour l’entreprise en termes de motivation et d’engagement des salariés. Après le burn-out (l’épuisement professionnel dû à une situation de travail trop intense) et le bore-out (l’épuisement professionnel provoqué par l’ennui et une sous-charge de travail), apparaît le brown-out qui se caractérise par un épuisement professionnel dû à la perte de sens se manifestant notamment par une baisse d’énergie et d’engagement du salarié. Ces trois syndromes génèrent les mêmes effets négatifs sur les salariés : stress, démotivation, anxiété, perte de l’estime de soi voire dépression.
Certaines entreprises peuvent également être confrontées à des salariés adeptes du quiet quitting ou démission silencieuse qui est une forme de réaction à la gestion de l’entreprise à l’aune de la productivité et de la performance avec les fameux Key Performance Indicators (KPIs). Dès lors, ces salariés ne sont pas, à proprement dit démissionnaires, mais ralentissent leur activité afin de préserver leur vie personnelle.
Même si ces phénomènes ne sont heureusement pas généralisés, les entreprises doivent les détecter, les traiter et les prévenir car le désengagement des salariés leur est extrêmement préjudiciable : manque de créativité, d’implication, de motivation, hausse de l’absentéisme, risques psycho-sociaux et in fine baisse des performances économiques. Dès lors, l’entreprise doit s’évertuer à donner du sens au travail, recréer ou consolider la dynamique collective afin de pérenniser son capital humain. Plusieurs leviers d’actions sont envisageables parmi lesquels les dispositifs d’épargne salariale, d’épargne-retraite mais aussi et surtout l’actionnariat salarié collectif. En effet, une entreprise qui associe ses salariés au partage des résultats et des performances, se préoccupe d’aider les salariés à préparer leur retraite et leur offre la possibilité de devenir actionnaire est une entreprise qui fédère, motive, attire et fidélise ses salariés.
I. Les dispositifs d’épargne salariale
Deux dispositifs d’épargne salariale sont susceptibles de générer des droits pour les salariés, la participation et l’intéressement.
La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution - au profit des salariés - d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise. Obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, elle est facultative pour les autres. Depuis le 1er janvier 2020, l’effectif et le franchissement de ce seuil sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du Code de la Sécurité sociale. Ainsi, une entreprise sera assujettie à la participation à compter du premier exercice ouvert postérieurement à une période de cinq années civiles après le franchissement du seuil de 50 salariés (sous réserve qu’elle ne franchisse pas ce seuil à la baisse dans cet intervalle).
Le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) est calculé selon la formule légale suivante :
RSP = ½ [B – 5% C] x [S/VA]
B : le bénéfice net de l'entreprise
C : les capitaux propres de l'entreprise
S : les salaires de l'entreprise
VA : la valeur ajoutée de l'entreprise.
L’entreprise peut opter pour un mode de calcul différent de la formule légale à condition que le résultat de ce mode de calcul dit dérogatoire soit au moins égal à celui résultant de l'application de la formule légale (principe de l’équivalence des avantages) et que ce résultat ne soit pris en compte que dans la limite d’un certain plafond.
Compte tenu de la formule de calcul exclusivement fondée sur des données financières, l’entreprise n’a aucune marge de manœuvre pour déployer, via la participation sa démarche RSE, ce qui n’est pas le cas en matière d’intéressement.
L’intéressement est un dispositif facultatif visant à associer les salariés aux résultats et/ou aux performances de l’entreprise. Par la détermination de critères de performances en lien avec l’activité et les objectifs de l’entreprise, il peut constituer un véritable outil de management en orientant les comportements des salariés vers des bonnes pratiques (critère de sécurité dans les entreprises du BTP, critère de qualité, de baisse des rebuts dans les entreprises de production, de satisfaction dans les entreprises de services…).
De plus, il est possible d’adapter la formule de calcul à un périmètre inférieur à celui de l’entreprise : l’établissement mais aussi les unités de travail. Le Code du travail fait référence, à plusieurs reprises, à l’unité de travail mais sans la définir expressément. L'unité de travail est caractérisée par des salariés qui travaillent habituellement ensemble, qui accomplissent des tâches proches ou identiques, avec des conditions de travail analogues et qui sont placés sous la responsabilité d'un même encadrement. Le département commercial d'une entreprise constitue, par exemple, une unité de travail. Or, en adaptant la formule d’intéressement au niveau des unités de travail, les salariés sont plus à même de mesurer l’impact de leur activité au quotidien sur le montant des droits à intéressement qu’ils perçoivent, ce qui évidemment favorise une meilleure implication de ces derniers. C’est l’une des grandes différences avec la participation.
Pour parachever l’intéressement comme outil de pilotage de la politique RSE de l’entreprise, la loi « Pacte » encourage l’intégration de critères de performances liés à la responsabilité sociale de l’entreprise et renvoie à cet égard aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance), contenus dans la déclaration de performance extra-financière (santé et sécurité des salariés, sobriété énergétique, baisse de consommation des consommables, recyclage…). Ainsi, l’intéressement peut être un élément essentiel de la politique RSE en permettant aux salariés d’être impliqués financièrement dans la mise en œuvre de celle-ci.
L’entreprise et les salariés sont alors tous les deux gagnants dans la mesure où l’intéressement, comme la participation, bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur. En effet, la participation comme l’intéressement sont exonérés de cotisations sociales (part salariale et patronale), mais soumis à CSG-CRDS (9,7 % sur une assiette de 100 %) et le cas échéant, au forfait social. S’agissant du forfait social (au taux de 20 ou 16 %) selon les cas, ce dernier a été supprimé, depuis le 1er janvier 2019, sur l'intéressement, dans les entreprises de moins de 250 salariés et sur la participation, dans les entreprises de moins de 50 salariés. Ils sont également déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
En outre, ces dispositifs incitent les salariés à se constituer une épargne à moyen terme via une affectation des droits au plan d’épargne d’entreprise ou à horizon retraite en cas de placement dans le PERCOL, ce qui leur permet, en outre, de bénéficier d’une exonération sur l’impôt sur le revenu.
II. Les dispositifs d’épargne retraite
Dans le contexte de réformes successives des régimes de retraite légaux aboutissant au constat d’une baisse relative des niveaux de pensions, la question du recours à une épargne retraite complémentaire se pose avec une acuité croissante. L’employeur, dans une démarche de responsabilité sociale vis-à-vis de ses salariés, a un rôle majeur à jouer. À ce titre, l’OCDE vient de publier un rapport sur les pensions de retraite [1], dans lequel elle incite les employeurs à s'investir toujours davantage dans le développement des régimes de retraite par capitalisation au bénéfice de leurs salariés. L’OCDE relève d'ailleurs qu'il s'agit d’un facteur d'attractivité et de satisfaction des collaborateurs et des futurs collaborateurs.
Dans cette perspective, l'employeur dispose désormais du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise (PERE) institué par la loi « Pacte ». S'il s'agit d'un dispositif unique de retraite, il regroupe en réalité deux outils distincts déjà connus des entreprises : le Perco et le régime à cotisations définies (dit « article 83 »). Ainsi, le Perco est devenu le PER Collectif (PERCOL) et « l’article 83 » le PER Obligatoire (PERO), l’entreprise ayant la faculté de regrouper les deux.
De manière schématique le PER, qu’il soit d’entreprise ou individuel, comporte toujours trois compartiments dans lesquels sont logées les sommes selon leur origine :
- le « compartiment retraite individuelle » est destiné à accueillir les différents types de versements volontaires du salarié ;
- le « compartiment épargne salariale » accueille l'intéressement, la participation, les abondements de l'employeur, les droits inscrits au compte épargne-temps et les jours de repos non pris ;
- le compartiment « retraite collective obligatoire », accueille les cotisations obligatoires employeur et salarié versées au titre d'un contrat collectif à adhésion obligatoire.
Cette compartimentation identique de tous les PER du marché permet une transférabilité effective entre différents plans. Elle permet également de déterminer le régime social et fiscal applicable aux sommes épargnées, lors de leur versement, ainsi qu’au moment de leur sortie du plan. À l’exception des sommes épargnées dans le compartiment « retraite collective obligatoire » qui ne peuvent être liquidées que sous forme de rente, les sommes épargnées dans le PER peuvent être liquidées à la retraite soit sous forme de capital, soit sous forme de rente viagère.
Le PERCOL est par essence collectif puisqu’il a vocation à bénéficier à tous les salariés, sans exception [2]. Le Code monétaire et financier prévoit une obligation de négocier sur la mise en place d’un PERCOL, lorsque l’entreprise dispose d’un PEE depuis plus de trois ans (C. mon. fin., art. L. 224-9 N° Lexbase : L4922LRQ).
La mise en place d’un PERCOL dans l’entreprise n’est pas nécessairement synonyme d’épargne régulière en vue de la retraite puisqu’il n’existe pas d’obligation pour l’entreprise d’alimenter les comptes individuels des salariés. Le PERCOL a pour objectif premier d'accueillir l'épargne volontaire de ces derniers, qui peut alors être complétée par les abondements de l'employeur. Ainsi, celui-ci peut abonder la somme versée par le salarié jusqu'au triple de celle-ci, dans la limite annuelle de 16 % du PASS (soit 7 039 euros en 2023).
Le législateur incite, cependant, les entreprises à enclencher, pour les collaborateurs, une véritable épargne sur le PERCOL, en dehors de tout versement volontaire de ces derniers. Ainsi l'employeur peut d’une part, réaliser un versement initial pour un montant maximum correspondant à 1 % du PASS, et d’autre part, effectuer des versements périodiques, sous réserve d'une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. Le total des sommes ainsi versées par l’employeur ne peut excéder 2 % du PASS (soit environ 880 euros en 2023). Ces versements de l'employeur, en l'absence de contribution du salarié, peuvent permettre de déclencher une véritable prise de conscience des enjeux qui entourent la préparation de la retraite et ainsi encourager les salariés à effectuer des versements réguliers sur le PERCOL. En effet, pour se constituer un véritable complément de pension de retraite, l’épargne doit être réalisée de manière régulière et sur une période longue. À défaut, la déception au moment de la liquidation de la retraite est certaine.
Le frein qui est souvent mis en avant, s’agissant du PERCOL, concerne l'indisponibilité des sommes épargnées jusqu'à la retraite. En effet, les cas de déblocage sont limités et recouvrent en majorité des situations difficiles (invalidité, décès, surendettement, expiration des droits à l'assurance chômage), mais il est également possible de débloquer les sommes épargnées sur le PERCOL pour acquérir sa résidence principale.
À côté du PERCOL, le PERO est l’outil qui permet véritablement à l’entreprise de s’engager de manière effective pour aider le salarié à se constituer une épargne retraite régulière sur le long terme. En effet, l’employeur s’engage à verser une cotisation prédéterminée pour chaque salarié bénéficiaire. Cette cotisation est déterminée en pourcentage de la rémunération[3]. Une cotisation salariale peut également être prévue par le PERO, ce qui est souvent le cas.
Le champ des bénéficiaires peut être constitué de l'ensemble des salariés ou bien d'une catégorie d'entre eux. La définition de la catégorie des bénéficiaires doit répondre aux exigences posées par les articles R. 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4189L7B [4], pour que le financement patronal au PERO puisse bénéficier du régime social de faveur.
L’alimentation régulière du PERO par l’employeur et le salarié, permet à ce dernier de se constituer une épargne significative qui sera convertie en rente viagère au moment de la liquidation de la retraite, les sommes épargnées dans le compartiment « retraite collective obligatoire » ne pouvant pas se dénouer en capital.
Au travers de ce dispositif, l’employeur aura accompagné son salarié tout au long de sa carrière dans l’entreprise dans la préparation financière de la cessation d’activité professionnelle. Si cet avantage social peut paraitre très lointain pour les plus jeunes, il est perçu très favorablement après quelques années passées dans la vie active.
Pour favoriser ces dispositifs et inciter les entreprises à entrer dans cette démarche vertueuse, les pouvoirs publics ont mis en place des avantages sociaux et fiscaux tant pour le salarié que pour l’entreprise.
Pour l’employeur, les abondements au PERCOL et les cotisations obligatoires du PERO sont :
- exonérés de cotisations sociales patronales, dans la limite d’un plafond ;
- soumis au forfait social au taux de 16 %, dès lors que le plan prévoit une gestion pilotée des sommes investies et que l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres destinés à financer les PME et ETI ;
- déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Pour le salarié, les versements de l’employeur :
- sont exonérés de cotisations sociales salariales, dans la limite d’un plafond,
- n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu
- restent soumis à la CSG-CRDS (9,7 % sur une assiette de 100%).
En comparaison avec le versement d’un salaire totalement soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, le coût pour l’entreprise est significativement moins élevé et le taux d’efficacité [5] pour le salarié est (selon le niveau d’imposition) nettement supérieur (du simple au double).
La politique de l’entreprise en matière de retraite supplémentaire peut constituer un atout aux yeux des futurs embauchés. Elle doit être valorisée auprès des collaborateurs de manière régulière, afin de mettre en lumière l’investissement fait par l’employeur, sur une période souvent longue. La retraite supplémentaire s’inscrit donc bien dans une démarche engagée et efficiente de l’entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs.
III. L’actionnariat salarié
Deux types d’actionnariat salarié doivent être distingués :
- l’actionnariat sélectif, réservé principalement au top management et qui prend la forme d’attributions gratuites d’actions, de stock-options, de BSPCE … ;
- l’actionnariat salarié collectif (ou démocratique) qui vise la collectivité des salariés.
Ces deux formes d’actionnariat salarié ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent donc tout à fait être cumulées.
Dans le cadre de sa politique RSE, l’entreprise peut ouvrir son capital au plus grand nombre, à savoir la collectivité des salariés. Pour cela, elle dispose d’un outil très efficace le plan d’épargne d’entreprise.
En réalisant une augmentation de capital (ou une cession de titres auto-détenus) via le PEE, les salariés (adhérents du PEE) bénéficient d’un levier financier très incitatif. L’actionnariat dans le PEE peut être direct mais il est opportun de mettre en place un fonds commun de placement dédié en titres de l’entreprise (FCPE dédié) pour faciliter la gouvernance dans l’entreprise. En effet, dans ce cas, les salariés ne sont pas directement actionnaires mais porteurs de parts du FCPE dédié et c’est le conseil de surveillance de ce dernier qui agit pour leur compte.
Associer les salariés au capital de l’entreprise s’inscrit bien évidemment dans la politique RSE de l’entreprise. Il permet de développer le sentiment d’appartenance des salariés à l’entreprise ou au groupe (y compris à l’international), fidéliser les salariés, attirer les talents en améliorant la marque employeur, augmenter les performances économiques du fait notamment de la plus grande implication des salariés.
C’est d’ailleurs pour l’ensemble de ces raisons que les pouvoirs publics encouragent, par des dispositions encore plus incitatives, le développement de l’actionnariat salarié.
Quelles sont-elles ?
La première mesure incitative est la possibilité pour l’entreprise de consentir une décote sur le prix de souscription de l’action. Lorsqu’elle procède à une augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE, l’entreprise va devoir établir le prix de l’action. Le Code du travail distingue deux cas de figure :
- si la société est admise aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession des titres est fixé d’après les cours de Bourse ;
- en revanche, si la société n’est pas cotée, le prix de cession est notamment déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise.
L’entreprise a la possibilité, dans le cadre de l’augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE, de fixer un prix de souscription du titre inférieur de 30 % au prix de cession (porté à 40 % si l’indisponibilité dans le PEE est d’au moins 10 ans. Ces plafonds ont été revus à la hausse par la loi Pacte). Si par exemple, le prix de cession du titre est fixé à 100 euros avec une décote de 30 %, le prix de souscription sera alors de 70 euros. Des actions gratuites[6] peuvent aussi être accordées en substitution totale ou partielle de la décote. Ainsi, le salarié se verra attribuer trois actions gratuites pour sept actions souscrites à 100 euros. Outre la faculté de prévoir une décote, l’entreprise peut abonder, de manière majorée, les sommes versées par le salarié pour l’acquisition des titres de l’entreprise.
En effet, l’abondement maximal dans le PEE est fixé à 8 % du PASS sans pouvoir excéder le triple de la contribution du salarié mais quand le salarié acquiert des titres de l’entreprise, l’abondement maximal est alors majoré de 80 %, ce qui le porte à 14,4 % du PASS (soit 6 334 euros en 2023). L’abondement peut, comme la décote, être remplacé, en tout ou partie, par des actions gratuites. En outre, l’abondement unilatéral (dans la limite de 2 % du PASS, étant précisé qu’il s’impute sur l’abondement majoré) peut également être utilisé pour permettre aux salariés de devenir actionnaire sans mise de fonds initiale.
Cette question de la capacité d’investissement des salariés est évidemment une préoccupation de l’entreprise. C’est pour cette raison que le calendrier de l’augmentation de capital réservée est calé sur les périodes de versement de l’intéressement et de la participation afin que les salariés n’aient pas de cash à sortir pour souscrire à l’augmentation de capital mais utilisent leurs droits à participation et intéressement ce qui les fait, en outre, bénéficier de l’exonération fiscale attachée à l’affectation de leurs droits dans le PEE.
Consentir une décote et un abondement est très avantageux aussi bien pour l’entreprise que le salarié. En effet, l’avantage correspondant à la décote est exonéré de cotisations sociales (part salariale et patronale), de CSG-CRDS, de forfait social et d’impôt sur le revenu. L’abondement de l’employeur est, quant à lui, exonéré de cotisations sociales (salariales et patronales) mais soumis à CSG-CRDS (9,7 % sur une assiette de 100 %), au forfait social au taux de 10 % dans la mesure où il s’agit d’une opération en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise [7]. Il est également assujetti à l’impôt sur le revenu et déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
L’abondement comme la décote constituent des avantages financiers importants pour les salariés, ils sont donc très incitatifs. Ils permettent, en outre, de couvrir en partie le risque de perte du salarié en cas de baisse ultérieure de la valeur du titre. Ils s’inscrivent donc pleinement dans la politique de responsabilité sociale de l’entreprise.
L’entreprise dispose donc d’une palette d’outils lui permettant d’inscrire sa politique de rémunérations au sens large, dans la dimension sociale de sa démarche RSE. Selon ses besoins et objectifs : attirer, fidéliser, distribuer de la rémunération cash ou plutôt différée (épargne retraite), ou encore associer les salariés au capital, l’entreprise pourra efficacement combiner les dispositifs, sans oublier de les valoriser auprès de l’ensemble de ses parties prenantes.
[2] Une condition d’ancienneté de maximum trois mois peut être prévue.
[3] Exemple : 2 % de la tranche 1 de la rémunération et 2,5 % de la tranche 2 de la rémunération
[4] Respect du caractère collectif et obligatoire notamment.
[5] Efficacité = montant net après IR pour le salarié/coût total pour l’entreprise.
[6] Ces actions gratuites ne relèvent pas du régime juridique découlant des articles L. 225-197-1 et s. du Code de commerce N° Lexbase : L2188LYP, mais d’un régime autonome
[7] À noter que le forfait social applicable à l’abondement versé dans le cadre d’opération d’actionnariat salarié avait été supprimé de manière temporaire pour les années 2021 et 2022 par la LF pour 2021. Cette mesure devrait être reconduite pour 2023 par la LF pour 2023.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483664
[Brèves] Inaptitude : l’avis non contesté du médecin du travail s’impose à l’employeur, au salarié et au juge
Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-23.662, FS-B N° Lexbase : A85248XY
Lecture: 4 min
N3599BZC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lisa Poinsot
Le 14 Décembre 2022
► L'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties.
Faits et procédure. À l’issue d’un arrêt de travail, un salarié est déclaré « inapte total » à son poste de travail par avis du médecin du travail dans lequel est précisé que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Ce salarié saisit la juridiction prud’homale pour contesté son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d’appel (CA Angers, 15 juillet 2021, n° 19/00152 N° Lexbase : A26134ZS) constate que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, le 11 avril 2017, mentionne les voies et les délais de recours. Elle relève que cet avis n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de quinze jours.
Les juges du fond en déduisent que la régularité de l’avis, qu’elle concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de son poste, ne peut plus être contestée. Cet avis s’impose alors aux parties comme au juge.
Par conséquent, ils déclare l’absence de nullité du licenciement du salarié, ce licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse. Ils déboutent le salarié de ses demandes relatives au licenciement.
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation en soutenant, notamment, que son inaptitude n'a pas été régulièrement constatée. Il argue que l'avis du médecin du travail ne prend pas en considération l'étude du poste de travail.
|
Pour rappel. L’employeur et le salarié peuvent chacun contester l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, reposant sur des éléments de nature médicale. Cette contestation ne tend pas à faire juger un manquement aux règles de l’art du médecin du travail à l’origine de l’avis, mais à analyser les conséquences sur les conditions de travail du salarié. Elle a lieu devant le CPH, selon la procédure accélérée au fond, dans les quinze jours suivant leur notification. Le CPH peut alors ordonner une mesure d’instruction par la désignation d’un médecin expert. Passé ce délai, la contestation devant le CPH est irrecevable. Le dépassement du délai constitue une fin de non-recevoir, de sorte que la partie négligente est forclose dans son action. |
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 4624-7 du Code du travail N° Lexbase : L1789LRP, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, de l’article R. 4624-45 du même code N° Lexbase : L2346LUG.
Par conséquent, le non-respect de la procédure du constat de l'inaptitude par le médecin du travail ne suffit pas à remettre en cause l'avis d'inaptitude.
La Cour de cassation confirme par ailleurs sa position adoptée dans un avis (Cass, soc., avis n° 15-002, 17 mars 2021, n° 21-70.002, publié N° Lexbase : A94564M8) : la contestation devant le CPH de l’avis d’inaptitude peut porter sur les éléments purement médicaux ou l’étude du poste du salarié. Elle prévoit donc une large interprétation de l’article L. 4624-7 du Code du travail.
|
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483599
[Brèves] SAS : la clause statutaire d’exclusion est conforme à la Constitution
Réf. : Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1029 QPC, du 9 décembre 2022 N° Lexbase : A02288Y4
Lecture: 4 min
N3605BZK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
Le 13 Décembre 2022
► Le premier alinéa de l’article L. 227-16 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-912, du 18 septembre 2000, relative à la partie législative du Code de commerce, et les mots « et L. 227-16 » figurant au second alinéa de l’article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, sont conformes à la Constitution.
QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. com., 12 octobre 2022, n° 22-40.013, FS-B, QPC N° Lexbase : A55188NP, P. Cathalo, Lexbase Affaires, octobre 2022, n° 732 N° Lexbase : N2952BZD) d’une QPC relative au premier alinéa de l’article L. 227-16 N° Lexbase : L6171AIE et au second alinéa de l’article L. 227-19 N° Lexbase : L2386LRS du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 2019 N° Lexbase : L3994I73, aux termes desquels les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent.
Dispositions contestées. La Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que les articles L. 227-16 et L. 227-19 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 2019, qui suppriment l’exigence d’unanimité pour l’adoption ou la modification d’une clause statutaire d’exclusion dans les SAS, sont susceptibles de porter atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété garantis par les articles 2 N° Lexbase : L1366A9H et 17 N° Lexbase : L1364A9E de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, en ce qu’ils permettent la cession forcée par un associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant.
Décision. En premier lieu, le Conseil constitutionnel constate que ces dispositions ont pour seul objet de permettre à une SAS d'exclure un associé en application d'une clause statutaire. S'il en résulte qu'un associé peut être contraint de céder ses actions, elles n'entraînent donc pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel considère qu’en permettant à une société par actions simplifiée de contraindre un associé à céder ses actions, le législateur a entendu garantir la cohésion de son actionnariat et assurer ainsi la poursuite de son activité. Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 2019 que, en prévoyant que l'adoption ou la modification d'une clause d'exclusion puisse être décidée sans recueillir l'unanimité des associés, il a également entendu éviter les situations de blocage pouvant résulter de l'opposition de l'associé concerné à une telle clause. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
En troisième lieu, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la décision d'exclure un associé ne peut être prise qu'à la suite d'une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un motif, stipulé par ces statuts, conforme à l'intérêt social et à l'ordre public, et ne pas être abusive.
En quatrième lieu, l'exclusion de l'associé donne lieu au rachat de ses actions à un prix de cession fixé, selon l'article L. 227-18 du Code de commerce N° Lexbase : L6173AIH, en application de modalités prévues par les statuts de la société, ou, à défaut, soit par un accord entre les parties, soit par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil N° Lexbase : L1737LRR.
En dernier lieu, le Conseil constitutionnel affirme que la décision d'exclusion peut être contestée par l'associé devant le juge, auquel il revient alors de s'assurer de la réalité et de la gravité du motif retenu. L'associé peut également contester le prix de cession de ses actions.
Dès lors, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sont déclarées conformes à la Constitution.
|
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les droits et obligations des associés de la société par actions simplifiées, L'exclusion de l'associé de la SAS, in Droit des sociétés, Lexbase N° Lexbase : E55127AE. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483605
[Focus] Facturation électronique : à vos marques ! Prêts ? Facturez ! car vous serez surveillés !
Lecture: 20 min
N3678BZA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Pierre Pradeau - Olivier Galerneau et Maxime Mahtout, Avocats, EY Société d'avocats
Le 18 Janvier 2023
Mots-clés : TVA • facturation électronique • facture • fraude fiscale • entreprises
À compter du 1er juillet 2024, l’ensemble des opérateurs seront concernés par le nouveau dispositif de la facturation électronique : soit en en tant qu’émetteur, soit en tant que destinataire.
Même si la mise en place de cette nouvelle règlementation se fera progressivement, l’ensemble des opérateurs se doivent d’anticiper ces changements qui peuvent s’avérer complexes.
I. Rappel du contexte
Cette nouvelle réforme s’inspire d’une volonté européenne (cf. Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance [1] et Ensemble pour une Europe plus forte). En effet, comme précisé dans sa communication du 15 juillet 2020, la Commission comprend « la nécessité de développer davantage la facturation électronique ».
Dans son plan d’action fiscal et son ensemble de 25 initiatives (nouveau paquet fiscal – 15 juillet 2020), la Commission a notamment précisé sa volonté d’aider « les États membres à faire respecter les règles fiscales existantes et à améliorer leur conformité fiscale, en veillant à ce qu’ils puissent garantir des recettes fiscales fiables » et « les autorités fiscales à mieux exploiter les données existantes et à partager plus efficacement les nouvelles données, de manière à améliorer l’application des règles fiscales et à lutter plus efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales ».
La TVA est ainsi au cœur de la préoccupation de la Commission dans le cadre des réformes à venir. En témoigne également l’ensemble des réformes passées et à venir commentées : e-commerce, Directive taux, réforme de la TVA financière ou encore la réforme du régime de la TVA propre aux agents de voyage pour ne citer que celles-ci.
À ce jour, l’article 218 de la Directive n° 2006/112/CE N° Lexbase : L7664HTZ prévoit que « pour les besoins de la présente Directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous format électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre ».
L’article 232 de la même Directive indique que « l’utilisation d’une facture électronique est soumise à l’acceptation du destinataire ».
La notion de facturation électronique reste ainsi vague et opaque et, comme l’a précisé Madame Céline Frackowiak [2], « revêt une acceptation extensive qui conduit à y inclure notamment les factures sous un format PDF ».
À la lumière de la volonté de la Commission d’aider autorités fiscales à mieux exploiter les données existantes et à partager plus efficacement les nouvelles données, de manière à améliorer l’application des règles fiscales et à lutter plus efficacement contre la fraude et l’évasion fiscale, certains pays de l’Union européenne ont sollicité une dérogation afin de généraliser la facturation électronique.
Tel a été le cas notamment de l’Italie (cf. Décisions 2018/593 du Conseil de l’UE du 16 avril 2018 et 2021/2251 du 13 décembre 2021). La mise en œuvre de la facturation électronique a permis la réduction de lutter efficacement contre la fraude à la TVA à hauteur de 2 milliards d’euros.
La France a également enclenché sa modernisation. Le Conseil de l’Union par une décision d’exécution de janvier 2022 [3] a autorisé la France « à accepter des factures émises par des assujettis établis sur le territoire français sous forme de documents ou de messages uniquement si ceux-ci sont transmis sous forme électronique » ainsi qu’à « disposer que l’utilisation de factures électroniques émises par les assujettis établis sur le territoire français n’est pas soumise à l’acceptation par un destinataire établi sur le territoire français de l’utilisation de factures électroniques » par dérogation aux articles 218 et 232 de la Directive n° 2006/112/CE.
La France prévoit ainsi d’introduire de nouvelles mesures complexes relatives à la facturation électronique sur la base :
- de l’article 26 de la loi n° 2022-1157, du 16 aout 2022, de finances rectificative pour 2022 N° Lexbase : L7052MDK prévoyant l’introduction de nouveaux articles 289 bis N° Lexbase : L7413MDW, 290 N° Lexbase : L7411MDT, 290 A N° Lexbase : L7414MDX, 290 B N° Lexbase : L7415MDY, 1737-III à V N° Lexbase : L7436MDR, 1788 D N° Lexbase : L7437MDS et 1788 E N° Lexbase : L7438MDT dans le Code général des impôts (« CGI »).
- du décret n° 2022-1299, du 7 octobre 2022, relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission des données de transaction N° Lexbase : L5386ME9. Ce décret prévoit notamment l’introduction de nouvelles mentions obligatoires sur les factures à compter du 1er juillet 2024.
- de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A) relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission des données de transaction ; et
- d’un dossier de spécifications externes de la facturation électronique [4] (pas de valeur légale).
II. Quand la réforme de la facturation électronique entrera en vigueur et pourquoi la généraliser ?
Cette réforme poursuit plusieurs objectifs :
- renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’allègement de la charge administrative, à la diminution des délais de paiement et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation. Pour une entreprise, le coût d’une facture électronique est inférieur à celui d’un timbre-poste alors que celui d’une facture papier est supérieur à 10 euros ;
- simplifier, à terme, les obligations déclaratives des entreprises en matière de TVA grâce à un pré remplissage des déclarations de TVA ;
- améliorer la détection de la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi ;
- améliorer la connaissance en temps réel de l’activité des entreprises pour permettre un pilotage de la politique économique au plus près de la réalité économique des acteurs.
| Calendrier d’application pour l’émission des factures électroniques | |
| 1er juillet 2024 | Les grandes entreprises, entreprise dont l’effectif est au moins égal à 5000 personnes et/ou dont le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan est au moins égal à 2 000 millions d’euros. |
|
1er janvier 2025
| Les ETI, entreprise de taille intermédiaire, une entreprise qui n'appartient pas à la catégorie des PME, dont l’effectif est inférieur à 5000 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 500 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000 millions d'euros. |
|
1er janvier 2026 | Les PME, petite et moyenne entreprise, entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Cela concernant également les microentreprises dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. |
| Calendrier d’application pour la réception des factures électroniques | |
|
1er juillet 2024 | Tous les assujettis clients des opérateurs concernés devront réceptionner les factures électroniques d’achat via la plateforme pertinente. |
Ces critères seront à apprécier au 30 juin 2023, sur la base du dernier exercice clos avant cette date, ou en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.
III. Qu’est-ce que la réforme de la facturation électronique ?
Au-delà de la définition de la facture électronique et son format, deux grandes nouvelles obligations auxquelles devront se plier les opérateurs entreront en vigueur selon le calendrier précisé au II. :
- l’obligation d’e-invoicing ou de facturation électronique : la facturation électronique concerne l’ensemble des opérations d’achats et de ventes de biens et/ou de prestations de services réalisées entre des entreprises (B2B) établies en France qui sont assujetties à la TVA dès lors qu’il s’agit d’opérations dites domestiques, c’est-à-dire qu’elles concernent le territoire national ;
- l’obligation d’e-reporting : le e-reporting est la transmission à l’administration de certaines informations (par exemple, le montant de l’opération, le montant de la TVA facturée …) relatives à des opérations commerciales qui ne sont pas concernées par la facturation électronique.
Les factures électroniques émises par les opérateurs seront déposées sur une plateforme qui fera le lien entre l’émetteur et le destinataire de la facture.
Cette plateforme pourra être le Portail Public de Facturation (« PPF ») ou une Plateforme de Dématérialisation partenaire (« PDP »).
Source : dossier de spécifications externes
Grâce à l’ensemble de ces nouvelles obligations et ce schéma de transit des factures, l’Administration pourra être en mesure de mieux exploiter les données existantes et à partager plus efficacement les nouvelles données comme le souhaitait, en 2020, la Commission européenne.
L’e-invoicing et l’e-reporting associés permettront de reconstituer l’activité économique d’ensemble d’une entreprise. À terme, l’e-reporting permettra de proposer aux entreprises un préremplissage des déclarations de TVA des assujettis.
A. Définition de la facture électronique
La facture électronique sera définie par l’article 289 bis du CGI.
Elle correspondra à une facture émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée et qui comportera nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée.
Ainsi, une facture électronique ne pourra être ni une facture papier, ni une facture PDF.
Cette facture sera adressée au client par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation partenaire, qu’il s’agisse du portail public de facturation ou d’une autre plateforme de dématérialisation. L’utilisation de factures électroniques par tous devrait permettre des économies pour l’ensemble des entreprises et constituer un levier de modernisation de la chaîne de facturation en simplifiant sa gestion et son suivi et en favorisant la réduction des délais de paiement.
Le format de la facture devra être choisi parmi les formats de types de factures suivants : UBL, CII ou Factur-X (format mixte) [5].
Une période transitoire sera prévue au cours de laquelle les entreprises auront la possibilité de déposer leurs factures sous format PDF non structuré. Selon la FAQ, cette période ira jusqu’au 31 décembre 2027, les plateformes de dématérialisation ayant la charge de la conversion.
B. Les plateformes
Les opérateurs pourront choisir d’avoir recours au PPF ou à une PDP ou d’avoir recours à ces deux plateformes.
Le PPF sera la plateforme dite « tiers de confiance public » offrant un service minimum et concentrant les factures et les données de facturation pour l’administration. Il s’agira de la plateforme par défaut.
Les PDP seront des prestataires de services offrant des services de dématérialisation des factures et seront immatriculés par l’Administration pour une durée de trois ans renouvelable (cf. Article 290 B du CGI).
Les données à transmettre au titre de l’e-invoicing et de l’e-reporting seront soit transmises directement auprès du PPF, soit transmises par le PDP au PPF grâce à l’annuaire central mis à disposition par le PFF aux opérateurs de plateforme de dématérialisation.
Ainsi, ces derniers seront en mesure grâce à cet annuaire de transmettre et d’adresser les factures électroniques aux destinataires mais également d’extraire des données des factures transitant par leur plateforme pour les transmettre à l’administration sauf si le PPF intervient dans le circuit de facturation.
Source : dossier de spécifications externes
Au titre des nouvelles obligations prévues par les articles 289 bis, 290 et 290 A du CGI, les plateformes de dématérialisation partenaires sont notamment tenues de :
- transmettre les factures électroniques, sous format structuré, aux plateformes de leurs destinataires ;
- recevoir les factures et les mettre à disposition de leurs destinataires ;
- extraire et transmettre les données obligatoires des factures à l’Administration ;
- recevoir, contrôler et transmettre à l’Administration les données d’e-reporting (transaction et paiement) ;
- effectuer des contrôles de conformité sur les factures et les données de transaction avant transmission ;
- gérer les statuts de traitement des factures électroniques : le cycle de vie de la facture pourra ainsi être suivi ;
- fournir au portail public de facturation les informations nécessaires à la mise à jour de l’annuaire.
C. L’obligation d’e-invoicing
Cette obligation sera régie par l’article 289 bis du CGI et s’appliquera à l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations et acomptes s’y rapportant :
1. mentionnées aux a et d du 1 du I de l’article 289 du CGI ;
2. et réalisées entre assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
En d’autres termes, sont concernées par l’e-invoicing les opérations domestiques d’achat et de ventes de biens et/ou services réalisées entre assujettis établis en France (dont les livraisons aux enchères publiques de biens d’occasion, d’œuvre d’art, d’objet de collection ou d’antiquité) pour lesquelles les règles de facturations françaises définies à l’article 289-0 du CGI s’appliquent.
Sont exclues toutes les opérations de commerce international (livraison intracommunautaire et exportations), les opérations exonérées de TVA et les opérations réalisées auprès de non-assujettis.
Les DROM seront également concernés par l’e-invoicing, sauf pour les opérations d’exportation.
Cela signifiera que les factures liées aux opérations concernées par l’e-invoicing (précitées) devront être déposées sur le PPF ou une PDP sous le format requis (sous réserve de la tolérance pour le format PDF). Les factures ne devront plus être envoyées par courrier.
Les données obligatoires de facturation seront ainsi collectées directement par le PPF ou transmises au PPF par le PDP.
Le nouvel article 242 nonies J de l’annexe II au CGI N° Lexbase : L5591MES [6] liste les données de facturation que devront comprendre les factures électroniques : « Les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A, aux articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du Code de commerce et à l'article L. 541-10 du Code de l'environnement, à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l'article 226-13 du Code pénal ».
Au total, 32 mentions obligatoires devront figurer sur la facture (les 8 dernières feront partie de la dernière vague de déploiement :
- numéro d’identité mentionné au premier alinéa de l’article R. 123-221 du Code de commerce (SIREN) – assujetti ;
- numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du CGI (n° TVA intracommunautaire) – assujetti ;
- numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du CGI (n° TVA intracommunautaire) – représentant fiscal de l’assujetti ;
- pays – assujetti x Numéro d’identité mentionné au premier alinéa de l’article R. 123-221 du Code de commerce (SIREN) – client ;
- numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du Code général des impôts (n° TVA intracommunautaire) – client ;
- pays – client ;
- mention catégorie de l’opération : livraison de biens (LB) / prestation de services (PS) /double (LBPS) ;
- date d'émission de la facture ;
- numéro unique de la facture ;
- numéro de la facture rectifiée en cas d’émission d’une facture rectificative x Option pour le paiement de la taxe d’après les débits ;
- total hors taxe par taux d’imposition de la taxe ;
- montant de la taxe correspondante par taux d’imposition ;
- taux de TVA applicable (à différencier si multiples)
- somme totale à payer HT ;
- montant de la taxe à payer ;
- en cas d’exonération, la référence à la disposition légale ;
- code/désignation devise de la facture
- mention « Autofacturation » ;
- référence à un régime particulier visé aux 15 et 16 du I de l’article 242 nonies A ;
- mention « Autoliquidation ;
- date de la livraison du bien ou de la fin d'exécution de la prestation ;
- date de l’acompte versé si elle est différente de la date d’émission de la facture ;
- minoration de prix (rabais, remises, ristournes) ;
- dénomination précise du bien livré ou du service rendu ;
- quantité de biens livrés ou de services rendus ;
- prix hors taxe de chaque bien livré ou service rendu ;
- adresse de livraison /de réalisation du service, si différente de l’adresse du client ;
- date d’émission de la facture rectifiée en cas d’émission de facture rectificative
- mention d’escompte ; et
- écoparticipation (C. env. art. L. 541-10 N° Lexbase : L1489LW3).
Si les opérateurs ne se conforment pas à cette obligation, une amende de 15 euros par facture, plafonnée à 15 000 euros par année civile s’appliquera.
La sanction déjà existante de 15 euros par défaut de mention obligatoire sur facture continuera également de s’appliquer.
Par ailleurs, il convient de noter que dans les mentions ci-dessus, figurent 4 nouvelles mentions au titre de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI compte tenu des modifications apportées par le décret du 7 octobre 2022 précité :
- le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du Code de commerce N° Lexbase : L9974HY3 ;
- l'adresse de livraison des biens si elle est différente de l'adresse du client ;
- l'information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d'opérations ; et
- lorsque le prestataire a opté pour le paiement de la taxe d'après les débits, la mention : « Option pour le paiement de la taxe d'après les débits ».
D. L’obligation d’e-reporting
Il ne s’agira pas ici du dépôt de facture sous un format particulier et cela ne concernera pas les mêmes opérations.
1) Que recouvre l’obligation d’e-reporting ?
Le e-reporting est la transmission à l’administration de certaines informations relatives à des opérations commerciales qui ne relève pas de l’obligation de facturation électronique.
L’obligation d’e-reporting distingue l’obligation de transmission d’informations relatives à des opérations particulières (CGI, art. 290) et l’obligation de transmission de données relatives au paiement d’opérations relevant de la catégorie des prestations de services (CGI, art. 290 A).
- Concernant l’obligation de transmission d’information relative à des opérations particulières
Les opérations concernées par la transmission d’informations sont listées à l’article 290 du Code général des impôts.
Il s’agit des opérations de vente et de prestation de services taxables ou non taxables et ouvrant droit à déduction (les opérations listées par les articles 261 à 261 E du CGI ne sont pas concernées) listées par l’article 290-I :
- avec des particuliers (BtoC) ; ou
- avec des opérateurs établis à l’étranger (exportations, livraisons intracommunautaires…).
Une liste exhaustive de ces opérations est faite par l’administration au sein de l’annexe A [en ligne].
Les opérateurs établis à l’étranger peuvent aussi être soumis à l’obligation de transmission d’informations dès lors qu’ils réalisent des opérations réputées situées en France soumises à TVA pour lesquelles ils sont redevables (CGI, art. 290-II) sauf concernant certains régimes particuliers tels que l’IOSS pour la VàD-BI ou l’OSS pour la VàD.
- Concernant l’obligation de transmission de données de paiement
Cette obligation ne concerne que les prestations de services relevant de la catégorie des prestations de services relevant du e-invoicing et du e-reporting, dans la mesure où l’entreprise n’a pas opté pour la TVA sur les débits et hors opérations donnant lieu à autoliquidation de la TVA.
Les données à transmettre sont, aux termes de l’article 242 nonies P-1-1° à 5° de l’annexe II au CGI issu du décret du 7 octobre 2022, les suivantes :
- le numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;
- la période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
- la date d'encaissement effective ;
- le montant encaissé, par taux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.
2) Que devra-t-on transmettre ?
Concernant les opérations B2B internationales, les données à transmettre seront identiques à celles du e-invoicing (cf. ci-devant) à l’exclusion logiquement du n° SIREN de l’assujetti non établi en France.
Concernant les transactions B2C, il s’agira notamment des informations suivantes :
- période au titre de laquelle la transmission est effectuée ;
- numéro d’identité mentionné au premier alinéa de l’article R. 123-221 du Code de commerce de l’assujetti (SIREN) ;
- la mention « option pour le paiement de la taxe d’après les débits », si l’assujetti a réalisé cette option ;
- par taux d’imposition, le montant total hors taxe et le montant de la taxe correspondante ;
- le montant total de la taxe à payer, à l’exclusion de toute TVA étrangère, et exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ;
- la devise ;
- la catégorie de transactions :
- livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- livraisons de biens et prestations de services non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France dont les ventes à distance intracommunautaires mentionnées au 1° du I de l’article 258 A et à l’article 259 B du Code général des impôts ;
- opérations donnant lieu à l'application des régimes prévus au e) du 1 de l'article 266 et aux articles 268 et 297 A du CGI (régime de TVA sur la marge) ;
- si une facture a été établie et a permis d’effectuer le e-reporting :
- le numéro de la facture, 21/143 ;
- la date de la facture ;
- le nombre de transactions quotidiennes (hors factures) ;
- la date des transactions, en l’absence de facture.
L’ensemble des données e-reporting seront transmises directement selon le format particulier autorisé au PPF ou à l’opérateur de plateforme qui les transmettra à son tour au PPF.
Concernant la fréquence de transmission, l’administration a publié un tableau résumé [en ligne] :
Il convient de noter que dans les opérations soumises au e-reporting, des opérations de ventes et d’achat sont concernées. En effet, en cas d’autoliquidation sur des opérations réalisées par une entreprise non établie avec un assujetti à la TVA en France, c’est l’acheteur redevable qui devra transmettre les informations nécessaires au titre du e-reporting.
Cette réforme française, comme soulignée en préambule, s’inscrit dans une volonté communautaire qui vient de se traduire par la publication d’un projet de Directive (COM(2022) 701 final – 2022/0407 (CNS)) introduisant dans l’Union européenne un recours plus large à la facturation électronique ainsi qu’une obligation de transmission des données des transactions intracommunautaires.
La réforme française s’accompagnera probablement d’adaptations et de compléments liés à ce projet de Directive.
[1] COM (2020) 312 final – Un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance – Bruxelles, le 15 juillet 2020.
[2] Ancien magistrat administratif et Directrice de projet « Facturation électronique » à la DGFiP – cf. Dr. Fisc, n° 41, 13 octobre 2022, comm. 359 ;
[3] Décision UE/2022/133 du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la Directive n° 2006/112/CE.
[4] Dossier en date du 25 août 2022 au jour de la publication du présent article. Toutefois, ce dossier peut être amené à évoluer compte tenu de la technicité de la mise en place de cette nouvelle règlementation et de l’installation progressive de celles-ci pour les opérateurs.
[5] Cf. Dossier de spécifications externes de la facturation électronique en page 86 &s.
[6] Décret n° 2022-1299, du 7 octobre 2022, relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction N° Lexbase : L5386ME9.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483678