[A la une] Le 30ème anniversaire du Code pénal : entre amertume et espoir
Lecture: 3 min
N8893BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Nicolas Catelan et Jean-Baptiste Perrier, Directeurs scientifiques de la revue Lexbase Pénal
Le 27 Mars 2024
La réforme du Code pénal est entrée en vigueur le 1er mars 1994, soit, désormais, il y a trente ans. L’âge de la maturité aux yeux de certains, mais l’âge où tout est encore à faire, avec l’espoir que les années écoulées permettent d’appréhender l’avenir sereinement. Les nombreuses réformes de la réforme, c’est-à-dire les innombrables modifications apportées au Code pénal depuis trente ans, laissent toutefois peu de doute sur cette sérénité espérée, et quelques inquiétudes sur la maturité attendue.
Cet anniversaire que vous propose de célébrer Lexbase Pénal est un peu particulier : le Code vient de perdre l’un de ses principaux artisans, l’immense Robert Badinter. On sait quel rôle fut le sien dans les années 1980 lorsqu’il ressuscita le projet de réforme qui permit d’aboutir aux lois du 22 juillet 1992. Nous étions évidemment très fiers lorsque l’ancien ministre de la Justice accepta notre proposition de participer à ce dossier spécial qui nourrit très substantiellement cette nouvelle livraison de la revue Lexbase Pénal. Les circonstances ne nous ont malheureusement pas permis de profiter du regard du célèbre avocat, professeur et Sage, sur l’évolution du Code pénal au cours des trente dernières années.
Ce deuil ne doit pas nous empêcher d’apprécier le travail considérable accompli par les nombreux auteurs ayant accepté de relever le défi que nous leur avons lancé. Les éditions Lexbase sont en effet très fières d’accueillir ce dossier si spécial qui combine des articles communs ou en miroir sur ce code aussi imparfait que moderne, qui guide, principe de légalité oblige, la main de tous les juges pénaux de France au moment de rendre une décision. Du droit pénal général au droit pénal spécial en passant par le droit de la peine, chacun a su avec talent, retracer trente ans d’évolutions… et d’interrogations.
À l’heure où un nouveau Code de procédure pénale est annoncé, il ne semble pas inutile de revenir sur ces trois dernières décennies pour comprendre quelle destinée ont les compilations ordonnées de lois à l’heure de la fluidification des normes, mais aussi de leur empilement, résultat d’injonctions souvent paradoxales d’efficacité, de simplicité… et de protection.
Le Code pénal, dont la réforme est entrée en vigueur en 1994, est encore jeune et pourtant il semble déjà accuser les années. La responsabilité ne semble plus être celle de 1994 comme en témoignent le mécanisme ad hoc relatif aux personnes morales ou encore le cas des troubles psychiques. Le droit pénal des mineurs n’a cessé d’évoluer, de se modifier… jusqu’à être désormais compilé ailleurs. Les peines semblent toujours marquées par la prison, pourtant si décriée sur un plan philosophique, sociologique…et pratique. Quant au droit pénal spécial, il semble bien difficile de trouver une ligne de pente évidente.
Pourtant, à y regarder de plus près, et grâce aux nombreuses contributions de ce dossier, des lignes de force apparaissent. Nouvelles ou anciennes, ces tendances éclairent la justice pénale actuelle : légalité renforcée sans nécessaire prévisibilité évidente, légistique chahutée mais encadrée par des normes supérieures, prison exceptionnelle mais possible donc toujours prononcée, incriminations galopantes au profit du filet répressif toujours plus étendu.
Ces lignes de force, qui sont souvent des lignes de fuite, pourraient demeurer invisibles si la doctrine ne passait son temps à mettre en lumière leurs manifestations, leurs contradictions, leur succès et leurs échecs. Qu’il nous soit donc permis de remercier à nouveau tous les nombreux contributeurs à ce dossier spécial et ceux qui, au sein de Lexbase, ont rendu possible ce nécessaire travail de mise en intelligibilité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488893
[Brèves] Revirement de jurisprudence en matière d’abus de confiance sur un immeuble
Réf. : Cass. crim., 12 mars 2024, n° 22-83.689, FS-B N° Lexbase : A05102UG
Lecture: 4 min
N8881BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Florian Engel, Docteur en droit privé et sciences criminelles
Le 17 Avril 2024
► La Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, considère que l’expression « biens quelconques » utilisée par l’article 314-1 du Code pénal, peut concerner un bien immeuble remis à titre précaire. Le détournement de l’immeuble par la volonté de l’auteur de se comporter comme le propriétaire constitue donc l’élément matériel de l’abus de confiance.
Rappel des faits et de la procédure. C’est à l’occasion d’une tentaculaire affaire de prise illégale d’intérêt, abus de confiance, trafics d’influence, de blanchiment, favoritisme, abus de bien sociaux, faux et usage de faux, que la Cour de cassation fut saisie de multiples pourvois tendant à contester l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait condamné les différents prévenus, ainsi que deux arrêts de la chambre de l’instruction de la même cour d’appel. En l’espèce, le procureur avait requis l’ouverture d’une information judiciaire confiée à la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, en raison de différents faits liés à la gestion et le traitement des déchets dans les Bouches-du-Rhône. Cette instruction préparatoire avait permis de mettre en relief différentes infractions et à la mise en examen de plusieurs individus, dont le président du Conseil général et son frère. L’avocat de ce dernier avait présenté devant la chambre de l’instruction diverses requêtes en nullité.
Moyens soulevés. Parmi les moyens soulevés, un en particulier a attiré l’attention de la Cour de cassation. Il s’agissait d’un moyen soulevé par plusieurs prévenus, dont le frère du président du Conseil général, qui critiquaient l’arrêt de la cour d’appel qui les avait déclarés coupables d’abus de confiance et de complicité de cette infraction en raison du détournement d’un bien immobilier. Ils faisaient valoir qu’en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, l’abus de confiance ne peut porter sur un bien immobilier. Ils considéraient ainsi qu’un revirement de jurisprudence in defavorem ne pouvait rétroagir à des faits commis antérieurement, de telle sorte qu’on ne pourrait de toute façon lui reprocher cette infraction pour des faits commis entre 2007 et 2010. Ils avançaient également qu’il n’existait en l’espèce aucun détournement et que l’infraction reprochée n’avait pas été réalisée au préjudice d’autrui.
Décision. Rappelant sa jurisprudence classique en la matière, la Cour reconnaît toutefois qu’un nouvel examen de la question s’impose, du fait de l’existence de controverses doctrinales sur la question. Dans une solution très pédagogique, la Cour explique que sa jurisprudence, qui a déjà évolué en matière d’escroquerie, mérite d’évoluer également en matière d’abus de confiance. Elle affirme que l’acte de détournement peut résulter de l’utilisation d’un bien à des fins étrangères à celles convenues, dès lors qu’il est constaté que son possesseur avait la volonté de se comporter comme véritable propriétaire du bien. Elle constate qu’en l’espèce tel était le cas, les prévenus s’étant comportés comme les propriétaires de certaines parcelles et infrastructures alors que la société qu’ils représentaient n’était qu’un prestataire qui bénéficiait du droit d’exploiter les terrains. Tout en censurant la cour d’appel qui avait affirmé que le préjudice n’était pas un élément constitutif du délit d’abus de confiance, la Cour considère qu’il existe bien un tel préjudice en l’espèce, qui se déduit du détournement et qui ne peut être qu’éventuel.
Enfin, s’agissant du revirement de jurisprudence, la Cour affirme que le principe de prévisibilité n’est pas méconnu, dès lors que les prévenus étaient en mesure de « s’entourer de conseils appropriés » et que la Cour avait déjà initié un élargissement de la conception d’objets détournés dans des arrêts antérieurs.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488881
[Focus] Les valeurs protégées dans le Code pénal : où donc ?
Lecture: 16 min
N8726BZ9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Emmanuel Dreyer, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 26 Mars 2024
Mots-clés : infraction • incrimination • valeur protégée • intérêt • ordre public • résultat
L’enseignement du droit pénal est devenu aberrant par la distance qui existe entre la théorie présentée aux étudiants et la pratique des juridictions à laquelle les avocats sont confrontés. Nombre d’enseignants ne présentent plus le droit pénal tel qu’il est mais tel qu’ils le rêvent à partir d’un passé ou d’un futur idéalisé. L’acmé du phénomène est sans doute atteinte par ces doctrines substantialistes qui prétendent raisonner en termes de valeurs protégées. Dans l’entre-soi des « écoles », chacun se comprend et surenchérit. Mais, vu de l’extérieur, cette endogamie intellectuelle consterne car elle ne correspond à rien de la réalité du droit pénal.
Cet article est issu du dossier spécial « Les 30 ans d'entrée en vigueur du Code pénal » publié le 28 mars 2024 dans la revue Lexbase Pénal. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici : N° Lexbase : N8781BZA
L’heure est grave. On se demande désormais comment il est possible d’enseigner le Droit pénal général [1]. La question se pose en effet à raison de la distorsion entre les principes et leur application. Asseoir la répression sur une exigence de légalité procède aujourd’hui d’un déni de réalité. Le juge a redéfini le périmètre des incriminations, avec la complicité d’un législateur qui multiplie les standards et les notions ouvertes, au point que la juridiction de Strasbourg ne voit plus de différence en Europe entre les pays de droit écrit et les pays de commun law [2]. La même distorsion peut être observée avec le caractère personnel de la responsabilité pénale, caractère que l’on rappelle à l’envie, mais qui est allègrement méconnu au détriment des personnes tant physiques que morales. Que dire ensuite de l’appréciation de l’intention (invérifiable) et de l’exigence d’individualisation (dépendant essentiellement des capacités de traitement de l’administration pénitentiaire) ? Les mêmes interrogations se font jour au sujet de la procédure pénale : comment peut-on encore enseigner les règles de poursuites applicables devant les juridictions répressives quand plus d’une affaire sur deux donnant lieu à une réponse pénale fait l’objet d’un traitement simplifié [3] ? Le summum de l’hypocrisie en la matière est atteint avec la justice pénale des mineurs, parée de tous les atours constitutionnels, mais à l’occasion de laquelle la saisine d’une juridiction (en l’occurrence, spécialisée) est encore plus rare qu’à l’égard des majeurs [4]. D’évidence, nous enseignons un droit pénal, de fond et de forme, « hors sol » qui ne correspond plus qu’à des hypothèses exceptionnelles, car son application est à mille lieues de ce que l’on présente aux étudiants.
Mais il y a pire que cela. En effet, l’artificialité de l’enseignement est encore accrue par certains d’entre nous lorsqu’ils développent un discours en termes d'intérêts juridiquement protégés qui est un défi au sens commun. Il importe de bien comprendre à cet égard la responsabilité qui est la nôtre, à nous enseignants, car c’est de plus belle un problème d’enseignement et non une question de droit positif. Encore plus déconnectés de la réalité, certains soutiennent que l’incrimination se justifierait par la nécessité de protéger des valeurs sociales ; que la sanction pénale se justifierait pas la nécessité d’en assurer la défense ; que l’intention coupable serait l’expression d’une hostilité à l’égard de ces valeurs et la faute l’effet d’une indifférence à leur encontre. Ce qui ne correspond à rien. Ce discours ne peut être justifié ni par la lecture du Code pénal (I.) ni par les décisions qui l’appliquent (II.). Il faut en finir avec cette approche irresponsable qui confond tout et s’avère étrangère à l’objet de la matière enseignée.
I. Les valeurs et les intitulés du Code pénal
Il est possible de retrouver l’origine de la dérive contemporaine de la doctrine pénale dans les justifications apportées au code actuel. Pour justifier l’abrogation du code de 1810 et l’adoption d’un nouveau code en 1992, on a prétendu que les temps avaient changé et les besoins de protection aussi. Alors que chacun sait que ces deux codes se ressemblent beaucoup, très peu de dispositions nouvelles ayant été intégrées, très peu de dispositions anciennes ayant été supprimées, l’œuvre « historique » qui aurait été réalisée à cette occasion a été justifiée par de prétendues valeurs nouvelles qu’il s’agissait de promouvoir [5]. La réflexion n’est pas allée bien loin. Elle s’est réduite à faire observer que, dans la partie spéciale du code, les infractions contre les personnes et les biens apparaissent désormais avant les infractions contre la chose publique, rebaptisées infractions contre la nation, l’État et la paix publique. Pour enfoncer le clou de la modernité, on a ajouté que désormais tout commence avec les atteintes collectives aux personnes (crimes contre l’humanité). Défendue par celui-là même qui obtint l’abolition de la peine de mort, une telle réorganisation pouvait sembler avoir une portée symbolique essentielle. Mais tout ceci n’était, en réalité, que de la communication, du marketing, destiné à vendre un code qui ne pouvait satisfaire ni les attentes des plus progressistes ni celles des plus conservateurs, puisqu’il restait identique à l’ancien, c’est-à-dire pragmatique, éloigné de toute démarche philosophique ou criminologique.
Sur le terrain même des symboles, il est possible de contester une telle présentation, car cette prétendue inversion des valeurs à laquelle il aurait été procédé s’avère dangereuse : à quoi sert-il d’avoir des infractions contre les personnes ou les biens si les atteintes à l’autorité de la justice, par exemple, ne sont pas correctement réprimées ? Il n’y avait rien d’aberrant à considérer que cette « chose publique » qu’est la démocratique doit primer sur la personne et ses différents intérêts dans un droit pénal qui est un droit objectif et non le réceptacle de garanties subjectives [6]. Par ailleurs, si on entre dans le détail de la partie spéciale du code, on s’aperçoit que l’affirmation de valeurs protégées lors du classement des différentes incriminations s’avère plus que contestable. Dès l’origine, il est apparu que certaines infractions n’ont rien à faire à l’endroit où elles apparaissent alors que d’autres y auraient été attendues, mais figurent ailleurs [7]. Une telle critique n’a fait ensuite que s’accentuer. Non, il n’est pas honnête de prétendre que ce code, à travers son plan, exprimerait des valeurs protégées. Il n’exprime rien de tel parce que le droit pénal n’est pas là pour protéger des valeurs. La fonction même du droit pénal n’est pas de protéger, mais de punir. Le droit pénal n’est pas un droit déterminateur, mais un droit sanctionnateur. C’est un droit auxiliaire : il apporte sa sanction aux autres branches du droit qui, elles, identifient des intérêts méritant protection et il permet – dans des limites qui devraient être étroitement précisées – de punir ceux qui y portent atteinte. À l’occasion d’une infraction, ce qui est enfreint, ce n’est pas la norme d’incrimination (à laquelle, au contraire, l’agent doit s’être conformé pour que sa responsabilité pénale soit engagée), mais la norme sous-jacente. Si une réflexion sur l’intérêt protégé dans un système juridique donné doit être menée, c’est par rapport à cette norme-ci et non par rapport à cette norme-là. En toute hypothèse, c’est en vain que l’on cherchera dans les travaux préparatoires du code ou d’aucune autre loi pénale des réflexions d’ordre philosophique sur les valeurs qu’il s’agit de défendre dans notre société. Nous sommes très loin ici de la dogmatique allemande. Les valeurs ne sont invoquées qu’à des fins de communication politique.
Or cette réflexion, que l’on ne trouve pas chez les parlementaires, on ne la trouve pas davantage dans la doctrine pénale qui en use et abuse sans jamais prendre au sérieux les valeurs en question. L’existence de valeurs protégées est affirmée au nom du bon sens, présentée comme une évidence et d’autant plus souvent répétée qu’elle n’est jamais approfondie par ceux qui l’utilisent et dont on aimerait bien qu’ils s’expriment sur leur conception de la vie humaine ou de la liberté sexuelle afin que les masques tombent : il en ressortirait que ces « convictions » ne reposent elles aussi sur aucun approfondissement, ni métaphysique ni sociologique, et qu’elles n’expriment que ce conservatisme, si ce n’est ce moralisme qui – d’après Ripert – serait le propre du juriste [8]. Parfois, cela produit des réflexions étonnantes. Il en va par exemple ainsi lorsque l’infraction est présentée comme étant elle-même un résultat et que l’on finit par ne plus savoir où est la cause et où est l’effet, la notion de résultat étant alors vidée de tout sens. Plus souvent, ces réflexions paraissent simplement ridicules : peut-on sérieusement soutenir que l’individu qui donne volontairement la mort à autrui témoigne à cette occasion de son hostilité à l’égard de la vie humaine et que le chauffard qui perd la maîtrise de son véhicule et heurte un passant manifeste à cette occasion son indifférence envers l’intégrité physique d’autrui ? Soumettez à l’un et à l’autre cette grille d’analyse de leur comportement, ils vous riront au nez. Quant au juge, ce n’est pas la défense de valeurs sociales qui justifie son intervention, mais l’apaisement du trouble à l’ordre public né d’une infraction : la défense de ces prétendues valeurs n’est pas l’une des fonctions de la peine prévues à l’article 130-1 du Code pénal N° Lexbase : L9806I3L.
II. Les valeurs et l’application du Code pénal
Ainsi, la référence aux valeurs protégées semble constituer soit la justification a posteriori d’un raisonnement tenu en dehors d’elles (avec tous les risques d’approximation que cela implique lorsque, s’agissant des infractions contre les biens par exemple, on omet qu’il s’agit de punir des appropriations frauduleuses pour ne retenir qu’une atteinte à la propriété d’autrui), soit à l’inverse l’expression d’une partialité dans le raisonnement qui s’efforce de donner a posteriori une explication juridique à un choix idéologique (les réactions doctrinales aux arrêts rendus sur l’impossibilité de caractériser un homicide involontaire in utero illustrant parfaitement notre propos). Entre ces deux écueils permanents, le recours aux valeurs protégées ne semble guère trouver d’écho en droit positif. Il ne saurait expliquer la justification des faits en cas de légitime défense dès lors qu’il ne s’agit pas là, pour le juge de peser les valeurs en conflit, mais d’apprécier la proportionnalité d’une agression avec les moyens mis en œuvre pour s’y opposer (la victime d’une tentative de viol peut légitimement tuer son agresseur pour se dégager). Le recours aux valeurs protégées ne saurait davantage aider à trancher les conflits de qualification dès lors qu’après avoir rendu des décisions plus que divinatoires en ce domaine (qui peut sérieusement prétendre qu’en lançant une bombe contre un café un terroriste veut à la fois porter atteinte à la propriété du cafetier et à la vie des consommateurs ? Pourquoi pas porter également atteinte à la tranquillité du visionnage, à la liberté du travail des employés et aux finances de l’État dont les rentrées fiscales sont accidentellement réduites pour l’occasion ?), la Cour de cassation a fini par admettre le cumul de toutes les qualifications applicables sous réserve d’exceptions, sans que le juge prenne spécifiquement en compte les intérêts prétendument protégés dans ces différentes occasions. Enfin, lorsqu’une intention homicide est caractérisée, c’est parce que le juge acquiert la conviction que le meurtrier a cherché à provoquer un fait (la mort d’autrui) et non parce qu’il a cherché à porter atteinte à une valeur (vie humaine). La réflexion en termes de valeurs protégées est absente du quotidien du juge lorsqu’il applique le Code pénal.
À une réserve près, qui doit nous inquiéter. Elle concerne l’arrêt rendu au bénéfice du cardinal Barbarin poursuivi pour non-dénonciation de crimes, à savoir le viol de certains d’enfants de chœur par un prêtre de son diocèse dont il avait pourtant été informé. Afin de justifier sa relaxe, non seulement la prescription des faits a été invoquée, mais aussi un argument plus surprenant et qui a insuffisamment retenu l’attention. En effet, après avoir rappelé les termes de l’article 434-3 du Code pénal N° Lexbase : L6209LLK, la Cour de cassation a ajouté que « cet article a pour but de lever l’obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l’âge ou la fragilité de la victime l’ont empêchée de dénoncer les faits. Il en résulte que, lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation ainsi prévue disparaît. Aussi, la condition, prévue par le texte en cause, tenant à la vulnérabilité de la victime, doit-elle être remplie non seulement au moment où les faits ont été commis, mais encore lorsque la personne poursuivie pour leur non-dénonciation en a pris connaissance ». Or au cas particulier, la Haute juridiction a relevé dans les motifs de l’arrêt d’appel attaqué « que les victimes étaient, au moment où les faits ont été portés à la connaissance de M. B [le cardinal], en état de les dénoncer elles-mêmes et que ce seul motif est de nature à justifier la relaxe prononcée » [9]. Pourtant, l’article 434-3 dispose d’une portée générale : il s’applique non seulement lorsque la victime des privations, mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles était une personne vulnérable (pas en état de se protéger), mais aussi lorsqu’elle était mineure au moment des faits. C’est au moment de ces privations, mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles que la fragilité ou la minorité de la victime est appréciée et non au moment de la dénonciation de tels faits. C’est en invoquant la ratio legis de cette incrimination que la Cour de cassation a cru pouvoir légitimer un raisonnement consistant à dire que les victimes peuvent libérer le destinataire de son obligation de dénoncer les faits lorsqu’elles sont elles-mêmes en mesure de le faire. Ici, clairement, c’est l’absence d’atteinte à la valeur prétendument protégée (défense de personnes fragiles devenues fortes) qui a été prise en compte pour passer outre la lettre pourtant très claire d’une incrimination qui ne permettait aucune distinction de cet ordre. Avec l’approbation de la Cour de cassation, les juges du fond ont réduit le périmètre de cette incrimination au motif qu’à partir du moment où les victimes étaient en mesure de défendre leurs intérêts, il n’était plus opportun de punir celui qui a manqué à son obligation de le faire à leur place [10]. Voilà à quoi conduit le raisonnement en termes de valeurs protégées !
On peut s’en féliciter, car, pour la première fois à notre connaissance, ce raisonnement opère in favorem et conduit à réduire le périmètre d’une incrimination quand le plus souvent l’interprétation téléologique sert à étendre la répression au-delà de ses termes (jusqu’à aboutir à cette légalité fantôme dénoncée en introduction) [11]. Mais on peut aussi s’étonner de la liberté ainsi prise par le juge avec la loi. D’abord, parce que, au regard du traumatisme des victimes, il n’est pas sûr que – même devenues majeurs – celles-ci aient été en mesure de défendre leurs intérêts et de porter plainte avant l’expiration du délai de prescription. Ensuite, parce que – si l’on veut vraiment se placer sur le terrain des valeurs protégées – il importe de constater qu’une telle obligation de dénoncer ne s’impose pas seulement dans l’intérêt des victimes. Elle s’impose aussi et avant tout dans l’intérêt de la justice qui doit être informée des comportements litigieux. Le Code pénal range d’ailleurs ce délit de non-dénonciation dans la catégorie des entraves à la saisine de la justice. Un tel classement aurait-il soudain perdu toute vertu expressive ? Ceux qui ont approuvé l’arrêt manquent cruellement de cohérence : comment peuvent-ils tout à la fois encenser la réflexion en termes de valeurs protégées et ignorer la valeur désignée par le code, car ils en préfèrent une autre ? En réalité, cette affaire est symptomatique du danger auquel conduit la réflexion en termes de valeurs : celui d’une manipulation des incriminations à des fins opportunistes. Ici, il fallait sauver le soldat « cardinal » ! Ce qui n’est pas sans poser difficulté à ceux qui se souviennent que, le même jour, fut rendu également l’arrêt de la Cour de cassation mettant fin à l’affaire Halimi [12]. Sur le fond, nous avons approuvé cette décision. Néanmoins, un esprit bassement polémique pourrait tirer de ce rapprochement chronologique que les catholiques et les juifs ne sont décidément pas traités avec les mêmes égards par la justice française.
*
Il faut absolument préserver notre justice de ce type de suspicions. Cela commande de renoncer à la réflexion en termes de valeurs qui témoigne a minima de l’inconséquence de ceux qui l’emploient (et ne peuvent la justifier par une réflexion théorique sur les valeurs en question), voire de leur perversité intellectuelle (dès lors qu’il s’agit de trouver des habits juridiques à des présupposés idéologiques). Soyons fiers de notre code, précisément parce qu’il nous permet d’échapper à ce type de travers ! Et que l’on ne nous oppose pas un positivisme desséché. Nous avons aussi des valeurs en tant que juristes et nous croyons en la nécessité de les défendre. Mais il se trouve que ces valeurs, dans un système juridique donné, sont exprimées par les droits fondamentaux et non par le Code pénal. Il nous semble essentiel de ne pas tout confondre, au risque de ne plus rien comprendre à l’influence de la Convention EDH, notamment. Influence que dénoncent précisément les thuriféraires des valeurs (pénalement) protégées, ce qui n’a rien d’un hasard…
[1] D. Mayer, Peut-on encore enseigner le droit pénal général ?, in Mél. Robert, LexisNexis, 2012, p. 524.
[2] V., les arrêts Kruslin et Huvig : CEDH, 24 avril 1990, Req. 11105/84, § 28 N° Lexbase : A6324AW7.
[3] Selon les Chiffres clés de la justice 2023, les tribunaux correctionnels ont rendu 236 400 jugements de relaxe ou condamnation en 2022 alors que, au cours de la même période, ont été rendues 197 409 ordonnances pénales et 90 644 ordonnances de CRPC : ces ordonnances ont donc représenté 55 % des décisions rendues sur l’action publique, au cours de l’année précédente [en ligne].
[4] L’édition 2023 des Chiffres clés de la justice laisse en effet apparaître un taux de réponse pénale pour les mineurs de 89,4 %. Mais ce qui retient l’attention, c’est la forme prise par cette réponse pénale que révèlent les Références statistiques Justice 2022 [en ligne] : sur à peine plus d’un cinquième des affaires traitées impliquant un mineur qui ont été considérées comme poursuivables, le taux de poursuites tombe à 31 % (une juridiction pour mineurs étant saisie dans 29 % des cas et un juge d’instruction dans les 2 % restant). Au contraire, dans plus de la moitié des affaires (57 %), une procédure alternative a été mise en œuvre, le reste étant constitué de classements sans suite (9,8 %) et les compositions pénales réussies (5,3 %). Quelle portée reconnaître à la justice pénale des mineurs dans ces conditions ?
[5] R. Badinter, Projet de nouveau Code pénal, Dalloz, 1988, p. 11.
[6] P. Lascoumes, P. Poncela et P. Lenoël, Au nom de l’ordre, une histoire politique du Code pénal, Hachette, 1989, p. 293.
[7] P. Poncelat et P. Lascoumes, Réformer le code pénal, où est passé l’architecte ?, Puf, 1998, p. 87.
[8] Rappelons que selon ce dernier, qui a été désigné comme modèle à des générations d’étudiants, « un juriste ne doit pas seulement être le technicien habile qui rédige ou explique avec toutes les ressources de l'esprit des textes de loi ; il doit s'efforcer de faire passer dans le droit son idéal moral, et, parce qu'il a une parcelle de la puissance intellectuelle, il doit utiliser cette puissance en luttant pour ses croyances » (La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 1949, p. 29).
[9] Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196, FS-P N° Lexbase : A25444PW : E. Dreyer, note, D., 2021, p. 937 ; H. Matsopoulou, note, JCP G, 2021, 575 ; A. Cappello, note, Gaz.Pal., 15 juin 2021, p. 22 ; A. Darsonville, note, AJ pénal, 2021, p. 257.
[10] V., plus largement, E. Dreyer, Droit pénal spécial, Lgdj, 2e éd., 2023, p. 696.
[11] V., plus largement, E. Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis, 6e éd., 2021, p. 539.
[12] Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135, FS-P+I N° Lexbase : A25434PU : F. Rousseau, note, JCP G, 2021, 521, et E. Dreyer, note, JCP G, 2021, 522 ; J.-B. Thierry, note, AJ pénal, 2021, p. 254 ; G. Beaussonie, note, Gaz.Pal., 8 juin 2021, p. 22.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488726
[Brèves] Majoration de la pension de réforme (SNCF) : un fait d’agression ne caractérise pas une lutte soutenue ou d’attentat subi
Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 21-24.984, F-B N° Lexbase : A24642W8
Lecture: 3 min
N8886BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 27 Mars 2024
► Les faits d’agression subis par un employé de la SNCF s’analysent en des violences volontaires sur une personne chargée d’une mission de service public et ne caractérisent donc pas une lutte soutenue ou un attentat subi à l’occasion de ses fonctions au sens de l’article 2 du décret n° 2008-639, du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF ; partant la demande de la victime tendant au bénéfice de la majoration de pension prévue par le dernier alinéa du décret précité doit être rejetée.
Faits et procédure. Un employé de la SNCF a subi une agression le 26 mai 2009, qualifiée d’accident du travail et a bénéficié à compter de cette date d’arrêts de travail. La société lui ayant notifié par courrier du 18 novembre 2016 sa mise en réforme en précisant que celle-ci n’était que partiellement imputable à un accident du travail qui n’en était pas l’élément déterminant, la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale en demandant qu’il soit dit que l’accident du travail était l'élément déterminant de cette décision de réforme, et qu'il pouvait prétendre pour la liquidation de sa pension au bénéfice de la majoration prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639, du 30 juin 2008 N° Lexbase : L5389H7Q. Le texte dispose que tout agent reconnu inapte dans les conditions visées au premier alinéa et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du Code de la Sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts de ses éléments de rémunération.
La cour d’appel ayant rejeté ses demandes, la victime a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment la majoration de pension prévue par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639, du 30 juin 2008, est applicable, selon ce texte, dès lors que l'inaptitude de l'agent résulte d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions (CA Paris, 6-12, 1er octobre 2021, n° 20/00175 N° Lexbase : A087348T).
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant retenu que les faits d'agression subis par la victime le 26 mai 2009 s'analysaient en des violences volontaires sur une personne chargée de mission de service public, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne caractérisaient pas une lutte soutenue ou un attentat subi à l'occasion de ses fonctions au sens de l'article 2 du décret précité, qu'ils ne recouvraient pas, de sorte que la victime ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du dernier alinéa de ce texte.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488886
[Brèves] L’amélioration du dispositif de limitation des droits parentaux de l’auteur de violences intra-familiales par la loi « Santiago » du 18 mars 2024
Réf. : Loi n° 2024-233, du 18 mars 2024, visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales N° Lexbase : L8646MLS
Lecture: 23 min
N8913BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adeline Gouttenoire, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux et Directrice du CERFAP
Le 27 Mars 2024
Mots-clés : autorité parentale • limitation des droits parentaux • violences intra-familiales • violences conjugales • agressions sexuelles • protection des enfants • retrait de l’autorité parentale • suspension de l’exercice de l’autorité parentale • droits de visite et d’hébergement (DVH) • délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale
Publiée au Journal officiel du 19 mars 2024, la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024, dite « Santiago », a pour objet d’améliorer la protection des enfants victimes de violences commises par l’un de leur parent sur l’autre ou sur eux-mêmes, durant la procédure pénale. Construit petit à petit par des textes successifs, le dispositif de limitation des droits d’un parent violent faisait quelque peu figure de mille feuilles et avait sans aucun doute besoin d’une remise à plat. Le nouveau texte utilise trois moyens pour aboutir au renforcement de la protection des enfants : l’extension du domaine de la limitation des droits parentaux, l’accentuation de cette limitation et l’amélioration de la lisibilité du dispositif.
Le dispositif de limitations des droits du parent auteur de violences conjugales relève à la fois de dispositions civiles relatives à l’autorité parentale et de dispositions civiles ou pénales relatives à la répression des violences conjugales. Ces différentes dispositions sont les manifestations de la prise en compte contemporaine de l’impact sur les enfants, des violences commises sur l’un de leur parent par l’autre. Cette approche qui s’appuie sur des études psychologiques et médicales, a été intégrée dans les textes juridiques depuis 2010 et n’a cessé de croître depuis cette date, au point d’être considérée aujourd’hui comme une évidence et une nécessité. Il est en effet incontestable que l’exercice des droits parentaux par l’auteur des violences constitue une mise en danger de l’enfant comme du parent victime et qu’il convient de les limiter le plus tôt possible lorsque les violences sont révélées. L’exercice de l’autorité parentale est en effet l’occasion pour le parent violent de menacer l’enfant et de l’utiliser contre le parent victime. Le maintien des contacts entre l’enfant et le parent violent ou présumé tel, que ce soit par des contacts physiques ou par la simple mise en présence de l’enfant avec son parent violent, est un risque qu’il faut écarter très rapidement.
Construit petit à petit par des textes successifs [1], le dispositif de limitation des droits d’un parent violent faisait quelque peu figure de mille feuilles et avait sans aucun doute besoin d’une remise à plat. Il pouvait en outre paraître trop limité à la fois quant aux hypothèses dans lesquelles il devait s’appliquer et quant aux mesures qu’il contenait. On a pu en effet regretter que les textes n’aillent pas suffisamment loin et ne mettent pas en place une incompatibilité de principe entre la coparentalité et les violences commises par un parent [2].
La loi dite « Santiago » du nom de la députée qui a porté et défendu de manière remarquable le texte durant tout son parcours législatif, répond partiellement à ces critiques. Elle porte toutefois exclusivement sur les dispositions relatives à la limitation des droits parentaux comme conséquence d’une procédure pénale, sans traiter des dispositions composant ce qu’on peut appeler le droit de l’autorité parentale. On peut le regretter, mais cette prise en compte aurait sans doute nuit à l’homogénéité du texte.
Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, il est précisé que cette dernière « n’a pas la prétention de répondre à toutes les questions des violences intrafamiliales, mais à défaut d’un projet de loi transversal et d’une loi de programmation pluriannuelle du Gouvernement, que nous attendons depuis plusieurs années, elle propose de reprendre les mesures prioritaires identifiées par les acteurs afin de mieux, et vite, protéger les enfants victimes, directes ou indirectes, de violences intrafamiliales, physiques, sexuelles, incestueuses ou psychologiques. »
L’objet du texte, clairement formulé dans son intitulé, est d’améliorer la protection des enfants victimes de violences commises par l’un de leur parent sur l’autre ou sur eux-mêmes, durant la procédure pénale.
Le texte utilise trois moyens pour aboutir au renforcement de la protection des enfants : l’extension du domaine de la limitation des droits parentaux (I), l’accentuation de cette limitation (II) et l’amélioration de la lisibilité du dispositif (III).
I. L’extension du domaine de la limitation des droits parentaux au-delà des violences conjugales graves
Agressions sexuelles. L’ensemble du dispositif de limitation des droits parentaux mis en place par les lois successives de lutte contre les violences conjugales et amélioré dans la présente loi, est étendu à tous les crimes et les agressions sexuelles commises par un parent sur son enfant. Cette extension, clairement influencée par les travaux de la CIIVISE, est plus que bienvenue car il était choquant qu’un enfant qui a subi des violences sexuelles de la part de son parent soit moins protégé qu’un enfant co-victime de violences conjugales. Le législateur place ainsi les agressions sexuelles au même plan que les crimes, alors qu’elles constituent des délits, leur particulière gravité justifiant une telle assimilation. Les infractions sexuelles font d’ailleurs l’objet de règles plus sévères en matière de prescription que pour les autres délits. Certaines dispositions du texte, quoique rares concernent également les délits commis sur un enfant par son parent autre que l’agression sexuelle.
Assimilation au viol. Le fait de ne pas différencier parmi les infractions sexuelles incestueuses le viol et l’agression sexuelle doit être salué. En effet, il est tout d’abord souvent difficile en pratique de qualifier les violences sexuelles, faute de certitudes et de preuves précise de la pénétration. Il s’avère ensuite, qu’en pratique, la correctionnalisation peut aboutir à juger une agression sexuelle alors que les faits relèvent de la qualification de viol. Enfin, l’agression sexuelle de l’enfant par son parent constitue tout autant que le viol une transgression inacceptable de l’interdit de l’inceste et du principe selon lequel l’autorité parentale a pour finalité la protection de l’enfant. Le fait, à l’inverse, d’abuser de son autorité pour commettre une violence sexuelle sur l’enfant en le contraignant au silence, doit avoir les mêmes conséquences qu’il s’agisse d’un viol ou d’une agression sexuelle. Il est dans les deux cas inadmissible que l’enfant puisse rester soumis à l’autorité de son parent.
- II. L’instauration d’un retrait de l’autorité parentale de principe
Appréciation antérieure du juge pénal. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 mars 2024, la limitation des droit parentaux résultait d’une appréciation du juge pénal condamnant l’auteur de violences sur l’autre parent de l’enfant, les textes lui imposant de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice en cas de crime. Même si plusieurs décisions de la Cour de cassation de ces dernières années [3] permettent de penser que ces dispositions ont fait l’objet d’un certain nombre d’applications récentes, il apparaissait en pratique que les décisions de retrait de l’autorité parentale n’étaient pas systématiques en matière de crime et inexistantes en matière de délit. En outre dans les deux décisions de 2023, la Cour de cassation a clairement énoncé qu’elle contrôlait l’appréciation par les juges du fond de l’intérêt de l’enfant à voir son parent privé de ses droits, considérant notamment que la cour d’appel qui avait retiré l’autorité parentale au parent d’un enfant dont il avait violé la mère n’avait pas suffisamment motivé concrètement sa décision au regard de l’intérêt de l’enfant [4].
Retrait de l’autorité parentale de principe. La loi du 18 mars 2024 renverse totalement le dispositif du retrait de l’autorité parentale en cas de crimes sur l’autre parent ou l’enfant, ou en cas d’agression sexuelle sur ce dernier. Elle instaure clairement – et de manière bienvenue – une présomption selon laquelle dans ces dernières hypothèses, il est de l’intérêt de l’enfant de voir son parent privé de ses droits, au moins partiellement. Ainsi, en vertu des articles 378 N° Lexbase : L8778MLP du Code civil et 228-1 N° Lexbase : L8776MLM du Code pénal, dont la formulation est tout à fait identique, en cas de condamnation d’un parent pour crimes sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou pour agression sexuelle sur ce dernier, le juge pénal doit prononcer le retrait au moins partiel de l’autorité parentale sauf décision contraire spécialement motivée. Cette évolution répond incontestablement aux préconisations de la CIIVISE tout en les atténuant. En effet, la CIIVISE souhaitait que le retrait soit systématique et c’est d’ailleurs ce que prévoyait la proposition de loi dans sa version initiale. Celle-ci a été modifiée durant le parcours législatif pour introduire une appréciation minimum par le juge de la conformité du retrait de l’autorité parentale à l’intérêt de l’enfant. Cette modification permet d’assurer la conformité du texte à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui exige qu’une limitation des droits parentaux même dans un cadre pénal doit être appréciée au regard de l’intérêt de l’enfant [5]. Même si elles sont sans doute rares, on peut envisager des hypothèses où il n’est pas opportun pour l’enfant que son parent soit privé de droit sur lui, notamment lorsque le parent auteur du crime sur l’autre était la victime des violences conjugales.
Violences conjugales. À l’origine du texte, le domaine du retrait de principe de l’autorité parentale était applicable aux violences conjugales ayant donné lieu à une ITT de plus de huit jours. Face à l’hostilité d’un certain nombre de parlementaires, et le risque d’une disproportion entre la gravité de l’infraction et l’atteinte aux droits parentaux, les porteurs de la proposition de loi ont restreint le domaine du retrait de principe aux crimes et agressions sexuelles. Ce retrait mérite d’être salué car en étendant trop largement le domaine du retrait de principe de l’autorité parentale, le risque était qu’il soit peu appliqué.
Prononcé du retrait. Le retrait de l’autorité parentale quoique de principe n’est cependant pas automatique et il doit être prononcé par le juge. Ce prononcé est nécessaire pour choisir la portée de la privation des droits parentaux : retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou seulement retrait de son exercice. Ces trois choix sont hiérarchisés dans le texte : « le jugement ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale. » On peut émettre quelques craintes sur l’application effective du texte. En effet, jusqu’à présent, les juges avaient l’obligation de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale et ils ne s’y conformaient que rarement ; la nouvelle formulation du texte va-t-elle davantage les contraindre ? Si le juge ne prononce pas le retrait de l’autorité parentale on peut penser que le représentant de l’enfant – son autre parent, son administrateur ad hoc ou le délégataire de l’autorité parentale – pourrait intenter un recours contre cette absence de décision.
Prise en charge de l’enfant. Dans l’arrêt du 6 septembre 2023 [6] la Cour de cassation affirme que l'article 380 N° Lexbase : L8775MLL du Code civil imposant à la juridiction qui prononce le retrait de l'autorité parentale de désigner, si nécessaire, la personne à laquelle l'enfant sera confié ou de le confier au service de l'aide sociale à l'enfance, ne s'applique pas à la Cour d’assise qui prononce le retrait de l'autorité parentale à l'égard du condamné. Cette affirmation devrait s’appliquer au nouveau dispositif de retrait de l’autorité parentale issu de la loi du 18 mars 2024. Il conviendra alors, si l’autre parent est décédé ou dans l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale de mettre en place une délégation de l’exercice de l’autorité parentale en vertu des 3° et 4° de l’article 377 N° Lexbase : L6255MLA du Code civil tel qu’issu de la loi de 2024 à la demande de la personne ou du service à qui l’enfant est confié.
Retrait par le juge civil. En l’absence – illégale – de décision du juge pénal sur le retrait de l’autorité parentale, ou si ce dernier estime que celui-ci n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, le juge civil peut être saisi de la même demande sur le fondement de l’article 378-1 N° Lexbase : L5369LTZ du Code civil. Dans ce dernier cas, l’autorité de la chose jugée au pénal ne devrait pas empêcher le juge civil de prononcer le retrait de l’autorité parentale dès lors que selon, ce dernier texte, sa décision sera motivée par le danger « manifeste » encouru par l’enfant.
Exécution provisoire. L’article 228-1 du Code pénal précise que la décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, c’est-à-dire qu’elle s’applique dès son prononcé, et même si l’auteur forme un recours.
Autres enfants. L’article 228-1 du Code pénal prévoit en outre que le retrait de l’autorité parentale pourra être étendu aux autres enfants du parent condamné, sans que le juge ne soit tenu de se prononcer sur cette question. Sur ce dernier point, on peut noter que cette disposition est en contradiction avec l’article 379 N° Lexbase : L2993LUE du Code civil selon lequel « à défaut d'autre détermination, [le retrait] s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. »
III. La clarification du dispositif de limitation des droits du parent violent
La clarification du dispositif de limitation des droits du parent violent se traduit d’une part par l’amélioration de certains éléments du dispositif (A), et d’autre part par une réorganisation globale de ce dernier (B).
A. L’amélioration de certains éléments du dispositif
1) La suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement
Domaine. La suspension « de plein droit » de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement du parent violent au début de la procédure, déjà prévue par l’article 378-2 N° Lexbase : L8783MLU du Code civil en cas « de poursuite ou condamnation même non définitive « pour crime sur la personne de l’autre parent », a été étendue aux crimes ou agressions sexuelles sur l’enfant. Au départ, l’article 1er de la proposition de loi prévoyait également la mise en place d’une suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent condamné, même non définitivement, pour des faits de violences sur l’autre parent ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits. Mais cette hypothèse de suspension n’a pas été retenue dans la version finale du texte. Il aurait pu cependant être envisagé que cette suspension puisse être décidée de manière exceptionnelle par le procureur de la république (cf. infra).
Durée. La loi de 2024 a, en outre, modifié le régime de la suspension des droits parentaux en vue de faciliter sa mise en œuvre et garantir l’absence de relations entre l’enfant et le parent présumé auteur de violences graves pendant la procédure. L’ancien texte prévoyait que cette suspension courait « jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours. » Selon l’interprétation du texte, par la circulaire d’application et la pratique, la suspension était automatique, et le procureur devait seulement saisir le juge aux affaires familiales dans les huit jours pour obtenir une délégation de l’exercice de l’autorité parentale si l’autre parent était décédé ou la confirmation au fond d’un exercice exclusif de l’autorité parentale dans le cas contraire. La suspension de l’exercice de l’autorité parentale ne pouvait être notifiée au parent auteur des violences qu’au moment de la saisine du juge, faute d’autre acte pour constituer le support de cette notification.
Point de départ. Désormais, la suspension découle automatiquement de l’enclenchement des poursuites par le ministère public ou par la mise en examen par le juge d’instruction de l’auteur des violences. Dans les deux cas, la suspension est notifiée à l’auteur des violences dans le même acte que celui qui lui signifie soit sa convocation par le ministère public à une audience de comparution immédiate ou autre, soit sa mise en examen par le juge d’instruction. La suspension n’aura donc pas lieu en cas de classement sans suite.
Enquête. Il n’est pas prévu que la suspension des droits parentaux puisse intervenir pendant l’enquête préliminaire, ce qui a pu susciter des critiques. Il apparaît cependant qu’une suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale dès le début de l’enquête constituerait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale du parent mis en cause et à la présomption d’innocence. Il paraît plus conforme aux droits et libertés fondamentales de mettre en place la suspension des droits parentaux seulement lorsqu’est établie la réalité des soupçons suffisants pesant sur l’auteur présumé des violences. Cette suspension des droits parentaux aurait pu cependant intervenir de manière exceptionnelle par décision du ministère public pour protéger l’enfant et son parent de manière immédiate lorsque l’auteur des violences risque de les réitérer. Ce pouvoir exceptionnel reconnu au ministère en cas d’urgence serait comparable à celui qui lui permet de rendre une ordonnance de placement provisoire pour protéger un enfant d’un danger grave et imminent [7]. Cette suspension exceptionnelle des droits parentaux pendant l’enquête pourrait fonctionner de la même manière que l’ordonnance de placement provisoire, le procureur de la république qui rend la décision devant saisir le juge compétent dans les huit jours - le juge des enfants pour le placement, le juge aux affaires familiales pour la suspension des droits parentaux - pour qu’il infirme ou confirme sa décision.
Terme. Le régime de la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement évolue également à travers la modification de son terme. Alors qu’auparavant, la suspension cessait soit au moment où le juge aux affaires familiales, obligatoirement saisi par le ministère public, rendait sa décision, soit automatiquement au bout de six mois, le nouveau texte permet indirectement de faire perdurer la suspension jusqu’à la fin de la procédure. En effet le texte prévoit d’abord que la suspension perdure jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales « saisi le cas échéant par le parent poursuivi ». En effet, dès lors que la saisine du juge aux affaires familiales par le parquet n’est pas plus obligatoire, celui-ci ne sera pas saisi de manière systématique. Seule la personne poursuivie aura intérêt à saisir le juge aux affaires familiales pour lui demander de faire cesser la suspension. Le juge aux affaires familiales devra alors décider s’il maintient ou non la suspension, ce qui n’est pas la même chose que de décider s’il la met en place ou non. Hormis l’hypothèse du parent qui s’est défendu des violences de l’autre, on ne voit pas trop ce qui pourrait inciter le juge aux affaires familiales à faire cesser la suspension des droits parentaux alors que le parent est soupçonné de faits particulièrement graves et qu’on peut présumer qu’il représente un danger pour l’enfant. Il est plus probable que le juge aux affaires familiales maintienne la suspension des droits jusqu’à la fin de la procédure pénale. Si l’auteur des violences ne saisit pas le juge aux affaires familiales, aucun délai n’est prévu par le texte et la suspension perdure jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision – de condamnation ou d’acquittement – de la juridiction de jugement. Cette modification a suscité la réticence des sénateurs. Elle a cependant été acceptée dans le cadre de la commission paritaire « en espérant que les JAF auront à se prononcer rapidement sur ces suspensions lorsqu’elles ne sont pas dans l’intérêt de l’enfant. » Si la procédure aboutit à une condamnation du parent, c’est le prononcé du retrait de l’autorité parentale ou de son exercice qui succèdera à la suspension de ce dernier. En cas de non-lieu ou d’acquittement, le parent retrouve ses droits, et il conviendra en cas de persistance d’un danger pour l’enfant, de saisir rapidement le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants pour protéger l’enfant et le parent victime, par un exercice exclusif de l’autorité parentale ou un placement, notamment dans l’hypothèse où la fin de la procédure est uniquement fondée sur un défaut de preuves des faits allégués.
Changement de résidence. Selon la loi du 18 mars 2024, l’obligation d’un parent d’informer l’autre de tout changement de résidence, contenue dans l’article 373-2 N° Lexbase : L8774MLK du Code civil, est écartée pour le parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 N° Lexbase : L8100MAA, si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent. Cette disposition aboutit concrètement à empêcher le parent violent d’entrer en contact avec l’autre parent et ses enfants et constitue un corollaire bienvenu à la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite.
2) La clarification du régime de la délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale
Parent seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. Le législateur a réécrit de façon plus lisible l’article 377 N° Lexbase : L8782MLT du Code civil relatif à la délégation de l’exercice de l’autorité parentale. Celui-ci énumère désormais plus clairement les quatre cas de délégation forcée : d’une part le désintérêt des parents ou leur impossibilité d’exercer l’autorité parentale, et d’autre part des poursuites, par le procureur de la République, ou une mise en examen par le juge d’instruction d’un parent soit pour un crime commis sur l’autre parent ayant entrainé la mort de celui-ci, soit pour un crime ou une agression sexuelle commise sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. Cette dernière hypothèse a été rajoutée par la loi du 18 mars 2024. Dans les deux derniers cas, la délégation de l’exercice de l’autorité parentale n’est envisagée que dans les cas où l’autre parent n’exerce pas l’autorité parentale, ce qui est logique car dans le cas contraire c’est ce dernier qui exercera seul cette autorité. Les 3° et 4° de l’article 377 sont donc destinés à permettre au service ou à la personne qui a recueilli l’enfant de se voir transférer les prérogatives nécessaires pour assurer la prise en charge de celui-ci sans avoir à composer avec le parent auteur du crime ou de l’agression sexuelle, en attendant, le cas échéant, un retrait de l’autorité parentale au moment de la condamnation de ce dernier.
B. La mise en place d’un dispositif gradué et cohérent
Regroupement. Formellement, la clarification du dispositif de limitation des droits parentaux par le juge pénal passe par la suppression des dispositions éparses relatives au retrait de l’autorité parentale ou de son exercice dans la Code pénal, pour les remplacer par un chapitre VIII du Code pénal qui lui est spécifiquement consacré, dans le titre sur les atteintes à la personne humaine et après le chapitre sur les atteintes au mineur et à sa famille.
Gradation. L’article 228-1 du Code pénal issu de la loi du 18 mars 2024 améliore la visibilité du dispositif de limitation des droits du parent violent en distinguant trois situations et en prévoyant pour chacune le régime du retrait de l’autorité parentale. Le texte prévoit une gradation de la limitation des droits parentaux selon la gravité de l’infraction. Même si cela implique de reprendre certains points évoqués plus haut, il paraît opportun de présenter le dispositif de la limitation des droits parentaux en son entier : aux différentes étapes de la procédure et après celle-ci, tel qu’il ressort désormais des différents textes, du Code pénal et du Code civil, relatifs à la limitation des droits parentaux.
Crime ou agression sexuelle. En cas de crime sur l’autre parent, sur l’enfant ou une agression sexuelle sur ce dernier, une suspension automatique des droits parentaux est prévue lors des poursuites, et le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice est de principe en cas de condamnation. En outre, une délégation de l’exercice de l’autorité parentale pourra être prononcée en cours de procédure si l’autre parent n’exerce pas l’autorité parentale ou est décédé.
Délit sur la personne de l’enfant. En cas de délit sur la personne de l’enfant autre qu’une agression sexuelle, la suspension des droits parentaux n’est pas prévue au moment des poursuites, mais elle peut être demandée au juge aux affaires familiales. Lors de la condamnation, le juge doit se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice sans être obligé de prononcer celui-ci.
Violences conjugales. En cas de délit de violences sur l’autre parent ou si la personne poursuivie est coautrice d’une infraction commise sur l’enfant, la suspension des droits parentaux au moment des poursuites n’est pas prévue – elle peut là encore être demandée au juge aux affaires familiales - et lors de la condamnation le juge pénal peut se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice sans y être obligé.
Restitution de l’autorité parentale. Le Sénat a introduit en commission un article additionnel qui clarifie l’article 381 N° Lexbase : L8784MLW du Code civil en distinguant les modalités de restitution des droits attachés à l’autorité parentale selon que le retrait porte sur l’autorité parentale ou sur son exercice. Ainsi, si la demande de restitution ne peut être formée qu’à l’issue d’un délai d’un an après que la décision de retrait est devenue irrévocable en cas de retrait total de l’autorité parentale, ce délai n’est que de six mois lorsque le retrait porte sur l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 du Code civil, c’est-à-dire en cas d’infraction pénale commise sur l’enfant ou son autre parent ou en cas de danger manifeste pour l’enfant. Cette rédaction introduit une gradation entre les hypothèses de limitations de l’exercice de l’autorité parentale. Pour éviter que cette restriction à la restitution de l’exercice de l’autorité parentale ne soit contournée, aucune demande de modification ne pourra être présentée au JAF, avant six mois, dans le cadre de sa compétence de droit commun en matière d’autorité parentale [8].
[1] Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants N° Lexbase : L7042IMR ; loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes N° Lexbase : L9079I3N ; loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille N° Lexbase : L2114LUT, v. I. Corpart, Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales, Lexbase Droit privé, janvier 2020, n° 809 N° Lexbase : N1877BY8 ; et loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales N° Lexbase : L7970LXH, v. A. Gouttenoire, La loi du 30 juillet 2020 : un nouveau pas dans la protection civile de toutes les victimes de violences conjugales, Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 836 N° Lexbase : N4539BYR.
[2] A. Gouttenoire, La coparentalité à l’épreuve des violences conjugales, in A. Gogos-Gintrand et S. Zeidenberg dir.), Une décennie de mutations en droit de la famille, Dalloz, Thèmes commentaires et études, 2021 p.185-195.
[3] Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-85.904, F-P+B N° Lexbase : A7041WLD, Lexbase hebdo, éd. droit privé, 14 déc. 2017, n° 723. C. assises Tarn et Garonne, 19 mai 2016, n° 4 bis/2016 ; C. assises Gironde, 18 oct. 2017, cités par C. Quennesson, Le retrait de l’autorité parentale par le juge pénal en cas de crime d’un parent sur l’autre, Lexbase hebdo, droit privé, 14 déc. 2017 ; Cass. crim., 6 septembre 2023, n° 22-87.022, F-D N° Lexbase : A13241G7 ; Cass. crim., 21 juin 2023, n° 22-82.287, F-D N° Lexbase : A430994D.
[4] Cass. crim., 21 juin 2023 préc.
[5] CEDH, 28 septembre 2004, Req. n° 46572/99, Sabou et Pircalab c/ Roumanie N° Lexbase : A4446DDZ ; CEDH, 30 juin 2009, Req. n° 75109/1 et 12639/02, Viorel Burzo c/ Roumanie [en ligne] ; CEDH, 1 juillet 2008, Req. n° 42250/02, Calmanovici c/ Roumanie N° Lexbase : A0856EAX ; CEDH, 14 octobre 2008, Req. 6817/02, Iordache c/ Roumanie N° Lexbase : A7328EAN ; CEDH, 17 juillet 2012, Req. n° 64791/10, M.D. et autres c/ Malte [en ligne] en anglais, Dr. fam. 2013, étude n° 3, obs. A. Gouttenoire.
[6] préc. Cass. crim., 6 septembre 2023, n° 22-87.022, F-D N° Lexbase : A13241G7.
[7] C. civ., art. 375-5, al. 2 N° Lexbase : L4936K8C.
[8] C. civ., art.381 N° Lexbase : L8784MLW al.2 du Code civil qui renvoie à l’article 373-2-13 N° Lexbase : L2594LBP du Code civil, selon lequel « les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge » notamment à la demande d’un parent.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488913
[Brèves] Publication de la loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus
Réf. : Loi n° 2024-247, du 21 mars 2024, renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux N° Lexbase : L8964MLL
Lecture: 4 min
N8897BZK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 27 Mars 2024
► La loi n° 2024-247, du 21 mars 2024, renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, publiée au Journal officiel du 22 mars 2024, vise notamment à accroître les sanctions encourues par les auteurs de faits de violences commis à leur encontre.
La protection contre les violences. Pour mieux protéger les élus en cas de violences commises à leur encontre (titre Ier), celles-ci, lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (dans la limite de six ans à compter de l'expiration du mandat). Toute destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à l’un de ces élus en cette qualité est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.
Les paroles, gestes ou menaces dont ils font l’objet constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général. Le fait de les harceler par des propos ou comportements répétés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à leur vie privée, familiale ou professionnelle pendant la durée de la campagne électorale, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La prise en charge des élus victimes. La loi a aussi pour objectif d’améliorer la prise en charge des élus victimes de violences, d’agressions ou d’injures dans le cadre de leur mandat ou d’une campagne électorale (titre II). Ainsi, la commune accorde sa protection (fonctionnelle) au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
Toutefois, le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune (sur le modèle du retrait d’une décision individuelle explicite créatrice de droits illégale, CE, ass., 26 octobre 2001, n° 197018 N° Lexbase : A1913AX7).
Cette protection implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection.
Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection auquel il participe, de cette protection assurée par l'État. Celui-ci assure notamment la protection de l'intégrité physique du candidat.
Le rôle des acteurs judiciaires et étatiques. Le texte vise enfin à renforcer la prise en compte des réalités des mandats électifs locaux par les acteurs judiciaires et étatiques (titre III). Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel.
Dorénavant, le maire est systématiquement (et non plus à sa demande) informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés.
Il est aussi systématiquement (et non plus à sa demande) informé, dans un délai d'un mois, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui.
Des conventions prévoyant un protocole d'information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des élus peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République.
Signalons enfin que le procureur de la République du ressort de la cour d'appel compétent sur le territoire de la commune peut diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune, lorsque celle-ci compte plus de 1 000 habitants.
| À ce sujet : lire le numéro spécial La protection du mandat des élus locaux avec le cabinet Seban Avocats, Lexbase Public, décembre 2023, n° 729 N° Lexbase : N7744BZT. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488897
[Brèves] Revirement sur la décennale appliquée aux éléments d’équipements sur existants
Réf. : Cass. civ. 3, 21 mars 2024, n° 22-18.694 FS-B+R N° Lexbase : A24682WC
Lecture: 5 min
N8919BZD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 27 Mars 2024
► Revirement de jurisprudence : si les éléments d’équipement installés en remplacement ou pas adjonction sur un ouvrage existant ne sont pas eux-mêmes un ouvrage, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
À force de persévérance, chacun peut soulever une montagne, proverbe chinois.
Multipliant les occasions de saisir la Haute juridiction de cette question, les détracteurs de la jurisprudence constante depuis 2017 sur ce que certains ont appelé les quasi-ouvrages, ont fini par être entendus. INRI ?
1. Rappel de la jurisprudence antérieure sur les éléments d’équipement sur existant
Depuis l’arrêt cité dans la décision rapportée rendue le 15 juin 2017 (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6831WHH), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a opéré, ce que beaucoup qualifient, de revirement de jurisprudence. Ce n’est pourtant pas complètement le cas. Auparavant, pour que la responsabilité décennale s’applique, il fallait que les travaux sur existant fussent, eux-mêmes, qualifiés d’ouvrage. La jurisprudence se fondait sur plusieurs critères, tels que l’ampleur des travaux (pour exemple, le cas d’une rénovation lourde, Cass. civ. 3, 29 janvier 2003, n° 01-13.034, FS-P+B N° Lexbase : A8328A49), l’immobilisation dans un ouvrage existant (pour exemple, le cas d’un silo intégré au bâtiment par soudure, Cass. civ. 3, 8 juin 1994, n° 92-12.655, inédit au bulletin N° Lexbase : A7265CPR) ou encore le critère de reprise d’une partie d’ouvrage assurant une fonction de clos et de couvert (pour exemple, le cas d’une reprise de toiture, Cass. civ. 3, 8 octobre 2014, n° 13-21.807, FS-D N° Lexbase : A2128MYH). Mais, dans certaines situations, les juges appliquaient la responsabilité décennale à des désordres aux éléments d’équipement, même dissociables (CA Montpellier, 9 mars 1999, n° 95/0007479 N° Lexbase : A6955XCL) lorsqu’ils rendaient l’ouvrage lui-même impropre à sa destination (par exemple pour des canalisations, Cass. civ. 3, 3 décembre 2002, Constr. Urb. 2002, p.125, ou du chauffage Cass. civ. 3, 10 mars 1981, n° 80-10.069 N° Lexbase : A8898CGN, JCP 1981, IV, 190, ou encore une climatisation Cass. civ. 3, 20 novembre 1984, JCP 1985, IV, 42). L’élément déterminant était, l’affectation de la solidité ou, le plus souvent, l’impropriété à la destination de l’ouvrage lui-même, le caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement étant indifférent (Cass. civ. 3, 23 janvier 1991, n° 88-20.221 N° Lexbase : A2626ABU).
Les arrêts rendus par la Haute juridiction depuis juin 2017 ne faisaient que stigmatiser ces solutions, par le truchement d’un attendu de principe selon lequel les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6831WHH ; Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-17.323, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6554WR8 ; Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, n° 16-18.120, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8797WWQ ; Cass. civ. 3, 14 décembre 2017, n° 16-10.820, FS-D N° Lexbase : A1265W8D et Civ.3ème 25 janvier 2018, n° 16-10.050, F-D N° Lexbase : A8526XBE). La Cour de cassation a tenu à en faire état dans le Bulletin d’information du 1er décembre 2017 : « désormais, tous les dommages, de la gravité requise par l’article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale, qu’ils affectent des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ». La souplesse du critère de l’impropriété à destination autorise, une nouvelle fois, l’extension du champ d’application de la responsabilité décennale.
Dans le prolongement, l’assurance RCD devait être souscrite (Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, préc.).
Ce principe ne s’applique que pour les éléments d’équipement qui fonctionnent. Ce régime extensif ne s’applique, toutefois, que si l’élément d’équipement à vocation à fonctionner. Les désordres, quelle que soit leur gravité, affectant un élément d’équipement non destiné à fonctionner, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur (Cass. civ. 3, 13 février 2020, n° 19-10.249, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A75253EG).
2. Revirement de jurisprudence
La Haute juridiction se justifie de ce qu’elle appelle un revirement.
Ces jurisprudences avaient, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon l’élément d’équipement d’origine ou seulement adjoint à l’existant, lorsque les dommages l’affectant rendaient l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination.
Elles visaient aussi, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres d’ouvrage, qui réalisent de plus en plus de travaux de rénovation ou de réhabilitation.
Mais ces objectifs n’ont pas été atteints.
Elle décide donc d’y renoncer. Désormais, si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement et ce quel que soit le critère de gravité des désordres. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun à vocation à s’appliquer.
Le principe est applicable aux instances en cours.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488919
[Brèves] Caractérisation de l’interdépendance contractuelle et effets de la caducité
Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2024, n° 22-21.451, FS-B N° Lexbase : A05032U8
Lecture: 4 min
N8923BZI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 29 Mars 2024
► La caducité des contrats appartenant à un même ensemble contractuel peut être rétroactive dès lors que les contrats n’ont pas été entièrement exécutés.
En ce début d’année 2024, les ensembles contractuels sont sous le feu des projecteurs. Après avoir envisagé, il y a quelques semaines, le sort des clauses de divisibilité, la Cour de cassation se prononce aujourd’hui sur la caractérisation de l’ensemble et les effets de l’anéantissement d’un contrat sur les autres contrats de l’ensemble (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466, FS-B+R N° Lexbase : A2729784 ; v. Aurélie Dardenne, Application de la caducité dans les ensembles contractuels : rien de nouveau sous le soleil, Lexbase Droit privé, mars 2024, n° 978 N° Lexbase : N8819BZN). En matière d’ensembles contractuels, les faits sont souvent complexes. Ceux ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 13 mars 2024 n’y font pas exception.
Faits et procédure. En l’espèce, le client d’une banque avait souscrit, par l’intermédiaire de cette dernière, un contrat d’assurance-vie, lequel était abondé grâce à des sommes versées par cette même banque au titre de différents prêts. Quelques années plus tard, le client exerce sa faculté de renonciation (C. ass., art. L. 132-5-1 N° Lexbase : L9567LGG), dont la mise en œuvre a été considérée comme valable. Sur renvoi après cassation, les juges du fond avaient caractérisé l’existence d’une interdépendance contractuelle entre l’assurance-vie et les crédits ayant permis d’abonder celle-ci. S’agissant de l’anéantissement des contrats de prêt consécutif à la caractérisation de l’ensemble contractuel, ils ont admis la rétroactivité de la caducité (CA Paris, 28 juin 2022, n° 20/07437 N° Lexbase : A1288794). Deux points faisaient débat : la caractérisation de l’interdépendance et les effets de celle-ci.
Caractérisation de l’interdépendance. Le pourvoi reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le contrat d’assurance-vie et les contrats de prêt ne pouvaient pas être exécutés indépendamment les uns des autres. Pour récuser l’argument, la Cour de cassation relève un certain nombre d’éléments : la banque qui était la seule interlocutrice du client car elle agissait non seulement en qualité de prêteur mais également de courtier, la présence du logo de la banque sur le bulletin d’adhésion signé par l’assuré, la concomitance et la durée des prêts calquées sur l’assurance-vie. En outre, la cour d’appel avait constaté que « la commune intention des parties était de rendre leurs conventions interdépendantes, peu important qu’elles fussent matériellement exécutables indépendamment les unes des autres » (rappr. sous l’empire du droit nouveau inapplicable aux faits de l’espèce, C. civ., art. 1186 N° Lexbase : L0892KZ3). Mais ce n’est sans doute pas là que réside l’apport essentiel de l’arrêt.
Effets de la caducité : rétroactivité ? La caducité (rappr. Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 02-18.277, FS-P+B N° Lexbase : A9591DNK) peut produire des effets rétroactifs. La solution était admise sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, ce que le nouvel article 1187 N° Lexbase : L0891KZZ ne semble pas remettre en cause en se contentant d’évoquer la « fin du contrat », analyse d’ailleurs corroborée par l’alinéa 2 qui admet qu’elle puisse donner lieu à restitutions. Dès lors, y avait-il lieu à prononcer l’anéantissement rétroactif des prêts, et ce faisant, la restitution au client des intérêts qu’il avait payés ? La Cour de cassation donne le critère : la caducité ne peut avoir lieu que si « les contrats caducs n’ont pas été entièrement exécutés à la date d’exercice de la faculté de renonciation ». Or, en l’espèce, l’ensemble des prêts, à l’exception d’un, avaient été entièrement exécutés. Les restitutions sont donc neutralisées. L’arrêt d’appel qui avait admis la rétroactivité, est donc cassé au visa de l’ancien article 1134 du Code civil.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488923
[Pratique professionnelle] Les clauses de propriété intellectuelle dans le contrat de travail
Lecture: 19 min
N8862BZA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Katia Beider, Avocate en propriété intellectuelle et droit du numérique, fondatrice du cabinet Beider Avocat
Le 27 Mars 2024
Mots clés : propriété intellectuelle • salarié • création salariée • cession • droit d’auteur • innovation • risques juridiques • contrat de travail • régime des créations salariées
L’objet de cet article est de s’intéresser à l’épineuse question de l'encadrement contractuel du travail des salariés lorsque celui-ci est protégeable par la propriété intellectuelle, en particulier par le droit d'auteur.
L’analyse se divise autour de quatre axes : les règles de protection des œuvres par le droit de propriété intellectuelle, les règles de cession des droits à l’employeur ainsi que l’encadrement contractuel de cette cession et enfin une présentation des risques liés à la création d’œuvres par des salariés.
Comment encadrer le travail des salariés lorsque celui-ci est protégeable par la propriété intellectuelle ? Et plus particulièrement par le droit d’auteur ? Existe-t-il des cessions automatiques au profit des employeurs ? Ce travail découle-t-il automatiquement de l’exécution du contrat de travail ?
Pour répondre à ces interrogations, nous ferons d’abord un bref rappel des règles de protection des œuvres par le droit de la propriété intellectuelle (I.), pour ensuite nous intéresser à la cession de ces droits à l’employeur (II.), suivi d’une grille des mentions à prévoir pour que la cession ait lieu en bonne et due forme au profit de l’employeur (III.).
Nous nous intéresserons enfin à l’épineuse question des risques engendrés par la création d’œuvres par le salarié (IV.).
I. La protection des œuvres par le droit de la propriété intellectuelle : rappel des règles
Le droit d’auteur protège [1] :
- du seul fait de leur création « toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » ;
- sans formalité de dépôt
Le droit d’auteur protège ainsi tout type d’œuvre, qu’il s’agisse d’écrits, d’œuvres graphiques et plastiques, de photographies, de compositions musicales, de logiciels, de matériel pédagogique ou encore de créations des industries saisonnières de l’habillement [2].
Attention, toutefois, si le dépôt n’est pas obligatoire, il est fortement recommandé de se constituer des preuves (par exemples : enregistrement d’une enveloppe Soleau auprès de l’INPI, actes d’huissier, enregistrement sur la blockchain, envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email).
Les conditions positives suivantes doivent être réunies pour ouvrir droit à la protection par le droit d’auteur :
- l’œuvre doit être tangible : il doit s’agir d’une création de forme (on ne protège ni les idées ni les concepts) ;
- l’œuvre doit résulter d’une activité humaine consciente ;
- l’œuvre doit être originale, c’est-à-dire être empreinte de la personnalité de son auteur.
Les droits patrimoniaux durent jusqu’à :
- 70 ans après la mort de l’auteur [3] ;
- ou 70 ans après la divulgation de l’œuvre en cas d’œuvre collective [4].
Les droits moraux sont perpétuels.
De nombreuses œuvres sont créées par des salariés dans le cadre de leurs missions.
L’encadrement de ces créations a alimenté la doctrine et les tribunaux depuis de nombreuses années, amenant l’interrogation suivante : existe-t-il une cession automatique des droits au profit de l’employeur ?
II. La cession des droits du créateur-salarié au profit de son employeur
Par principe, seul le créateur d’une œuvre originale est titulaire de droits [5].
Il n’existe donc pas de cession automatique des droits du créateur-salarié au profit de son employeur, peu important que les œuvres aient été créées dans le cadre des fonctions salariales.
Il existe néanmoins deux exceptions à ce principe : le droit d’auteur sur les logiciels [6] ainsi que le régime des œuvres collectives [7] qui appartiennent à l’employeur par application de la loi.
En pratique, s’agissant des œuvres collectives, il est recommandé de :
- se constituer des preuves écrites d’instructions précises données au salarié par l’employeur ;
- éviter que les contributions de chaque salarié soit identifiable dans l’œuvre pour que celle-ci bénéficie bien du régime d’œuvre collective.
S’agissant des logiciels, il est recommandé de :
- s’assurer que les développements se font sur instructions de l’employeur ;
- décrire dans le contrat de travail que la création de logiciels est inhérente au poste.
L’auteur dispose de droits patrimoniaux (droits économiques d’exploitation) ainsi que de droits moraux exclusifs et opposables à tous.
Les droits patrimoniaux peuvent être cédés tandis que les droits moraux sont incessibles et inaliénables, car ils sont attachés à la personne de l’auteur.
D’une part, tout créateur-salarié bénéficie des droits patrimoniaux suivants [8] :
- droit de reproduction ;
- droit de représentation.
D’autre part, tout créateur-salarié bénéficie des droits moraux suivants [9] :
- droit à la paternité de l’œuvre ;
- droit au respect de l’intégrité de l’œuvre ;
- droit de première divulgation de l’œuvre ;
- droit de retrait et repentir (sous réserve d’indemnisation).
Le droit d’auteur ne peut être cédé que par écrit [10].
L’employeur doit donc signer un contrat de cession de droits avec son salarié.
En pratique, l’employeur prévoit une cession de droits directement dans le contrat de travail.
III. L’encadrement de la cession contractuelle au profit de l’employeur : mentions à prévoir et cas d’école
A. Les mentions obligatoires
Les mentions obligatoires à prévoir pour que la clause de cession soit valide sont les suivantes :
- des créations identifiées ;
- une liste détaillée des droits patrimoniaux cédés avec une mention distincte par droit cédé (exemples : droit de traduction, d’adaptation, de distribution ?) ;
- l’étendue du domaine d’exploitation des créations :
- modes de diffusion des droits cédés (exemple : exploitation numérique via des sites web) ;
- destination de ces droits (qui va avoir accès aux œuvres ?) ;
- le lieu de diffusion géographique (le monde entier ?) ;
- la durée de la cession des droits (la durée du contrat de travail ?) ;
- les modalités de calcul de la rémunération de l’auteur cédant ses droits (rémunération proportionnelle ou forfaitaire ?)
B. La prohibition des cessions globales des œuvres futures
L’obligation d’identifier les créations objet de la cession découle du principe d’interdiction de cession globale des œuvres futures [11].
Ce principe fragilise nombre de clauses de cession de propriété intellectuelle présentes dans les contrats de travail, car le créateur-salarié n’a pas encore créé d’œuvre au moment où il signe son contrat de travail.
En pratique, l’on voit fréquemment des clauses prévoyant une cession des œuvres au fur et à mesure de leur réalisation.
Dès lors, ce type de clause est-elle valide ?
En ce sens, la cour d’appel de Paris a rendu en 2023 une décision fortement commentée dans laquelle elle indiquait qu’une clause de cession est licite dès lors qu’elle porte sur des œuvres déterminables et individualisables, réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail et cédées au fur et à mesure de leur réalisation [12].
En l’espèce, une styliste de mode avait conclu un contrat de travail avec une société dont elle était actionnaire minoritaire. La société employeur avait autorisé des sociétés tierces à exploiter les créations dans le cadre d’une licence qu’elle leur avait consentie. La salariée avait alors assigné son employeur pour contrefaçon de ses créations et absence de rémunération complémentaire au titre de la soi-disant cession. La créatrice-salariée considérait la clause de cession de droit d’auteur figurant dans son contrat de travail et portant sur les œuvres créées dans le cadre de ses fonctions comme nulle, car portant sur des œuvres futures.
La clause litigieuse prévoyait une cession « de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle [...] relatifs aux créations réalisées dans le cadre du présent contrat, au fur et à mesure de leur réalisation ».
La cour d’appel a rejeté cette demande en considérant la clause de cession comme licite.
Si l’on reprend les mentions obligatoires présentées ci-avant, on peut en déduire que :
- la cession étant réalisée sur les œuvres créées dans le cadre des fonctions salariales, elle est donc délimitée à des œuvres précises. On peut donc arguer qu’il n’y a pas de cession globale ;
- elle est également délimitée dans le temps puisqu’elle n’est valable que pour les œuvres créées pendant la durée du contrat de travail. Elle n’est donc pas perpétuelle.
À noter, la cession est définitive et continue à produire ses effets après le départ du salarié [13]. L’auteur bénéficiera néanmoins toujours de droits moraux puisque ces derniers sont incessibles, inaliénables et perpétuels.
En cas de cession, celle-ci englobe la totalité des droits patrimoniaux énumérés dans la clause [14]. Les employeurs doivent donc être vigilants et prévoir à l’écrit l’ensemble des hypothèses pouvant se présenter.
Néanmoins, afin de ne pas freiner l’innovation et le commerce, le Code de la propriété intellectuelle accepte que la cession comporte une référence à l’exploitation sous une forme imprévisible sous réserve de faire participer le créateur-salarié aux profits d’exploitation :
« La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation » [15].
Cette clause peut être très utile dans le développement des nouvelles formes d’exploitation tel que l’avènement récent des « NFT » (non-fongible token) et de l’exploitation d’œuvres sous forme virtuelle.
C. La rémunération de la cession de droit d’auteur
Si la cession de droit d’auteur peut être faite gratuitement, elle semble difficile à défendre dans le cadre d’une relation salarié-employeur du fait de l’existence d’un lien de subordination.
Par principe, le créateur-salarié doit bénéficier d’une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre [16].
La clause de cession doit dès lors obligatoirement mentionner cette rémunération.
Par exception, si cette rémunération proportionnelle ne peut être déterminée, l’employeur et le créateur-salarié peuvent prévoir une rémunération forfaitaire [17].
S’agissant du calcul de cette rémunération au titre de la cession de droits d’auteur, une partie de la doctrine considère que pour être licite, la clause de cession doit prévoir une ventilation entre la rémunération pour le travail et la rémunération au titre des droits d’exploitation cédés, la simple référence au salaire versé au titre du contrat de travail n’étant pas suffisante [18].
Or, en pratique, dans la majorité des industries (exceptions faites de l’audiovisuel, de l’édition et de l’industrie musicale), l’employeur intègre généralement la rémunération au terme du droit d’auteur directement au salaire du créateur-salarié.
Dans la décision précitée du 25 janvier 2023 de la cour d’appel de Paris [19], les juges du fond ont considéré que la rémunération était certes non distincte du salaire, mais que :
- le salaire de la styliste avait été revalorisé ;
- qu’elle bénéficiait d’une rémunération variable en fonction des résultats obtenus au regard des objectifs arrêtés par la société ;
- et qu’enfin elle percevait des dividendes, car elle était associée.
Qu’ainsi, ces éléments incluaient nécessairement la cession de droits d’auteur.
Surtout, les juges du fond énoncent clairement qu’: « une rémunération forfaitaire n’opérant pas de distinction entre la rémunération de la prestation de travail et la contrepartie de la cession des droits d’auteur est licite ».
La règle est dès lors posée : la distinction n’est pas obligatoire en droit.
Cette analyse juridique a été vivement critiquée par une partie de la doctrine qui y trouve un éloignement de la lettre et de l’esprit de la loi [20]. En effet, rien n’indiquait expressément dans la clause que la salariée serait rémunérée au titre de la cession via son salaire.
En ce sens, la doctrine indique que : « la cause du salaire peut en effet être à la fois le travail et la rémunération de la propriété intellectuelle. Mais c'est seulement si le contrat le précise, faute de quoi il faut revenir à la séparation entre la rémunération du travail et le prix, contrepartie d'un transfert de droit qui ne peut être qu'exprès. Les prestations respectives des parties doivent être identifiées et équilibrées ».
L’interprétation est dès lors ouverte et il n’y a pas de solutions clé en main sur le sujet, mais bien des analyses judiciaires au cas par cas.
La prudence voudra que les employeurs appliquent néanmoins une réelle distinction entre la rémunération au titre de la cession de droits d’auteur et le salaire versé en contrepartie du travail du salarié ou du moins prévoit expressément que la rémunération de la cession est incluse dans le salaire.
IV. Quels sont les risques lorsque le salarié crée des œuvres ?
Lorsqu’un salarié crée des œuvres dans le cadre de ses fonctions, il faut s’assurer dans la clause de cession qu’il :
- demande l’autorisation de l’employeur avant d’utiliser des outils tiers pour ses créations ;
- s’interdise de recourir à des outils tiers pour créer des éléments qu’il cède sauf s’il obtient en amont l’autorisation de les exploiter à des fins commerciales ;
- s’engage à indemniser l’employeur contre toute action en violation de droits de propriété intellectuelle intentée par un tiers et portant sur les œuvres cédées.
En outre, les employeurs doivent être vigilants à la diffusion publique d’œuvres créées par des salariés dans le cadre de leurs fonctions.
Une bonne pratique consiste à prévoir au contrat l’interdiction de diffusion d’œuvres collectives en ce que cette diffusion serait contraire au secret professionnel.
En ce sens, les juges du fond ont déjà pu juger que l’avertissement était une sanction proportionnée au manquement commis par un salarié qui avait participé à une œuvre collective et l’avait diffusée sur son site internet de web designer pour proposer ses propres services [21].
Au regard de ce qui précède, les employeurs doivent s’assurer de la présence de clauses de cession de droits de propriété intellectuelle précises et complètes dans leur contrat de travail afin de pouvoir exploiter librement les créations faites par leurs salariés dans le cadre de leurs fonctions.
Ces clauses de cession devront préciser et détailler l’ensemble des droits cédés et des domaines d’exploitation envisagés ainsi que souligner le fait que la contrepartie financière de la cession est soit comprise dans le salaire du créateur-salarié soit opérer une ventilation entre la rémunération due au titre du travail et celle due au titre de la cession.
ANNEXE : Exemple non exhaustif de clause de propriété intellectuelle dans le contrat de travail
Identification des créations cédées :
Le/La Salarié(e) peut être amené(e) à élaborer ou participer à l’élaboration de créations protégées par des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de ses fonctions, notamment (partie à réadapter selon la réalité opérationnelle : œuvres graphiques, plastiques, œuvres photographiques, logiciel (en code objet et en code source) œuvres de l’industrie du textile et de l’habillement) (« les Créations »).
Durée et lieu de la cession :
À ce titre, il/elle cède à l’Employeur, à titre exclusif, pour le monde entier, l’ensemble des droits d’exploitation qu’il/elle détient sur les Créations, au fur et à mesure de la réalisation des Créations, ainsi que sur tous les éléments ayant servi à leurs conceptions, pour la durée légale de protection desdites Créations comme prévu par la législation française et les conventions internationales applicables.
Le/la Salarié(e) s’interdit d’utiliser tout ou partie des Créations cédées pour son propre compte ou au profit d’un tiers, sauf accord préalable exprès de l’Employeur.
Liste détaillée des droits patrimoniaux cédés, étendue, destination et modes de diffusion :
Les droits cédés comprennent notamment :
Le droit de reproduction : le droit de fixer, faire fixer, reproduire ou de faire reproduire, dupliquer, imprimer, télécharger, compresser, numériser, enregistrer, faire enregistrer tout ou partie des Créations ainsi que leurs adaptations en tous formats, y compris en format NFT et autres représentations virtuelles, et ce en nombre illimité, par tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour et, pour les bases de données, leurs évolutions et mises à jour, pour une exploitation de manière isolée ou avec d’autres éléments, sans limitation de nombre, en tout ou partie, par tous moyens de procédés, sur tout support permettant de stocker de manière permanente ou provisoire les Créations, que ce soit des supports mécaniques, analogiques, magnétiques, électroniques, numériques, par téléchargement, sur vidéogrammes, pour une consultation en ligne via notamment des sites internet, des applications mobiles, ou hors ligne, sur des smartphones, tablettes numériques, CD-Rom, DVD, Blu-ray Disc, disques durs, disques numériques, disquettes, bandes, listings, bases de données, microfilms, cartes Sim, clés USB, Memory cards, mémoire flash, SD cards et assimilés ou tous autres types de supports virtuels .
Le droit de représentation : le droit de représenter ou de faire représenter, mettre en circulation, distribuer, communiquer ou faire communiquer au public, tout ou partie des Créations, ainsi que leurs adaptations et traductions, , en tous formats y compris en format NFT et autres représentations virtuelles et en nombre illimité, et pour les bases de données, leurs évolutions et mises à jour, par tous procédés de communication connus ou inconnus à ce jour, par fil ou sans fil, publics ou privés, gratuits ou payants et notamment par ondes, par voie hertzienne, par câble, par satellite, par affichage sur tout type d’écran, et de réseau de diffusion, notamment analogique, numérique (tels que Internet, intranet, réseaux sociaux, blogs, chaînes payantes ou gratuites) de type 5G, 4G, 3G, EDGE, UMTS, par voie de téléchargement, de télétransmission, ou tout autre système destiné aux téléphones mobiles et aux assistants personnels, aux consoles de jeux, ou par tous procédés analogues existant ou à venir, par tous canaux de vente, pour toute réception destinée à un usage privé ou un usage collectif dans les lieux publics.
Ces communications au public pourront être faites soit directement, soit par l’intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés par l’Employeur et ce, tant dans le secteur commercial que non commercial, à titre gratuit ou onéreux.
Le droit d’adaptation :
- Le droit d’intégration en tout ou partie des Créations, ou leurs adaptations, dans un ensemble, avec ou sans modification.
- Le droit de traduire en toutes langues ou dans tout langage informatique tout ou partie des Créations et leurs adaptations et de reproduire ces traductions par tous procédés et sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, notamment télématique ou numérique, aux fins de tous types d’exploitation.
- Le droit d’adapter, modifier, ou arranger tout ou partie des Créations quant à leurs couleurs, leurs tailles, leurs graphismes, leurs formes, l’apposition du nom et/ou de la qualité du/de le/la Salarié(e), en fonction des supports et des modalités d’exploitation des Créations.
- Le droit d’en faire des extraits, destinés à être reproduits sur tout support tel que le site Internet de l’Employeur, dans des expositions, salons, dans des publications, et plus généralement dans toutes manifestations culturelles diverses.
Les droits secondaires : le droit de reproduire ou de faire reproduire, d’autoriser la présentation de tout ou partie des Créations ou de leurs adaptations, seules ou avec d’autres éléments sur tout type de support à des fins de publicité et/ou promotion ainsi qu’à des fins de parrainage, mécénat ou sponsoring.
Les droits dérivés : le droit de réaliser ou de faire réaliser à partir de tout ou partie des Créations, par l’Employeur ou toute personne choisie par l’Employeur, toutes nouvelles œuvres dérivées, interactives ou non et susceptibles d’être mises à disposition du public par tous moyens et procédés (tels que lecteurs, écrans, ordinateurs, etc.) par vente ou location ou simple droit d’accès en vue de la consultation.
Modalités de calcul de la rémunération :
Option 1 : rémunération proportionnelle
En contrepartie de cette cession, le/la Salarié(e) percevra une rémunération proportionnelle aux recettes générées par la vente de ses Créations.
Option 2 : rémunération forfaitaire
En contrepartie de cette cession, le/la Salarié(e) percevra une rémunération forfaitaire conformément aux prescriptions du code de la propriété intellectuelle.
Option 2.1 : Cette rémunération sera de (à compléter).
Option 2.2 : Cette rémunération est intégrée directement dans le montant de la rémunération annuelle perçue par le/la Salarié(e).
Le/la Salarié(e) garantit à l’Employeur la jouissance paisible, pleine et entière des Créations cédées. Le/la Salarié(e) garantit l’Employeur contre toute revendication, réclamation, recours, opposition de tous tiers, ainsi que contre toute action en justice sur le fondement de la contrefaçon, des droits de la personnalité, du droit de propriété, de la concurrence déloyale ou du parasitisme, de la diffamation et plus généralement contre tout trouble affectant la jouissance paisible des droits cédés sur les Créations et tout élément qu’elle contient ou qui y serait reproduit ou représenté. Le/la Salarié(e) s’engage à indemniser l’Employeur contre toute action en revendication intentée par un tiers et portant sur les éléments précités.
Option si utilisation d’outils tiers par le/la Salarié(e) :
En outre, le/la Salarié(e) s’interdit de recourir à des outils tiers pour créer des éléments qu’il/elle cède ou concède au titre du Contrat sauf s’il/elle obtient en amont l’autorisation de les exploiter à des fins commerciales. L’utilisation d’outils tiers par le Prestataire pour créer des éléments à céder à l’Employeur est soumise à l’autorisation préalable écrite de l’Employeur.
[1] CPI, at. L. 111-1 N° Lexbase : L3636LZP.
[2] CPI, art. L. 112-2 N° Lexbase : L3334ADT.
[3] CPI, art. L. 123-1 N° Lexbase : L3373ADB.
[4] CPI, art. L. 123-3 N° Lexbase : L3375ADD.
[5] CPI, art. L. 111-1 N° Lexbase : L3636LZP et L. 113-1 N° Lexbase : L3337ADX.
[6] CPI, art. L. 113-9 N° Lexbase : L0392LTP.
[7] CPI, art. L. 113-5 N° Lexbase : L3341AD4.
[8] CPI, art. L. 122-1 N° Lexbase : L3355ADM et s..
[9] CPI, art. L. 121-1 N° Lexbase : L3346ADB et s..
[10] CPI, art. L. 131-2 N° Lexbase : L1102KZT.
[11] CPI, art. L. 131-1 N° Lexbase : L3384ADP.
[12] CA Paris, 25 janvier 2023, n° 19/15256 N° Lexbase : A51689AN.
[13] En ce sens, des sites internet avaient été créés par un salarié pour le compte de son ancien employeur : T. com. Nice, 21 avril 2008 : Propr. industr., 2008, comm. 50, note J. Larrieu.
[14] CPI, art. L. 131-3 N° Lexbase : L3386ADR.
[15] CPI, art. L. 131-6 N° Lexbase : L3389ADU.
[16] CPI, art. L. 131-4 N° Lexbase : L3387ADS.
[17] CPI, art. L. 131-4 N° Lexbase : L3387ADS.
[18] F. Pollaud-Dulian, Auteur salarié : quand une cour d'appel s'affranchit du droit, Frédéric Pollaud-Dulian, RTD com., 2023, p. 332.
[19] CA Paris, 25 janvier 2023, n° 19/15256 N° Lexbase : A51689AN.
[20] F. Pollaud-Dulian, Auteur salarié : quand une cour d'appel s'affranchit du droit, Frédéric Pollaud-Dulian, RTD com., 2023, p. 332.
[21] CA Amiens, 6 septembre 2023, n° 22/04997 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 99788499, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CA Amiens, 06-09-2023, n\u00b0 22/04997, Confirmation", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A42871GU"}}.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488862
[Brèves] ISF et dispositif Dutreil : conditions d’appréciation de l’activité exercée selon un faisceau d’indices
Réf. : Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.300, F-B N° Lexbase : A04992UZ
Lecture: 3 min
N8827BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 29 Mars 2024
► La Chambre commerciale est revenue dans un arrêt du 13 mars 2024, sur l’appréciation de la prépondérance de l’activité exercée dans le cadre du bénéfice du dispositif Dutreil applicable en matière d’ISF.
Faits. L'administration fiscale a notifié au requérant une proposition de rectification portant rappel d’ISF pour les années 2011 à 2015 et de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) pour l'année 2012, remettant en cause l'exonération partielle de 75 % de la valeur des actions de la société P au motif que cette société exercerait à titre principal une activité civile non éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 885 I bis du Code général des impôts.
Procédure. Après rejet implicite de sa réclamation, le requérant a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires réclamées.
Principe (CGI, art. 885 I bis N° Lexbase : L3205LCP). Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
- les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;
- l'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
Précisions de la Chambre commerciale. Ce régime de faveur peut également s'appliquer aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice.
Pour la Chambre commerciale, la cour d’appel n’a pas appliqué cette méthode du faisceau d’indices.
La cour d’appel a rejeté les demandes du requérant :
- en énonçant que le caractère prépondérant de l'activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale peut être retenu si le chiffre d'affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % de son chiffre d'affaires total et si le montant de l'actif brut immobilisé est supérieur à 50 % du montant total de l'actif brut,
- en relevant que la société en cause au litige développe une activité commerciale de prestations de services rendues dans le domaine de l'audiovisuel et une activité civile de gestion de patrimoine.
L’arrêt retient ainsi que le requérant ne rapporte pas la preuve que les actifs affectés à l'activité commerciale représenteraient plus de 50 % de son actif brut et que l'actif brut de la société Parasol production serait majoritairement constitué de valeurs mobilières de placement ne présentant pas un caractère professionnel ; à tort selon la Chambre commerciale.
La cour d’appel aurait dû examiner l'ensemble des indices dont se prévalait le contribuable pour démontrer le caractère principalement commercial de la société, en particulier les éléments relatifs à la nature de l'activité exercée et les conditions de son exercice. Elle aurait dû également rechercher si les liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la société constituaient des actifs dont l'acquisition découlait de son activité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris est cassé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488827
[Focus] Les aspects fiscaux du contrat d’assurance-vie dans un contexte international
Lecture: 13 min
N8865BZD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
Le 26 Mars 2024
Mots-clés : notaires • assurance-vie • domicile fiscal • convention fiscale
Face à la multiplication des échanges et à la mobilité internationale accrue des résidents comme des non-résidents, la question de la fiscalité du contrat d’assurance-vie est pour le moins devenue assez technique lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte international.
L’hypothèse est plus fréquente qu’on ne le pense et touche à la fois les contribuables français ayant souscrit un contrat d’assurance-vie étranger et qui souhaitent s’expatrier mais également les non-résidents ayant souscrit un contrat auprès d’une compagnie étrangère.
Les règles pouvant varier fortement d’un pays à l’autre en fonction du pays d’expatriation, le notaire est tenu d’avoir une lecture éclairée des difficultés attachées aux aspects fiscaux du contrat d’assurance-vie en présence d’une convention fiscale bilatérale comme en son absence.
L’objet de cette étude sera de présenter les principes fiscaux applicables à la fiscalité sous une double perspective : la fiscalité en cas de rachat et en cas de décès lorsque le contribuable est confronté à un élément d’extranéité venant complexifier le régime fiscal du contrat d’assurance-vie.
I. La détermination préalable du domicile fiscal des parties
Préalablement à l’étude du régime fiscal du contrat d’assurance-vie, il convient de procéder à la détermination du domicile fiscal des parties. Les critères retenus pour la détermination du domicile fiscal sont définis au sein du Code général des impôts. L’article 4 B du CGI N° Lexbase : L6146LU8 prévoit une série de rattachements alternatifs de nature à caractériser le domicile fiscal.
Est ainsi considérée comme résident fiscal français toute personne qui remplit l’un des critères suivants :
- Avoir en France son foyer ou à défaut, son lieu de séjour principal ;
- Exercer en France une activité professionnelle à titre principal (salariée ou non) ;
- Avoir en France le centre de ses intérêts économiques.
A. Le foyer ou lieu de séjour principal
D’une part, le foyer s’entend comme le lieu où les intéressés habitent normalement, c'est-à-dire le lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.
En jurisprudence, les juges du Conseil d’État [1] ont défini la notion de foyer comme le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le juge ne tiendra pas compte des séjours effectués à l’étranger temporairement s’ils ont un caractère exceptionnel ou sont justifiés par des motifs d’ordre professionnel.
Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer [2]. Il se définit comme le lieu où le contribuable y séjourne au moins six mois au cours d’une année déterminée.
B. L’activité professionnelle
Par principe, doivent être également considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. En cas d’exercice de plusieurs activités, le juge est tenu d’identifier l’activité à laquelle il consacre le plus de temps.
Pour les salariés, le domicile est fonction du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle.
Pour les mandataires sociaux d'une société dont le siège social ou le siège de direction effective est situé en France, cette situation implique, en principe, l'exercice en France du mandat social.
Pour les professionnels indépendants, le domicile est déterminé en France si le contribuable a un point d’attache fixe et s’il y exercice son activité à titre principal.
C. La notion d’intérêts économiques
La notion d’intérêts économiques renvoie au lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens. Ceci peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles ou d'où ils tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus. S’ils possèdent plusieurs activités ou sources de revenus, on prend en compte le centre de ses intérêts où il tire la majeure partie de ses revenus.
Pour les titulaires de mandats sociaux au sein de plusieurs sociétés dont les sièges sociaux ou de direction effective respectifs sont situés dans différents pays, le centre des intérêts économiques est recherché, selon les circonstances propres à chaque espèce, en tenant compte des liens entre les mandats sociaux exercés.
En jurisprudence [3], le Conseil d’État a récemment jugé que le fait de percevoir ses retraites en France peut rendre le contribuable résident fiscal français alors même qu’il pensait avoir transféré sa résidence fiscale à l’étranger, et ainsi le rendre imposable sur ses revenus mondiaux en France.
II. La fiscalité lors du rachat du contrat d’assurance-vie dans un contexte international
Une fois avoir déterminé le domicile fiscal du contribuable, il convient de s’intéresser tout particulièrement à la fiscalité du contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’une compagnie étrangère, que le contribuable soit un résident ou un non-résident.
A. Le contrat d’assurance-vie souscrit par un résident fiscal français auprès d’une compagnie d’assurance étrangère
1) Les règles d’imposition en l’absence de convention fiscale
Par principe, en cas de rachat, qu’il soit partiel ou total, seuls les intérêts sont soumis à imposition sur le territoire français. L’administration fiscale française ne soumet pas à imposition la fraction de capital rachetée.
En l’absence de conventions fiscales, l’article 125 A III bis du CGI N° Lexbase : L6041LMP prévoit que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du Code général des impôts qui bénéficient d’intérêts sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui exerce le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi en France ou hors de France.
Depuis la loi de finances pour 2018, une distinction est effectuée quant à la date de versement des primes et dépend de deux facteurs : la durée du contrat et l’importance des primes versées.
Intérêts réalisés jusqu’au 26 septembre 2017
Concernant les intérêts pour les primes versées avant le 27 septembre 2017, la fiscalité antérieure à la loi de finances pour 2018 continue de s’appliquer. Le souscripteur devra ainsi s’acquitter en France d’un impôt forfaitaire variable selon la durée de détention. Une possibilité est offerte pour le souscripteur d’opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire dégressif mais uniquement pour 4 ans.
| Date de souscription du contrat | Imposition |
| Inférieure à 4 ans | 35 % |
| Entre 4 et 8 ans | 15 % |
| Supérieure à 8 ans | 7,5 % |
Intérêts réalisés à compter du 26 septembre 2017
| Date de souscription du contrat | Part de l’encourt inférieure à 150 000 € | Par de l’encourt supérieure à 150 000 € |
| Inférieure à 4 ans | 12,8 % | 12,8 % |
| Entre 4 et 8 ans | 12,8 % | 12,8 % |
| Supérieure à 8 ans | 7,5 % | 12,8 % |
À compter du 27 septembre 2017, les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) au taux de 12,8 %, quelle que soit la durée du contrat.
Attention, le régime fiscal est pour le moins ici peu favorable aux non résidents. Ceux-ci ne bénéficient pas de l’abattement fiscal annuel de 4 600 euros (pour une personne seule) ou 9 200 euros (pour un souscripteur marié), sur les rachats réalisés au bout de 8 ans.
2) Les outils d’imposition en présence d’une convention fiscale
Par ailleurs, le notaire, officier ministériel, est tenu de vérifier si une convention fiscale entre la France et l’État de résidence du contribuable est applicable. Cette vérification est déterminante et permet de limiter ou d’éviter une double taxation pour le contribuable.
Généralement, les conventions fiscales prévoient que l’imposition des intérêts perçus s’effectuera dans le pays de résidence du contribuable. Toutefois, cette méthode est loin de faire l’adhésion par l’ensemble des États et dépend de la rédaction de la convention fiscale bilatérale.
Plusieurs méthodes sont prévues au sein des conventions fiscales :
- Les produits du rachat de contrats d’assurance-vie peuvent être imposés dans l’État de résidence du souscripteur.
Tel est le cas par exemple de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni en date du 19 juin 2008 N° Lexbase : E0467EUT, qui prévoit la suppression totale des prélèvements. En application de son article 12, les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet État.
- L’État de source peut conserver un droit d’imposition par le biais du prélèvement à la source. Les taux peuvent différer selon les États et les conventions fiscales conclues.
À titre d’exemple, certains États comme la Chine, le Luxembourg, l’Espagne ou l’Italie ont opté pour une retenue à la source de 10 % maximum ou encore 15 % pour les résidents de Malaisie, du Brésil ou de Belgique.
Le notaire est ainsi tenu de vérifier au sein de la convention avec le pays de résidence si un taux particulier dérogatoire existe ou non et l’appliquer au besoin. Si une convention fiscale est conclue entre la France et l’État de résidence du souscripteur du contrat, celui-ci peut demander l’application de la fiscalité la plus favorable et il arrive fréquemment que les produits du rachat soient imposés dans l’État de résidence du souscripteur uniquement.
En pratique, pour bénéficier de ces taux, les assureurs demanderont en général au souscripteur de fournir une preuve de résidence fiscale. Ils devront alors retourner le formulaire 5000-SD complété par l’administration fiscale du pays de résidence.
Dans la majorité des cas, l’assureur demandera au non-résident un justificatif de résidence fiscale étrangère de l’année de la souscription, un bulletin d’auto certification fiscale & une attestation sur l’honneur de non-résidence fiscale.
À défaut de fournir un justificatif, l’assureur sera fondé à ne pas tenir compte des taux inscrits dans la convention fiscale et pourra prélever selon le taux prévu selon les règles du droit français.
- La méthode du crédit d’impôt peut être retenue par la convention fiscale. Dans ce cas, la double imposition est supprimée par l’État de résidence en faisant prévaloir au souscripteur un crédit d’impôt à valoir sur l’impôt à payer dans cet État.
La Convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 N° Lexbase : E0482EUE retient le crédit d’impôt comme méthode d’élimination des doubles impositions à son article 23. Les revenus qui proviennent du Canada et qui sont imposables au Canada seront pris en compte pour le calcul de l’impôt français. L’impôt canadien n’est pas déductible des revenus du contribuable mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français.
B. Le contrat d’assurance-vie souscrit par un non-résident fiscal français auprès d’une compagnie étrangère
Le rachat est soumis ou non aux prélèvements libératoires en fonction des produits attachés aux primes versées avant ou après le 27 septembre 2017. Une particularité est à relever ici. Il n’existe pas de possibilité pour les non-résidents d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu ou de bénéficier des abattements pour les rachats dont la durée est supérieure à huit années.
III. La fiscalité du contrat d’assurance-vie en cas de décès du souscripteur
Rappelons tout d’abord que les primes versées lors du dénouement d’un contrat d’assurance-vie relèvent de la loi applicable à la succession. La règle de principe est ici posée par les règles de territorialité des droits de succession en application de l’article 750 ter du Code général des impôts N° Lexbase : L9528IQX.
Conformément à l’article 750 ter du Code général des impôts et même en présence d’une convention fiscale, il convient de déclarer le patrimoine mondial, quel que soit le domicile du bénéficiaire de la transmission (en France ou hors de France) à partir du moment où le donateur dispose de son domicile fiscal en France.
Il convient ici de distinguer plusieurs hypothèses afin de mieux saisir les aspects fiscaux du contrat d’assurance-vie sous l’angle fiscal :
Si le donateur ou défunt et bénéficiaire est non domicilié en France : conformément à l’article 750 ter 2° du CGI, lorsque le disposant et le bénéficiaire n’ont pas leur domicile en France au moins six ans au cours des dix dernières années, il conviendra alors de ne déclarer que les seuls biens situés en France.
Les sommes versées avant 70 ans sur un contrat souscrit par un non-résident seront transmises au bénéficiaire sans fiscalité si au moment du décès, l’assuré n’est pas fiscalement domicilié en France et ne l’a pas été pendant au moins six ans au cours des dix années précédent le décès. Le cas échéant, les capitaux seront taxés à hauteur de 20 % après un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire jusqu’à un plafond de 700 000 euros et 31,25 % au-delà (CGI. art. 990 I N° Lexbase : L1476MH7).
Pour les sommes versées après 70 ans sur un contrat souscrit par non-résident, celles-ci seront transmises en franchise de droit de succession avec un abattement de 30 500 euros global (CGI. art. 757 B N° Lexbase : L1534MHB). L’excédent est soumis aux droits de succession. Les intérêts perçus sur le contrat sont exonérés de droits de succession.
Si le donateur ou défunt est non domicilié en France et le bénéficiaire est domicilié en France : lorsque le bénéficiaire a eu son domicile en France au moins six ans au cours des dix dernières années, il convient alors de déclarer l’intégralité des biens qu’ils soient situés en France ou hors de France, sans considération du domicile du disposant.
En définitive, en droit français, à défaut de convention fiscale bilatérale, seront soumis à une imposition en France les contrats d’assurance-vie qui réunissent l’une des conditions alternatives suivantes :
- Le souscripteur défunt est domicilié en France au moment du décès (CGI. art. 750 ter, al. 1)
- À défaut, le bénéficiaire est domicilié en France (CGI. art. 750 ter, al. 3)
- À défaut, le siège social de la compagnie d’assurance est situé en France (CGI. art. 750 ter, al. 2)
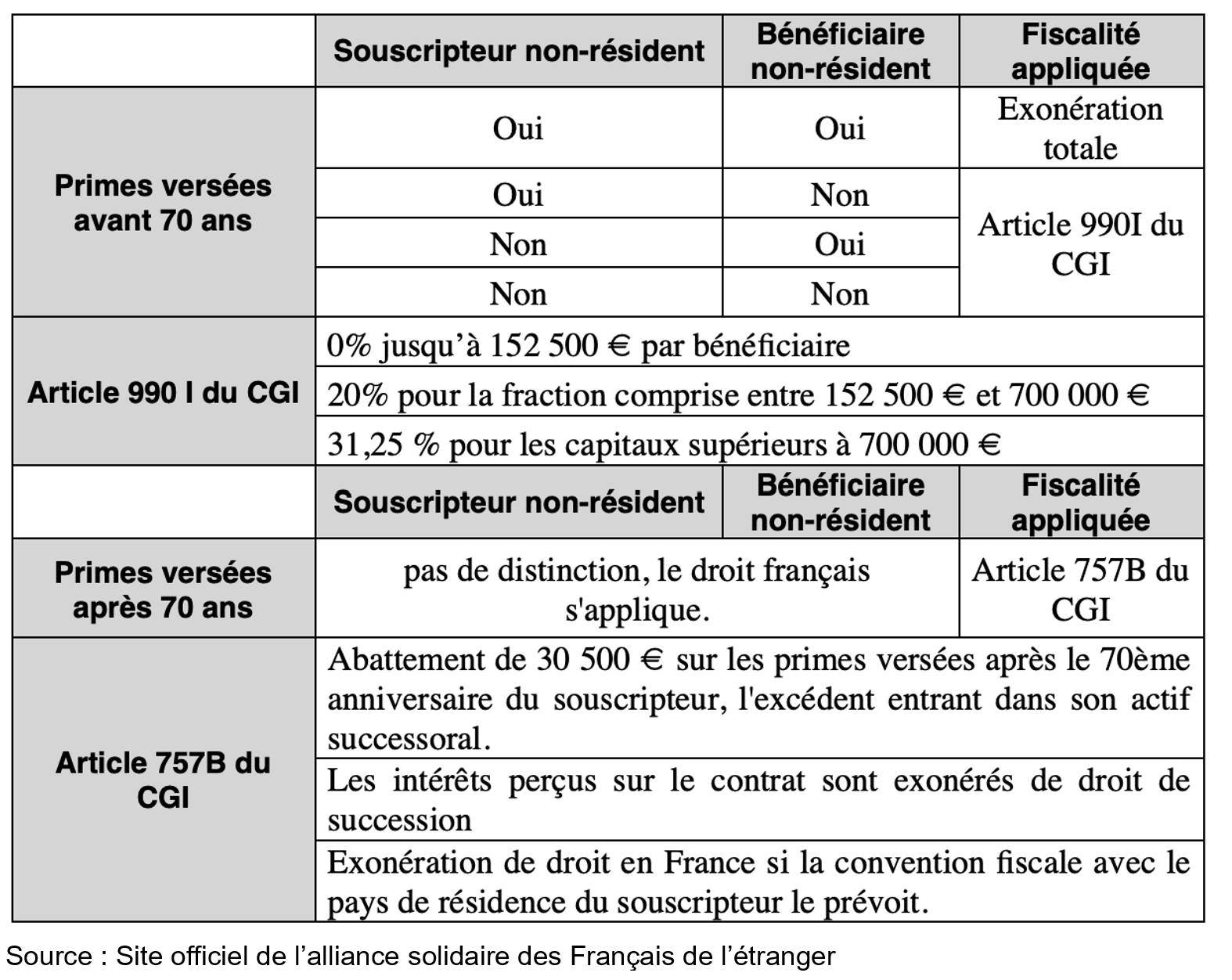
En définitive, la question de la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie est loin d’être aussi simple qu’on ne le pense et mérite une attention particulière des notaires, officiers publics ministériels chargés du règlement des successions dans un contexte international.
Le notaire fait face à plusieurs difficultés qu’il doit nécessairement résoudre en s’efforçant de sortir des sentiers battus, tant concernant la détermination du domicile fiscal, qui dans certains cas peut s’avérer complexe, que concernant la détermination de la bonne méthode d’imposition des contrats d’assurance-vie (élimination pure et simple de l’impôt, crédit d’impôt, imposition par le biais du prélèvement à la source) par la lecture des conventions fiscales.
[1] CE Contentieux, 3 novembre 1995, n° 126513 N° Lexbase : A6488ANM ; CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2018, n° 408609, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1651XUP.
[2] CE 9° et 10° ssr., 21 octobre 2011, n° 333898 N° Lexbase : A8335HYD.
[3] CE 9° et 10° ssr., 17 juin 2015, n° 371412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5371NLI.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488865
[Jurisprudence] Le dialogue des juges et la règle prétorienne dégagée par l’arrêt « Czabaj »
Réf. : CE, 3° ch., 16 février 2024, n° 444996, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A72792MK
Lecture: 14 min
N8833BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Edwin Matutano, docteur en droit, Avocat à la cour, enseignant à l’UVSQ
Le 27 Mars 2024
Mots clés : Czabaj • délai raisonnable • dialogue des juges • recours administratif • sécurité juridique
La jurisprudence « Czabaj » du Conseil d’État a suscité de nombreuses études doctrinales en raison de ses incidences sur l’effectivité du principe constitutionnel de l’accès au juge. Depuis que cette décision prétorienne a été rendue, elle a fait l’objet de précisions, d’extensions et de restrictions de son champ et plus récemment, d’une appréhension par d’autres juridictions suprêmes (Cour européenne des droits de l’Homme et Cour de cassation). La décision faisant l’objet de ce commentaire s’inscrit dans le fil de ce dialogue des juges et plus particulièrement, dans celui tissé avec la Cour européenne des droits de l’Homme.
Les faits : Un fonctionnaire territorial, appartenant au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, de catégorie B, avait sollicité, le 26 mars 1998, de son employeur, la communauté urbaine de Lille, devenue la métropole européenne de Lille, sa titularisation dans un cadre d’emplois de catégorie A, celui des attachés territoriaux. Cette demande lui fut refusée par une décision du 15 juin 1998.
Le 23 avril 2010, il forma un recours gracieux à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 12 octobre 2015, il saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette décision du 15 juin 1998, à ce qu’il soit enjoint à son employeur de reconstituer sa carrière comme attaché territorial principal à compter du 1er avril 1998 et à ce que la métropole européenne de Lille soit condamnée à réparer le préjudice qu’il estimait avoir subi.
Le tribunal administratif de Lille rejeta sa requête par un jugement en date du 23 octobre 2018.
Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Douai.
Cette dernière, par arrêt en date du 30 juillet 2020, confirma le jugement de première instance et rejeta sa requête.
Le requérant forma un pourvoi auprès du Conseil d’État, demandant l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai, le règlement de l’affaire au fond en faisant droit à son appel.
La décision du Conseil d’État du 16 février 2024, rendue sur le pourvoi, s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence « Czabaj » du 13 juillet 2016 [1], par laquelle, de manière prétorienne, le Conseil d’État a jugé que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En pareille hypothèse, selon le Conseil d’État, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable et en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
Mais la décision du 16 février 2024 tient compte également de la position exprimée par la Cour européenne des droits de l’Homme [2], laquelle a condamné la France du fait de l’application immédiate de la jurisprudence « Czabaj » aux instances en cours en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR.
C’est à ce titre qu’elle illustre le dialogue des juges qui s’est instauré au sujet du délai d’un an dégagé par l’arrêt « Czabaj » et que la Cour de cassation est venue abonder à son tour [3]. La décision du Conseil d’État du 16 février 2024 illustre ainsi le dialogue des juges ; c’est ce qu’il convient de mettre en exergue, après avoir rappelé les développements, assortis de limites, de la jurisprudence « Czabaj », telles que le Conseil d’État les a, lui-même, entendues au fil de ses décisions.
I. Développements et limites de l’arrêt « Czabaj »
Ils furent, les uns comme les autres, l’œuvre du Conseil d’État. Cet état du droit apparaît naturel dans la mesure où l’arrêt « Czabaj » livre une interprétation des dispositions des articles R. 421-1 N° Lexbase : L4139LUT et R. 421-5 N° Lexbase : L3025ALM du Code de justice administrative.
En vertu de l’article R. 421-1, le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contre une décision et ce recours doit être formé dans les deux mois suivant la notification ou la publication de ladite décision.
Le point de départ des voies et délais de recours coïncide ainsi avec l’accomplissement de la formalité idoine de publicité de la décision déférée au juge : la notification s’il s’agit une décision individuelle ; la publication au cas d’une décision réglementaire ou d’une décision ni individuelle ni réglementaire.
L’article R. 421-5 précise que les voies et délais de recours ne sont opposables que s’ils ont été mentionnés dans l’acte de notification de la décision.
Cette précision vise nécessairement les décisions individuelles, puisque les autres décisions administratives sont rendues publiques par un autre moyen que la notification, la publication ou l’affichage, ainsi qu’il l’a été rappelé supra.
La jurisprudence dite « Czabaj » se rapporte donc exclusivement à cette catégorie de décisions administratives.
Avant son intervention, en droit, lorsque l’administration avait négligé de rédiger une mention relative à l’exercice des voies et délais de recours ou avait entaché celle-ci d’une erreur de nature à entraîner une confusion de la part du requérant, le recours contre une décision administrative pouvait être formé sans limites dans le temps, autre que celles découlant de la théorie jurisprudentielle de la connaissance acquise de la décision litigieuse ou de l’application, en matière pécuniaire, de la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 N° Lexbase : L6499BH8.
Par conséquent, la portée de l’arrêt « Czabaj » est constitutive d’une limite à cette latitude du requérant, laquelle, faut-il le rappeler, est la résultante d’une négligence de l’administration.
Cette portée a connu, depuis huit ans, des extensions et des limitations.
A. Les extensions de la jurisprudence « Czabaj »
En premier lieu, sa portée fut étendue aux conclusions indemnitaires, ce qui, en pratique, ne constituait pas le moindre élargissement [4].
En deuxième lieu, cette portée fut également étendue aux exceptions d’illégalité d’une décision administrative individuelle [5].
En troisième lieu, elle le fut aux décisions implicites de l’administration, hypothèse des plus répandues [6]. Cette extension a connu une précision s’agissant du rejet implicite d’un recours gracieux [7].
En quatrième lieu, cette position jurisprudentielle connut une extension remarquable, quoique logique, aux recours amiables pré-contentieux (recours gracieux et hiérarchique), ainsi qu’une précision importante relative à l’effet interruptif du délai d’un an en raison d’une demande d’aide juridictionnelle [8].
En cinquième lieu, elle fut, de surcroît, rendue applicable aux recours en contestation de la validité de contrats administratifs [9].
Dans cet esprit tendant à conférer à la jurisprudence « Czabaj » toute sa plénitude, l’on doit, de même, faire état de la décision par laquelle le Conseil d’État a refusé de voir dans l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) une circonstance particulière de nature à infirmer la solution de sa jurisprudence « Czabaj » [10] et sa décision selon laquelle le délai d’un an qui en est issu s’applique même dans l’hypothèse où le requérant a saisi, à tort, la juridiction judiciaire [11], car, aux termes de cette dernière décision, en pareille hypothèse, le requérant ne dispose que d’un délai de deux mois pour saisir utilement le juge administratif après que la décision d’incompétence du juge judiciaire lui a été notifiée ou signifiée.
B. Les limites apportées
En premier lieu, le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable issu de l’arrêt « Czabaj » ne peut être soulevé d’office qu’après que les parties ont été avisées de ce qu’un moyen d’ordre public est soulevé et qu’elles ont pu faire valoir à son sujet leurs observations [12].
En deuxième lieu, par une décision remarquée, le Conseil d’État jugea qu’elle n’était pas transposable aux actions en responsabilité [13].
Ainsi, le Conseil d’État étendit, avec quelques réserves, le champ de son arrêt prétorien « Czabaj ».
II. La décision commentée : le fruit du dialogue des juges
A. La portée de la décision « Czabaj » ne s’étend pas aux affaires où est en cause une décision administrative qui lui est antérieure
Assurément, la décision du 16 février 2024 tient compte de la position de la Cour européenne des droits de l’Homme [14], qui a considéré, à titre principal, que le délai prétorien d’un an dégagé par le Conseil d’État n’était pas constitutif d’une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal tel qu’il est protégé par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
C’est en statuant in concreto que la Cour a atténué les effets les plus radicaux de la règle prétorienne. Son arrêt relève que, à l’égard des requérants, qui avaient introduit leur recours avant que le Conseil d’État français ne rende sa décision « Czabaj », l’article 6 §1 avait, cependant, été méconnu, parce que ces requérants n’avaient pu anticiper de quelque manière la jurisprudence nouvelle du Conseil d’État.
Eu égard à la circonstance tenant à ce qu’était en cause devant la Cour la question de la privation du droit de propriété pour cause d’utilité publique, faisant l’objet de l’article premier du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’arrêt du 9 novembre 2023 en infère que le requérant n’avait pu, du fait de la forclusion qui lui avait été opposée, exposer sa cause afin de contester effectivement les mesures ayant porté atteinte au respect au droit au respect des biens.
Et la Cour vit, à l’égard de certains des requérants qui l’avaient saisie, un préjudice moral dans la violation du droit d’accès à un tribunal qu’ils ont subi.
Par sa décision n° 444996 du 16 février 2024, le Conseil d’État s’appuya expressément (cf. point 7 de sa décision), sur la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l’Homme en citant la décision « Legros et autres » de la Cour et en en déduisant que la règle de procédure de l’arrêt « Czabaj » ne pouvait être opposée à l’auteur d’un recours juridictionnel formé avant la date de cet arrêt, sauf à ce qu’il s’ensuive une violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, le Conseil d’État a jugé que le requérant ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, les conditions pour bénéficier d’une intégration dans un cadre d’emplois de catégorie A. Par conséquent, son administration de rattachement était tenue de rejeter sa demande de titularisation dans un tel cadre d’emplois.
Au surplus, le Conseil d’État répondit au moyen du requérant selon lequel sa demande tendait en réalité au retrait de la décision du 17 novembre 1994 par laquelle il avait été intégré dans un cadre d’emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
À cet égard, le Haut juge considère que si les circonstances tenant au retrait de cette décision auraient pu être établies, en raison du changement de circonstances de droit postérieur à cette décision du 17 novembre 1994, en revanche, le retrait n’aurait pu être accompagné d’aucune titularisation dans un cadre d’emplois de catégorie A. Et le Conseil d’État en déduit que le retrait aurait abouti à priver le requérant des avantages liés à la qualité d’agent titulaire.
Aussi, après avoir évoqué l’affaire sur le fondement de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3298ALQ, rejeta-t-il la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Lille.
B. La sécurité juridique : principe général du droit ou standard juridique ?
La décision qui fait l’objet de la présente note participe du dialogue des juges que la Cour de cassation, dans les deux arrêts de son assemblée plénière précités, a enrichi et dont il résulte que l’économie du droit processuel applicable en matière civile justifie que le particularisme du contentieux de l’excès de pouvoir, à propos duquel le Conseil d’État a dégagé la règle prétorienne du délai utile d’un an aux fins de la poursuite de l’annulation d’une décision administrative, ne lui soit pas étendu [15].
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est, en effet, efforcée de souligner le caractère spécial du contentieux de l’excès de pouvoir, qui ressortit à la compétence exclusive des juridictions administratives pour motiver l’indépendance de solutions propres à chaque ordre de juridiction, y compris dans les cas où le juge judiciaire est appelé à se prononcer sur un litige né d’une décision de l’administration.
Il n’est pas indifférent qu’elle ait à cet effet dégagé un principe général du droit des dispositions de l’article 680 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1240IZX, dont il résulte que l’acte de notification d’un jugement doit indiquer de manière apparente les voies et délais de recours existants à l’encontre de ce jugement, ainsi que leurs modalités d’exercice et qu’à défaut, lesdits voies et délais ne courent pas.
Par là même, c’est également une appréciation de la sécurité juridique qu’a fait prévaloir la Cour de cassation, afin de garantir l’équilibre des droits des parties au cours du procès civil en ne reprenant pas à son compte la règle de la forclusion au terme d’un an dégagée par le Conseil d’État.
Et dans les affaires à elle soumises, elle a fait application de ce principe afin de concilier, d’une part, le droit d’un créancier public de recouvrer les sommes qui lui sont dues et d’autre part, le droit d’accès au juge de son débiteur.
La conséquence de cette acception duale d’un même principe par chacun des deux ordres de juridiction contribue à faire de celui-ci, davantage même qu’un principe de droit processuel, également applicable par les deux ordres de juridiction, un standard juridique, aux contours forcément modulables.
Cet état du droit ne doit pas surprendre si l’on se souvient des vicissitudes qu’avait connues le principe général tenant à la sécurité juridique, dégagé par le Conseil d’État lui-même [16], durant la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire consécutive à la pandémie de covid-19 (cf. ordonnances n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif N° Lexbase : L5719LWQ et n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiées N° Lexbase : L5730LW7) du fait de la prorogation de délais pré-contentieux, qui eut pour résultat de créer une incertitude prononcée quant à la teneur de l’ordonnancement juridique et la computation des délais de recours.
[1] CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL, Rec. p. 340.
[2] CEDH, 9 novembre 2023, Req. 72173/17, Legros et autres N° Lexbase : A12331XX.
[3] Ass. Plén., 8 mars 2024, n° 21-125.60, publiée au Bulletin N° Lexbase : A92692S4 et n° 21-21.230, publiée au Bulletin N° Lexbase : A92722S9.
[4] CE, 9 mars 2018, n° 405355, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6316XGZ.
[5] CE, 27 février 2019, n° 418950, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2163YZ7.
[6] CE, 18 mars 2019, n° 417270, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1779Y4N.
[7] CE, 12 octobre 2020, n° 429185, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40653XT.
[8] CE, avis, 12 juillet 2023, n° 474865 N° Lexbase : A78321AC.
[9] CE, 19 juillet 2023, n° 465309 N° Lexbase : A85161BZ.
[10] CE, 11 mars 2024, n° 488227 N° Lexbase : A92872T7.
[11] CE, 5 juillet 2023, n° 465478, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A376098R.
[12] CE, 28 mars 2018, n° 410552 N° Lexbase : A9020XIW.
[13] CE, 17 juin 2019, n° 413097 N° Lexbase : A6638ZEL, Rec. p.214.
[14] CEDH, 9 novembre 2023, Req. 72173/17, Legros et autres, préc.
[15] Ass. Plén., 8 mars 2024, n° 21-125.60, publiée au Bulletin et n° 21-21.230, publiée au Bulletin, préc.
[16] CE, Ass., 24 mars 2006, n° 288460 N° Lexbase : A7837DNL, Req. p. 150.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488833
[Brèves] Pacte d’actionnaires : l’acte non daté se prouve par tout moyen
Réf. : Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.844, F-B N° Lexbase : A20492WS
Lecture: 2 min
N8829BZZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
Le 01 Avril 2024
► En application de l'article 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen.
Faits et procédure. Les associés d’une SARL dont l'activité a débuté le 1er octobre 2009, ont, par un acte sous seing privé dépourvu de date, conclu un pacte d'associés stipulant une clause de non-concurrence à l'égard de cette société. Un cosignataire de cet acte a perdu la qualité d'associé le 11 septembre 2017.
Invoquant une violation par l’associé de son obligation de non-concurrence, la SARL l'a assigné en responsabilité.
Par un arrêt du 30 novembre 2022, la cour d’appel (CA Colmar, 30 novembre 2022, n° 21/03012 N° Lexbase : A16628Y9) a jugé que l'absence de date vidait de sa substance l'obligation qui était opposée à l'associé et a rejeté l’intégralité des demandes de la société.
La SARL a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1328 du Code civil N° Lexbase : L0978KZA, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK.
Elle rappelle ainsi que si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen.
Par conséquent, la cour d’appel, qui s’est fondée sur le fait que l’acte – bien que signé par tous les associés – était non daté pour dire que la société ne pouvait se prévaloir à l’égard de l’associé de la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d’associé, a violé l’article 1328 du Code civil.
|
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les pactes d’actionnaires, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E1456AEN. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488829
[Brèves] Délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés : peut-il être également représentant syndical au CSE ?
Réf. : Cass. soc., 20 mars 2024, n° 23-18.331, F-B N° Lexbase : A20502WT
Lecture: 4 min
N8907BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lisa Poinsot
Le 28 Mars 2024
► Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, un délégué syndical ne peut pas être investi du mandat de représentant syndical au comité social et économique, qu'il soit ou non membre élu de ce même comité.
Faits et procédure. Un syndicat désigne une salariée en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au CSE d’une entreprise employant moins de cinquante salariés.
L’employeur saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annuler uniquement la désignation du représentant syndical au CSE.
Le tribunal judiciaire constate, tout d’abord, que l’association emploie moins de cinquante salariés.
Le tribunal rappelle, ensuite, que le cumul entre les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de cinquante salariés est exclu. Dès lors, une salariée ne peut siéger simultanément dans le même CSE en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci. Selon le tribunal, cette incompatibilité résulte de l’impossibilité d’exercer, en même temps, les fonctions délibératives qui sont celles d’élu et les fonctions consultatives liées au mandat de représentant syndical, lorsqu’elle est désignée par une organisation syndicale.
Enfin, le tribunal affirme que la salariée n’a pas de voix délibérative au CSE et ne risque donc pas un cumul incompatible en qualité de représentant syndical avec voix consultative.
En conséquence, le tribunal judiciaire rejette la demande en annulation de la désignation du représentant syndical au CSE.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
| Rappel. Les syndicats désignent les salariés en qualité de représentants. Au contrairement, les membres du CSE sont élus par le personnel de l’entreprise et ne sont pas nécessairement soutenus par un syndicat. Les règles sont dès lors les suivantes :
Si l’entreprise compte au moins trois cents salariés, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il ne peut pas s’agir d’un membre élu du CSE. La désignation du représentant syndical au CSE est distincte de celle de délégué syndical. Si l’entreprise comprend un effectif entre cinquante et deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, le délégué syndical est d’office le représentant syndical au CSE dès lors qu’il n’est pas élu au CSE. |
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient apporter une précision pour la première fois quant à la désignation du représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de cinquante salariés au visa des articles L. 2314-2 N° Lexbase : L8508LG9, L. 2143-3 N° Lexbase : L1436LKE, L. 2143-6 N° Lexbase : L8708LGM et L. 2143-22 N° Lexbase : L8651LGI du Code du travail.
La Haute juridiction précise que la désignation dérogatoire d'un membre de l'institution représentative du personnel prévue dans les entreprises de moins de cinquante salariés comme délégué syndical résultant d’une disposition conventionnelle, sans crédit d'heures de délégation supplémentaire, n'a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du CSE des entreprises de moins de cinquante salariés.
| Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488907