[Brèves] Loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales : permettre la mise à l’abri et accompagner vers l’indépendance
Réf. : Loi n° 2023-140, du 28 février 2023, créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales N° Lexbase : L0495MHS
Lecture: 7 min
N4587BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
Le 22 Mars 2023
► Le 1er mars 2023, était promulguée la loi n° 2023-140, du 28 février 2023, créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales. Ce texte crée une aide financière d’urgence et ouvre droit à des accompagnements professionnels et sociaux permettant aux victimes de s’extirper des violences, de faire face aux premières dépenses et de construire leur indépendance. Il prévoit également l’adoption, tous les cinq ans, d’une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes devra être adoptée afin de déterminer la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de violence.
Contexte. En septembre 2019, le Gouvernement lançait sont « Grenelle des violences conjugales ». S’en suivait la loi n° 2019-1480, du 28 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille N° Lexbase : L2114LUT puis la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales N° Lexbase : L7970LXH.
Le 1er février 2022, le décret n° 2021-1516, du 23 novembre 2021, tendant à renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes d’infractions commises au sein du couple ou de la famille N° Lexbase : L3341L9M et le décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021, relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d’infractions commises au sein du couple N° Lexbase : L1152MAW, entraient en vigueur. Malgré ces différentes mesures et comme le déplore la sénatrice Jocelyne Guidez elle-même dans son rapport fait au nom de la commission des affaires sociales chargée d’examiner la présente loi, le nombre de violences conjugales n’a pas cessé d’augmenter. En témoignent les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur au cours de l’année 2022 : en 2021, 143 homicides conjugaux ont été recensés (+ 14 % par rapport à 2020). 122 d’entre eux avaient pour victimes des femmes. En 2021 toujours, les services de sécurité enregistraient 149 989 faits de violences conjugales ayant eu lieu la même année, soit une augmentation de 17 % des faits commis pendant l’année en cours par rapport à 2020.
L’analyse des appels au « 3919-Violences Femmes Info » témoigne quant à elle de la difficile protection des victimes de violences conjugales en raison des répercussions économiques et de l’instabilité résidentielle susceptible d’en résulter (en 2021, 17 % des victimes déclarent une situation d’hébergement complexe, 56 % des victimes veulent quitter le domicile conjugal).
C’est à cette situation de vulnérabilité que la loi du 28 février 2023 doit contribuer à répondre en aidant les victimes à se mettre à l’abri des violences et en les soutenant dans le recouvrement de leur indépendance.
Création d’une aide d’urgence
La loi créée tout d’abord une aide financière d’urgence pour les victimes de violences conjugales (CASF, art. L. 214-8 et s.).
Bénéficiaires. Pour bénéficier de cette aide, la personne doit être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacs. Ces violences doivent être attestées par :
- une ordonnance de protection délivrée par un juge aux affaires familiales ;
- un dépôt de plainte ;
- ou un signalement adressé au procureur de la République.
Procédure. Au moment du dépôt de la plainte ou du signalement adressés au procureur de la République, après information de la victime et avec son accord, un formulaire simplifié de demande peut être transmis à l'organisme débiteur des prestations familiales compétent. Dès réception de la demande, celle-ci est transmise au président du conseil départemental par l'organisme débiteur des prestations familiales saisi, avec l'accord exprès du demandeur.
Nature. L’aide financière créée est un prêt sans intérêt ou une aide non remboursable, selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte, de la présence d’enfants à charge. Par ailleurs, pendant six mois à compter du premier versement de l'aide, la victime peut bénéficier des droits et des aides accessoires au revenu de solidarité active, y compris l'accompagnement social et professionnel.
Versement. L’intégralité ou une partie de l’aide intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être porté à cinq jours ouvrés si le demandeur n’est pas allocataire.
Remboursement du prêt d’urgence par le conjoint. Lorsque l’aide d’urgence aura été délivrée sous la forme d’un prêt, et lorsque les faits auront donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne pourra être demandé à la victime tant que la procédure est en cours. Il pourra toutefois être mis à la charge de l’auteur des violences lorsque celui-ci aura été définitivement condamné à cette peine complémentaire, ou fait l’objet de la mesure de composition pénale ou de classement sous condition de versement pécuniaire mentionnée à l’article L. 214-12 du Code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros.
Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière
Une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes
Objet. Le texte prévoit également qu’avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes devra être adoptée afin de déterminer la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de violence, pour trois périodes successives de cinq ans.
Motifs. Ce texte devra se fonder sur une évaluation des besoins des personnes victimes de violences conjugales ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou de violences subies effectivement.
Objectifs. Ce texte devra définir :
- les objectifs de financement public nécessaire :
- pour assurer l'accompagnement psychologique et social ;
- nécessaire à la mise à l'abri via des dispositifs d'hébergement ;
- aux échelons régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs ;
- les moyens destinés à la formation des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des agents des services de l'état civil, des agents des services pénitentiaires, des magistrats, des personnels de l'éducation nationale, des personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs ainsi que des personnels de police et de gendarmerie ;
- les moyens destinés au « 3919 » dans l'accomplissement de ses missions.
Contrôle. L'Observatoire national des violences faites aux femmes et le Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes sont chargés de remettre un avis sur la cohérence entre les objectifs fixés et les moyens financiers par la loi de programmation.
| Pour vous former : v. formation Lexlearning, Les violences conjugales : comprendre et agir (LXBEL140) (dir. M. Dayan et S. Giraud) ; Pour aller plus loin : v. M. Bouchet, Décryptage et analyse de la loi du 20 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, Lexbase Pénal, septembre 2020 N° Lexbase : N4505BYI. Sources :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484587
[Brèves] Absence d’illégalité d’une décision administrative fondée sur des motifs issus de lignes directrices non publiées
Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 446826, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23279GB
Lecture: 2 min
N4585BZT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 08 Mars 2023
► S'il appartient, en principe, à l'administration de publier au préalable les instructions et circulaires dont elle entend se prévaloir à l'égard de ses administrés, la seule circonstance qu'elle fonde sa décision sur des motifs repris ou identiques à ceux de lignes directrices qui n'auraient pas fait l'objet d'une publication n'entache pas d'illégalité cette décision.
Faits. Le ministre de la Défense a, le 30 janvier 2015, émis un avis défavorable aux permis de construire huit éoliennes sur le territoire des communes de Boffles, Buire-au-Bois et Rougefay sollicités par la société Eoliennes des Cosmos, du fait de la proximité du radar de défense de Doullens, en reprenant notamment, pour apprécier les perturbations pouvant être générées par les éoliennes projetées sur le fonctionnement de ce radar, des critères d'appréciation, issus d'une étude technique réalisée par ses soins en novembre 2009, qu'il applique depuis 2010 pour définir les zones de protection et de coordination des radars de défense et dont un exposé était joint en annexe 2 de cet avis.
Décision CE. La cour administrative d’appel a pu estimer, sans erreur de droit, que le ministre de la Défense avait pu se fonder sur des éléments d'appréciation comportant, notamment, les critères litigieux d'appréciation des perturbations générées par les éoliennes sur le fonctionnement des équipements militaires, alors même que ces derniers n'auraient pas fait l'objet d'une publication préalable, dès lors que ceux-ci étaient repris de manière explicite dans l'avis du 30 janvier 2015 et dans ses annexes.
Précisions rapporteur public. Selon Nicolas Agnoux, « nous n’identifions ni dans les termes de la loi de 1978 ni d’ailleurs dans ceux du CRPA désormais en vigueur d’obligation pour l’administration de publier l’intégralité des éléments de la doctrine émanant de ses décisions ou de ses avis, ou révélée par ces réponses. Toute autre interprétation aurait pour conséquence de paralyser l’action administrative en contraignant chaque département ministériel à publier et tenir à jour l’ensemble des prises de position qu’elle retient dans l’interprétation des textes avant de pouvoir en faire application aux situations individuelles dont elle est saisie ».
| À ce sujet. Lire A. Bron, Droit souple : de nouveaux horizons contentieux, Lexbase Public, mai 2022, n° 667 N° Lexbase : N1490BZ9. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484585
[Le point sur...] Numéro spécial "Femmes Avocates : Égalité et sororité" - La dévirilisation de l’office d’avocat : la loi du 1er décembre 1900
Lecture: 42 min
N4533BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Hélène Duffuler-Vialle, Maîtresse de conférences en histoire du droit, membre du Centre Droit, Éthique et Procédures (CDEP, EA 2471), membre associée du Centre d’Histoire Judiciaire (CHJ, UMR 8025), coordinatrice du projet ANR HLJPGenre*
Le 08 Mars 2023
Mots-clés : femme • avocate • féminisation • genre • loi du 1er décembre 1900 • Jeanne Chauvin • virilité
L'étude de la féminisation du métier d’avocat révèle des logiques qui se retrouvent dans le processus de féminisation de l’ensemble des secteurs traditionnellement réservés aux hommes, mais qui présentent aussi des spécificités liées aux métiers juridiques, et en particulier à la représentation de la fonction d’avocat, en tant qu’« office viril ». Plus largement ce processus s’inscrit dans une histoire globale de l’évolution des droits des femmes. À la fin du XIXe siècle, quelques femmes, des pionnières féministes, lèvent progressivement les différents obstacles qui les séparent du barreau, pour autant les portes du Palais leur sont fermées par une décision emblématique de la cour d’appel de Paris du 30 novembre 1897. Les débats parlementaires sont houleux sur le sujet. Que ce soit dans le camp des opposants ou des défenseurs, se dessine la figure de « la femme », dans une altérité réifiée, dont les répercussions se retrouvent encore aujourd’hui tant dans les représentations des femmes avocates elles-mêmes que dans les rôles sociaux et professionnels auxquels elles restent cantonnées. Une loi sexospécifique, c’est-à-dire qui vise directement les femmes identifiées comme telles, sera votée le 1er décembre 1900, pour leur permettre l’accès à la profession d’avocate avec un régime différencié de celui des hommes avocats. Malgré cette loi, jusqu’à la fin de l’entre-deux-guerres, la présence des femmes dans les barreaux reste très marginale, ce qui oblige les quelques pionnières à adopter des stratégies particulières dans un milieu masculin globalement hostile.
L’homme de loi n’était certainement pas une femme au XIXe siècle. C’est d’une évidence telle que lorsque la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) [1] réinstaure officiellement le métier d’avocat [2], le sujet n’est même pas évoqué. Et pourtant, dès la Révolution, des voix dissidentes réclament l’égalité des sexes en matière de droits politiques et professionnels. Pour ne citer que la plus célèbre, Olympe de Gouges propose d’être la défenseuse officieuse [3] – car le titre d’avocat, le costume et l’Ordre ont été supprimés sous la Révolution – de Louis XVI [4]. Paradoxe macabre : si Olympe de Gouges n’est pas montée à la tribune [5] pour défendre Louis Capet, elle monte sur l’échafaud notamment pour l’avoir proposé.
Peu de travaux ont été consacrés en histoire du droit à l’accès des femmes à la profession d’avocates : dans sa thèse soutenue en 1995 sur La profession d’avocat et son image dans l’entre-deux-guerres, Catherine Fillon réserve vingt pages à ce thème, elle présente trois figures de « la femme avocate » : « la mère oblative », l’« Eve-tentatrice » ou l’« Amazone intrépide ». Pour ce faire, l’historienne du droit étudie les discours de rentrée solennelle des juridictions, les publications de l’Ordre des avocats, ainsi que les caricatures, les pièces de théâtre, les cartes postales, les romans mettant en scène des avocates et enfin une enquête de 1930 réalisée par un avocat, Maître Corcos, recueillant des témoignages sur la perception de « la femme avocate » [6]. Annie Deperchin, spécialiste de la Première Guerre mondiale, a également déjà consacré quelques développements à ce sujet, dans un chapitre sur la justice pendant la Première Guerre mondiale, dans l’ouvrage de référence sur l’Histoire de la Justice dirigé par Jean-Pierre Royer [7]. Elle présente, dans un ouvrage très récent sur Les magistrats et les avocats pendant le premier conflit mondial [8], de précieuses pages sur « La guerre, les femmes et le barreau ». Elle y souligne la misogynie du barreau et présente quelques pionnières, dont, bien sûr, l’incontournable Jeanne Chauvin. Elle étudie également des pièces de théâtre, des articles de presse et des sources directes du barreau de Bordeaux et de Toulouse. Elle montre que, malgré le rôle laissé aux femmes lors de la Première Guerre mondiale, il n’y eut pas de changement structurel à l’issue du conflit. Dans les Études d’histoire de la profession d’avocat, publiées en 2004 [9], seul un paragraphe est consacré à la première avocate du barreau de Toulouse [10] en concluant un peu rapidement que l’accès de celle-ci au barreau n’avait pas posé de difficulté [11]. Dans l’ouvrage Histoire des avocats en France, des origines à nos jours, deux pages sont consacrées aux premières femmes ayant prêté serment, Jeanne Chauvin et Olga Petit. Ces pages soulignent les difficultés d’accès des femmes à la profession d’avocate avec l’adage « Robe sur robe ne vaut », ainsi que l’isolement des pionnières, mais il précise de manière quelque peu exagérée que Jeanne Chauvin aurait ensuite été accueillie par ses confrères « à bras ouverts » [12]. Les travaux de référence sur le sujet sont à chercher également hors de la sphère juridique : en histoire et en science politique. Par exemple, l’importante thèse de Juliette Rennes propose une analyse fine des débats parlementaires sur la question de l’accès des femmes aux professions de prestige, dont les professions juridiques. Paradoxalement, il existe également une littérature plus abondante sur les femmes avocates françaises aux États-Unis [13].
Les études de genre permettent une analyse novatrice et féconde des phénomènes juridico-politiques, celles-ci sont relativement récentes en droit et presque inédites encore en histoire du droit en France [14]. Cet article sur l’accès des femmes à l’avocature s’inscrit résolument dans ce champ, en intégrant donc une approche critique des présupposés essentialistes liés à la réification de « la femme ». À cette fin seront principalement analysés, avec la grille de lecture du genre, l’arrêt de la cour d’appel du 30 novembre 1897 et les débats parlementaires de la Chambre des députés du 30 juin 1899 et du Sénat du 13 novembre 1900.
Comment la profession d’avocat s’est-elle progressivement ouverte aux femmes ? Par quels leviers, quelles stratégies, dans quel contexte ? Quels sont historiquement les facteurs identifiables qui expliquent aujourd’hui encore les différences de genre entre les individus dans l’exercice de leur profession ?
L’étude de la féminisation du métier d’avocat révèle des logiques qui se retrouvent dans le processus de féminisation de l’ensemble des secteurs traditionnellement réservés aux hommes, mais présentent aussi des spécificités liées aux métiers juridiques, et en particulier à la représentation de la fonction d’avocat. Plus largement ce processus s’inscrit dans une histoire globale de l’évolution des droits des femmes. À la fin du XIXe siècle, quelques femmes, des pionnières féministes, lèvent progressivement les différents obstacles qui les séparent du barreau, pour autant les portes du Palais leur sont fermées par une décision emblématique de la cour d’appel de Paris en 1897 (I). Une loi sexospécifique,- c’est-à-dire qui vise directement les femmes, identifiées comme telles –, sera votée pour leur permettre l’accès à la profession d’avocate avec un régime spécifique et différencié de celui des hommes avocats. Malgré cette loi, jusqu’à la fin de l’entre-deux-guerres, la présence des femmes dans les barreaux reste très marginale, ce qui oblige les quelques pionnières à adopter des stratégies particulières dans un milieu masculin globalement hostile (II).
I. Les femmes, aux portes du barreau
Lorsque la profession d’avocat est réinstitutionnalisée par Bonaparte, l’accès est conditionné à l’obtention d’un diplôme de licence [15]. Or à l’époque napoléonienne, dans la continuité de l’Ancien régime [16], l’instruction est réservée en théorie aux hommes. En effet, Napoléon Bonaparte reprend les poncifs, issus de la pensée grecque et romaine, selon lesquels les femmes n’auraient pas besoin de bénéficier d’une éducation intellectuelle, à la fois parce qu’elles n’en auraient pas les capacités et parce qu’elles seraient inconsistantes et futiles. Il ajoute une composante genrée à ces approches essentialistes, c’est-à-dire qu’il ajoute une dimension spécifiquement culturelle : les qualités que la société attend des femmes, à savoir résignation et indulgence, ne reposent pas sur leur instruction, mais sur leur dévotion [17]. La loi sur l’instruction publique du 11 floréal an X (1er mai 1802) institue les lycées, en interdisant leur accès aux femmes. Seuls les hommes sont concernés par les dispositions relatives à l’école primaire et à l’école secondaire [18].
Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, l’instruction publique des filles est timidement organisée en primaire [19]. L’ordonnance du 23 juin 1836 organise la profession d’institutrice et permet aux femmes d’obtenir leur premier diplôme d’État : le brevet de capacité, indispensable pour exercer la profession d’instituteur [20]. Jusqu’à la fin du Second Empire, et au-delà des textes, aucune femme ne parvient à transgresser la règle et à accéder à l’Université, car l’accès à l’enseignement secondaire leur est fermé et a fortiori l’enseignement universitaire, conditionné à l’obtention du baccalauréat. Même les femmes des milieux élitistes, dont l’éducation parfois très poussée se fait en marge du système étatique via certains couvents ou par des précepteurs personnels [21], ne parviennent pas à forcer les portes, et ce jusqu’en 1860, date à partir de laquelle des pionnières féministes ouvrent des passages (A) jusqu’aux portes du barreau (B).
A. Du baccalauréat à la faculté de droit
Julie-Victoire Daubié parvient à passer le baccalauréat en 1861 [22]. Sa trajectoire est remarquable comme souvent le sont celles des pionnières : il s’agit d’une féministe militante issue de la petite bourgeoisie, qui réclame des droits politiques et dénonce la précarité économique des femmes et la prostitution réglementée [23]. Elle passe le seul diplôme accessible aux femmes, le brevet supérieur de capacité, et devient alors préceptrice. Autodidacte, elle apprend le grec et le latin notamment grâce à l’aide de son frère, enseignement subversif, car les humanités (grec, latin, philosophie) étaient considérées comme particulièrement nobles et dévolues aux hommes, toujours avec cette idée qu’élever intellectuellement les femmes risquait de leur faire perdre la modestie requise pour leur rôle social de mère et d’épouse. Soutenue par des alliés, dont l’homme d’affaires saint-simonien Arlés-Dufour [24], elle tente de passer le baccalauréat à Paris, sans succès, et réussit à le passer à Lyon du fait du geste militant du doyen de la faculté Francisque Bouiller. Elle obtint la mention passable, ce qu’elle mit en avant pour expliquer qu’elle n’était pas une femme d’exception dont les qualités hors du commun justifieraient sa transgression de genre, mais une femme aux capacités ordinaires, ceci afin de ne pas ériger en exploit individuel une démarche féministe [25]. L’étude du processus de féminisation d’un champ jusque-là interdit aux femmes invite à ne pas se focaliser sur les pionnières, car ce serait donner l’impression erronée d’une rupture. Il est important de rappeler que les pionnières sont insolites, seules, rares, hors-normes. La seconde bachelière, Emma Chenu, sera elle-même la seule femme, deux ans après Julie-Victoire Daubié, et on ne compte que d’une à cinq bachelières par an. Entre 1860 et 1880, la présence de femmes à l’Université reste une marginalité extrême [26].
Il faut attendre la loi du 21 décembre 1880, sous la IIIe République, pour que l’enseignement secondaire soit ouvert aux femmes. Le programme n’est pas harmonisé avec celui des hommes. Il est plus léger. Si tous et toutes étudient la langue française, les langues vivantes, la littérature et l’histoire, les « humanités » (le grec, le latin et la philosophie) ne sont dispensées qu’aux hommes. Les femmes suivent des cours de « travaux d’aiguille ». Elles ne sont pas censées passer le baccalauréat, mais un diplôme de fin d’études [27]. Néanmoins, en candidates libres, les femmes sont alors neuf ou dix par an à passer le baccalauréat, davantage ès sciences qu’ès lettres, tendance qui s’inversera à partir de 1900. Elles représentent moins de 0,03 % des bachelier·es. Comme l’explique l’historienne Carole Christen-Lécuyer, les bachelières sont souvent plus âgées que les bacheliers et vivent les conditions de leur oral de manière particulière, le public se presse pour observer le spectacle : l’impétrante « devenait le point de mire de tous les yeux, rouge, embarrassée, elle n’osait gagner sa place ; les examinateurs, presque aussi gênés qu’elle, n’osaient faire asseoir, au milieu de tous ces pantalons, cette jupe » [28].
Le baccalauréat, s’il est une condition d’accès à l’Université, n’est pas pour autant le sésame qui ouvre la porte de la faculté de droit. En effet, dans les représentations, les facultés de médecine ou de pharmacie semblent « prédisposées » à accueillir les femmes, car, bien que celles qui étudient soient transgressives, la finalité de l’étude, à savoir soigner autrui dans la sphère domestique, renvoie à un rôle social féminin, et même à une caractéristique de l’« identité féminine ». La finalité du droit s’inscrit dans un tout autre imaginaire : les métiers emblématiques – avocats et magistrats – sont des professions de pouvoir dans l’espace public, viriles par essence. Les femmes qui prétendent étudier le droit sont donc doublement transgressives : elles étudient et elles veulent conquérir des espaces masculins identitaires. Aussi ce n’est qu’en 1884 que Sarmiza Bilcesco, Roumaine féministe de dix-sept ans, son double baccalauréat en poche : ès lettre et ès science, tente de franchir les portes de la faculté de droit de Paris et se voit bloquer l’entrée par l’huissier qui refuse de la laisser passer parce qu’elle est une femme [29]. Le conseil de faculté est alors appelé à statuer. Il tranche en la faveur de l’étudiante malgré une forte opposition dont celle du doyen Beurdant. Sarmiza Bilcesco fit alors face à l’hostilité des professeurs de droit. Confrontés à l’éventualité de la présence de femmes dans leurs amphithéâtres, les professeurs réactionnaires rivalisèrent d’ingéniosité dans la recherche d’arguments pour dissuader les femmes de s’inscrire et développèrent toute une théorie selon laquelle le fameux « esprit juridique » serait spécifiquement masculin. L’esprit féminin ne serait qu’intuitif ou à l’inverse mécaniquement déductif sans capacité d’abstraction et d’intellectualisation, et il lui manquerait nuance et subtilité qui permettent la déduction souple requise pour le raisonnement juridique [30]. Ne leur en déplaise, Sarmiza Bilcesco obtint sa licence en droit en 1887, major de sa promotion, lauréate du concours de droit romain et elle soutint un doctorat en 1890 sur La condition légale de la mère [31]. Néanmoins, elle n’est pas suivie de beaucoup d’émules, car le droit reste dissuasif pour les femmes : de 1884 à 1894, deux femmes s’inscrivent en moyenne chaque année à la faculté de droit de Paris. Par comparaison les femmes sont 575 à la faculté de médecine, 31 à la faculté des sciences, 61 à la faculté de lettres et 54 en pharmacie.
Les quelques femmes qui accèdent à la faculté viennent accompagnées de leur mère ou de leur mari, car la mixité fait craindre pour leur réputation. La présence de femmes dans les amphithéâtres suscite des commentaires de la part des professeurs invitant les hommes à la courtoisie, renvoyant ainsi les femmes à un statut d’objets de désir, d’éléments potentiellement perturbateurs. Les femmes développent alors des stratégies pour permettre à la figure de « l’étudiante » de supplanter celle de « la femme » : tenue simple, bras et gorge couverts. Elles tentent de lutter contre les préjugés relatifs à leur inconsistance, leurs faibles capacités intellectuelles, leur faiblesse face à l’effort. Ces stratégies permettent aux femmes de s’imposer comme étudiantes, mais entraînent leur discrédit en tant que femmes, car elles perdent alors leur statut d’objets de désir pour devenir, dans un sens positif, « des camarades » ou dans un sens négatif des « transgressives », qui par leurs aspirations intellectuelles ont trahi la place sociale qui était la leur en tant que femme [32].
Le diplôme de licence de droit en main, il reste encore une dernière porte à forcer pour l’accès à la profession d’avocat : celle du barreau. Ce sera le combat de Jeanne Chauvin.
B. L’échec judiciaire de l’inscription au barreau
En 1890, Jeanne Chauvin est la deuxième étudiante titulaire d’une licence en droit, après Sarmiza Bilcesco, devenue avocate en Roumanie. Jeanne Chauvin vient d’une famille de juristes : son père, mort alors qu’elle était en bas âge, était notaire et surtout son frère Émile est lui-même docteur en droit, avocat et maître de conférences à la faculté de droit de Paris, avant d’être radié pour ses idées socialistes. Jeanne Chauvin soutient une thèse en droit en 1892 intitulée Étude historique des professions accessibles aux femmes, dans laquelle elle développe l’idée que l’inégalité juridique des hommes et des femmes est imputable au catholicisme – stratégie intéressante dans un contexte de laïcisation des institutions sous la IIIe République – afin de prôner l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Sa soutenance est ajournée une première fois, car des étudiants font irruption pour chanter La Marseillaise en protestation, ce qui n’empêche pas Jeanne Chauvin d’être reçue à l’unanimité des membres du jury quelques jours plus tard. Elle enseigne le droit dans des lycées parisiens pour jeunes filles tout en militant en faveur de la capacité juridique des femmes mariées. Elle souhaite forcer la porte du barreau [33]. L’entreprise s’annonce délicate. En Belgique, Marie Popelin, dix ans avant elle, avait essayé jusqu’en cassation, sans succès. Elle avait été mise en cause personnellement, s’était vu reprocher « ses virils efforts », et avait été ramenée à son rôle de femme : la maternité, la conjugalité, ses qualités de femme ; la modestie et la pudeur, sa condition de femme ; sa faiblesse physique et sa condition juridique de femme ; ses incapacités civiques et civiles. Le prestige du barreau empêchait de reconnaître parmi ses membres un être de condition inférieure et en outre la société avait le devoir de protéger la pudeur des femmes des sujets scabreux abordés devant les juridictions. L’argument juridique principal se référant à la loi napoléonienne – donc la même que celle applicable en France – avait estimé qu’une condition de sexe implicite interdisait l’accès des femmes au barreau : le barreau était un office viril.
Tous les hommes juristes n’étaient pas hostiles à l’accès des femmes au barreau. Au-delà des proches des pionnières, certains juristes féministes n’ont pas hésité à se faire les porte-parole des femmes, ou à défendre leurs propres positions sur le sujet. C’est notamment le cas de Louis Franck, avocat et docteur en droit de l’Université de Bologne et de Bruxelles, ouvertement féministe qui défendit Marie Popelin en justice et qui ensuite rédige en 1898, un ouvrage en soutien de la cause de Jeanne Chauvin. De manière moins ouvertement engagé, c’est le cas en France du professeur de procédure civile et spécialiste de l'histoire du droit français, du droit romain et du droit comparé Glasson, qui commente les arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation belges. L’argument juridique mis en avant est le suivant : l’égalité est la règle, l’inégalité l’exception…. Le silence de la loi sur l’accès des femmes à la profession d’avocat n’est pas une exclusion implicite, c’est un impensé. Or seul un texte peut décider de l’incapacité juridique des femmes en telle ou telle matière. Dans le silence de la loi, la femme peut s’infiltrer [34].
Quel est le problème avec la profession d’avocat pour les femmes ? Les représentations renvoient à une profession de pouvoir viril qui évoque le combat judiciaire, la joute oratoire. L’avocat est un guerrier du droit dont l’arme est la parole. Ce combat est public. L’accès des femmes au barreau signifie qu’une femme pourrait descendre dans l’arène judiciaire, affronter un homme, voire remporter la victoire. Au-delà du risque de dévirilisation de la profession, ce sont les hommes eux-mêmes qui risquent leur virilité dans un affrontement juridique avec des femmes [35].
Jeanne Chauvin adopte la stratégie de l’étape intermédiaire : elle prétend demander l’inscription au barreau pour obtenir le titre d’avocate, mais sans s’inscrire au stage, donc sans exercer réellement la profession. Le 24 novembre 1897, elle fait viser son diplôme de licence par le procureur général Octave Bernard, près la cour d’appel de Paris, assistée d’un avoué. Elle plaide elle-même sa cause devant la cour. Le procureur répond à l’argument de Glasson, qu’il cite expressément, et affirme que l’exclusion des femmes de la profession d’avocat en droit ne serait pas un impensé, mais bien une exclusion implicite : la femme serait un « hors objet » du droit. Le débat juridique entre le procureur Bernard et Jeanne Chauvin sur la question du genre de la langue et des catégories du droit est extrêmement intéressant et a des résonnances très actuelles. « L’avocat », donc l’emploi du masculin dans les termes de la loi, est-il un masculin genré ou un masculin générique, renvoie-t-il au genre masculin ou est-ce un masculin universel qui inclut le féminin ? Jeanne Chauvin défend le masculin générique, l’idée que les catégories juridiques sont souples et qu’en fonction de l’évolution des mœurs elles incluent des situations impensées à l’origine. Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire de féminiser un texte pour le dégenrer : elle prend l’exemple de la loi invoquée par le procureur, celle de ventôse an XII, qui porte sur la formation en droit, et démontre qu’il n’a pas été nécessaire de modifier la loi en utilisant les termes d’« étudiante », « licenciée » et « doctoresse » pour appliquer les articles en question aux femmes. Au-delà des différents arguments juridiques avancés, le procureur Bernard défend une approche conservatrice de l’ordre juridique genré : « l’on ferait un premier pas dans un ordre de progrès qui mènerait trop loin ». Il rappelle la place culturelle des femmes dans la société dans des termes qui n’auraient rien à envier à une mauvaise accroche d’un·e étudiant·e en première année de droit : « de tout temps, à toutes époques, on a reconnu que la femme ne devait pas sortir du cercle de la famille ». Pour autant s’il mobilise un argument genré, il ne s’engage pas sur un terrain essentialiste [36].
L’arrêt de la Cour rejette la demande de Jeanne Chauvin. Elle est, elle-même, personnellement mise en cause et dénoncée comme manipulatrice et arrogante, ce qui à la fois renvoie au préjugé relatif à la fausseté des femmes et en même temps dénonce la transgression de genre, à savoir l’attitude de Jeanne aux antipodes de la modestie, composante de la féminité. L’avocature est une profession réservée aux hommes : « cette règle absolue qui n’était que l’application logique du principe en vertu duquel on a toujours considéré la profession d’avocat comme un office viril ». Enfin, ultime argument décisif : la profession d’avocat n’est pas qu’une profession libérale, car une disposition de la loi napoléonienne prévoit que l’avocat supplée le magistrat en cas de carence de celui-ci [37]. Or le magistrat exerce l’autorité de l’État, un pouvoir régalien qui ne saurait être confié à un être dépourvu de droits civiques et politiques. La Cour se retranche derrière son rôle d’interprétation stricte de la loi et estime que ce n’est pas à la justice de faire évoluer les mœurs. La solution de l’accès des femmes à la profession d’avocate ne peut être judiciaire [38]. Jeanne Chauvin, pour ne pas reproduire l’exemple belge et auréoler la décision de l’autorité de la juridiction supérieure, décide de ne pas poursuivre ce débat stérile devant les magistrats conservateurs de la Cour de cassation. Étant proche des milieux politiques radicaux-socialistes, elle se tourne vers l’assemblée.
La résistance judiciaire masculine, qui interprète une catégorie juridique potentiellement universelle comme irrémédiablement genrée, forcera donc la rédaction d’une loi sexospécifique pour permettre l’accès des femmes au barreau.
II. L’accès des femmes au barreau
La lecture des débats parlementaires révèle des présupposés genrés caricaturaux sur la place des femmes et leur nature spécifique. Que ce soit dans le camp des opposants ou des défenseurs, ils dessinent la figure de « la femme », dans une altérité réifiée, dont les répercussions se retrouvent encore aujourd’hui tant dans les représentations des femmes avocates elles-mêmes que dans les rôles sociaux et professionnels auxquels elles restent cantonnées. Si les femmes accèdent au barreau, elles ne seront pas pour autant des avocat·es comme les autres, car la loi prévoit des conditions spécifiques pour les femmes (A). Au-delà des débats, la féminisation du barreau reste très marginale jusqu’à la fin de l’entre-deux-guerres (B).
A. Une loi sexospécifique
Jeanne Chauvin est soutenue par des parlementaires : Léon Bourgeois, radical-socialiste, Jules Léveillé, député de la Seine et Professeur de droit pénal à la faculté de droit de Paris, Paul Deschanel et Raymond Poincaré, alors tous deux députés républicains modérés (centre gauche) qui déposent à la Chambre la proposition de loi de Jeanne Chauvin, dépassant sa demande initiale et proposant l’accès des femmes non seulement au titre, mais également à l’exercice de la profession d’avocate. La proposition est écartée par la VIe législature, mais lors de la VIIe, un groupe de députés – derrière René Viviani, lui-même radical-socialiste, avocat et proche de la famille Chauvin – la dépose à nouveau le 21 novembre 1898. Lors du débat parlementaire du 30 juin 1899 à la chambre des députés, la gauche s’oppose frontalement à l’extrême droite sur cette question. Le rapporteur René Viviani, qui défend le projet de loi, met en avant les enjeux économiques de l’accès à la profession d’avocate, qui entraîneraient une égalité financière entre les sexes permettant aux femmes de s’émanciper, tout en souscrivant à leurs obligations familiales, car les femmes, comme les hommes, peuvent les concilier avec leurs obligations professionnelles. Il inscrit cette proposition de loi dans la politique de la IIIe République ; l’accès à la profession d’avocate ne serait que la suite logique de l’instruction des femmes développée depuis 1880, et dans un contexte international : la Norvège, la Suède, la Suisse et les États-Unis ont autorisé les femmes à exercer la profession d’avocate. Pour autant la proposition de loi met en place des différences de traitement entre les hommes et les femmes avocat·e·s : les femmes ne pourront pas suppléer les magistrats en cas de carence, à l’instar des avocats stagiaires. En outre les femmes mariées devront obtenir l’autorisation de leur mari avant de prêter serment, conformément aux règles du Code civil [39]. Du côté des opposants, deux députés se révèlent particulièrement virulents : le député Massabuau, alors républicain indépendant et membre du terrifiant groupe parlementaire antijuif, et le comte Henri du Périer de Larsan, député chez les républicains progressistes (aile paradoxalement la plus conservatrice des républicains). Leurs arguments sont les mêmes sur la dénonciation de la transgression de genre que représenteraient les femmes au barreau : Massabuau en reprenant la terminologie de la lutte des classes – la femme avocate serait « une déclassée », « un de ces êtres monstrueux qui descendus trop bas, ou montés trop haut, ne peuvent plus s’harmoniser dans leur milieu » –, Périer de Larsan sous l’angle de l’utilité : « Quand on intervertit les rôles, quand la femme veut faire l’homme, elle s’en acquitte aussi mal que quand l’homme veut faire la femme », la femme avocate serait donc nécessairement mauvaise. Les exemples étrangers évoqués ne concernent que des pays dénoncés comme primitifs ou dépravés, à l’instar des femmes américaines qui seraient vénales et/ou vicieuses. Ils rappellent tous deux que la place des femmes est au sein de la famille et certainement pas au prétoire. « La femme » pourrait éventuellement exercer certaines professions, mais seulement si ces professions renvoient aux caractéristiques de l’identité féminine, à l’instar de la médecine. Le prestige de la profession d’avocat serait compromis par la présence de femmes, qui, en outre, risquerait de jeter l’opprobre non seulement sur l’avocature, mais également sur la magistrature, car « la femme » est séductrice. Les justiciables pourraient penser que les magistrats n’ont rendu la décision que sous l’emprise du charme de « la femme avocate ». « La femme » séductrice, « la femme » sexuelle, « la femme dangereuse » se cacherait sous la robe de l’avocate [40], que d’ailleurs elle porterait nécessairement mal étant donné que la robe est virile. Massabuau propose une meilleure occupation pour les femmes : mettre leur pouvoir de séduction au service de la France en attirant les hommes dans les colonies pour asseoir la domination française hors métropole. Enfin la liberté de « la femme avocate » serait incompatible avec le mariage et obligerait « la femme avocate » à être célibataire. Massabuau dénonce derrière cette loi les dangers du féminisme. Il estime qu’ouvrir la profession d’avocat aux femmes est la première marche qui entraînera ensuite la reconnaissance du droit de vote des femmes, puis la remise en cause de l’institution du mariage et enfin la destruction des fondements du capitalisme qui reposent sur la propriété patriarcale. Périer de Larsan souligne que le sujet est plus que futile, qu’en un mot, c’est ridicule. L’égalité des sexes étant impossible, la prétention des femmes à être avocates est hors-sol : et ensuite que réclameront-elles « plaider à la Cour de cassation et au Conseil d’État ou encore faire partie du Conseil de l’Ordre et même être élue Bâtonnière ? » Et la majesté du prétoire déclinera « quand le président aura donné la parole à maîtresse une telle ». Malgré ces discours virulents, à l’issue de ce débat, la loi est votée au 30 juin 1899 à l’Assemblée nationale par 319 voix contre 174 ; le projet a été soutenu par la gauche en général, mais aussi par une partie du centre droit [41].
La proposition est alors débattue au Sénat le 13 novembre 1900. Dans ce débat l’opposant principal est le sénateur Gourju, avocat, républicain progressiste, qui rappelle la fameuse référence de Jean-Louis de Lolme, juriste suisse et calviniste de la fin du XVIIIe siècle, selon laquelle le Parlement anglais pouvait tout faire « sauf changer une femme en homme ». Permettre aux femmes d’accéder à la profession d’avocat reviendrait à viriliser les femmes. Il explique que l’égalité n’implique pas la confusion d’identité entre les hommes et les femmes. Les femmes seraient supérieures aux hommes pour tout ce qui touche à l’émotionnel : pitié, charité, dévouement, soins, etc., mais les aptitudes nécessaires à la profession d’avocat sont l’éloquence, la prestance, la maîtrise de la pratique du droit, les réseaux et le sens des affaires. Or la femme est-elle suffisamment « armée » (le mot est intéressant) dans tous ces domaines ? La concurrence entre avocats est très rude, peu d’hommes s’enrichissent, et la femme « sera broyée », car elle est plus nerveuse que l’homme et a moins de philosophie. Si quelques femmes exceptionnelles bénéficient de telles aptitudes, ce sera au prix de leur fatigue et de leur santé, car les femmes n’ont pas les mêmes capacités de résistance physique que les hommes. En outre sous la robe les avocats trouvent des techniques dans leur toilette pour réguler leur température, que les femmes ne pourraient pas copier pour des raisons de décence : une femme ne saurait avoir une toilette désordonnée. Autre argument : si des nations subalternes font peu de cas de la profession d’avocat, en France « la voix de l’avocat à la barre est considérée comme une des grandes voix du monde », ce qui exclut la femme. En outre les mots du droit ne sont pas élégants dans la bouche d’un homme, donc a fortiori ils seraient insupportables dans la bouche d’une femme. Par ailleurs, la femme avocate mariée ne pourrait être nécessairement que la secrétaire de son mari. Il décide ensuite de s’adresser, au-delà des hommes de l’hémicycle, aux femmes qui liront la retranscription des débats en leur rappelant qu’elles gouvernent le monde en séduisant les hommes : l’accès à la profession d’avocate serait « une déchéance que, pendant tant de siècles, tant de générations n’ont pas connue et dont elles se sont passées avec tant de grâce, avec tant d’unanimité. Pour moi, je refuse […] de m’associer à un pareil crime de lèse-majesté féminine ». Le rapporteur est alors Louis Tillaye, également républicain progressiste. Il défend la proposition en atténuant la portée de cette loi – seules quelques femmes seront concernées, des femmes exceptionnelles : il ne s’agit donc que de faire entrer « quelques femmes d’élite qui sont l’honneur de leur sexe » – tout en affirmant que la place naturelle des femmes se trouve dans la famille et que le droit doit se charger de les y maintenir. Le rapporteur écarte donc complètement les arguments féministes et met en avant le principe fondamental de liberté des professions et l’évolution des mœurs, tout au long du XIXe et en particulier depuis l’avènement de la IIIe République. Il souligne que la loi prévoit de fermer la porte à toute velléité des femmes de devenir magistrates puisqu’elle ne les autoriserait qu’à plaider, activité qui relève de la profession libérale et réglementée, et non à juger qui relève de l’exercice de l’autorité publique. Interrogé sur le positionnement du Gouvernement par rapport à ce texte, le garde des Sceaux – à savoir Ernest Monis, ministre de la Justice du Gouvernement Waldeck-Rousseau, Gouvernement de crise en plein cœur de l’affaire Dreyfus, avec une union politique allant de la gauche au centre – apporte le soutien du Gouvernement à cette proposition de loi. Il met en avant une approche différentialiste, estimant que les femmes avec leurs qualités spécifiques apporteraient de la bienveillance et de la commisération dans l’exercice de la justice et il justifie l’accès des femmes à la profession d’avocat par le fait que les femmes avocates défendraient particulièrement bien les mères de famille. La justice serait, grâce aux femmes, plus humaine et meilleure. Se dessinent ainsi deux projections. D’abord au nom des principes d’égalité et de mérite républicains, le barreau serait ouvert en théorie aux femmes, mais en pratique leur condition féminine les en détournerait : seules de très rares femmes accéderaient au barreau. Ensuite, une répartition sexuée des contentieux est amorcée avec l’idée que dans la pratique, certains domaines pourraient être dévolus aux femmes et que donc, a contrario, d’autres ne leur seraient pas accessibles. La loi est votée à 172 voix pour et 34 voix contre [42].
Elle est promulguée le 1er décembre 1900 et autorise les femmes titulaires d’un diplôme de licence à prêter serment et à exercer la profession d’avocate [43]. La même loi introduit une différenciation entre les hommes avocats et les femmes avocates : les femmes ne pourront pas suppléer les magistrats dans l’exercice de la fonction. Ainsi, la loi précise bien que les femmes peuvent devenir avocates, mais pas dans les mêmes conditions que les hommes, avec les mêmes restrictions à durée illimitée que les stagiaires. La porte du couloir vers la magistrature reste bien verrouillée. Néanmoins, la porte du barreau est ouverte, et le processus de féminisation de la profession peut s’amorcer.
B. Les pionnières du barreau
La première femme à prêter le serment d’avocate en France n’est pas Jeanne Chauvin, mais Sonia Olga Balachowsky-Petit, une femme d’origine russe, française par mariage, qui a fait des études de droit en France et a obtenu un doctorat : elle prête serment le 6 décembre 1900, quelques jours avant Jeanne Chauvin qui, elle, prête serment le 19 décembre. Jeanne Chauvin sera la première femme à plaider devant une juridiction.
Pour autant l’exemple de ces pionnières n’est que peu suivi, comme l’explique Annie Deperchin. Une femme s’inscrit au barreau de Paris en 1901, une autre en 1906, deux en 1907, trois en 1908, enfin deux en 1912. En 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, elles sont dix inscrites au tableau et dix-sept stagiaires pour toute la France. Ce sont vingt-sept femmes sur les 7 300 avocats, soit 0, 35 % de la profession. La plupart d’entre elles sont parisiennes (huit inscrites et treize stagiaires) et vingt-quatre sur vingt-sept appartiennent à un barreau de cour d’appel [44].
Les avocats contemplent ces femmes avec suspicion et méfiance : peur de la concurrence avec notamment le risque de mobilisations d’arguments extrajuridiques (leurs appâts sexuels contre lesquels ils ne pourront pas rivaliser…).
Aussi les avocates sont évaluées par leurs confrères qui cherchent la faille. Tel est le cas de la première femme inscrite au barreau de Toulouse, Marguerite Dilhan, qui est aussi la première femme à plaider en cour d’assises en novembre 1903. Elle défend une belle-mère accusée d’avoir tué son gendre. L’avocat Paul Duserm témoigne de cet événement dans la Gazette du Midi, il en souligne le caractère exceptionnel : la femme avocate devant la cour d’assises. Il commence par saluer avec une certaine condescendance les qualités de la jeune avocate dans la joute oratoire et la solidité juridique de sa plaidoirie. Marguerite Dilhan a convaincu l’auditoire en obtenant pour sa cliente une requalification en coups et blessures et une peine de dix-huit mois de prison, alors qu’elle encourait la peine de mort, mais Duserm commente les erreurs professionnelles de Marguerite Dilhan concernant l’« oubli » de la récusation de certains membres du jury. Il conclut sur le fait que la place de la femme n’est pas à la barre, mais au foyer conjugal. Surtout, il développe un argument qui sera largement développé par la suite : la voix féminine qui dessert la cause, « sonorité un peu grêle-voix de femme naturellement » [45]. On retrouvera cet argument très étayé sous l’entre-deux-guerres dans l’enquête de l’avocat Corcos sur les femmes avocates, analysée par Catherine Fillon : « en règle presque absolue, la femme ne sait pas placer sa voix […]. C’est un fait que la femme parle d’une voix de gorge, jamais d’une voix de ventre et qu’à cette habitude elle rencontre le double inconvénient de se fatiguer elle-même et de fatiguer l’oreille des auditeurs » [46]. Et la panacée de l’argument sexiste est atteinte avec cet extrait sur l’éloquence virile : « À la barre, il y a des moments où il ne s’agit plus de ce que l’on a préparé, il ne s’agit plus de promener son œil sur des notes, il s’agit de s’élever d’un coup, d’oublier tout un plan et, dans une sorte d’éclair de bâtir un édifice nouveau, d’en assembler les matériaux instantanément et, par leur jet d’écraser l’adversaire et de soumettre le juge. Cela n’est pas un geste de femme, c’est un geste masculin. C’est un geste, si vous me permettez la hardiesse de la figure, de fécondation. C’est une chose mâle, ce n’est pas une chose femelle » [47]. Un autre encore reprend cette idée avec l’éloquence qui serait un « viol des consciences et des cœurs ». Un certain nombre d’avocats refusent de voir arriver des femmes avec des arguments toujours plus indigestes, à l’instar de ce parallèle raciste : « Pourquoi ne pas reconnaître franchement que ce n’est pas un métier de femme ? Après tout il y a des incapacités de race ; il y a aussi des incapacités de sexe. La femme n’est pas faite pour la contradiction » [48].
Devant l’évolution législative, les avocats sont néanmoins bien obligés d’acter la présence de femmes parmi eux, aussi certains entendent bien marquer la différence de statut créée par la loi elle-même : les hommes peuvent plaider et juger, les femmes ne peuvent que plaider. Le discours de rentrée de la conférence du stage du Bâtonnier Henri Spriet à Lille, en 1926, sous couvert d’« humour », reprend tous les poncifs de la femme avocate. Il explique que la femme est « bavarde » d’où le fait qu’elle veut être avocate, néanmoins elle n’est pas l’égale de l’homme avocat. Si l’Assemblée législative interdit aux femmes avocates de suppléer les magistrats, c’est sans doute parce qu’elles sont estimées indignes de confiance, nerveuses et impressionnables. Mais comme il ne veut faire « aucune peine » aux avocates, il propose de voir dans cette disposition législative de la galanterie : les femmes sont ainsi éternellement stagiaires, donc éternellement jeunes [49].
Face à l’inexorable et progressive arrivée des femmes, le discours s’adapte sur la place des femmes dans les cabinets d’avocat·es. L’idée n’est progressivement plus de les exclure, mais de les renvoyer à une place subalterne. Les femmes seraient de bonnes assistantes, de bonnes collaboratrices pour leur patron, qui, dans le meilleur scénario possible, pourrait d’ailleurs devenir leur époux. Si la sensibilité des femmes leur permet de défendre certaines causes comme s’occuper des femmes et des enfants, leur nervosité les empêcherait de plaider des domaines dans lesquels il faut garder la tête froide comme le droit des affaires ou des questions techniques de droit civil. Ensuite, concernant le pénal, si les « petits contentieux » peuvent être concédés aux femmes, elles n’auraient pas la résistance physique pour tenir la durée des longueurs d’un procès d’assises [50].
Pendant l’entre-deux-guerres, l’image permanente des discours de rentrée solennelle des avocats et magistrats est celle de « la femme » attentionnée, maternelle, bienveillante, consolatrice. Le pays panse ses plaies, et la figure de « la femme/mère » apporte un certain réconfort. Les praticiens ne décrient plus la présence de femmes dans les barreaux en évoquant la transgression de genre. Au contraire, ils réclament une justice apaisante, réconfortante, genrée au féminin grâce à la présence de femmes. À condition bien sûr que les femmes se contentent de certains contentieux. Les femmes qui se risquent sur des terrains autres que le droit de la famille, le droit de la protection sociale et le petit contentieux pénal, sont, lorsqu’elles obtiennent des succès professionnels, disqualifiées en tant que femmes : « il y a quelques femmes qui tiennent le coup à la barre ; mais entre nous si on regarde bien, ce ne sont plus des femmes, alors c’est très gênant » [51].
En marge de ces discours majoritaires qui expliquent le long processus de féminisation du barreau dans un milieu masculin particulièrement hostile, il est à noter certaines prises de parole lumineuses. Pendant l’entre-deux-guerres, un avocat interrogé dans le cadre de l’enquête de Corcos sur la présence de femmes explique : « les difficultés que rencontrent les femmes au Palais ne sont pas en elles mais en nous » [52].
La lente progression des femmes au sein des facultés de droit se poursuit. En 1913, entre deux cents et deux cent cinquante femmes se trouvent sur les bancs de la faculté de droit. En 1914 il y a dix avocates et dix-sept stagiaires, en 1920, il y a dix-huit avocates et cinquante et une stagiaires, dont 80 % à Paris, avec les décès massifs des hommes avocats pendant la guerre, les femmes représentent 1,1 % de la profession, ce qui est quatre fois plus qu’avant-guerre, mais reste très marginal. En outre, il y a beaucoup d’abandons entre le stage et l’inscription : mariage qui implique un repli sur le foyer volontaire ou involontaire du fait de l’interdiction maritale potentielle, hostilité des collègues face à cette concurrence d’un nouveau genre, méfiance de la clientèle qui adhère potentiellement aux poncifs sur l’incompétence des femmes. Enfin, devenir avocate revient à assumer d’être la seule femme dans un milieu exclusivement masculin, donc une situation marginalisée et marginalisante, à l’instar de Marguerite Dilhan, qui fut pendant douze ans la seule avocate parmi les cent quatre-vingt avocats de son barreau [53].
Les femmes avocates doivent faire oublier leur féminité pour obtenir leur reconnaissance professionnelle : elles refusent d’être perçues comme des avocates et revendiquent d’être des avocats ; le terme « maîtresse » est utilisé pour se moquer des femmes avocates, aussi veulent-elles se faire appeler « maîtres ». Elles développent des stratégies dans ce sens et sont parfois obligées de réagir face aux attitudes sexistes des magistrats. Par exemple un magistrat appelle les avocats hommes « Maîtres » et l’avocate Clémence Davasse « Madame », ainsi elle rétorque de manière provocatrice : « Monsieur l’Avocat général, je vous prie de ne pas faire plus état de mon sexe que je ne le fais du vôtre ! » [54]. Sous l’entre-deux-guerres l’heure n’est pas aux enjeux de la féminisation du titre, mais au respect des qualités professionnelles des avocates. Avant de faire reconnaître que la féminisation d’un titre ne porte pas atteinte à son prestige, encore faut-il dans un premier temps ne pas être renvoyée systématiquement à son genre. Les processus de féminisation d’un corps sont longs et complexes et il serait trop rapide de lire rétrospectivement dans le refus de la féminisation du titre des femmes avocates, alors qu’elles étaient minoritaires et a fortiori alors qu’elles étaient extrêmement marginales, un argument général contre la féminisation des titres [55]. Tout est question d’étape de contextualisation et d’évolution du processus.
Le décret du 25 mars 1924 organise la passation pour les femmes du baccalauréat si elles suivent en parallèle du diplôme de fin d’étude secondaire un enseignement facultatif. Les femmes pourront ainsi suivre l’intégralité des enseignements dispensés aux hommes, mais elles sont obligées de suivre, en outre, des cours d’économie domestique, de travaux d’aiguille et de musique [56]. Cette loi entraînera des conséquences et le nombre de femmes s’inscrivant au barreau connaîtra une augmentation dans les années 1930-1935 [57].
L’accès des femmes à la profession d’avocate s’est réalisé dans un contexte difficile. Les pionnières – Suzanne Grinberg, Agathe Dyvrande-Thévenin, et la célèbre avocate féministe Maria Vérone [58] – ont franchi les portes du baccalauréat, de la faculté de droit, de l’inscription au barreau que Jeanne Chauvin a réclamé en justice puis à l’Assemblée législative. In fine, il apparaît que les enjeux liés à la féminisation de la profession portent également sur la déconstruction des représentations historiques liées à la « virilité » du métier d’avocat. Le processus de féminisation de la profession d’avocate est en marche depuis maintenant cent vingt-trois ans. Alors que jusqu’en 1900, aucune femme n’était inscrite au barreau, la situation a considérablement évolué [59]. Depuis les années 2010, les femmes sont majoritaires au barreau, ce qui fait de la profession d’avocat.e le métier du droit le plus féminisé [60]. Pour autant, le processus de féminisation n’est pas achevé : majoritaires par leur nombre, les femmes avocates restent soumises au plafond de verre, elles ne sont que 25 % à être associées. La répartition sexuée des contentieux reste très genrée dans le sens où elle renvoie aux rôles sociaux traditionnels des hommes et des femmes. Ainsi, on constate une surreprésentation des hommes dans certains secteurs prestigieux et rémunérateurs comme le droit des affaires ou le droit international, et une surreprésentation des femmes en droit de la famille et en droit du travail et de la protection sociale, considérées comme des disciplines subalternes du droit [61]. En outre les femmes sont victimes de discriminations sexistes dans les cabinets. Enfin, des questions liées au genre se posent dans la représentation au sein des conseils ordinaux [62]. Ces phénomènes, qui s’expliquent par des raisons historiques et culturelles, ont pour conséquence le fait qu’aujourd’hui encore, les femmes gagnent en moyenne deux fois moins que les hommes [63].
[1] [En ligne] Cet article a bénéficié de la relecture attentive et des précieux conseils d’Elise Ternynck et des historiennes du droit Prune Decoux et Florence Renucci, dont les récents et passionnants travaux sur les pionnières avocates du Maghreb dans un contexte colonial, avec une analyse intersectionnelle, sont à mettre en perspective avec le présent travail : F. Renucci, Les premières avocates du Maghreb (début du XXe siècle). L’émancipation au prisme de l’intersectionnalité, dans B. Dupret, N. Bernard-Maugiron (dir.), Droits et sociétés du Maghreb, Paris, Karthala, 2023 et Les premières avocates du Maghreb (début du XXe s.). Des « avantages cumulés genrés » ? , dans Les juifs des protectorats du Maghreb et la France, Paris, Garnier, 2023.
[2] Après sa « disparition » lors de la période révolutionnaire – disparition relative car, de fait, le défenseur officieux et l’avoué remplissaient l’office, exception faite de l’époque de la Grande Terreur.
[3] Sous la Révolution les défenseurs officieux permettent en théorie à tout citoyen de se défendre lui-même ou de défendre autrui. Cette phase informelle de la profession d’avocat aurait pu être une des portes d’entrée des femmes. Or d’après les études consultées, il n’y eut pas de femmes. De fait, les travaux universitaires, et en particulier ceux de Nicolas Derasse, montrent que le terrain offert aux profanes pour défendre leur semblable avait été occupé par des professionnels du droit, anciens avocats momentanément sans robe : N. Derasse, Les défenseurs officieux : une défense sans barreaux, in Annales historiques de la Révolution française, n° 350, 2007. Justice, nation et ordre public, p. 49-67. Voir aussi H. Leuwers, L’invention du barreau français 1660-1830, EHESS, Paris, 2007, p. 231-264.
[4] Les aspirations féministes ne sont ni un concept récent ni un concept contemporain. Simone de Beauvoir reconnaît ainsi dans Christine de Pisan, autrice de la Cité des dames, au XVe siècle, la toute première féministe, au sens où celle-ci décrit les relations entre les sexes comme inégalitaires au détriment des femmes. Elle remet en question l’idée selon laquelle l’infériorité des femmes serait naturelle et démontre qu’il s’agit d’une infériorité construite et intériorisée par les femmes. En un mot la Cité des dames est un ouvrage dans lequel on trouve les prémices des réflexions sur le genre : C. de Pisan, La cité des dames, (1405), Stock, Paris, 1986. Voir l’analyse de Simone de Beauvoir : S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome 1, Gallimard, Folio essais, 1949, p. 177.
[5] Olympe de Gouges écrivit « si la femme a le droit de monter sur l'échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune », article 10 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791 [en ligne].
[6] F. Catherine, La profession d’avocat et son image dans l’entre-deux-guerres, thèse soutenue en 1995 à Lyon, p. 326-347.
[7] A. Deperchin, La justice et la Première Guerre mondiale, in J.-P. Royer, Histoire de la Justice, PUF, 1995, p. 176.
[8] A. Deperchin, La Justice à l’épreuve de la guerre, Magistrats et avocats pendant le premier conflit mondial, L’harmattan, Paris, 2023, p. 362-371.
[9] J.-L. Gazzagina, Études d’histoire de la profession d’avocat : Défendre par la parole et par l’écrit, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2004.
[10] J.-L. Gazzaniga, Le barreau de Toulouse à la Belle Époque, ibid., p. 321-341.
[11] Si les femmes bénéficient d’une loi spéciale à partir de 1900 qui leur permet de s’inscrire au barreau, les freins juridiques et extrajuridiques restent nombreux comme le montrent les travaux approfondis d’Annie Deperchin, de Catherine Fillon et des historiennes et sociologues citées dans le présent article. Néanmoins, les situations sont variées, et certains contextes ont de manière paradoxale joué plutôt en faveur des femmes, tel est le cas du contexte communautaire et des représentations raciales en Tunisie et en Algérie, voir F. Renucci, op. cit..
[12] B. Sur, Histoire des avocats en France, des origines à nos jours, Dalloz, Paris, 1998.
[13] Voir les importants travaux de Juliette Rennes à ce sujet et notamment : J. Rennes, Une controverse républicaine : l'accès des femmes aux professions de prestige (1880-1940), Paris, Fayard, 2007 ; Voir, également les travaux de M. Passini, Les femmes et les professions juridiques (1900-1950), mémoire de DEA soutenu à Paris VII, sous la direction de M. Perrot, 1991, Boigeol, « French women lawyers and the women’s cause in the first half of the twentieth century », International Journal of the Legal Profession, vol. 10, n°2, 2003, p. 193-207. L’importance de la littérature aux États-Unis vient du fait que les avocates pionnières font l’objet d’un champ d’étude spécifique et une partie de l’historiographie propose une approche comparatiste : M.-J. Mossman, A comparative Study of Gender, Law and the Legal Professions, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2006 ; S.-L. Kimbel, M. Röwekam (eds), New Perspectives on European Women’s Legal History, Routledge, 2017.
[14] En droit les premiers travaux sur le genre datent des années 2000, mais c’est véritablement l’ANR Régine en 2011 qui lance le processus d’acculturation des études de genre en droit. En histoire du droit, après les travaux pionniers de quelques chercheurs et chercheuses, l’ANR HLJPGenre amorce cette acculturation dans la discipline [en ligne].
[15] L’article 24 de la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) dispose « À compter de la même époque, nul ne pourra exercer les fonctions d'avocat près les tribunaux, et d'avoué près le tribunal de cassation, sans avoir représenté au commissaire du Gouvernement, et fait enregistrer, sur ses conclusions, son diplôme de licencié, ou des lettres de licence obtenues dans les universités, comme il est dit en l'article précédent ». Ainsi pour devenir avocat il faut détenir un diplôme universitaire [en ligne].
[16] Les avocats d’Ancien Régime avaient fait des études de droit, ils étaient passés par l’université avec ses cours de droit romain et de droit canonique en latin et un timide cours en français afin d’étudier les Ordonnances royales, en particulier celles de Louis XIV : Ch. Christian, Pigeau et Bellart : la formation des praticiens du droit de la fin de l’Ancien Régime à la Restauration, in Les praticiens du droit du Moyen Âge à l'époque contemporaine : Approches prosopographiques (Belgique, Canada, France, Italie, Prusse), Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 285-297. Or les bancs des universités étaient réservés exclusivement aux hommes.
[17] « La faiblesse du cerveau des femmes, la mobilité de leurs idées, leur destinée dans l’ordre social, la nécessité d’une constante et perpétuelle résignation et d’une sorte de charité indulgente et facile, tout cela ne peut s’obtenir que par la Religion, par une religion charitable et douce », Napoléon Ier, Lettre à M. de Lacépède, Grand Chancelier de la Légion d’honneur, 15 mai 1807. Voir à ce sujet R. Rogers, Les bourgeoises au pensionnat : L'éducation féminine au xixe siècle, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 33-65.
[18] H. Duffuler-Vialle, Chronologie des droits des femmes en France de la Révolution française à nos jours, Musée Criminocorpus [en ligne].
[19] L’ordonnance royale du 3 avril 1820 évoque les écoles de filles et demande à chaque canton d’organiser l’instruction primaire des filles sous la surveillance d’un comité et le 31 octobre 1821 une ordonnance du roi crée des maisons d’éducation de degrés supérieurs de filles. La loi sur l’enseignement du 15 mars 1850, donc sous la Deuxième République, précise le contenu des enseignements primaires dispensés aux filles, qui est le même que celui des garçons, avec en plus des travaux d’aiguille, ibid.
[20] Loi du 28 juin 1833 [En ligne].
[21] R. Rogers, op. cit.; D. Dinet, L’éducation des filles de la fin du 18e siècle jusqu’en 1918, Revue des sciences religieuses [Online], 85/4 | 2011.
[22] De nombreuses études lui sont consacrées : A. Thiercé, La pauvreté laborieuse au XIXe siècle vue par Julie-Victoire Daubié, La découverte, Paris, 1999, p. 110-128 ; G. Fraisse, Julie-Victoire Daubié (1824-1874). Intellectuelle pionnière, in Féminisme et philosophie, Gallimard, 2020, p. 277-281 ; V. André-Durupt, Julie-Victoire Daubié la première bachelière, Amis du Vieux Fontenoy, Épinal, 2011 ; C. Christen-Lecuyer, Histoires de pionnières, La bachelière, revue du MAGE, L'Harmattan, Paris, 2000 ; M. Perrot, Avant-propos de la Femme Pauvre au dix-neuvième siècle, Côté-femmes, 1992 ; Y. Ripa, Femmes d’exception : les raisons de l'oubli, Le Cavalier Bleu, 2018.
[23] J.-V. Daubié, La Femme pauvre au XIXe siècle, Paris, Guillaumin, 1866, 2e éd., Paris, Thorin, 1869-1870.
[24] Féministe saint-simonien, proche de Rosa Bonheur et Georges Sand, qui a, pour l’anecdote, accolé le nom de son épouse à son nom dans un geste de défi envers l’usage et la tradition afin d’affirmer au sein de son couple l’égalité femme-homme N. Dockès-Lallement, D. Saint-Pierre (dir.), Arlès-Dufour, François, in Dictionnaire historique des Académiciens de Lyon : 1700-2016, Lyon, éd. Asbla, 2017, p. 47-53.
[25] A. Thiercé, Julie-Victoire Daubié première bachelière de France – De la condition économique morale et politique de la femme au XIXe, in Bulletin du centre Pierre Léon d'histoire économique et social, mars 1993.
[26] C. Christen-Lécuyer, Les premières étudiantes de l'Université de Paris, in Travail, genre et sociétés, vol. 4, n° 2, 2000, p. 35-50.
[27] H. Duffuler-Vialle. Chronologie…, op. cit.
[28] J. Crouzet-Ben-Aben, Bachelières d’aujourd’hui et bachelières d’autrefois, in La Grande Revue, 10 décembre 1911, citée par C. Christen-Lécuyer, Les premières…, op. cit.
[29] « Comment, Monsieur, dit ma mère au secrétaire, dans un pays où il est écrit même sur les portes des prisons : Liberté, Egalité, Fraternité, vous empêcheriez une femme de s’instruire, rien que parce qu’elle est femme » : S. Bilcesco a été interviewée par E. Charrier, L’Évolution intellectuelle féminine, Paris, Mechelinck, 1931, p. 157, citée par C. Christen-Lécuyer, ibid. Voir aussi J.-F. Condette, « Les Cervelines » ou les femmes indésirables. L'étudiante dans la France des années 1880-1914, in Carrefours de l'éducation, vol. 15, n° 1, 2003, p. 38-61.
[30] « La femme » n’a pas l’esprit juridique, mais davantage l’esprit mathématique car la femme est intuitive, elle trouve une solution sans pouvoir intellectualiser son raisonnement et l’expliquer ou en appliquant un raisonnement purement déductif en application de règles précises, alors que pour le droit, il faut un esprit déductif, mais aussi une souplesse que la femme n’a pas : « ce qui manque à l’esprit féminin c’est le raisonnement juridique, nuancé ; son esprit en effet voit juste sans démêler les motifs de cette perception, c’est un soleil sorti brusquement du brouillard » F. Vitry, L’heure de la femme, in La Renaissance politique, littéraire, artistique, 27 août 1921, citée par C. Christen-Lécuyer, Les premières…, op. cit.
[32] Cette synthèse est directement issue des précieux travaux de C. Christen-Lecuyer, Les premières…, op. cit.
[33] A.-L. Catinat, Les premières avocates du barreau de Paris, in Mil neuf cent, n° 16, 1998 ; M. Dassas, Femme de robe, Romorantin-lanthenay, Éditions Marivole, 2018 ; F. Prévôt, Jeanne Chauvin, in B. Didier, A. Fouque, M. Calle-Gruber (éd.), Le Dictionnaire universel des créatrices, Paris, Éditions des femmes, 2013 ; J. Rennes, Jeanne Chauvin, in Ch. Bard, S. Chaperon (dir.), Dictionnaire des féministes : France XVIIe – XXIe siècle, PUF, 2017.
[34] L. Frank, En cause de Melle Chauvin. La femme-avocat, exposé historique et critique de la question, Giard et Brière, Paris, 1898 ; M. Brogniez (de), Le fabuleux destin de Marie Popelin et Jeanne Chauvin ou l'histoire de l'accès des femmes au barreau en droit belge, in Revue de la Faculté de Droit de l'Université de Liège, 2016/1.
[35] A. Boigeol, Le genre comme ressource dans l'accès des femmes au « gouvernement du barreau » : l'exemple du barreau de Paris, in Genèses, vol. 67, n° 2, 2007, p. 66-88.
[36] Dalloz, Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle : ou Journal des audiences de la Cour de cassation et des Cours royales, Dalloz, Paris, 1898, 1er cahier, 2e partie, p. 185-195.
[37] Article 30 de la loi du 22 ventôse an XII : « À compter du 1er vendémiaire an XVII, les avocats selon l'ordre du tableau, et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, seront appelés, en l'absence des suppléants, à suppléer les juges, les commissaires du Gouvernement et leurs substituts ».
[38] Dalloz, op. cit.
[39] Voir H. Duffuler-Vialle, op. cit.
[40] Le discours des opposants à l’accès des femmes à la profession d’avocate est ponctué de plaisanteries sexistes qui suscitent les rires de l’Assemblée. Par exemple, Périer de Larsan se réfère à un exemple de la Grèce antique : Phryné, une courtisane, aurait été jugée pour impiété. Alors qu’elle allait perdre le procès, son avocat aurait alors arraché sa tunique pour dévoiler les seins de la femme devant l’aréopage. Le député ironise alors elle « produisit un plaidoyer sensationnel, suggestif et éloquent, comme une jolie femme sait toujours en produire quand elle veut s’en donner la peine (on rit) ». Quant à l’évocation de la femme avocate qui pourrait suppléer un magistrat, Périer de Larsan fait de cette éventualité une plaisanterie sans doute grivoise avec l’idée de « monter sur le siège ».
[41] Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso, Paris, 1er juillet 1899, p. 1758-1764.
[42] Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Sénat : compte rendu in-extenso, Paris, 13 novembre 1900, p. 835-841.
[43] « À partir de la promulgation de la présente loi, les femmes munies des diplômes de licencié en droit seront admises à prêter le serment prescrit par l'article 31 de la loi du 22 ventôse an XII, à ceux qui veulent être reçus avocats et à exercer la profession d'avocat sous les conditions de stage, de discipline et sous les obligations réglées par les textes en vigueur » [en ligne].
[44] A. Deperchin, op. cit, p. 364.
[45] Ibid., p. 364-365.
[46] F. Corcos, Les avocates, p. 73-74, cité par C. Fillon, op. cit., p. 340.
[47] Ibid., p. 102.
[48] Ibid., p. 78.
[49] Barreau de Lille, Discours de rentrée de la conférence du stage prononcé par le bâtonnier Henri Spriet, Imprimerie Danet, 1926, p. 26 et suivantes, cité par C. Fillon, op. cit, p. 338.
[50] C. Fillon, op. cit., p. 341.
[51] F. Corcos, op. cit., p. 103-104.
[52] Ibid., p. 150.
[53] Ibid., p. 364-365.
[54] Ibid., p. 366.
[55] En outre les enjeux contemporains de l’universalisme et du différentialisme, du féminisme matérialiste ou du féminisme essentialiste, du constructivisme ou de l’abolition du genre sont totalement inconnus en 1900. Le processus de féminisation des titres n’est peut être lui-même qu’une étape vers l’abolition du genre dans la langue du droit. Dans les soutiens contemporains à la féminisation des titres, il ne faudra certainement pas en tirer ultérieurement des arguments figés contre la reconnaissance de la neutralisation du genre ou de celle de la pluralité des genres.
[56] H. Duffuler-Vialle, op. cit.
[57] A. Deperchin, op. cit., p. 370.
[58] Pour lire en détail les déboires individuels de ces pionnières, voir A.-L. Catinat, La féminisation du barreau de Paris de 1900 à 1939, in C. Bard, et al., Femmes et justice pénale : XIXe-XXe siècles, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2002, p. 353-361.
[59] Parmi les études sur la féminisation de la profession et ses enjeux récents, voir : N. Lapeyre, N. Le Feuvre, 36. Avocats et médecins : féminisation et différenciation sexuée des carrières, in D. Demazière (éd.), Sociologie des groupes professionnels. Acquis récents et nouveaux défis, Paris, La Découverte, « Recherches », 2009, p. 424-434 ; N. Le Feuvre, P. Walters, Égales en droit ? La féminisation des professions juridiques en France et en Grande-Bretagne, in Sociétés contemporaines, n° 16, « Femmes au travail : l'introuvable égalité ? », décembre 1993, p. 41-62.
[61] T. Delpeuch, L. Dumoulin Laurence, C. Galembert (de), Chapitre 7 - Professionnels du droit et de la justice, in Sociologie du droit et de la justice, Paris, Armand Colin, « Collection U », 2014, p. 205-234 ; J. Chevallier, Ce qui fait discipline en droit. Qu’est-ce qu’une discipline juridique ? Évolution et recomposition des disciplines juridiques dans les facultés de droit, Lextenso, p. 47-59, 2018.
[62] A. Boigeol, Le genre comme ressource dans l'accès des femmes au « gouvernement du barreau » : l'exemple du barreau de Paris, in Genèses, 2007/2 (n° 67), p. 66-88.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484533
[Brèves] Droit de préemption subsidiaire du locataire : quid de la commission d’agence ?
Réf. : Cass. civ. 3, 1er mars 2023, n° 21-22.073, FS-B N° Lexbase : A17999GQ
Lecture: 3 min
N4535BZY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 13 Mars 2023
► Le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire en acceptant l'offre notifiée par le notaire, qui n'avait pas à être présentée par l'agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien.
Dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013, la troisième chambre civile avait été amenée à se prononcer sur la question de savoir si le locataire exerçant son droit de préemption peut être tenu au paiement de la commission d’agence, en y apportant une réponse négative : « Le locataire titulaire d'un droit de préemption acceptant l'offre de vente du bien qu'il habite qui n'a pas à être présenté par l'agent immobilier, mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien » (Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-19.442, FS-P+B N° Lexbase : A5601KIB).
La question s’est posée à nouveau dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 1er mars 2023, à ceci près qu’il ne s’agissait pas du droit de préemption initial du locataire, mais du droit de préemption subsidiaire, qui naît à son profit lorsque, après avoir refusé d’exercer son droit de préemption, la vente est finalement proposée à un tiers à un prix ou à des conditions plus avantageuses. C’est l’article 15, II, alinéa 4, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z87268SM, qui octroie ce droit au preneur : « dans le cas où le propriétaire, après un refus de l'offre initiale de vente adressée au locataire, décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente et cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ».
La solution ainsi retenue dans l’arrêt rendu le 3 juillet 2013 pouvait-elle être étendue dans le cas du droit de préemption subsidiaire du locataire ?
La cour d’appel d’Amiens ne l’avait pas admis, ayant retenu qu'à la suite du refus initial des locataires, les bailleurs avaient conclu un mandat avec l'agence immobilière, laquelle avait effectué une réelle prestation de recherche d'acquéreurs qu'elle avait ensuite présentés aux vendeurs afin que soit signé le « compromis » de vente, que ce n’était que treize jours plus tard qu'une offre avait été faite aux locataires qui avaient exercé leur droit de préemption, que la prestation de l'agence immobilière ne s’était pas limitée à la présentation d'une offre aux locataires et que, compte tenu du caractère déterminant de l'intervention de celle-ci, la commission était justifiée, que les locataires, en se substituant aux acquéreurs, avaient accepté d'acquérir aux mêmes conditions et en étaient redevables (CA Amiens, 11 mai 2021, n° 19/05641 N° Lexbase : A46984RG).
Mais sa décision est censurée par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée en introduction, au visa de l’article 15, II, alinéa 4, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, et de l’article 6 de la loi n° 70-9, du 2 janvier 1970 N° Lexbase : L7536AIX, dont il résulte que « le droit à rémunération de l'agent immobilier, auquel un mandat de recherche a été confié, suppose une mise en relation entre le vendeur et l'acquéreur ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484535
[Brèves] Érosion du littoral : pas d’obligation pour l’État et les collectivités territoriales d’assurer la protection des installations de camping
Réf. : CAA Toulouse, 4e ch., 21 février 2023, n° 21TL00405 N° Lexbase : A89689DI
Lecture: 3 min
N4506BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 08 Mars 2023
► Ni l’État, ni les collectivités territoriales, n’ont l’obligation d’assurer la protection des installations de camping dans les territoires victimes du phénomène d’érosion du littoral.
Faits. Le 23 novembre 2018, quatre sociétés exploitant des installations de camping sur le territoire de la commune littorale de Vendres (Hérault) ont saisi le Premier ministre, le maire de Vendres, le maire de la commune limitrophe de Valras-Plage et le président de la communauté de communes La Domitienne en leur demandant de réaliser des travaux de protection de la plage de Vendres-ouest et de la dune à l’arrière de laquelle sont implantées leurs installations.
Le refus de réaliser ces travaux résultant du silence gardé par l’État et les collectivités territoriales sur les demandes des sociétés a été attaqué devant le tribunal administratif de Montpellier. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a rejeté l’action en justice dont il avait été saisi.
Position CAA. En l’absence de dispositions législatives ou règlementaires les y contraignant, ni l’État, ni les collectivités territoriales, ni leurs établissements publics, n’ont l’obligation d’assurer la protection des propriétés riveraines des rivages de la mer contre l’action naturelle des eaux. Il résulte au contraire de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais, que cette protection incombe aux propriétaires intéressés.
Décision. Par suite, la société Camping de la plage et du bord de mer n’est pas fondée à soutenir que les personnes publiques sollicitées le 23 novembre 2018 auraient méconnu une obligation légale en refusant implicitement de réaliser des travaux de protection de la plage de Vendres-est consistant, notamment, en la mise en place d’ouvrages similaires à ceux installés sur le littoral amont de cette plage.
Les circonstances que les travaux souhaités par la société requérante seraient à réaliser sur le domaine public maritime et qu’ils contribueraient à préserver également le cordon dunaire derrière lequel se situent ses installations ne sont pas de nature à créer une obligation particulière à la charge des intimés.
Au surplus, la société appelante n’invoque aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé des préconisations retenues par les pouvoirs publics dans le cadre de la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte élaborée au titre de l’article L. 321-16 du Code de l’environnement N° Lexbase : L3069MCN, selon lesquelles il convient de ne pas construire de nouveaux ouvrages de protection dure dans cette zone pour ne pas perturber le travail sédimentaire par une artificialisation supplémentaire du littoral.
Décision. La requête est donc rejetée.
| À ce sujet. Lire M.-L. Lambert, Nouvelles mesures pour la prise en compte du dérèglement climatique dans le droit de l’urbanisme – quels impacts prévisibles sur les valeurs immobilières ?, Lexbase Public, novembre 2021, n° 883 N° Lexbase : N9282BYG. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484506
[Focus] Le droit d’expression de l’opposition municipale
Lecture: 22 min
N4509BZZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jean-Pierre Camby, Professeur de droit public, Université Versailles Saint-Quentin
Le 08 Mars 2023
Mots clés : droit d’expression • opposition municipale • réglement municipal • tribune d'opposittion • campagne municipale
Le droit d’expression de l’opposition municipale, garanti par la loi et les règlements intérieurs municipaux sur les bulletins d’information et les sites informatiques des villes, par la publication de tribune, a bien du mal à s’imposer lorsque les maires sont réticents à appliquer les règles qu’ils ont eux-mêmes fait adopter : irrecevabilité des référés, suspensions illégales des tribunes de l’opposition en période électorale, censures, répliques ou inégalités rédactionnelles qui subsistent jusqu’à ce que la jurisprudence, à effet trop différé, y mette un terme.
La communication institutionnelle des collectivités locales est un vecteur indispensable à la vie locale, quelle que soit la démographie de la commune concernée. On y trouve des renseignements sur les services publics, la couverture sanitaire, les travaux en cours ou à venir, la protection de l’environnement, l’urbanisme, les loisirs et la culture, qui constituent autant d’éléments nécessaires à la citoyenneté. Depuis des années, ils prennent la forme de bulletins, périodiques ou non publiés, et, depuis qu’Internet et les réseaux sociaux ont pris une place prééminente en matière de communication, les sites ou les comptes municipaux les intègrent, sans supplanter le papier.
Si le bulletin municipal tisse le lien social, il n’y a pas pour autant d’obligation légale à publier un bulletin, mais bien une exigence « politique » au sens courant du terme : c’est la vie de la cité. Evidemment, cette nécessité est plus forte encore en période de crise : le bulletin a permis de gérer au niveau local la crise du COVID et les confinements. Le juge de l’élection a d’ailleurs systématiquement rejeté les griefs invoquant le mélange des genres par l’utilisation des moyens d’information municipale, même lorsqu’ils permettent une présentation des plus flatteuses des élus candidats et même en cas d’écart des voix particulièrement restreint [1]. Le « contexte » a permis au juge de l’élection d’admettre, plus largement qu’à l’accoutumée, l’usage des moyens de communication institutionnels par des élus candidats [2].
La garantie d’un droit d’expression de l’opposition est apparue avec la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité N° Lexbase : L0641A37. L’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L2549KGI l’établit alors pour les communes de plus de 3 500 habitants et ouvre un espace d’expression aux conseillers « n’appartenant pas à la majorité municipale … lorsque la commune diffuse sous quelque forme que ce soit » un bulletin , et renvoie au règlement intérieur le soin d’en définir les modalités d’application. Avec la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République N° Lexbase : L1379KG8, dite «NOTRe » le texte connaît trois modifications. Premièrement, le droit d’expression est ouvert aux « conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale », ce qui couvre les aléas de la vie municipale, dont la dissidence définitive, sans inclure ni les sièges acquis à l’occasion de la fusion des listes, lesquels restent « majoritaires » [3], ni les divergences partielles ou temporaires [4]. En revanche, un ralliement clair à la majorité avec maintien de la tribune sous le timbre de l’opposition détourne l’objet même de la loi. En second lieu, la loi s’applique désormais aux communes de 1 000 habitants et plus, pour coïncider avec les dispositions relatives aux modes de scrutin, qui ont connu le même abaissement de seuil par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral N° Lexbase : L7927IWI. Enfin, ne sont plus visés par le dispositif les seuls bulletins municipaux mais la diffusion par la commune « d’informations générales », même sur d’autres supports que le seul bulletin. Sur ce point, la jurisprudence garantit que le droit d’expression s’applique « sur l'ensemble des supports de communication de la commune, notamment la publication mensuelle … et le site internet de la commune » [5].
Cette évolution législative est sans nul doute confortée par l’insertion dans l’article 4 de la Constitution, avec la révision du 23 juillet 2008, du respect du pluralisme des courants d’expression. Il appartient donc à la jurisprudence de réaffirmer le principe, ce qu’elle ne manque pas de faire. Elle consacre ainsi « l’intérêt public qui s’attache à ce que ce droit consacré par la loi soit respecté et … commande qu’ils puissent effectivement et pleinement exercer ce droit » [6]. Le texte est clair, il a été affiné en 2015 ; sa source peut être recherchée dans la Constitution, l’affirmation jurisprudentielle du principe est sans faille. Mais derrière l’étendard, l’intendance suit-elle sur le plan juridique ? On peut en douter lorsqu’on aborde des questions plus concrètes.
I. Un droit de l’opposition contrarié par une reconnaissance implicite de la majorité
Dans ses deux versions successives, le dispositif légal n’ouvre aucun droit spécifique à la majorité, laquelle dispose du reste de la publication ou du site. Les informations rendent évidemment compte , sous un jour favorable , de la gestion municipale , donc de l’action de la majorité . la tribune de l’opposition est là pour contrebalancer cette appréciation « Il s'agit d'assurer aux administrés une information pluraliste, les bulletins d'information municipale ayant, de façon générale, pour objet de rendre compte aux administrés des actions entreprises par le maire et la majorité du conseil municipal qui ont toute possibilité de s'exprimer dans les publications dont ils ont en principe le contrôle » [7]. Dans le silence du texte, le juge admet cependant la possibilité d’une tribune de la majorité. Le tribunal administratif de Dijon juge que les dispositions, dans leur rédaction initiale « si elles prévoient un espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité, ne font pas obstacle à ce que les pages des publications municipales créées à cet effet soient également ouvertes aux conseillers de la majorité municipale » [8], à la condition toutefois que cette tolérance n’aboutisse pas à réduire l’expression de l’opposition. Ainsi, si une ville « pouvait parfaitement ne réserver qu'une demi-page à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale, elle ne pouvait cependant pas, sauf à contourner abusivement la loi, accorder dans le cadre de la même tribune une autre demi-page à l'expression des élus appartenant à la majorité municipale » [9].
Seule l’expression de l’opposition -telle que définie par la loi- est donc garantie [10]. Pour autant, les tentatives de majorités peu scrupuleuses ou irritées du droit de parole de leurs adversaires, la démocratie locale étant parfois plus « locale » que « démocratique », sont nombreuses, mais toujours jugées strictement. Ainsi, la tribune de la majorité ne saurait ni être proportionnelle au nombre de sièges détenus, ni même d’un volume supérieur à l’espace rédactionnel reconnu aux conseillers n’y apparentant pas. Sont de ce fait jugées illégales les textes et les pratiques qui en découlent réservant aux élus d’opposition un espace « manifestement insuffisant pour leur permettre d'exprimer un point de vues argumentées sur les réalisations de la gestion du conseil municipal » [11], imposant la signature de la tribune par tous les membres des listes d’opposition [12], figeant le périmètre de l’opposition selon le critère des seuls groupes constitués après l’élection [13], ne tenant pas compte des évolutions pouvant intervenir en cours de mandat [14], ou du nombre de sièges détenus [15]. Ces tentatives, systématiquement condamnées par la jurisprudence, mettent en évidence la difficulté pour les maires et les majorités d’admettre la critique sur un support institutionnel. Elles expliquent la modification législative de 2015 qui conforte le droit d’expression de l’opposition.
Pour autant, la reconnaissance d’une tribune de la majorité fait figure de passager toléré de la loi : sa place n’est pas réservée, mais elle n’est pas interdite : il ressort de ces arrêts que le dispositif n’a pas pour effet de priver la majorité d’une tribune. On peut toujours s’interroger sur les dispositions des règlements intérieurs qui assurent une expression à « parts égales » de la majorité et de l’opposition, auxquelles sont préférables les répartitions par groupes, qui assurent davantage le pluralisme dès lors qu’il ne peut pas y avoir plusieurs majorités : « en fixant à 7 200 le nombre de signes de l’ensemble des tribunes, sans définir de limite par groupe d’élus, l’article 20 du règlement intérieur pose le principe d’une répartition strictement égalitaire de l’espace d’expression mis à la disposition de chacun des groupes siégeant au conseil municipal. Ces dispositions garantissent ainsi un espace d’expression suffisant et équitable entre groupes d’élus, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition, et dont les tribunes, en cas de création d’un nouveau groupe, seront toutes réduites dans les mêmes proportions » [16]. Mais même lorsque c’est la part égale qui est retenue par le règlement, les irrégularités sont fréquentes, ce qui explique l’abondance du contentieux. Les maires sont souvent tentés de contourner les règles qu’ils ont pourtant eux-mêmes fixées via le règlement intérieur. Comment faire respecter la loi face à des maires irrités de se voir critiqués et de ce fait a priori peu enclins au strict respect de la loi ou du règlement, alors même qu’ils agissent en tant qu’agents de l’État en publiant le bulletin municipal ?
II. Le maire, directeur de la publication, et le maire critiqué sont-ils dissociables ?
Il est clairement jugé que le maire ne dispose d’aucune compétence pour contrôler le texte rédigé par les conseillers d'opposition [17]. L’espace spécifique qui est réservé dans chaque bulletin à l’opposition doit en toute hypothèse être garanti et la commune n’est pas fondée à refuser la publication d’un texte au motif qu’étant tenue de publier un droit de réponse suite à une précédente tribune, il ne restait plus l’espace suffisant pour insérer le texte litigieux [18]. Plus généralement, « ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va seulement autrement lorsqu'il ressort à l'évidence de son contenu qu'un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » [19]. Le juge doit alors « rechercher s'il ressortait à l'évidence du contenu de cette tribune que son caractère injurieux, ou diffamatoire, était manifeste » pour justifier d’un refus de publication [20]. Tel n’est pas le cas d’un ton vif et polémique. Le maire ne saurait s’opposer à une tribune parce qu’elle traite d’une question qui n’entre pas dans les compétences de la commune, par exemple d’une question nationale [21]. En dehors donc d’un contenu outrageant, le maire n’exerce aucun contrôle sur le contenu du texte de l’opposition. Il commet, au sens exact du terme, un excès de pouvoir s’il le caviarde ou le refuse dès lors qu’il est présenté dans les délais et formes requis par le règlement intérieur.
Et pourtant, on ne compte pas le nombre de décisions dans lesquelles le maire tente de limiter le droit d’expression, au prétexte qu’il « serait déjà exercé par d’autres » [22], qu’il s’agit d’un bulletin spécial, hors périodicité [23]. On peut ajouter à cela le cas dans lequel l’opposition annonce un clair ralliement, dans le cadre d’une élection à venir, ce qui constitue un détournement du droit d’expression de l’opposition, mais avec une chance à peu près nulle de voir le juge de l’élection retenir l’argument : « le protestataire fait valoir qu’une conseillère municipale aurait utilisé le bulletin municipal pour faire part de son ralliement au maire en méconnaissance des dispositions précitées, il résulte de l’instruction que ce ralliement a été annoncé dans l’édition du mois d’août 2019, soit avant le 1er septembre 2019, date qui marque le début de la période à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article L. 52-1 du Code électoral » [24].
III. Pendant les campagnes électorales, seule la majorité est contrainte
Cette jurisprudence qui fait respecter la loi contre les maires réticents a été rendue compatible avec celle qui s’applique spécifiquement aux campagnes électorales. La tribune de l’opposition ne saurait être qualifiée de don émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral N° Lexbase : L7612LT4 [25], ou de campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'art. L. 52-1, alinéa 2, du même code N° Lexbase : L9941IPU [26]. La tribune de l’opposition doit donc continuer de paraître en période électorale, dès lors que le bulletin paraît. Aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit aux conseillers municipaux d'opposition de continuer à bénéficier de ce droit d'expression pendant les périodes précédant un scrutin [27]. La tribune peut donc être critique à l’endroit des élus sortants, alors que la majorité, elle, ne saurait se servir du bulletin municipal à des fins de propagande électorale. Cette inégalité, liée à la prohibition de l’aide de la commune à la campagne est donc curieuse mais parfaitement explicable. Elle peut conduire soit à suspendre la publication elle-même pendant les six mois précédant l’élection, soit à suspendre la tribune majoritaire, comme souvent les éditoriaux du maire, en ramenant la loi à son seul objet donc à son seul périmètre : garantir un droit d’expression à l’opposition.
Et pourtant la suspension de leur publication, qui porte atteinte au droit d'expression reconnu aux élus concernés par la loi, n’est pas considérée, en elle-même, comme les privant d'un moyen de propagande électorale. Ainsi « la décision de suspendre les tribunes libres dans le bulletin Bron Magazine ne peut être regardée comme ayant été de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats ni à altérer la sincérité du scrutin » [28]. Sans doute cette décision a-t-elle inspiré la modification législative de 2015.
IV. Quel impact sur l’élection ?
Pour autant, le juge de l’élection ne tire pas de conséquence de la suspension irrégulière de la tribune de l’opposition en période électorale : « alors même que, en raison de leur contenu et de la date de leur publication, les tribunes publiées par des élus municipaux dans le bulletin d'information générale de la commune sont susceptibles de comporter des éléments de propagande électorale, la suspension de leur publication, qui porte atteinte au droit d'expression reconnu aux élus concernés par la loi, ne peut être regardée, en elle-même, comme les privant d'un moyen de propagande électorale. » [29]. Dans d’autres cas où il constate également l’irrégularité de la suspension [30], il utilise les moyens classiques d’écarter le grief en matière électorale eu égard « à l’écart des voix entre les listes en présence et à la possibilité pour ces groupes politiques [d’opposition ] de demander à nouveau la publication de leur tribune en temps utile») ou lorsqu’« il ne résulte pas de l’instruction que le candidat évincé de son droit d’expression « n’aurait pas été invité en temps utile à diffuser un message dans cet espace réservé » [31]. Il prend également acte par exemple de l’absence de toute propagande dans le bulletin [32]du fait que majorité et opposition se soient l’une et l’autre servies du bulletin à des fins de propagande [33], de la suppression de l’éditorial du maire [34]Il ne sanctionne pas davantage le cas où la majorité se livre à de la propagande électorale [35].
Il est souhaitable qu’au moins cette dernière jurisprudence soit abandonnée, pour deux raisons : la tribune de la majorité ne correspond pas à une obligation légale alors qu’elle devient un moyen de propagande sous une apparence institutionnelle, et l’utilisation des moyens municipaux à son profit ne saurait être admise, même s’il ne s’agit pas d’une campagne promotionnelle au sens du code électoral . La CNCCFP est totalement dans son rôle et dans le sens du respect de la loi en retenant une approche rigoureuse . Dans une décision du 30 septembre 2020, elle retient que : « la tribune présentée par la majorité dans le bulletin municipal du mois de mars 2020 appelle expressément à voter pour le maire et revêt un caractère indéniablement électoral. De plus, elle n’est accompagnée d’aucune tribune émanant des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Sa publication doit être regardée comme un don d’une personne morale au sens de l’article L. 52-8 du Code électoral », décision qui est confirmée par le juge au motif de « la publication d’une tribune dans l’édition de mars 2020 du bulletin municipal, appelant à voter pour sa liste « Ris pour tous » quelques jours avant le premier tour du scrutin municipal » [36]. Pour des faits plus flagrants encore, une décision de la CNCCFP du 8 février 2021 va dans le même sens en reconnaissant un usage électoral des tribunes prohibé par l’article L. 52-8 du Code électoral (« - la tribune d’octobre 2019 s’achevait pas la mention : « rejoignez-nous au sein de notre comité de soutien … la tribune de décembre 2019 évoquait les opposants qui « ne duperont pas les électeurs qu’ils cajolent aujourd’hui par une présence indécente sur tous les événements et les portes palières et des sourires forcés et de circonstance, et celle de mars 2020 envisageait de « continuer cet engagement avec une équipe renouvelée et tout aussi motivée derrière notre Maire, avec son allant, son dynamisme et sa vision moderne de notre ville » »). Il y a loin de l’objet de la loi, garantie de l’opposition, à de tels propos, porte-voix de la majorité. Mais cette décision n’a pas été confirmée par le juge électoral qui a annulé l’élection pour un autre motif [37]. On peut donc souhaiter qu’une telle utilisation de la tribune de la majorité soit précisément sanctionnée par le juge de l’élection, y compris par l’inéligibilité, puisque l’existence légale des tribunes est détournée de son objet. Tant que ce n’est pas le cas, cet usage pourtant indéniablement contraire à la loi, se présente comme un risque contentieux plus que comme une limite réelle.
V. L’effet utile des jugements est-il garanti ?
Une fois la tribune publiée de façon irrégulière, comment faire cesser les effets d’une telle publication ? Hors périodes électorales, le risque de sanctions est également bien faible.
La seule voie ouverte pour que l’irrégularité ne produise pas d’effets à long terme liés à des délais de jugement trop longs est celle du référé. La jurisprudence distingue alors deux cas : la demande de référé, lorsqu’elle ne porte pas seulement sur une question de surface rédactionnelle ou de contenu, remplit la condition d’urgence [38]. le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaissait l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité [39] ?
En cas de refus irrégulier, le référé permet d’exiger de rétablir, dès la prochaine publication du bulletin municipal suivant la date de notification, le droit des élus d’opposition à la tribune que le maire a décidé de suspendre [40], ou encore de suspendre un règlement irrégulier.
Mais la différence ainsi opérée par les décisions du 14 avril 2022 fait apparaître une faible recevabilité des référés. Ainsi, une rupture d’égalité, même flagrante, de surface rédactionnelle et l’argument selon lequel le maire ne dispose pas du droit de modifier unilatéralement – et sans respect du règlement intérieur –ne caractérisent pas un « doute sérieux » justifiant que la condition tirée de l’urgence soit remplie [41]. Le juge des référés, après avoir hésité sur ce point [42], ne considère pas que la condition d’urgence est remplie du fait d’un seul refus [43], ou d’un déséquilibre méconnaissant les prescriptions du règlement intérieur [44], ni d’une incertitude résultant du règlement intérieur [45]. La perspective d’une faible chance de voir aboutir un recours en cassation devant le Conseil d’État portant sur un refus de référé du fait d’une irrégularité de contenu – par exemple un déséquilibre entre les tribunes, ou une censure de propos- est naturellement décourageante pour le requérant [46].
Il arrive même que des maires, compte tenu des délais de jugement et de l’irrecevabilité des référés, récidivent dans des pratiques pourtant irrégulières, alors que des contentieux sont engagés. Des années après publication, quel sera l’effet utile d’un jugement ?
Les nombreuses annulations au fond prononcées par le juge administratif - le plus souvent par les tribunaux administratifs - n’effacent donc pas l’irrégularité : la tribune irrégulièrement publiée subsiste, la tribune irrégulièrement caviardée ou refusée ne sera rétablie qu’à terme.
Au moins les annulations peuvent-elles conduire à faire modifier la version électronique des bulletins irréguliers figurant sur le site officiel de la commune. Un maire peu scrupuleux continuera donc des pratiques mettant en cause la liberté d’expression de l’opposition, d’autant plus qu’il détient la clef de la publication : il dispose du texte de l’opposition avant publication, puisqu’il le publie, et peut , au mépris de l’égalité, répliquer à celui-ci par la tribune de la majorité si les délais de remise des manuscrits ne sont pas identiques ou permettent des corrections au profit de la seule majorité, ce que condamne la jurisprudence [47]. On voit alors la tribune de la majorité, légalement inexistante et jurisprudentiellement tolérée, répondre à celle de l’opposition qui devra attendre la publication suivante pour répliquer. On voit même l’insertion d’un droit de réplique immédiat par la majorité. La cour d'appel de Colmar a ainsi sanctionné l'insertion par le directeur de la rédaction d'une réponse en lettres rouges à la suite d'une tribune de l'opposition sous forme de démenti anonyme qui ne constituait pas un exercice régulier du droit de réponse et avait confisqué indûment une partie de l'espace réservé au groupe d'opposition [48].
Reste alors à faire respecter la loi, ce que bien des édiles – agents de l’État – ont du mal – leaders de la majorité – à admettre. Plusieurs questions se posent, dont les réponses sont donc plutôt , en l’état peu satisfaisantes.
D’abord, celle de la compétence de la cour administrative d’appel parfois retenue sur les « seules les conditions d'exercice du droit de réponse » et non sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales – ce qui peut être discuté –. En principe, le contentieux relatif à la mise en œuvre du droit d'expression des élus, sous réserve du contentieux des dispositions adoptées par le conseil municipal dans son règlement intérieur, devrait être qualifié, comme en matière de local commun ou de groupes d'élus, de contentieux relatif aux élections municipales, relevant directement en appel du Conseil d'État.
Ensuite, celle de l’effet utile des jugements, rendus bien après la diffusion d’un texte litigieux ou annulé. Des délais de jugement trop longs sont de nature à aggraver le constat selon lequel l’irrégularité subsiste, même en période électorale. Ne faudrait-il pas ouvrir une voie de référé suspension qui tienne compte du fait qu’une fois la publication diffusée, l’effet utile de décisions longtemps après la publication est bien peu dissuasif face à la tentation immédiate du maire de censurer l’opposition ? Peut-être faut-il envisager qu’une voie de référé pour des conclusions tendant à une obligation de publier une tribune de l’opposition supprimée à tort ou irrégulièrement publiée soit spécifiquement ouverte.
Enfin, il faut poser plus nettement la question : ne faudrait-il pas interdire les tribunes de la majorité, en tant que telles, qui ne résultent pas d’un droit légalement reconnu ? L’espace rédactionnel serait ainsi réservé « à titre exclusif » à l’opposition.
En effet, la majorité dispose de tout le reste du bulletin : éditorial du maire, photographies, portraits des élus, explicitation du travail et des décisions. S’ y trouvent confondues l’information et la promotion de l’action de la majorité… A-t-on besoin de lui reconnaître, en plus, la possibilité, en dehors de l’objet de l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, de s’exprimer, alors même que la jurisprudence peine à faire sanctionner utilement les violations, même les plus flagrantes, du droit d’expression de l’opposition ?
[1] CE, 22 avril 2021, n° 446735 N° Lexbase : A10514QY ; deux voix d’écart avec utilisation du compte Facebook de la ville pour des « messages accompagnés de photographies faisant état de la remise à titre gracieux de deux mille masques au profit des personnes âgées et des résidents de maisons de retraite par une société dont le dirigeant était un membre de la liste conduite par M. D..., ces messages, diffusés dans le contexte de crise sanitaire, revêtaient un caractère purement informatif ».
[2] CE, 16 juillet 2021, n° 451050 N° Lexbase : A23784Z4, identité du nombre de voix, annulation pour un autre motif.
[3] Sur les règles légales et leur évolution, V. Bluteau, Les tribunes libres de l’opposition, Territorial éditions, avril 2020, BK 345, p. 13.
[4] TA Cergy Pontoise, 28 septembre 2013, n° 1307692.
[5] CE, 14 avril 2022, n° 451097 N° Lexbase : A98267T4, concl Merloz, obs M.-C. de Montecler, Dalloz Actu, 9 mai 2022 ; CAA Versailles, 17 avril 2009, n° 06VE00222 N° Lexbase : A1570EHM, AJDA, 2009. 1712, concl. B. Jarreau.
[6] TA Nice, 15 décembre 2008, n° 0806670 ; TA Montreuil, 28 juin 2017, n° 1705129 N° Lexbase : A7466WL4.
[7] QE n° 40329 de Mme Branget Françoise, JOANQ, 27 janvier 2009 p. 659, réponse publ. 14 avril 2009, p. 3614, 13ème législature N° Lexbase : L0309MHW.
[8] TA Dijon, 27 juin 2003, n° 021277 N° Lexbase : A4783DQ9.
[9] J.-M. Maillot, note sous TA Montpellier, 4 novembre 2008, Dumont C/ ville de Montpellier, AJDA, 2009, p. 316.
[10] CE, 28 janvier 2004, n° 256544 N° Lexbase : A2218DBR, AJDA, 2004. 932, note S. Brondel, JCP éd. A, 2004. 1196, note J. Moreau.
[11] TA Nice, 15 décembre 2008, n° 0806670, JCP éd. A, 2009, n° 2185, note R. Poesy.
[12] TA Rouen, 24 mars 2005, Poilve c. Cmne de Saint-Valery-en-Caux.
[13] TA Grenoble, 26 mars 2010, n° 0604195 ; TA Grenoble, 29 mars 2012, n° 0805362.
[14] CAA Versailles, 13 décembre 2007, n° 06VE00383 N° Lexbase : A8979D3X.
[15] TA Montpellier, 31 mars 2009, n° 0803039.
[16] TA Versailles, 16 décembre 2022, n° 2008152 N° Lexbase : A853783L.
[17] TA Orléans, 5 janvier 2007, n° 0400702 N° Lexbase : A6412DXR, AJDA, 2007. 1149 ; CE, 30 decembre 2021, n° 450099 N° Lexbase : A44127HU.
[18] CAA Paris 27 mars 2007, n° 04PA03958 N° Lexbase : A0537D3B, JCP éd. A, 2007. 2215, note J. Moreau
[18] CE, 30 décembre 2021, n° 451385 N° Lexbase : A44287HH.
[20] CE, 27 juin 2018 n° 406081 N° Lexbase : A0408XUN, qui annule de ce fait le jugement d’appel mais, sur le fond constate que la condition est remplie : le texte attribue faussement au maire un cumul de mandats et fonctions et une rémunération de « plus de 10 000 euros par mois net d'impôts ». Il est accompagné d'une caricature qui représente le maire les poches remplies de billets de banque et déclarant « l'important c'est la taille des poches ». La juxtaposition de cette tribune, faisant ainsi allusion, sans preuve, à sa malhonnêteté, et de cette caricature présente à l'évidence un caractère manifestement diffamatoire.
[21] CE, 20 mai 2016, n° 387144 N° Lexbase : A0961RQN.
[22] TA Bordeaux, 14 novembre 2014, n° 1400645.
[23] TA Montreuil, 24 décembre 2013, n° 1303781.
[24] TA Pau, 30 septembre 2020, n° 2002669.
[25] CE, 7 mai 2012, n° 353536, Lebon N° Lexbase : A9014IK3, AJDA 2012. 975, obs. S. Brondel, JCP éd. A, 2012, Dalloz Actu. 330, obs. C.-A. Dubreuil : « la commune de Saint-Cloud a fait paraître dans le numéro de février 2011 du bulletin d'information municipale " Saint-Cloud Magazine ", dans la rubrique " tribunes " réservée, à l'opposition municipale, trois articles dont un, consacré pour l'essentiel à un rappel de la portée des élections cantonales et à l'annonce de la candidature de Mme D à cette élection, ne traduit, dans les circonstances de l'espèce, aucune irrégularité susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ».
[26] CE, ass., 4 juillet 2011, n°s 338033 et 338199 N° Lexbase : A6336HU9 et CE, 16 juillet 2021, n° 451050, préc..
[27] TA Versailles, 28 juin 2007, n° 0701599, AJDA, 2008. 250, note Alzamora.
[28] CE, 17 juin 2015, n° 385204 N° Lexbase : A1544NLR.
[29] CE, 22 novembre 2021, n° 450959 N° Lexbase : A74517CX.
[30] CE, 30 décembre 2021 n° 451358, préc..
[31] CE, 22 juillet 2021, n° 447067 N° Lexbase : A36144ZU.
[32] CE, 5 mai 2021, n° 449668 N° Lexbase : A88404S9.
[33] TA Lyon, 2 mars 2021, n° 2004285, n° 2004583 N° Lexbase : A59534IC.
[34] CE, 27 juillet 2015, n° 386219 N° Lexbase : A0838NND.
[35] CE, 3 juillet 2009, n° 322430 N° Lexbase : A5665EIN.
[36] TA Versailles, 25 janvier 2021, n° 2006625.
[37] TA Lyon, 2 mars 2021, n° 2004285, n° 2004583, préc. ; CE 16 juillet 2021, n° 451050, préc., qui ne retient pas la qualification générale de propagande électorale au titre des campagnes de communication publicitaire.
[38] TA Melun, 30 octobre 2007, n° 0705526/6 ; v. aussi CE, 14 avril 2022, n° 448912 et n° 451097, préc., obs. M.-C. de Montecler, Dalloz actu, 9 mai 2022 : « la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que la décision attaquée produit ses effets à chaque publication mensuelle du magazine », le règlement suspendu faisait porter sur la seule délibération annuelle le droit d’expression.
[39] CE 14 avril 2022 n° 448912 et n° 451097, préc. et CAA Versailles, 17 avr. 2009, n° 06VE00222, préc..
[40] TA Melun, réf., 30 oct. 2007, préc.
[41] CE, 14 avril 2022, n° 448912 et n°451097, préc.
[42] CE, 6 avril 2007, n° 304361 N° Lexbase : A9369DUK.
[43] CE, 29 avril 2011, n° 348653 N° Lexbase : A0982HQG.
[44] TA Pau, 8 janvier 2021, n° 2022613.
[45] CE, 28 février 2003, n° 254411 N° Lexbase : A2327EDK, et CE, 28 janvier 2004, n° 256544 N° Lexbase : A2218DBR.
[46] CE, 12 avril 2021, n° 448966 N° Lexbase : A84229GZ, confirmant l’absence d’urgence : TA Pau, 8 janvier 2021, n° 2022613, préc.
[47] CAA Douai, 20 octobre 2020, n° 19DA01986 N° Lexbase : A46753YS : « il est loisible à la majorité municipale, dans le cadre du débat démocratique légitime que peut susciter le contenu de la tribune rédigée par les élus de l’opposition, d’y répondre, une telle réponse, qui ne saurait être apportée dans le même magazine municipal, peut l’être par tout moyen légal, et dans le respect de l’espace réservé à la tribune des élus de l’opposition ».
[48] CA Colmar 31 mars 2011 ; v. Olivier Maetz, Liberté d'expression des élus d'opposition dans un bulletin municipal et droit de la presse, AJDA, 2011. 1623 ; F. Dieu, Quand le droit d'expression de l'opposition se heurte à la liberté de la presse. ou de la compatibilité entre l'article L. 2121-27-1 du CGCT et les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, AJDA, 2008. 72.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484509
[Brèves] L’action en paiement de travaux à l’encontre d’un consommateur court à compter de la connaissance des faits : revirement confirmé !
Réf. : Cass. civ. 3, 1er mars 2023, n° 21-23.176, FS+B N° Lexbase : A18009GR
Lecture: 3 min
N4612BZT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 08 Mars 2023
► L’harmonisation du point de départ des délais de prescription se poursuit : l’action en paiement de travaux exercée par le professionnel à l’encontre du consommateur court à compter de l’exécution de la prestation.
Il faut s’en féliciter, la Haute juridiction continue son travail d’harmonisation et, par la même, de simplification, des délais de prescription en ce compris quant à leur point de départ. La prescription étant une notion transverse, elle s’applique au droit de la construction comme à d’autres branches du droit, comme en atteste la décision rapportée.
Mais il y a un « mais ». Cela peut conduire à réduire le délai de prescription pour celui qui tarde à facturer.
En l’espèce, un maître d’ouvrage confie des travaux de construction d’un mur de soutènement et de réfection de terrasses à un constructeur. Le constructeur lui adresse une facture pour le solde de ses travaux le 19 décembre 2011. Après une expertise amiable, l’entreprise assigne en paiement par acte du 23 septembre 2014.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 mai 2011, déclare sa demande irrecevable pour être prescrite.
Le constructeur forme un pourvoi en cassation. Il articule, d’une part, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent certes par deux ans mais que ce délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce n’est donc pas la date d’émission de la facture, contrairement à ce qu’ont considéré les juges du fond. Le point de départ devrait être le jour où la créance est devenue exigible. Il expose, d’autre part, que ce point de départ ne peut en tout état pas être la date de contestation de l’achèvement ou de la bonne réalisation des travaux.
La Haute juridiction, par une motivation dite enrichie particulièrement pédagogue, rappelle que :
1° l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T prévoit une prescription biennale de l’action des professionnels des biens et des services qu’ils fournissent aux consommateurs ;
2° l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC précise que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Partant, elle explique que doit être abandonnée la jurisprudence antérieure qui fixait le point de départ des délais au jour de l’établissement de la facture (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-10.908, FS-P+B N° Lexbase : A2287NKW ; Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-31.466, F-D N° Lexbase : A3425YX7) même lorsque l’action est enfermée dans le court délai de prescription biennale prévu par le Code de la consommation.
Afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription, précise la Haute juridiction, il y a désormais lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
La décision avait déjà été amorcée il y a quelques mois : il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être l’achèvement des travaux (Cass. civ. 1, 19 mai 2021, n° 20-12.520, FS-P N° Lexbase : A10004ST).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484612
[Brèves] Charte du cotisant contrôlé : annulation du paragraphe relatif au contrôle dématérialisé
Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 17 février 2023, n° 464155, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A52699DI
Lecture: 2 min
N4620BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 08 Mars 2023
► Le paragraphe de la charte du cotisant contrôlé intitulé « Les investigations sur support dématérialisé », permettant la réalisation des investigations sur support dématérialisé sur le matériel professionnel de l’agent de contrôle à partir de copies fournies par le cotisant contrôlé est annulé.
Les faits et la procédure. Par un arrêté du 31 mars 2022, le ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics, ont fixé le modèle de la charte du cotisant contrôlé pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2022. L’association Le Cercle Lafay a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe intitulé « Les investigations sur support dématérialisé ».
La décision. Prononçant l’annulation du paragraphe litigieux, la Haute juridiction accède à la requête de l’association. En effet, en ne faisant état de la possibilité que les traitements automatisés soient réalisés sur le propre matériel du cotisant contrôlé que dans l'hypothèse d'un refus écrit par celui-ci ou d'impossibilité avérée de mise en œuvre d'un traitement sur le matériel de l'agent de contrôle, sans rappeler la procédure, prévue par les dispositions de l'article R. 243-59-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2869K97, selon laquelle il peut être recouru au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée ni le droit pour cette dernière, également prévu par ces dispositions sous certaines conditions, de s'y opposer, le paragraphe en cause méconnaît le sens et la portée des dispositions de l'article précité.
Rappelons que la charte du cotisant contrôle est un document opposable.
| Pour aller plus loin : F. Taquet, Étude : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, Le contrôle sur place, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E71393NQ. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484620
[Brèves] Affaire « LukLeaks » : la CEDH consolide sa jurisprudence en matière de protection de lanceur d’alerte
Réf. : CEDH, 14 février 2023, Req. 21884/18, Halet c/ Luxembourg N° Lexbase : A89139DH
Lecture: 5 min
N4588BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires
Le 08 Mars 2023
► La CEDH a reconnu le statut de lanceur d’alerte à un collaborateur qui avait divulgué des accords fiscaux avantageux entre son employeur et l’administration fiscale luxembourgeoise ;
► Pour la Cour, au vu des constats opérés quant à l’importance, à l’échelle tant nationale qu’européenne, du débat public sur les pratiques fiscales des multinationales auquel les informations divulguées par le requérant ont apporté une contribution essentielle, l’intérêt public attaché à la divulgation de ces informations, l’emporte sur l’ensemble des effets dommageables.
Faits. Un ressortissant français (Raphaël Halet) travaillait pour PricewaterhouseCoopers. Entre 2012 et 2014 des déclarations fiscales et rescrits fiscaux établis par PwC ont été publiés dans différents médias. Les documents mettaient en lumière des accords fiscaux très avantageux passés entre PwC pour ses clients (des sociétés multinationales) et l’administration fiscale luxembourgeoise. Les documents provenaient, selon une enquête interne de PwC, de copies réalisées par un auditeur. À la suite des publications, une seconde enquête interne établit le fait que le requérant avait contacté le journaliste responsable des publications pour lui proposer et lui remettre de nouveaux documents finalement publiés par un consortium international (ICIJ).
PwC a porté plainte et obtenu la condamnation de M. Halet à une amende de 1 000 euros et le paiement d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral. La condamnation finale, celle de la cour d’appel puisque le pourvoi en cassation a été rejeté, établit que la divulgation des documents couverts par le secret professionnel avait causé un préjudice supérieur à l’intérêt général.
Le requérant invoque l’article 10 de la CEDH relatif à la liberté d’expression en estimant que sa condamnation constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Le 11 mai 2021, la Cour conclut à la non-violation de la CEDH, ce qui entraîne une demande du requérant de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre qui rend en février 2023 la décision dont il est ici question.
Rappel. Le statut de lanceur d’alerte n’est pas légalement défini mais fait l’objet d’une définition jurisprudentielle impliquant la mise en perspective des faits reprochés avec leurs conséquences tant sur le débat public que sur l’entité dont les secrets/documents ont été révélés.
La Cour rattache la situation à la notion de lanceur d’alerte et rappelle en quoi cette situation est particulière vis-à-vis de la liberté d’expression. Le requérant est en effet dans une relation de travail avec PwC et a donc des obligations de loyauté, de réserve et de discrétion mais aussi de secret professionnel. Aussi, il se situe dans une situation de faiblesse économique vis-à-vis de l’entité dont les secrets ont été révélés.
La Cour rappelle que la notion de lanceur d’alerte n’a pas de définition juridique univoque mais se rattache aux critères définis dans l’arrêt Guja c/ Moldova (CEDH, 12 février 2008, Req. 14277/04, Guja c/ Moldova N° Lexbase : A7465D4A) qu’elle met en regard de la présente situation :
- existence d’autres moyens pour procéder à la divulgation : puisque les faits portent sur des faits habituels de l’employeur qui n’ont rien d’illégal, la communication d’éléments présentant un intérêt public suppose d’admettre le recours direct à une voie externe, tels que les médias comme c’est le cas en l’espèce ;
- l’authenticité de l’information divulguée : les faits doivent être exacts et authentiques ce qui est le cas ;
- la bonne foi du requérant : le requérant doit, comme en l’espèce, agir de bonne foi en ne cherchant pas l’enrichissement ou la nuisance ;
- l’intérêt public de l’information : contrairement à la cour d’appel qui estime que l’objectif est d’interpeller ou scandaliser, la Grande Chambre retient que les informations participent à un débat social majeur portant sur les questions d’évitement fiscal des multinationales. C’est aujourd’hui une question de société fondamentale du fait de leur importance dans l’économie. Le requérant a ainsi contribué à la révélation d’éléments ayant un intérêt public ;
- les effets dommageables de la divulgation : la Grande Chambre estime que la cour d’appel n’a pas considéré avec assez de précisions et de mesure les effets négatifs des révélations et du vol et que l’affirmation d’atteintes supérieures à l’intérêt général était faite sans preuve et reposait sur une interprétation trop restrictive de l’intérêt public des informations divulguées. Ainsi, les effets dommageables devant être relativisés eu égard à l’importance des informations cela ne saurait être reproché outre mesure au requérant ;
- enfin, la sévérité de la sanction : le requérant a été licencié, l’affaire a eu un retentissement médiatique majeur et le requérant a été condamné à 1 000 euros d’amende. La Grande Cour estime que l’accumulation des sanctions amplifie leur gravité et entraîne un effet dissuasif au regard de la liberté d’expression du requérant mais aussi d’autres futurs lanceurs d’alertes.
Solution. Le requérant remplissant les conditions jurisprudentielles de la notion de lanceur d’alerte. Sa condamnation et l’ingérence qu’elle entraîne dans son droit à liberté d’expression ne sont pas nécessaires dans une société démocratique. En conséquence, la Grande Chambre estime qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention et condamne et Luxembourg à verser 15 000 euros au titre du dommage moral et 40 000 euros pour frais et dépens au requérant.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484588
[Jurisprudence] De l’importance de la chronologie : précision sur le régime de l’écrit en procédure orale
Réf. : Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.932, F-B N° Lexbase : A96899BH
Lecture: 15 min
N4526BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Corinne Bléry, Professeur de droit privé à l’Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes), Faculté de droit et d’administration publique, Directrice du Master Justice, procès, procédure, Membre du conseil scientifique de Droit & Procédure et Jean-Paul Teboul Greffier associé du tribunal de commerce de Versailles.
Le 08 Mars 2023
Mots-clés : oralité classique • oralité moderne • date des écrits • échanges • exception d’incompétence • recevabilité • appel en garantie
L’applicabilité de l’article 446-4 du Code de procédure civile dépend de la date à laquelle le juge organise les échanges écrits entre les parties, conformément au dispositif de mise en état en procédure orale prévu à l’article 446-2 du même code.
Une complexe affaire de transport aérien et terrestre au Moyen-Orient [1] conduit à s’intéresser à la chronologie des évènements en procédure orale [2] : organisation des échanges entre parties et prétentions présentées par écrit. De cette chronologie dépend le régime de l’écrit en procédure orale, c’est-à-dire le moment auquel le juge sera juridiquement saisi des prétentions et moyens formulés par écrit. La décision commentée, qui s’inscrit dans le prolongement d’un précédent arrêt du 22 juin 2017, affine les modalités de recherche de ce moment : elle permet ainsi d’apprécier la recevabilité des exceptions de procédure. Autrement dit, l’arrêt conduit à revenir sur l’oralité « post-moderne » qui est d’ailleurs tout autant « post-classique », en tant qu’elle mêle « oralité classique » et « moderne » [3].
Un litige, porté devant le tribunal de commerce de Nanterre, oppose huit parties.
En demande, une société PFM et son assureur Generali – que nous appellerons Primus ; en défense, une société Qualitair et son assureur Helvetia – Secondus ; toujours en défense, appelées en garantie par Secondus, la société RJA – Tertius et trois sociétés SS, KL et AMT – Quartus.
Un juge chargé d’instruire l’affaire (JCIA) est désigné. En effet, devant le tribunal de commerce, les dispositions des articles 860-1 N° Lexbase : L1162IND, 861 N° Lexbase : L1426I8C et 861-3 N° Lexbase : L7744IUD du Code de procédure civile prévoient que la procédure est orale et que la formation de jugement peut confier à l’un de ses membres le soin d’instruire l’affaire, notamment en organisant des échanges entre les parties conformément à l’article 446-2 N° Lexbase : L6754LEU du même code.
De fait, le JCIA organise des échanges écrits entre les parties et plusieurs jeux d’écritures sont échangés entre les parties. Cependant, la chronologie entre écritures et organisation des échanges par le JCIA n’est pas très claire.
On sait seulement que :
- après les assignations initiale de Primus contre Secondus et en garantie de Secondus contre Tertius et Quartus, Quartus a demandé, par écrit, à être lui-même garantie par Tertius,
- par d’autres écrits, le même Quartus a soulevé une exception d’incompétence territoriale,
- Tertius, également par écrit, a soulevé une exception d’incompétence de la juridiction française dans ses rapports avec Secondus, incompétence fondée sur les dispositions de l’article 333 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2015H4E.
Le tribunal de commerce rend un jugement qui fait l’objet d’un appel devant la cour de Versailles.
Avant de statuer au fond [4], la cour déclare irrecevable l’exception d’incompétence de Quartus : cette exception de procédure n’aurait pas été soulevée dans ses écritures initiales tendant à ce qu’il soit garanti par Tertius ; elle l’aurait été après une défense au fond, à savoir ledit appel en garantie de Tertius et donc sans respecter l’article 74 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1293H4N. En revanche, la cour déclare recevable le déclinatoire de compétence présenté par Tertius et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur les demandes concernant cette partie.
Un pourvoi principal est formé par Primus sur le fond.
Quartus, puis Secondus, forment alors un pourvoi incident.
Le premier moyen du pourvoi incident de Quartus reproche à la cour d’appel une violation des articles 74, 446-1 N° Lexbase : L1138INH et 860-1 du Code de procédure civile (1re branche), ainsi qu’un manque de base légale au regard des articles 446-2, 446-4 N° Lexbase : L1135IND et 861-3 dudit code (2e branche).
La première branche du second moyen des deux pourvois incidents reproche à la cour d’appel une violation de l’article 333 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation casse et renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, tant sur le fond [5] qu’en procédure : à cet égard, elle statue d’abord au visa des articles 74, 446-1, alinéa 1er, 446-2, 446-4 et 861-3 du Code de procédure civile (violation de l’article 74 et manque de base légale au regard des articles 446-2 et 4) ; elle statue ensuite au visa de l’article 333 (violation de ce texte), après avoir admis la recevabilité du moyen comme étant de pur droit et en rappelant que « en l’absence d’une clause compromissoire ou d’une clause attributive de juridiction, l’article 333 du nouveau [sic] Code de procédure civile, aux termes duquel le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, est applicable dans l’ordre international ». Tertius « qui n’invoquait ni clause attributive de juridiction ni clause compromissoire, ne pouvait décliner la compétence de la juridiction française dans ses rapports avec les sociétés [Secondus], qui l’avaient appelée en garantie ».
Sur ce point, l’arrêt est des plus classiques [6] et n’appelle pas de développement particulier.
En revanche, l’arrêt, longuement motivé [7], apporte un éclairage sur la valeur des écrits en procédure orale, particulièrement sur l’articulation des articles 446-2 et 446-4 du Code de procédure civile (I), valeur qui dépend de la chronologie des actes (II).
I. L’articulation des conceptions de l’oralité
Pour comprendre l’apport de l’arrêt, il convient de revenir sur la réforme de la procédure orale, opérée par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 N° Lexbase : L0992IN3 [8], puis – dans une moindre mesure – par les décrets n° 2017-692 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L0894LET et n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 N° Lexbase : Z7419194 [9] (A), puis sur la valeur des écrits en procédure orale (B).
A. Les réformes de l’oralité
Les articles 446-1 à 446-4 du Code de procédure civile, créés en 2010, constituent un socle de règles communes à l’oralité. Ce socle est à compléter avec les dispositions propres à chaque juridiction.
Le traditionnel principe de présence a été maintenu en 2010 et est affirmé à l’article 446-1, alinéa 1er : « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien » : c’est le premier régime de l’oralité qui est « classique ». Le texte a également repris l’autre aspect historique de l’oralité classique, construit par la jurisprudence, selon lequel : « elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. […] ». Ce principe et son aménagement sont, respectivement, invoqués par le pourvoi incident et rappelés par la Cour de cassation.
En outre, au principe de présence, a été ajoutée une possible dispense de présentation – l’ « oralité moderne » – autorisée dans certains cas : c’est l’alinéa 2 de l’article 446-2 qui la prévoit. La dispense est conditionnée par l’existence d’une disposition particulière à la juridiction concernée : selon le cas, elle est de droit ou soumise à autorisation du juge. Lorsque les parties sont dispensées de se présenter par le juge, les échanges sont écrits et transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou notification entre avocats. Devant le tribunal de commerce, la dispense judiciaire et l’organisation des échanges sont prévus par l’article 861-1 du Code de procédure civile [10].
L’article 446-2, quant à lui, offre au juge des pouvoirs pour organiser la mise en état matérielle des affaires : selon l’alinéa 1er « lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces » [11]. L’alinéa 2 prévoit que les conclusions sont qualificatives, récapitulatives et structurées – comme en procédure écrite [12] – si les parties sont assistées par un avocat ; dans l’hypothèse inverse, envisagée à l’alinéa 3, la récapitulation est seule envisagée, de manière facultative. Les alinéas 4 et 5 prévoient des sanctions en cas de non-respect des alinéas précédents. L’article 446-3 régit la mise en état intellectuelle : le juge peut demander des explications de droit ou de fait aux parties... Enfin, l’article 446-4 – on l’a vu – fixe la date des prétentions et moyens régulièrement présentés par écrit : ce texte dispose que « la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ».
Autant dire que la procédure orale ressemble beaucoup à une procédure écrite sans pour autant en être totalement une…
B. La valeur des écrits en oralité
En oralité classique, les prétentions et moyens contenus dans un écrit ne saisissent le juge qu’au jour de l’audience, par leur réitération orale ou par la référence qui y est faite par le plaideur (CPC, art. 446-1, al. 1er). La jurisprudence antérieure à 2010 a dû élaborer le régime de l’écrit en procédure orale [13]. Celui-ci – qui joue toujours depuis 2010 – permet, notamment, de soulever oralement, à l’audience et in limine litis, une exception d’incompétence alors que des écrits contenant défense(s) au fond ou fin(s) de non-recevoir ont été préalablement échangés.
En revanche, en oralité moderne – en cas de dispense de présentation –, l’écrit bénéficie d’une valeur autonome de sa réitération ou référence orale (CPC, art. 446-1, al. 2).
Par faveur pour l’écrit, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été au-delà de la stricte oralité moderne dans l’arrêt du 22 juin 2017 [14] : elle a considéré que lorsque des échanges écrits ont été organisés entre les parties par le juge conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du Code de procédure civile, l’article 446-4 est alors applicable – de sorte que la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties – « peu important que les parties aient été ou non dispensées [de se présenter] » [15]. Outre la déconnexion avec la dispense de présentation, la deuxième chambre civile évoque l’organisation d’échanges écrits, ce que le texte ne précise pas.
Or, dans l’arrêt commenté, la chambre commerciale s’approprie cette conception et la réaffirme, alors que la deuxième chambre civile semblait l’avoir perdue de vue en 2022 [16].
Tant la décision de 2017 que celle de 2023 relèvent d’une oralité qui peut être dite « post-moderne », mais aussi « post-classique ». En effet, nous sommes en oralité classique (absence de dispense de présentation donc présence obligatoire), mais du fait de l’organisation d’échanges écrits, ces écrits ont la même valeur qu’en oralité moderne (dispense de présentation). La Cour de cassation a mélangé les deux oralités – celle d’avant 2010 et celle d’après 2010...
II. La chronologie des actes
En raison de la conception de l’oralité, l’importance de la chronologie des actes apparait : il est nécessaire que le juge la vérifie (A), afin d’en tirer des conséquences (B).
A. La vérification de la chronologie des actes
Dès 2017, il nous apparaissait que « la construction jurisprudentielle de l’oralité classique [allait se] trouver bouleversée » par la conception de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Il nous semblait qu’il allait désormais falloir « prendre en compte l’existence ou l’absence d’une organisation d’échanges écrits ; dès lors qu’une telle organisation aura[it] lieu, les écrits aur[aient] pour date celle de leur communication et pourr[aient] primer les paroles à l’audience » [17].
L’arrêt de 2023 en est la parfaite illustration. Dès lors que des échanges écrits sont organisés, la date des conclusions est celle de leur communication entre parties… mais encore faut-il vérifier qui, de l’écrit ou de l’organisation des échanges, vient en premier.
Si l’écrit est antérieur à l’organisation des échanges, sa date est celle de l’audience à laquelle les prétentions et moyens qu’il contient sont oralement réitérés, il n’a pas de valeur autonome ; s’il est postérieur, sa date est celle de sa communication entre les parties, il a valeur autonome : sa réitération à l’audience importe peu.
Or, la cour d’appel n’avait pas vérifié cette chronologie, mettant la Cour de cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, d’où la cassation pour manque de base légale… Curieusement la cassation disciplinaire relative à cette absence de vérification n’est énoncée qu’en second, alors que ladite vérification nous semble précéder, en logique, la question relative à la violation de l’article 74 du Code de procédure civile – celle-ci n’étant que la conséquence.
B. La conséquence de la chronologie des actes
Il est nécessaire que le juge vérifie la chronologie des actes, afin d’admettre ou non, leur recevabilité, en particulier pour l’application de l’article 74 du Code de procédure civile.
Pour autant, la Cour de cassation a commencé par rappeler le double principe posé à l’article 74 du Code de procédure civile [18] applicable aux exceptions d’incompétence, de litispendance et de nullité pour vice de forme. C’est ainsi que les exceptions doivent être soulevées in limine litis, c’est-à-dire au seuil du procès. Cette affirmation contient deux règles :
- les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute autre défense, à savoir défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité ;
- les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément, sous la même sanction.
En revanche, il importe peu que soient présentées préalablement à un déclinatoire de compétence une « protestation » à une jonction d’instance[19] ou une demande incidente – telle qu’une demande en intervention.
Quid d’un appel en garantie ? La Cour de cassation juge que l’appel en garantie de tiers constitue une défense au fond rendant irrecevable une exception d’incompétence ultérieure [20]… à l’exclusion de l’appel en garantie d’une partie déjà en la cause et à condition toutefois que l’assignation ait été enrôlée[21].
Cette qualification, discutable [22], est reprise encore une fois par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 8 février 2023. Elle a au moins le mérite de permettre à la cour de renvoi, une fois la chronologie établie, de trancher la recevabilité de l’exception d’incompétence.
Une nouvelle fois, soit les premières conclusions ne sont pas autonomes, soit elles le sont. Si elles ne sont pas autonomes, seuls comptent les jeux de conclusions postérieurs à l’organisation des échanges écrits, jeux qui fixeront l’ordre dans lequel les moyens ont été soulevés (et non pas la réitération à l’audience) ; dans notre affaire, si elles sont autonomes, elles ne contiennent ni exception de procédure (à concentrer avec le déclinatoire de compétence), ni fin de non-recevoir, ni défense au fond, mais seulement une demande incidente.
***
Il est permis, une fois de plus, de regretter que l’oralité, conçue pour être simple, soit devenue très, trop, complexe. Il en est de même pour la distorsion des notions : pourquoi transformer une demande incidente en défense au fond dans certains cas ? Un troisième regret peut aussi tenir dans la difficulté croissante à lire les arrêts, en raison du développement des apports juridiques, difficile de démêler… d’autant que l’appareil de faits est, lui, parfois bien lacunaire : la motivation n’est pas tant « enrichie » qu’ « obscurcie »…
| À retenir :
|
[1] Elle est commentée sous cet angle par V. Téchené, Transport aérien : responsabilité du transporteur et conditions d’application de la Convention de Montréal, Lexbase Affaires, février 2023, n° 746
[2] Cass. civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-17.118, FS-P+B N° Lexbase : A1156WKZ, C. Bléry et J.-P. Teboul, D. 2017, p. 1588.
[3] Sur ces notions, v. C. Bléry et J.-P. Teboul, D. 2017, p. 1588, préc. et infra.
[4] V. Téchené, Transport aérien : responsabilité du transporteur et conditions d’application de la Convention de Montréal, Lexbase Affaires, février 2023, n° 746
[5] V. Téchené, Transport aérien : responsabilité du transporteur et conditions d’application de la Convention de Montréal, Lexbase Affaires, février 2023, n° 746
[6] V. déjà, Cass. civ.1, 12 mai 2004, n° 01-13.903, FS-P N° Lexbase : A1559DCQ, R. Perrot, Bull. civ. I, n° 129 ; D. 2004. 1562 ; RTD civ. 2004. 553 ; Cass. civ.1, 14 avril 2021, n° 19-22.236, FS-P N° Lexbase : A80394PG, X. Delpech, D. actu. 11 mai 2021.
[7] Ci-après reproduit la solution de Cour de cassation, Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.932, F-B : «Vu les articles 74, 446-1, alinéa 1, 446-2, 446-4 et 861-3 du Code de procédure civile :
15. Selon le deuxième de ces textes, qui régit la procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
16. En application des quatrième et cinquième de ces textes, lorsque des échanges ont été organisés entre les parties par le juge du tribunal de commerce chargé d’instruire l’affaire conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par le troisième de ces textes, la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
17. Aux termes du premier, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
18. Il résulte de ces dispositions qu’en procédure orale, lorsque le dispositif de mise en état prévu à l’article 446-2 précité a été mis en œuvre par le juge chargé d’instruire l’affaire, l’exception d’incompétence doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures communiquées par la partie qui s’en prévaut.
19. Pour dire irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés S-K-A, l’arrêt retient qu’elle ne figurait pas dans leurs conclusions d’appel en garantie déposées le 9 septembre 2015 devant le tribunal de commerce, lesquelles présentaient une défense au fond en appelant des tiers en garantie.
20. En premier lieu, en statuant ainsi, alors qu’était formée une demande de garantie à l’égard de la société RJA, déjà en la cause, et non un appel en garantie d’un tiers, constitutif en procédure orale d’une défense au fond, la cour d’appel a violé l’article 74 du code de procédure civile.
21. En second lieu, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher la date à laquelle le juge chargé d’instruire l’affaire avait organisé les échanges écrits entre les parties, conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu à l’article 446-2 du code de procédure civile, ce qui aurait rendu l’article 446-4 applicable, peu important que les parties aient été ou non dispensées de comparaître, la cour d’appel, qui devait déterminer si l’exception d’incompétence avait été soulevée dans les premières conclusions des sociétés S-K-A notifiées postérieurement à la mise en place de ce calendrier de procédure, n’a pas donné de base légale à sa décision.»
[8] E. de Leiris, Les métamorphoses des procédures orales – Le décret du 1er octobre 2010, in C. Bléry et L. Raschel (dir.), Les métamorphoses de la procédure civile, colloque Caen, Gaz. Pal. 31 juillet 2014, p. 23 ; C. Bléry et J.-P. Teboul, D’un principe de présence à une libre dispense de présentation ou les évolutions en cours de l’oralité, in Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015), Les Éditions Panthéon-Assas, 2016, p. 109.
[9] C. Bléry, Un juge civil toujours plus lointain… ? Réflexions sur la dispense de présentation et la procédure sans audience, Dalloz actualité, 22 décembre 2020 ;
[10] Dans sa rédaction de 2020. Notons que l’article 861-3 du Code de procédure civile confère ce même pouvoir, de dispenser les parties de se présenter et d’organiser les échanges, au profit du JCIA, par renvoi à l’article 861-1. Adde C. Bléry et J.-P. Teboul, ÉTUDE: La procédure devant le tribunal de commerce, in
[11] Dans sa rédaction de 2017 : depuis le 11 mai 2017, il n’est plus nécessaire que les parties soient d’accord pour fixer des délais, seul leur avis est recueilli par le juge, en revanche, leur accord reste nécessaire pour l’organisation des échanges.
[12] Depuis 2017 : cet alinéa 2 est le décalque de l’article 768 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9310LTY applicable en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire (qui reprend l’article 753 N° Lexbase : L9297LTI, pour le tribunal de grande instance) et de l’article 954 N° Lexbase : L7253LED applicable en procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.
[13] Sur laquelle, v. Y. Strickler, Raison d’être et réformes de la procédure orale, in Les principes essentiels du procès à l’épreuve des réformes récentes du droit judiciaire privé (dir. L. Flise et E. Jeuland), IRJS, 2014, p. 35 s. C. Gentili, L’écrit des parties dans la procédure orale, Procédures 2007, étude 24. ; L. Raschel, Retour sur les particularités de la procédure orale, Gaz. Pal. 25-26 mai 2012, p. 33. C. Bléry et J.-P. Teboul, D’un principe de présence à une libre dispense de présentation, n° 5.
[14] Cass. civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-17.118, FS-P+B, préc.
[15] L’arrêt – comme très souvent – évoque une dispense de comparaître ; or, il s’agit d’une dispense de se présenter ; le jugement est alors contradictoire, car la partie comparaît sans être présente.
[16] Cass. civ. 2, 3 février 2022, n° 20-18.715, F-B N° Lexbase : A32137LL ; C. Bléry, Oralité : quelle présence pour une comparution régulière ?, Lexbase Avocats, avril 2022, n° 324 N° Lexbase : N0985BZI.
[17] C. Bléry et J.-P. Teboul, D. 2017, p. 1588.
[18] V. déjà Cass. civ.2, 2 février 2023, n° 21-15.924, F-B N° Lexbase : A26009BW, C. Bléry, Dalloz actualité, 17 février 2023.
[19] Cass. civ. 2, 2 février 2023, n° 21-15.924, F-B, préc.
[20] Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-14.741, F-P+B N° Lexbase : A5925IIB ; C. Bléry , RLDC 2012/95, n° 4760 p. 70 ; v. déjà Cass. civ. 2, 6 mai 1999, n° 96-22.143, P, RTD civ. 1999, p. 700, R. Perrot ; Cass. com., 6 juin 2000, n° 97-22.330, P ; Cass. civ. 2, 12 juin 2003, n° 01-11824, P N° Lexbase : A3222CGG ; Adde C. Bléry, Dalloz actualité, 17 février 2023.
[21] Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 04-13.172, FS-P+B N° Lexbase : A1210DPI, R. Perrot, Procédures 2006, comm. 181.
[22] V, dans le même sens : J. Héron, Droit judiciaire privé, Lextenso, 7e éd., 2019, par T. Le Bars et K. Salhi, n° 138.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484526
[Brèves] Illustration de l’interruption de la prescription dans le cadre des actions tendant au même but
Réf. : Cass. civ. 2, 2 mars 2023, n° 21-18.771, F-B N° Lexbase : A23939GQ
Lecture: 3 min
N4537BZ3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 08 Mars 2023
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de préciser que la demande de mesure d’instruction sollicitée avant tout procès permet de suspendre la prescription, et que le délai recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée ; si en principe, la suspension comme l’interruption ne peuvent s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; les Hauts magistrats relèvent que la demande d'expertise en référé tendant à identifier les causes des sinistres subis par les matériels livrés et à déterminer s'ils sont atteints d'un vice rédhibitoire tend au même but que l'action en inexécution de l'obligation de délivrance conforme.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société ayant acquis des moteurs auprès d’une autre a obtenu en novembre 2009 une ordonnance d’un juge des référés prescrivant une mesure d'expertise sur ces moteurs en application de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49. Le rapport d’expertise a été établi en février 2015. Par acte du 4 mars 2016, la société a assigné la défenderesse en paiement au titre du manquement à son obligation de délivrance conforme sur ces moteurs et à son obligation de conseil et d'information. Un tribunal de commerce a par jugement rendu le 19 mars 2018 condamné la défenderesse à payer à la demanderesse diverses sommes à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel. Elle a interjeté appel par acte du 6 avril 2018.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Lyon, 29 avril 2021, n° 18/02686 N° Lexbase : A58524QS), d’avoir jugé irrecevable comme prescrite l’action en délivrance engagée à l’encontre de la partie adverse. L’intéressée fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 2239 du Code civil N° Lexbase : L7224IAS. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l'instance en référé avait été initiée par acte du 2 janvier 2009 ayant donné lieu au dépôt du rapport de l'expert le 26 février 2015 en vue de rechercher l'existence de vices rédhibitoires, que l'instance in futurum n'ayant pas le même objet que celui de l’instance au fond en inexécution de délivrance conforme. Les juges d’appel ont conclu qu'aucun effet suspensif n'en résultait.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 2239 du Code civil N° Lexbase : L7224IAS, la Cour de cassation relève que la cour d’appel a violé le texte susvisé et censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoie l’affaire.
|
Pour aller plus loin : É. Vergès, ÉTUDE : La prescription de l’action civile, Les situations dans lesquelles la prescription est simplement suspendue, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E0020037. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484537
[Focus] Vers un droit commun de la preuve numérique ?
Lecture: 30 min
N4347BZZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alice Mornet, Maître de conférences à l'Université d’Avignon
Le 08 Mars 2023
Mots-clés : preuve • preuve numérique • numérique • techniques d’enquête numériques • procédure pénale • enquête • données • données de connexion
À la faveur de la loi du 24 janvier 2022, le législateur a autorisé le recours aux drones à des fins de police judiciaire, allongeant encore davantage la liste des techniques d’enquête numériques et offrant l’occasion de s’intéresser à leur régime. À l’étude, les garanties entourant ces mesures se révèlent profondément hétérogènes alors qu’elles fragilisent, toutes, les droits à la vie privée et à la protection des données. Un tel constat invite à s’interroger sur l’opportunité d’un droit commun des techniques d’enquête numériques se structurant à partir de leur objet : la donnée numérique.
La preuve numérique apparaît être l’héroïne d’une saga dont les rebondissements feraient pâlir les plus grands scénaristes. Se trouvant au cœur de l’actualité législative[1] et jurisprudentielle[2], française comme européenne[3], elle attire toute l’attention. Significative, cette « success story » témoigne, en réalité, des difficultés qu’il y a à encadrer son recueil et son exploitation.
Volatile, évanescente, fuyante… Autant de qualificatifs ayant été attribués à la preuve numérique pour souligner les résistances de son appréhension pénale. En se dissimulant dans les sinuosités innombrables des réseaux informatiques, elle échappe à la maîtrise – tant physique qu’intellectuelle – des praticiens et de la doctrine. Cependant, en dépit de son ambiguïté, certaines certitudes existent, notamment quant aux mécanismes permettant de « capturer » cette insaisissable preuve.
La preuve numérique, en effet, peut être recueillie à l’occasion d’une enquête ou d’une instruction [4] et, plus précisément, à la faveur de la mise en œuvre des techniques d’enquête numériques. Celles-ci recouvrent l’« ensemble des mesures d’investigation susceptibles d’être employées par les autorités de police et justice via les réseaux de transmission électronique – satellitaires et terrestres, fixes et mobiles, dès lors qu’ils passent par des canaux numériques –, ou sur des appareils connectés à ces réseaux, afin de mettre à jour des infractions pénales et d’identifier leurs auteurs [5] ». Si l’objet résiste aux définitions, il n’en va donc pas ainsi de son mode de recueil, lequel a, de surcroît, été consacré par la création, en 2017, de l’Agence nationale des techniques d’enquête numériques judiciaires (ANTEN) [6]. Mettant en œuvre la plateforme nationale des interceptions judiciaires, l’agence est également compétente s’agissant des techniques d’enquête prévues aux articles 230-1 et suivants N° Lexbase : L6546MGK et 706-95-1 et suivants N° Lexbase : L7225LPB du Code de procédure pénale [7]. Au regard de ce champ de compétences, il faudrait conclure que la preuve numérique ne peut être recueillie qu’au moyen des techniques d’enquête prévues auxdits articles. Toutefois, ce serait oublier les réquisitions et les perquisitions qui, en raison de leur généralité, permettent également de l’obtenir. Volatile, la preuve numérique l’est donc aussi au sein du Code de procédure pénale tant les dispositions y afférentes y sont dispersées. Elle apparaît, en effet, aux articles relatifs à l’enquête et à l’instruction, à ceux communs aux deux cadres et, enfin, à ceux consacrés à la lutte contre la criminalité organisée. Une telle division, sans logique apparente, semble résulter des multiples interventions du législateur visant à combattre la cybercriminalité.
Dans un monde exponentiellement numérisé, il est en effet impérieux de lutter contre les infractions commises sur ou au moyen des réseaux [8], qu’il s’agisse d’incriminer de nouveaux comportements [9] ou d’adapter les techniques permettant de les déceler. Aussi, depuis la loi du 10 juillet 1991, relative aux écoutes téléphoniques [10] N° Lexbase : L7789H3U jusqu’à celle du 24 janvier 2022 autorisant l’usage des drones à des fins de police judiciaire [11], le législateur n’a cessé de créer ou d’étendre les mesures d’enquête numériques [12].
S’il est plus que nécessaire d’appréhender la preuve numérique [13] — le web ne devant pas être un sanctuaire pour les délinquants — la technique impressionniste du législateur interroge quant à l’existence d’une cohérence d’ensemble. En effet, au-delà de leur dispersion au sein du Code de procédure pénale, les mesures d’enquête numériques connaissent un encadrement variable et les différences existantes ne sont pas toujours évidentes. Regrettable, ce désordre l’est surtout en ce que ces méthodes d’investigation sont susceptibles de fragiliser les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel [14], évidemment, mais également le droit à un procès équitable. Ainsi, toute variation de garanties devrait être justifiée par la nature de l’ingérence portée à ces derniers. À cet égard, la proposition de règlement relatif aux injonctions de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale [15] laisse à penser, au regard de son titre, qu’il existerait, ou devrait exister, un droit commun de la preuve numérique. Or à l’évidence, un tel droit est, pour l’heure, introuvable. Une telle absence pourrait trouver sa cause dans le manque d’égards concédé à l’objet, autrement dit à la preuve numérique. Faute d’acception précise de ce qu’elle recouvre, élaborer un régime cohérent semble, en effet, impossible [16].
Partant, la précision de la notion de preuve numérique (I.) constitue la première pierre à l’édification d’un droit commun des techniques d’enquête numériques (II.).
I. La révélation de la nature plurielle de la preuve numérique
Si la preuve numérique est évanescente au sein des réseaux, sa définition l’est tout autant et son acception ne fait l’objet d’aucun consensus, qu’il soit légal ou doctrinal (A.). Pour autant, cette carence sémantique semble pouvoir être corrigée en recourant à une notion qui lui est proche, peut-être même identique : la donnée numérique (B.).
A. L’absence de définition de la preuve numérique
La preuve numérique, ou preuve électronique [17], résiste à toute tentative de définition, qu’elle soit d’origine légale, jurisprudentielle ou doctrinale [18].
En droit interne, elle est seulement envisagée en droit civil, dans le cadre de la signature électronique [19]. Arlésienne pénale, elle demeure absente des dispositions du Code pénal ou de procédure pénale, mais apparaît ici et là dans certains travaux du législateur, qu’il s’agisse de souligner son utilité en matière de répression [20] ou de préciser les modalités de sa collecte [21]. Le droit européen lato sensu utilise en revanche plus volontiers l’appellation de « preuve électronique » [22], laquelle figure dans les intitulés du protocole additionnel à la Convention de Budapest relatif « au renforcement de la coopération et de la divulgation des preuves électroniques [23] » et de la proposition de règlement de l’Union européenne relatif « aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale » [24] . Tandis que le premier texte se garde bien de définir ce que cette preuve recouvre, le second s’essaye à l’exercice en indiquant qu’il s’agit de la « preuve stockée sous forme électronique par un fournisseur de services ou en son nom au moment de la réception d’un certificat d’injonction de production ou de conservation, consistant en données stockées relatives aux abonnés, à l’accès, aux transactions et au contenu » [25] . Bienvenue, cette définition demeure cependant purement contextuelle, en étant seulement envisagée en référence aux fournisseurs de services de communication en ligne. La définition jurisprudentielle de la preuve numérique – ou preuve électronique – n’est pas plus élaborée, loin de là. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne n’utilise jamais ces expressions, lesquelles se font également très rares au sein des arrêts de son homologue strasbourgeoise [26]. S’agissant des juridictions françaises, seul le Conseil d’État évoque, parfois, la « preuve électronique » en matière pénale [27] lorsqu’il aborde les dispositions de la Convention de Budapest [28].
La doctrine pourrait combler cette imprécision notionnelle, mais, alors que de nombreux auteurs mentionnent la « preuve numérique » [29], peu d’entre eux se prêtent à l’exercice de définition. Soulignant l’hétérogénéité de la catégorie, certains estiment qu’il s’agit de la preuve recueillie au moyen des techniques d’enquête numériques [30], quand d’autres insistent davantage sur sa physionomie en énonçant qu’il s’agit « de toute information contenue dans un objet que l’homme n’est pas en mesure d’examiner par l’usage direct de ses sens [31] ». Faute de consensus doctrinal, il est difficile de cerner l’essence de cette preuve aux contours si particuliers, sauf à revenir aux fondamentaux c’est-à-dire aux définitions de ses composantes : la preuve, d’une part ; le numérique, d’autre part.
La preuve recouvre « tout moyen permettant d’affirmer l’existence ou la non-existence d’un fait [32] » ou le « fait, témoignage, raisonnement susceptible d’établir de manière irréfutable la vérité ou la réalité » [33]. Elle renvoie donc, alternativement, à l’objet probant ou au moyen mis en œuvre pour le recueillir. Quant à l’adjectif « numérique », il correspond à ce « qui concerne des nombres, qui se présente sous la forme de nombres ou de chiffres, ou qui concerne des opérations sur des nombres [34] » ou encore à « la représentation de l’information ou de grandeurs physiques (images, sons) par un nombre fini de valeurs discrètes, le plus souvent représentées de manière binaire par une suite de 0 et de 1 » [35]. À la lecture de ces définitions, il est donc possible d’avoir deux approches de la « preuve numérique » : l’une consistant à soutenir qu’il s’agit de la preuve qui se présente sous la forme de nombres ou de chiffres ; l’autre tendant davantage à qualifier la technique probatoire ayant permis de rendre lisible, pour tout un chacun, cette suite de chiffres.
En réalité, quelle que soit la définition privilégiée, la preuve numérique apparaît toujours, initialement, comme une suite de chiffres ou de nombres ce qui la rapproche d’une notion dont l’acception semble bien plus claire : la donnée.
B. La synonymie de la donnée et de la preuve numérique
La donnée peut se définir comme « la représentation de l’information ou de grandeurs physiques (par ex. images, sons) par un nombre fini de valeurs discrètes, le plus souvent représentées de manière binaire par une suite de 0 et de 1 [36] » [37] et constitue alors une « information “valorisée” dont le traitement est facilité du fait de sa forme » [38] . À l’instar de la preuve, la donnée est donc, initialement, une simple information qui, comme la première, tire sa spécificité de sa forme [39]. L’étude des textes relatifs aux techniques d’enquête numériques ne fait que confirmer l’intuition selon laquelle toute preuve numérique est, fondamentalement, une donnée. Effectivement, si elles sont destinées à recueillir la preuve numérique, ces techniques portent toujours, en réalité, sur des données. Ainsi, pour qualifier leurs objets, le législateur utilise les termes de « données intéressant l’enquête » [40], « données saisies ou obtenues au cours de l’enquête » [41], « données de localisation » [42], « données de connexion » [43], « données informatiques » [44], « données techniques de connexion » [45] ou, plus directement, de « données [46] » [47]. Les décisions de justice adoptées sur la base de ces dispositions légales confirment l’assimilation de la preuve numérique et de la donnée, quelle que soit la mesure d’enquête étudiée [48].
Initialement, la preuve numérique est donc toujours une donnée. Or, contrairement à la première, la seconde voit son régime progressivement dessiné, notamment lorsque se posent des questions relatives à sa conservation ou à sa communication à des fins pénales. En effet, dans ces derniers cas, les garanties juridiques fluctuent selon la sensibilité de l’information en cause. Partant, le recours à la notion de données – qui n’est pas unitaire – pourrait, éventuellement, expliquer les variations de garanties entourant l’ensemble des techniques d’enquête numériques.
Plusieurs catégories de données ont été identifiées, bien que celles-ci diffèrent selon la juridiction ou le texte étudié. Tout d’abord, la Convention de Budapest distingue les données de contenu, les données de trafic et, enfin, les données relatives aux abonnés [49]. Quant au droit de l’Union européenne, ensuite, la proposition de révision de la directive commerce électronique [50] différencie les données de contenu des métadonnées de communications [51]. La proposition de règlement e-evidence, plus précise, identifie quatre catégories de données : celles relatives aux abonnés [52], celles relatives à l’accès [53], celles relatives aux transactions [54] et, enfin, celles relatives aux contenus [55]. Alors que les deux premières catégories sont jugées peu intrusives, les deux dernières font l’objet d’une protection accrue, s’agissant notamment de l’organe compétent pour émettre une injonction européenne de production les concernant [56]. Une telle catégorisation se retrouve, peu ou prou, au sein de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, celle-ci n’apprécie pas la proportionnalité de l’ingérence de la même manière selon la nature des données concernées. Ainsi, dans l’arrêt Ministerio Fiscal, elle affirma que les données relatives aux abonnés [57] ne permettaient pas d’obtenir des informations intrusives et que l’ingérence n’avait donc pas à se limiter aux infractions graves [58]. En outre, elle opère une distinction entre les données de trafic et de localisation et les données de contenu et, si elle considère que l’ingérence est plus importante lorsque les secondes sont concernées [59], elle souligne tout de même la sensibilité des premières en ce qu’elles « sont susceptibles de révéler des informations sur un nombre important d’aspects de la vie privée des personnes concernées, y compris des informations sensibles [60] » [61]. Enfin, parmi les données de trafic et de localisation, elle isole l’adresse IP qu’elle rapproche des données relatives à l’identité civile en ce qu’elle sert principalement à identifier la personne concernée [62]. À la lecture des arrêts de la juridiction de Luxembourg, il est donc possible de distinguer les données d’identité, comprenant l’adresse IP, les données de trafic et de localisation et, enfin, les données de contenu.
L’autorité de la Cour de justice a conduit le législateur français à modifier l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications N° Lexbase : L4175L7R relatif aux obligations de conservation de données s’imposant aux opérateurs de communications électroniques [63]. Sont désormais distinguées les informations relatives à l’identité civile, les informations relatives à la souscription d’un contrat et au paiement, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou relatives aux équipements terminaux utilisés, les autres données de trafic et, enfin, celles relatives aux communications électroniques. À y regarder de plus près, le législateur s’est fortement inspiré de la classification élaborée par la Cour de justice, les trois premières catégories pouvant être regroupées sous l’appellation « données d’identité », jugées peu sensibles [64].
Finalement, la « preuve numérique » semble englober trois catégories de données qui, au regard de leur sensibilité, méritent d’être distinguées [65] : les données relatives à l’état civil, au contrat, à la facturation, ainsi que l’adresse IP (données d’identité) ; les données de trafic et de localisation [66] et, enfin, les données de contenu, recoupant celles qui concernent les échanges écrits ou oraux tenus entre plusieurs protagonistes, mais également l’image de ces derniers ou le simple son de leurs voix. La classification proposée ressemble à celle retenue par la Cour de justice, au terme d’une jurisprudence riche et dense, ou encore à celle arrêtée par le législateur au sein de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications N° Lexbase : L4175L7R. Cependant, si elle semble, de prime abord, n’avoir d’intérêt que dans le cadre du contentieux relatif aux obligations de conservation et de communication des données de connexion, elle pourrait, en réalité, permettre l’édification d’un droit commun de la preuve numérique.
II. La construction d’un régime unifié de la preuve numérique
Les techniques d’enquête numériques se sont développées au fil des interventions impressionnistes du législateur. En apparence, elles semblent identiques, tant du point de vue de l’atteinte portée aux droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel que de celui de leur objet, la preuve numérique. Pourtant, à y regarder de plus près, les garanties entourant la mise en œuvre de ces techniques diffèrent amplement selon la mesure d’investigation étudiée (A.). Regrettable, cet encadrement anarchique semble pouvoir être reconstruit autour de la notion de donnée, pour laisser entrevoir un droit commun de la preuve numérique (B.).
A. L’éclatement regrettable du régime de la preuve numérique
En portant sur le même objet – la donnée –, toutes les techniques d’enquête numériques devraient être soumises aux mêmes garanties légales. Pourtant, nombreux sont les auteurs à avoir souligné une absence de cohérence [67], relevant même l’existence d’« un encadrement à géométrie variable [68] ». Pour se convaincre de ces disparités, il convient de s’intéresser plus avant au régime de ces mesures. Traditionnellement, en droit interne, elles sont soumises à trois conditions dont l’objectif est de garantir la protection des droits des personnes mises en cause et qui tiennent à la gravité de l’infraction concernée, à la durée de la mesure ainsi qu’à l’organe chargé de l’autoriser.
La condition tenant à la gravité de l’infraction concernée, d’abord, permet de s’assurer de la proportionnalité du recours aux techniques d’enquête numériques et devrait, dès lors, s’imposer pour chacune d’elles. Pourtant, elle est absente s’agissant des perquisitions informatiques[69] et des mises au clair de données chiffrées[70]. En revanche, la peine encourue doit être d’au moins trois ans d’emprisonnement lorsqu’il s’agit de recourir aux drones[71] ou à une géolocalisation [72] et, s’agissant des opérations de cyberpatrouilles, elles sont limitées aux crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques [73]. Les techniques d’enquête numériques prévues aux articles 706-95 et suivants du Code de procédure pénale [74] N° Lexbase : L1609MAT, quant à elles, ne concernent que les infractions relevant de la criminalité organisée énoncées aux articles 706-73 N° Lexbase : L6560MG3 et 706-73-1 N° Lexbase : L6561MG4 du même code, lesquelles sont, à tout le moins, punies de trois ans d’emprisonnement. S’agissant, enfin, des réquisitions, elles ne sont, en principe, soumises à aucune condition de gravité [75]. Toutefois, lorsque sont concernées des données de connexion, l’infraction en cause doit être punie de trois ans d’emprisonnement ou, si la mesure a pour seul objet d’en identifier l’auteur, doit être un délit puni d’un an d’emprisonnement commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. Par ailleurs, si les réquisitions concernent uniquement les équipements terminaux de la victime et qu’elles interviennent à sa demande, l’infraction doit seulement être punie d’emprisonnement [76].
La condition tenant à la durée de la mesure, ensuite, diffère également selon la technique d’enquête étudiée. En effet, l’usage des drones [77], l’interception des correspondances [78], la captation de données informatiques [79] et les sonorisations et fixations d’images [80] sont limités à un mois, renouvelable une fois. Les opérations de géolocalisation, quant à elles, ne peuvent excéder huit jours ou, dans le cas où l’infraction concernée relèverait de la criminalité organisée, quinze jours. À l’issue de ces délais, elles peuvent néanmoins être reconduites pour un mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an ou, si l’infraction relève de la criminalité organisée, deux ans[81]. Le recours aux IMSI-Catcher ne connaît de limite temporelle, fixée à quarante-huit heures, que dans le cas où le dispositif a pour objet d’intercepter les correspondances émises ou reçues par un équipement terminal [82]. Enfin, aucun délai maximum n’encadre les perquisitions informatiques [83], la mise au clair de données chiffrées [84], les cyberpatrouilles [85], l’accès aux correspondances stockées [86] et les réquisitions [87] sauf, pour ces dernières, s’il s’agit de requérir des opérateurs de télécommunications qu’ils conservent le contenu des informations consultées [88].
Enfin, quant à l’organe compétent pour autoriser la mesure, le procureur de la République intervient s’agissant de la mise au clair de données chiffrées [89], de l’usage des drones [90] et des cyberpatrouilles [91]. Il laisse sa place au juge des libertés et de la détention lorsqu’il s’agit d’accéder à des correspondances [92], de procéder à une sonorisation, à une captation d’images[93] ou de données informatiques [94] ou, enfin, d’intercepter des communications [95], y compris lorsque cette interception résulte de l’utilisation d’un IMSI-Catcher [96]. Concernant les géolocalisations, les deux autorités se partagent la compétence, selon le lieu où le dispositif est installé et/ou la durée de la mesure [97]. Il en va de même pour les réquisitions où, malgré les critiques [98], le juge des libertés et de la détention n’intervient que si celles-ci portent sur les données de connexion émises par un avocat ou si elles tendent à conserver des données de contenu [99]. Enfin, les perquisitions informatiques font, quant à elles, l’objet d’un régime particulier au sein duquel aucune autorisation n’est requise si les enquêteurs agissent en flagrance et, en enquête préliminaire, s’ils disposent de l’assentiment de l’intéressé. À défaut d’un tel consentement, le juge des libertés et de la détention peut tout de même autoriser la mesure si l’enquête est relative à une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans [100].
À l’évidence, de profondes différences se font jour sans qu’il soit possible de comprendre, immédiatement, leur raison d’être. Effectivement, toutes les mesures d’enquête numériques portent atteinte aux droits à la vie privée et à la protection des données ce qui, théoriquement, devrait justifier l’édiction de garanties analogues, sinon identiques. Toutefois, ce désordre pourrait, en réalité, n’être qu’apparent, car, en y regardant de plus près, certains éléments, dont la nature de la donnée fait partie, pourraient justifier une variation des garanties encadrant les techniques d’enquête numériques.
B. L’élaboration progressive du régime de la preuve numérique
À l’image des réquisitions [101], les garanties entourant les techniques d’enquête numériques pourraient fluctuer selon la sensibilité de la preuve qu’elles visent à recueillir, donc selon la nature de la donnée en cause. Pour s’en convaincre, il convient d’étudier, précisément, l’objet des mesures d’enquête numériques. À l’analyse, elles portent, à la fois, sur des données d’identité, des données de trafic et de localisation ainsi que sur des données de contenu, à l’exception des réquisitions et de la géolocalisation qui ne concernent pas ces dernières. Partant, ces mesures d’enquêtes devraient connaître un encadrement moins exigeant que celui dévolu, par exemple, aux mises au clair de données chiffrées qui, elles, peuvent également porter sur des données de contenu, ce qui n’est pourtant pas le cas [102]. En revanche, la nature de la preuve a eu une incidence dans le cadre des réquisitions où les données de connexion réclament une exigence de gravité accrue [103]. De surcroît, ce critère vient, ici et là, justifier des aménagements au sein du régime d’une même technique d’enquête. Ainsi, le recours aux IMSI-Catcher se trouve, lorsque des données de contenu sont en cause, subordonné à l’autorisation de juge des libertés et de la détention. La nature de la donnée semble donc déjà jouer un rôle dans la détermination du régime des techniques numériques d’enquête, bien que celui-ci ne soit pas systématique. Si ce critère ne suffit pas, à lui seul, à justifier l’oscillation des garanties légales, en existe-t-il un autre susceptible, en s’y additionnant, de l’expliquer ? Celui-ci pourrait trouver son origine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme opérant une distinction selon que l’intrusion dans le droit à la vie privée s’opère en temps réel ou en temps différé, considérant la mesure plus attentatoire dans le premier cas [104]. Il s’agit, pour le dire autrement, de distinguer les recueils de données déjà disponibles des interceptions de flux actifs de données qui seraient plus intrusives, l’individu, véritablement surveillé, n’ayant aucune possibilité de les supprimer [105]. Préconisé par la juridiction de Strasbourg, et repris par la Cour de justice de l’Union européenne [106], ce critère a-t-il une incidence dans l’encadrement interne des techniques d’enquête numériques ? La condition tenant à la gravité, d’abord, est imposée pour toutes les mesures consistant à intercepter un flux actif de données. À l’inverse, elle est absente s’agissant des perquisitions informatiques, de la mise au clair des données chiffrées et des réquisitions, lesquelles sont bien des techniques de recueil. Toutefois, lorsque les réquisitions concernent des données de connexion, l’exigence de gravité réapparaît. Il en va de même pour l’accès aux correspondances stockées qui, s’il ne permet qu’un recueil, est, en portant sur des données de contenu, soumis à une exigence de gravité. Partant, le critère lié à la nature de la donnée vient se cumuler au premier et justifier l’accroissement des garanties. La condition tenant à la durée, ensuite, s’impose dans la majorité des cas impliquant une interception de données, à l’exception notable des cyberpatrouilles. À l’inverse, elle s’applique s’agissant de l’accès aux correspondances stockées qui ne permet pourtant qu’un simple recueil. Si le cas des cyberpatrouilles ne trouve, a priori, aucune explication, il semble que, dans le second cas, la condition de durée soit, une nouvelle fois, justifiée par la nature des données concernées. Le régime des IMSI-Catcher illustre cette affirmation, la mesure n’étant limitée que lorsqu’elle porte sur des données de contenu. Enfin, concernant la condition tenant à la qualité de l’organe compétent, il est très difficile de déceler une quelconque logique. En effet, si les techniques d’enquête impliquant une interception supposent parfois l’intervention du juge des libertés et de la détention [107], celle-ci est souvent subordonnée à la durée de la mesure ou à la nature des données concernées [108]. En outre, dans d’autres cas, le procureur de la République demeure compétent, en dépit de la sensibilité de ces dernières [109]. Parallèlement, les simples recueils de données réclament, lorsque celles-ci sont intrusives, l’intervention du juge des libertés et de la détention [110].
À bien observer le régime des techniques d’enquête numériques, la nature de la donnée et la temporalité de la mesure semblent avoir une incidence, laquelle n’apparaît toutefois pas aboutie. Ainsi, pour trouver une cohérence, ce régime doit être strictement pensé autour de ces deux critères, seuls à même de mesurer la gravité de l’ingérence portée dans les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Avant d’entrer dans le détail, il convient de préciser que l’ensemble des techniques d’enquête numériques est subordonné à une exigence de nécessité qui, si elle est parfois visée par les textes, s’impose dans tous les cas à la lecture de l’article préliminaire du Code de procédure pénale[111]. Une fois cela indiqué, il s’agit de s’intéresser précisément aux critères précédemment dégagés. Alors que le critère temporel doit, selon nous, déterminer la durée de la mesure ainsi que l’information de la personne concernée, le critère matériel, quant à lui, doit guider les conditions tenant à la gravité de l’infraction et à la qualité de l’organe d’autorisation.
Quant à la condition tenant à la durée de la mesure, elle n’a de sens que dans le cadre des techniques captant un flux actif de données. En effet, imposer une telle exigence pour les recueils d’informations serait hypocrite, car si ceux-ci pouvaient se tenir dans le temps, ils s’apparenteraient, finalement, à une captation. Partant, cette condition doit être prévue pour chacune des mesures impliquant une interception. En outre, la nature de la donnée doit jouer un rôle dans la détermination du délai, lequel doit être plus court lorsque des informations sensibles sont en cause. En l’état actuel de la législation, les techniques d’enquête impliquant une interception active de données de contenu sont limitées à deux mois et, s’il s’agit de données de trafic et de localisation, à deux ans. Cependant, aujourd’hui, aucun délai n’encadre les captations de données de connexion réalisées par les IMSI-Catcher ou celles opérées dans le cadre des cyberpatrouilles. Partant, les secondes devraient se limiter à deux mois et les premières, à deux ans. Ce critère temporel doit également guider la garantie tenant à l’information de l’individu faisant l’objet de la mesure [112]. Effectivement, si celle-ci consiste à intercepter un flux actif de données, prévenir la personne concernée pourrait nuire à l’efficacité de l’enquête. En outre, la limitation de la durée de la mesure permet de corriger cette absence, à condition qu’une information soit délivrée une fois la technique d’enquête échue. Pour les techniques impliquant un simple recueil, la personne pourrait être informée, les données étant, dans tous les cas, à disposition des enquêteurs.
Conformément aux exigences de la Cour de justice de l’Union européenne, seules les infractions « graves » devraient permettre la mise en œuvre d’une technique numérique d’enquête portant sur des données de trafic et de localisation et, a fortiori, de contenu [113]. Cette condition devrait donc s’étendre lorsqu’il s’agit de mettre au clair des données chiffrées ou de procéder à une perquisition informatique. Une difficulté demeure : comment définir un seuil ? En France, celui de trois ans d’emprisonnement est majoritairement imposé [114], mais est-il suffisamment élevé pour la Cour de Luxembourg ? Rien ne permet de l’affirmer [115] et il y a fort à penser que ce critère soit progressivement affiné par les juridictions, internes comme européennes. En outre, afin d’éviter les détournements de procédure, il apparaît essentiel de préciser que ces techniques d’enquête ne doivent pas avoir pour objet de rechercher d’autres infractions que celles visées dans la décision les autorisant, et ce à peine de nullité [116].
Enfin, la nature des données en cause devrait guider le choix de l’organe autorisant la mesure d’enquête, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne l’impose. En effet, elle estime que la sensibilité des données de connexion exige « un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante » intervenant « à la suite d’une demande motivée » [117] des autorités répressives [118]. Elle ajoute « qu’un ministère public qui dirige la procédure d’enquête et exerce, le cas échéant, l’action publique ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers par rapport aux intérêts légitimes en cause » et, qu’ainsi il « n’est pas en mesure d’effectuer le contrôle préalable des demandes d’accès aux données conservées » [119]. La solution de la Cour de Luxembourg [120] ayant été reprise par la Chambre criminelle [121], elle devrait s’imposer en France, en dépit des résistances du Conseil constitutionnel [122] et des contestations du monde judiciaire. Plus loin, en étant dictée par la nature des données concernées, elle devrait s’étendre à la totalité des techniques d’enquête numériques, lesquelles portent toutes, à tout le moins, sur des données de connexion[123]. Ainsi, le recours à d’autres critères, tels que la durée de la mesure, le lieu de l’implantation du dispositif ou l’assentiment de l’intéressé ne semble plus pertinent et seule doit être prise en compte la nature de la donnée . Qu’il s’agisse de confier ce contrôle au juge des libertés et de la détention ou à une autorité administrative indépendante dédiée [124], le ministère public devra céder sa compétence.
À l’occasion des réflexions sur une réforme d’ensemble du Code de procédure pénale [125], le législateur pourrait construire un droit commun de la preuve numérique. Les critères pour réaliser cet édifice sont déjà présents, encore faut-il qu’il ait, réellement, la volonté de le bâtir…
| À retenir. L’hétérogénéité de l’encadrement des techniques d’enquête numériques semble trouver sa source dans l’absence de définition concédée à leur objet : la preuve numérique. Le recours à la notion de données numériques, plus claire, pourrait permettre de corriger cet état de fait. Véritable critère, la nature de la donnée en cause vient, en s’ajoutant au critère temporel, justifier une variation des garanties entourant les techniques d’enquête et dessiner, progressivement, un droit commun de la preuve numérique. |
Annexe
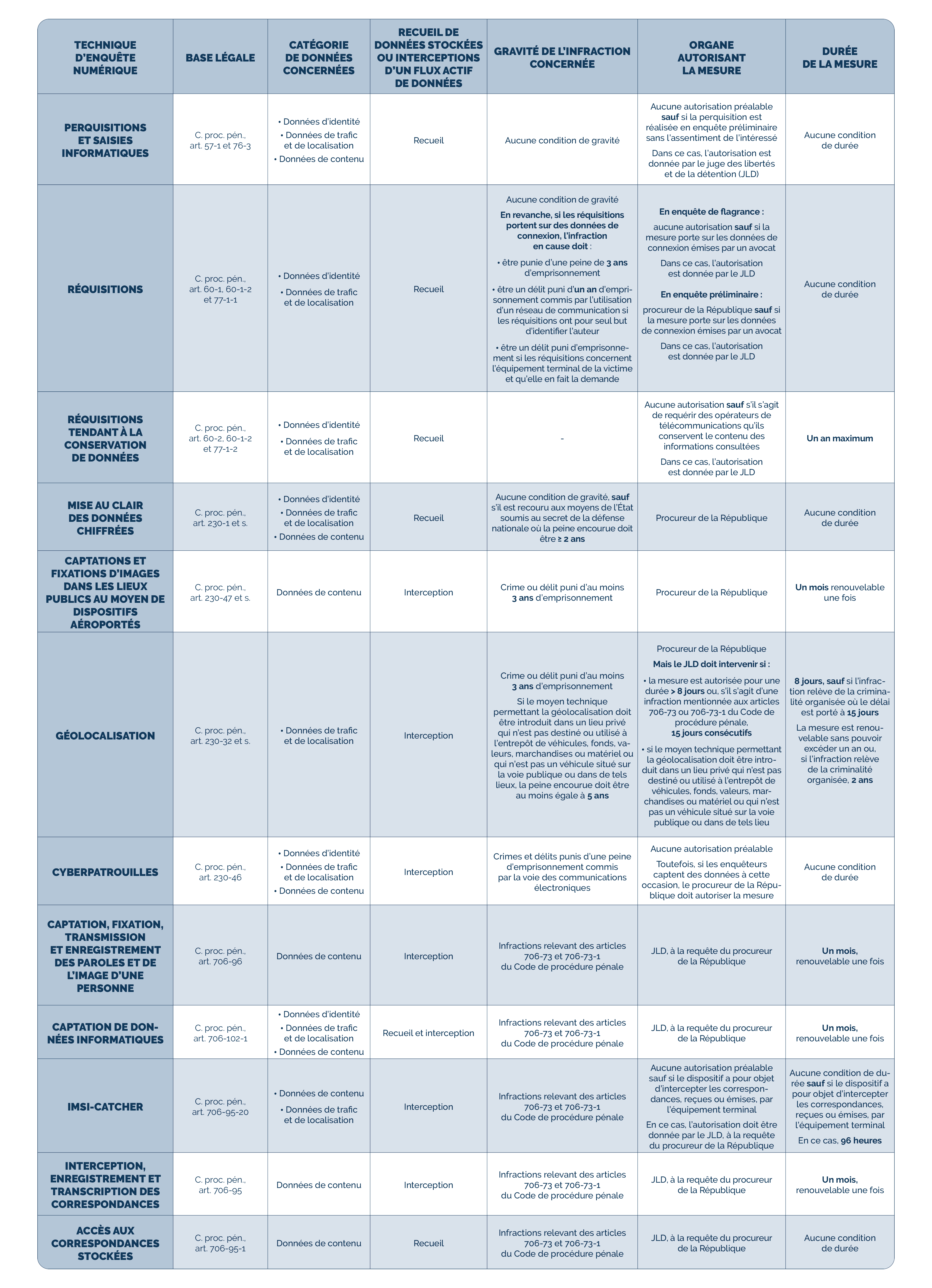
[1] En témoigne la réforme des réquisitions relatives aux données de connexion à la faveur de la loi n° 2022-299, du 2 mars 2022, visant à combattre le harcèlement scolaire N° Lexbase : L7677MBX.
[2] V. not. s’agissant des réquisitions de données de connexion : Cons. const., décision n° 2021-952 QPC, du 3 décembre 2021, M. Omar Y. N° Lexbase : A00977EC – T. Douville, obs., Gaz. Pal., 2022, 12, 5 ; B. Guillaumin, LPA, 2022, 3, 53, comm. ; F. Fourment, obs., Gaz. Pal., 2022, 6, 55 ; B. Daligaux, obs., Gaz. Pal., 2022, 2, 19, comm. ; M. Audibert, Inconstitutionnalité différée des réquisitions de données informatiques par le procureur de la République dans le cadre de l’enquête préliminaire : le jour d’après, Lexbase Pénal, décembre 2021 N° Lexbase : N9789BY9 – Cons. const., décision n° 2021-976/977 QPC, du 25 février 2022, M. Youcef Z. N° Lexbase : A03477PK : C. Evrard, Collecte des données personnelles de connexion : censure du Conseil constitutionnel, Dalloz actualité, 9 mars 2022 [en ligne] ; A. Archambault, obs., AJ pénal, 2022, 220b ; C. Crichton, obs., Dalloz IP/IT, 2022, 118 ; A. Botton, obs., RSC, 2022, 415 ; A. Léon, Données personnelles : inconstitutionnalité du dispositif de conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, Lexbase N° Lexbase : N0554BZK ; Cons. const., décision n° 2022-993 QPC, du 20 mai 2022, M. Lofti H. N° Lexbase : A58297X8 : P. Collet, obs., Gaz. Pal., 2022, 24, 16 ; C. Richaud, obs., Gaz. Pal., 2022, 40, 10 ; Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 21-83.710, FS-B N° Lexbase : A84348AM, n° 21-83.820, FS-B N° Lexbase : A84318AI, n° 21-84.096, FS-B N° Lexbase : A84328AK, n° 21-83.729, FS-D N° Lexbase : A56808BY ; O. Cahn, note, JCP G, 2022, 40, 1123 ; M. Bouchet, obs., Gaz. Pal., 2022, 31 ; J. Eynard, obs., Dalloz IP/IT, 2022, 408 ; B. Nicaud, Restrictions à la conservation des données de connexions et à leur accès : la Cour de cassation tire les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, Dalloz actualité, 5 septembre 2022 [en ligne] ; M. Bendavid et C. Quendolo, note, AJ pénal, 2022, 415 ; A. Léon, Données de connexion : la Chambre criminelle applique son mode d’emploi, Lexbase Pénal, septembre 2022 N° Lexbase : N2437BZB – Cass. crim., 11 octobre 2022, n° 22-81.244, F-D N° Lexbase : A34138P4 : R. Mésa, obs., Gaz. Pal., 2022, 38, 16. S’agissant de l’accès aux données chiffrées : Cons. const., décision n° 2022-987 QPC, du 8 avril 2022, M. Saïd Z. N° Lexbase : A49327SH : H. Barbier, RTD Civ., 2022, 628, comm. ; M. Slimani, Constitutionnalité d’une preuve pénale classée secret-défense, Dalloz actualité, 10 mai 2022 [en ligne] ; L. Saenko, Captation de données informatiques et secret défense : une arme sans contrôle ?, Lexbase Pénal, avril 2022 N° Lexbase : N1274BZ9 ; A. Léon, Captation de données informatiques en matière de criminalité et délinquance organisées : le recours aux moyens couverts par le secret de la défense nationale est conforme à la Constitution, Lexbase Pénal, avril 2022 N° Lexbase : N3701BZ4.
[3] S’agissant de l’Union européenne : proposition de règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, COM(2018) 225 final, Strasbourg, 17 avril 2018 [en ligne]. S’agissant du Conseil de l’Europe : deuxième protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques, Strasbourg, 12 mai 2022 [en ligne].
[4] Nos propos se limiteront à l’étude de ces mesures dans le cadre de l’enquête, à l’exclusion de l’instruction.
[5] M. Touillier, Lumière sur un arsenal de lutte contre une délinquance tapie dans l’ombre, AJ pénal, 2017, p. 312.
[6] Décret n° 2017-614, du 24 avril 2017, portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires » et d'un comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires N° Lexbase : L9646LDM.
[7] Ibid., art. 2.
[8] Conformément à la définition de la cybercriminalité proposée par le Sénat selon laquelle celle-ci peut se concevoir comme « toute action illégale dont l’objet est de perpétrer des infractions sur ou au moyen d’un système informatique interconnecté à un réseau de télécommunications » : Sénat, Rapport d’information sur la lutte contre la cybercriminalité, n° 613, 9 juillet 2020, p. 6 [en ligne].
[9] V. not. B. Pereira, La lutte contre la cybercriminalité : de l’abondance de la norme à sa perfectibilité, RIDE, n° 3, 2016, p. 387-409 ; M. Quéméner, Pour une lutte plus efficace contre la cybercriminalité, Sécurité globale, n° 15, 2018, p. 5-16.
[10] Loi n° 91-646, du 10 juillet 1991, relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications N° Lexbase : L7789H3U.
[11] Loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure N° Lexbase : L7812MAL.
[12] Il en va ainsi, par exemple, de la loi n° 2004-204, du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité N° Lexbase : L1768DP8 qui a permis les sonorisations et les fixations d’images ou encore de la loi n° 2016-731, du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale N° Lexbase : L4202K87 ayant étendu ces mesures à l’enquête, ayant créé l’accès aux correspondances stockées et permis le recours aux IMSI-Catcher.
[13] M. Quéméner, F. Dalle, L’accès à la preuve numérique, enjeu majeur de toute enquête pénale : pratique et perspectives, Dalloz IP/IT, 2018, p. 418.
[14] Sur la différence entre ces deux droits fondamentaux : A. Mornet, Les fichiers pénaux de l’Union européenne. Contribution à l’étude de la protection des données à caractère personnel, thèse dactylographiée, Université Toulouse I, 2020, n° 17.
[15] Proposition de règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, op. cit.
[16] J.-L. Bergel, Différence de nature (égale) différence de régime, RTD civ., 1984, p. 255-272.
[17] En effet, les deux termes sont employés indifféremment par la doctrine.
[18] V. également en ce sens, É. Vergès, La preuve numérique, entre continuité et changement de paradigme, in Le traitement de la preuve numérique par les magistrats dans les procédures judiciaires civiles et pénales, RJA, n° 21, 2019, p. 16.
[19] Instruction de la Direction générale des systèmes d’information et de communication n° 2003/DEF/DGSIC portant code de bon usage des systèmes d’information et de communication du ministère de la défense, 20 novembre 2008, p. 16.
[20] Le Sénat emploie effectivement l’expression « preuve numérique » en insistant sur son importance dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité : Sénat, Résolution européenne sur la lutte contre la cybercriminalité, JORF n° 207, du 25 août 2020 [en ligne].
[21] En effet, la circulaire de présentation des dispositions de la loi n° 2016-731, du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale N° Lexbase : L4202K87 contient une fiche technique consacrée au « recueil de la preuve numérique » : circulaire du ministre de la Justice, du 2 décembre 2016, de présentation des dispositions de la loi n° 2016-731, du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, relative au renforcement du dispositif en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, p. 12 et s. [en ligne].
[22] En droit de l’Union européenne, le terme a été employé pour la première fois en matière de délinquance financière : communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Prévenir et combattre les malversations financières et pratiques irrégulières des sociétés, COM(2004) 611 final, Bruxelles, p. 13 [en ligne].
[23] Deuxième protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques, op. cit.
[24] Proposition de règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, op. cit.
[25] Ibid., art. 2, 6).
[26] La Cour européenne des droits de l’Homme utilise l’expression « preuve électronique » dans un seul arrêt, pour désigner le contenu d’une messagerie électronique utilisée par une organisation criminelle : CEDH, 2e sec., 22 novembre 2021, Req. 19699/18, Akgün c/ Turquie, §67 N° Lexbase : A24214ZP.
[27] Les juridictions civiles l’emploient, quant à elles, pour désigner l’écrit électronique de l’article 1366 du Code civil N° Lexbase : L1034KZC : CA, Versailles, 13e ch., 30 octobre 2014, n° 13/00220 N° Lexbase : A3052MZ3. Quant à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), elle utilise l’expression « preuve numérique » pour désigner les QR Codes Covid (CNIL, Délibération n° 2021-067, du 7 juin 2021, portant avis sur le projet de décret portant application du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689, du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire N° Lexbase : X9103CM4) et le terme « preuve électronique » en matière civile (CNIL, Délibération relative au projet de décret modifiant le titre II du décret n° 98-247, du 2 avril 1998, relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers).
[28] CE Contentieux, 21 avril 2021, n° 393099, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A01664Q9.
[29] M. Quéméner, Les spécificités juridiques de la preuve numérique, AJ pénal, 2014, p. 63 ; C. Michalski, La recherche et la saisie des preuves électroniques, Gaz. Pal., 2014, n° 42 ; C. Castets-Renard, Quelles nouveautés en matière de preuve numérique ?, Justice et Cassation, 2017, p. 23 ; M. Quéméner et F. Dalle, L’accès à la preuve numérique, enjeu majeur de toute enquête pénale : pratique et perspectives, op. cit., p. 418.
[30] Ainsi, selon Mélanie Clément-Fontaine : « La preuve numérique est une modalité particulière d’établissement de la vérité qui consiste à avoir recours à des moyens numériques variés qui vont de l’étude des contenus dans la mémoire d’un disque dur, aux messages électroniques, en passant par l’enregistrement numérique » : Définition et cadre juridique de la preuve numérique, in La preuve numérique à l’épreuve du litige, Actes de colloque du CNEJITA, 13 avril 2010, p. 11. V. également, É. Vergès, La preuve numérique, entre continuité et changement de paradigme, op. cit., p. 16-17.
[31] D. Benichou, Le juge pénal, ses attentes, une preuve sûre et intelligible, in La preuve numérique à l’épreuve du litige, Actes de colloque du CNEJITA, 13 avril 2010, p. 58.
[32] R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, Cujas, 1979, p. 151.
[33] V. « Preuve » : TLFi : Trésor de la langue Française informatisé [en ligne], ATILF – CNRS et Université de Lorraine.
[34] V. « Numérique » : TLFi : Trésor de la langue Française informatisé [en ligne], ATILF – CNRS et Université de Lorraine.
[35] Conseil d’État, Le numérique et les droits fondamentaux, La documentation française, 2014, p. 9.
[36] Ibid., p. 17.
[37] La Convention de Budapest utilise, quant à elle, l’expression « donnée informatique » qu’elle définit comme « toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu’un système informatique exécute une fonction » : Convention sur la cybercriminalité, op. cit., art. 1, b).
[38] A. Debet, J. Massot, N. Metallinos, Informatique et libertés. La protection des données à caractère personnel en droit français et européen, LGDJ, coll. « Les intégrales », 2015, n° 483. En italique dans le texte.
[39] L’article 60-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6528MGU confirme cette analyse en évoquant les « informations intéressant l’enquête » disponibles « sous forme numérique ».
[40] S’agissant des perquisitions et saisies informatiques : C. proc. pén., art. 57-1 N° Lexbase : L6526MGS et 76-3 N° Lexbase : L6537MG9.
[41] S’agissant de l’accès aux données chiffrées : C. proc. pén., art. 230-1 et s. N° Lexbase : L6546MGK.
[42] S’agissant de la géolocalisation : C. proc. pén., art. 230-8 N° Lexbase : L4542LNK.
[43] S’agissant des réquisitions : C. proc. pén., art. 60-1-1 N° Lexbase : L7996MBR et 77-1-1 N° Lexbase : L6551MGQ. L’article 60-1-2 N° Lexbase : L7997MBS évoque, quant à lui, les « données techniques » et, s’agissant des réquisitions « générales », le législateur précise qu’il peut s’agir d’informations « sous forme numérique ». Enfin, les articles 60-2 N° Lexbase : L7998MBT et 77-1-2 N° Lexbase : L8000MBW visent les « informations utiles à la manifestation de la vérité [...] contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives ».
[44] S’agissant de la captation de données informatiques : C. proc. pén., art. 706-102-1 N° Lexbase : L7414LPB.
[45] S’agissant des IMSI-Catcher : C. proc. pén., art. 706-95-20 N° Lexbase : L7216LPX.
[46] S’agissant des interceptions et transcriptions de correspondances stockées : C. proc. pén., art. 706-95-1 N° Lexbase : L7420LPI et 706-95-2 N° Lexbase : L7419LPH. Il en va de même pour les cyberpatrouilles et les drones : C. proc. pén., art. 230-46 N° Lexbase : L6547MGL et 230-52 N° Lexbase : L8110MAM.
[47] En réalité, seul l’article 706-96 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7418LPG relatif à la sonorisation et à la fixation d’images n’emploie pas ce terme. Pour autant, les informations révélées par le corps et fixées par le biais de dispositifs numériques sont des données et, plus précisément, des données à caractère personnel : CNIL, Voix, image et protection des données personnelles, La Documentation française, 1996, 119 p.
[48] Tous les arrêts ou décisions relatifs aux techniques d’enquête numériques utilisent, en effet, l’expression de « données ». V. par exemple, pour les réquisitions : Cons. const., décision n° 2021-952 QPC, du 3 décembre 2021, M. Omar Y. N° Lexbase : Z094101S ; Cons. const., décision n° 2022-1000 QPC, du 17 juin 2022, M. Ibrahim K. N° Lexbase : Z310512D : M. Lassalle, obs., D., 2022, 1540 ; J.-B. Perrier, obs., D., 2022, 1487 – Cass. crim., 11 octobre 2022, n° 22-81.244, F-D N° Lexbase : A34138P4. Pour les obligations de conservation de données : Cons. const., décision n° 2021-976/977 QPC, du 25 février 2022, M. Habib A. et autres N° Lexbase : A03477PK. Pour la géolocalisation : Cons. const., décision n° 2014-693 DC, du 25 mars 2014 N° Lexbase : A9174MHA ; Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019 N° Lexbase : A5079Y4U : C. Fleuriot, Géolocalisation : censure partielle pour violation des droits de la défense, Dalloz actualité, 27 mars 2014 [en ligne] ; E. Dupic, obs., Gaz. Pal., 2014, 95, 14. Pour l’accès aux données chiffrées : Cons. const., décision n° 2022-987 QPC, du 8 avril 2022, M. Saïd Z. N° Lexbase : A49327SH. Pour les cyberpatrouilles : Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019 N° Lexbase : A5079Y4U. Pour l’interception de paroles : Cons. const., décision n° 2013-679 DC, 4 décembre 2013 N° Lexbase : A5483KQ7 ; Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC, du 9 octobre 2014, M. Maurice L. et autres N° Lexbase : A0029MYQ : J.-B. Perrier, obs., AJ pénal, 2014, 574 ; M. Léna, Plus (du tout) de garde à vue de 96 heures pour les escroqueries en bande organisée, Dalloz actualité, 15 octobre 2014 [en ligne] ; A. Maron et M. Haas, obs., Dr. Pénal, 2014, 142 ; S. Anane, obs., RFDC, 2015. 206. Pour la captation de données informatiques : Cons. const., décision n° 2022-987 QPC, du 8 avril 2022, M. Saïd Z. N° Lexbase : A49327SH ; Cass. QPC., 1er février 2022, n° 21-85.148, F-D N° Lexbase : A48307LH : X. Laurent, obs., Dalloz IP/IT, 2022, 578 ; Pour les IMSI-Catcher et pour l’accès aux correspondances stockées : Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019 N° Lexbase : A5079Y4U.
[49] Les données de trafic sont « toutes données ayant trait à une communication passant par un système informatique, produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le type de service sous-jacent » : Convention sur la cybercriminalité, op. cit, art. 1, d),. Quant aux données relatives aux abonnés, il s’agit de « toute information, sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme, détenue par un fournisseur de services et se rapportant aux abonnés de ses services, autres que des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d’établir : a) le type de service de communication utilisé, les dispositions techniques prises à cet égard et la période de service ; b) l’identité, l’adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone de l’abonné, et tout autre numéro d’accès, les données concernant la facturation et le paiement, disponibles sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services ; c) toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les équipements de communication, disponible sur la base d’un contrat ou d’un arrangement de services » : Convention sur la cybercriminalité, op. cit, art. 18§3.
[50] La Directive commerce électronique distingue, quant à elle, les données de trafic et les données de localisation. Une telle division est en voie d’être abandonnée car elle n’a pas de conséquences pratiques, ces deux catégories de données présentant le même degré de sensibilité : Directive (CE) n° 2002/58, du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), art. 2, b) et c),.
[51] Les premières correspondent au « contenu échangé au moyen de services de communications électroniques, notamment sous forme de texte, de voix, de documents vidéo, d'images et de son » tandis que les secondes recouvrent « les données traitées dans un réseau de communications électroniques aux fins de la transmission, la distribution ou l'échange de contenu de communications électroniques, y compris les données permettant de retracer une communication et d’en déterminer l’origine et la destination ainsi que les données relatives à la localisation de l'appareil produites dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques, et la date, l’heure, la durée et le type de communication » : Proposition de règlement du parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la Directive (CE) n° 2002/58 (règlement «vie privée et communications électroniques»), art. 4§3, l) et m), COM(2017) 10 final, Bruxelles, 10 juillet 2017 [en ligne].
[52] Il s’agit de « toutes les données relatives à a) l’identité d’un abonné ou d’un client, telles que le nom, la date de naissance, l’adresse postale ou géographique, les données de facturation et de paiement, le numéro de téléphone ou le courriel fournis ; b) le type de service et sa durée, y compris les données techniques et les données identifiant les mesures techniques liées ou les interfaces utilisées ou fournies par l’abonné ou le client, et les données relatives à la validation de l’utilisation du service, à l’exclusion des mots de passe ou autres moyens d’authentification utilisés à la place d’un mot de passe fournis par un utilisateur ou créés à la demande d’un utilisateur » : Proposition de règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, op. cit., art. 2, 7).
[53] Il s’agit des « les données relatives au début et à la fin d’une session d’accès utilisateur à un service, strictement nécessaires aux seules fins d’identification de l’utilisateur du service, telles que la date et l’heure d’utilisation, ou la connexion et la déconnexion du service, ainsi que l’adresse IP attribuée par le fournisseur de service d’accès à l’internet à l’utilisateur d’un service, les données identifiant l’interface utilisée et l’identifiant de l’utilisateur. Sont incluses les métadonnées de communications électroniques telles que définies à l’article 4, paragraphe 3, point g), du [règlement concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques] » : ibid., art. 2, 8)
[54] Il s’agit des « données relatives à la fourniture d’un service proposé par un fournisseur de services, qui servent à fournir des informations contextuelles ou supplémentaires sur ce service, et qui sont générées ou traitées par un système d’information du fournisseur de services, tel que la source et la destination d’un message ou d’un autre type d’interaction, les données sur l’emplacement du dispositif, la date, l’heure, la durée, la taille, le routage, le format, le protocole utilisé et le type de compression, sauf si ces données constituent des données relatives à l’accès. Sont incluses les métadonnées de communications électroniques telles que définies à l’article 4, paragraphe 3, point g), du [règlement concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques] » : ibid., art. 2, 9).
[55] Il s’agit de « toutes les données stockées dans un format numérique tel que du texte, de la voix, des vidéos, des images et du son autres que les données relatives aux abonnés, les données relatives à l’accès ou les données relatives aux transactions » : ibid., art. 2, 10).
[56] En effet, pour ces deux catégories de données, l’injonction ne peut être émise que par un juge, une juridiction ou un juge d’instruction, à l’exclusion de toute autre autorité compétente en matière pénale : ibid., art. 4 §2.
[57] Il s’agissait, en l’espèce, des numéros de téléphone et des noms, prénoms et adresses des titulaires de cartes SIM.
[58] CJUE, 2 octobre 2018, aff. C-207/16, Ministerio Fiscal, § 59-61 N° Lexbase : A2111X8P : S. Fucini, obs., D., 2018 ; A. Fitzjean Ó Cobhthaigh, obs., Comm. com. électr., 2018, 10, 79 . V. également en ce sens, CJUE, 6 octobre 2020, aff. C-511/18, C-512/18 et C-520/18, §157, La Quadrature du Net e. a. N° Lexbase : A78303WW – W. Azoulay, Collecte de données électroniques et droits fondamentaux : la CJUE en quête d’équilibre ?, Lexbase Pénal, novembre 2020 ; A. Léon, Données afférentes aux communications électroniques : la CJUE encadre la collecte de masse, Lexbase Pénal, octobre 2020 ; M. Lassalle, obs., D., 2021, 406 ; E. Daoud, I. Bello et O. Pecriaux, obs., Dalloz IP/IT, 2021, 46 ; W. Maxwell, étude, Légipresse, 2020, 671 ; N. Mallet-Poujol, étude, Légipresse, 2021, 240 ; B. Bertrand, obs., RTD Eur., 2021, 175 ; F. Benoît-Rohmer, obs., RTD Eur., 2021, 973.
[59] CJUE, 21 décembre 2016, aff. C‑203/15 et C‑698/15, § 101, Tele2 Sverige AB c/ Post-och telestyrelsen et Secretary of State for the Home Department c/ Tom Watson e. a. N° Lexbase : A7089SXT : F. Gazin, comm., Europe, 2017, 2, 48 ; D. Berlin, obs., JCP G, 2017, 3, 59 ; F.-X. Brechot, obs., AJDA, 2017, 73 ; F.-X. Brechot, obs., RUE, 2017, 178 ; D. Fores, obs., Dalloz IP/TP, 2017, 230.
[60] CJUE, 6 octobre 2020, aff. C-511/18, C-512/18 et C-520/18, § 117, La Quadrature du Net e. a. N° Lexbase : A78303WW ; CJUE, 6 octobre 2020, aff. C-623/17, § 71, Privacy International c/ Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e.a. N° Lexbase : A78323WY ; CJUE, 5 avril 2022, aff. C-140/20, § 45 G.D. c/ Commissioner of An Garda Síochána e. a. N° Lexbase : A10957TQ : C. Crichton, Précisions sur l’accès aux métadonnées à des fins de sécurité publique, Dalloz actualité, 5 avril 2022 ; J.-B. Perrier, obs., D., 2022, 1487.
[61] La Cour européenne des droits de l’Homme adopte une lecture similaire en permettant aux États parties de ne pas soumettre aux mêmes garanties les traitements de données de contenu et ceux de métadonnées, tout en soulignant la sensibilité des secondes : CEDH, 25 mai 2021, Req. 58170/13, 62322/14 et 24960/15, § 368, Big Brother Watch et autres c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A69824TR : M.-C. de Montecler, obs., D., 2021, 1082 ; N. Mallet-Poujol, obs., Légipresse, 2022, 253 ; J. Andriantsimbazovina, obs., Gaz. Pal., 2021, 25, 25 ; CEDH, 25 mai 2021, Req. 35252/08, § 256 et § 277-278, Centrum för Rättvisa c/ Suède N° Lexbase : A69814TQ : N. Mallet-Poujol, obs., Légipresse, 2022, 253. V. pour un commentaire des deux arrêts, J.-P. Marguénaud, La protection de la vie privée contre l’interception en masse des communications transfrontières, RTD civ., 2021, p. 843.
[62] CJUE, 5 avril 2022, aff. C-140/20, § 73, G.D. c/ Commissioner of An Garda Síochána e. a. N° Lexbase : A10957TQ ; CJUE, 6 octobre 2020, aff. C-511/18, C-512/18 et C-520/18, § 154, La Quadrature du Net e. a. N° Lexbase : A78303WW.
[63] À la faveur de l’arrêt rendu par le Conseil d’État dans l’affaire La Quadrature du Net : CE Contentieux, 21 avril 2021, n° 393099, 397844, 397852, 424717 et 424718, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A01664Q9 : N. Belkacem, comm., Comm. com. électr., 2021, 56 ; T. Douville et H. Gaudin, note, D., 2021, 1268 ; A. Iliopoulou-Peno, obs., JCP G, 2021, 659.
[64] De telles catégories se retrouvent désormais au sein des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation : Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 21-83.820, FS-B N° Lexbase : A84318AI, n° 21-84.096, FS-B N° Lexbase : A84328AK, n° 21-83.729, FS-D N° Lexbase : A56808BY. De même, le Conseil constitutionnel isole la catégorie des données de connexion, en raison de leur sensibilité : Cons. const., décision n° 2021-952 QPC, du 3 décembre 2021, M. Omar Y., § 11 N° Lexbase : A00977EC ; Cons. const., décision n° 2022-993 QPC, du 20 mai 2022, M. Lofti H., § 10 N° Lexbase : A58297X8 ; Cons. const., décision n° 2022-1000 QPC, du 17 juin 2022, M. Ibrahim K., § 11 N° Lexbase : A500877M ; Cons. const., décision n° 2021-976/977 QPC, du 25 février 2022, M. Habib A. et autres, § 11 N° Lexbase : A03477PK.
[65] V. pour une catégorisation proche, J. Bossan, Les réquisitions judiciaires relatives aux données de connexion : suite... et fin ?, Dr. pén., n° 7-8, 2022, 17. L’auteur distingue, en effet, les données administratives, qui correspondent à l’identité de l’utilisateur ainsi qu’aux informations relatives au paiement, des données techniques, plus sensibles. Certains auteurs ont proposé d’autres catégories : G. Haas, A. Dubary, Cybercriminalité : mais que fait la justice ?, Lamy Droit des affaires, n° 168, 2021 ; M. Bouchet, Conservation et accès aux données de connexion dans le cadre des enquêtes pénales : mode d’emploi, Gaz. Pal., n° 31, 2022.
[66] Les deux premières catégories recouvrent, en réalité, celle, plus large, des données de connexion. V. également en ce sens, M. Audibert, L’accès aux données de trafic et de localisation dans le cadre d’une enquête judiciaire, Lexbase Procédure pénale, août 2022 N° Lexbase : N2356BZB.
[67] J.-C. Saint-Pau, Les investigations numériques et le droit au respect de la vie privée, AJ pénal, 2017, p. 321 ; O. Décima, Du piratage informatique aux perquisitions et saisies numériques ?, AJ pénal, 2017, p. 315.
[68] M. Touillier, Lumière sur un arsenal de lutte contre une délinquance tapie dans l’ombre, op. cit.
[69] Toutefois, sauf s’ils agissent dans le cadre de l’enquête de flagrance, les enquêteurs doivent obtenir le consentement de la personne concernée : C. proc. pén., art. 57-1 N° Lexbase : L6526MGS.
[70] Il faut noter que l’article 230-1 in fine N° Lexbase : L6546MGK permet de recourir aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale afin d’obtenir les données en clair, mais, cette fois, seulement lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement.
[71] C. proc. pén., art. 230-47 N° Lexbase : L8105MAG.
[72] C. proc. pén., art. 230-32 N° Lexbase : L7402LPT. En revanche, lorsque le moyen technique permettant la géolocalisation doit être introduit dans un lieu privé qui n’est pas destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel ou qui n’est pas un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, la peine encourue doit être au moins égale à cinq ans : C. proc. pén., art. 230-34, al. 2 N° Lexbase : L7400LPR.
[73] C. proc. pén., art. 230-46 N° Lexbase : L6547MGL.
[74] Il s’agit de l’interception de paroles (C. proc. pén., art. 706-96 N° Lexbase : L7418LPG), de la captation de données informatiques (C. proc. pén., art. 706-102-1 N° Lexbase : L7414LPB), du recours aux IMSI-Catcher (C. proc. pén., art. 706-95-20 N° Lexbase : L7216LPX), de l’accès aux correspondances stockées (C. proc. pén., art. 706-95-1 N° Lexbase : L7225LPB) et des interceptions de communications (C. proc. pén., art. 706-95-1 N° Lexbase : L7225LPB).
[75] C. proc. pén., art. 60-1 N° Lexbase : L6528MGU, 60-2 N° Lexbase : L7998MBT, 77-1-1 N° Lexbase : L6551MGQ et 77-1-2 N° Lexbase : L8000MBW.
[76] C. proc. pén., art. 60-1-2 N° Lexbase : L7997MBS.
[77] Durant l’instruction, le recours à ce dispositif est autorisé pour quatre mois, renouvelables dans la limite de deux ans : C. proc. pén., art. 230-48 N° Lexbase : L8106MAH.
[78] C. proc. pén., art. 706-95 N° Lexbase : L1609MAT. Durant l’instruction, cette mesure est limitée à quatre mois, renouvelables dans la limite d’un an ou, si l’infraction relève de la criminalité organisée, de deux ans : C. proc. pén., art. 100-2 N° Lexbase : L4941K8I.
[79] Durant l’instruction, le recours à ce dispositif est autorisé pour quatre mois, renouvelables dans la limite de deux ans : C. proc. pén., art. 706-95-16 N° Lexbase : L7210LPQ.
[80] Ibidem.
[81] Durant l’instruction, elle est autorisée pour quatre mois renouvelables, sous réserve des mêmes durées maximales que dans le cadre de l’enquête : C. proc. pén., art. 230-33 N° Lexbase : L7401LPS.
[82] En effet, aucune condition de durée n’est imposée lorsque le dispositif a seulement pour objet de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé : C. proc. pén., art. 706-95-20 N° Lexbase : L7216LPX.
[83] C. proc. pén., art. 57-1 N° Lexbase : L6526MGS.
[84] C. proc. pén., art. 230-1 N° Lexbase : L6546MGK.
[85] C. proc. pén., art. 230-46 N° Lexbase : L6547MGL.
[86] C. proc. pén., art. 706-95-1 N° Lexbase : L7225LPB et 706-95-2 N° Lexbase : L7419LPH.
[87] C. proc. pén., art. 60-1 N° Lexbase : L6528MGU, 60-2 N° Lexbase : L7998MBT, 77-1-1 N° Lexbase : L6551MGQ et 77-1-2 N° Lexbase : L8000MBW.
[88] En ce cas, les données ne peuvent être conservées qu’un an : C. proc. pén., art. 60-2, al. 2 N° Lexbase : L7998MBT et 77-1-2, al. 2 N° Lexbase : L8000MBW.
[89] C. proc. pén., art. 230-1 N° Lexbase : L6546MGK.
[90] C. proc. pén., art. 230-48 N° Lexbase : L8106MAH.
[91] Mais cette autorisation n’est requise que lorsque les enquêteurs recueillent, à cette occasion, des données : C. proc. pén., art. 230-46 N° Lexbase : L6547MGL.
[92] C. proc. pén., art. 706-95 N° Lexbase : L1609MAT.
[93] C. proc. pén., art. 706-95-12 N° Lexbase : L7207LPM.
[94] Ibidem.
[95] C. proc. pén., art. 706-95-1 N° Lexbase : L7420LPI.
[96] C. proc. pén., art. 706-95-20 N° Lexbase : L7216LPX.
[97] En effet, le procureur de la République est compétent pour autoriser la mesure pour une durée maximale de quinze jours consécutifs lorsque l’enquête porte sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 706-73 N° Lexbase : L6560MG3 ou 706-73-1 N° Lexbase : L6561MG4 ou pour une durée de huit jours dans les autres cas : C. proc. pén., art. 230-33, 1° N° Lexbase : L7401LPS. De même, si le moyen technique permettant la géolocalisation doit être introduit dans un lieu privé qui n’est pas destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel ou qui n’est pas un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, seul le juge des libertés et de la détention peut autoriser la mesure : C. proc. pén., art. 230-34, al. 2, 1° N° Lexbase : L7400LPR.
[98] V. infra.
[99] C. proc. pén., art. 60-1-2 N° Lexbase : L7997MBS, 60-2 N° Lexbase : L7998MBT et 77-1-1 N° Lexbase : L6551MGQ.
[100] C. proc. pén., art. 57-1 N° Lexbase : L6526MGS et 76 N° Lexbase : L0490LTC.
[101] V. supra.
[102] V. supra.
[103] V. supra.
[104] CEDH, 5e sect., 8 février 2018, Req. 31446/12, Ben Faiza c/ France, spé. § 74 N° Lexbase : A1984XDT : N. Nalepa, CEDH : géolocalisation en temps réel avant la loi du 28 mars 2014 et violation de la vie privée, Dalloz actualité, 6 mars 2018 [en ligne].
[105] Le Professeur Décima affirme, à ce sujet, qu’« il existe (ou devrait exister) désormais deux grands types d’investigations numériques, que le Code de procédure pénale traite malheureusement ensemble ». Précisément, selon l’auteur, « d’une part, les autorités répressives peuvent détourner un flux de données » ; « d’autre part, les investigations peuvent consister à s’introduire dans un ordinateur pour en fouiller le contenu et extraire toute information utile ». Contrairement à la Cour européenne des droits de l’Homme, le Professeur Décima estime les premières plus intrusives : O. Décima, Du piratage informatique aux perquisitions et saisies numériques ?, op. cit. V. également en ce sens, P. Collet, La censure des réquisitions de données informatiques en enquête préliminaire !, JCP G, 2022, n° 4.
[106] CJUE, gde ch., 6 octobre 2020, aff. C-511/18, C-512/18 et C-520/18, § 187, La Quadrature du Net e. a. N° Lexbase : A78303WW.
[107] Il en va ainsi pour les sonorisations et captations d’images et les interceptions de communications : v. supra.
[108] Il en va ainsi pour la géolocalisation et pour le recours aux IMSI-Catcher : v. supra.
[109] Il en va ainsi de l’usage des drones ainsi que des opérations de cyberpatrouilles : v. supra.
[110] Il en va ainsi pour les réquisitions concernant les données de connexion émises par un avocat ainsi que pour l’accès aux correspondances stockées : v. supra.
[111] En effet, « Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espère, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction » : C. proc. pén., art. préliminaire, III, al. 6 N° Lexbase : L1305MAL.
[112] La Cour de justice de l’Union européenne a récemment rappelé l’exigence tenant à l’information de la personne concernée dans le cadre des réquisitions de données de connexion en affirmant que le droit de l’Union s’opposait « à une législation nationale prévoyant l’accès, par les autorités nationales compétentes en matière d’enquêtes pénales, à des données relatives au trafic et à des données de localisation, conservées de manière licite, sans garantir que les personnes dont les données ont fait l’objet d’un accès par ces autorités nationales en soient informées dans la mesure prévue par le droit de l’Union et sans qu’elles disposent d’une voie de recours à l’encontre d’un accès illégal à ces données » : CJUE, 6ème ch., 17 novembre 2022, Spetsializirana prokuratura, aff. C-350/21, § 76 N° Lexbase : A61828T7.
[113] V. supra.
[114] V. supra.
[115] V. également en ce sens, O. Cahn, Données de connexion et enquête pénale : la chèvre et le chou malmenés, JCP G, 2022, n°40.
[116] V. également en ce sens, J.-C. Saint-Pau, Les investigations numériques et le droit au respect de la vie privée, op. cit.
[117] L’exigence de motivation est essentielle en la matière, la Chambre criminelle y veille : v. not. à ce sujet, P. Collet, Le renforcement progressif des garanties applicables à deux mesures intrusives : la géolocalisation et la sonorisation, Rev. sc. crim., 2021, p. 29. Malgré une telle vigilance, il faut noter que la Cour de cassation autorise le juge des libertés et de la détention, dans le cas où il intervient à la suite d’une requête présentée par le ministère public, à reprendre, dans son ordonnance, les motifs avancés par ce dernier justifiant, en fait et en droit, la nécessité d’ordonner ou de poursuivre les mesures de sonorisation ou de géolocalisation : Cass. crim., 17 janvier 2023, n° 22-84.067, F-D N° Lexbase : A331589N. De même, le procureur de la République qui autorise la poursuite d’une mesure de géolocalisation initiée dans l’urgence peut se contenter de viser, dans son autorisation, le procès-verbal de l’officier de police judiciaire établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves : Cass. crim., 24 janvier 2023, n° 22-83.606, F-D N° Lexbase : A42729AH.
[118] CJUE, gde ch., 5 avril 2022, aff. C-140/20, G.D. c/ Commissioner of An Garda Síochána e. a., § 106 N° Lexbase : A10957TQ.
[119] Ibid., § 109 N° Lexbase : A10957TQ.
[120] La proposition de règlement e-evidence va également en ce sens en imposant, lorsqu’il s’agit d’émettre une injonction de conservation de données de trafic et de localisation ou de contenu, l’intervention d’un juge, d’une juridiction ou d’un juge d’instruction, à l’exclusion de toute autre autorité en matière pénale : Proposition de règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, op. cit., art. 4, § 2.
[121] Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 21-83.710, FS-B N° Lexbase : A84348AM, n° 21-83.820, FS-B N° Lexbase : A84318AI, n° 21-84.096, FS-B N° Lexbase : A84328AK, n° 21-83.729, FS-D N° Lexbase : A56808BY.
[122] Le Conseil constitutionnel estime en effet que l’autorisation donnée par le procureur de la République en enquête préliminaire constitue une garantie suffisante, y compris lorsque sont en cause des données de connexion : Cons. const., décision n° 2021-952 QPC, du 3 décembre 2021, M. Omar Y., § 13 N° Lexbase : A00977EC.
[123] V. pour une extension de cette exigence à la géolocalisation : A. Gogorza, L’accès aux données de connexion : les affres du pluralisme normatif, Dr. Pénal, 2022, n° 10, étude 20.
[124] V. à ce sujet, A. Archambault, Accès aux données de connexion : quelles pistes pour une mise en conformité ?, AJ Pénal, 2022, p. 400.
[125] V. à ce sujet, M. Léna, Le nouveau Code de procédure pénale (brouillon), AJ pénal, 2023, p. 1 ; L. Garnerie, Éric Dupond-Moretti présente un plan d'action pour restaurer la place de la justice, Gaz. Pal., 2023, n° 1, p. 3.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484347
[Pratique professionnelle] Maîtriser les bases du bulletin de paie
Lecture: 17 min
N4553BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Hagenbourger, Directeur administratif et financier
Directeur des ressources humaines, Part-time
Le 08 Mars 2023
Mots-clés : bulletin de paie • cotisations de Sécurité sociale • impôt sur le revenu • salaire brut • prélèvement à la source • net à payer • CSG / CRDS
Plus de 20 millions de salariés du secteur privé reçoivent chaque mois leur bulletin de salaire. Un document parfois complexe à décrypter malgré les simplifications dont il a fait l’objet au cours de ces dernières décennies [1].
Pourtant, une lecture avertie nous permet de comprendre à quel point il est le reflet du financement de notre système de protection sociale et la transcription de la politique de rémunération de chaque entreprise.
Quelques éclairages s’imposent donc pour mieux appréhender les règles régissant son calcul.
I. Mentions relatives à l’identification de l’employeur et du salarié
Avant de s’intéresser aux règles régissant le calcul du bulletin à proprement parler, il est utile de rappeler la nécessité d’indiquer certaines informations touchant à l’identification de l’employeur et du salarié.
Tout bulletin de paie devra donc contenir les mentions suivantes :
- le nom et l’adresse de l’employeur (l’établissement dont dépend le salarié pourra éventuellement être indiqué) ;
- le numéro de la nomenclature d’activité de l’établissement employant le salarié : il s’agit ici du code de l’activité principale exercée (APE) ou du code de nomenclature des activités (économiques) françaises (NAF) ;
- le numéro d’inscription de l’entreprise au répertoire national des entreprises et des établissements (numéro SIRET) ;
- la convention collective de branche applicable aux salariés de l’établissement ou la référence à l’article du Code du travail concernant la durée des congés payés et des délais de préavis en cas de rupture de la relation de travail (si l’entreprise n’est couverte par aucune convention collective de branche) ;
- le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle (il peut également s’agir du niveau ou du coefficient hiérarchique)
Analysons à présent le contenu détaillé du bulletin en commençant par le calcul de la rémunération brute indiquée en « haut de bulletin ».
II. Le calcul du « haut de bulletin » : la rémunération brute
Dans cette partie nous allons détailler la manière dont se calcule la ligne « salaire brut » dénommée aussi parfois « rémunération brute ».
Le « salaire brut » est la somme d’un certain nombre d’éléments issus du contrat de travail, des accords d’entreprise ou des conventions collectives. Nous pouvons en faire une liste non exhaustive :
- le salaire de base : il s’agit du montant indiqué dans le contrat de travail du salarié ou dans le dernier avenant relatif à sa rémunération contractuelle :
- la rémunération liée à l’accomplissement d’heures supplémentaires : il s’agit du montant rémunérant les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail (majorations incluses) – qu’elles soient contractuelles ou ponctuelles ;
- les primes et variables éventuelles. Dans la majorité des cas, il s’agira de primes d’objectif, de commissions, d’éventuelles primes exceptionnelles, de treizième mois et/ou d’ancienneté ;
- les absences du mois et les éventuelles indemnités versées en compensation de ces absences (congés payés, absence maladie, congés pour évènements familiaux…) ;
- l’évaluation du montant de l’avantage en nature dont le salarié bénéficie : il s’agit ici de l’indication de la valeur forfaitaire de l’avantage afin que ce dernier puisse être assujetti à cotisations sociales et à impôt (des règles spécifiques à chaque type d'avantage en nature viennent préciser le calcul de « conversion » de l’avantage en nature en euros. Précisons que comme le salarié ne touchera pas d’argent au titre de l’avantage en nature, la somme indiquée en haut de bulletin sera ensuite déduite en bas de bulletin).
L’ensemble de ces éléments vont être additionnés (ou soustraits s’il s’agit de la perte de rémunération liée à une absence) pour constituer le « salaire brut » ou la « rémunération brute ».
Le montant est d’ailleurs souvent indiqué en gras sur la fiche de paie.
En voici une illustration :
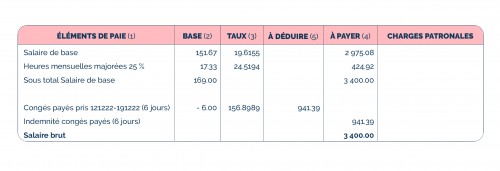
1. Nous retrouvons dans la colonne « Éléments de paie » les différents sujets évoqués, à savoir dans cet exemple :
- le salaire de base ;
- des heures supplémentaires majorées à 25 % ;
- une absence pour congés payés ;
- une indemnité de congés payés compensant la perte de rémunération liée à l’absence.
Regardons ensuite comment se calculent les autres colonnes du « haut de bulletin ».
2. Nous retrouvons dans une seconde colonne la « Base ». Cette dernière peut indiquer différents types d'unités. Il peut s’agir:
- des heures réalisées dans le mois (qu’elles soient contractuelles ou non) ;
- des jours d'absence (pour congés payés ou tout autre motif) ;
- d’un montant sur lequel sera calculée une éventuelle prime d’ancienneté (cas où la prime d’ancienneté est égale à un pourcentage d’un salaire ou d’un minima conventionnel).
Dans l’exemple indiqué ci-dessus, il s’agit des heures rémunérées (pour les trois premières lignes) ou des jours d’absences (pour la quatrième ligne).
| ⚠️ Si la durée contractuelle de travail est de 35 heures par semaine, la base mensuelle sera alors de 151,67 heures sur la ligne « salaire de base ». Cela correspond à la moyenne des heures mensuellement travaillées (35 heures par semaine fois 52 semaines par an divisé par 12 mois). Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours devraient voir indiquer en « base » la mention « forfait » et le nombre de jours annuels prévu dans ce dernier. |
3. Une troisième colonne indique ensuite le « Taux » : il peut s’agir d’un taux journalier (si la base indique des jours) ou d’un taux horaire (si la base est indiquée en heures).
Pour le salaire de base, le taux horaire se calcule en divisant la durée mensuelle contractuelle par le montant du salaire brut.
Le taux des heures supplémentaires se calcule en intégrant au taux horaire contractuel la majoration applicable.
Enfin, les colonnes « à déduire » ou « à payer » ne sont que les totaux du calcul « base » x « taux » :
4. Si le résultat est lié à l’ajout d’un élément de rémunération, on l’indiquera dans la colonne « à payer ».
5. Si le résultat est lié à la déduction d’une absence, on l’indiquera dans la colonne « à déduire ».
À la fin de ces calculs, on obtient le salaire brut. C’est sur ce montant que les cotisations sociales et diverses contributions vont être calculées.
III. Le calcul des cotisations sociales
Le salaire brut n’est évidemment pas le montant que le salarié va percevoir. En effet, des cotisations et contributions vont être déduites du montant du salaire brut, permettant ainsi d’obtenir le salaire net avant impôt. On parlera dans ce cas de cotisations salariales.
Parallèlement, des cotisations et des taxes, calculées toujours sur la base du salaire brut, vont venir augmenter le coût pour l’entreprise : on parlera de charges patronales qui figureront dans la colonne tout à droite du bulletin.
Notons dès à présent que le bulletin de paie simplifié remis au salarié ne mentionne que le montant des charges patronales sans détailler le calcul de ces dernières. En effet, le taux et la base de ces charges patronales n’apparaissent pas sur ce document, contrairement aux cotisations salariales (les logiciels de paie permettent cependant d’obtenir ce détail – comme indiqué dans l’exemple de la partie 5).
Abordons successivement les cotisations salariales et les charges patronales.
Pour avoir une « vue claire » de l’ensemble des cotisations et de leur utilisation, le législateur a souhaité regrouper les cotisations par grands thèmes. Voici la liste que nous retrouvons sur chaque bulletin :
- santé ;
- accidents du travail & maladie professionnelle ;
- retraite ;
- famille ;
- assurance chômage ;
- les cotisations statutaires ou prévues par la convention collective ;
- les autres contributions dues par l’employeur ;
- la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Pour chaque thème, plusieurs lignes pourront venir préciser l’affectation exacte de chaque cotisation ou contribution (précisons toutefois que la ligne « autres contributions dues par l’employeur » regroupe différentes taxes et cotisations par esprit de simplification).
Qu’il s’agisse de cotisations salariales ou patronales, la logique de calcul est similaire :
- étape 1 : on commence tout d’abord par la colonne « Base ». Il s’agit du montant sur lequel va s’appliquer le taux de cotisation.
| ⚠️ Cette base est souvent égale au « salaire brut ». Dans quelques cas, on ne prendra qu’une partie du salaire et non la totalité. C’est le cas notamment pour la cotisation vieillesse plafonnée. On ne retiendra que le montant du salaire pour sa part inférieure au montant du plafond de Sécurité sociale (soit 3 666 euros / mois en 2023). |
- étape 2 : on multiplie ensuite la « Base » par le « Taux » indiqué dans une seconde colonne. Il s’agit ici généralement d’un pourcentage qui est propre à chaque type de cotisation.
| ⚠️ Le taux de chaque cotisation de Sécurité sociale est défini par le Parlement de manière à ce que les cotisations permettent de couvrir les dépenses prévisionnelles des assurés. Les modifications sont généralement faites une fois par an lors du vote de la loi de financement de la Sécurité sociale. Les représentants patronaux et syndicaux fixent également certains taux (cotisations chômage et de retraite complémentaire) Les taux des régimes de mutuelle et de prévoyance sont liés aux contrats souscrits par l’entreprise (et varient donc en fonction de nombreux paramètres : niveau de garanties, liste des ayants droit couverts…) |
- étape 3 : le résultat du calcul (« base » x « taux ») est soustrait du montant du salaire brut s’il s’agit d’une charge salariale (pour obtenir le salaire net avant impôt) ou est additionné au montant du brut s’il s’agit d’une charge patronale (pour obtenir le coût total employeur).
Après avoir détaillé la méthode de calcul de chaque ligne, regardons plus en détail les cotisations salariales et la manière dont on passe du salaire brut au salaire net avant impôt.
IV. La différence salaire brut / salaire net
Pour ce faire, reprenons l’exemple de notre introduction et affichons la « seconde partie » du bulletin de paie :
Analysons le détail de chaque thème.

1. Thème « Santé »
Dans ce premier thème, le bulletin évoque une cotisation « Complémentaire – Incap. Inval. Décès » et une « Complémentaire – Santé ». Il s’agit ici de cotisations prévoyance pour la 1ère ligne et de frais de santé (ou mutuelle) pour la seconde. Le montant de ces cotisations dépend des règles applicables à chaque convention collective (généralement pour la prévoyance), voire à chaque entreprise (plutôt pour les frais de santé). Les taux varient notamment en fonction des niveaux de garanties prévues au contrat et de l’équilibre général de chaque régime.
Notons que certaines entreprises ont fait le choix de prendre à leur charge l’ensemble de ces cotisations. Il n’y aura alors pas de part salariale à déduire. Ces cotisations couvrent les risques de la vie et le remboursement des frais médicaux en prévoyant généralement :
- le maintien (au moins partiel) du salaire en cas de longue maladie, le versement d'un capital ou d'une rente en cas de décès ou d'invalidité : il s’agit des garanties de prévoyance ;
- le remboursement des dépenses et des soins médicaux (médecins, dentiste, médicaments, lunettes, etc...) pour la part non prise en charge par la Sécurité sociale pour la partie frais de santé.
2. Thème « Retraite »
Le bulletin de paie comporte 3 lignes distinctes (mais pourrait en comporter 2 supplémentaires).
La première ligne concerne la cotisation retraite au régime général de Sécurité sociale. Elle est dite plafonnée, car la base sera constituée de la part du salaire n’excédant pas une fois le montant du plafond de Sécurité sociale (3 666 euros par mois en 2023). Le taux appliqué à cette base est de 6,9 %.
La seconde ligne concerne également le financement du régime général sur un taux bien moindre (0,4 %) qui s’appliquera en revanche à l’intégralité du salaire brut (même si ce dernier est supérieur au plafond de Sécurité sociale). On parle de cotisation retraite Sécurité sociale déplafonnée.
La troisième ligne concerne la cotisation au régime de retraite complémentaire obligatoire (régime AGIRC/ARRCO). On parle de cotisation tranche 1 dans la mesure où la base de cette cotisation sera plafonnée au montant du plafond de Sécurité sociale. Le taux applicable sur cette tranche est actuellement de 4,01 %.
Une quatrième et une cinquième lignes apparaissent lorsque le salaire perçu est supérieur au plafond de Sécurité sociale. Il s’agira de la cotisation au régime retraite complémentaire tranche 2 (avec un taux de 9,72 % appliqué sur la partie du salaire supérieure au plafond de Sécurité sociale et qui ne dépasse pas la limite de 8 fois ce même plafond, soit 29 328 euros par mois en 2023). La cinquième ligne sera intitulée « Contribution d'Équilibre Technique » (et financera le régime de retraite complémentaire) : elle n'apparaîtra que pour les salaires supérieurs à une fois le plafond de Sécurité sociale mais sera assise sur l’intégralité du salaire brut, avec un taux de part salariale de 0,14 %.
3. Thème « Assurance chômage »
Une cotisation salariale d’un taux de 0,024 % est due sur l’intégralité des salaires des cadres pour le financement de l’Agence pour l’emploi des cadres (APEC). Cette cotisation ne s’applique cependant pas à la part du salaire supérieure à 4 fois le montant de la Sécurité sociale.
4. Thème « CSG / CRDS »
La contribution sociale généralisée est une contribution exclusivement salariale affectée au financement du système de protection sociale. Elle finance principalement la branche maladie, l’assurance chômage, la branche allocations familiales et l’aide à l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Elle se décompose en deux lignes :
- une ligne CSG déductible (de l’impôt sur le revenu) ;
- une ligne CSG non-déductible couplée avec la CRDS.
Le taux de la CSG déductible est de 6,8 % tandis que celui de la CSG non déductible + CRDS est de 2,9 %, soit un total de 9,7 %.
Le calcul de la base de chacune de ces lignes est identique. Il convient d’additionner 98,25 % du salaire brut (pour la part inférieure à 4 fois le plafond de Sécurité sociale ; au-delà, on retiendra 100% du salaire brut) avec la part patronale au régime frais de santé et la part patronale au régime de prévoyance.
En déduisant du salaire brut l’intégralité des cotisations salariales évoquées ci-dessus, on obtient le salaire net.
Notons une particularité dans notre exemple : les heures supplémentaires ne sont pas assujetties exactement aux mêmes règles de cotisation puisqu’elles bénéficient d’une exonération de cotisations retraite (dans la limite de 11,31 % ) : c’est ce qui explique la ligne « Exonération sociale sur HS/HC » (heures supplémentaires / heures complémentaires).
| Si l’on résume, le salaire brut va diminuer d’environ 21 % du fait des cotisations retraite et de CSG/CRDS, voire d’un peu plus, en fonction du montant des cotisations mutuelle et prévoyance. Ainsi, il n’existe pas un « taux fixe » de charges salariales. |
Il sera donc préférable de parler de fourchette allant de 21 % à 25 % qui sera juste dans l’immense majorité des cas puisque le taux exact varie pour chaque bulletin en fonction du niveau de salaire et des garanties complémentaires proposées par les entreprises.
Dernière précision : ce salaire net avant impôt pourra être augmenté par le versement de sommes non assujetties à charges sociales. Il pourra s’agir, par exemple, du remboursement de la moitié du montant du titre de transport en commun, du forfait « Mobilités Durables » ou du remboursement de frais professionnels.
V. Le coût total entreprise
Si les cotisations salariales viennent baisser le montant du salaire net, les cotisations patronales font grimper l’addition pour l’entreprise.
Sans entrer ici dans l’exhaustivité des charges patronales qui pourront faire l’objet d’une fiche dédiée, il est important de retenir deux éléments :
- Lors de sa création, l’entreprise va bénéficier d’un certain nombre d’exonérations liées à sa taille.
Si elle se développe et qu’elle passe certains seuils d’effectifs (11 salariés, 50 salariés, 250 salariés…) elle verra ses exonérations progressivement disparaître. Cela peut alourdir son taux de charges de près de 5 %, une fois l’ensemble des seuils franchis. Ces exonérations s’appliqueront notamment sur le versement mobilité, la contribution à la formation professionnelle continue, à la cotisation FNAL, à la participation des employeurs à l’effort de construction (ces contributions étant regroupées, pour la majorité, dans le thème « Les autres contributions dues par l’employeur », sans qu’elles soient détaillées sur le bulletin de paie).
- Quelle que soit la taille de l’entreprise, le montant de salaire perçu par chaque salarié va également avoir un impact important sur le taux de charges patronales de l’entreprise.
En effet, plus le salaire va être proche du SMIC, plus les exonérations vont être importantes et le taux de charges réduit (par le biais d’exonérations générales de cotisations de Sécurité sociale, d’exonérations partielles d’assurance maladie et d’allocation familiale).
Ce graphique donne un aperçu du taux de charges patronales par rapport au niveau de salaire (en prenant comme paramètre une entreprise de plus de 250 salariés).
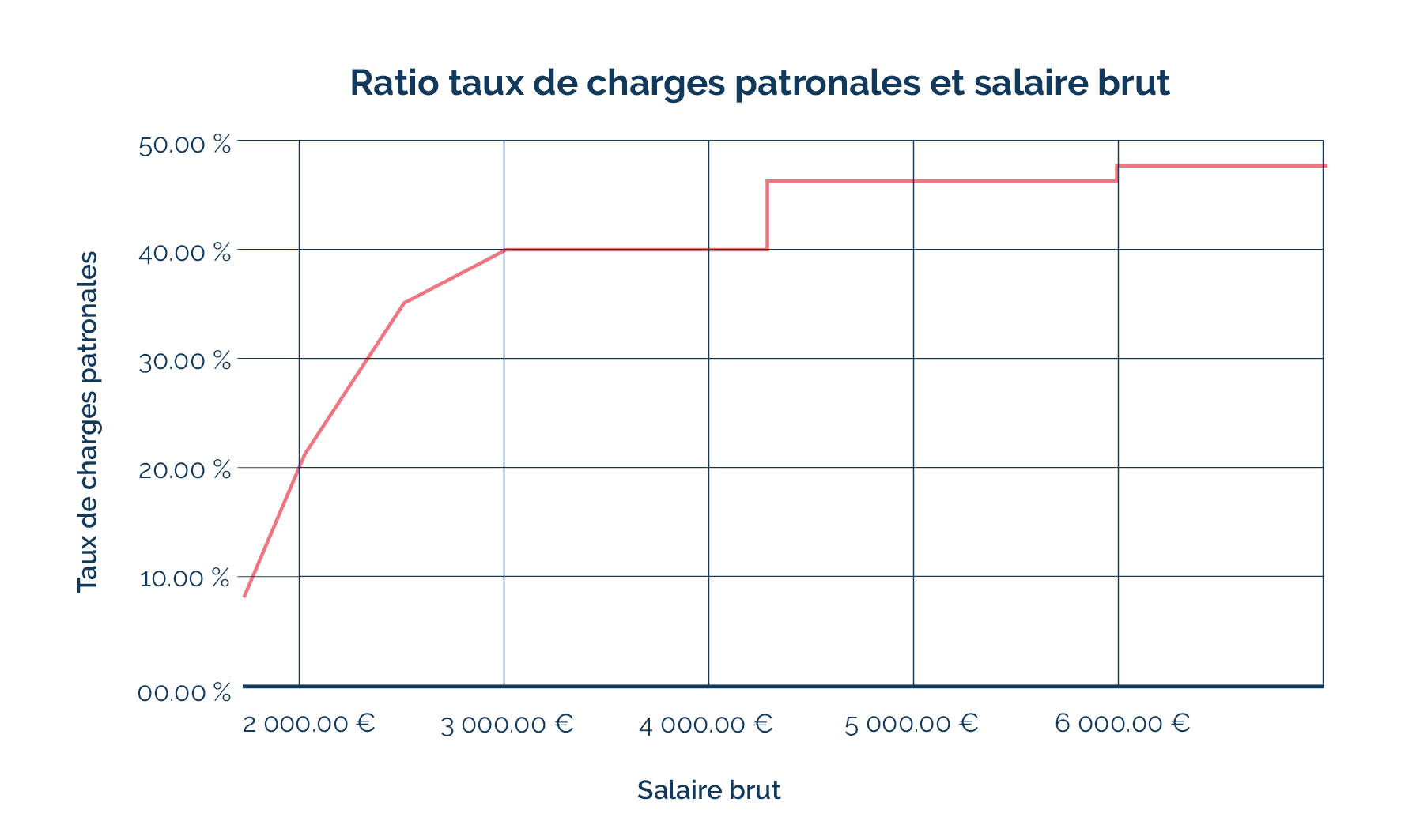
Après le calcul des cotisations sociales, intéressons-nous au « bas du bulletin » et au calcul du net à payer après impôt, plus précisément.
VI. Le calcul du salaire net après impôt
Une erreur classique consiste à penser que l’impôt va être calculé directement sur le salaire net avant impôt. Or, ce n’est pas la solution retenue en droit fiscal : il faut au préalable calculer le salaire net imposable qui sera la base de calcul de l’impôt prélevé à la source.
Voici les étapes à suivre :
- étape 1 : le salaire net avant impôt est le résultat de « salaire brut – charges salariales » ;
- étape 2 : après avoir calculé ce salaire net avant impôt, il faut déduire l’impôt prélevé à la source. Pour le calculer, il faut déterminer le « salaire net imposable » en faisant la somme des éléments suivant : « le salaire net avant impôt + la part non-déductible de CSG et la CRDS (telle qu’indiquée sur le bulletin) + la cotisation patronale au régime frais de santé d’entreprise » ;
- étape 3 : on multiplie ensuite le salaire net imposable par le taux d’impôt à la source applicable (ce dernier des informations transmises par l’administration fiscale – ou de l’application d’un barème en cas d’absence d’informations) afin d’obtenir le montant de l’impôt à prélever ;
- étape 4 : enfin, on déduit le montant de l’impôt du salaire net avant impôt pour obtenir le salaire net à payer après impôt. C’est ce montant qui est versé sur le compte bancaire du salarié.
Par exemple : un salaire net avant impôt de 2 716 euros et un salaire brut de 3 500 euros, un montant de CSG / CRDS non déductible de 101 euros et une part patronale mutuelle de 50 euros :
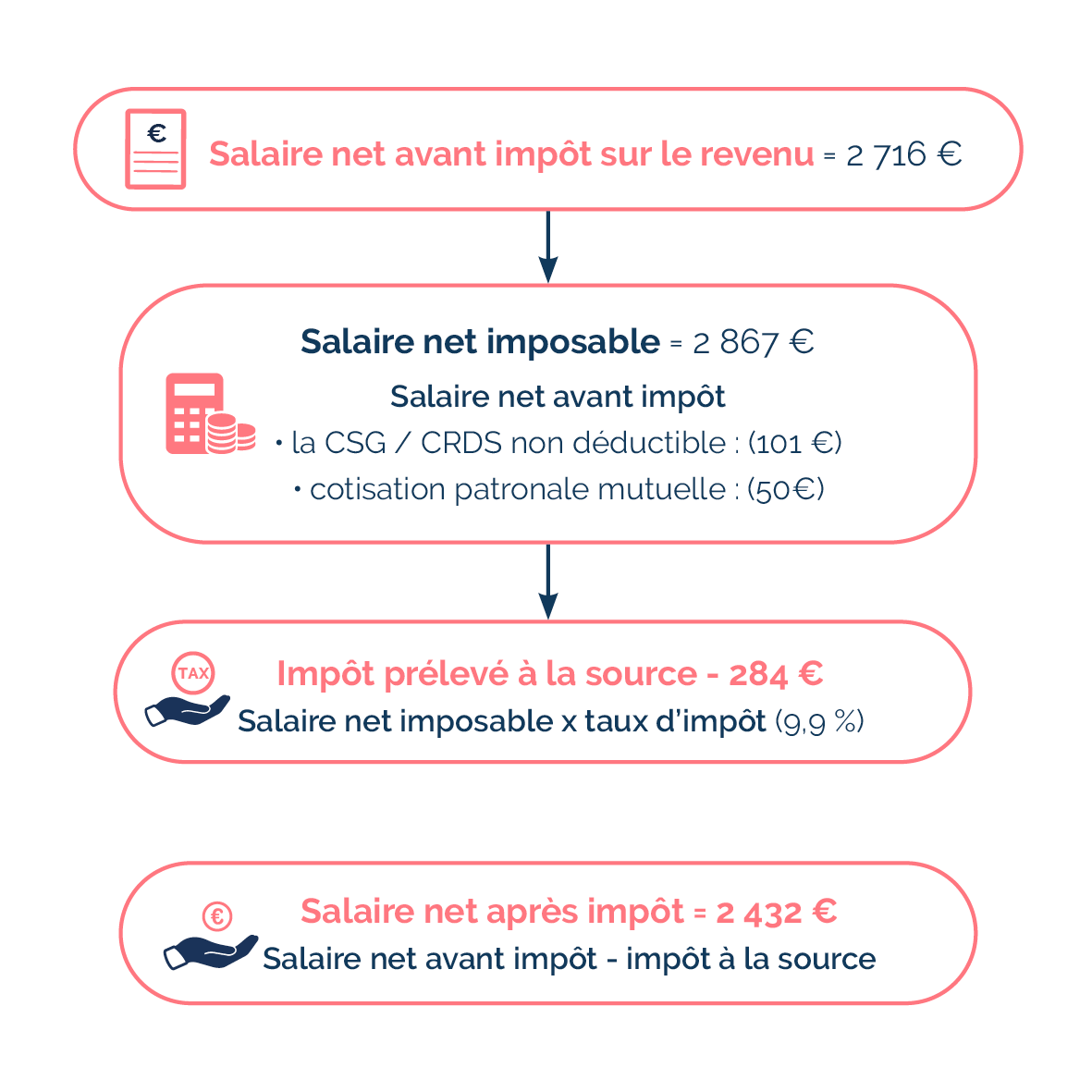
Même si cet exposé n’a pas un caractère exhaustif, il devrait vous permettre désormais d’appréhender plus facilement la lecture et la compréhension du bulletin de paie, tel qu’il est remis chaque mois à l’ensemble des salariés français.
[1] Circulaire du 30 juin 2005 relative à la simplification du bulletin de paie N° Lexbase : L9377HBW ; arrêté du 25 février 2016 N° Lexbase : L9088K3Y puis arrêté du 9 mai 2018 N° Lexbase : L2424LKY, arrêté du 23 décembre 2021 N° Lexbase : L1978MAI et arrêté du 31 janvier 2023 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations du bulletin de paie mentionnées à l’article R. 3243-2 du Code du travail N° Lexbase : L7483MGA.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484553
[Brèves] Inaptitude : caractère forfaitaire du salaire maintenu au salarié
Réf. : Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-19.956, F-B N° Lexbase : A17929GH
Lecture: 3 min
N4558BZT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 08 Mars 2023
► Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.
Faits et procédure. En l’espèce, un salarié, déclaré inapte, est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il saisit la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et demande notamment le versement d’un rappel de salaire correspondant au montant des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) déduites des salaires qui lui ont été versés après l’expiration du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude.
La cour d’appel (CA Rouen, 12 novembre 2020, n° 18/00705 N° Lexbase : A287534A) juge qu'il convenait de déduire les IJSS des sommes dues au salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du travail N° Lexbase : L5819ISC.
Pour limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 3 159,44 euros nets, outre 315,94 euros de congés payés afférents, les juges du fond ont retenu que si la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relève des seuls rapports entre ces derniers, les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ne peuvent suivre le même régime dès lors que les sommes dues par l'employeur ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts.
Ils ajoutent qu'il résulte des articles R. 323-11 N° Lexbase : L1640L4I et R. 433-12 N° Lexbase : L0066I49 du Code de la Sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie ou d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative, seul l'employeur étant subrogé de plein droit à l'assuré.
La cour d’appel en conclut qu'il convient de déduire les indemnités journalières des sommes dues au salarié, sauf à permettre définitivement au salarié de percevoir une rémunération plus importante que celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure la position des juges du fond et retient qu’il n’est pas possible pour l’employeur de déduire du salaire à maintenir les sommes dues au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale.
|
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484558
[Jurisprudence] Droit spécial du pacte d’associés : sa durée peut être alignée sur celle de la société
Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2023, n° 19-25.478, FS-B N° Lexbase : A06569AK
Lecture: 20 min
N4546BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Bruno Dondero, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, CMS Francis Lefebvre
Le 09 Mars 2023
Mots-clés : pacte d'associés • durée de vie de la société • prohibition des engagements perpétuels • résolution unilatérale
Il résulte de la combinaison de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1838 du même code que la prohibition des engagements perpétuels n'interdit pas de conclure un pacte d'associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement.
L’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la première chambre civile de la Cour de cassation, dont on va voir l’apport très appréciable pour la pratique, comporte un petit piège pour le lecteur, car il est en réalité rendu en partie par… la Chambre commerciale, et pour la partie indiscutablement la plus marquante qui plus est. Ce n’est pas simplement d’une solution qui serait rendue par une chambre civile après avis de la formation commerciale que l’on parle, mais bien d’un arrêt faisant intervenir successivement les deux formations, chacune rédigeant une partie de la décision.
Les pactes d’associés sont de longue date devenus un instrument courant de la vie des affaires. Les praticiens complètent les statuts des sociétés – aussi bien ceux des sociétés de capitaux que des sociétés de personnes – par des accords contractuels qui précisent ou infléchissent le jeu des règles légales ou des clauses statutaires et ce, avec des objectifs variés : prendre le pouvoir, le conserver ou le partager, s’assurer de la composition de l’actionnariat, garantir une liquidité des investissements faits, etc. Ces pactes sont très fréquents dans les joint-ventures et ils le sont également dans les sociétés familiales, hypothèse qui correspondait à l’espèce.
Un pacte avait été conclu le 30 janvier 2010 entre un père, M. [I] [F], et ses cinq enfants, ainsi qu’avec une société HC. Ces six personnes physiques et cette personne morale étaient les associés d’une SAS Socri promotions. Le pacte prévoyait « ce qui devra être mis en œuvre lorsque M. [I] [F] ne sera plus associé du groupe Socri afin que le groupe reste au sein de la famille, ainsi que des dispositions devant immédiatement régir la vie de la société et les actes des associés ». On apprend un peu plus loin que ce pacte comportait quinze articles, traitant « notamment de la stratégie d'entreprise, de la responsabilité des descendants, de la rémunération des mandats sociaux, de la prise de décisions collectives, de l'embauche de certains collaborateurs, du fonctionnement des holdings familiales, de la cession des actions entre descendants, des droits sociaux dérivés, de la politique de distribution des dividendes, des engagements de non-concurrence, des droits de préférence, de l'arbitrage et de la médiation en cas de mésentente entre descendants ».
Cet agencement était destiné à assurer la stabilité de l’entreprise familiale, mais contre toute attente, ce n’était pas un enfant rebelle qui entendait jeter à bas l’ordre établi, mais le père et la société associée qui notifiaient à l’un des cinq enfants signataires du pacte, par lettre du 23 février 2017, la résolution unilatérale du pacte. Cette résolution appelle deux observations. (1) Il aurait été plus pertinent de parler de résiliation, dès lors qu’il n’était vraisemblablement pas question de provoquer des restitutions ; (2) on ne sait pourquoi un seul des enfants était destinataire de cette notification, mais il est possible qu’un système de représentation avait été mis en place. Le destinataire de la lettre contestait en justice la résiliation, dont il estimait qu’elle avait été mise en œuvre de manière abusive et qu'elle était irrégulière et inefficace. L’une de ses sœurs, de son côté, procédait également à la résiliation unilatérale du pacte.
La cour d’appel [1] saisie du litige était appelée à trancher deux questions, l’une relative à l’étendue d’une nullité, l’autre à la durée du pacte.
On ne fera que mentionner la première question, qui naissait de la prétention, émise par les parties du pacte qui souhaitaient sa résiliation, de voir le juge prononcer la nullité de cet accord en son entier, motif tiré d’une violation de l’article 722 du Code civil N° Lexbase : L3330ABX, texte encadrant la validité des pactes sur succession future. Tout en relevant qu’une clause du pacte, relative aux modalités de remboursement du compte courant du père lors de l'ouverture de sa succession, énonçait une disposition relative à un bien futur de la succession de l’associé concerné, elle avait refusé d’en déduire la nullité du pacte tout entier, dans la mesure où cet accord ne portait pas, en ses autres stipulations, sur les biens meubles ou immeubles de la succession, mais visait à définir la stratégie de gestion qu’il conviendrait d’adopter par les enfants lorsque leur père se serait retiré des affaires ou serait décédé, afin de pérenniser le groupe familial et de préserver leurs intérêts.
La Cour de cassation énonce une règle qui est une reformulation de l’actuel article 1184, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L0894KZ7, lorsqu’elle juge que « lorsque la nullité en résultant » (ce qui doit faire référence à la violation de l’article 722 du Code civil) « n'affecte qu'une ou plusieurs clauses de l'acte, elle n'emporte sa nullité en son entier que si cette ou ces clauses en constituent une condition essentielle et déterminante ». Parce que la cour d’appel a vu que les quatorze autres articles du pacte traitaient de toute une série de questions relatives au fonctionnement de l’entreprise et aux relations entre les associés descendants et qu’elle a estimé que, « dans ce contexte », la clause litigieuse « n'avait été conçu[e] que comme une des mesures de gestion de la société au décès de M. [I] [F] », elle a fait ressortir que cette clause « n'était pas un élément essentiel du pacte d'actionnaires, déterminant de l'engagement des parties » et elle « n'a pu qu'en déduire que la demande de nullité du pacte en son entier devait être rejetée ».
L’arrêt est d’un apport bien plus considérable sur la seconde question, qui est celle de la durée du pacte [2]. Pour mettre immédiatement fin au suspense, indiquons que la Cour juge qu’il résulte de la combinaison de l'article 1134, alinéa 1er du Code civil (selon lequel les conventions sont la loi des parties N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, et de l'article 1838 de ce même code (N° Lexbase : L2009ABZ sur la durée de vie des sociétés, plafonnée à 99 ans) que « la prohibition des engagements perpétuels n'interdit pas de conclure un pacte d'associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».
Revenons sur la difficulté à articuler les statuts et le pacte, s’agissant de leurs durées respectives (I), avant d’évoquer l’harmonie que la décision commentée permet de retrouver entre ces normes (II).
I. La difficulté à articuler les statuts et le pacte
A. Des textes de portée générale
Il est difficilement contestable que le pacte conclu entre les associés ou les actionnaires d’une société a pour cause la participation de ces derniers à la société, peu important que la notion de cause ait disparu du Code civil aujourd’hui. En clair, ce n’est que parce qu’ils ont la qualité d’associé ou sont intéressés à un titre ou à un autre au fonctionnement de la société que les signataires du pacte concluent cet accord. Or, la société est régie par ses statuts, qui doivent prévoir un terme, c’est-à-dire une durée de vie de la société. Il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire sur cette « vie » des personnes morales, mentionnée occasionnellement par la Cour de cassation [3].
Observation troublante : cette vie de la personne morale peut durer… par-delà la mort, pardon, par-delà la dissolution qui accompagne l’expiration du terme statutaire, puisque l’on sait que la personnalité morale se maintient pendant la période de liquidation pour les besoins de celle-ci (C. civ., art. 1844-8, al. 3 N° Lexbase : L2028ABQ). Parce que la société a une durée statutaire qui peut approcher le siècle (il semble que le maximum autorisé soit 99 ans, soit généralement retenu), se pose la question de la durée du pacte.
La difficulté vient du fait que le pacte n’est qu’un contrat. C’est certes parce qu’il a cette nature et qu’il bénéficie de la souplesse et de la liberté du contrat qu’on a recours au pacte, qui permet d’ajouter un niveau normatif au fonctionnement rigide et exposé à tous les regards de l’organisation légale et statutaire des sociétés. Mais en tant que contrat de droit commun, le pacte se heurte précisément aux limites qui pèsent sur tous les contrats : si leur durée est déterminée, encore faut-il qu’elle ne soit pas perpétuelle. L’article 1210 du Code civil N° Lexbase : L0928KZE dispose, en sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que « les engagements perpétuels sont prohibés ». Antérieurement à l’adoption de ce texte, la jurisprudence retenait une prohibition identique et jugeait que le contrat dont la durée était trop longue était assimilé à un engagement perpétuel [4].
On a vanté la liberté que permettaient les pactes, qui échappent à une réglementation particulière. Observons cependant que si elle avait existé, une telle réglementation aurait pu permettre, à l’instar de ce que fait l’article 1838 du Code civil pour le contrat de société, de sécuriser cette question de durée. En l’absence de règles spécifiques, le pacte est soumis à la prohibition précitée des engagements perpétuels dont l’article 1210 du Code civil précise aujourd'hui la sanction : « Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ». Cette application du régime du contrat à durée indéterminée, tel qu'il résulte de l’article 1211 du Code civil N° Lexbase : L0927KZD, se traduit par la nécessité de « respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
B. Une jurisprudence difficilement lisible
La jurisprudence a abordé par plusieurs décisions remarquées la question de la durée des pactes, et la situation des praticiens ne s’en trouvait pas véritablement stabilisée.
Est souvent citée une décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 mars 1981, non publiée au Bulletin et par ailleurs inaccessible sur le site Légifrance à l’heure où nous écrivons [5]. Cet arrêt ne mentionne pas un pacte d’associés en tant que tel mais un pacte de préférence ; la réponse faite pour ce dernier accord pourrait toutefois être exploitée pour traiter la question des pactes d’associés, dès lors que le pacte de préférence en est souvent un élément.
Était donc en cause un pacte de préférence conclu en 1938 et portant sur les parts sociales d’une SARL dont la durée s’achevait en 1953… si ce n’est que cette société avait vu sa durée de vie prorogée et que se posait alors la question de la durée du pacte de préférence. Au regard de la question de la durée des engagements entre associés, on retiendra surtout que le demandeur au pourvoi plaidait que « la cour d’appel ne pouvait décider que la durée du pacte de préférence était égale à celle de la société, telle qu’elle était prévue à l’origine, sans tenir compte du fait que cette durée avait été prorogée », et que le pourvoi est rejeté, motif tiré de ce que les juges du fond avaient « retenu que la promesse de X ne l’engageait que jusqu’au 1er janvier 1953, date de l’expiration du pacte social ». On pouvait donc déduire de cette décision que la Cour de cassation n’était pas opposée à ce que la durée du pacte soit calquée sur celle de la société.
Après une longue période au cours de laquelle la durée des pactes ne semblait pas être un véritable sujet de préoccupation, intervenait un arrêt non publié au Bulletin, comme le précédent, mais pour le coup très commenté [6]. Cet arrêt inquiétait beaucoup les praticiens, car, outre le fait qu’il était en partie difficilement intelligible, il approuvait la cour d’appel d’avoir jugé qu’un pacte n’était affecté d’aucun terme, alors que celui-ci stipulait qu’il était appelé à s’appliquer aussi longtemps que les parties demeureraient ensemble actionnaires.
La Cour de cassation revenait sur la question dix ans plus tard, par un arrêt échappant encore au Bulletin [7] et dont on ne pouvait déduire qu’elle souhaitait s’éloigner de la position exprimée en 2007.
Plus près de nous, un arrêt publié au Bulletin venait préciser la sanction encourue par le pacte reconnu comme étant perpétuel [8]. La décision ne portait pas sur la qualification d’engagement perpétuel, mais sur la sanction du vice de perpétuité. On notera cependant que la Chambre commerciale ne formulait pas de réserve particulière telle que « en admettant qu’un pacte d’une telle durée puisse être vu comme un engagement perpétuel… ». En l’occurrence, il s’agissait d’un pacte conclu par une personne physique pour une durée de 75 ans.
C. La situation délicate des praticiens
Cette construction jurisprudentielle plaçait les praticiens dans une situation particulièrement délicate à l’heure de faire conclure un pacte aux associés d’une société lorsque la durée de vie du groupement était de 99 ans, comme c’est souvent le cas.
Si les rédacteurs du pacte lui donnaient la même durée de vie que la société, ils s’exposaient à ce que l’engagement soit vu comme perpétuel car trop long [9]. Mais s’ils choisissaient de se référer à la durée de détention des parts sociales ou des actions par les signataires du pacte, le risque était que l’on puisse considérer que la clause en question ne constituait pas un terme.
Les parties disposaient cependant d’une solution de repli, consistant à doter le pacte d’une durée déterminée qui ne soit pas trop longue : cinq ans, dix ans, quinze ans, etc. Avant la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les auteurs accordaient leur préférence aux pactes assortis d’une durée déterminée, compte tenu des risques issus de la jurisprudence que l’on a précédemment évoquée. Ils l’accordent plus encore dans le nouveau contexte : « aujourd’hui, les parties auront, plus que jamais, intérêt à jouer ici la carte de la clarté et à fixer d’emblée une durée au pacte » écrit un éminent auteur [10].
Si ce choix permet de se mettre à l’abri de la qualification du pacte en contrat à durée indéterminée, il comporte l’inconvénient d’imposer d’assurer le suivi post-pacte. S’il est assuré qu’aucun signataire ne peut se délier du pacte pendant la période convenue, encore faut-il prévoir ce que sera la situation des parties une fois cette période expirée. Le pacte sera-t-il prorogé ou renouvelé automatiquement sauf opposition d'une partie ? Mais il faut alors prévoir les conséquences d'une telle opposition.
II. L’harmonie retrouvée des statuts et du pacte
A. L’affirmation d’une solution claire
La cour d’appel saisie du litige avait jugé que la double résiliation du pacte qui était intervenue en l’espèce était régulière et elle avait rejeté les demandes d’indemnisation formées, motif tiré de la durée excessive du pacte, qui « confisqu[ait] toute possibilité réelle de fin de pacte pour les associés » et par conséquent « ouvr[ait] aux parties la possibilité de résilier ce pacte unilatéralement à tout moment ».
Il est vrai que le pacte en cause ne se contentait pas de calquer sa durée sur celle de la société, c’est-à-dire d’être en vigueur « pour le temps restant à courir jusqu'à expiration des 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ». Il était également prévu qu'au terme de cette première période, le pacte serait automatiquement et tacitement renouvelé pour la nouvelle durée de la société éventuellement prorogée. Une porte de sortie était tout de même prévue, puisqu’il était stipulé qu'à l'occasion de chaque renouvellement, toute partie pourrait « dénoncer le pacte pour ce qui la concerne, en notifiant sa décision au moins six mois à l'avance aux autres parties ».
Un élément supplémentaire avait cependant, semble-t-il, fini de convaincre la cour d’appel du caractère perpétuel de la convention conclue entre associés, et cet élément tenait à l’application du pacte aux ayants droit des parties. Précisément, il était prévu par le pacte qu’il lierait et bénéficierait « aux héritiers, aux légataires, ayants droit, ayants cause de chacune des parties, et notamment leurs holdings familiales, ainsi que leurs représentants légaux », ce qui, en tenant compte d’une durée de vie de la société se terminant le 24 janvier 2068, imposait aux descendants du père de rester dans les liens du pacte jusqu’ « à un âge particulièrement avancé, entre 79 et 96 ans selon les signataires du pacte ».
Ces différentes réticences sont cependant balayées par la Cour de cassation, qui juge ainsi qu’on l’a dit que la combinaison de l’ancien article 1134, alinéa 1er du Code civil et de l'article 1838 du même code conduit à affirmer qu’un pacte d’associés peut être conclu pour la durée de vie de la société, en dépit de la prohibition des engagements perpétuels. Parce que la Cour de cassation précise que « les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement », on comprend que le pacte en question, en dépit de sa longue durée, demeure un contrat à durée déterminée.
La solution sera accueillie avec soulagement par la pratique, dont on a vu qu’elle était confrontée à des choix peu satisfaisants : soit accepter de mettre en place des pactes de durée trop brève et sans l’assurance qu’ils soient renouvelés ou prorogés, soit prendre le risque d’une contestation de la qualification de contrat à durée déterminée de la convention unissant les associés.
B. Un élément du droit spécial du pacte
Ainsi que le synthétise très clairement un auteur, « le pacte, à la différence d’un contrat “classique”, peut donc engager ses signataires pendant 99 ans sans pouvoir être résilié unilatéralement », ce qui constituerait un « traitement de faveur » [11]. À la différence de ce qu’avait jugé la cour d’appel de Paris [12], la Cour de cassation ne réserve pas sa solution aux seuls signataires personnes morales. C’est donc un élément du droit spécial du contrat de pacte d’associés qui nous est donné par la Cour de cassation, et non des moindres puisque le pacte se trouve doté d’un équivalent à l’article 1838 du Code civil, d’origine jurisprudentielle.
La justification de la solution retenue nous semble être la finalité commune (la cause commune) aux statuts et au pacte : organiser le fonctionnement de la société et les relations entre ses associés. C’est cette identité de but qui justifie que la durée des statuts et celle du pacte puissent être rendues identiques par les parties, alors même que le législateur n’a pas prévu d’équivalent à l’article 1838 du Code civil pour les pactes. D’autres justifications proches permettraient d’aboutir à la même solution. Par exemple, il est tentant de mettre en relation la solution retenue par la Cour de cassation le 25 janvier 2023 (la durée du pacte peut être calquée sur celle des statuts) avec celle formulée à propos de la SAS le 12 octobre 2022 [13] (les statuts peuvent être complétés par des actes extrastatutaires). Au-delà de la satisfaction que l’on éprouve à trouver une cohérence à des décisions éparses, il y a bien l’idée que le pacte vient compléter les statuts. La notion d’accessoire ou celle d’ensemble contractuel pourraient aussi bien expliquer la solution formulée par l’arrêt commenté.
Indiquons incidemment qu’il ne nous semble pas gênant que le pacte ait la même durée que les statuts, alors qu’il pourrait contenir des mécanismes plus rigoureux que ces derniers ou que le pacte ne pourrait être modifié qu’à l’unanimité [14]. S’agissant des clauses rigoureuses que l’on prétendrait trouver dans les seuls pactes, elles peuvent en règle générale être tout autant insérées dans les statuts. Quant à la modification du pacte à la majorité, elle nous apparaît pleinement possible pour peu qu’elle ait été acceptée par les signataires du pacte.
D’éminents auteurs écrivent certes que cette thèse « se heurte toutefois à de fortes objections et ne semble guère retenir les faveurs de la doctrine » [15]. On retrouve il est vrai ici l’idée qu'une telle décision de modification à la majorité, acceptée par avance par tous les signataires, serait dépourvue d’objet [16]. Il est cependant étonnant que les auteurs qui invoquent cet argument ne soient pas gênés par l’application de la règle majoritaire dans les sociétés. Peut-être est-ce le fondement légal dont se prévaut souvent l’application de la règle majoritaire dans les sociétés qui dispense de cette interrogation ? Il ne nous semble cependant pas que la situation soit très différente entre une SAS dans laquelle un principe de liberté d’organisation des décisions entre associés est reconnu par l’article L. 227-9 du Code de commerce N° Lexbase : L2484IBM et les organisations contractuelles où cette liberté est fondée sur le principe de liberté contractuelle aujourd’hui reconnu par l’article 1102 du Code civil N° Lexbase : L0823KZI.
En conclusion, il est très utile que la Cour de cassation ait choisi de donner une règle claire aux parties quant à la durée des pactes et il est heureux que la règle en question soit celle-là. L’autorité avec laquelle la solution est formulée permet aussi d’affirmer que l’on tient, avec l’arrêt de la « première Chambre civilo-commerciale » (!) du 25 janvier 2023 un élément, et non des moindres, du droit spécial du pacte d’associés.
[1] CA Aix-en-Provence, 17 octobre 2019, n° 18/15518 N° Lexbase : A4730ZRM.
[2] Sur cette question, v. déjà J.-M. Desaché, La durée des pactes d’associés, Actes pratiques et ingénierie sociétaire, mai-juin 2020, n° 171, p. 30.
[3] V. Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-17.592, F-B N° Lexbase : A06419AY, JCP E, 2023, note à paraître B. Dondero, évoquant la persistance de l’obligation de déposer au RCS les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la « constitution d’une personne morale » (sic), qui « perdure pendant toute la vie de la personne morale ».
[4] V. par ex. Cass. civ. 1, 18 janvier 2000, n° 98-10.378 N° Lexbase : A5405AW4.
[5] Cass. com., 10 mars 1981, Bull. Joly Sociétés, 1981, p. 449.
[6] Cass. com., 6 novembre 2007, n° 07-10.620, FS-D N° Lexbase : A4290DZW, Bull. Joly Sociétés, 2008, p. 125, note X. Vamparys ; D., 2008, jur., p. 1024, note B. Dondero ; Rev. sociétés, 2008, p. 429, note J. Moury ; RTD civ., 2008, p. 104, obs. B. Fages ; Dr. sociétés, 2008, comm. 10, note H. Hovasse ; RTDF, 2008, p. 61, note J.-F. Louit ; JCP E, 2008, 1829, note A. Constantin et 1280, §5, obs. J.-J. Caussain, Fl. Deboissy et G. Wicker, rejetant un pourvoi en cassation formé contre CA Paris, 3-B, 15 décembre 2006, n° 05/16389 N° Lexbase : A0427DUD, Bull. Joly Sociétés, 2008, p. 479, note F.-X. Lucas.
[7] Cass. com., 20 décembre 2017, n° 16-22.099, F-D N° Lexbase : A0543W9Y, Bull. Joly Sociétés, 2018, p. 154, note J.-M. Moulin ; RTD com., 2018, p. 145, obs. J. Moury ; JCP E, 2018, 1143, note A. Couret et B. Dondero.
[8] Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-16.994, F-B N° Lexbase : A25278KS ; Dr. sociétés, 2023, comm. n° 1-2, note R. Mortier ; Rev. Sociétés, 2023, p. 23, note G. Pillet ; Bull. Joly Sociétés, janvier 2023, p. 20, note Th. Massart ; Gaz. Pal., novembre 2022, p. 20, note M. Cormier ; Gaz. Pal., janvier 2023, p. 4, obs. D. Houtcieff ; JCP G, 2022, 1292, note S. Schiller ; JCP E, 2023, note B. Dondero.
[9] V. sur l’appréciation de la perpétuité, V. Poux, Quel(s) seuil(s) pour la perpétuité en droit des contrats ?, RLDC, 2021, n° 193, p. 10.
[10] J. Mestre, Les pactes d’actionnaires au lendemain de l’entrée en vigueur du nouveau droit commun des contrats, in Mélanges en l’honneur de J.-J. Daigre, Ed. Joly, 2017, p. 219.
[11] V. Cl. Barrillon, D., 2023, p. 370, note sous l’arrêt commenté.
[12] V. CA Paris, 5-16, 15 décembre 2020, n° 20/00220 N° Lexbase : A7916393, Rev. sociétés, 2021, p. 305, note J. Heinich ; Dr. Sociétés, 2021, comm. 46, note R. Mortier ; rapp. à propos d’une convention de croupier : CA Paris, 5-9, 28 janvier 2021, n° 20/01252 N° Lexbase : A96369BI, RJDA, juillet 2021, n° 450 et 475, jugeant qu’ « un terme trop lointain (99 ans), au regard de la durée moyenne de la vie professionnelle, ne peut être considéré comme une durée déterminée. Par suite, il y a lieu de considérer que la convention de croupier a été conclue entre les parties pour une durée indéterminée, et qu'elle pouvait donc faire l'objet d'une résiliation unilatérale à tout moment, à condition de respecter un délai de préavis raisonnable… ».
[13] Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382, F-B N° Lexbase : A55138NI, D., 2022, p. 2086, note J.-B. Barbièri ; Bull. Joly Sociétés, décembre 2022, p. 13, note P.-L. Périn ; Rev. Sociétés, 2023, p. 92, note A. Reygrobellet ; Dr. Sociétés, 2022, comm. n° 134, note J.-F. Hamelin ; JCP G, 2022, 1364, note D. Gibirila ; JCP E, 2022, 1371, note B. Dondero ; Th. Favario, Révocation du directeur général d'une SAS : les statuts, tous les statuts... rien que les statuts ?, Lexbase Affaires, octobre 2022, n° 733 N° Lexbase : N3069BZP.
[14] V. en ce sens C. Barrillon, préc.
[15] A. Couret et Th. Jacomet, Les pièges des pactes d’actionnaires : questions récurrentes et interrogations à partir de la jurisprudence récente, RJDA, 2008, p. 951, sp. p. 953.
[16] A. Tadros, Quelques observations sur la conclusion, la modification et l’exécution des pactes d’associés, D., 2019, p. 1351, sp. n° 21 : « Faute de dispositions spécialement applicables au pacte d'associés, les modifications ultérieures à sa naissance ne peuvent résulter d'une décision prise à la majorité. Le pacte d'associés n'est pas une société, ni une convention d'indivision. Ainsi, le consentement donné “en blanc” pour toute modification ultérieure n'a, juridiquement, guère de sens. Une décision de modification du pacte prise à la majorité est, dans ces conditions, annulable pour défaut d'objet – de contenu certain – même si tous les signataires ont donné leur accord initialement pour réaliser les modifications de cette manière ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484546
[Brèves] Sociétés mères : quid de la possibilité de céder une filiale en état de cessation des paiements ?
Réf. : Cass. com., 1er mars 2023, n° 21-14.787, FS-B N° Lexbase : A17939GI
Lecture: 3 min
N4552BZM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
Le 08 Mars 2023
► Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.
Faits et procédure. Le 18 octobre 2011, une société mère a cédé la totalité des actions qu’elle détenait dans le capital d’une filiale, qui avait notamment comme client un grand groupe automobile allemand, à une société de droit allemand.
La société cédée a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 21 novembre 2011 et 9 mai 2012, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 31 juillet 2011. Le 30 mai 2012, le mandataire liquidateur a licencié l’ensemble des salariés de la société de droit français.
Trente salariés ont saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces mêmes salariés ont assigné la société mère et le groupe automobile en paiement, in solidum, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de leur emploi.
Par décision du 4 février 2021, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 6-2, 4 février 2021, n° 19/07936 N° Lexbase : A72794EC) a rejeté la demande des salariés de condamnation in solidum des sociétés à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, aux motifs qu’aucune faute n’avait été commise au moment de la cession.
Les salariés ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction rejette le moyen tendant à voir la société mère condamnée à payer aux salariés de la filiale cédée diverses sommes à titre de dommages et intérêts, du fait de la cession d’actions intervenue le 18 octobre 2011, en dépit du fait que les demandeurs au pourvoi soutenaient que constitue une faute le fait, pour une société mère, de céder une filiale en état de cessation des paiements sans procéder à une vérification de la viabilité du projet présenté par le repreneur.
En particulier, les juges de la Cour de cassation attirent l’attention sur le fait qu’il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.
La Chambre commerciale censure tout de même l’arrêt d’appel sur le fondement d’une règle de procédure.
|
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La cession de contrôle, Les obligations du cédant et du cessionnaire, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E0949AEU. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484552
[Jurisprudence] L’exercice de la déduction de la TVA par les sociétés holdings : une question toujours d’actualité ?
Réf. : CAA Lyon, 15 décembre 2022, n° 21LY00167 N° Lexbase : A395584A
Lecture: 10 min
N4615BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Pierre Pradeau - Olivier Galerneau et Maxime Mahtout, Avocats, EY Société d'avocats
Le 08 Mars 2023
Mots-clés : TVA • holdings • droit à déduction • coefficient d’assujettissement • prestations de services
L’exercice du droit à déduction de la TVA par les sociétés holding répond à des principes désormais bien établis s’articulant autour de la règle de l’affectation, de la notion de frais généraux et de l’immixtion dans la gestion des filiales.
La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 15 décembre 2022, s’est prononcée sur le fait de savoir si les dépenses engagées par une société holding avaient un lien direct avec son activité constituée de prestations de services rendues à ses filiales et étaient, à ce titre, déductibles.
Cette société holding fournissait à sa filiale, dont l’activité était le courtage en produit d’assurance pour les animaux, des prestations de gestion des feuilles de soins et des données médicales sur la base de contrats conclus entre les deux sociétés et percevait une rémunération fixée sur la base d’un prix fixe forfaitaire mensuel déterminé en fonction du nombre de contrats créés par sa filiale.
La société holding a acquis des prestations de services de gestion, de marketing, de conseil, d’assistance, de développement stratégique et commercial dans le domaine de la santé et de l’assurance pour animaux et a déduit l’intégralité de la TVA grevant ces dépenses au titre de ses frais généraux.
L’administration fiscale a contesté la déduction de la TVA effectuée par la société holding au titre de ces prestations et a redressé cette dernière du montant de la TVA déduite au motif que le prix de ces prestations n’aurait pas été répercuté à sa filiale.
I. Un arrêt rappelant le principe de l’immixtion dans la gestion des filiales
Dans les nombreuses jurisprudences rendues par les juridictions françaises et par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), le débat s’est cristallisé autour de la notion d’immixtion des sociétés holding dans la gestion de leurs filiales.
Cette notion d’immixtion dans la gestion des filiales [1] permet en effet de déterminer si la société holding agit dans le cadre d’une activité économique assujettie à la TVA tournée vers ses filiales, ou si elle agit dans le cadre de la seule gestion de son patrimoine (c’est-à-dire dans le cadre de la gestion de ses participations).
Il est désormais établi que pour déterminer si une société holding est en mesure de déduire un montant de TVA supporté au titre d’une dépense, il convient de rechercher dans un premier temps si la société s’immisce directement ou indirectement dans la gestion des sociétés dont elle détient des titres, puis, dans un second temps, si tel est le cas, la dépense d’amont à un lien direct et immédiat avec l’activité économique déployée par la société.
Ainsi, si une société holding se borne à détenir des participations dans des sociétés sans s’immiscer dans la gestion de ces dernières, elle n’agit pas en qualité d’assujetti à la TVA au titre de la détention de ses participations et elle ne peut donc exercer aucun droit à déduction à ce titre (son coefficient d’assujettissement est alors égal à 0).
Inversement, si la société holding s’immisce dans la gestion de ses filiales en lui fournissant des prestations administratives, financières et juridiques par exemple, cette immixtion, qui se caractérise par la fourniture de services, confère à la société holding la qualité d’assujetti à la TVA au titre de l’exercice de cette activité économique dès lors qu’une contrepartie existe.
Dans cette situation, lorsqu’une immixtion peut être caractérisée, la TVA ayant grevé les dépenses d’amont supportées par la société holding pourra être déductible dès lors que les dépenses d’amont ont un lien direct et immédiat avec des opérations soumises à la TVA en aval.
En effet, il est de jurisprudence constante que « en principe, l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est nécessaire pour qu'un droit à déduction de la TVA en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit » [2].
En l’espèce, c’est précisément ce raisonnement que la Cour administrative d’appel de Lyon a appliqué afin de déterminer si les dépenses supportées par la société holding étaient déductibles. À ce titre, elle ne conteste pas le fait que la société holding s’immisce dans la gestion de sa filiale, mais elle considère que les prestations de services de gestion, de marketing, de conseil, d’assistance, de développement stratégique et commerciale dans le domaine de la santé et de l’assurance pour animaux acquises par la holding ne se rattachent pas à son activité économique de gestion et de saisie de feuilles de soins des contrats conclus par sa filiale.
Pour autant, selon nous, la Cour semble s’être arrêtée à la première étape du raisonnement qui doit être appliqué dans la mesure où lorsqu’une dépense n’a pas un lien direct et immédiat avec une opération d’aval, il convient de s’interroger si la théorie des frais généraux est applicable.
II. La non-application de la théorie des frais généraux aux prestations litigieuses, une décision délibérée ou un dommage collatéral ?
Dans l’affaire en cause, la société holding soutenait que les prestations de services de gestion, de marketing, de conseil, d’assistance, de développement stratégique et commercial acquises avaient le caractère de frais généraux et étaient des éléments constitutifs du prix des biens ou services qu’elle fournissait à sa filiale. À ce titre la société holding soutenait que la TVA ayant grevé ces prestations était intégralement déductible.
S’agissant des dépenses n’ayant pas de lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations en aval, il a été reconnu par la jurisprudence que celles pouvant être qualifiées de frais généraux ouvrent droit à déduction dans la mesure où elles ont un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique déployée par l’assujetti [3].
Au cas particulier, il semble que la Cour administrative d’appel se soit émancipée de cette théorie en recherchant si les modalités de détermination du prix des prestations rendues par la société holding à sa filiale étaient déterminées en prenant en compte les prestations litigieuses et non en recherchant si les prestations en cause se rattachaient à l’ensemble de l’activité économique.
La Cour relève en effet que « la requérante a communiqué à l’administration le détail des coûts refacturés par la requérante à sa filiale ayant permis de déterminer la rémunération forfaitaire prévue par les contrats, ces coûts portant sur les salaires, les locations, les services informatiques et les frais de gestion » et en déduit qu’ « il n’apparaît pas dans les éléments ainsi communiqués à l’administration lors des opérations de vérification, que le coût de ces prestations intègrerait également […], les dépenses litigieuses, [..] [et] n’apporte pas plus d’élément ou de précision sur la nature des autres activités qu’elle prétend exercer, alors qu’il résulte de l’instruction que l’essentiel de l’activité facturée à sa filiale, la société Vetassur, porte sur les prestations de gestion et saisie de feuilles de soins des contrats conclus par cette filiale et la gestion de produits annexes ».
Autrement dit, la Cour a considéré que le coût des prestations n’ayant pas été répercuté ne serait-ce que partiellement par la société holding à sa filiale, ces prestations ont été fournies à titre gratuit.
Se fondant alors sur le principe du lien direct et immédiat décrit succinctement ci-dessus, elle considère que ces prestations n’ont pas été engagées par la holding dans le cadre de son immixtion dans la gestion de sa filiale et rejette en conséquence la déduction de la TVA ayant grevé ces dépenses.
La Cour semble rejeter la qualification de frais généraux aux prestations litigieuses au motif que les prestations acquises ne seraient pas constitutives d’un chiffre d’affaires taxable et se fonde, pour ce faire, sur une ordonnance de la CJUE [4] rendue en 2017.
Il nous semble qu’il aurait été intéressant que la Cour s’interroge sur le fait de savoir si les prestations litigieuses pouvaient être qualifiées de frais généraux puisque ces derniers constituent, par nature, des dépenses d’amont qui certes n’entretiennent pas un lien direct et immédiat avec les dépenses d’aval, mais ont un lien direct et immédiat avec l’ensemble des activités économiques déployées par la société holding.
La position adoptée par la Cour administrative d’appel pourrait, nous semble-t-il, être contestée dans la mesure où le raisonnement adopté peut être assimilé à la logique de l’acte anormal de gestion applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d’impôts sur les sociétés. En effet, on pourrait s’interroger sur le fait de savoir si la décision prise par la cour n’a pas été uniquement guidée par le fait que le prix des prestations litigieuses acquises par la société holding n’a pas été répercuté, ne serait-ce que partiellement, à sa filiale. Or, il est constant que cette notion d’acte anormal de gestion n’existe pas en matière de TVA.
Cette décision nous semble également différente de celle rendue récemment par la CJUE dans un arrêt « W GmbH » du 8 septembre 2022 [5]. En effet, dans cette affaire, la Cour de Justice de l’UE a considéré que la TVA supportée au titre de prestations de services acquises par une société holding n’était pas déductible dans la mesure où elle apportait ces prestations aux filiales en échange de l’octroi d’une participation aux bénéfices généraux, et que les prestations :
- avaient des liens directs et immédiats avec les activités majoritairement exonérées des filiales ;
- n’entraient pas dans le prix des opérations imposables réalisées en faveur des filiales ; et,
- ne faisaient pas partie des frais généraux de l’activité économique propre à la société holding.
La cour avait relevé, concernant la qualification ou non de frais généraux des opérations en cause, qu’il s’agissait de dépenses qui « constituent l’objet même de la contribution d’associée de W à ses filiales » et qu’une telle contribution qu’elle soit « en numéraire ou en nature relève de la détention de parts sociales qui […] ne constituent pas une activité économique au sens de la Directive TVA ».
Autrement dit, c’est parce que ces dépenses étaient intrinsèquement liées aux parts sociales détenues par la société W dans ces filiales qu’elles ne pouvaient pas avoir le caractère de frais généraux.
Ainsi, l’arrêt de la cour administrative de Lyon nous semble contestable puisqu’il semble s’appuyer sur le seul fait que la SAS La compagnie des animaux n’a pas été en mesure de démontrer que le prix des prestations acquises avait été répercuté, au moins partiellement, à sa filiale et qu’en ne recherchant pas si ces dépenses se rattachaient ou non à l’ensemble des activités déployées par la société holding, il semble se détourner de la théorie des frais généraux.
Pour autant, cet arrêt met en lumière qu’une attention particulière doit être portée par les opérateurs sur les dépenses qualifiées de frais généraux. En effet, considérer que la notion de frais généraux a un caractère « attrape-tout » permettant la déduction de la TVA grevant l’ensemble des dépenses acquises par les sociétés holdings sans rechercher si lesdites dépenses peuvent bien être qualifiées de frais généraux semble de plus en plus téméraire au regard des jurisprudences récentes.
[1] Voir en ce sens notamment : CJUE, 16 juillet 2015 aff. C-108/14 et C-109/14, Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG N° Lexbase : A1668RQT ; CJUE 5 juillet 2018 aff. C-320/17, Marle Participations SARL N° Lexbase : A9951XU4.
[2] Voir notamment en ce sens CJUE 8 juin 2000 aff. C-98/98, Commissioners of Customs and Excise c/ Midland Bank plc N° Lexbase : A2016AII.
[3] Voir notamment en ce sens CJUE, 16 juillet 2015 aff. C-108/14 et C-109/14 précité.
[4] CJUE, 12 janvier 2017, aff. C-28/16, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság N° Lexbase : A3986TBA.
[5] CJUE, 8 septembre 2022 aff. C-98/21, W GmbH {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 88085931, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CJUE, 08-09-2022, aff. C-98/21, W GmbH", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A23978HA"}}.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484615