[Jurisprudence] Entre ombre et lumière : la communication des documents administratifs des personnes morales de droit privé
Réf. : CE, Section, 7 octobre 2022, n° 443826, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A91988MM
Lecture: 13 min
N3256BZM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Otero, Maître de conférences en droit public, Université de Rouen
Le 16 Novembre 2022
Mots clés : communication • documents administratifs • fondations • Louis Vuitton • personnes morales
Le Conseil d’État, dans une formation solennelle, devait se pencher sur la question du caractère communicable on non des comptes annuels d’une fondation d’entreprise. Saisie par l’association Anticor souhaitant obtenir la communication des comptes annuels de la fondation Louis Vuitton, la Haute juridiction profite de cette espèce pour dresser un vade-mecum de la communication des documents administratifs s’agissant des personnes morales de droit privée et des différents cas de figure pouvant se présenter. La Haute juridiction, après avoir rappelé que la protection de la vie privée s’étend aux personnes morales de droit privé, juge que s’agissant des fondations d’entreprise, et à défaut de perception de subventions publiques ou de dispositions législatives le prévoyant, leurs comptes ne sont pas communicables à des tiers.
La transparence : pour qui ? et jusqu’où ? En l’espèce, l’association Anticor, requérant d’habitude [1], dont l’objet est notamment la lutte contre la corruption et la promotion de l’éthique en politique, a souhaité en savoir davantage sur les comptes de la fondation Louis Vuitton. Cette dernière a été créé par le numéro mondial du luxe, à savoir le groupe LVMH, et l’association souhaitait obtenir des éclaircissements sur les avantages dont elle bénéficie au titre de l’article 238 bis du Code général des impôts N° Lexbase : L7468L7Q, lequel prévoit une réduction d’impôt. C’est la raison pour laquelle elle s’est adressée au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, aux fins de lui demander communication des comptes annuels des exercices 2016 et 2017 de la fondation d’entreprise Louis Vuitton ainsi que leurs annexes. En effet, en vertu de l’article 19-10 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, sur le développement du mécénat N° Lexbase : L8334AGR : « l’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement de la fondation d’entreprise ; à cette fin, elle peut se faire communiquer tous les documents et procéder à toutes investigations utiles. La fondation d’entreprise adresse, chaque année, à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels ». Par décision du 29 janvier 2019, le préfet a refusé de faire droit à cette demande. En réaction, l’association Anticor a saisi le tribunal administratif de Paris [2] d’une demande d’annulation de la décision préfectorale et qu’il soit enjoint au représentant de l’État de lui communiquer les comptes demandés sans délai et sous astreinte.
Dans la motivation de son jugement, le tribunal a retenu que les comptes annuels des fondations d’entreprises sont reçus par le préfet dans le cadre de la mission de contrôle des comptes annuels de ces fondations et que ces pièces constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L4910LA4. Mais bien qu’ils soient des documents administratifs, et donc par suite en principe susceptibles d’être communiqués, la juridiction a retenu qu’en l’espèce, s’agissant de la fondation d’entreprise Louis Vuitton, une telle communication « est de nature à porter atteinte au secret de sa vie privée garanti à toute personne, tant physique que morale ». Le refus du préfet étant légalement fondé, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’association Anticor. Cette dernière a entendu poursuivre le contentieux en formant un pourvoi devant le Conseil d’État contre le jugement rendu. De prime abord, la question de la communication de ces documents pourrait sembler anodine, mais il n’en est rien. Elle pose la problématique plus générale de la protection de la vie privée des personnes morales de droit privé. Il s’avère que s’agissant de ces dernières il convient de distinguer deux hypothèses : la première est celle où elles sont assujetties à l’obligation de communication de leurs documents administratifs (I), la seconde recouvre les cas où cette communication est conditionnée (II).
I. Les personnes morales de droit privée assujetties à l’obligation de communication
Par principe, la question de la communication des personnes morales de droit public (État, collectivités locales, établissements publics) ne pose pas de complications dans la mesure où, eu égard à la finalité d’intérêt général qu’elles poursuivent, l’accès à leurs documents est de droit, sous réserves de quelques exceptions [3]. De la même façon, celle de la communication des personnes morales de droit privé (société, fondation, association), compte tenu de l’intérêt personnel qui caractérise leur création et leurs buts, ne soulève pas de difficultés car elles ne sauraient se soumettre à un régime de transparence. Pour autant, le droit serait-il cette science si magnifique et plaisante s’il ne recelait, au sein et à côté des principes, de tant d’exceptions et de dérogations, lesquelles, sous réserve d’être soit expressément prévues soit non prohibées, sont tout autant constitutives de la règle de droit ?
Le présent arrêt en ce qu’il envisage de nombreuses hypothèses dérogatoires s’avère fécond de telles singularités. En effet, au critère organique qui tiendrait uniquement et exclusivement à la personne considérée, le Code de relations entre le public et l’administration en son article L. 300-2, a préféré privilégier un approche matérielle et se référer à la notion de documents administratifs, lesquels sont « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Si l’identification de l’ensemble des personnes publiques est aisée, il n’en va pas de même de ce que sont les personnes de droit privée chargées d’une mission de service public. Ainsi que le mentionnait en 1990, Marcel Pochard, « ni la doctrine, ni la jurisprudence ne sont absolument catégoriques sur ce qu’il faut entendre par personnes privée chargée de la gestion d’un service public » [4]. Il y a quinze ans, sans donner une véritable définition de ce qu’est une personne privée chargée de la gestion d’un service public, le Conseil d’État, par le biais de l’arrêt « APREI » [5], relatif justement au contentieux de la communication des documents des personnes morales de privées, a offert une synthèse recouvrant l’ensemble des hypothèses.
La première est celle où le législateur a lui-même entendu reconnaître [6] ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public. La qualification par détermination de la loi est évidemment la plus simple à identifier. La deuxième hypothèse est celle de réunions des trois critères jurisprudentiels longtemps mobilisés [7], à savoir qu’une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Enfin, la dernière alternative est celle où même en l’absence de prérogatives de puissance publique, une personne privée est également regardée, dans le silence de la loi, comme assurance une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
Outre de régler l’hypothèse de ce que la doctrine a pu considérer comme étant des « associations administratives » [8] eu égard à leur proximité avec l’administration dont elles ne seraient qu’un faux nez, cette hypothèse s’applique à l’ensemble des personnes privées chargées de la gestion d’un service public malgré l’absence de détention de prérogatives de puissance publique. Ainsi, a été reconnue comme tel, le Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire, association dont l’objet est « l’étude, dans le domaine nucléaire, de l’évaluation de la protection de l’homme sous ses aspects techniques, biologiques, économiques et sociaux », créée par Électricité de France, alors établissement public, et par le Commissariat à l’énergique atomique (CEA), pour le compte desquels elle est chargée d’évaluation et dont elle perçoit des subventions. Partant, il a été jugé que, eu égard à leur nature et à leur objet, sont des documents administratifs communicables, et doivent être communiqués s’ils sont sollicités : les comptes annuels de cette association, les rapports des commissaires aux comptes et les procès-verbaux des assemblées générales de cet organisme, ou encore les décisions de cette association fixant le montant de l’adhésion du CEA [9]. Dans de tels cas de figure, à l’instar des personnes morales de droit public, c’est la lumière, c’est-à-dire la transparence, qui prédomine. La vie privée des personnes morales de droit privé si ce n’est s’efface du moins s’incline devant l’intérêt public eu égard à leur mission de service public et devant l’intérêt du public à pouvoir avoir accès à leurs documents administratifs.
II. Les personnes morales de droit privé pour lesquelles la communication est conditionnée
Lorsqu’elles ne sont pas chargées d’une mission de service public et donc soumises à l’obligation de communication, les personnes morales de droit privé devraient en principe bénéficier pleinement et totalement de la protection de leur vie privée constitutionnellement et conventionnellement garantie. Ici, c’est donc l’ombre et donc le secret qui prédomine. Pour autant, comme le montre l’espèce, à côté du principe subsiste des exceptions. La présente affaire, comme la jurisprudence antérieure [10] avait pu en être l’illustration, pose la question des cas où, bien qu’émanant d’une personne morale de droit privé ces documents doivent être transmis à l’administration pour que cette dernière exerce son contrôle, et où se pose la question de leur communication ou non aux tiers qui en feraient la demande. Le Conseil d’État vient ici poser expressément un principe, celui de la non communication au nom du droit à la vie privée de ces personnes morales de droit privé. Il juge en effet que, bien qu’étant des documents administratifs, le fait que la personne morale de droit privée dont s’agit ne soit pas chargée d’une mission de service public fait obstacle à la communication des documents produits et détenus par l’administration.
Sur ce point, l’arrêt est clairement explicite : « les documents produits par une personne privée qui n’est pas investie d’une mission de service public acquièrent le caractère de documents administratifs, pour l’application du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’ils ont été reçus par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public. De tels documents, sauf à ce qu’il soit possible d’occulter ou de disjoindre les mentions en cause, ne peuvent toutefois être communiqués qu’à la personne intéressée lorsque cette communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée (…). [L]es dispositions [législatives] doivent être entendues, s’agissant de leur application aux personnes morales de droit privé, comme excluant en principe, sous réserve qu’elle ne soit pas imposée ou impliquée par d’autres dispositions, la communication à des tiers, par l’autorité administrative qui les détient, des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. La circonstance que de tels documents aient été transmis à l’administration afin de permettre à celle-ci d’exercer un contrôle sur l’activité de l’organisme concerné est sans incidence, par elle-même, sur les conditions dans lesquelles des tiers peuvent se les voir communiquer ».
On relèvera néanmoins deux exceptions mentionnées dans ce considérant de principe : la première, formelle, où une disjonction serait possible ; la seconde, légale, où c’est l’absence de dispositions législatives expresses qui rend la communication prescrite ou possible. De la sorte, la protection et les garanties dont bénéficient les personnes physiques de droit privé est étendue de la même manière aux personnes morales de droit privé, nonobstant le caractère de fiction juridique de ces dernières. Cette position jurisprudentielle, comme le montrent les conclusions du rapporteur public Laurent Domingo s’inscrit en adéquation avec les positions des juridictions européennes [11] et d’autres pays européens, lesquelles sont autant des justifications dont le juge administratif sait ne plus vouloir faire l’économie, dans le cadre d’un « univers juridique multipolaire » [12], que des contraintes dont le juge administratif sait ne plus pouvoir faire l’économie. Il n’en demeure pas moins que restait en suspens la question a priori centrale, objet du pourvoi, mais in fine assez marginale, au regard de la motivation de l’arrêt, du cas spécifique des fondations d’entreprises, personnes morales à but non lucratif créées par une ou plusieurs entreprises pour réaliser une œuvre d’intérêt général. Quid s’agissant de la transparence pour elles ?
Là encore, là toujours, l’on retrouve le principe et les exceptions. La Haute juridiction juge ainsi que « si les statuts des fondations d’entreprise sont communicables à tout personne qui en fait la demande sous réserve des informations qui seraient couvertes par les secrets protégés par la loi, les comptes des fondations n’ayant reçu aucune subvention publique, qui relèvent de la vie privée de ces organismes au sens des dispositions de l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L7092MAW et qui font l’objet des contrôles [confiés à l’autorité administrative], ne sont, en l’absence de disposition législative le prévoyant expressément, pas communicables aux tiers ». Le principe s’agissant de ces entités est donc celui de la non-communication. Les exceptions, au nombre de deux, sont celles où : la fondation d’entreprise a reçu des subventions publiques ou si une disposition législative en prévoit expressis verbis la communication à ceux qui en feraient la demande. En l’espèce, la fondation Louis Vuitton n’ayant reçu aucune subvention au titre des années 2016 et 2017, c’est-à-dire les exercices sur lesquels l’association Anticor sollicitait la communication, elle n’entre pas dans l’une des exceptions et par suite les documents sollicités revêtent un caractère non communicable. Par suite, la requête de l’association est rejetée. Néanmoins, en définitive, il est loisible de se demander si, à terme, cette jurisprudence ne pourrait pas se retourner contre…l’association requérante qui l’a initiée.
[1] Par exemple, CE, 12 novembre 2020, n° 425340 N° Lexbase : A390734H.
[2] TA Paris, 17 juin 2020, n° 1910687 N° Lexbase : A30258ND.
[3] CRPA, art. L. 311-5.
[4] M. Pochard, concl. sur CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun et Association « Melun-Culture-Loisirs », n°s 69867, 72160, AJDA, 1980, p. 820.
[5] CE, 22 février 2007, n° 264541 N° Lexbase : A2709DUU.
[6] CE, 12 octobre 2018, n° 410998 N° Lexbase : A3435YGC, pour les sociétés de courses qui participent « au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural ».
[7] CE, 28 juin 1963, n° 43834 N° Lexbase : A1155EWP.
[8] J.-P. Négrin, Les associations administratives, AJDA, 1980, p. 129.
[9] CE, 25 juillet 2008, n° 280163 N° Lexbase : A7897D9D.
[10] CE, 17 avril 2013, n° 344924 N° Lexbase : A1385KCB.
[11] CEDH, 16 avril 2002, Req. 37971/97 N° Lexbase : A5397AYK ; CJUE, 22 octobre 2002, aff. C-94/00, SA Roquette Frères N° Lexbase : A3294A3E.
[12] B. Genevois, Comment tranche-t-on au Conseil d’État ?, in L’office du juge, Actes du colloque des 29 et 30 septembre 2006, Les colloques du Sénat, Sénat, p. 315.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483256
[Doctrine] Le créancier professionnel
Lecture: 19 min
N3277BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Thierry Favario, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3
Le 16 Novembre 2022
Le présent article est issu d’un dossier spécial intitulé « Les déclinaisons du professionnel » et publié dans l’édition n° 735 du 17 novembre 2022 de la revue Lexbase Affaires. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici N° Lexbase : N3283BZM.
1. Le banquier, naturellement. Mais la réponse est un peu courte : le banquier est un exemple de « créancier professionnel » ; il en est peut-être l’archétype. On ne saurait cependant réserver cette qualification au seul banquier si bien qu’une recherche plus approfondie s’impose, nécessairement.
2. Définitions. La définition du « créancier » est connue : il est le « titulaire d’une créance », celui « à qui le débiteur doit quelque chose », le « sujet actif de l’obligation » [1]. La créance peut être de somme d’argent mais pas seulement [2]. Pareille définition juridique marque par sa rigueur mais masque la réalité d’un rapport de force : le créancier est celui à qui « on doit » et qui peut donc exiger et contraindre. Un créancier peut rapidement se métamorphoser : partenaire enthousiaste ; partie exigeante attachée à la force obligatoire du contrat conclu [3] ; demandeur menaçant voire belliqueux : il n’est ainsi pas rare de voir un débiteur souhaiter in fine « fuir ses créanciers ». L’adjectif « professionnel », utilisé pour qualifier le « créancier », est ambivalent en ce qu’il limite et élargit le sujet. La limite tient à l’exclusion imposée : tous les créanciers ne sont pas visés, mais seulement un sous-ensemble de cette vaste catégorie, les professionnels par opposition aux non-professionnels ; l’élargissement découle du sens même de l’adjectif : « inhérent à la profession ; lié à son exercice » [4]. Le créancier l’est donc à raison de sa profession soit « l’activité habituellement exercée par une personne pour se procurer les ressources nécessaires à son existence » [5]. L’entrepreneur donc, en nom ou en société… et pourquoi pas le salarié, titulaire d’une créance de salaire à raison de l’exercice de sa profession ? Cette définition est à rapprocher de celle du professionnel, retenue par le Code de la consommation [6]. Au terme de ces définitions, c’est peu écrire que le flou persiste autour de l’expression « créancier professionnel » et qu’un effort supplémentaire de qualification s’imposera dans le cadre de cette étude.
3. Problématiques. Car le juriste raisonne simplement : d’une qualification doit découler un régime ; à la notion de « créancier professionnel » devrait donc être attachée l’application d’un ensemble de règles. En d’autres termes, la notion de « créancier professionnel » devrait renvoyer à un statut juridique, un complexe de droits et d’obligations lié à cette qualification. Si l’on s’en tient aux seuls entrepreneurs, ce statut se compose a priori de deux strates. La première forme le statut élémentaire, applicable à tout « créancier professionnel », peu important la nature de sa profession. Evoquer le caractère fragmentaire de ce statut est une litote. L’expression « créancier professionnel », longtemps logée dans le Code de la consommation, a finalement migré vers les codes civil [7], de commerce [8] et monétaire et financier [9]. Et ces dispositions légales ne s’entendent qu’éclairées par la jurisprudence. Bornons-nous pour l’instant à relever que ce statut élémentaire réunit les droits et obligations fondant une espèce de droit commun à tous les créanciers professionnels. La seconde strate est le statut complémentaire de ce « créancier professionnel ». Il comprend les règles spécialement liées à l’exercice d’une profession donnée. Banquier, sous-traitant et avocat sont ainsi tous des créanciers professionnels, mais chacun est contraint par des règles qui lui sont propres, inhérentes à sa profession. Ces règles se caractérisent par la diversité de leur nature : généralement légales et réglementaires, elles peuvent également être déontologiques, particulièrement quand le créancier exerce une profession libérale réglementée [10]. Les créanciers professionnels sont ainsi soumis à un droit commun et à leur droit professionnel. Ce constat conduit à adopter une focale large compte tenu du cadre étroit de cette étude.
4. Plan. Flou persistant et focale large : décidément, la notion de « créancier professionnel » mérite que l’on s’y attarde. L’étude se veut nécessairement didactique : celle-ci envisagera en premier lieu ce qu’est un « créancier professionnel » (I), puis en second lieu le comportement normalement attendu de ce dernier (II).
I. Être
5. Le « créancier professionnel » ne se qualifie pas en une fois et d’un bloc : il convient au contraire de procéder par approches successives en envisageant ce qu’il est puis ce qu’il n’est pas. L’exposé d’une thèse (A) précèdera l’antithèse (B).
A. Thèse : ce qu’il est
6. Dire ce que le « créancier professionnel » est. La proposition est ambitieuse. Il est vrai qu’hier, le « créancier professionnel » était bien connu. Aujourd’hui, des incertitudes peuvent cependant naître d’évolutions récentes du droit positif.
7. Certitudes d’hier. Commençons par les certitudes d’hier. Au temps où l’expression « créancier professionnel » hantait le Code de la consommation, le juge avait dû en définir les contours. L’enjeu était de taille mais circonscrit : ni plus ni moins que la remise en cause de l’efficacité du cautionnement bénéficiant à ce type de créancier, dès lors que l’acte était dénué d’une certaine mention manuscrite [11] ou carrément disproportionné [12]. La Cour de cassation avait ainsi énoncé que « le créancier professionnel au sens de ces textes [article L. 341-2 N° Lexbase : L5668DLI et L. 341-3 N° Lexbase : L5675DLR, devenus L. 331-1 . N° Lexbase : L1165K7B et L. 331-2 N° Lexbase : L1164K7A du Code de la consommation] s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles » [13], peu important que celle-ci ne soit pas principale [14]. La migration des dispositions du Code de consommation vers le Code civil remettra-t-elle en cause cette approche de la notion de « créancier professionnel » ? La lecture du rapport présentant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, au Président de la République N° Lexbase : Z442981N, ne laisse rien présager de tel : il s’agit d’unifier au sein du Code civil des règles auparavant dispersées dans divers codes, sans affecter leur substance. Le « créancier professionnel » du Code civil sera donc le même, sauf évolution de jurisprudence, que celui du Code de la consommation.
8. Les doutes d’aujourd’hui. Les occurrences de l’expression « créancier professionnel » citées précédemment ne concernent que le régime du cautionnement. Or, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, rénovant le statut de l’entrepreneur individuel N° Lexbase : L3215MBP, par une scission de son patrimoine selon qu’il est le gage de titulaires de créances professionnelles ou non professionnelles [15], envisage la situation sous un angle différent. S’attachant au gage des créanciers de l’entrepreneur individuel, les dispositions légales distinguent selon la nature de la créance, professionnelle ou non professionnelle, du point de vue de l’entrepreneur, et non selon la qualité de son créancier [16]. Dans la plupart des cas, la coïncidence s’imposera : la créance professionnelle du point de vue de l’entrepreneur individuel aura pour titulaire un « créancier professionnel ». Mais la coïncidence ne sera pas parfaite : ledit entrepreneur pourrait ainsi avoir une dette professionnelle envers un créancier non professionnel ; que l’on songe au prêt d’un membre de sa famille ou d’un ami destiné à financer l’acquisition d’un bien nécessaire à l’exploitation de l’entreprise. Est-ce du reste pour prévenir le risque de contentieux lié à pareil hiatus que la loi affirme que « les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel » [17] ? Subtilité d’un lien de droit, simultanément considéré comme une dette professionnelle et comme une créance non-professionnelle selon que l’on se place du point de vue du débiteur ou du créancier. En d’autres termes, la loi du 14 février 2022 met en lumière la figure singulière du créancier non-professionnel mais titulaire d’une créance professionnelle, singularité dont la loi ne tient peut-être pas suffisamment compte.
B. Antithèse : ce qu’il n’est pas
9. À partir de la stricte définition prétorienne du « créancier professionnel » au sens des dispositions consuméristes anciennes, il devrait être possible de définir, par antithèse, les personnes qui n’entrent pas dans cette catégorie.
10. Principes : blanc et noir. L’antithèse du « créancier professionnel » est celui « non professionnel » soit le créancier dont la créance est née dénuée de lien avec son activité professionnelle. Tel est le cas, par exemple du prêt d’un ami à un entrepreneur : pareil prêt ne lui confère pas la qualité de « créancier professionnel ». Réciproquement, le prêt de l’entrepreneur individuel à un ami n’en fait pas un « créancier professionnel ». Le raisonnement est invariable : d’abord identifier l’activité du créancier, ensuite l’existence ou non d’un lien entre la créance et cette activité. La déclaration de son activité par l’entrepreneur individuel, à l’occasion de son immatriculation à un registre professionnel, facilite la qualification. Le raisonnement paraît plus simple encore pour une personne morale de droit privé, notamment une société, celle-ci constituant per se et exclusivement un patrimoine affecté de nature professionnelle tandis que son objet social défini statutairement [18] et accessible aux tiers via un Kbis, fixe les contours de son activité. En d’autres termes, une société ne pourrait théoriquement être qu’un « créancier professionnel » tant on imagine mal dans quels cas il pourrait en aller autrement : soit la créance est liée à son objet social et la société est un « créancier professionnel » ; soit elle ne l’est pas et la situation est juridiquement anormale.
11. Difficultés : entre gris clair et gris foncé. Entrer dans le détail des situations conduit évidemment à considérer certaines nuances. Qu’il soit jugé que la cession par un associé de ses titres sociaux ou le remboursement des avances qu’il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que cet associé ait été le gérant de la société cédée si bien que cet associé n’est pas un créancier professionnel et que les dispositions protectrices de la caution ne s’appliquent pas, est logique [19]. Qu’il en aille de même du créancier personne physique qui, ayant cédé des parts lui appartenant dans le capital d'une société commerciale dont il est le gérant, agit en paiement du prix de cession, ce qui retentit sur les modalités de calcul de l’intérêt légal, ne choque pas [20]. Quid cependant de l’entrepreneur individuel qui, se prêtant au rôle de business angel, prête de l’argent à une société nouvelle opérant en-dehors de son propre secteur d’activité ? Est-il un créancier professionnel ? Son activité de business angel pourrait être qualifiée d’accessoire de sa profession principale. S’agissant des personnes morales, que l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), dont l’objet est la fourniture à ses adhérents de la garantie financière légalement exigée pour exercer l’activité d’agent de voyages, quand bien même son activité est non lucrative soit considérée comme un créancier professionnel ne heurte pas [21]. Une association au sens de la loi du 1er juillet 1901 peut donc être considérée comme un créancier professionnel dès lors que la créance se rattache à son objet… peu important le défaut de professionnalisme de ses dirigeants. Quid de la société commerciale qui prête une somme d’argent à une autre dans le cadre d’un prêt inter-entreprises [22] ? Peut-elle être considérée comme un « créancier professionnel » [23] ? La question mérite d’être posée. Encore n’évoque-t-on pas l’épineuse application de cette qualification à la société civile immobilière [24]… finalement tranchée dans le sens de la négative par la troisième chambre civile de la Cour de cassation [25].
12. La qualification de « créancier professionnel » dépend en somme de l’appréciation du lien entre la créance et l’activité professionnelle du créancier : lien direct et principal ou indirect car accessoire ? La première option, plus stricte, paraît préférable, la reconnaissance du statut de « créancier professionnel » entraînant en effet des sujétions auxquelles les autres créanciers échappent.
II. Se comporter
13. La reconnaissance de la qualité de « créancier professionnel » retentit notablement sur le comportement attendu de ce dernier à l’égard de son débiteur. Cela se traduit plus précisément par une densification de ses diligences soit positivement, soit négativement. En d’autres termes, plus qu’un autre créancier, celui « professionnel » s’oblige (A) et s’abstient (B).
A. Être obligé de
14. Si la densification des obligations du « créancier professionnel » se constate aux différents stades de la relation contractuelle le liant à son débiteur [26], elle est particulièrement nette en amont et en aval de la relation.
15. En amont. Il s’agit sans doute de la marque principale du « créancier professionnel ». Alors que toute partie qui entend contracter est tenue à une obligation d’information portant sur les éléments ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties [27], le « créancier professionnel » est par ailleurs obligé à un devoir de conseil. Absent du Code civil, posé par la jurisprudence et développé dans le cadre des règles de déontologie, le devoir de conseil est impérativement mais exclusivement attendu du « créancier professionnel », singulièrement du banquier évidemment. Ce dernier peut même être tenu à un devoir de mise en garde, en présence d’une caution personne physique, lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier [28]. Rappelons que ce devoir de mise en garde, d’origine prétorienne, a un domaine qui excède la seule conclusion d’un cautionnement pour concerner tous les cas d’octroi d’un financement par un établissement de crédit [29]. Devoirs de conseil et le cas échéant de mise en garde constituent de véritables injonctions professionnelles : on ne saurait mieux montrer la densification des obligations du « créancier professionnel » en amont de la relation le liant à son débiteur.
16. En aval. La qualité de « créancier professionnel » oblige à prendre des précautions particulières quand est envisagée la rupture d’une relation contractuelle à durée indéterminée ou s’inscrivant dans la durée. Ces précautions s’imposent au vrai à tous, créanciers peu important leur qualité, voire débiteurs [30]. Elles sont cependant exacerbées par le droit spécial de la concurrence qui sanctionne la fameuse « rupture brutale » d’une relation commerciale établie [31]. L’article L. 442-1, II, alinéa 3, du Code de commerce N° Lexbase : L6216L8Q dispense certes de préavis l’auteur de la rupture en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations mais le juge a précisément estimé que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constituait pas per se, une faute grave autorisant une rupture sans préavis [32]. On remarquera que l’expression « relation commerciale établie » conduit à exclure du domaine du texte de nombreux créanciers professionnels à l’image de ceux du secteur libéral médical [33] et de certains professionnels du droit [34]. Ceux-ci sont donc soumis au droit commun ou à des règles spéciales, déontologiques [35] voire légales. Tel est le cas des établissements de crédit ou les sociétés de financement, le cœur de la catégorie « créancier professionnel », lesquels sont tenus de respecter les prescriptions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L2507IX7, notamment un délai de préavis de 60 jours a minima, quand ils envisagent de réduire ou de supprimer les concours accordés à une entreprise. Si les textes sont épars, le principe est cependant clair : un « créancier professionnel » est bien tenu à des diligences particulières quand il envisage de rompre une relation contractuelle ancrée dans la durée.
B. S’abstenir de
17. Reconnaître la qualité de « créancier professionnel » doit conduire son titulaire à une certaine modération dans ses rapports avec son débiteur. La loi impose ponctuellement pareille modération : le créancier est ainsi tenu de limiter son droit de créance et, en principe, obligé de limiter son droit de gage.
18. Limiter son droit de créance. Le Législateur a naturellement conscience que le « créancier professionnel » est généralement en position de force dans la relation contractuelle. Le droit commun des obligations tente certes d’instaurer un équilibre entre les parties. Reposant sur une logique abstraite, le droit civil ignore cependant la réalité des rapports de force dont d’autres branches du droit se font au contraire l’écho. Le « créancier professionnel » devrait par principe s’abstenir d’abuser de sa position de force envers son débiteur pour étendre excessivement son droit de créance envers lui. La règle est expressément énoncée s’agissant du cautionnement souscrit par une personne physique envers un « créancier professionnel », manifestement disproportionné [36]. Elle rencontre de nombreuses manifestations dans d’autres dispositions légales. La disproportion [37] voisine ainsi avec le « déséquilibre significatif » [38] dans l’énumération des pratiques restrictives de concurrence, lesquelles impliquent forcément un créancier professionnel [39]. Un certain nombre d’actes, susceptibles d’être annulés s’ils ont été conclus en « période suspecte » rendent également compte de cette obligation du « créancier professionnel » de ne pas abuser de sa position et de limiter son droit de créance [40]. Reste naturellement la plus emblématique des dispositions, soit celle déclarant « abusives », dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » [41]. Emblématique car une des premières dispositions légales attirant l’attention sur le statut particulier du « créancier professionnel » [42], sur les risques d’abus liés à ce statut… et sur l’injonction implicite qui lui est faite de s’abstenir.
19. Limiter son droit de gage. C’est bien encore de modération dont il est question quand est envisagé le droit de gage du créancier professionnel sur l’entrepreneur individuel. On sait que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers [43]. Il s’agit déjà d’une limite en soi. La loi du 14 février 2022 en a institué une seconde quand le débiteur est un entrepreneur individuel : ce dernier n’est en principe tenu de remplir son engagement à l’égard des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel [44]. Si la loi envisage la nature de la créance et non du créancier, ce sont naturellement des « créanciers professionnels » qui seront principalement concernés par cette limitation. N’est-ce pas, du reste, en raison d’une telle assimilation que la loi a particulièrement encadré les conditions d’une renonciation par l’entrepreneur individuel au bénéfice du cloisonnement patrimonial légal [45] ? Le Législateur avait sans doute en tête le cas du banquier faisant renoncer l’entrepreneur individuel au bénéfice de la protection légale… Au renfort de cette analyse, il n’est pas anodin de constater que les mesures de protection du renonçant s’inspirent du droit de la consommation : formes prescrites à peine de nullité, délai de réflexion de sept jours… En d’autres termes, nonobstant la qualité de « professionnel » de l’entrepreneur individuel, la loi s’inscrit, quoiqu’imparfaitement, dans un schéma mettant en présence un « créancier professionnel » et une personne physique, pareil schéma imposant du premier des devoirs supplémentaires envers le second et notamment celui de se modérer.
***
20. En conclusion. Parvenu au terme de cette brève étude, une simple esquisse du portrait-robot de « créancier professionnel » est proposée, comme des règles qui lui seraient spécialement dédiées. L’étude serait donc à parfaire. En passant, on ne peut toutefois manquer d’être frappé par deux situations. La première est celle du créancier non professionnel dont la créance présente un caractère professionnel pour l’entrepreneur individuel. Celui-là sera-t-il au fait des subtilités affectant son gage sur celui-ci ? On peut en douter si bien que prévoir, de lege ferenda, une information particulière de ce créancier « profane » contractant avec l’entrepreneur individuel serait opportun. La seconde situation est le traitement uniforme des créanciers du débiteur défaillant au sens du livre VI du Code de commerce. Il est ainsi surprenant de constater que tous les créanciers, professionnels ou non, sont soumis à une unique discipline collective. Il paraît discutable de soumettre aux mêmes règles de déclaration des créances par exemple, une banque rompue aux usages des affaires et l’ami désintéressé quoique créancier de l’entrepreneur. La césure, à approfondir, pourrait ainsi aboutir à un traitement différencié de la situation du créancier, selon son statut. Le « créancier professionnel » est ainsi une expression féconde, en quête d’une qualification et d’un régime dédié.
[1] G. Cornu, Vocabulaire juridique, Puf, Quadrige, 2002, V° CRÉANCIER.
[2] C. civ., art. 1163, al. 1er N° Lexbase : L0883KZQ : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future ».
[3] C. civ., art. 1103 N° Lexbase : L0822KZH : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
[4] G. Cornu, op. cit. V° PROFESSIONNEL, ELLE.
[5] G. Cornu, op. cit. V° PROFESSION.
[6] C. consom., art. liminaire N° Lexbase : Z63103TQ : « Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
[7] Elle a ainsi fait une entrée remarquée dans le Code civil, singulièrement dans les dispositions relatives au cautionnement (par ex. : art. 2299 N° Lexbase : L0173L8W, 2302 N° Lexbase : L0153L88, 2303 N° Lexbase : L0154L89 du Code civil), par le truchement de l’ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D).
[8] C. com., art. L. 622-6 N° Lexbase : L3680MBW.
[9] C. mon. fin., art. L. 313-2, al. 2 N° Lexbase : L0226I47: « [Le taux de l’intérêt légal] comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas ».
[10] C’est le cas, par exemple, de l’avocat, dont le traitement des honoraires fait l’objet de dispositions particulières, notamment en cas de contestation : art. 174 et s. du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID.
[11] C. consom., art. L. 331-1, anc. N° Lexbase : L1165K7B et L. 331-2, anc. N° Lexbase : L1164K7A.
[12] C. consom., art. L. 332-1, anc N° Lexbase : L1162K78.
[13] Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-26.630, FS-P+B N° Lexbase : A5284IAX – Cass. com., 27 septembre 2017, n° 15-24.895, FS-P+B+I N° Lexbase : A1400WTZ.
[14] Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-15.910, FS-P+B+I N° Lexbase : A7351EI4.
[15] C. com., art. L. 526-22 et s. N° Lexbase : L3666MBE.
[16] C. com., art. L. 526-22, al. 4 : « Par dérogation aux articles 2284 N° Lexbase : L1112HIZ et 2285 N° Lexbase : L1113HI3 du Code civil […], l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel ».
[17] C. com., art. L. 526-22, al. 5.
[18] C. civ., art. 1833, al. 1er N° Lexbase : L8681LQL et 1835 N° Lexbase : L8682LQM.
[19] Cass. com., 8 septembre 2021, n° 20-17.035, FS-D N° Lexbase : A258944N.
[20] Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-11.845, F-B N° Lexbase : A94367P8.
[21] Cass. com., 27 septembre 2017, préc.
[22] C. mon. fin., art. L. 511-6, 3bis N° Lexbase : L1674MAA.
[23] Il est vrai que la loi précise que le prêt est consenti à titre accessoire à son activité principale.
[24] CA Lyon, 30 janvier 2018, n° 16/02577 N° Lexbase : A0408XC4, JCP N, 2018, 1297, note Th. de Ravel d’Esclapon.
[25] Cass. civ. 3, 17 février 2022, n° 21-12.934, FS-B N° Lexbase : A40677NX.
[26] Le « créancier professionnel » n’a-t-il pas une obligation particulière de « surveiller » le devenir de sa créance face au risque de défaillance de son débiteur ?
[27] C. civ., art. 1112-1 N° Lexbase : L0598KZ8.
[28] C. civ., art. 2299, al. 1er N° Lexbase : L0173L8W..
[29] Par ex. : Cass. com., 1er juillet 2020, n° 19-10.641, F-D N° Lexbase : A55943QA : « La banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de conclusion du contrat, n’est pas, en l’absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde ».
[30] C. civ., 1211 N° Lexbase : L0927KZD : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
[31] C. com., art. L. 442-1, II N° Lexbase : L6216L8Q
[32] Cass. com., 20 septembre 2016, n° 13-15.935, FS-P+B N° Lexbase : A0139R4W.
[33] Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.774, FS-P+B N° Lexbase : A8484DYU – Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-16.139, F-P N° Lexbase : A47444NZ (chirurgien-dentiste et fournisseur de matériel dentaire).
[34] Cass. com., 20 janv. 2009, n° 07-17.556, F-P+B N° Lexbase : A6375EC4 (notaire) – Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-17.905, F-P+B N° Lexbase : A6378KBT (conseil en propriété industrielle).
[35] Décret n° 2005-790, du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, art. 11, al. 3 N° Lexbase : L6025IGA : « À défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet ».
[36] C. civ., art. 2300 N° Lexbase : L0174L8X.
[37] C. com., art. L. 442-1, I, 1°.
[38] C. com., art. L. 442-1, I, 2°.
[39] Désigné comme « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » : C. com., art. L. 442-1, I, al. 1er.
[40] Par ex. : C. com., art. L. 632-1, I, 2° N° Lexbase : L3688MB9.
[41] C. consom., art. L. 212-1, al. 1er N° Lexbase : L3278K9B.
[42] Pour l’application de la qualification de « professionnel » à une association : Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-12.501, F-D N° Lexbase : A22168MZ.
[43] C. civ., art. 2285 N° Lexbase : L1113HI3.
[44] C. com., art. L. 526-22.
[45] C. com., art. L. 526-25 N° Lexbase : L3669MBI.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483277
[Focus] Un avocat peut-il se représenter lui-même ?
Lecture: 11 min
N3088BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Hélène Bornstein, Avocat au barreau de Paris, Médiateur, Directrice scientifique de l'Ouvrage Lexbase "La profession d'avocat"
Le 30 Décembre 2022
Mots clés : avocat • champ d'activité • mandat • partie à l'instance • indépendance • incompatibilité • qualité d'avocat • représentation en justice • représentation obligatoire • se défendre soi-même • se représenter soi-même • article 6-1 de la CESDH
Cette question suggère que devant le juge, l’avocat serait moins bien traité que ses concitoyens puisqu’il ne pourrait pas assurer sa propre défense, alors précisément que sa formation juridique et son expérience lui permettraient mieux que quiconque de se représenter lui-même.
C’est cet apparent paradoxe et les solutions qui lui ont été apportées, tant sur le plan procédural que déontologique, qui sont analysées ici.
La question peut surprendre : pourquoi en effet, interdire à un avocat de se représenter lui-même ?
Certes, le principe essentiel d’indépendance qui régit la profession doit amener l’avocat à se dispenser d’intervenir lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Ce sera le cas notamment lorsqu’il interviendra pour un ou plusieurs membres de sa propre famille, pour un ami très proche, ou pour un compagnon. On admet ici que l'existence de liens personnels entre un client et son conseil ne peuvent que perturber l'indépendance dont il doit faire preuve dans l'exercice de sa mission [1].
Exactement comme le médecin, qui ne doit pas – sauf urgence, naturellement – traiter un proche, car dans le cadre de son exercice, il doit faire preuve d'objectivité vis-à-vis de ses patients, ce qui exige de maintenir avec eux une saine distance.
Mais la recommandation est plus troublante lorsqu’on sait qu’elle concerne également celle de ne pas se traiter soi-même. On imagine bien que le chirurgien ne va pas s’opérer lui-même de la vésicule biliaire, mais pourquoi le cancérologue ne pourrait-il pas suivre et traiter lui-même son propre cancer ?
Et pourquoi imposer à l’avocat de prendre un avocat ?
Celui-ci ne serait-il pas fondé à n’y voir qu’une perte de temps ? (devoir exposer à un autre un dossier qu’il connait sur le bout des doigts) ;
une perte d’argent ? (pourquoi régler des honoraires à un autre alors qu’il peut faire le travail lui-même) ;
et surtout, pourquoi confier sa défense à un moins bon que soi !?
D’autant que devant la plupart des juridictions, la représentation n’est pas obligatoire.
Alors, si devant ces juridictions, les justiciables sont autorisés à plaider pour eux-mêmes, comment justifier qu’il en soit autrement pour les avocats, sauf à les priver de leurs droits – notamment civiques – les plus élémentaires ?
Tant sur le plan de la procédure que sur le plan déontologique, des réponses ont été apportées à ces questions qu’il convient d’analyser ici.
I. Sur le plan strictement procédural
On l’a vu, sur un plan strictement procédural, la question n’a d’intérêt qu’en présence des juridictions devant lesquelles la représentation est obligatoire, puisque rien ne s’oppose à ce qu’un avocat plaide pour lui-même devant une juridiction sans représentation obligatoire.
Lorsque les parties sont tenues de constituer avocat devant une juridiction, un avocat, partie personnellement au litige, ne peut, en principe, se constituer au soutien de ses propres intérêts.
C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Paris le 29 septembre 2015 [2]. Un avocat avait régularisé pour lui-même une déclaration d'appel et avait élu domicile en son propre cabinet. La cour d'appel a prononcé l'annulation de sa déclaration d'appel au motif que l’avocat qui s'était ainsi constitué pour lui-même, ne pouvait assurer sa propre représentation, puisque la représentation en justice implique l'existence d'un mandat donné à cet effet à un avocat distinct de la partie représentée. La cour en a conclu que l'irrégularité de l'acte d'appel, consistant dans le défaut de pouvoir se représenter lui-même, a pour conséquence, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, un défaut de représentation effective de l'appelant, c’est-à-dire une irrégularité de fond ne pouvant être couverte que dans le délai permettant de régulariser cet acte.
La cour n’a pas expressément visé les dispositions de l’article 1984 du Code civil N° Lexbase : L2207ABD mais celles-ci prévoient en effet que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant, et en son nom. Du représentant ou du représenté, du mandant ou du mandataire, l’un des deux manquait – sans jeu de mot – à l’appel. Celui-ci était donc irrecevable.
Même analyse par le juge administratif : Au visa des articles R. 431-2 [LXB= L9938LAC] et R. 811-7 N° Lexbase : L8941LDI du Code de justice administrative, et sur le fondement du principe d'indépendance de l'avocat, un avocat agissant en son nom propre ne pouvait assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il était personnellement partie [3].
« Ces textes impliquent nécessairement que l'avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne soient pas en cause dans l'affaire, et font obstacle à ce qu'un requérant exerçant la profession d'avocat puisse, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du Code de justice administrative » [4].
Il a tout de même été jugé, au sujet de la rémunération de l’aide juridictionnelle, que si par principe, un avocat ne peut se représenter lui-même, les dispositions des articles R. 811-7 et R. 431-2 du Code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle assure sa propre représentation dans le cadre de la contestation d'une décision juridictionnelle ayant statué sur la demande qu'il avait présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 [5], ou lorsque l'avocat entend contester la décision prise par le Président de la juridiction sur le montant de la contribution de l'État à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle assurée par l'avocat [6].
Mais le Juge européen ne semble pas l’avoir entendu de cette oreille, et a rendu en 2014 une décision intéressante : un ressortissant serbe, exerçant la profession d’avocat, avait introduit une action contre un client en paiement de ses honoraires. Sa requête avait été rejetée sur le fondement de la législation nationale selon laquelle un appel soulevant des points de droit ne pouvait être introduit que par les avocats représentant les parties au procès, même si ces dernières exercent la profession d’avocat. L’avocat a donc saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) au titre d’une atteinte à son droit d’accéder à un tribunal, alléguant que l’interprétation excessivement stricte de la loi nationale, selon laquelle le ministère d’avocat est obligatoire dans les cas d’appel soulevant des points de droit, l’avait empêché de bénéficier d’un examen au fond de son affaire.
Sur le fondement de l’article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) N° Lexbase : L7558AIR, qui reconnaît à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou de bénéficier de l’assistance du défenseur de son choix, la CEDH l’a suivi, et a conclu à la violation de l'article 6-1 de la CESDH en estimant d'une part, que le requérant pouvait assurer la défense de ses propres intérêts puisqu'en qualité d'avocat, il était qualifié pour former un recours pour le compte d'autrui, et d'autre part, qu’une l'interprétation stricte de l'article 6-1 par le juge national ne répondait pas aux objectifs de sécurité juridique ou de bonne administration de la justice [7].
En d’autres termes – et on en revient à nos propos introductifs – puisqu’en tant qu’avocat, il effectue quotidiennement cette diligence pour ses clients, le requérant était capable de former un appel soulevant des points de droit pour son propre compte. Son recours ne pouvait donc être déclaré irrecevable au seul motif qu’il n’était pas présenté ou soutenu par un autre avocat.
II. Sur le plan déontologique
Si cette solution est intéressante, elle ne règle pas tout. Bien au contraire, elle pose questions à plusieurs égards.
Ainsi, cet avocat constitué et plaidant pour lui-même est-il dans cette procédure une partie ou un avocat ?
Cette question d’apparence anodine a de réelles conséquences, en premier lieu sur sa relation avec son contradicteur : les échanges et correspondances qu’il aura avec l’avocat de la partie adverse seront-ils couverts par la confidentialité ?
Cet avocat/partie plaidera-t-il en robe ?
Et en matière pénale, l’avocat/partie aura-t-il accès à l’entier dossier d’instruction ?
Consciente de ces difficultés, la profession a toujours tenu à rappeler à quel point elle est attachée au principe d’indépendance.
Il a donc été jugé que s'il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité d'avocat et celle de secrétaire d'une association, le principe d'indépendance interdit à l'avocat qui cumule ces titres d'être le conseil de l'association dont il est lui-même le secrétaire [8].
Et que s'il n'existe aucune incompatibilité formelle pour un avocat de plaider pour une société dans laquelle il détient des intérêts, la proximité existante est de nature à compromettre son indépendance [9].
Alors, si rien dans les textes n’interdit en effet à l’avocat de se représenter lui-même – en tout cas devant les juridictions sans représentation obligatoire – l'exigence d'indépendance attachée à la profession d’avocat, et dont elle est le socle, devrait à elle seule le dissuader de se constituer pour lui-même, que la représentation soit obligatoire ou non.
C’est exactement ce qu’a jugé la CEDH dans un arrêt qu’elle a rendu cette fois en matière pénale, considérant que le droit de se défendre soi-même ou de bénéficier de l’assistance du défenseur de son choix n’était pas absolu, et qu’il pouvait faire l’objet de certaines limitations inhérentes notamment aux intérêts de la justice.
Ce dossier était très particulier puisque le requérant-avocat qui souhaitait assurer sa propre défense avait été suspendu de son Barreau au moment des faits, de sorte qu’il ne comparaissait pas comme avocat, mais comme « accusé formé à la profession d’avocat » [10].
S’étant vu refuser la possibilité d’assurer lui-même sa propre défense dans son pays d’origine, le Portugal, la CEDH a jugé que l’impossibilité pour un accusé de se défendre seul dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à son encontre ne violait pas l’article 6 de la CESDH au motif notamment que l’obligation d’être représenté par un avocat n’a pas pour but de restreindre la capacité de défense du requérant, mais de lui garantir l’assistance effective d’un professionnel du droit expérimenté, compétent et objectif, dans une matière où était encourue une peine privative de liberté.
Surtout, la CEDH ajoute – et c’est sans doute cela le plus important – qu’un accusé formé à la profession d’avocat peut ne pas être capable de défendre sa cause de manière effective et dépassionnée si les accusations le visent personnellement.
La voilà la vraie justification !
Même les meilleurs n’hésitent pas à recourir aux services d’un confrère lorsqu’ils ont affaire à la justice. Et pas seulement en matière pénale.
Et ils sont de moins en moins nombreux à se sentir capables d’assurer leur propre défense devant un conseil de discipline. Leur réputation et leur carrière sont en jeu, ils comparaissent par conséquent de plus en plus souvent accompagnés d’un confrère.
Naturellement, la solution dépend de la nature et de l’importance du litige. C’est ainsi que l’auteur de ces lignes a pu il y a vingt-cinq ans, sans craindre d’enfreindre sa déontologie, assigner en résolution du contrat de vente – et donc de plaider pour lui-même devant le tribunal d’instance local – une grande enseigne qui lui avait fourgué un ordinateur qui ne répondait ni à sa commande ni à ses attentes. Le montant du litige portait sur moins de … 3 000 francs à l’époque, et rien de justifiait qu’il embarrasse l’un de ses confrères en lui demandant de mener à sa place cette insignifiante procédure.
Mais la main du chirurgien tremble lorsque c’est son fils qu’il opère.
Alors non, l’avocat ne doit pas se représenter lui-même.
Parce que se concentrer sur sa défense rend le reste difficile, parce que pris par sa propre défense, ses autres dossiers pourraient en souffrir.
Parce que si l’on fait son travail avec soin et application pour ses clients, il arrive qu’on le néglige quand l’objet nous revient.
Parce que l’absence de recul et d’objectivité dont fait preuve l’avocat dans son propre dossier constitue évidemment un obstacle majeur à une défense efficace.
Parce que même le meilleur avocat n’a pas la distance nécessaire pour analyser froidement tous les aspects de son dossier.
Parce que rien ne justifie de se priver d’un œil extérieur, surtout lorsqu'il est avisé.
Au-delà de l’indépendance, c’est sans doute également la prudence qui doit commander à l’avocat de ne pas se représenter lui-même.
[1] Commission de déontologie de Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n° 19.8290, 1er mars 2010.
[2] CA Paris, 29 septembre 2015, n° 13/15894 N° Lexbase : A2916RK9.
[3] CE, 22 mai 2009, n° 301186, Manseau, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1803EHA.
[4] De l'impossibilité pour un avocat d'assurer sa propre représentation devant le juge, Quotidien, Lexbase, 1er juin 2009 N° Lexbase : N4508BK8.
[5] Loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique N° Lexbase : L8607BBE.
[6] CE, avis, 18 janvier 2017, n° 399893, Pollono, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3272S93. Cette solution ne vaut pas devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation, où l’avocat à la Cour, et donc pas avocat aux Conseils, ne pourra pas assurer sa propre représentation (en dehors des cas de dispense de ce ministère expressément prévus) (CE 28 janvier 2021, n° 433994, Boukara N° Lexbase : A85354DH : B. Seiller, note, Gazette du Palais, 8 juin 2021, n° 21/2021, p. 39).
[7] CEDH, 11 février 2014, Req. 30671/08, Maširević c/ Serbie.
[8] Commission de déontologie de Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n° 131/20.7569, 22 septembre 2010.
[9] Commission de déontologie de Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n° 131/22.4690, 28 mars 2012.
[10] CEDH, 4 avril 2018, Req. 56402/12, Correia de Matos c/ Portugal N° Lexbase : A0011XKM.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483088
[Brèves] Action en diminution de loyer en cas d’erreur sur la mention de la surface habitable : attention, délai de forclusion !
Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2022, n° 21-19.212, FS-B N° Lexbase : A12978ST
Lecture: 2 min
N3248BZC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laure Florent
Le 16 Novembre 2022
► Le délai de quatre mois prévu par l'article 3-1, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur.
Pour rappel, l’article 3-1, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH prévoit, notamment, que lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. Pour agir en diminution de loyer, à défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.
En l’espèce, les preneurs d’une maison à usage d’habitation, se prévalant d'un écart entre la surface mentionnée au bail et celle mesurée par eux, ont, après vaine demande à la bailleresse, assigné cette dernière en diminution de loyer et en paiement de diverses sommes.
La cour d’appel (CA Bordeaux, 27 avril 2021, n° 19/03446 N° Lexbase : A47104QI) a déclaré irrecevable, comme tardive, leur demande en diminution de loyer, et les a condamnés à payer un arriéré locatif.
La cour d’appel a énoncé que le délai de quatre mois prévu par l’article 3-1 précité était un délai préfix de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur, soit un délai en principe insusceptible d’interruption ou de suspension, ce que les preneurs ont contesté : selon eux, ce délai était un délai de prescription. Ils pouvaient donc se prévaloir d’une cause d’interruption du délai de leur action.
La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel : le délai de quatre mois est bien un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur.
Dès lors, en l’espèce, après avoir constaté que les preneurs avaient demandé à la bailleresse de réduire le loyer le 18 août 2017 et que l'assignation avait été délivrée le 5 février 2018, soit plus de quatre mois plus tard, elle en a exactement déduit que cette demande était irrecevable (sur la sanction de l’action en diminution de loyer tardive, v. notre brève Irrecevabilité de l’action en réduction de loyer intentée hors délai, Lexbase Droit privé, octobre 2022, n° 920 N° Lexbase : N2941BZX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483248
[Brèves] Pénalité financière : contestation devant la juridiction de Sécurité sociale, sans saisine préalable de la commission de recours amiable
Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2022, n° 21-12.759, F-B N° Lexbase : A29138SP
Lecture: 2 min
N3286BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 16 Novembre 2022
► Il résulte des articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du Code de la Sécurité sociale que la contestation de la pénalité financière notifiée à un professionnel de santé est portée devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu de saisir, au préalable, la commission de recours amiable.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle de sa facturation, un hôpital s’est vu infliger une pénalité financière par la caisse primaire d’assurance maladie. L’établissement de santé a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour annuler la pénalité financière, l'arrêt relève que l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale
La décision. Statuant sur le pourvoi de la caisse contre la solution de la cour d’appel, la Haute juridiction casse et annule cette dernière. Il ressort de l’article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0843IZA que la pénalité est motivée et « peut être contestée devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale ». La cour d’appel a dès lors violé les articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5246KW9 en faisant de la saisine de la commission de recours amiable un préalable à la contestation de la pénalité financière.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483286
[Brèves] Conformité des dispositions permettant au médecin d’aller à l’encontre de directives anticipées inappropriées à la situation du patient
Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022 N° Lexbase : Z489892L
Lecture: 3 min
N3250BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 16 Novembre 2022
► Les mots « lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » figurant au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-232, du 11 mars 2020, relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, sont conformes à la Constitution.
La saisine. Le Conseil constitutionnel a été saisi de la question de la conformité des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4870LWB (CE référé, 19 août 2022, n° 466082, inédit N° Lexbase : A68868ER, voir notre brève N° Lexbase : N2498BZK) :
« Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d' investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ».
Les requérants reprochent à ces dispositions de permettre à un médecin d’écarter les directives anticipées par lesquelles un patient a exprimé sa volonté que soient poursuivis des traitements le maintenant en vie. Selon ces derniers, ces dispositions ne seraient pas entourées de garanties suffisantes dès lors que ces termes seraient imprécis et conféreraient au médecin une marge d’appréciation trop importante, alors qu’il prend sa décision seul et sans être soumis à un délai de réflexion préalable.
Il en résulterait une méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, dont découlerait le droit au respect de la vie humaine, ainsi que de la liberté personnelle et de la liberté de conscience.
Pour l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, association intervenante, ces dispositions instaureraient en outre une différence de traitement injustifiée entre les personnes en été d’exprimer leur volonté sur l’arrêt d’un traitement et celles qui n’ont pu l’exprimer que dans des directives anticipées.
La décision. Pour prononcer la conformité des dispositions en cause, le Conseil constitutionnel énonce que :
- en permettant au médecin d’écarter des directives anticipées qui ont pu être rédigées à un moment où la personne ne se trouvait pas encore confrontée à la situation particulière de la fin de vie, le législateur a entendu garantir le droit de toute personne à recevoir les soins les plus appropriés à son état et assurer la sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie ; ces dispositions ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif poursuivi ;
- les dispositions ne sont ni imprécises ni ambiguës ;
- la décision du médecin est prise à l’issue d’une procédure collégiale, inscrite au dossier médical et portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou à défaut, de sa famille ou de ses proches ;
- la décision du médecin est soumise, le cas échéant, au contrôle du juge.
Au regard de ces énonciations, le législateur n’a méconnu ni le principe de sauvegarde de la dignité humaine ni la liberté personnelle, et, par conséquent, la liberté de conscience ni le principe d’égalité devant la loi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483250
[Brèves] Application des règles de représentation équilibrée femmes-hommes aux élections partielles des membres du CSE en cours de mandat
Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2022, n° 21-60.183, F-B N° Lexbase : A12888SI
Lecture: 3 min
N3247BZB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 16 Novembre 2022
► Les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes sont applicables en cas d’élections partielles des membres du comité social et économique en cours de mandat.
Faits et procédure. Un protocole d'accord préélectoral est signé entre une société et trois organisations syndicales en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de la société, prévoyant un collège unique, les proportions de femmes et d'hommes dans ce collège étant respectivement de 28,1 % et de 71,9 %, douze postes étant à pourvoir. Les élections se sont tenues courant 2019.
Le nombre de membres titulaires ayant été réduit de moitié, la société a organisé en 2021 des élections partielles afin de pourvoir six postes de titulaires et douze de suppléants.
| Pour rappel. Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (C. trav., art. L. 2314-10 N° Lexbase : L8500LGW). |
Un syndicat a déposé une liste de quatre candidats tant pour les titulaires que pour les suppléants, composée uniquement d'hommes. À l'issue du second tour, ont été élus sur ces listes un titulaire et trois suppléants.
La société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de l'élection de M. X et M. Y, au motif que les listes sur lesquelles ils ont été élus ne respectent pas les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes.
Le tribunal judiciaire accède à la demande de la société et annule l'élection de M. X en tant qu'élu titulaire et celle de M. Y en tant qu'élu suppléant, intervenue lors des élections partielles. Le syndicat forme un pourvoi en cassation.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette ce pourvoi.
Le tribunal judiciaire, qui a relevé que le syndicat avait présenté, en vue des élections partielles des membres du comité social et économique de la société, des listes incomplètes composées de quatre hommes et constaté que ces listes comportaient un homme en surnombre au regard de la proportion de femmes et d'hommes figurant dans le protocole d'accord préélectoral établi pour les élections initiales, en a déduit qu'il convenait d'annuler l'élection du dernier élu du sexe surreprésenté, soit M. X sur la liste des titulaires et M. Y sur la liste des suppléants.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, L'organisation d'élections partielles, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1922GAG. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483247
[Jurisprudence] Exonération pour cession d’un logement autre que la résidence principale et formalisme
Réf. : CAA Marseille, 6 octobre 2022, n° 20MA02805 N° Lexbase : A51178NT
Lecture: 7 min
N3251BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jérôme Mazeres, Fiscaliste - Diplômé en gestion de patrimoine, Les fourmis du patrimoine
Le 15 Novembre 2022
Mots-clés : plus-value immobilière • résidence secondaire • exonération • cession • logement
La cour administrative de Marseille est revenue dans un arrêt du 6 octobre 2022 sur le formalisme nécessaire pour bénéficier d’une exonération pour cession d’un logement autre que la résidence principale.
1.-L’article 150 U, II-1° bis du Code général des impôts N° Lexbase : L4526MBA permet de bénéficier d’un régime d’exonération de la plus-value immobilière en cas de première cession d’un logement et de ses dépendances immédiates, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession.
2.-L’application de ce régime de faveur implique de réinvestir une partir du prix de cession dans un délai de 24 mois dans l’acquisition ou la construction d’un logement, affecté dès son achèvement ou son acquisition, à son habitation principale.
3.- Pour l’application de ce régime d’exonération, l’article 41 duovicies-0 H à l’annexe III du Code général des impôts N° Lexbase : L1449IU9 précise les mentions que doit porter l’acte de cession du logement.
Celui-ci doit mentionner :
- l'identité du bénéficiaire de l'exonération ;
- les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;
- la fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ;
- le montant de la plus-value exonérée.
4.- Ces mentions doivent être indiquées pour chacun des bénéficiaires de l’exonération.
5.- L’article 150 VG, III du Code général des impôts N° Lexbase : L2566IYP précise qu’en cas d’exonération totale, celle-ci étant notamment fondée sur ce dispositif, il n’y a pas lieu de déposer une déclaration de plus-value immobilière (2048 IMM). En revanche, en cas d’exonération partielle, cette déclaration est à déposer.
Cet article précise également que l’acte doit préciser la nature et le fondement de l’exonération ou de l’absence de taxation, sous peine de refus d’enregistrement.
6.- Si les conditions de formes visées à l’article 41 duovicies-0 H à l’annexe III du Code général des impôts ne sont pas respectées, et plus particulièrement si l’acte de cession ne fait pas mention de l’exonération, le cédant peut-il bénéficier du régime d’exonération ?
La cour administrative d’appel de Marseille s’est positionnée le 6 octobre 2022 sur cette question.
7.- Dans cette affaire, Madame D avait vendu un bien immobilier situé à Sanary-Sur-Mer le 27 avril 2012. L’acte de cession précisait que la cession entrait dans le champ d’application du régime des plus-values immobilières. L’acte de cession comportait en annexe la déclaration n°2048-IMM.
Celle-ci a réinvesti le produit de la cession dans l’acquisition de sa résidence principale.
En effet, le 16 juillet 2013, elle achète un autre bien immobilier qui constituera sa résidence principale.
Madame a sollicité le 26 mars 2014 l’application du régime d’exonération visé à l’article 150 U, II-1° bis du Code général des impôts.
8.- L’administration fiscale a rejeté celle-ci au motif que l’acte de cession ne répondait pas aux conditions de forme édictées par l’article 41 duodevicies-0 H de l’annexe III du Code général des impôts.
Le tribunal administratif de Toulon donne raison à l’administration fiscale le 5 juin 2020.
Madame interjette appel.
C’est ainsi que l’affaire est portée devant la cour administrative d’appel de Marseille.
9.- L’instruction du dossier permet d’établir que les conditions d’application de ce dispositif étaient effectivement remplies.
En effet, Madame a été locataire d’un logement au titre des quatre années de référence. Le bail, les quittances de loyer et les factures d’électricité permettent d’attester qu’il s’agissait de sa résidence principale. En outre, le prix de cession a été réemployé intégralement dans l’acquisition dans le délai de 24 mois de sa résidence principale.
10.- Le fond du problème portait donc sur la possibilité de solliciter l’application de l’article 150 U, 1° bis du Code général des impôts par voie de réclamation.
La cour administrative d’appel de Marseille confirme qu’il est possible de solliciter l’application de ce dispositif par voie de réclamation, dès lors que cette demande est effectuée dans le délai de réclamation.
11.- Il est vrai que ni l’article 150 U, II 1° bis du CGI, ni l’article 150 VG, III du Code général des impôts ne subordonnent explicitement l’application du régime d’exonération à une condition de forme. Cependant, les commentaires administratifs visés au BOI-RFPI-PVI-10-40-30 n° 160 précisent : « L’exonération s’applique sur demande du cédant par une mention portée dans l’acte de cession, conformément au III de l’article 150 VG du CGI ».
12.- Cette décision est intéressante car elle semble se heurter au positionnement d’autres juridictions du fond.
À ce titre, nous pouvons notamment relever la position de la cour administrative d’appel de Douai. « Ces dispositions doivent ainsi être regardées comme faisant obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire ces informations, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession, quand bien même il justifierait satisfaire aux autres conditions requises pour y prétendre ». (CAA de Douai, 23 avril 2019 n° 17DA01449 N° Lexbase : A3012ZB8).
| Lire en ce sens, F. Laffaille, À propos de la lecture restrictive des dispositions de l’article 150 U du CGI (1° bis du II), ou de la réclamation, Lexbase Fiscal, mai 2019, n° 783 N° Lexbase : N8893BXN. |
La CAA de Douai a ainsi pris une position contraire.
13.- Plus récemment encore, le tribunal administratif de Paris7 adoptait un jugement dans le même sens que la CAA de Marseille (TA de Paris, 31 mars 2021, n° 1916052). Les conclusions de Madame la rapporteure publique Marie Prevot demeurent particulièrement intéressantes.
Madame Prevot relève notamment que la lettre du texte ne subordonne pas son application à une option pour le bénéfice de celle-ci.
Elle en profite à ce titre pour faire le lien avec d’autres dispositifs qui eux nécessitent la réalisation d’une option ou la matérialisation d’un engagement spécifique.
14.- Elle fait notamment le lien avec l’application de l’article 238 quindecies du Code général des impôts N° Lexbase : L8929MCP (exonération en fonction de la valeur des éléments cédés) qui nécessitent la réalisation d’une option.
À ce titre, il convient de rappeler que plusieurs arrêts ou jugements confortent la possibilité d’opter pour ce régime dans le cadre du délai de réclamation.
15.- Au vu de l’opposition des juridictions du fond, qui en fait consiste à déterminer si la mention dans l’acte de cession de l’option pour l’application de l’article 150 U, II 1°bis du CGI constitue une condition de son application. Il sera intéressant dans l’avenir d’avoir un positionnement du Conseil d’État afin de voir cette discussion prendre fin, afin d’améliorer la sécurité juridique du cédant quant au bénéfice de son exonération.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483251
[Brèves] Travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover : ce n’est pas une charge déductible !
Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 460113, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68498PD
Lecture: 2 min
N3271BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 18 Novembre 2022
► Il résulte, d’une part, des articles 13, 28 et 31 du CGI, d’autre part, des articles L. 262-1, L. 262-2, L. 262-4 et R. 262-9 du CCH que, dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover, le prix des travaux devant être réalisés par le vendeur est un élément du prix d’acquisition de l’immeuble ;
Dès lors, le coût de ces travaux, qui ne sont pas des charges de propriété, ne peut, pour la détermination du revenu net être déduit des revenus fonciers provenant de la location du bien ainsi acquis.
Les faits :
- les requérants ont déduit de leurs revenus fonciers, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015, le prix des travaux réalisés sur un bien immobilier situé à Bayonne acquis le 28 novembre 2014 dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover ;
- ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Bordeaux a rejeté leur appel contre le jugement du TA de Toulouse ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années après remise en cause de cette déduction (CAA Bordeaux, 4 novembre 2021, n° 19BX03720 N° Lexbase : A72927DG).
Pour refuser aux requérants la déduction du prix des travaux effectués dans un immeuble récemment acquis de leurs revenus fonciers, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que ces travaux avaient été menés dans le cadre d'un contrat de vente d'un immeuble à rénover, dont le prix d'acquisition, comprenant celui des travaux, constituait une dépense en capital qui ne pouvait être considérée comme une charge déductible des revenus fonciers des acquéreurs.
Raisonnement validé par le Conseil d’État.
Le pourvoi des requérants est rejeté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483271
[Pratique professionnelle] L’entretien d’évaluation : atouts et points de vigilance
Lecture: 17 min
N3261BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Laurence Boulanger, Avocat associé et Maud Wintrebert, Avocat, cabinet Fromont Briens
Le 16 Janvier 2023
Mots-clés : entretien • évaluation • critères d’évaluation • méthodes d’évaluation • atouts de l’entretien d’évaluation • RGPD et évaluation • entretien et risques psychosociaux • évaluation et CSE • salariés protégés et évaluation • compte rendu d’évaluation
En dépit des vives critiques qu’il a pu essuyer et bien que quelques grands groupes internationaux l’aient abandonné au profit de méthodes considérées comme plus fluides (Feedbacks réguliers, évaluation par projet…), l’entretien d’évaluation professionnelle demeure une pratique toujours très répandue à ce jour.
Entre outil de management incontournable pour les uns, étape désuète pour les autres, mais toujours incontestablement ancrée au sein de la majeure partie des entreprises, comment le pratiquer en toute vigilance et l’utiliser au mieux de ses atouts ?
I. L’entretien d’évaluation est-il obligatoire ?
Principe : aucun texte légal ne prévoit l’obligation pour l’employeur d’organiser un entretien d’évaluation.
Facultatif, il s’agit d’un droit reconnu de l’employeur d’évaluer ses salariés en vertu de son pouvoir de direction.
Exception : l’organisation d’un entretien d’évaluation peut être rendue obligatoire lorsqu’un accord collectif (de branche ou d’entreprise) l’impose ou lorsqu’il existe un « usage » ou une décision unilatérale en la matière non dénoncé.
À titre d’illustration, la Convention collective nationale de la banque N° Lexbase : X8100APP, la Convention collective nationale des agences de voyages et du tourisme N° Lexbase : X8249AP9 ou encore celle du Notariat N° Lexbase : X8396APN prévoient une telle obligation pour l’employeur.
Ainsi, avant toute chose, dès lors qu’il est abordé la question de l’entretien d’évaluation professionnelle, il convient de vérifier l’existence de dispositions conventionnelles applicables et d’auditer les pratiques existantes au sein de l'entreprise en la matière.
| 🔎 Le saviez-vous ? Il est possible, selon nous, de réserver l’entretien à une certaine catégorie de salariés, sous réserve de pouvoir justifier cette différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes. Lorsqu’il est institué, l’entretien d’évaluation s’impose au salarié concerné, sous peine de sanction disciplinaire (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-42.368, F-D N° Lexbase : A1175AZK), lequel doit « répondre de bonne foi aux questions posées » (C. trav., art. L. 1222-2 N° Lexbase : L0809H9T). |
II. L’évaluation professionnelle est-elle recommandée ?
L’évaluation des salariés apparait indispensable à plusieurs égards.
Elle contribue :
- au respect par l’employeur de son obligation générale d’adaptation des salariés à leur poste de travail et au maintien de leurs capacités à occuper leur emploi [1] ;
- au respect par l’employeur de son obligation générale de prévention des risques psychosociaux au sein de l'entreprise [2] : éviter les situations d’isolement, moment d’échange privilégié consacré au salarié, reconnaissance du travail accompli, dialogue sur les objectifs fixés...
Elle permet également de justifier et d’objectiver des choix en termes de formation, de rémunération ou d’avancement professionnel et constitue une pièce maîtresse dans le cadre des éventuelles discussions ou des éventuels litiges relatifs à des problématiques de discrimination ou d’égalité de traitement [3].
Elle est, enfin, souvent incontournable dans le cadre du contentieux relatif à une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ou à la définition, le cas échéant, de critères d’ordre en matière de licenciement économique [4].
III. Quel est l’objet de l’entretien d’évaluation professionnelle ?
Méthode parmi d’autres d’évaluation des salariés, il prend la forme d’un échange contradictoire entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique.
Il s’agit d’un bilan sur une période déterminée, usuellement annuelle, lequel doit porter sur l’appréciation des seules capacités professionnelles du salarié et l’atteinte des éventuels objectifs fixés.
| ⚠️ Attention de ne pas le confondre avec :
Ces deux entretiens sont imposés par la loi (C. trav., art. L. 6315-1 N° Lexbase : L7678LQG) et leur absence sanctionnée dans les entreprises d’au moins 50 salariés (la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, instituant l’obligation de mener un entretien professionnel N° Lexbase : L6066IZP, est entrée en vigueur le 7 mars 2014).
Les juridictions veillent régulièrement, en cas de contentieux, à ce que l’employeur respecte distinctement ses obligations en matière d’entretiens (CA Bourges, 19 novembre 2021, n° 21/00002 N° Lexbase : A35427C8 ; CA Amiens, 14 décembre 2021, n° 21/01127 N° Lexbase : A05637GX). Aussi, si l’entretien d’évaluation peut être l’occasion d’aborder la question de la charge de travail du salarié et de son équilibre vie professionnelle/ vie privée ou encore ses attentes en matière de formation, il ne saurait suppléer l’entretien obligatoire en matière de suivi des salariés en forfait-jours ni l’entretien professionnel. Rien n’empêche, toutefois, l’employeur d’organiser, dans un souci de rationalisation des coûts, des entretiens spécifiques durant la même journée ou à la suite, dès lors qu’ils font l’objet de moments et procédures/supports distincts. |
IV. Existe-t-il des conditions de validité de l’entretien d’évaluation professionnelle ?
Les informations demandées à un salarié ne peuvent avoir pour finalité que d’apprécier ses aptitudes professionnelles.
Les évaluateurs doivent ainsi s’interdire de collecter des informations dépourvues de tout lien direct et nécessaire avec l’emploi occupé par le salarié [5].
| Les critères d’évaluation se doivent d’être :
|
L’entretien d’évaluation ne doit ainsi nullement aborder la sphère personnelle du salarié.
Également, il convient d'être vigilant quant aux critères d’évaluation comportementale.
Si les juges du fond admettent leur principe, ils les encadrent toutefois très strictement. Ils doivent être ainsi limités à des catégories de salariés pour lesquels le comportement professionnel fait partie des qualités professionnelles ; être exclusivement en lien avec le travail et cibler une action concrète ; être suffisamment précis.
Il peut s’agir, notamment, de l’organisation, du sens de l’animation d’équipe, de la créativité, du sens du relationnel.
| Exemples : ont été jugés trop imprécis ou rejaillissant sur la sphère personnelle, les critères : « agir avec courage », « faire preuve d’optimisme » (CA Toulouse, 21 septembre 2011, n° 11/00604 N° Lexbase : A9463HXR), « les notions de bon sens », « d’optimisme », « d’honnêteté » (CA Rennes, 2 juin 2022, n° 21/05292 N° Lexbase : A835874C). |
Par ailleurs, le critère de la transparence implique que les salariés soient préalablement informés des techniques et des méthodes d’évaluations retenues [6].
V. Comment appréhender l’entretien d’évaluation professionnelle au regard de la gestion des risques psychosociaux ?
Si l’entretien d’évaluation professionnelle fait partie intégrante des mesures préventives des risques psychosociaux dans l'entreprise, c’est à la condition qu’il soit :
- préparé en amont ;
- réalisé de manière contradictoire et constructive ;
- conduit dans l’écoute et dans des termes choisis et mesurés.
Il est d’évidence qu’aucun propos injurieux, insultant ou discriminatoire ne saurait y être employé.
Par ailleurs, rappelons que le terme « évaluer » signifie dans le langage courant « porter un jugement sur la valeur… ».
Aussi, l’évaluation du salarié peut être source de stress et d’appréhension, d’autant qu’elle est susceptible d’être invoquée à l’appui d’une décision de la Direction en matière de progression salariale ou professionnelle.
L’employeur doit ainsi veiller à ce que l’entretien ne soit pas, à l’inverse, une source démesurée de tensions pour les salariés ni facteurs de risque, étant tenu à l’égard de son personnel, à une obligation de sécurité [7].
| 🔎 Le saviez-vous ? Il a été jugé que constituait un accident du travail la dépression nerveuse d’un salarié, apparue soudainement, deux jours suivant la tenue d’un entretien annuel d’évaluation, au cours duquel son supérieur hiérarchique lui avait fait part de son insatisfaction et de sa future rétrogradation (Cass. civ. 2, 1er juillet 2003, n° 02-30.576, FS-P N° Lexbase : A0610C9H). Également, même si le salarié souffrait d’un état pathologique antérieur, le malaise survenu au cours d’un entretien avec son supérieur hiérarchique a été qualifié d’accident du travail jusqu’à preuve contraire (Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 15-29.411, F-D N° Lexbase : A9485WBW). Il en est de même d’un « choc psychologique » à la suite d’un entretien d’évaluation (CA Versailles, 13 janvier 2022, n° 19/01925 N° Lexbase : A21537IL). |
La formation régulière des managers en la matière, comprenant le rappel des fondamentaux de la tenue d’un entretien d’évaluation et de ses suites, apparait ainsi indispensable. Elle permettra, en cas d’éventuelle mise en cause de la responsabilité de l’employeur, de démontrer la prise en compte de ce facteur de risque et la mise en œuvre des moyens de prévention destinés à éviter sa survenance.
| 🔎 Le saviez-vous ? Les résultats de l’évaluation se doivent, naturellement, de rester confidentiels et ne peuvent être communiqués auprès des collègues de travail. S’ils peuvent faire l’objet de traitements ultérieurs et être complétés par une autre méthode d’évaluation, une comparaison des résultats au regard des meilleurs salariés est à bannir, seule une comparaison à une éventuelle médiane est admise par les juridictions. |
VI. Doit-on porter une vigilance particulière à l’égard des salariés protégés ?
Il convient, effectivement, de faire preuve d’une vigilance accrue en matière d’évaluation des salariés protégés, laquelle s’avère plus délicate que celle des autres salariés.
Pour rappel, le Code du travail prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance à un syndicat, l’exercice de l’activité syndicale ou représentative d’un salarié [8].
De même, au-delà des dispositions légales existantes, depuis le 1er septembre 2022 [9], l’article L. 1132-1 du Code du travail N° Lexbase : L0918MCY prévoit expressément l’impossibilité pour l’employeur de prendre en compte les activités syndicales ou électives pour l’évaluation de la performance des salariés.
Il est ainsi impératif de veiller à ne faire aucune référence au mandat exercé par le salarié (même à titre descriptif ou implicitement) ni à son incidence sur l’activité professionnelle de celui-ci.
Il en découle :
- une interdiction d’évoquer les activités syndicales ou représentatives lors de l’évaluation ;
- une interdiction de prendre en compte les absences du salarié.
Sont, par conséquent, à bannir les références à une disponibilité réduite, à l’absence de prise en charge de toutes les activités liées à son poste de travail, à la difficulté de gérer son emploi du temps en conséquence de l’exercice d’une activité syndicale [10].
| Exemples :
|
.
| 🔎 Le saviez-vous ? Le meilleur moyen de sécuriser l’évaluation des salariés mandatés est la conclusion d’un accord collectif déterminant les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle et la carrière syndicale ou élective (C. trav., art. L. 2141-5, al. 2 N° Lexbase : L2652LI3 et Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-13.529, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6603ZQM) ou de les intégrer dans l’accord GPEC (entreprises de + de 300 salariés). S’agissant des représentants « 100 % », dont le temps de travail peut être intégralement consacré à l’exercice de leur mandat, il est impératif de ne pas les écarter du process d’évaluation sous peine de pratique discriminatoire et de confier l’évaluation au DRH de l’entreprise. |
VII. Comment mettre en œuvre, pour la première fois, l’entretien d’évaluation professionnelle ou opérer un changement significatif de méthodes d’évaluation ?
La mise en œuvre de l’entretien d’évaluation professionnelle ou la modification des méthodes d’évaluation suppose l’information/consultation préalable du CSE au titre de ses attributions générales dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Il s’agit, en effet, d’un dispositif relatif aux conditions d’emploi [11] et portant sur un moyen de contrôle de l’activité des salariés [12].
| À défaut, l’employeur s’expose à un risque de délit d’entrave et une action en justice en référé aux fins de suspension du dispositif d’évaluation des salariés jusqu’à la consultation de l’instance (Cass. soc., 28 novembre 2007 n° 06-21.964, FS-P+B+R N° Lexbase : A9461DZG). En outre, les données issues du dispositif sont inopposables au salarié (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.866, FS-P+B N° Lexbase : A8544DP7 ; Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-11.792, FS-P+B N° Lexbase : A1613Z8A). |
Une fois la procédure d’information/consultation du CSE menée, les salariés de l’entreprise doivent être informés préalablement du principe et des modalités de l’évaluation professionnelle. Il est recommandé à cet égard une information individuelle. Aucune forme n’est imposée, mais un écrit est là encore vivement conseillé à des fins probatoires (une note insérée dans les bulletins de salaire, remise en main propre contre décharge, courriel électronique…).
| 🔎 Le saviez-vous ? Le recours par le CSE à un expert est possible dans les entreprises de plus de 50 salariés si le dispositif d’évaluation projeté entraine d’importantes modifications des conditions de travail des salariés (CA Versailles, 8 septembre 2010, n° 10/02253 N° Lexbase : A0204E9G ; CA Paris, 16 janvier 2012, n° 11/12996 N° Lexbase : A6771IAZ). Un avis négatif du CSE ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre du processus d’évaluation. Il expose toutefois l’employeur à un risque de présomption de faute inexcusable en cas d’accident du travail consécutif à une méthode d’évaluation jugée comme illicite par le CSE ou à l’égard de laquelle il s’est opposé en raison des risques psychosociaux engendrés. |
VIII. Les procédures d’information préalables respectées, existe-t-il un formalisme particulier à l’égard du salarié ?
Aucune procédure particulière ni formalisme n’est prévu par la loi, sauf dispositions conventionnelles contraires.
L’employeur demeure libre dans ses modalités d'organisation (physique ou visio conférence) et sa fréquence.
| Pour des questions probatoires, il est toutefois, recommandé d’adresser au salarié une convocation écrite avec un formulaire « support » adapté à ses fonctions et responsabilités, énonçant les différentes thématiques évoquées, dans un temps suffisamment lointain afin de lui permettre une préparation sérieuse et loyale. |
IX. Un compte rendu d’évaluation est-il nécessaire ?
Le compte rendu d’évaluation n’est également nullement obligatoire, mais vivement préconisé.
Il permet de tracer l’échange intervenu et de disposer d’éléments matériellement vérifiables aux fins d’asseoir des décisions d’individualisation de la rémunération et en cas d’éventuel litige.
Il est, naturellement, d’autant plus probant s’il est revêtu de la signature du salarié. Rappelons à cet égard que le salarié n’a nullement l’obligation de le signer (CA Chambéry, 19 janvier 2010, n° 09/01180 N° Lexbase : A8137EZE ; CA Versailles, 9 octobre 2008, n° 07/03427 N° Lexbase : A3560ERB et CA Paris, 8 février 2011, n° 08/10559 N° Lexbase : A9563GW4).
À l’instar du déroulement de l’échange, prudence dans la rédaction du compte rendu :
- veiller à l’exactitude de la mention du libellé de poste et de l’éventuel secteur géographique, hiérarchique du salarié concerné ;
- éviter toute rédaction pouvant être jugée offensante, subjective ou discriminatoire ;
- retranscrire de manière fidèle la réalité de la situation ;
- proscrire les excès d’optimisme au motif de ne pas vouloir démotiver le salarié, à défaut ensuite de ne plus pouvoir invoquer légitimement des éventuelles défaillances ou insuffisances à l’appui d’une mesure de licenciement. Le compte rendu peut, en effet, être utilisé, tant par le salarié que par l’employeur, à l’appui d’un litige (CA Dijon, 3 mars 2022, n° 20/00115 N° Lexbase : A42537P9) ;
- attention, à l’inverse, en cas de pointements des carences du salarié éventuelles, de ne pas basculer dans le ton comminatoire, sous peine de se voir reprocher une sanction notifiée.
L’employeur ne pouvant sanctionner deux fois le même fait, il sera ensuite dans l’impossibilité de prononcer une sanction ou mesure disciplinaire si le compte rendu est analysé comme une sanction ayant épuisé le pouvoir disciplinaire.
| Ainsi, très récemment, la Cour de cassation a rappelé que la frontière avec le disciplinaire pouvait être vite franchie. Elle a ainsi considéré qu’un compte rendu d’évaluation constituait une sanction dans la mesure où il faisait état non seulement de griefs et d’insuffisances, mais invitait le salarié « de manière impérative et comminatoire et sans délai à un changement complet et total ». Pour la Cour, l’intention de sanctionner était établie par la mise en demeure du salarié contenue de redresser son comportement (Cass. soc., 2 février 2022, n° 20-13.833, F-D N° Lexbase : A52477LW). |
X. L’entretien d’évaluation et le RGPD ?
Le compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle contient, par essence, des données à caractère personnel. Il constitue un traitement de telles données soumis au RGPD dès lors qu’il est automatisé, systématique ou appelé à figurer dans un fichier informatique.
En application du RGPD [13], il convient ainsi notamment de respecter les principes suivants :
- minimisation des données : ne mentionner que les informations « adéquates pertinentes et non excessives au regard de la finalité du traitement » selon la CNIL ;
| Aussi, sont à proscrire les mentions suivantes : numéro de sécurité sociale, date de naissance, adresse du salarié, statut marital… |
- réduire les personnes susceptibles de consulter le compte rendu : seules les personnes habilitées au titre de leurs missions ou fonctions doivent pouvoir accéder aux données d’évaluation ;
- informer le salarié de son droit d’accéder à ce compte-rendu : en cas de demande, il doit lui être adressé une copie intégrale dans « les meilleurs délais » sans dépasser un délai d’un mois [14].
Cette information peut être judicieusement insérée dans le compte rendu dans un encart particulier rappelant les droits issus du RGPD et de la loi « Informatique et Libertés » ;
- veiller à respecter la durée de conservation préconisée par la CNIL : période d’emploi de la personne concernée et archivage en « base intermédiaire » dans la limite de la prescription afin de se prémunir contre une éventuelle action en justice d’un ancien salarié [15]
Alors prêts à évaluer ?
[1] C. trav., art. L. 6321-1 N° Lexbase : L9898LL8.
[2] C. trav., art. L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY.
[3] C. trav., art. L. 1133-1 N° Lexbase : L8177LQW.
[4] CA Lyon, 4 juillet 2019, n° 18/01820 N° Lexbase : A1167ZI3.
[5] C. trav., art. L. 1222-2 N° Lexbase : L0809H9T
[6] C. trav., art. L. 1222-3 N° Lexbase : L0811H9W et art. L. 1222-4 N° Lexbase : L0814H9Z.
[7] C. trav., art. L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY.
[8] C. trav., art. L. 1132-1 N° Lexbase : L0918MCY et art. L. 2141-5 N° Lexbase : L2652LI3.
[9] Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte N° Lexbase : L0484MCW.
[10] CA Bordeaux, 1er juillet 2008, n° 07/03513 N° Lexbase : A1002EDH ; Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-16.655, FS-P N° Lexbase : A5266IAB ; Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 08-40.988, FS-P+B N° Lexbase : A6023EIW.
[11] C. trav., art. L. 2312-8 N° Lexbase : L6660L7S.
[12] C. trav., art. L.2312-38, al. 3 N° Lexbase : L8271LGG.
[13] Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE N° Lexbase : L0189K8I.
[14] Règlement (UE) n° 2016/679, précité, art. 12.
[15] Délibération de la Cnil n° 2019-160 du 21 novembre 2019, portant adoption d’un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion du personnel, art. 7 N° Lexbase : Z985809S.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483261
[Jurisprudence] Clair-obscur sur la convention secrète de déchiffrement des téléphones portables
Réf. : Cass. crim., 7 novembre 2022, n° 21-83.146, B+R N° Lexbase : A04948S4
Lecture: 22 min
N3275BZC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Emmanuel Dreyer, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne
Le 25 Novembre 2022
Mots-clés : entrave à la justice • omission • convention de déchiffrement • téléphone • code de déverrouillage
La Cour de cassation maintient que le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie. Cassant l’arrêt en sens contraire attaqué, elle exige en conséquence de la cour de renvoi qu’elle vérifie si le téléphone au sujet duquel un prévenu a refusé de communiquer son code de déverrouillage était ou non équipé d’un moyen de cryptologie.
1. Solution. Réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé, le 7 novembre 2022, que « le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie ». Elle a reproché en conséquence à une cour d’appel d’avoir relaxé un individu poursuivi pour non-transmission du code de déverrouillage de son téléphone sans avoir au préalable vérifié si le téléphone en cause était équipé d'un moyen de cryptologie et si ledit code de déverrouillage permettait de mettre au clair tout ou partie des données cryptées que le téléphone contenait ou auxquelles il donnait accès.
2. Hors sujet. En premier lieu, on conviendra d’une certaine frustration alors que l’affaire en cause posait une question de principe sur laquelle la Haute juridiction ne revient pas. Il s’agit de déterminer si l’obligation faite à un suspect de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie dont il a connaissance (alors que ce moyen de cryptologie est susceptible d'avoir été utilisé par lui pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit) est ou non conforme au droit de ne pas s’auto-incriminer tel qu’il découle du respect dû à la présomption d’innocence. Pour la Cour de cassation, cette question est tranchée [1]. En effet, la Cour européenne considère que le droit de ne pas s’auto-incriminer « ne s’étend pas à l’usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect » [2]. Notre Haute juridiction ne cherche pas à se montrer plus protectrice. Toutefois, l’arrêt sur lequel elle s’appuie est ancien et peu convaincant [3]. À notre sens, l’interprétation même de cet arrêt peut être discutée car il suppose que l’autorité publique recherche la preuve et non contraigne autrui à l’apporter [4]. Mais tel n’est pas le problème soulevé par le pourvoi en l’espèce. Avec prudence, le procureur général près la cour de Douai s’est tenu éloigné de toute question de principe pour ne reprocher à l’arrêt attaqué qu’une motivation insuffisante, ce dont convient la Cour de cassation dans sa formation la plus solennelle.
3. Faits et procédure. En second lieu, il convient d’expliquer le recours à cette procédure quelque peu exceptionnelle. En l’occurrence, à l’origine de toute l’affaire, se trouve le refus d’un individu placé en garde à vue, à l’occasion d'une enquête ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants, de communiquer aux enquêteurs les mots de passe de deux smartphones découverts en sa possession lors de son interpellation. Cet individu a été poursuivi pour détention et offre ou cession de produits stupéfiants ainsi que pour l’infraction de l’article 434-15-2 N° Lexbase : L4889K8L classée dans le Code pénal parmi les entraves à l’exercice de la justice. Le premier juge l’a condamné pour trafic de stupéfiants mais relaxé pour ce refus de remettre la convention secrète d'un moyen de cryptologie qu’il aurait utilisé pour participer audit trafic. Sur appel du procureur de la République, la cour de Douai a confirmé cette relaxe. Elle a estimé qu'un téléphone portable ne peut être considéré comme un moyen de cryptologie et que le code permettant de déverrouiller l'écran d'accueil d'un téléphone, qu'il s'agisse d'un code chiffré ou d'un ensemble de points à relier dans un sens prédéfini par l'utilisateur, ne peut être qualifié de convention secrète de déchiffrement. En effet, elle a observé « qu'un tel code de déverrouillage de l'écran ne sert pas à décrypter les données contenues dans le téléphone, mais seulement à débloquer l'usage de l'écran, pour accéder aux données contenues dans le téléphone », ce que son procureur général a contesté à l’occasion d’un premier pourvoi. La Chambre criminelle s’est ainsi déjà prononcée dans cette affaire. Après avoir rappelé les textes applicables, elle a jugé que « le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement, si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie » [5]. En conséquence, elle a censuré le premier arrêt attaqué.
L’affaire ayant été renvoyée devant la même cour d’appel autrement composée, celle-ci a refusé de s’incliner. Par arrêt du 20 avril 2021, la cour de Douai a confirmé de plus belle la décision de relaxe au motif « que la clé de déverrouillage de l'écran d'accueil d'un smartphone n'est pas une convention secrète de déchiffrement, car elle n'intervient pas à l'occasion de l'émission d'un message et ne vise pas à rendre incompréhensibles ou compréhensibles des données mais tend seulement à permettre d'accéder aux données et aux applications d'un téléphone, lesquelles peuvent être ou non cryptées ». Un nouveau pourvoi ayant été formé par le procureur général contre cette décision, reprochant à la cour de ne pas avoir tiré les conséquences qui s’imposaient de l’arrêt précédent, la Chambre criminelle a estimé que sa doctrine était en cause et qu’il appartenait dès lors à la Cour de cassation de statuer toutes chambres confondues.
À l’occasion de l’arrêt commenté du 7 novembre 2022, elle réitère sa position. Sans plus faire référence aux articles L. 871-1 N° Lexbase : L4997KKB et R. 871-3 N° Lexbase : L3940KYL du Code de la sécurité intérieure qu’elle avait cumulativement invoqués dans sa précédente décision, elle censure le nouvel arrêt attaqué au visa de l’article 434-15-2 du Code pénal et de l’article 29 de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) N° Lexbase : C15764ZE. Elle réaffirme qu'« une convention de déchiffrement s'entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d'une donnée transformée par un moyen de cryptologie, que ce soit à l'occasion de son stockage ou de sa transmission », ce qui lui permet d’asseoir la solution selon laquelle le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement (dès lors que ce téléphone est effectivement équipé d'un moyen de cryptologie). En conséquence, les parties sont renvoyées devant la cour de Paris. On ignore ce qui a justifié ce choix. Mais on précisera tout de même que cette cour a initialement jugé, dans une autre affaire, elle-aussi, que le code de déverrouillage d’un téléphone n’est pas une convention secrète de déchiffrement [6]. Son arrêt retiendra donc, à son tour, l’attention…
4. Mais que penser ici du nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation ? On pourrait se contenter de renvoyer à notre précédent commentaire dès lors que la réponse apportée par cette Haute juridiction est identique à celle formulée lors du précédent pourvoi. Néanmoins, quelques observations supplémentaires méritent d’être formulées. Elles reviennent à se demander ce qu’est une convention de déchiffrement (I) et si le problème se posait vraiment dans ces termes en l’espèce (II).
I. Qu’est-ce qu’une convention de déchiffrement ?
5. Caractère secret. Au cœur du délit de l’article 434-15-2 du Code pénal apparaît la notion de « convention de déchiffrement ». Ce texte évoque plus particulièrement une convention « secrète » de déchiffrement, un tel caractère renvoyant essentiellement à la fonction que ladite convention remplit. Pour que le chiffrement de données permette de les faire échapper au regard de personnes non autorisées à en prendre connaissance, cette convention doit être réservée aux initiés ; inversement, pour permettre l’accès à ces données, la convention de (dé)chiffrement doit être révélée. C’est même une obligation, pour celui qui la connaît, dès lors qu’un moyen de cryptologie est susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Quiconque pouvant le faire s’abstient d’une telle communication aux autorités judiciaires s’expose désormais à trois ans d’emprisonnement et 270 000 euros d’amende.
6. Tâtonnements. Qu’est-ce donc qu’une convention de chiffrement (ou déchiffrement) ? Aucune disposition légale ne l’indique clairement. L’article 434-15-2 précité ne définit pas les termes qu’il emploie. Par ailleurs, l’article 29, alinéa 1er, de la LCEN, dont il semble pouvoir être rapproché, évoque lui aussi cette notion sans la préciser. Sa première phrase dispose : « on entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète ». Autant dire qu’aucun des deux textes visés ici par la Cour de cassation ne précise la convention de déchiffrement dont la non-remise constitue un délit. La solution peut surprendre au regard du principe de légalité. Mais la surprise est d’autant plus grande qu’ici la Haute juridiction se dispense de viser un autre texte qui contient, lui, une définition. En effet, l’article R. 871-3 du Code de la sécurité intérieure dispose que « les conventions mentionnées à l'article L. 871-1 s'entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données ». Il faut comprendre que les conventions de déchiffrement, au sens de l’article L. 871-1 précité, peuvent correspondre non seulement à des clés cryptographiques mais aussi à toute information permettant la mise au clair de données. Si la référence à l’article L. 871-1 du Code de la sécurité intérieure relatif aux seules réquisitions des agents du renseignement n’aurait pas été pertinente en l’espèce, la référence à son texte d’application aurait pu être utile (l’objet de ces réquisitions ne variant pas suivant qu’elles relèvent de la police administrative ou de la police judiciaire). Il est surprenant qu’une telle référence ait disparu à l’occasion de ce second pourvoi alors que ce texte était expressément visé à l’appui de la première cassation. De toute évidence, la Cour de cassation a voulu être libre de définir la convention de (dé)chiffrement au sens de l’article 432-15-2 comme elle l’entend. Toutefois, la conception qu’elle s’en fait appelle des réserves.
7. Distinctions. En effet, l’élément qui disparaît dans la définition jurisprudentielle pose problème. La Cour de cassation réduit la convention de (dé)chiffrement à un moyen logiciel ou à toute autre information permettant la mise au clair de données transformées par un moyen de cryptologie. Au contraire, on l’a vu, l’article R. 871-3, du Code de la sécurité intérieur distingue en soulignant que la convention de chiffrement peut être entendue aussi bien d’une clé cryptographique (lorsqu’un moyen de cryptologie a été utilisé), que d’un moyen logiciel ou d’une information quelconque (faute d’utilisation d’un moyen de cryptologie) permettant la mise au clair de données. Cette définition s’avère plus large. Il en résulte qu’il peut y avoir convention de (dé)chiffrement non seulement lorsqu’il y a utilisation d’un moyen de cryptologie (la convention correspondant alors à la clé cryptographique) mais aussi en l’absence d’un tel moyen dès lors qu’un code (traité ou non informatiquement) empêche ou permet de prendre connaissance de données. Transposée à l’univers du téléphone, cette définition réglementaire signifie qu’un code de déverrouillage constitue nécessairement une convention (secrète) de déchiffrement. Peu importe que le déverrouillage soit effectué par un moyen de cryptologie ou par un logiciel : tant que le téléphone est verrouillé, les données qu’il contient ne sont pas visibles ; elles le deviennent lorsqu’il est déverrouillé. Il y a donc bien chiffrement au sens de l’article R. 871-3. Mais cela ne signifie pas pour autant que tout code de déverrouillage doit être communiqué à l’autorité judiciaire sur réquisition de celle-ci sous peine de sanctions pénales. En effet, l’article 434-15-2 ne commande, sous la menace de sanctions pénales, que la transmission de la convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie dont ce téléphone serait équipé. Ce qui renvoie bien davantage à la clé cryptographique dont parle l’article R. 871-3 précité qu’au mot de passe [7].
Il s’ensuit que l’affirmation de la Cour de cassation selon laquelle un code de déverrouillage « peut » constituer une clé de déchiffrement si un téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie s’avère inexacte. Certes, tout code de déverrouillage est bien une clé (convention) de déchiffrement mais il n’est pas nécessairement la clé de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Pour qu’un code de déverrouillage soit la clé de déchiffrement d’un moyen de cryptologique, il faut qu’il soit plus qu’un simple mot de passe (une « information » permettant la mise au clair de données). Il faut qu’il soit associé à une clé cryptographique. Ce qui – semble-t-il – est de plus en plus souvent le cas. Mais cela n’autorise pas la Cour de cassation en l’espèce à juger qu’un code de déverrouillage est nécessairement une clé de déchiffrement lorsqu’un téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie. La fonction première d’un code de déverrouillage n’est pas de crypter des données mais d’empêcher l’accès aux fonctionnalités d’un téléphone (et, indirectement, aux données qu’il contient). Tout code de déverrouillage n’est pas ainsi nécessairement associé à une clé cryptographique alors même que le téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie. Le lien fait par l’arrêt entre ces deux questions nous semble abusif. En effet, on peut tout à fait concevoir qu’un code de déverrouillage existe, permettant d’utiliser le téléphone, et qu’une clé cryptographique distincte soit supplémentairement proposée à l’utilisateur de ce téléphone pour protéger les données transmises ou stockées. Dès lors, la formule utilisée par la Cour selon laquelle « le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie » semble bien discutable car elle repose sur une éclipse qui - lorsqu’on en prend conscience - rend la formule tautologique : ce n’est pas tout code de déverrouillage d’un téléphone mobile qui « peut » constituer une clé de déchiffrement mais seulement les codes de déverrouillage auxquels sont associées des clés cryptographiques… lorsque ledit téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie ! Était-il bien utile de se réunir en assemblée plénière pour dire qu’une clé cryptographique suppose l’emploi d’un moyen de cryptologie ?
Si on part du principe que le code de verrouillage et la clé cryptographique sont nécessairement associés lorsqu’un téléphone est équipé d’un moyen de cryptographie, on peut comme la Cour de cassation considérer que la communication de ce code s’impose. Mais c’est postuler un lien qui ne s’impose pas nécessairement. En cela, l’analyse de la cour de Douai était sans doute bien plus exacte, elle qui soulignait que l’on ne pouvait reprocher au prévenu de ne pas avoir transmis son code de verrouillage alors que c’était sa clé cryptographique qui aurait dû lui être demandée.
8. Transition. Au bénéfice de cette observation, il convient de se demander maintenant si, dans cette affaire, le problème n’a pas été mal posé dès l’origine.
II. De quoi est-il question ici ?
9. Rappels. À la lettre, l’article 434-15-2 du Code pénal n’incrimine pas la non-transmission de tout code de déverrouillage des téléphones portables, fort heureusement ! Il n’incrimine que la non-transmission de la clé (secrète) de déchiffrement permettant de mettre au clair les données stockées ou transmises par un téléphone portable lorsque l’utilisateur de celui-ci a activé le moyen de cryptologie dont il est équipé. Ce qui n’est pas du tout la même chose. Pire : pour qu’une sanction pénale soit encourue à ce titre, l’autorité de poursuite doit être en mesure d’établir que ce moyen de cryptologie est susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. On en est loin ici. Au regard des termes de l’article 434-15-2 précité, les juges du fond ont eu raison de considérer que le seul refus par le prévenu de remettre le code de déverrouillage de ses téléphones ne constituait pas un délit.
10. Interrogation. Au cas particulier, ce qui surprend, c’est l’attitude de l’autorité de poursuites qui s’acharne à prétendre le contraire. La guérilla judiciaire qu’elle mène en l’espèce poursuit néanmoins un objectif bien particulier : il s’agit de permettre à la police judiciaire d’aller vérifier le plus simplement du monde le contenu de tous les téléphones portables sans avoir besoin de procéder à une expertise technique parfois longue et toujours couteuse pour craquer le code de déverrouillage (indépendamment de tout cryptage des données). Mais c’est tout de même forcer un peu trop violemment les termes de la loi que d’estimer que tout refus de communiquer un code équivaut à cacher une clé cryptographique. L’efficacité de la répression ne saurait justifier une telle interprétation de l’article 434-15-2. Il en va spécialement ainsi en l’espèce où l’autorité de poursuite prétend poursuivre un refus de transmission sans même avoir établi que les téléphones litigieux étaient dotés d’un moyen de cryptologie. C’est pourtant une condition préalable à l’établissement du délit. Celui-ci ne se conçoit que si un tel moyen a été utilisé afin de préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit (ce qui est encore moins établi à ce stade). Cette preuve incombe au ministère public : le refus de communiquer la clé de déchiffrement ne peut être sanctionné si un tel moyen n’a pas été employé. Or, cette preuve liminaire fait défaut en l’espèce (c’est précisément ce que la Cour de cassation demande à la cour de renvoi de vérifier).
On aurait pu, éventuellement, comprendre le raisonnement consistant à dire qu’un refus de communiquer un code de déverrouillage équivaudrait à un refus de communiquer une clé cryptographique si, au moins, la preuve de l’équipement d’un moyen de cryptologie sur les téléphones avait été établie en l’espèce. La présomption aurait pu reposer alors sur des faits la rendant vraisemblable. Mais cette preuve minimale n’étant pas rapportée ici, l’association des deux s’avère nécessairement excessive. On peut sérieusement se demander si le débat engagé devant la Cour de cassation sur la définition de la « convention de chiffrement » n’est pas un débat purement théorique, les faits constatés ne permettant pas – en l’état – d’établir l’infraction reprochée.
11. Objection. Et c’est en vain que le ministère public pourrait nous opposer que, en l’absence de transmission du code de déverrouillage, il est précisément impossible de vérifier si le téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie et si, en l’espèce, une clé cryptographique a précisément été utilisée pour masquer les données transmises ou stockées, afin de préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Ce que l’on veut bien admettre. Mais un tel raisonnement pêche à sa base.
En effet, la Cour de cassation semble considérer qu’un moyen de cryptologie est désormais installé en série sur tous les téléphones portables (ce qui lui permet de considérer, on l’a vu, que – nécessairement – le code de déverrouillage est associé à une clé cryptographique dès lors qu’un téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie) [8]. C’est aussi le raisonnement implicitement tenu par le procureur général qui indique dans le moyen développé à l’appui de son pourvoi (détail autrement inutile) que les portables en question sont des iPhone 4. Or, si tel est le cas, il n’est pas nécessaire d’avoir accès aux téléphones eux-mêmes pour déterminer si une clé cryptographique est nécessairement associée à leur code de déverrouillage. Il suffit de se référer aux caractéristiques techniques de ces téléphones telles qu’elles sont publiées par leur constructeur. En d’autres termes, il incombe encore et toujours à l’autorité de poursuites (c’est son rôle !) d’établir que tous les téléphones de la catégorie des téléphones litigieux associent nécessairement au code de déverrouillage une clé cryptographique qui permet de masquer, ou mettre au clair, les données que ce type de téléphones transmet ou stocke. C’est le préalable à toute démonstration de l’infraction qu’il importera à l’autorité de poursuite d’effectuer devant la nouvelle cour de renvoi faute de l’avoir fait jusque-là [9].
Il conviendra ensuite au ministère public d’établir que cette catégorie de téléphones a été spécialement choisie à raison d’une telle spécificité pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit car, encore une fois, le simple refus de communiquer le code de déverrouillage d’un téléphone, même équipé d’un moyen de cryptologie, ne saurait être puni sur le fondement de l’article 434-15-2. Or, même en rappelant qu’il n’est pas nécessaire que le moyen de cryptologie ait été effectivement utilisé pour commettre une infraction, dès lors qu’il doit seulement avoir été susceptible de l’être, une telle preuve paraît impossible à rapporter. Ce qui est de nature à calmer nos inquiétudes. Le refus de transmettre ce code devrait pouvoir intervenir sans trop de risque pénal compte tenu de la difficulté à établir que le moyen de cryptologie dont seraient automatiquement équipés les nouveaux téléphones (tous les utilisateurs en ont-ils conscience ?) a précisément été choisi pour commettre une infraction.
12. Conclusion. Beaucoup de bruit pour rien ? Peut-être si les termes de la loi sont respectés, peu importe que ces termes, en l’espèce, la réduisent à l’impuissance.
| À retenir : si un téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie qui est susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, le détenteur de ce téléphone doit transmettre la convention secrète de déchiffrement dont il a connaissance aux autorités judiciaires sur réquisitions de celles-ci. Cela passe, selon la Cour de cassation, par la transmission du code de déverrouillage du téléphone. |
[1] V. aussi Cass. crim., 10 décembre 2019, n° 18-86.878, F-P+B+I N° Lexbase : A1461Z8M : Ph. Conte, obs., Dr. pén., 2020, comm. 27.
[2] CEDH, 17 décembre 1996, Req. n° 19187/91, Saunders c. Royaume-Uni, § 69 N° Lexbase : A8427AWZ.
[3] Depuis lors, la juridiction de Strasbourg a jugé que « le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé » (CEDH, 19 mars 2015, Req. n° 7494/11, Corbet c. France, § 32 N° Lexbase : A8875ND3).
[4] Même si le Conseil constitutionnel a également rejeté l’objection (Const. const., décision n° 2018-696 QPC, 30 mars 2018,N° Lexbase : A9002XIA : Ph. Conte, obs., Dr. pén., 2018, comm. 123 ; M. Lacaze, obs., AJ pénal, 2018, p. 257,).
[5] Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 19-85.984 N° Lexbase : A96163XG : P. Combles de Nayves, obs., AJ pénal, 2020, p. 587 ; E. Dreyer, note JCP G, 2020, 1417.
[6] CA Paris, 16 avril 2019, n° 18/09267 N° Lexbase : A9549Z9K : P. de Combles de Nayves, obs., AJ pénal, 2019, p. 439.
[7] Ce périmètre limité du délit s’explique aisément : le mot de passe, lorsqu’il n’est pas associé à une clé cryptographique, peut être aisément deviné par les services de police technique et scientifique. Il n’en va pas de même d’une clé cryptographique, a fortiori lorsque toutes les données d’un téléphone sont effacées après un nombre limité de tentatives d’accès infructueuses.
[8] Interprétation confortée par le communiqué de presse publié par la Cour à la suite de l’arrêt où l’on peut lire que « certains téléphones sont équipés, dès l’origine, d’un dispositif nommé "convention secrète de déchiffrement", dont le but est de rendre incompréhensibles les informations contenues dans l’appareil ». Il est par ailleurs précisé que « c’est le cas aujourd’hui de la plupart des téléphones portables » [en ligne].
[9] En pratique, une telle preuve sera sans doute bien difficile à apporter car l’iPhone 4 n’a été commercialisé par Appel que de 2010 à 2011. Il n’est pas certain qu’il appartienne à cette génération de téléphones qui sont désormais équipés d’un moyen de cryptologie. D’où sans doute l’insistance de l’autorité judiciaire à exiger le code de déverrouillage sans avoir à démontrer qu’il est adossé à une clé cryptographique…
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483275
[Brèves] Ordonnance de maintien d’une saisie pénale : l’appel conserve son objet tant que la confiscation n’est pas définitive
Réf. : Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 21-86.996, F-B N° Lexbase : A13038S3
Lecture: 3 min
N3290BZU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Helena Viana
Le 23 Novembre 2022
Lorsque le jugement prononçant une peine de confiscation a été frappé d’appel, la juridiction de jugement n’est pas compétente pour statuer sur l’appel contre l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien de la saisie pénale. Cet appel, bien qu’intervenant avant le prononcé de la confiscation, n’est pas devenu sans objet et la chambre de l’instruction demeure compétente pour statuer.
Faits et procédure. Les sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire d’un individu poursuivi pour des faits de fraude fiscale ont fait l’objet d’une procédure de saisie pénale. L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention (JLD) le 22 mai 2020 et autorisant le maintien de la saisie pénale a été frappée d’un appel par le mis en cause.
Entre temps, le prévenu a été condamné par jugement en date du 24 septembre 2021 à la confiscation de sommes à titre de peines principales et complémentaires. Le 18 novembre 2021, la cour d’appel de Versailles, qui statuait sur l’appel formé contre l’ordonnance du JLD, a déclaré sans objet cet appel au motif la chambre correctionnelle ayant prononcé ladite condamnation était désormais saisie de l’appel sur ces confiscations.
Les moyens du pourvoi. En substance le demandeur au pourvoi reprochait aux juges de la chambre de l’instruction de n’avoir pas relevé dans leurs motivations l’absence d’exécution provisoire de la peine de confiscation et d’avoir constaté qu’un appel avait été formé à l’encontre du jugement de condamnation. Partant, le jugement n’était pas devenu définitif et l’appel ne pouvait être déclaré sans objet.
Décision. Au visa des articles 708 N° Lexbase : L5346LCY, 706-141 N° Lexbase : L7245IMB, 706-143 N° Lexbase : L7243IM9, 706-145 N° Lexbase : L7241IM7 et 706-150 N° Lexbase : L7454LPR du Code de procédure pénale la Chambre criminelle casse l’arrêt déféré.
Elle reproche à la chambre de l’instruction d’avoir méconnu les textes susvisés alors qu’elle avait constaté que la peine complémentaire de confiscation ne présentait pas un caractère définitif.
En effet, l’article 708 du Code de procédure pénale subordonne l’exécution de la peine à ce que la décision l’ayant prononcée soit devenue définitive. La Cour de cassation en déduit que l’ordonnance de saisie cesse seulement de produire ses effets, soit lorsque l’ordonnance de mainlevée de la saisie est devenue définitive, soit lorsque la confiscation du bien a été prononcée et est devenue définitive.
Soucieuse d’apporter des précisions quant au moment à partir duquel cette décision devient définitive, elle ajoute que l’article 706-150 du Code de procédure pénale ouvre un délai de dix jours à compter de la notification aux parties pour déférer la décision à la chambre de l’instruction. Passé ce délai, la décision acquiert donc un caractère définitif.
Or, la Haute juridiction constate qu’en l’espèce l’ordonnance de maintien de la saisie pénale rendue par le JLD n’a pas cessé de produire ses effets dans la mesure où le jugement en date du 24 septembre 2021 avait été frappé d’un appel. De fait, la confiscation prononcée par la chambre correctionnelle n’était pas devenue définitive.
Autrement dit, même en présence d’une condamnation à une peine de confiscation, la chambre de l’instruction demeure compétente pour statuer sur l’appel d’une ordonnance duquel elle a été saisie antérieurement à cette condamnation, dès lors que la condamnation n’est pas assortie de l’exécution provisoire ni n’est devenue définitive.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483290
[Point de vue...] Barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 : un barème à contre-temps
Lecture: 23 min
N3265BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Quézel-Ambrunaz, Professeur à l’Université Savoie Mont Blanc, Centre de recherches en droit Antoine Favre, membre de l’Institut Universitaire de France
Le 16 Novembre 2022
Mots-clés : responsabilité • dommage corporel • rente indemnitaire • capitalisation • barème de capitalisation • logiciel de capitalisation • taux • table de mortalité
La Gazette du Palais vient de faire paraître son nouveau barème de capitalisation des rentes des victimes (2022). La nouvelle édition d’un barème, supposée rendre obsolètes les millésimes précédents, devrait être synonyme d’une meilleure adéquation aux réalités socio-économiques du moment. Il n’en est rien pour ce barème de la Gazette du Palais de 2022, qui apparaît terriblement « à contre-temps » ; il est critiquable sur chacun de ses paramètres, qu’il s’agisse du choix du taux, du choix de la table de mortalité, ou de sa présentation sous forme de tableau.
La capitalisation d’une rente indemnitaire doit être, autant que possible, une opération respectant la réparation intégrale du préjudice indemnisé. Cet objectif est atteint si la victime peut, en plaçant le capital sur un support lui offrant toutes les garanties de sécurité, en retirer sa rente selon la périodicité adéquate, la majorant comme s’il s’agissait d’une rente indexée, consommant ce faisant, à la fin de la période indemnitaire, tant le capital que les intérêts qui en sont les fruits.
Afin de calculer le capital, il convient, pour chaque année que compte la période prévisionnelle d’indemnisation :
1/ De chiffrer le besoin de la victime, qui correspond au montant de sa rente augmenté de l’inflation ;
2/ D’actualiser la somme correspondant à ce besoin, en déterminant le montant qu’il convient de placer pour que, augmenté des intérêts, il corresponde au besoin au moment où le retrait sera effectué ;
3/ De multiplier ce montant par la probabilité que la victime soit encore en vie l’année considérée [1], probabilité déterminée par le calcul : 1 - coefficient de mortalité.
Les barèmes de capitalisation présentés sous forme de tableaux, comme celui proposé en 2022 par la Gazette du Palais [2], réalisent ce calcul pour divers âges, pour une rente annuelle de 1 euro, ce qui donne un prix de l’euro de rente. Afin de les utiliser, il suffit de multiplier la rente annualisée octroyée à la victime par le prix de l’euro de rente, ce qui donne le capital à constituer.
Trois paramètres sont donc essentiels à la construction d’un barème : les données relatives à la mortalité, le taux d’inflation, et le taux d’intérêt. La différence entre le taux d’intérêt et le taux d’inflation donne le taux d’actualisation du barème. Toutes choses égales par ailleurs, plus celui-ci est élevé, plus le capital représentatif de la rente est faible. Les barèmes proposés dans la Gazette du Palais 2022 sont donc plus favorables aux victimes que les précédents, ainsi que le montre le tableau suivant, pour une rente annuelle de 10 000 euros : les taux proposés sont de 0 % ou de -1 %.
| Barème utilisé | Femme, 34 ans, rente temporaire jusqu’à 63 ans | Homme, 17 ans, rente pour la vie entière |
|---|---|---|
| Gaz. Pal. 2020, 0,3 % | 272 130 € | 563 800 € |
| Gaz. Pal. 2020, 0 % | 284 430 € | 621 620 € |
| BCRIV 2021, taux variable | 284 600 € | 555 500 € |
| Gaz. Pal. 2022, 0 % | 284 560 € | 625 110 € |
| Gaz. Pal. 2022, -1 % | 331 570 € | 892 230 € |
À propos de ce tableau, il peut être remarqué que :
- sur certaines durées de rente, le barème du BCRIV est plus favorable aux victimes que le barème Gazette du Palais à 0 % ;
- l’accroissement (faible) des capitaux pour les deux barèmes à 0 % s’explique par des tables de mortalité différentes (tables 2017-2019 pour le barème 2022, tables 2014-2016 pour le barème 2020) ;
- les différences de capitaux entre les deux barèmes millésimés 2020 étaient relativement limitées, alors qu’elles sont considérables pour les deux barèmes 2022, qui diffèrent d’un point.
Plus précisément, le graphique suivant représente les écarts entre les prix de l’euro de rente pour la vie entière, selon différents barèmes, pour les femmes :
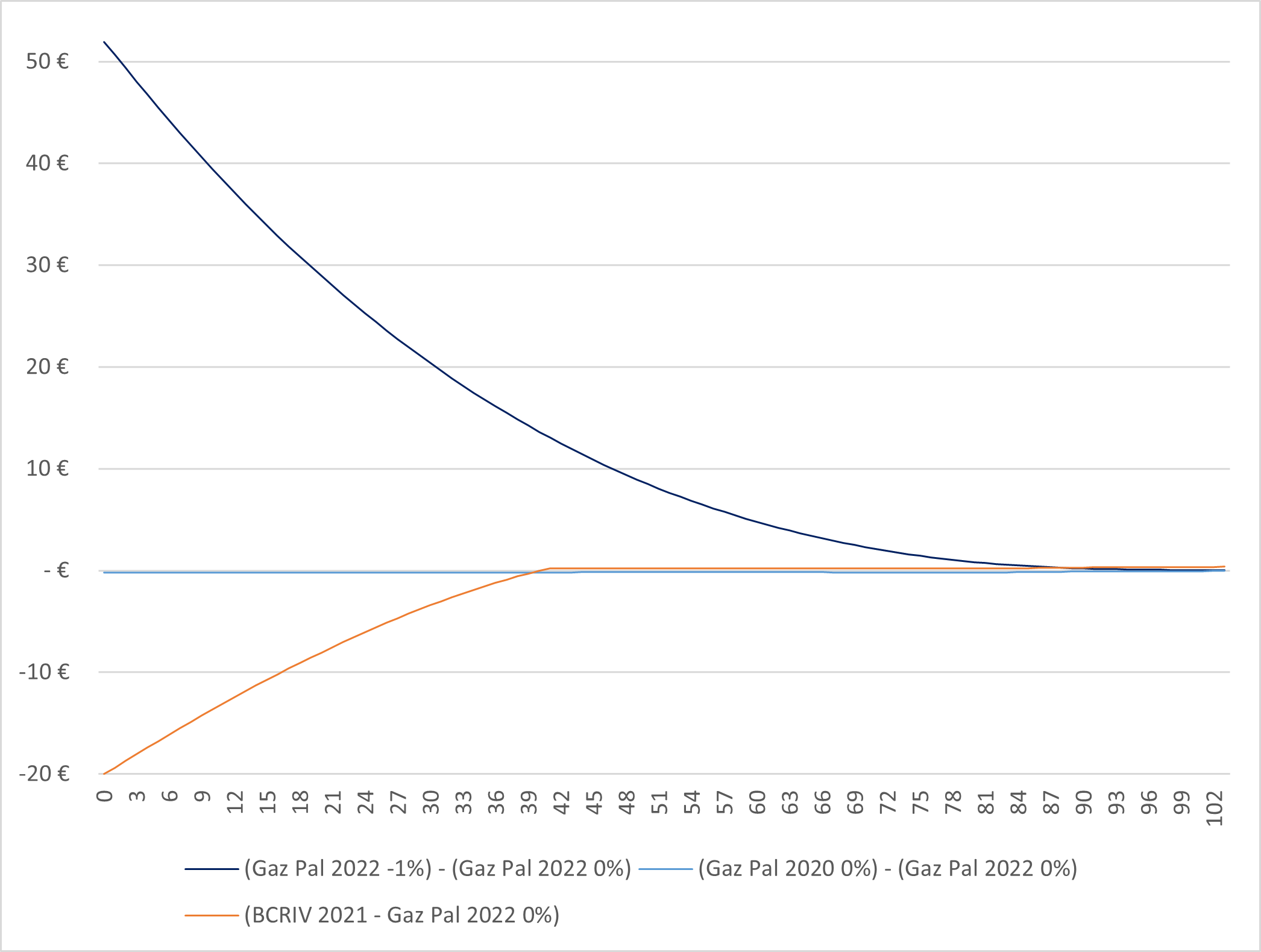
Figure 1 — Différence entre les prix de l’euro de rente pour la vie entière de différents barèmes, selon l’âge à la capitalisation (femmes)
(Lecture de ce graphique et des suivants : lorsqu’une courbe est sous la ligne horizontale correspondant au 0, alors le barème au premier terme de la soustraction est moins favorable à la victime que le barème Gaz. Pal. 2022 à 0%, et inversement lorsqu’elle est au-dessus ; par ailleurs, une courbe qui se trouve au-dessus d’une autre montre que le barème au premier terme de la soustraction est plus favorable à la victime que le barème au premier terme de la soustraction de la courbe se trouvant en-dessous).
Les écarts entre les barèmes sont considérables pour les longues périodes d’indemnisation, mais se resserrent pour les indemnisations plus courtes. Afin que cela soit plus facilement apparent, le graphique ci-dessous omet les jeunes âges.
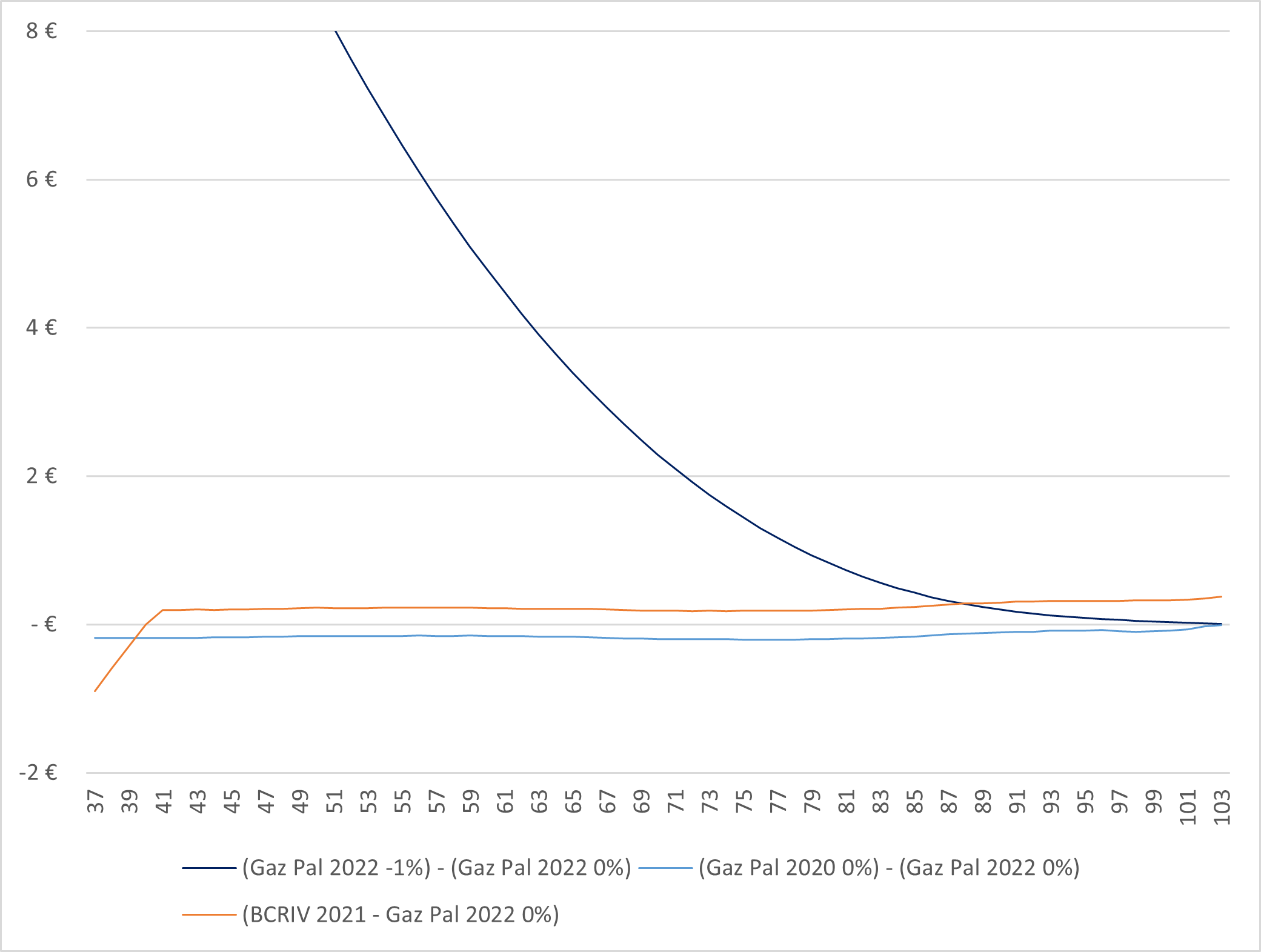
Figure 2 — Différence entre les prix de l’euro de rente pour la vie entière de différents barèmes, selon l’âge à la capitalisation (femmes)
Il apparaît ainsi que, pour les rentes pour la vie entière des femmes :
- le barème de la Gazette du Palais à 0 % de 2022 est toujours plus favorable à la victime que le barème à 0 % de 2020 ;
- le barème de la Gazette du Palais à -1 % de 2022 est toujours plus favorable à la victime que tous les autres barèmes, sauf à partir de 88 ans où le BCRIV est plus favorable ;
- le barème de la Gazette du Palais 2022 à 0 % est moins favorable à la victime de plus de 40 ans, pour les capitalisations pour la vie entière.
Pour les hommes, des constats similaires peuvent être faits :

Figure 3 — Différence entre les prix de l’euro de rente pour la vie entière de différents barèmes, selon l’âge à la capitalisation (hommes)
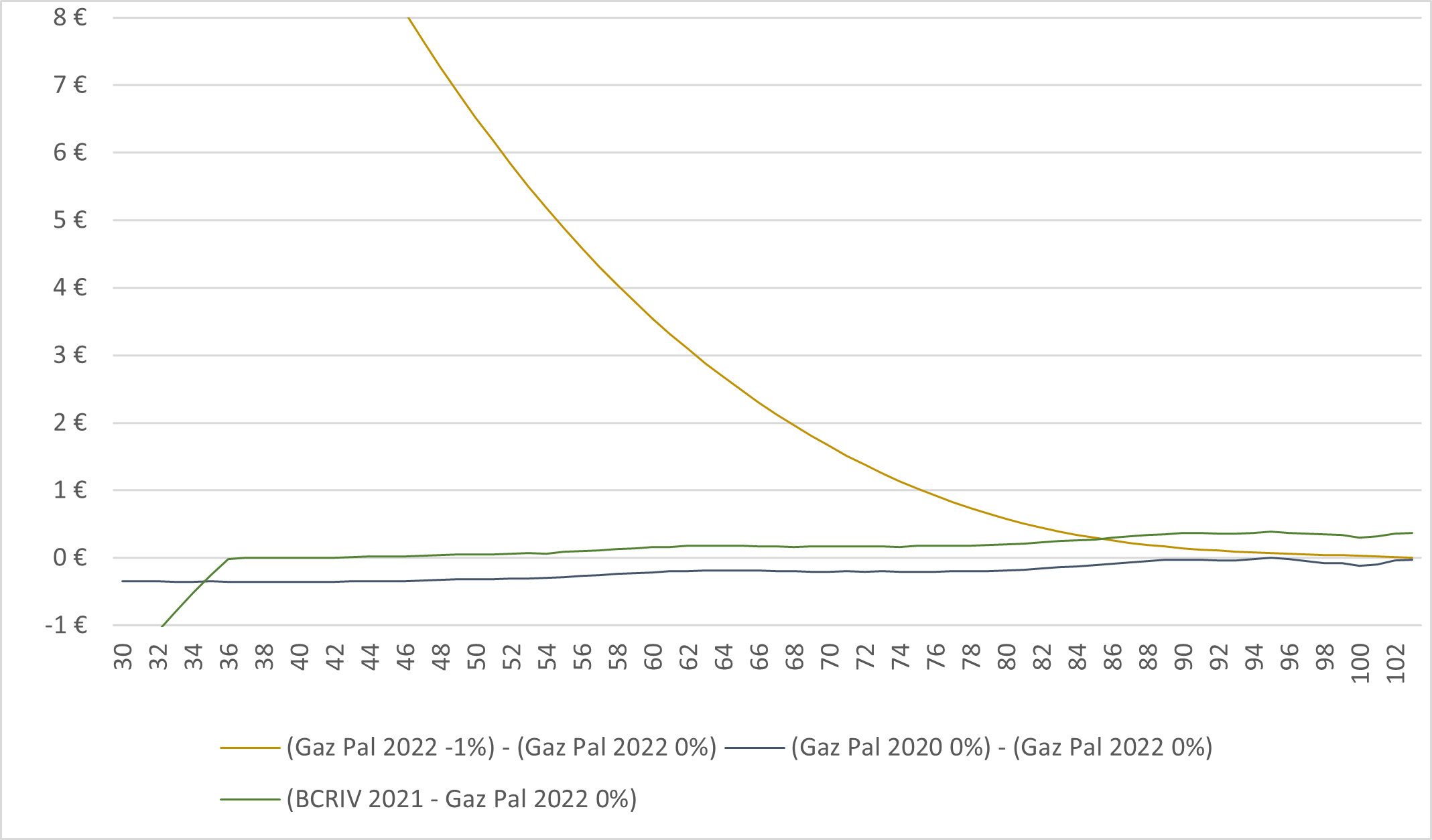
Figure 4 — Différence entre les prix de l’euro de rente pour la vie entière de différents barèmes, selon l’âge à la capitalisation (hommes)
Ainsi, pour les hommes, pour les rentes données pour la vie entière :
- le barème de la Gazette du Palais à -1 % est plus favorable à la victime que tous les autres, sauf au-delà de 83 ans où le BCRIV est plus favorable ;
- le BCRIV est plus favorable à la victime que le barème de la Gazette du Palais 2022 à 0 % dès lors que la victime a plus de 36 ans ;
- des deux barèmes de la Gazette du Palais à 0 %, celui de 2022 est plus favorable à la victime que celui de 2020.
La nouvelle édition d’un barème, supposée rendre obsolètes les millésimes précédents, devrait être synonyme d’une meilleure adéquation aux réalités socio-économiques du moment. Il n’en est rien pour ce barème de la Gazette du Palais de 2022, qui apparaît terriblement « à contre-temps » ; il est critiquable sur chacun de ses paramètres, qu’il s’agisse du choix du taux (I), du choix de la table de mortalité (II), ou de sa présentation sous forme de tableau (III).
I. Le taux du barème
En remontant jusqu’en 2013, il apparaît que chaque mise à jour du barème de la Gazette du Palais amène une baisse du taux d’actualisation (donc, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation des capitaux à allouer). Cette apparente faveur pour les victimes doit être tempérée, car, en réalité, à chaque mise à jour jusqu’en 2020, la méthode a évolué (ce qui a pu être critiqué [3]) pour limiter la baisse de ce taux. Si les méthodes n’avaient pas évolué, la baisse aurait été plus importante jusqu’en 2020, comme le montre le tableau ci-dessous.
| Millésime du barème Gazette du Palais (date de parution) | Méthode de détermination du taux de placement | Méthode de détermination du taux d’inflation | Taux de capitalisation ou d’actualisation | Taux de capitalisation ou d’actualisation selon critères de 2013 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 (mars 2013) | Moyenne du TEC 10 sur 6 mois (2nd sem 2012) | 80 % de l’inflation de 2012 (IPC hors tabac) | 1,2 % | * |
| 2016 (avr. 2016) | Moyenne du TEC 10 sur 12 mois (début dec. 2013 à fin nov. 2014) | Moyenne de 2014 et 2015 (IPC hors tabac) | 1,04 % | 0,94 % |
| 2018 (nov. 2017) | Moyenne du TEC 10 sur 24 mois (début nov. 2015 à 31 oct. 2017) | Moyenne sur 3 ans, 2014 à 2016 (IPC hors tabac) | 0,5 % | -0,06 % |
| 2020 (sept. 2020) | Valeur d’un portefeuille d’assurance-vie | Moyenne 2019 (IPC tabac inclus) | 0,3 % et 0 % | -0,96 % |
| 2022 (oct. 2022) | Moyenne approchée 2021 | 0 % et -1 % | 0,46 % |
Il ressort de ce tableau que si la méthode de l’année 2013 avait été maintenue ne varietur, un taux de -1 % aurait été adopté lors du barème de 2020, mais que celui de 2022 serait revenu dans le positif. Envisageant la possibilité d’un taux de -1 % pour le barème 2020, ses auteurs ont écrit « une telle valeur, expliquée par le niveau artificiellement bas des taux d’intérêt, apparaît peu réaliste pour représenter, dans le contexte économique actuel, la rémunération de ses placements nette d’inflation qu’une victime pourrait attendre » [4], en relevant l’existence de mesures d’assouplissement quantitatif de la BCE. Cette politique monétaire non conventionnelle ayant désormais pris fin, il devrait être considéré a fortiori que les taux négatifs n’ont pas lieu d’être.
La critique ici développée n’est pas liée aux taux négatifs dans l’absolu — dont nous avons par ailleurs, avec d’autres, défendu la pertinence [5] —, elle est liée à la temporalité. Autant un taux négatif aurait dû être acté dans le barème 2020, et ne pas l’avoir fait est une sorte de spoliation des victimes, autant le reconnaître maintenant est dépourvu de sens au point de rendre très peu crédible toute demande qui serait aujourd’hui présentée sur la base du barème à -1 %. Le barème à 0 % semble présenter un taux plutôt faible au regard des taux d’intérêts actuels, mais encourt moins directement la critique.
À la lecture du graphique ci-dessous, il pourrait être objecté que le taux d’actualisation du barème étant la différence entre le temps de placement et le taux d’inflation, il apparaît clairement que cette différence n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui, avec une inflation très supérieure au taux de placement.
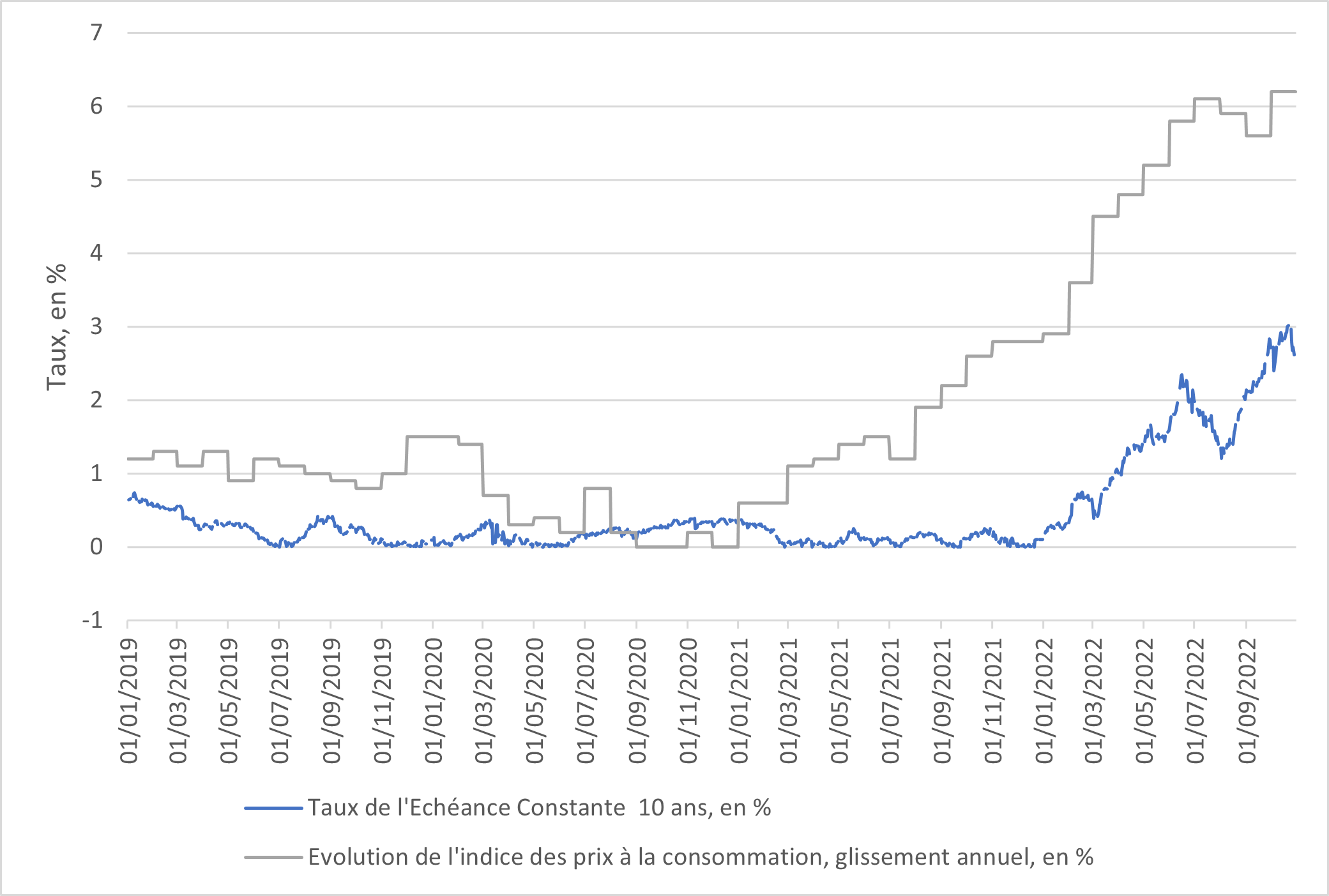
Figure 5 — Comparaison du TEC 10 et de l’inflation. Sources : Banque de France, Agence France Trésor, Insee
Cette objection n’a pas de valeur pour la capitalisation des rentes indemnitaires. La capitalisation n’est respectueuse de la réparation intégrale, cela a été dit, que si la victime peut se servir de sa rente indexée en la retirant de son capital et des intérêts produits. Or le placement du capital est supposé se faire au moment de la liquidation de la réparation, et les évolutions ultérieures du taux de placement sont sans influence pour la victime. En revanche, l’inflation est subie par la victime pendant l’entièreté de la période d’indemnisation, à chaque fois qu’elle retire sa rente de son capital. L’inflation à venir, pendant toute la période d’indemnisation, est à considérer, et non l’inflation instantanée. Les deux indices dont la combinaison permet de déterminer le taux du barème ne doivent donc pas être envisagés dans la même temporalité.
Ainsi, en l’année 2020, le taux de placement était faible ; certes, l’inflation était modérée à faible, mais il était impossible de faire l’hypothèse (d’ailleurs démentie) d’une inflation si faible pendant la durée indemnitaire. En 2022, le taux de placement a considérablement remonté, de telle sorte que le capital placé par la victime sera productif d’intérêts en quantité appréciable. Certes, l’inflation est très élevée, mais personne ne parierait sur le maintien, pendant les décennies à venir, d’une inflation si forte. Les banques centrales ont adapté leur politique monétaire pour la contenir.
L’article 127 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne N° Lexbase : L2426IPK dispose que « l’objectif principal du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé “SEBC”, est de maintenir la stabilité des prix » ; la Banque Centrale Européenne conduit une politique monétaire destinée à maintenir l’inflation à 2 %. Il est donc déraisonnable de considérer une inflation supérieure à 2 % pour construire un barème de capitalisation, car des taux supérieurs ne pourront se maintenir pendant la durée de la période indemnitaire. Or, actuellement, les taux d’intérêt sont supérieurs à cette limite de 2 %, ce qui signifie que, même en soustrayant une inflation inférieure ou égale à 2 %, le taux d’actualisation du barème doit être positif.
Enfin, le taux choisi par la Gazette du Palais est un taux fixe, et non un taux variable, comme le propose notamment le BCRIV. Les auteurs s’en expliquent en ce que la construction de telles courbes « ne fait pas consensus » et est « au moins en partie arbitraire ». Il est aisé de répondre que choisir un taux de référence selon la performance d’une assurance-vie ne fait pas non plus consensus et est au moins en partie arbitraire… Selon le schéma idéal de la victime plaçant l’intégralité de son capital pour en retirer régulièrement sa rente, il s’agit pour elle de choisir des obligations ayant des maturités différentes, correspondant à sa période indemnitaire. Or, il est notoire que le loyer de l’argent est dépendant du temps pendant lequel les sommes sont immobilisées. Si une victime, jeune encore, place une partie de son capital à un horizon de trente ans, elle obtiendra sur cette somme une bien meilleure rémunération que celle correspondant à la fraction placée sur cinq ans. Une courbe de taux (autrement dit, un taux variable selon la durée de la période indemnitaire) a certainement une part d’artifice, mais de manière moins flagrante qu’un taux fixe.
II. La table de mortalité
L’Insee publie chaque année des tables de mortalité ; celles-ci indiquent, pour chaque âge, l’espérance de vie de la personne, et le quotient de mortalité. Le quotient de mortalité représente, pour une population fictive, le nombre de personnes devant décéder dans l’année ; en d’autres termes, il indique la probabilité pour une personne d’un certain âge de décéder avant l’âge suivant. Ce paramètre est déterminant dans la construction des tables de capitalisation, car, pour chaque annuité de rente, le capital représentatif est minoré dans cette proportion.
Les tables de mortalité utilisées pour la construction du barème de la capitalisation de la Gazette du palais sont triennales : en lissant les probabilités de décès sur trois années, les effets mortifères d’événements climatiques ou de pandémies sont dilués. L’Insee propose chaque année des tables de mortalité dites provisoires, dont le millésime est de type n-4—n-1. Ainsi, en 2022, les tables provisoires les plus récentes sont les tables 2018-2021. Trois ans après la parution d’une table provisoire, elle devient définitive, après d’éventuelles corrections. L’expérience montre que ces corrections sont négligeables, ainsi que le montre le tableau ci-dessous. Il compare les quotients de mortalité (pour 100 000 survivants à l’âge indiqué) à quelques âges des années 2014-2016, pour la table provisoire avec des données arrêtées fin décembre 2017, et la table définitive, pour les deux sexes ensemble.
| 10 ans | 20 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | 60 ans | 70 ans | 80 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table provisoire 2014-2016 | 7 | 39 | 57 | 110 | 300 | 711 | 1372 | 3578 |
| Table définitive 2014-2016 | 7 | 39 | 55 | 111 | 299 | 710 | 1365 | 3570 |
| Écart | 0 | 0 | 2/100000 | -1/100 000 | 1/100000 | 1/100000 | 7/100000 | 8/100000 |
Il peut donc être admis que les corrections sont insignifiantes entre table provisoire et définitive, et que la table de mortalité provisoire 2014-2016, qui aurait pu être utilisée pour construire, en 2017, le barème de la Gazette du Palais 2018, donnait une image fidèle des conditions démographiques de l’époque. Toutefois, pour ce barème, ce ne sont pas ces tables qui ont été utilisées, mais les tables 2010-2012, en raison de leur caractère définitif. Le problème est évidemment que celles-ci rendaient bien moins compte de la situation démographique au moment de l’élaboration — et a fortiori, de l’utilisation — de ce barème, ainsi que l’indique le tableau ci-dessous.
| 10 ans | 20 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | 60 ans | 70 ans | 80 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table définitive 2010-2012 | 7 | 47 | 62 | 125 | 340 | 732 | 1399 | 3888 |
| Table définitive 2014-2016 | 7 | 39 | 55 | 111 | 299 | 710 | 1365 | 3570 |
| Écart | 0 | 8/100000 | 7/100000 | 14/100000 | 41/100000 | 22/100000 | 34/100000 | 318/100000 |
L’écart entre la table définitive 2010-2012, choisie pour la Gazette du Palais 2018, et la table définitive 2014-2016, est bien plus important, surtout aux âges avancés, que l’écart entre la table provisoire et la table définitive 2014-2016. En d’autres termes, le recul permet de démontrer qu’au moment de la création du barème de 2018, la représentation la plus exacte de la mortalité était la table provisoire la plus récente, et non la table définitive la plus récente (2010-2012), pourtant choisie par la Gazette du Palais. En période d’augmentation de l’espérance de vie, cela conduit à une sous-indemnisation structurelle des victimes, et à une opération de capitalisation bien approximative.
Pour le barème de 2022, la Gazette du Palais indique adopter la table 2017-2019, qui serait la plus récente à être définitive — alors qu’à ce jour l’Insee indique que cette table est toujours provisoire, données arrêtées au 31 décembre 2021 [6]. Il ne s’agit toutefois pas de la table la plus récente, qui est millésimée 2018-2020.
| 10 ans | 20 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | 60 ans | 70 ans | 80 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table provisoire 2017-2019 | 7 | 38 | 54 | 108 | 288 | 689 | 1342 | 3428 |
| Table provisoire 2018-2020 | 6 | 36 | 55 | 108 | 287 | 684 | 1367 | 3503 |
| Écart | 1/100000 | 2/100000 | 1/100000 | 0 | 1/100000 | 5/100000 | -25/100 000 | -75/100 000 |
Le décalage n’étant ici que d’un millésime, il est peu important, mais néglige l’effet « covid » de hausse de la mortalité aux âges avancés, qui commence à être pris en compte dans les tables les plus récentes.
Quant à cet « effet covid », en recherchant les tables de mortalité abrégées — et en choisissant arbitrairement celle des femmes — le quotient de mortalité selon l’âge atteint dans l’année, pour différents millésimes de tables annuelles, se présente ainsi :
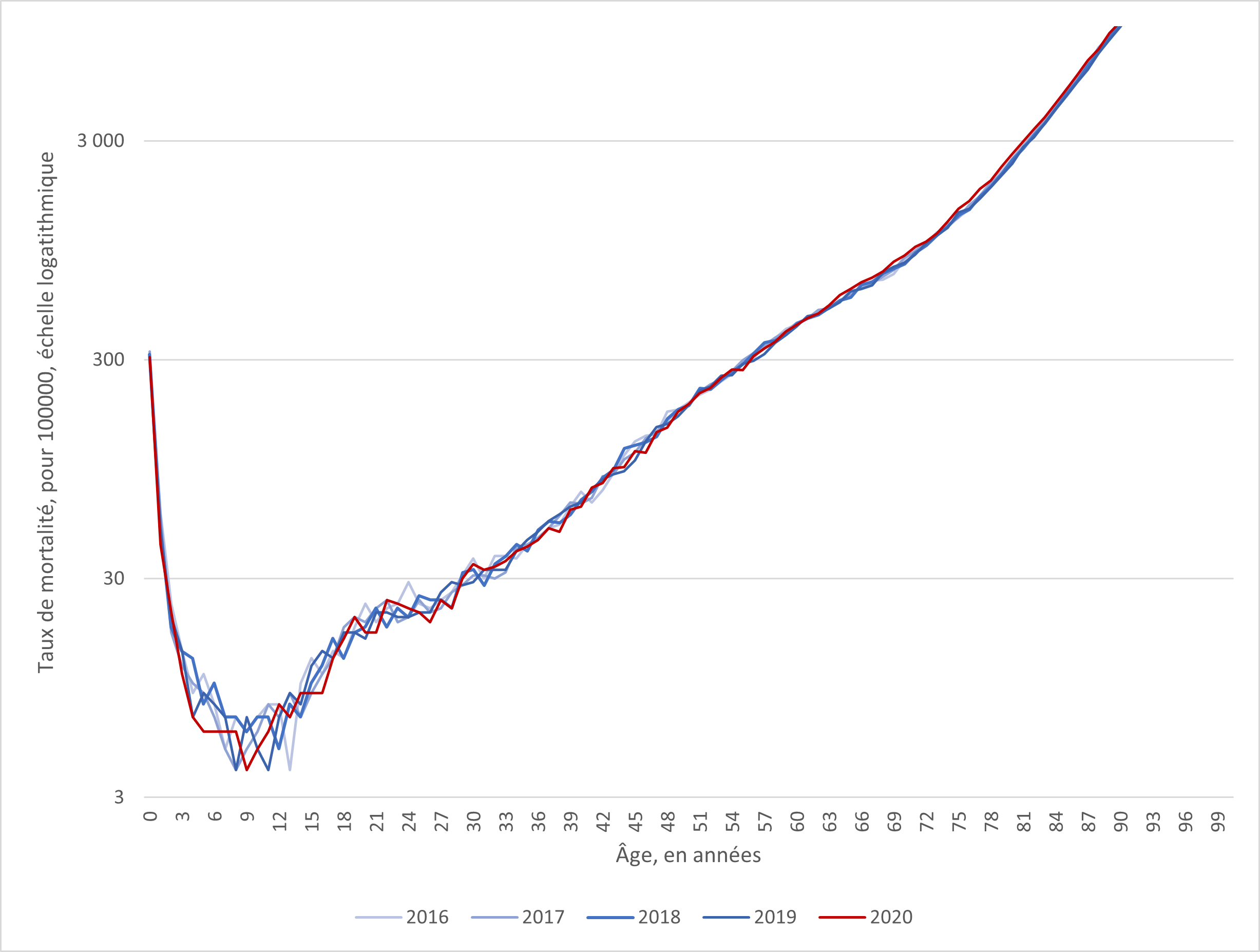
Figure 6 —Quotients de mortalité pour 100 000 survivants à l’âge indiqué —Sexe féminin —Source Insee
Il apparaît que l’année 2020, marquée par le Covid, connaît une mortalité plus élevée que les années précédentes aux âges avancés, mais non aux âges plus jeunes : il ne peut donc y avoir d’argument tendant à adopter volontairement des tables de mortalité non concernées par la surmortalité due à la pandémie pour refléter la situation actuelle de sortie de pandémie.
Les tables utilisées par le barème de la Gazette du Palais sont stationnaires, et non prospectives : cela conduit, dans un contexte de hausse de l’espérance de vie, à un nouveau biais de sous-indemnisation structurelle des victimes. En effet, des tables stationnaires postulent que les conditions de mortalité seront identiques à l’avenir.
Imaginons une femme qui avait 60 ans en 2013, et dont la rente a été capitalisée en 2013, donc sur les tables de mortalité 2006-2008. Cette femme a 69 ans aujourd’hui. La table de mortalité 2006-2008 indique, pour les femmes de 69 ans, un quotient de mortalité de 878/100000. Or, la table la plus récente, indique, pour ces femmes, un quotient de mortalité de 827/100000. En d’autres termes, la probabilité pour qu’une femme de 69 ans décède dans l’année a sensiblement diminué au fil du temps. L’impact est assez important ; d’une part, cette différence augmente avec le temps, et l’exemple pris ne concerne qu’une période de neuf ans ; d’autre part, cette différence se reproduit sur le capital représentant chaque annuité de la rente. Ainsi, en utilisant un logiciel de capitalisation des rentes [en ligne] permettant de choisir entre tables stationnaires et tables prospectives, la capitalisation d’une rente annuelle de 10 000 euros pour une femme de 60 ans, pendant sa vie entière, à un taux nul, correspond à un capital de 30 309,67 euros en utilisant une table prospective, mais de 27 833,12 euros en utilisant une table stationnaire.
Pour réaliser la meilleure capitalisation possible, il faudrait connaître l’évolution à venir de la mortalité. Cela étant impossible, deux possibilités sont concevables : parier sur un maintien de la mortalité à ses niveaux actuels pendant toute la période d’indemnisation, ou parier sur une poursuite de l’évolution de la mortalité sur la lancée des années précédentes. La première branche de l’alternative suppose l’usage de tables stationnaires, la seconde de tables prospectives. Les barèmes de capitalisation de la Gazette du Palais ont fait le pari du statu quo sur la mortalité, car ils sont basés sur des tables stationnaires ; pari perdu depuis leur création, car la mortalité a toujours évolué. À tout le moins, il serait appréciable que cette question puisse être mise dans le débat juridique contradictoire.
Une autre question liée à la mortalité qui mériterait d’être mise dans le débat contradictoire est celle de la capitalisation en rente viagère ou en rente certaine. Capitaliser « en rente viagère » (ce qui ne signifie aucunement « pour la vie entière », mais « sous condition de survie ») revient à prendre en compte, pour le calcul du capital à constituer pour chaque annuité, la probabilité que la victime décède avant cet âge, par l’intégration du quotient de mortalité. Au contraire, capitaliser « en rente certaine » revient à postuler que la victime vivra jusqu’au terme de sa rente, ou jusqu’à l’âge correspondant à son espérance de vie moyenne ou médiane pour les rentes données pour la vie entière. Il est aisé, avec un barème à 0 %, d’apprécier l’effet de cette prise en compte de probabilité de décès. Soit un homme de 45 ans à la liquidation de pertes de gains professionnels jusqu’à ses 65 ans. À un tel taux, si son risque de décès n’était pas pris en compte, il lui faudrait un capital exactement égal à vingt fois sa rente annuelle, pour qu’il puisse se verser les vingt annuités de rente dont il a besoin. Le barème de la Gazette du Palais capitalise en rente viagère, et le prix de l’euro de rente pour un homme de 45 ans jusqu’à 65 ans est de 19,062. En d’autres termes, aurait-il le comportement exactement attendu de lui (placement de l’intégralité du capital au taux prévu par le barème, retrait de la rente indexée…), il lui manquerait à peu près un an d’indemnisation à retirer de sa rente.
En faveur d’une capitalisation en rente certaine, il peut être soutenu que la victime n’est pas « probablement morte » chaque année, mais morte ou vivante, et que, dans le cas où elle survivrait jusqu’au terme prévu de sa rente, elle a été sous-indemnisée, et le juge s’est en quelque sorte contredit en ordonnant une rente, puis une capitalisation qui empêche la victime de se servir ladite rente. En faveur d’une capitalisation en rente viagère, il peut être remarqué que la rente, en dommage corporel, est toujours viagère (c’est-à-dire versée sous condition de survie), et que capitaliser en rente certaine revient à appauvrir indûment le payeur, en postulant que la victime ne pouvait décéder avant le terme de la rente. La question est importante, et il est regrettable que les auteurs d’un barème de capitalisation imposent leur réponse, sans laisser aux parties à une transaction ou à un litige l’opportunité d’en discuter.
Enfin, les tables de la Gazette du Palais sont sexuées (alors que l’Insee propose des tables de mortalité « indifférenciées » en plus des tables sexuées). Certes, le sexe est un déterminant important de l’espérance de vie ; il n’est toutefois pas l’unique facteur documenté par les statistiques [7]. Notamment, le niveau d’études comme le revenu ont un effet important, de telle sorte que nombre d’hommes lisant ces lignes ont une espérance de vie supérieure à celle de bien des femmes. Des discussions risquent de naître autour de la capitalisation des préjudices de personnes transexuelles, intersexes ou non-binaires. Le Conseil d’État a pu valider un coefficient de conversion d’une rente en capital ne prenant pas en compte le sexe [8] : il est possible qu’un juge estime un jour que prendre en compte le sexe est discriminatoire.
III. La présentation sous forme de tableau
Le barème de la Gazette du Palais est maintenu sous forme de tableau, alors même que, depuis l’édition précédente, comme cela a été relevé, un logiciel de capitalisation, paramétré sur les données économiques et démographiques françaises, est accessible en France, celui du Professeur Jaumain, actuaire [9].
Outre la réduction d’éventuelles erreurs de lecture ou de calculs, un logiciel de capitalisation présente plusieurs avantages considérables sur un tableau à double entrée :
- les calculs sont réalisés au jour près, et non selon une approximation à l’année ;
- les dépenses dont la périodicité diffère de l’année (salaires à verser mensuellement, renouvellement pluriennale de matériel médical…) n’ont pas à être annualisées, sachant qu’une telle annualisation est source d’approximations, tantôt en faveur, tantôt en défaveur de la victime ;
- les taux peuvent être personnalisés par l’utilisateur, pour refléter une évolution soudaine du contexte économique, ou pour prendre en compte l’évolution d’indices qui pourraient différer de celui des prix à la consommation (comme le prix du matériel médical, etc.) ;
- davantage de choix (sur la table de mortalité, le type de capitalisation) peuvent être offerts ;
- la capitalisation peut être faite sur deux têtes, ce qui est absolument indispensable pour calculer de manière rigoureuse la perte de revenus des proches consécutivement à un décès ;
- le règlement amiable peut être encouragé, la discussion se faisant sur chaque paramètre du barème de capitalisation, évitant ainsi que chaque partie se crispe sur son barème de prédilection.
Par sa présentation même, le barème de la Gazette du Palais 2022 apparaît encore à contre-temps. Il faut souhaiter que la pratique s’empare du logiciel de capitalisation des rentes existant, et que d’autres fassent leur apparition. S’entend parfois une défiance envers de tels logiciels, en raison de fallacieux prétextes qui cachent mal une velléité de rester dans le confort des habitudes, serait-ce au prix d’approximations regrettables dans la capitalisation. Et au risque que le législateur, ou le juge avant lui, prenant conscience des limites d’une capitalisation trop imprécise, l’interdise tout simplement.
[1] Sauf en cas de capitalisation en « rente certain », voir ci-dessous.
[3] APREF, Dommage corporel : De la pluralité des barèmes de capitalisation vers un barème officiel, octobre 2019 ; et la présentation de l’APREF du 7 décembre 2020.
[4] F. Planchet, G. Leroy, M. Leroueil, Gaz. Pal. 15 septembre 2020, n° 387e0, p. 3.
[5] N. Estienne, A. Guégan, C. Quézel-Ambrunaz, La réparation intégrale maltraitée par les barèmes de capitalisation à 0 %, RCA 2022, p. 7.
[6] Insee, Tableau 68 - Table de mortalité des années 2018 - 2020, données provisoires arrêtées à fin décembre 2021.
[7] Pour ne rien dire ce qui n’entre pas dans les statistiques officielles, comme l’hygiène de vie.
[8] CE, 1re ch., 30 septembre 2019, n° 429423 N° Lexbase : A1215ZQ3 : « qu’alors même que l’espérance de vie des hommes et celle des femmes ne sont, selon les données résultant des tables de mortalité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, pas identiques, [le requérant] n’est pas fondé à soutenir que les dispositions litigieuses seraient contraires au principe d’égalité en tant qu’elles prévoient un coefficient uniforme pour les assurés sociaux, qu’ils soient de sexe masculin ou de sexe féminin, pour fixer le tarif à utiliser afin de déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d’accidents du travail ».
[9] Ch. Quézel-Ambrunaz, Une révolution dans la capitalisation des rentes indemnitaires : l’avènement d’un logiciel de capitalisation, Lexbase Droit privé, janvier 2022, n° 890 N° Lexbase : N0029BZ4.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483265
[Brèves] Sociétés commerciales à capital variable : licéité de la clause statutaire d’exclusion qui ne délimite pas les causes d’exclusion possibles
Réf. : Cass. com., 9 novembre 2022, n° 21-10.540, FS-B N° Lexbase : A12918SM
Lecture: 3 min
N3244BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
Le 16 Novembre 2022
► Il résulte de l’article L. 231-6, alinéa 2, du Code de commerce qu’est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion.
Faits et procédure. Par acte du 7 juillet 2009, un associé a acquis un certain nombre de parts sociales d’une SARL à capital variable, dont l’article 13.3 des statuts stipule que tout associé peut être exclu pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts.
Lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2012, les associés ont donc voté son exclusion. Invoquant alors l’absence d’indication, dans les statuts de la SARL, des motifs d’exclusion d’un associé, ce dernier l’a assignée en annulation de la clause d’exclusion.
Par décision du 17 novembre 2020, la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 17 novembre 2020, n° 18/00065 N° Lexbase : A741434D) l’a débouté de ses demandes de réintégration et de dommages et intérêts aux motifs que la clause d’exclusion prévue dans les statuts de la société n’était pas nulle et que le motif de son exclusion n’était pas non plus abusif.
L’associé a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi au visa de l’article L. 231-6, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L6278AID. Elle énonce qu'est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion.
Dans cette logique, les juges de la Cour de cassation concluent que le moyen invoqué en l’espèce, selon lequel une clause statutaire stipulant la faculté d’exclure un associé n’est licite qu’à la condition qu’elle précise les causes justifiant cette exclusion, n’est donc pas fondé.
Observations. Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation semble revenir sur la question fortement débattue en doctrine de la possibilité d’exclure un associé de la société (v. Les clauses d’exclusion dans les sociétés non cotées, Lexbase Affaires, septembre 2002, n° 39 N° Lexbase : N3994AA8) pour adopter une interprétation large des motifs d’exclusion, en ce sens qu'elle affirme qu’une société commerciale à capital variable peut introduire dans ses statuts sociaux une clause d’exclusion sans avoir à définir, de manière limitative, les causes possibles d’exclusion.
| Pour aller plus loin : v. le commentaire de cet arrêt par B. Saintourens, in Lexbase Affaires n° 736, à paraître le 24 novembre 2022. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483244