[Focus] Cybercriminalité : la qualification pénale de l’utilisation d’un rançongiciel
Lecture: 27 min
N6367BYH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Eliaz Le Moulec, Docteur en droit qualifié aux fonctions de Maître de conférences, Enseignant-chercheur contractuel à l’Université de Rennes 1
Le 24 Février 2021
Mots-clés : rançongiciel • extorsion • cybermalfaiteur • chantage • cryptologie • STAD • sabotage
Le développement de l'activité numérique, au-delà de ses aspects positifs, constitue également le terreau fertile d’une criminalité « violente ». L'utilisation d'un rançongiciel en est une manifestation. La question de sa qualification pénale, en apparence assez simple, recèle en vérité à l'issue d'une analyse du mécanisme du rançongiciel, de redoutables difficultés. Les qualifications envisageables sont nombreuses, mais les règles qui gouvernent les conflits de qualifications semblent pourtant commander de n'en retenir qu'une seule. Au terme de l'analyse, c'est la qualification d'extorsion (C. pén., art. 312-1 N° Lexbase : L7189ALT) qui semble devoir être préférée à des qualifications dont le caractère numérique est pourtant davantage marqué (C. pén., art. 323-1 et s. N° Lexbase : L0870KC9).
1. Le 4 septembre dernier, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), en partenariat avec le ministère de la Justice, a publié un guide de sensibilisation intitulé « Attaques par rançongiciels, tous concernés – Comment les anticiper et réagir en cas d’incident ? » [1]. Cette publication témoigne d’une réalité inquiétante : la criminalité « astucieuse » n’est pas la seule à avoir fait de l’outil numérique une arme nouvelle [2]. Celui-ci est également le terreau fertile d’une criminalité « violente » [3]. L’utilisation d’un rançongiciel – ransomware en anglais – évoque en effet, toute proportion gardée, l’enlèvement et la séquestration, infraction dont la demande de rançon est érigée par la loi en circonstance aggravante [4]. En effet, après s’être introduit dans le système informatique de la victime (par l’entremise d’un courriel piégé par exemple), le rançongiciel prend en otage les données du système en les chiffrant, ce qui les rend inutilisables. S’en suit une demande de rançon dont doit s’acquitter la victime (généralement en Bitcoins) si elle souhaite obtenir la clé de déchiffrement. Comme l’indique fort bien le titre du guide publié par l’ANSSI, nul n’est à l’abri d’une telle menace. Depuis 2018, la tendance est toutefois à une multiplication des attaques contre de « grosses prises ». Les offensives sont dites « Big Game Hunting » pour insister sur l’importance financière et parfois institutionnelle de ceux qui en sont désormais souvent la cible : entre autres exemples, le Groupe M6, l’entreprise Fleury Michon et le CHU de Rouen figurent parmi les victimes de rançongiciels qui exigent parfois des rançons chiffrées en millions d’euros. À la fin du mois de décembre, la ville de La Rochelle et l’agglomération d’Annecy ont elles aussi été frappées. Plus récemment encore, à la mi-janvier, c’est la ville d’Angers, qui se veut précurseur des « territoires connectés », qui a été la cible d’un logiciel de cette nature [5]. Le préjudice engendré par de telles attaques est important puisque ces dernières peuvent entraîner la déstabilisation de services essentiels, un arrêt de la production, une chute du chiffre d’affaires, la perte de confiance des clients et même des risques juridiques [6]. La crise sanitaire actuelle, parce qu’elle a entraîné un accroissement substantiel du télétravail, a d’ailleurs contribué à renforcer le niveau de la menace. La multiplication des liaisons entre agents et réseaux internes ainsi que l’utilisation à domicile d’équipements personnels peu sécurisés ont ouvert de nouvelles brèches dans la sécurité des entreprises ou des collectivités.
2. Si le guide publié par l’ANSSI est riche de recommandations non seulement destinées à réduire le risque d’attaque (cloisonner le système d’information, limiter les droits des utilisateurs et les autorisations des applications, etc.), mais aussi à guider les victimes en cas d’infection (ne pas payer la rançon exigée, déconnecter les supports de sauvegarde, etc.), il ne répond pas à l’une des questions qui intéressent au premier chef les juristes : celle de la qualification pénale de l’utilisation d’un rançongiciel. Le document de l’ANSSI contient certes un développement consacré au dépôt de plainte, mais il ne précise pas sur quel fondement juridique pourront prospérer les poursuites consécutives à ce dépôt. Tout au plus indique-t-il que le dépôt de plainte pourra être réalisé en ligne sur la plateforme « THESEE » ouverte par le ministère de l’Intérieur « en matière d’escroquerie sur Internet », qualification qui est d’ailleurs impropre s’agissant d’une attaque par rançongiciel puisque la victime n’est pas trompée, mais contrainte à remettre une certaine somme d’argent. Où l’on voit que la question de la qualification mérite une attention particulière, et ce d’autant plus qu’en apparence assez simple, elle recèle de redoutables difficultés.
3. Juridiquement, il est vrai que la menace constituée par les rançongiciels n’intéresse pas seulement les juridictions répressives. Elle pose également des questions sur le terrain du droit civil. Ainsi, certaines cours d’appel ont pu admettre que l’infection par un rançongiciel était susceptible de constituer un cas de force majeure justifiant que la partie au procès qui en a été victime n’ait pas déposé ses conclusions dans le délai prévu par l’article 905-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7036LEC) [7].
4. Si cet aspect de la problématique ne manque pas d’intérêt, il reste que c’est surtout du point de vue du droit pénal que l’utilisation d’un rançongiciel suscite les interrogations les plus naturelles. On s’intéressera ici à la plus évidente d’entre elles : comment qualifier pénalement l’utilisation [8] d’un rançongiciel [9] ?
En vérité, si plusieurs infractions du Code pénal semblent dotées d’éléments constitutifs qui correspondent à l’utilisation d’un rançongiciel, il convient de n’en retenir qu’une seule afin de ne pas sanctionner deux fois le même fait. Autrement dit, de plusieurs qualifications envisageables (I) doit être dégagée la qualification applicable en vertu des règles qui régissent le concours idéal de qualifications (II).
I. Les qualifications envisageables
5. L’utilisation d’un rançongiciel semble réunir les éléments constitutifs de plusieurs infractions qui, bien que réunies pour la plupart d’entre elles dans le même livre du Code pénal « Des crimes et délits contre les biens », présentent des éléments constitutifs très différents : l’extorsion (A) et les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (B).
A. L’extorsion
6. Pour l’homme de la rue, retenir la clé de déchiffrement des données tant qu’une rançon n’aura pas été payée apparaît comme une forme de « chantage ». L’incrimination qui porte ce nom est néanmoins définie restrictivement par l’article 312-10 du Code pénal (N° Lexbase : L1879AMK). L’auteur doit menacer « de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ». Ce n’est donc qu’un procédé particulier de contrainte – la menace de diffamer ou de calomnier – que sanctionnent les peines du chantage. La pression exercée par le cybermalfaiteur grâce au rançongiciel n’est point de cette nature, sauf dans le cas particulier où il menacerait sa victime d’utiliser une partie des données afin de jeter le discrédit sur celle-ci ou de faire engager des poursuites à son encontre [10].
L’incrimination de l’article 312-12-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0663DHZ), dite « de la demande de fonds sous contrainte », n’est pas davantage envisageable. Le texte précise en effet que cette infraction doit être commise « sur la voie publique », ce que le réseau Internet n’est qu’en métaphore.
7. Il est nécessaire de remonter quelques articles en amont pour découvrir une incrimination qui semble épouser les contours de l’utilisation d’un rançongiciel. Définie par l’article 312-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7189ALT), l’extorsion « est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ». Certes, dans sa conception la plus traditionnelle, l’infraction d’extorsion suppose l’exercice d’une violence physique, ou du moins la menace de violences physiques, ce qui ne peut, à proprement parler, être reproché à l’utilisateur d’un rançongiciel. Cette conception stricte était celle du professeur Garçon, appuyée sur une analyse minutieuse de l’article 400 de l’ancien Code pénal [11]. Elle est néanmoins aujourd’hui dépassée par la formulation de l’article 312-1 du Code pénal : en mentionnant distinctement la « contrainte » par rapport à la « violence » et à la « menace de violences », le nouveau texte permet d’élargir l’incrimination à des procédés tenant davantage de la pression morale que de la violence physique. L’interprétation contraire rendrait en effet le terme de « contrainte » redondant par rapport aux deux autres : s’il désignait uniquement des menaces de violences, quelle aurait été son utilité puisque le texte, par ailleurs, vise déjà expressément les menaces de cette nature ? Il est vrai qu’un tel élargissement d’une incrimination historiquement violente a pu être critiqué par un auteur dans la mesure où il conduirait à un « affadissement de la définition de l’infraction » ; il a même été suggéré de scinder l’incrimination d’extorsion en deux incriminations distinctes, l’une – criminelle – sanctionnant l’usage de la violence physique, l’autre – délictuelle – frappant celui qui n’exerce qu’une contrainte d’ordre moral sur la victime [12]. Il demeure qu’en l’état du droit positif, la contrainte morale est susceptible de constituer l’infraction d’extorsion, même lorsqu’elle ne s’accompagne d’aucune forme de violence physique. La jurisprudence s’est engagée dans cette voie, sanctionnant par exemple sur le fondement de l’extorsion la menace de ne pas remettre un médicament à une personne qui en a un besoin impérieux [13] ou celle de causer des difficultés professionnelles [14]. Les exemples peuvent, en vérité, être multipliés [15].
L’utilisateur d’un rançongiciel se rend donc bel et bien coupable d’extorsion lorsqu’il obtient le paiement d’une rançon grâce à la pression exercée sur sa victime puisque celle-ci est « contrainte » de payer si elle souhaite obtenir la clé de déchiffrement de ses données [16]. Et lorsque la victime n’a point cédé, des poursuites peuvent être envisagées sur le fondement de l’article 312-9 du Code pénal (N° Lexbase : L7153ALI) qui incrimine la tentative d’extorsion. L’extorsion est en effet une infraction matérielle qui suppose, pour être consommée, la réalisation du résultat redouté : en l’occurrence, la remise de fonds. N’échappe donc pas à une sanction pénale le cybermalfaiteur dont la victime a pu découvrir la clé de déchiffrement par elle-même ou avec l’aide d’une entreprise spécialisée, ou qui a pu restaurer ses données à partir d’une sauvegarde.
8. Deux circonstances aggravantes peuvent être envisagées. En premier lieu, il est possible que les juges retiennent dans ce genre d’hypothèse la circonstance de recours à un moyen de cryptologie que l’article 132-79 du Code pénal (N° Lexbase : L9877GQU) érige en circonstance aggravante générale. Il est vrai toutefois que l’analyse la plus rigoureuse du principe non bis in idem pourrait au contraire conduire à écarter cette circonstance aggravante, argument pris de ce que l’auteur de l’extorsion par rançongiciel n’a pu précisément obtenir la remise convoitée que par le recours à ce procédé de cryptologie : l’utilisation du moyen de cryptologie serait donc déjà constitutive de la contrainte prise en compte par la qualification d’extorsion. En second lieu, de nombreuses espèces permettront de retenir la circonstance aggravante résultant de la réalisation de l’infraction en bande organisée (C. pén., art. 312-6 N° Lexbase : L1936AMN) car l’utilisation d’un rançongiciel suppose généralement la réunion de nombreuses compétences, de la conception du logiciel à la collecte de la rançon en passant par l’injection [17].
B. Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
9. Le Titre II du Livre III du Code pénal comporte un chapitre consacré aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD). Plusieurs incriminations y sont définies. Si elles supposent toutes une intention coupable, elles se distinguent par leurs éléments matériels. Sont notamment incriminés l’introduction et le maintien frauduleux dans un STAD (C. pén., art. 323-1 N° Lexbase : L0870KC9), le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un STAD (C. pén., art. 323-2 N° Lexbase : L0871KCA) et le fait d’introduire, d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données d’un STAD (C. pén., art. 323-3 N° Lexbase : L0872KCB). À laquelle de ces infractions l’utilisation d’un rançongiciel correspond-elle ?
10. La réponse à cette question n’est pas évidente, et cela pour au moins deux raisons. La première tient à l’état du droit positif qui distingue trois infractions dont la frontière est parfois délicate à tracer. La doctrine s’est d’ailleurs fait l’écho de ces difficultés : ainsi, la modification ou suppression de données est parfois le moyen d’entraver le fonctionnement du système [18]. Mais à la subtilité de la loi, se superpose la complexité du rançongiciel lui-même. C’est la seconde raison : véritable couteau suisse, le rançongiciel se borne rarement à une seule action. Il chiffre, mais doit d’abord pour cela accéder au système visé. Les plus redoutables d’entre eux réalisent même la suppression des copies cachées des fichiers pris en otage afin d’empêcher leur restauration par la victime [19]. Certains captent également des informations du système infecté, comme les mots de passe ou des données qu’ils menacent de rendre publics pour accroitre la pression sur la victime [20]. Et puisque le rançongiciel doit également donner à la victime des instructions pour le paiement de la rançon, il procède généralement à la création d’un fichier porteur du message ou à la modification du fond d’écran pour afficher sa demande, parfois grâce à une imagerie tirée d’une œuvre horrifique [21]. Le rançongiciel pousse parfois le vice jusqu’à empêcher purement et simplement les utilisateurs de se connecter aux machines infectées [22].
Même réduite à la fonction principale du rançongiciel (le chiffrement) la question de la qualification idoine demeure délicate. Chiffrer un fichier, est-ce entraver le fonctionnement du système ou plutôt modifier des données ? La réponse est tributaire de la conception même de la notion de « données » utilisée par le Code pénal, mais qui n’y est pas définie [23]. D’un premier point de vue, la donnée pourrait être considérée comme une information [24]. Cette conception conduit donc à considérer que le chiffrement de la donnée n’emporte pas, à proprement parler, sa transformation, mais en entrave plutôt l’accès, de la même manière que le cryptage d’un texte (par exemple en remplaçant chaque lettre par celle qui la suit dans l’alphabet) n’en modifie pas le sens. L’intégrité de l’information n’est en effet pas atteinte par le chiffrement ; celle-ci est simplement rendue inaccessible. Agissant comme une « enveloppe scellée numérique » [25], le chiffrement cache plutôt qu’il ne modifie l’information. La qualification applicable au chiffrement serait donc celle d’entrave au fonctionnement du système. Un second point de vue est néanmoins possible, refusant l’assimilation pure et simple entre la donnée et l’information pour regarder plutôt dans la première une forme de représentation de la seconde [26]. Dans cette configuration, le fait que l’information cachée demeure identique après le chiffrement n’empêche pas de considérer que la donnée qui la porte a, quant à elle, bel et bien été modifiée, car la manière de représenter l’information a effectivement été changée (ainsi, le rançongiciel modifie généralement l’extension ou la taille du fichier). La qualification adéquate serait donc celle de modification de données [27]. La question de la qualification envisageable à l’égard du chiffrement est donc redoutable puisque sa résolution dépend d’une inconnue : la définition de la donnée, à propos de laquelle le Code pénal est resté silencieux.
11. En définitive, il apparaît que les trois qualifications précitées peuvent être envisagées à l’égard de l’utilisation du rançongiciel dont la diversité des fonctions, de l’introduction dans le système jusqu’à la sollicitation de la rançon, en passant par le chiffrement lui-même, épouse les contours de chacun des trois textes d’incriminations [28]. Ces textes prévoient d’ailleurs une circonstance aggravante commune tenant dans la qualité du système visé : lorsque celui-ci est un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État, le quantum des peines fulminées est relevé.
Par ailleurs, si les infractions envisagées sont commises en bande organisée, circonstance qui n’est pas rare comme on a pu le dire s’agissant de l’utilisation d’un rançongiciel, l’aggravation prévue par l’article 323-4-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0873KCC) est applicable, mais à condition toutefois, précise le texte, que le système visé soit un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État. Voilà qui peut d’ailleurs être considéré comme une faille dans la législation : le législateur n’a envisagé l’aggravation des infractions dites « numériques » commises en bande organisée que dans une mesure très restreinte. La circonstance aggravante de bande organisée n’a d’effet qu’associée à celle précédemment envisagée. Autrement dit, lorsque l’infraction est réalisée contre un système « quelconque », la circonstance qu’elle a été commise en bande organisée est impuissante à en alourdir le quantum des peines. Il semblerait plus logique que la bande organisée soit prise en compte pour elle-même, indépendamment de la qualité du système ciblé.
La circonstance aggravante générale de cryptologie semble en revanche devoir être écartée dans la mesure où le fait qu’elle saisit – le chiffrement – est déjà pris en compte à titre d’élément constitutif, du moins s’agissant de l’entrave au fonctionnement du système et de la modification de données. Or, un même fait ne devrait pas être retenu tout à la fois comme un élément constitutif d’une infraction et comme circonstance aggravante de celle-ci [29]. Retenir à la fois la qualification de modification de données et la circonstance aggravante consistant précisément dans l’utilisation d’un « moyen matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données […] à l’aide de conventions secrètes » [30] ce serait courir le risque de sanctionner un seul fait à deux titres différents.
12. Cette étude des qualifications envisageables ne serait pas complète si n’était pas mentionnée l’incrimination de sabotage définie dans le Livre IV du Code pénal « Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique ». Lorsque l’utilisation du rançongiciel est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, elle réalise en effet les éléments constitutifs de cette infraction définie par l’article 411-9 du Code pénal (N° Lexbase : L1746AMM).
13. Un conflit de qualifications semble donc se faire jour. Il est nécessaire d’en entreprendre la résolution.
II. La qualification applicable
14. Déterminer la qualification applicable parmi toutes celles qui ont été envisagées (B) suppose préalablement de s’assurer que les règles du droit pénal obligent véritablement à n’en retenir qu’une seule (A).
A. La nécessaire unicité de qualification
15. Un principe gouverne la résolution d’un conflit de qualifications : non bis in idem. Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. Autrement dit, un même fait susceptible de plusieurs qualifications pénales ne saurait pour autant donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité. L’unicité de qualification doit prévaloir sur un cumul. Le juge ne doit en retenir qu’une [31].
16. S’agissant de l’utilisation d’un rançongiciel, on pourrait chercher à repousser ces règles en expliquant que les différentes qualifications qui ont été précédemment envisagées ne s’appliquent pas toutes à un seul et même fait. Chiffrer les données serait un fait ; ordonner à la victime de s’acquitter de la rançon en serait un autre. Les qualifications de modification de données et d’extorsion pourraient donc par exemple se cumuler puisque chacune d’entre elles s’appliquerait à un fait distinct.
17. Cette argumentation n’est pas nécessairement convaincante. D’une part, il est possible d’en stigmatiser la subtilité. Le rançongiciel est programmé pour réaliser les tâches successives nécessaires à l’enrichissement du malfaiteur. Après avoir pénétré le système ciblé, il n’a en principe guère besoin d’une nouvelle intervention de son auteur. Un seul fait est donc nécessaire au chiffrement des données et à l’exigence de la rançon. Surtout, la sollicitation de la rançon se conçoit difficilement sans le chiffrement des données qui est alors partie intégrante de la contrainte constitutive de l’extorsion.
D’autre part, l’argument de la pluralité de faits se heurte aux solutions récentes de la Cour de cassation. La Haute Juridiction semble aujourd’hui adopter une conception plus exigeante encore du principe non bis in idem que celle qui a été exposée. Plusieurs de ses arrêts reproduisent la formule suivante : « attendu que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes » [32]. Cette formule n’est pas sans ambiguïtés [33]. Il est toutefois possible d’y déceler la règle suivante : désormais, même en présence de faits différents, le principe non bis in idem peut faire obstacle à une pluralité de qualifications lorsque ces faits s’unissent au sein d’une seule action « globale », c’est-à-dire derrière une même intention coupable. L’unicité de qualification ne s’imposerait donc plus seulement à l’hypothèse d’une unicité de fait, mais également à celle d’une pluralité de faits composant une action unique caractérisée par une seule intention. Le critère essentiel apparaît alors comme étant celui de l’intention : son unicité fait celle de l’action. La pluralité de faits serait ramenée à l’unité d’une action globale susceptible d’une seule qualification pénale, argument pris de ce que ces faits seraient étroitement tenus par une seule intention coupable qui les relie. Cela revient en quelque sorte à traiter un concours réel comme s’il s’agissait d’un concours idéal. Appliqué au cas de l’utilisation d’un rançongiciel, le nouveau principe jurisprudentiel conduit au raisonnement suivant : à admettre que le chiffrement des données et la sollicitation de la rançon soient deux faits ontologiquement distincts, il est possible de penser qu’ils procèdent l’un et l’autre de manière indissociable d’une action unique de l’agent, caractérisée par une seule intention coupable. L’unité d’intention est en effet évidente puisque c’est elle qui relie le chiffrement des données à l’exigence de la rançon : l’agent ne conçoit la modification de données et l’entrave au fonctionnement du système que pour extorquer. Partant, ces faits ne devraient recevoir qu’une seule qualification pénale [34].
18. Soulèvera-t-on que malgré cette identité d’action, le cumul de qualifications demeure possible dans la mesure où les différentes incriminations envisagées protégeraient des valeurs sociales distinctes ? Cet argument, qui repose sur une exception au principe non bis in idem dont la pertinence même n’est pas évidente [35], peut être réfuté par le constat qu’à l’exception notable de l’incrimination de sabotage, l’ensemble des incriminations envisagées appartiennent au même livre du Code pénal et semblent destinées à protéger les biens. À l’unité d’intention se superpose donc celle des valeurs sociales protégées. Il est donc bel et bien nécessaire de choisir, ou plus précisément, de déterminer quelle est la qualification applicable [36].
B. La détermination de la qualification applicable
19. La détermination de la qualification applicable est une problématique qui, en l’occurrence, suppose d’être résolue en deux temps. Il est d’abord nécessaire d’identifier au sein même des qualifications d’atteinte à un STAD, celle qui doit être préférée aux autres et qui pourra ainsi « se mesurer » à la qualification d’extorsion. La qualification d’accès frauduleux (C. pén., art. 323-1) doit sans doute s’incliner car elle rend très imprécisément compte de l’action du rançongiciel dans la mesure où elle n’en saisit pas l’action essentielle, le chiffrement [37]. La véritable difficulté concerne les deux autres qualifications, l’entrave au fonctionnement (C. pén., art. 323-2 N° Lexbase : L0871KCA) et la modification de données (C. pén., art. 323-3 N° Lexbase : L0872KCB). La question est complexe, car, comme on a pu le percevoir [38], la réponse dépend de la définition de la notion de « donnée » à propos de laquelle le Code pénal est demeuré silencieux. En vérité, deux considérations permettent de penser que l’incertitude sur ce point n’a qu’un impact négligeable. En premier lieu, les deux infractions sont punies des mêmes peines. En second lieu, que l’on retienne l’une ou l’autre, la conclusion de l’étude n’en sera pas changée car elles semblent devoir toutes les deux s’incliner face à l’incrimination d’extorsion. Le raisonnement qui va suivre et qui sera formellement appliqué à la qualification de modification de données pourrait donc tout aussi bien être envisagé à l’égard de la qualification d’entrave.
20. En effet, trois raisons plaident en faveur de la qualification d’extorsion peu importe celle des deux qualifications qu’on lui oppose. D’abord, on sait que la jurisprudence résout parfois les conflits de qualifications en faisant primer celle qui correspond à l’infraction-fin sur celle applicable à l’infraction-moyen [39]. Or, dans l’hypothèse du rançongiciel, le chiffrement des données n’est qu’un moyen destiné à la réalisation du véritable objectif de l’agent : la remise de la rançon. Ensuite, l’extorsion est l’infraction la plus lourdement sanctionnée, ce qui plaide en sa faveur en vertu du principe dit de « la plus haute expression pénale ». Elle est en effet punie de sept ans d’emprisonnement [40] quand la modification de données est réprimée de 5 ans d’emprisonnement [41]. Enfin, et cet argument nous semble le plus décisif, la qualification d’extorsion est celle qui paraît embrasser les faits dans leur entièreté. Elle seule permet de rendre compte du comportement du cybermalfaiteur sans amputer une partie de celui-ci. En effet, parce que le chiffrement des données est le moyen de contraindre la victime, il s’intègre à l’acte constitutif de l’extorsion [42] tandis que la fin poursuivie – la remise d’une somme d’argent – est appréhendée à travers le résultat dans l’infraction. La qualification de modification de données elle, reste aveugle à ce dernier versant des choses, pourtant essentiel puisqu’il constitue l’ultima ratio de l’action globale de l’utilisateur du rançongiciel. Retenir la qualification de modification de données au détriment de celle d’extorsion, se serait donc priver une partie du comportement délictueux de qualification. La contrainte exercée sur la victime, la remise de la rançon et le dessein d’obtenir celle-ci seraient autant d’éléments passés « sous silence ». L’utilisateur d’un rançongiciel serait alors traité semblablement à un cambrioleur puni uniquement pour le bris d’une vitre et non pour la soustraction des meubles. C’est donc la qualification d’extorsion qui semble devoir être choisie afin que ne puisse être reproché au juge de s’être abstenu de se prononcer sur des éléments de faits dont il a été saisi [43].
21. Ce choix en faveur de la qualification d’extorsion n’est cependant pas sans inconvénient. Il prive les juridictions parisiennes de la compétence concurrente à laquelle elles auraient pu prétendre si l’une des qualifications des articles 323-2 et 323-3 du Code pénal avait été retenue. En effet, l’article 706-72-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4806K8I) dispose que le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 (N° Lexbase : L0480LTX), 52 (N° Lexbase : L4919K8P) et 382 (N° Lexbase : L0504LTT) du même code pour la poursuite, l'instruction et le jugement d’un certain nombre d’infractions commises en matière numérique. Parmi elles, sont citées les qualifications d’entrave au fonctionnement et de modification de données, mais non celle d’extorsion.
22. Cet « effet secondaire » du choix de la qualification d’extorsion peut toutefois, dans certaines circonstances, être purgé par le recours au quatrième alinéa de l’article 706-75 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0563LTZ) qui dispose que « le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l'ensemble du territoire national pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ». Or, d’une part, il apparaît que l’extorsion commise en bande organisée fait partie des infractions visées par cet article (et on l’a dit, l’utilisation d’un rançongiciel s’opère souvent en présence d’une telle bande). D’autre part, le rançongiciel frappe souvent des cibles dispersées sur l’ensemble du territoire [44] (il est même parfois transnational [45]) : la condition de « très grande complexité » résultant notamment, comme le précise expressément l’article, du « ressort géographique » sur lequel s’étend l’infraction sera donc souvent satisfaite. Perdue sur le fondement de l’article 706-72-1, la compétence concurrente des juridictions parisiennes serait alors regagnée grâce à l’article 706-75.
[1] V. également, pour une étude richement documentée du phénomène lui-même, le rapport de l’ANSSI, État de la menace rançongiciel, publié le 1er février 2021 [en ligne].
[2] Pour une étude de l’une de ces fraudes, v. not. D. Père, D. Forest, L’arsenal répressif du phishing, D., 2006, p. 2666.
[3] Sur la distinction entre criminalité de violence et criminalité d’astuce, v. not. R. Gassin, Ph. Bonfils et S. Cimamonti, Criminologie, Dalloz, 7e éd., 2011, n° 482.
[4] C. pén., art. 224-4, al. 1er (N° Lexbase : L6576IXT).
[5] On lira d’ailleurs dans le guide de l’ANSSI les témoignages de responsables du Groupe M6, de l’entreprise Fleury Michon et du CHU de Rouen. S’agissant de l’attaque contre ce dernier, v. également M. Quéméner, Cyberattaques et santé publique : l’hôpital de Rouen cible d’un rançongiciel, Dalloz IP/IT, 2019, 648. Quant à l’attaque subie par la ville d’Angers, on notera qu’aucune demande de rançon ne semble avoir été rapportée à ce jour.
[6] Certains rançongiciels, des « ransomhack » menacent de faire fuiter les données personnelles, ce qui aurait pour conséquence de dévoiler au grand jour l’insuffisance de protection de ces données et de placer l’entreprise ciblée sous la menace d’une amende fulminée par le RGPD. Sur cette question, v. not. A. Jomni, Le RGPD : un atout ou un frein pour la cybersécurité ? Dalloz IP/IT, 2019, 352.
[7] V. par ex. CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 12 février 2020, n° 19/17629 (N° Lexbase : A68963E7).
[8] La présente étude se donne pour objet la qualification de l’utilisation même du rançongiciel et non des comportements qui y seraient seulement liés plus ou moins étroitement, comme le refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement (punissable sur le fondement de l’article 434-15-2 du Code pénal N° Lexbase : L4889K8L).
[9] D’autres questions liées au rançongiciel intéressent la procédure pénale, notamment pour déterminer les meilleurs moyens d’investigation à mettre en œuvre face à ce type de délinquance qui est souvent transnationale et pour lequel le risque de dépérissement des preuves est important.
[10] Ainsi, le virus Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information faisait croire à ses victimes que des services de polices avaient découvert des activités illicites sur leurs ordinateurs pour exiger d’elles le paiement d’une « amende » de 100 €. Par ailleurs, le chantage à la non-conformité au RGPD est le mode de faire des « ransomhack » (v. note n° 6 supra).
[11] L’article employait les termes de « force », de « violence » et de « contrainte », mais non de « menaces de violences ». On pouvait donc, avec le professeur Garçon, légitimement considérer que la référence à la « contrainte » permettait de réprimer les menaces de violences et qu’elle n’avait pas d’autre rôle (E. Garçon, Code pénal annoté, 1re éd., Sirey, 1901, art. 400, n° 24).
[12] M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, Infractions du Code pénal, Dalloz, coll. Précis, 8e éd., 2018, n° 207. V. également nôtre Pour un renouvellement du système répressif dit des atteintes juridiques aux biens, préf. E. Verny, LGDJ, coll. Bibliothèque des sciences criminelles, 2021, n° 975 et s. où il est défendu l’idée de recentrer l’incrimination d’extorsion sur la violence physique et la menace de violences physiques en renvoyant la contrainte morale à une incrimination de chantage élargie.
[13] CA Paris, 27 septembre 1991 : D. Fortin, note, D., 1991, 635 ; P. Bouzat, obs., RSC, 1992, 760.
[14] Cass. crim., 23 mars 2016, n° 15-80.513, F-P+B (N° Lexbase : A3632RAR) : Y. Mayaud, obs., AJCT, 2016, 402 ; E. Dreyer, obs., Gaz. Pal., 2016, 2286.
[15] V. not. Cass. crim., 27 octobre 1999, n° 98-85.729 (N° Lexbase : A3211C4P) (menace de ne pas alimenter en eau un abonné s’il ne s’acquitte pas de la dette du précédent locataire) ; Cass. crim., 12 septembre 2007, n° 06-86.630 (N° Lexbase : A95314HH) (fonctionnaire qui exige un paiement indu à défaut duquel les marchandises de sa victime resteront bloquées en douane) ; Cass. crim., 28 février 2018, n° 17-80.684, F-D (N° Lexbase : A0646XGZ) (gérante d’un organisme de formation qui exige des étudiants ayant déjà entamé leur formation, une participation financière sous menace d’une exclusion du centre ou de refus d’accès aux examens en cas de non-paiement).
[16] V. not. en ce sens J.-N. Robin, La matière pénale à l’épreuve du numérique, Thèse Rennes, 2017, n° 192.
[17] Partageant ce constat, v. M. Quéméner, Cyberattaques et santé publique : l’hôpital de Rouen cible d’un rançongiciel, Dalloz IP/IT, 2019, 648, in fine.
[18] A. Lepage, P. Maistre du Chambon, R. Salomon, Droit pénal des affaires, LexisNexis, coll. Manuel, 5e éd., 2018, n° 647.
[19] Tel est le cas, par ex., des rançongiciels BitPaymer/FriedEx et Clop.
[20] Tel est le cas, par ex., des rançongiciels Maze, Sodinokibi et Egregor.
[21] Tel est le cas du rançongiciel Jigsaw.
[22] Telles les dernières versions du rançongiciel LockerGoga.
[23] Sur cette absence de définition, v. not. J.-N. Robin, La matière pénale à l’épreuve du numérique, Thèse Rennes, 2017, n° 38.
[24] Au soutien de cette thèse, pourrait être invoqué l’article 2 de la loi informatique et libertés, du moins dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2018-1125, du 12 décembre 2018 (N° Lexbase : L3271LNH), et qui disposait que « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée… ».
[25] Expression empruntée à la page « Comprendre les grands principes de la cryptologie et du chiffrement » du site Internet de la CNIL à propos de la notion de chiffrement.
[26] Au soutien de cette analyse, on invoquera l’arrêté du 22 décembre 1981 relatif à l’enrichissement du vocabulaire informatique (JO du 17 janvier 1982) selon lequel la donnée est la « représentation d’une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement ».
[27] On ajoutera au soutien de cette thèse la formulation de l’article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : C15764ZE) selon lequel « on entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données ».
[28] Toutefois, aucune de ces infractions n’est constituée lorsque le cybermalfaiteur est appréhendé avant d’avoir pu introduire le rançongiciel dans un STAD. Cela ne signifie pas pour autant que la répression est désarmée. Deux situations peuvent être distinguées. En premier lieu, si l’agent est parvenu à mettre en place son piège (par exemple en envoyant un courriel comportant une pièce jointe piégée), mais que la victime ne s’y est pas laissée prendre, la tentative des infractions envisagées au texte peut être retenue. En second lieu, si l’agent a seulement programmé ou s’est uniquement procuré le rançongiciel sans avoir pris le temps de placer des victimes à sa merci, ce sont les incriminations « obstacles » des articles 323-3-1 (N° Lexbase : L9875GQS) et 323-4 (N° Lexbase : L9875GQS) du Code pénal qui sont envisageables. Ces textes permettent en effet, à certaines conditions, de sanctionner la préparation des infractions précédemment étudiées, c’est à dire en amont de leur mise à exécution.
[29] V. not. en ce sens O. Décima, S. Detraz, E. Verny, Droit pénal général, LGDJ, coll. Cours, 3e éd., 2018, n° 289.
[30] L’article 132-79 du Code pénal (N° Lexbase : L9877GQU) renvoie à l’article 29 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui définit ainsi le moyen de cryptologie.
[31] V. déjà J.-L.-E. Ortolan, Éléments de droit pénal, 1886, t.1, n° 1146. Pour une présentation plus contemporaine, v. not. O. Décima, S. Detraz, E. Verny, op. cit., n° 288 et s. Pour une autre lecture du principe qui l’appréhende essentiellement en lien avec la question de l’autorité de la chose jugée, v. not. P.-J. Delage, De l’arrêt Ben Haddadi à l’affaire du Drugstore Publicis, D., 2020, p. 204, n° 5.
[32] V. par ex. Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 15-84.552, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3230SCM) : JCP G 2017, 16, note N. Catelan ; O. Décima, obs., Rev. pénit., 2016, p. 935, G. Beaussonie, obs., ibid, p. 941 ; Ph. Conte, obs., Dr. pén., 2016, comm. 4 – Cass. crim., 25 octobre 2017, n° 16-84.133, F-D (N° Lexbase : A1390WXR) : Ph. Conte obs., Dr. pén., 2018, comm. 1 – Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 18-83.122, F-P+B+I (N° Lexbase : A2147ZY8) : P.-J. Delage, note, D., 2020, p. 204 – Cass. crim. 30 septembre 2020, n° 19-81.664 (N° Lexbase : A70083WH).
[33] Ph. Conte, Non bis in idem : bref exercice d'exégèse d'où il résulte que le droit n'est pas la physique, Dr. pén., 2020, étude 10.
[34] V. cependant, un arrêt récent qui laisse entrevoir la possibilité d’une solution différente : Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-84.301, FS-P+B+I (N° Lexbase : A16753T9) : Ph. Conte, obs., Dr. pén., 2020, comm. 183 : où les qualifications de faux et d’escroquerie sont cumulées dans une hypothèse où les deux faits envisagés semblaient pourtant s’unir par une même intention, le faux ayant été réalisé afin de tromper.
[35] La doctrine critique notamment l’imprécision de la notion de valeur protégée, ainsi que son caractère extra-légal. V. not. O. Décima, S. Detraz, E. Verny, op. cit., n° 293. La jurisprudence continue toutefois à s’y référer : v. par ex. Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-83.938, F-D (N° Lexbase : A90253KH) : Ph. Conte, obs., Dr. pén., 2020, comm. 138.
[36] Un cumul entre la qualification d’extorsion et celles de modification de données apparaîtra encore plus délicat lorsque aura été retenue la circonstance de cryptologie aggravant l’extorsion (v. supra n° 8). Dans ce cas en effet un même fait – le chiffrement – serait alors constitutif à la fois de l’infraction de modification de données et de la circonstance aggravante de cryptologie de l’infraction d’extorsion. Le principe non bis in idem ne saurait permettre de retenir cumulativement l’une et l’autre. V. not. en ce sens Cass. crim., 6 janvier 1999, Bull. crim. n° 6 : « attendu qu'un même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ni être retenu comme élément constitutif d'un crime et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ». Plus récemment : Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 19-82.767, F-D (N° Lexbase : A506537Q).
[37] Il est vrai que l’article 323-1 aggrave les peines prévues contre l’infraction lorsque de l’accès ou du maintien frauduleux résulte la suppression ou la modification de données contenues dans le système ou l’altération du fonctionnement de celui-ci. La doctrine s’accorde cependant pour considérer que cette circonstance aggravante ne concerne que l’hypothèse où de tels résultats dommageables auraient été produits sans avoir été recherchés par l’auteur de l’accès ou du maintien frauduleux, ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse de l’utilisation d’un rançongiciel.
[38] V. supra n° 10.
[39] Cass. crim., 16 juin 1965, n° 64-91.637, Desbiolles (N° Lexbase : A8676CGG) (en cas de soustraction d’arbre sur pied, la qualification de destruction s’efface au profit de celle de vol).
[40] Peine portée à 10 ans si la circonstance aggravante de cryptologie est retenue.
[41] Certes, la peine d’amende fulminée contre la modification de données est plus sévère que celle encourue par l’auteur d’une extorsion. N’est-il toutefois pas permis de penser que la plus grande sévérité d’une peine d’emprisonnement l’emporte sur la plus grande sévérité d’une peine d’amende ? La privation de liberté n’est-elle pas, en toutes circonstances, plus grave qu’une sanction pécuniaire ?
[42] Il serait possible de renchérir en soulevant que la circonstance aggravante de cryptologie permet elle aussi, et même plus précisément encore, d’appréhender le chiffrement. Mais cet argument pourrait être mis à mal par la réserve formulée supra n° 8, d’autant plus qu’il donne du crédit à cette dernière en révélant au grand jour que retenir la circonstance aggravante de cryptologie, c’est donner une seconde qualification à un fait déjà pris en compte au titre des éléments constitutifs de l’extorsion.
[43] Dans le cas particulier où l’utilisateur aurait employé la contrainte spécifique du chantage (v. supra n° 6), le premier et le troisième argument pourraient être pareillement mobilisés pour plaider en faveur de la qualification de chantage. Quant au cas où les éléments constitutifs de l’infraction de sabotage seraient réunis (v. supra n° 12), on continuerait à plaider en faveur de la qualification d’extorsion qui paraît encore une fois embrasser le plus largement les faits. Les juges pourraient toutefois cumuler les deux qualifications, argument pris de l’atteinte à deux valeurs sociales protégées (sur cet argument discutable, v. supra n°18).
[44] V. not. en ce sens A. Chérif, Lutte contre la cybercriminalité : une traque au sein des réseaux informatiques ! D., 2019, p. 1536.
[45] Ainsi, en mai 2017, le rançongiciel Wannacry, peut-être le plus célèbre de tous, a infecté en une journée au moins 200 000 machines réparties dans environ 150 pays.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476367
[Brèves] Prescription quinquennale applicable au recours de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2021, n° 19-25.887, FS-P (N° Lexbase : A60924H4) et n° 19-25.886 (N° Lexbase : A62204HT)
Lecture: 3 min
N6531BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 24 Février 2021
► Ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription ;
En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) ; la Cour de cassation opère ici un revirement de jurisprudence mettant fin à sa jurisprudence du 9 mai 2019 (Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-10.909, FS-P+B+I N° Lexbase : A9352ZAM), par laquelle elle interprétait les articles R. 142-18 (N° Lexbase : L2854K9L), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et R. 441-14 (N° Lexbase : L7292ADG), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, du Code de la Sécurité sociale, en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l’employeur, qui est recevable à en contester l’opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par ces textes, le recours de l’employeur ne revêt pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du Code civil.
Les faits et procédure. Une société a été informée, le 3 septembre 2009, par la caisse primaire d’assurance maladie de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de l’une de ses salariés. Après avoir saisi en vain, le 22 février 2013, la commission de recours amiable, l’employeur a porté son recours devant la juridiction de Sécurité sociale, le 24 février 2016.
La cour d’appel. Adoptant la position de la Cour de cassation du 9 mai 2019 précitée, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 18 octobre 2019, n° 18/02442 N° Lexbase : A5502ZR9), pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l’action de l’employeur, retient que l’action diligentée par l’employeur en contestation de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du Code civil, de sorte que la prescription de droit commun de cinq ans ne lui est pas applicable.
Cassation. Entendant les critiques soulevées par la jurisprudence de 2019, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, son interprétation des textes pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui en justifient le réexamen.
Une solution identique est énoncée dans l’arrêt n° 19-25.886 (N° Lexbase : A62204HT, cassation CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 18 octobre 2019, n° 18/02431 N° Lexbase : A5771ZR8).
| Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, La contestation de la décision de la caisse, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E3092ETP). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476531
[Brèves] Arbitrage à dire d'expert pour l'évaluation des droits dans l'association d'avocats du retrayant (non)
Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2021, n° 19-22.964, FS-P (N° Lexbase : A61274HE)
Lecture: 3 min
N6543BYY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 03 Mars 2021
► L'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L1737LRR), qui prévoit l’arbitrage à dire d’expert, n’est pas applicable à une association d'avocats en l'absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d'un avocat.
Faits et procédure. Trois avocats, avaient conclu ensemble une convention d'association. L’un des trois avait décidé de se retirer de l'association, ce dont étaient convenus les associés dans le cadre d’une convention. Aucun accord n'étant intervenu sur les modalités de son retrait, il avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Haute-Loire d'une demande d'arbitrage. Devant la Cour de cassation, il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom de limiter la somme lui demeurant due par ses anciens associés, alors « que l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : Z80327KW), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), ne dérogeait pas à l'article 1843-4 du Code civil ; que, dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n'y déroge qu'en ce qu'il donne compétence au Bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ; qu'en ayant refusé l'arbitrage à dire d'expert demandé par le premier avocat pour l'évaluation de ses droits dans l'association d'avocats l'ayant lié aux autres, au motif que la procédure d'arbitrage par le Bâtonnier était dérogatoire au droit commun et excluait l'application de l'article 1843-4 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour. La Haute juridiction rappelle que selon l'article 1843-4 du Code civil, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux cédés par un associé ou rachetés par la société en cause, un expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés détermine cette valeur. Si une association d'avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 (N° Lexbase : L2001ABQ) à 1844-17 (N° Lexbase : L2037AB3) du Code civil, cependant, l'article 1843-4 ne lui est pas applicable en l'absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d'un avocat. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la Cour de cassation conclut que la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Rejet. Elle rejette, par conséquent, le pourvoi.
|
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les structures d’exercice, Le recours à un expert pour l'évaluation des parts sociales de l'avocat associé retrayant, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E41443RW). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476543
[Brèves] Location de meublé touristique sur une courte durée : validation du dispositif de changement d'usage
Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2020, n° 17-26.156, FP-PR (N° Lexbase : A33354HY), n° 19-13.191 (N° Lexbase : A33364HZ) et n° 19-11.462 (N° Lexbase : A33374H3), FP-P
Lecture: 11 min
N6505BYL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 24 Février 2021
► Les articles L. 631-7, alinéa 6 (N° Lexbase : L0141LNK), et L. 631-7-1 (N° Lexbase : L2375IBL) du Code de la construction et de l’habitation sont conformes à la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4) ;
La location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage qui est soumis à autorisation administrative préalable ;
Le règlement municipal de la Ville de Paris qui prévoit une obligation de compensation est conforme au principe de proportionnalité ;
► Un formulaire H2 rempli postérieurement au 1er janvier 1970 ne permet pas nécessairement d’établir l’usage d’habitation du bien à cette date.
Faits. Dans les trois arrêts, le propriétaire d’un bien immobilier situé à Paris a été assigné par la Ville de Paris en paiement d’une amende pour l’avoir loué « de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile », sans avoir sollicité l’autorisation de changement d’usage prévue par l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Procédure. Dans le premier arrêt (n° 17-26.156), condamnée par le juge des référés, puis par la cour d’appel, au paiement d’une amende, elle a, à l’occasion de son pourvoi en cassation, soulevé la non-conformité des articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du Code de la construction et de l’habitation aux articles 9 et 10 de la Directive 2006/123/CE (dite « Directive services ») du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Par un arrêt du 15 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 15 novembre 2018, n° 17-26.156, FP-P+B+I N° Lexbase : A1712YLY), la Cour de cassation a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction.
Dans le deuxième arrêt (n° 19-13.191), la demande de la Ville de Paris a été rejetée en première instance et en appel au motif qu’aucun changement d’usage n’était en l’espèce caractérisé, la notion de « courte durée » visée à l’article L. 631-7, dernier alinéa, ne recouvrant pas toute location durée inférieure à un an ou à neuf mois, comme le soutenait la Ville de Paris.
Par un arrêt du 28 mai 2020, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans les affaires C-724/18 (CJUE, 22 septembre 2020, aff. C-724/18, Cali Apartments SCI N° Lexbase : A43833UU).
Dans le troisième arrêt (n° 19-11.462), la demande a été accueillie en première instance et en appel. Le pourvoi posait notamment la question de la preuve de l’usage d’habitation de ce local au sens de ce texte et plus précisément de la portée qu’il convenait de donner à la déclaration « H2 » remplie par les propriétaires de propriétés bâties à l’occasion de la révision foncière de 1970.
Par un arrêt du 6 février 2020, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans les affaires C-724/18 et C-727/18.
Dans les trois arrêts, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que, par un arrêt du 22 septembre 2020 (C-724/18 et C-727/18), la CJUE s’est prononcée sur les questions posées.
Questions posées à la Cour de cassation. Les questions posées à la Cour de cassation sont les suivantes :
- dans le premier arrêt (n° 17-26.156) : les articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du Code de la construction et de l’habitation sont-ils conformes aux articles 9 et 10 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ?
- dans le deuxième arrêt (n° 19-13.191) : le fait pour un bailleur de donner en location, à deux reprises au cours de la même année, un appartement meublé à usage d’habitation, pour des durées respectives de quatre et six mois, à deux sociétés pour y loger la même personne en qualité de salarié, caractérise-t-il un changement d’usage au sens de l’article L. 631-7, alinéa 6, du Code de la construction et de l’habitation ?
- dans le troisième arrêt (n° 19-11.462) : le formulaire de l’administration fiscale intitulé « H2 » rempli par le propriétaire d’un local postérieurement au 1er janvier 1970 est-il de nature à établir la preuve de l’usage d’habitation du bien à cette date ?
Réponses de la Cour de cassation. Dans les deux premiers arrêts (n° 17-26.156 et 19-13.191), la Cour de cassation a tout d’abord jugé que les articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du Code de la construction et de l’habitation sont conformes à la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.
Dans le premier arrêt (n° 17-26.156), sur la conformité à l’article 9 de la Directive, l’interprétation de la Directive par la CJUE s’imposant à elle, la Cour de cassation, reprenant les motifs de la juridiction européenne, a jugé que l’article L. 631-7, alinéa 6, qui soumet à autorisation préalable le fait, dans certaines communes, de « louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile », est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et est proportionné à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante (telle que, par exemple, la limitation des nuitées disponibles à la location ou bien encore la mise en place d’une imposition spécifique destinée à rendre moins attrayante économiquement ce type de contrats), notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
Sur la conformité à l’article 10 de la Directive, alors que, sur ce point, la CJUE a laissé à la Cour de cassation le soin de se prononcer après lui avoir toutefois donné quelques « indications de nature à lui permettre de statuer », celle-ci a jugé :
- d’une part, que l’article L. 631-7, alinéa 6, précité répond aux exigences d’objectivité et de non-ambiguïté prévues par l’article 10 précité, dès lors que, hormis les cas d’une location consentie à un étudiant pour une durée d’au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8), d’un bail mobilité d’une durée de un à dix mois et de la location du local à usage d’habitation constituant la résidence principale du loueur pour une durée maximale de quatre mois, « le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation. »
À cet égard, la question centrale portait sur la notion de « courtes durées », figurant dans l’article L. 631-7, alinéa 6, et considérée comme trop imprécise par la société demanderesse au pourvoi : se référant à la réglementation nationale et en particulier à l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0189LNC) auquel l’article L. 631-7 renvoie, la Cour de cassation a estimé qu’une location de courte durée devait s’entendre de toute location « inférieure à un an ». Elle en a déduit que ce texte est suffisamment précis, en ce qu’il concerne la location à plus d’une reprise au cours d’une même année d’un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
- d’autre part, que l’article L. 631-7-1 du Code de la construction et de l’habitation (qui confie au maire de la commune de situation de l’immeuble la faculté de délivrer l’autorisation préalable de changement d’usage et attribue au conseil municipal le soin de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées des compensations éventuelles, au regard des objectifs de mixité sociale en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements) prévoit des critères qui sont justifiés par une raison d’intérêt général, qui satisfont aux exigences de clarté, de non-ambiguïté, d’objectivité, de publicité, de transparence et d’accessibilité de la Directive et qui, tels que mis en œuvre par la Ville de Paris dont le règlement municipal prévoit une obligation de compensation, sont conformes au principe de proportionnalité. Autrement dit, le règlement municipal de la Ville de Paris qui prévoit une obligation de compensation est conforme au principe de proportionnalité.
Dans le deuxième arrêt (n° 19-13.191), s’agissant du champ d’application de l’article L. 631-7, dernier alinéa, du Code de la construction et de l’habitation, la Cour a retenu, en raisonnant comme dans le premier arrêt, que les deux locations litigieuses, consenties à deux sociétés, sur une période de moins d’un an, pour des durées respectives de quatre et six mois, donc inférieures à un an, constituaient un changement d’usage, au sens du texte précité, soumis à autorisation préalable.
Dans le troisième arrêt (n° 19-11.462), la Cour rappelle que, pour l’application de la réglementation sur le changement d’usage des locaux d’habitation, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 (CCH, art. 631-7, al. 3).
La Ville de Paris produisait, pour établir l’usage d’habitation du local en cause, la déclaration établie selon le modèle « H2 » fourni par l’administration fiscale, qu’il avait été demandé aux redevables de la contribution foncière des propriétés bâties de souscrire en vue de la révision foncière du 1er janvier 1970.
En l’espèce, ce formulaire avait été rempli par le propriétaire du local en 1978.
La cour d’appel a considéré que ce document établissait l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970 au regard des réponses des propriétaires selon lesquelles le bien était loué en meublé.
Mais ces formulaires comportent les renseignements demandés « à la date de leur souscription », à l’exception du montant du loyer qui est celui en vigueur au 1er janvier 1970 (article 40 du décret d’application du 28 novembre 1969).
La Cour de cassation en a déduit que les renseignements portés dans ce formulaire ne pouvaient être considérés comme décrivant l’usage du bien au 1er janvier 1970 sans qu’il soit précisé en quoi les réponses apportées établissaient l’usage d’habitation du local à cette date.
L’arrêt de la cour d’appel a donc été cassé.
| Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476505
[Brèves] Rupture brutale de relations commerciales nées d’un contrat administratif : compétence du JA
Réf. : T. confl., 8 février 2021, n° 4201 (N° Lexbase : A21674GD)
Lecture: 2 min
N6450BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 24 Février 2021
► La demande tendant à obtenir réparation d'un préjudice subi du fait de la rupture brutale d'une relation commerciale antérieurement établie, lorsque le demandeur et l'auteur de la rupture étaient liés par un contrat administratif, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même que le demandeur se prévaut des dispositions du Code de commerce ; le litige ressortit, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative (sur renvoi de Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-21.955, FS-P+B N° Lexbase : A54723TT).
Faits. La société Entropia Conseil, qui a réalisé des prestations au bénéfice de l'établissement public SNCF Réseau sur la base de bons de commande régis par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF, a intenté une action, dirigée contre SNCF Réseau et la SNCF, tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre elle et SNCF Réseau.
Nature du contrat en cause. Le contrat qui liait l'établissement public SNCF Réseau et la société Entropia Conseil était régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF prévoyant, notamment, au bénéfice de la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat. Comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif.
Décision. Appliquant le principe précité, le Tribunal des conflits conclut à la compétence de la juridiction administrative (s'agissant d'une action en responsabilité à raison de comportements ayant altéré les stipulations d'un contrat administratif, voir T. confl., 16 novembre 2015, n° 4035 N° Lexbase : A1459NYP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476450
[Brèves] Ordonnance de protection : caractérisation d’une « mise en danger » et appréciation souveraine des juges du fond
Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2021, n° 19-22.793, F-P (N° Lexbase : A79614GX)
Lecture: 5 min
N6583BYH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 24 Février 2021
► C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d'une ordonnance de protection était justifié à l’égard du seul conjoint.
Faits et procédure. En l’espèce, par requête du 20 avril 2017, une femme avait saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection à l'égard de son conjoint.
Décision cour d’appel. La cour d’appel avait retenu que l’épouse était fondée à solliciter une mesure de protection et, en conséquence, lui avait attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal, ordonné que l’époux quitte sans délai le domicile conjugal, ordonné en tant que de besoin son expulsion, avec l'assistance de la force publique, et interdit aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif en les autorisant, à défaut, à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée, si besoin avec le concours de la force publique.
Pour se prononcer ainsi, la cour d’appel avait retenu qu'il ressortait des éléments de preuve produits que l’épouse avait été victime de violences conjugales à plusieurs reprises, alors que les faits dénoncés à son encontre par l’époux correspondaient à des dégradations matérielles, sans violence physique, ou à des violences réactionnelles à une agression subie par l'épouse. La cour constatait qu'à cela s'ajoutaient un contexte de violences psychologiques et un syndrome dépressif réactionnel, dont souffrait l'intéressée depuis plusieurs années, comme en attestait son médecin, et qui n'était pas dû, contrairement à ce que soutenait l’époux, à ses difficultés professionnelles. La cour relevait que l’époux ne démontrait pas que son épouse s’était rendue coupable, à son égard, de violences psychologiques ou économiques.
Pourvoi. Pour contester la décision, l’époux faisait valoir que c’était, au contraire, lui-même qui était exposé à un danger ; il soutenait que constitue un acte de violence tout acte dommageable pour la personne ou les biens de la victime qui est de nature à lui causer un trouble physique ou moral ; qu'en affirmant que la matérialité des violences psychologiques commises à son préjudice n'était pas avérée par la production d'éléments objectifs et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du fait que l’épouse avait quitté le domicile conjugal munie d'un couteau, en 2016, pour se rendre au lieu où s'était réfugié l’époux, afin de lacérer la capote et crever les pneus de son véhicule dès lors que ces faits, aussi désagréables soient-ils, n'étaient pas constitutifs des violences physiques dénoncées par l'intéressé, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces faits n'étaient pas de nature à caractériser des violences morales, en ce qu'ils étaient constitutifs d'un acte prémédité d'intimidation avec arme, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 (N° Lexbase : L2997LUK) et 515-11 (N° Lexbase : L8563LXG) du Code civil.
Rejet du pourvoi. Mais les arguments sont écartés par la Haute juridiction, qui rappelle qu’aux termes de l'article 515-9 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
Selon la Haute juridiction, en l'état des constatations et appréciations susmentionnées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d'une ordonnance de protection était justifié.
Observations. Par cette décision, la Cour de cassation rappelle, d’une part, que le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si les conditions de délivrance d’une ordonnance de protection sont réunies (cf. Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-24.180, F-P+B N° Lexbase : A4507R73).
Cette décision rappelle, d’autre part, que la caractérisation d’une mise en danger est déterminante pour justifier la délivrance d’une ordonnance de protection (cf. également Cass. civ. 1, 13 février 2020, n° 19-22.192, F-D N° Lexbase : A75143EZ ; et notre brève N° Lexbase : N2354BYT).
En l’espèce, s’agissant des violences dénoncées par l’époux, la cour d’appel a ainsi estimé (souverainement) que la condition d’existence d’une mise en danger n’était pas caractérisée (contrairement aux violences dénoncées par l’épouse, les faits dénoncés par l’époux correspondant à des dégradations matérielles, sans violence physique, ou à des violences réactionnelles à une agression subie par l'épouse).
| Pour aller plus loin : - cf. A. Gouttenoire, L’ordonnance de protection : une véritable mesure d’urgence, Lexbase, Droit privé, n° 828, 2020 (N° Lexbase : N3763BYZ) ; - cf. ETUDE : Les mesures de protection pour les victimes de violences conjugales, Les conditions et la procédure de délivrance d'une ordonnance de protection (N° Lexbase : E1144EUW) in L’Ouvrage « Mariage - Couple - PACS » (dir. A. Gouttenoire). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476583
[Pratique professionnelle] La paie pendant la crise sanitaire liée à la covid-19
Lecture: 5 min
N6590BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lola Pascaud et Myriam Tourneur, Avocats of Counsel, Factorhy Avocats
Le 09 Mars 2021
L’épidémie de la covid-19 a frappé de plein fouet les entreprises françaises, les obligeant à se réorganiser pour faire face à la crise.
Selon l’INSEE, un tiers des sociétés ont fermé pour une durée moyenne de cinquante-sept jours, le plus souvent à la suite de restrictions administratives d’accueil du public (65 %) [1].
Fermetures administratives, protocoles sanitaires stricts, pénurie de masques, ont d’abord été le lot des entreprises durant cette période de crise inédite.
L’urgence et les impacts de la crise se sont également rapidement fait ressentir en paie, en obligeant les équipes RH, juristes et prestataires paie à s’adapter aux nombreuses évolutions liées aux dispositifs exceptionnels mis en place par le Gouvernement durant cette période de crise.
Toujours selon l’INSEE, plus de quatre sociétés sur cinq ont fait appel aux aides mises en place par les pouvoirs publics, afin de faire face à une réduction d’activité, et notamment au chômage partiel (70 % des sociétés), ainsi qu’aux mesures permettant d’alléger les charges des entreprises (53 %).
Si l’inédit et l’urgence qui ont caractérisé les premières paies à l’occasion du premier confinement semblent désormais un lointain souvenir, les RH et prestataires paie n’en sont pas pour autant revenus à une situation confortable. En effet, la complexité réside désormais pour eux dans la multiplication des textes et annonces gouvernementales concernant les évolutions des dispositifs mis en place pour faire face à la crise sanitaire.
Les mesures permettant de faire face à la réduction d’activité (Partie 1), de maintenir le pouvoir d’achat des salariés (Partie 2) et d’alléger les charges des entreprises (Partie 3) sont désormais le quotidien des professionnels des ressources humaines qui doivent composer avec ces nouvelles normes.
Ce foisonnement de textes législatifs et réglementaires, entremêlés d’annonces gouvernementales parfois obscures, imposent de se tenir régulièrement informé des dernières évolutions afin de maitriser leurs impacts en paie.
Par souci de clarté, ces différentes problématiques et leurs conséquences en paie sont synthétisées sous forme de tableaux ci-après.
Partie 1 : Faire face à une réduction d’activité
I. Activité partielle/APLD



II. Impact de l’activité partielle sur les indemnités de rupture

III. Impact de la crise sur les congés payés

Partie 2 : Maintien du pouvoir d’achat des salariés
I. Indemnisation des arrêts de travail des salariés et activité partielle
A. Salariés en arrêts de travail dérogatoires
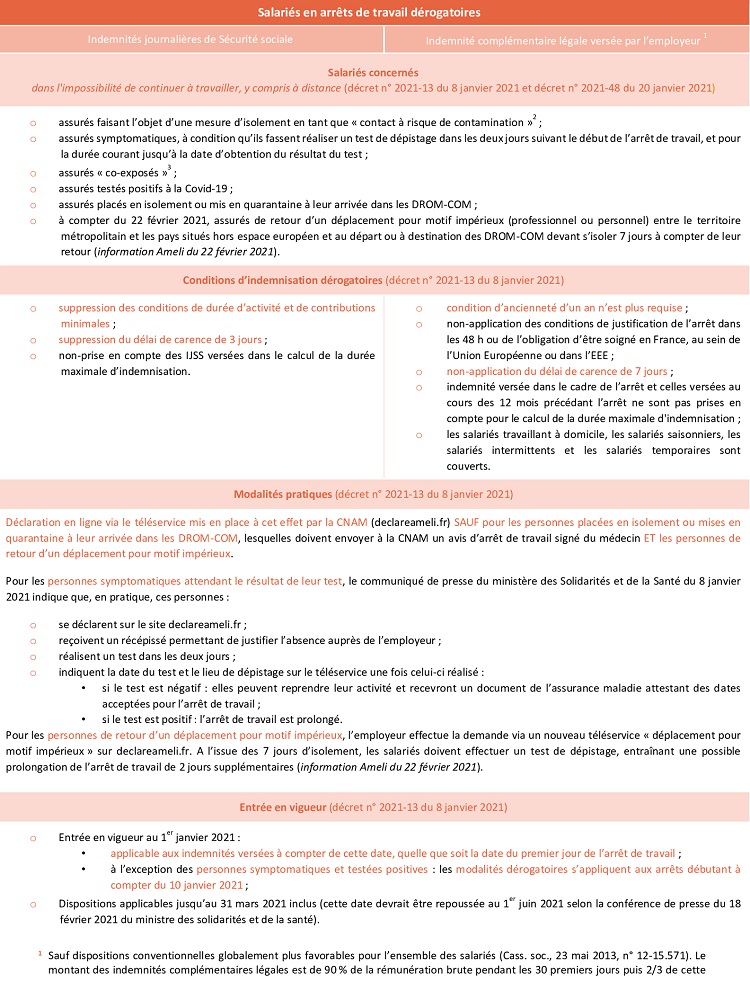

B. Salariés placés en situation d’activité partielle

4 Depuis le 12 novembre 2020, sont considérés comme salarié(e)s vulnérables les salarié(e)s qui satisfont aux deux conditions cumulatives ci-dessous :
Condition n°1 - Le salarié doit être dans au moins l’une des situations limitativement énumérées par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 (par exemple : être âgé de 65 ans et plus ; avoir des antécédents cardiovasculaires ; avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications)
Condition n°2 - Le salarié ne doit ni pouvoir recourir totalement au télétravail ni bénéficier des mesures de protection sanitaires renforcées (isolement du poste de travail ; respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés, etc.)
5 Il convient de distinguer deux périodes distinctes (décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 ; décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020) :
- jusqu’au 31 décembre 2020 : l’indemnité versée par l’employeur au salarié est égale à 70 % de la rémunération horaire brute ;
- à compter du 1er janvier 2021 : l’indemnité versée par l’employeur au salarié est égale à 70 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
II. Frais liés au télétravail
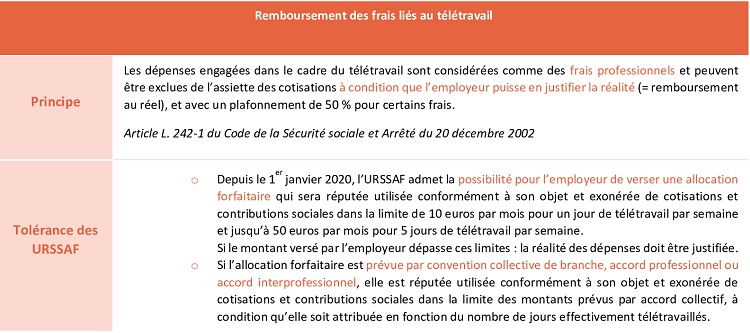
Partie 3 : Allègement des charges sociales des entreprises
I. Allègement des charges sociales des entreprises
A. Report des charges sociales et des cotisations AGIRC-ARRCO
Afin d’accompagner la trésorerie des entreprises, des reports de cotisations sociales et de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO sont accordés depuis le mois de mars 2020 (communiqués ACOSS et AGIRC-ARRCO).
Selon les périodes d’emploi concernées, le report :
- a été automatique ou a dû faire l’objet d’une demande préalable auprès de l’URSSAF ;
- concernait à la fois les cotisations patronales et salariales ou uniquement les cotisations patronales ;
- devait ou non être justifié par une fermeture ou une restriction d’activité.
En tout état de cause, aucune pénalité ni majoration de retard n’est appliquée.
Pour les prochaines échéances des 5 et 15 mars 2021, les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics pourront une nouvelle fois reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations patronales et salariales.
Les entreprises concernées devront remplir un formulaire unique de demande préalable, valant à la fois pour les cotisations URSSAF et pour les cotisations AGIRC-ARRCO. En l’absence de réponse de l’URSSAF sous 48 heures, le report est considéré comme acquis.
L’URSSAF contactera ultérieurement les employeurs pour leur proposer un plan d’apurement de leurs dettes.
B. Mesures exceptionnelles « URSSAF »
1) 1er volet des mesures (article 65 de la LFR 3 pour 2020 et décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020)

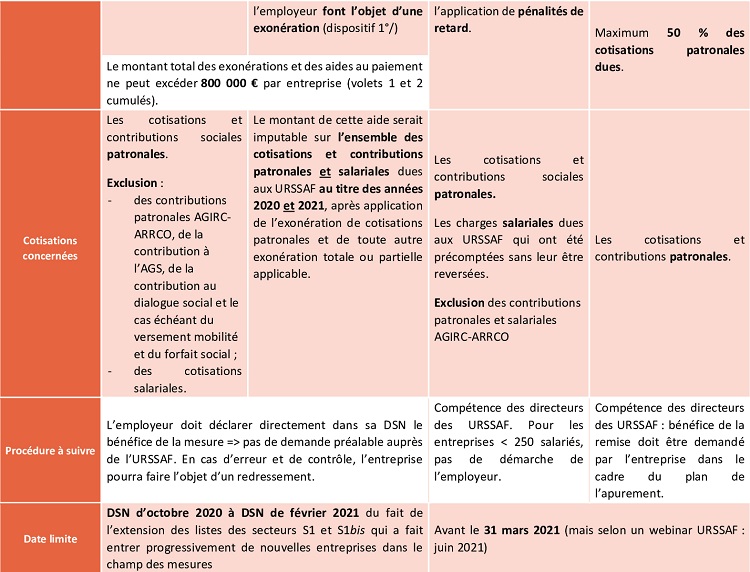
2) 2ème volet des mesures (LFSS pour 2021, art. 9 et décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021)


3) Comparaison des Volets 1 et 2 des mesures exceptionnelles URSSAF
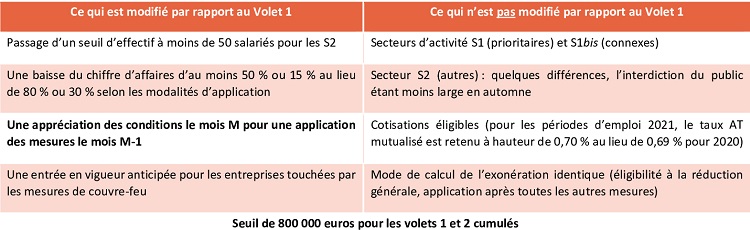
[1] INSEE Première, L’impact de la crise sanitaire sur l’organisation et l’activité des sociétés, décembre 2020, n° 1830 [en ligne].
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476590
[Jurisprudence] Affaire Wildenstein : fin du troisième volet pénal
Réf. : Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 18-84.570, FS-P+B+I (N° Lexbase : A56144BK)
Lecture: 19 min
N6534BYN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire Litaudon, Avocat associé CM & L AVOCATS
Le 24 Février 2021
Mots-clés : fraude fiscale • prescription • taxation des trusts
Par un arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation décide que le délit de fraude fiscale est susceptible de réitération.
Elle précise également que les héritiers avaient l’obligation, dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011 (loi n° 2011-900, du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L0278IRQ), de déclarer à la succession de leur auteur les biens que ce dernier avait placés dans un trust étranger dès lors qu’il ne s’en était pas dessaisi de manière effective et irrévocable de son vivant, afin qu’ils soient assujettis aux droits de mutation.
Aux termes de l’arrêt commenté, la Cour de cassation met un terme, au moins de manière provisoire, à un dossier de droit pénal fiscal qui a défrayé la chronique, tant judiciaire que médiatique, pendant plus de deux décennies.
Cette affaire trouve son origine dans le décès à Paris, en octobre 2001, du marchand d’art Daniel Wildenstein, qui avait constitué de son vivant plusieurs trusts de droit étranger, dans lesquels étaient logées diverses propriétés immobilières, œuvres d’art ou parts de sociétés.
Lors de son décès, Daniel Wildenstein a laissé pour lui succéder, sa veuve, Madame Sylvia Roth, et ses deux fils, Guy et Alec Wildenstein, nés d’une précédente union.
Une première déclaration de succession a été déposée par Messieurs Guy et Alec Wildenstein en avril 2002, après que leur belle-mère ait renoncé à la succession de feu son époux. Cette déclaration ne faisait aucune mention des trusts créés par Monsieur Daniel WILDENSTEIN. Les droits de succession, ainsi liquidés, s’élevaient à une somme de 17 753 829 euros et ont été acquittés par dation en paiement d’œuvres d’art.
Par la suite toutefois, Madame Sylvia Roth a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de faire annuler sa renonciation à la succession de son époux. Après plusieurs années de procédure, et par un arrêt en date du 14 avril 2005, la Cour d’appel de Paris a fait droit aux demandes de Madame Roth, et annulé à la fois sa renonciation à succession, et la déclaration de succession déposée en 2002.
Entre temps, et plus précisément le 17 février 2008, Alec Wildenstein est à son tour décédé, également en France. Il a laissé pour lui succéder sa veuve, Liouba Stoupakova, ainsi que ses deux enfants, Alec Junior Wildenstein et Diane Wildenstein.
Ses héritiers ont déposé une déclaration de succession le 23 février 2009, ne faisant pas davantage mention des biens placés en trust.
Le 3 avril 2008, compte tenu de l’annulation par la cour d’appel de Paris de la première déclaration de succession déposée, l’Administration fiscale a adressé aux héritiers de Daniel Wildenstein (originaires ou venant à la succession par représentation d’Alec Wildenstein) une mise en demeure d’avoir à déposer une nouvelle déclaration de succession.
Celle-ci, déposée le 31 décembre 2008, ne faisait toujours pas mention de l’existence des trusts.
L’administration a ouvert une procédure de vérification de ces deux déclarations de succession.
En ce qui concerne la déclaration de succession d’Alec Wildenstein, elle a adressé une proposition de rectification aux héritiers le 8 décembre 2014, par laquelle elle réintégrait à la succession la quote-part des biens issus de la succession de Daniel Wildenstein et placés en trust, ainsi que les biens contenus dans des trusts constitués par Alec Wildenstein lui-même, ce qui représentait un actif net de 301 millions d’euros.
Une contestation a été formée devant le juge de l’impôt, en l’espèce devant le tribunal de grande instance de Paris, qui l’a rejetée, mais la décision n’est pas définitive à ce jour.
Le 5 juillet 2010, Madame Sylvia Roth a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des faits qu’elle qualifiait notamment d’abus de confiance et de blanchiment. Madame Stoupakova s’est également constituée partie civile, les deux veuves reprochant notamment aux trustees de leur avoir caché l’existence de trusts dont elles auraient dû être les bénéficiaires, et de ne pas les avoir déclarés à la succession de leurs époux décédés.
Pour sa part, l’administration fiscale, après avoir exercé son droit de communication auprès du magistrat instructeur en charge du dossier, a saisi la commission des infractions fiscales de deux propositions de plaintes, à l’encontre des héritiers de Daniel et d’Alec Wildenstein sur le fondement des articles 1741 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6015LMQ) et du 3ème alinéa de l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales (dans sa version en vigueur au 30 décembre 2009) (N° Lexbase : L6506LUI), et donc sans que les contribuables soient informés de cette saisine.
Après avis conforme de la commission des infractions fiscales, deux plaintes ont été déposées pour présomptions caractérisées de fraude fiscale par dissimulation d’actifs placés dans les trusts. Ces plaintes ont ensuite été jointes au dossier d’instruction déjà ouvert consécutivement à la plainte des veuves.
En cours d’instruction, la Direction Générale des Finances Publiques s’est constituée partie civile du chef de fraude fiscale, tandis que l’État français s’est constitué partie civile du chef de blanchiment (pour la distinction entre le préjudice de l’État et celui de l’administration fiscale, voir Cass. crim., 29 janvier 2020, n° 17-83.577, F-P+B+I N° Lexbase : A83173CZ).
Le magistrat instructeur a mis en examen les héritiers de Daniel et Alec Wildenstein (à l’exception de Diane Wildenstein), mais également un notaire, un avocat, le protecteur des trusts et certains des trustees, des chefs de fraude fiscale, de complicité de fraude fiscale, et de blanchiment de fraude fiscale.
À l’issue de l’information, toutes les personnes mises en examens ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris.
Le premier jour d’audience, les prévenus ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité du cumul des poursuites pénales (exercées sur le fondement de l’article 1741 du Code général des impôts) et fiscales (exercées sur le fondement de l’article 1729 du même Code N° Lexbase : L4733ICB), qui a été transmise à la Cour de cassation (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 16-90.001, FS-P+B+I N° Lexbase : A5104RAB ; voir également Cass. crim., 30 mars 2016, n° 16-90.005, FS-P+B N° Lexbase : A1597RBR) puis au Conseil constitutionnel.
Aux termes d’une décision en date du 24 juin 2016 (cons. const., décision n° 2016-545 QPC, du 24 juin 2016 N° Lexbase : A0909RU9 ; cons. const., décision n° 2016-546 QPC, du 24 juin 2016 N° Lexbase : A0910RUA), le Conseil constitutionnel a estimé que l’application combinée des deux dispositions précitées n’était pas contraire à la Constitution, tout en assortissant sa décision de trois réserves d’interprétation.
Le dossier est donc revenu devant le tribunal correctionnel de Paris pour être jugé au fond.
Deux questions essentielles se posaient : la première concernait le problème de l’éventuelle prescription des poursuites en ce qui concerne la succession de Daniel Wildenstein, tandis que la seconde concernait une question de fond, à savoir si les biens placés en trust par les de cujus devaient être mentionnés dans les déclarations de succession avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011, traitant expressément de la problématique de l’imposition des trusts par décès.
La question était juridiquement ardue, et a conduit les juges du fond à prononcer deux décisions de relaxe, sous des motivations partiellement distinctes.
Ainsi, dans son jugement du 12 janvier 2017, le tribunal, après avoir mené une analyse de la jurisprudence afférente à la fiscalité des trusts, a décidé qu’aucune règle fiscale suffisamment claire n’imposait, avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, d’intégrer les biens placés en trust et survivant au décès du constituant dans les déclarations de succession.
Il a déduit de ce qui précède que l’élément légal de l’infraction faisait défaut, et a prononcé une relaxe générale de ce chef.
Il ne s’est en revanche pas prononcé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du délit de fraude fiscale en ce qui concerne la déclaration de succession de Daniel Wildenstein qui lui avait été soumise du fait de cette relaxe.
Saisie de l’entier litige, la Cour a procédé différemment.
Elle a d’abord statué sur cette fin de non-recevoir et a déclaré les poursuites prescrites en ce qui concerne la déclaration de succession de Daniel Wildenstein.
S’agissant de la fraude fiscale poursuivie comme ayant été commise à l’occasion de la déclaration de succession d’Alec Wildenstein, elle a confirmé la décision de relaxe, en corrigeant toutefois la motivation adoptée par le tribunal, et en décidant quant à elle que l’élément matériel (et non légal) de l’infraction n’était pas constitué.
La Cour de cassation a été saisie sur pourvoi du Parquet et des parties civiles.
Aux termes d’une décision particulièrement didactique, elle a cassé l’arrêt d’appel qui lui était soumis, et a mis un terme aux controverses juridiques que ce dossier avait fait naître.
Elle décide ainsi d’une part que le délit de fraude fiscale est susceptible d’être réitéré (I) et, d’autre part, qu’il existait une obligation, avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011, de déclarer à la succession les biens placés en trust par le de cujus (II).
I - Sur l’admission de la réitération du délit de fraude fiscale
Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce de manière inédite sur la problématique de la réitération du délit de fraude fiscale.
Ainsi que le rappelle la Haute Juridiction, l’article 1741 du Code général des impôts dispose que « commet le délit de fraude fiscale celui qui s’est frauduleusement ou a tenté de se soustraire à l’établissement et au paiement total ou partiel des impôts, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt [...] ».
L’article L. 230 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9536IYT), dans sa version applicable aux faits de l’espèce prévoyait que « Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise » (depuis la loi depuis la loi 2013-1117, du 6 décembre 2013, la prescription est de six ans N° Lexbase : L6136IYW).
En l’espèce, le problème de la prescription ne se posait qu’en ce qui concerne la déclaration de succession de Daniel Wildenstein.
Les prévenus soutenaient que la prescription était acquise s’agissant de cette déclaration, étant donné qu’elle avait été déposée en 2002 sans qu’un acte interruptif de prescription n’intervienne dans le délai de 3 ans précité, le premier acte interruptif datant de 2011.
Ils soutenaient ainsi que le dépôt de la deuxième déclaration de succession (datant de 2008) ne pouvait être pris en compte, étant donné que le délit de fraude fiscale est un délit instantané, non susceptible de réitération, qui avait été entièrement consommé lors du dépôt de la première déclaration.
Les parties civiles et le Parquet soutenaient pour leur part que la deuxième déclaration devait être prise en considération, le délit pouvant parfaitement être réitéré.
La cour d’appel s’était laissé convaincre par le raisonnement des prévenus, mais la Cour de cassation casse sèchement la décision, en rappelant sa jurisprudence antérieure aux termes de laquelle, dans une hypothèse de soustraction de sommes sujettes à l’impôt, la prescription commence à courir le jour où « une déclaration inexacte est produite auprès des services fiscaux » (Cass. crim. 13 décembre 1982, n° 80-95.151 N° Lexbase : A9457ATG).
La motivation de la Cour quant au point de départ de la prescription n’est donc pas surprenante.
En revanche, l’arrêt est novateur en ce que la haute juridiction décide qu’une nouvelle déclaration inexacte déposée dans le cadre d’une même procédure fait courir un nouveau délai de prescription et est constitutif d’un nouveau délit de fraude fiscale.
Elle consacre donc par cet arrêt la possibilité d’une réitération de ce délit.
L’affaire commentée étant empreinte de particularité, ce problème ne se posera à notre avis que dans des hypothèses relativement réduites, mais cette décision tranche en tous cas clairement l’une des difficultés spécifiques posées par ce dossier fleuve.
II - Sur l’obligation de déclarer les biens placés en trust
Au-delà de ce problème procédural, la véritable portée de la décision se trouve dans la cassation prononcée en ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction.
On rappellera brièvement à titre liminaire, que le trust, mécanisme de droit anglo-saxon est une institution par laquelle un constituant (propriétaire de biens) se dépossède de ces derniers, en créant un patrimoine séparé du sien, dont il confie la gestion à un trustee, chargé de les gérer et de les distribuer à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, le cas échéant sous la protection d’un protecteur.
On précisera également qu’un trust est déclaré irrévocable lorsque le constituant se dessaisit de manière définitive des biens en les plaçant en trust, et de discrétionnaire lorsque le constituant perd tout pouvoir de gestion de ces derniers.
En l’espèce, l’essentiel de la fortune de la famille Wildenstein est placée en trust depuis plusieurs générations.
Au moment des successions de leurs auteurs, les héritiers ont décidé de ne pas déclarer les biens placés en trust, estimant qu’ils ne faisaient pas partie du patrimoine des de cujus d’une part, et qu’aucune disposition fiscale expresse leur faisait obligation de les déclarer d’autre part.
Ils estimaient ainsi que l’article 750 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L9528IQX), dans sa version applicable aux faits de l’espèce qui disposait que « sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêt, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque la donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B » n’était pas suffisamment large pour y inclure les biens placés en trust.
Ils faisaient également valoir que ces biens ne pouvaient être taxés étant donné qu’ils ne se dénouaient pas à la mort de leurs auteurs et n’étaient donc pas transmis par succession.
Ils indiquaient enfin qu’avant l’intervention de la loi du 29 juillet 2011, aucune taxation des biens placés en trust n’était prévue par le Code général des impôts en cas de succession.
L’administration faisait pour sa part valoir les trusts auraient dû être intégrés aux déclarations de succession, compte tenu de la rédaction large de l’article 750 ter précité, de la jurisprudence civile et fiscale antérieure rendue à propos des trusts, et du fonctionnement réel de ces derniers, qui démontrait selon elle que les constituants ne s’étaient pas dessaisis des biens.
Le tribunal puis la Cour ont examiné chacun de ces arguments.
Ils ont l’un et l’autre constaté que le principe d’imposition avait été codifié à l’article article 792-0 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L6036LMI), à l’occasion de l’adoption de la loi de finances du 29 juillet 2011, lequel assujettit expressément la transmission de biens placés en trust aux droits de mutation à titre gratuit, que ces biens soient transmis par donation ou succession, et ceci même si les trusts survivent au décès du constituant, sans transmission du capital qui les composent. L’article 750 ter précité a au demeurant été complété par renvoi à ce texte par la même loi.
Ne se cantonnant toutefois pas à cette interprétation littérale, ils ont étudié la jurisprudence qui leur était soumise par la partie civile.
Plusieurs décisions avaient en effet été rendues de longue date sur cette problématique.
Ainsi, par un jugement très ancien en date du 10 décembre 1890, le tribunal civil de la Seine avait déjà décidé que les biens placés en trust et échus par décès à l’époux du constituant, devaient être soumis aux droits de mutation à titre gratuit dès lors que le de cujus ne s’en était en réalité jamais dépossédés de son vivant.
D’autres arrêts, largement commentés, avaient été rendus par la suite par la cour de cassation.
Ainsi, par un premier arrêt en date du 20 février 1996 (n° 93-1955), la Cour de cassation avait décidé que la transmission de biens par le biais d’un trust révocable devait être qualifiée de donation indirecte.
Dans un arrêt du 15 mai 2007, la Cour de cassation (Cass. com., 15 mai 2007, n° 05-18.268, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A2263DWQ) avait également décidé que, dans l’hypothèse d’un trust irrévocable, « la remise des biens aux bénéficiaires, lors du décès du constituant [...] devait être qualifiée de mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust ».
De même, dans deux arrêts rendus les 31 mars 2009 (Cass. com., 31 mars 2009, n° 07-20.219 N° Lexbase : A5124EEI) et le 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-14.591, FS-D N° Lexbase : A8605KIK) la Cour de cassation avait décidé que les biens logés dans un trust devaient être taxés à l’ISF étant donné qu’ils ressortaient des constatations faites par les juges du fond qu’ils n’étaient ni discrétionnaires, ni irrévocables, et qu’ils n’étaient donc pas sortis du patrimoine du constituant.
Après avoir analysé la jurisprudence précitée, le tribunal puis la Cour ont toutefois décidé que la jurisprudence n’était pas suffisamment établie, pour permettre « d’affirmer qu’il existait, avant la loi du 29 juillet 2011 […] une obligation, suffisamment claire et certaine, portant obligation de déclarer les biens placés dans un trust, qui plus est, les biens logés dans un trust perdurant au décès de leur constituant, catégorie pour laquelle la loi a instauré une imposition spécifique ».
Cette motivation a donc été soumise à la Cour de cassation dans le deuxième moyen du pourvoi.
La Cour a de nouveau sèchement cassé la décision en affirmant que « c’est à tort que les juges ont retenu l’absence, avant la loi du 29 juillet 2011, de toute obligation de déclarer, lors d’une succession, les biens placés en trust ».
Pour expliquer la cassation prononcée, la haute juridiction est d’abord revenue sur la jurisprudence précitée, et notamment sur celle rendue par la Cour de cassation à partir de 1996.
Ce faisant, elle a expliqué que le principe de l’imposition des trusts en droit français était acquis avant 2011, et qu’il convenait, dans chaque hypothèse, de « s’attacher aux effets concrets du trust concerné, tel qu’établi par la loi étrangère applicable » afin de déterminer s’il a réalisé un transfert de propriété par décès ou si à l’inverse le constituant ne s’était pas dessaisi des biens placés en trust.
Elle a ensuite fait référence aux travaux parlementaires de la loi de 2011, en indiquant que l’intervention du législateur n’avait eu alors pour but que de « confirmer, préciser et compléter le régime fiscal antérieur ».
Elle a ainsi exposé que, « même avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011, lorsque le constituant d’un trust de droit étranger, fût-il, aux termes de l’acte de trust, qualifié de discrétionnaire, irrévocable, et ne prenant pas fin à son décès, ne s’est pas irrévocablement et effectivement dessaisi des biens placés, ses héritiers sont tenus de les déclarer lors de la succession » et a ajouté que « par voie de conséquence, la méconnaissance de cette obligation déclarative, est susceptible de caractériser le délit de fraude fiscale ».
Elle a enfin donné des directives très claires à la cour de renvoi en indiquant « Dès lors, il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi ».
Il appartiendra à la cour d’appel de Paris, autrement composée, de répondre à cette question.
Elle devra analyser le fonctionnement de chacun des trusts qui lui seront soumis, et veiller à ne pas procéder par affirmations équivoques ou contradictoires, de manière à permettre à la Cour de cassation d’exercer ensuite son contrôle sur la motivation, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire dans l’arrêt rapporté.
Il lui appartiendra par ailleurs, si elle estime que l’infraction primaire est constituée, de statuer sur les faits de blanchiment subséquents également poursuivis et qui n’ont jamais été examinés, compte tenu des relaxes antérieures.
Cet arrêt, aussi important soit-il, ne met ainsi pas un terme définitif à la saga Wildenstein.
La suite donc au prochain épisode !
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476534
[Brèves] Dispense de déclaration de la créance admise au passif d'une précédente procédure : attention au renouvellement des sûretés !
Réf. : Cass. com., 17 février 2021, n° 19-20.738, F-P (N° Lexbase : A62294H8)
Lecture: 5 min
N6552BYC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 24 Février 2021
► Si l'admission de la même créance à la procédure de sauvegarde permet au créancier, en application de l'article L. 626-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L8805LQ8), de ne pas la déclarer à nouveau à la procédure de liquidation ouverte après résolution d'un plan ainsi que les warrants qui la garantit, elle ne le dispense pas, conformément à l'article L. 342-7, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3900AE8), de renouveler l'inscription de ces derniers après l'expiration du délai de cinq ans fixé par ce texte et jusqu'au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées ;
Et, l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées et cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte par l'article L. 626-27 au créancier, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement.
Faits et procédure. Une société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au passif de laquelle ont été admises diverses créances. L'admission des créances d’une créancière a été prononcée, pour partie, à titre privilégié, sur le fondement de deux warrants agricoles. Le plan de sauvegarde arrêté au profit de la société débitrice ayant été résolu par un jugement qui a également prononcé la liquidation judiciaire, la créancière a indiqué au liquidateur que subsistait un solde de sa créance et a demandé son admission à titre privilégié dans la nouvelle procédure. Faisant valoir que l'inscription des warrants n'avait pas été renouvelée, le liquidateur s'y est opposé et le juge-commissaire a prononcé une admission à titre seulement chirographaire.
La cour d’appel (CA Rennes, 4 juin 2019, n° 16/05653 N° Lexbase : A1973ZDG) ayant déclaré irrecevable la contestation de la proposition d'admission de sa créance formée par le liquidateur, la créancière a formé un pourvoi en cassation.
Décision. la Cour de cassation retient d’abord que c’est à tort que la cour d’appel a opposé au créancier son absence de réponse, dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L7291IZ3), à la contestation par le liquidateur du caractère privilégié de sa créance, dès lors que celle-ci, admise au passif de la procédure de sauvegarde, devait, en l'absence de toute modification, être admise de plein droit au passif de la liquidation judiciaire sous la seule déduction des sommes déjà perçues, cette créance n'étant pas soumise à une nouvelle vérification ni, par conséquent, à la sanction de l'article L. 622-27 précité. Toutefois, pour la Haute juridiction, l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure.
En effet, elle énonce que si l'admission de la même créance à la procédure de sauvegarde permettait au créancier, en application de l'article L. 626-27 du Code de commerce, de ne pas la déclarer à nouveau à la procédure de liquidation ouverte après résolution d'un plan ainsi que les warrants qui la garantissaient, elle ne le dispensait pas, conformément à l'article L. 342-7, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, de renouveler l'inscription de ces derniers après l'expiration du délai de cinq ans fixé par ce texte et jusqu'au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées. L’autorité de la chose jugée attachée à l’admission à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées, et cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte par l'article L. 626-27 précité au créancier, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement.
Or, le liquidateur et la société débitrice, dont la discussion ne portait que sur le caractère privilégié de la créance, ayant fait valoir expressément, dans leurs conclusions d'appel, qu'il n'était « pas contesté que les warrants [...] n'avaient pas fait l'objet, avant leur expiration, d'un renouvellement » et qu'il était « constant que, lors de la résolution du plan de sauvegarde et au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la [créancière] avait perdu le bénéfice de sa sûreté », cette dernière n'a pas, en réplique à ces conclusions, prétendu qu'elle aurait procédé au renouvellement de l'inscription des warrants.
Ainsi, le pourvoi est rejeté, le moyen, en ce qu'il tend à contester la proposition d'admission à titre chirographaire du liquidateur, étend, selon la Haute juridiction, inopérant.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le domaine de la déclaration de créance, La créance antérieure admise au passif d'une précédente procédure, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E0347EX7). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476552
[Brèves] Mise en cause de l’assureur en appel : la liquidation judiciaire ne constitue pas une évolution du litige !
Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2021, n° 18-16.535, F-P+I (N° Lexbase : A45084G3)
Lecture: 4 min
N6501BYG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 25 Février 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 11 février 2021, vient d’effectuer un revirement de sa jurisprudence ; elle énonce que l’ouverture, après le jugement, d’une procédure collective n’a pas pour effet de modifier les données juridiques du litige, et ne constitue pas une évolution de ce dernier permettant, pour la première fois en cause d’appel, la mise en cause de l’assureur ; en conséquence, l’assignation en intervention forcée, faute d’évolution du litige au sens de l’article 555 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6706H7I) sera déclarée irrecevable.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un contrat de fournitures de pièces constituant l’un des composants de boîtes automatiques destinées à équiper des véhicules automobiles a été conclu entre la société General Motors Strasbourg et la société Sidéo RDT, assurée auprès de la société Allianz. Le traitement thermique de durcissement de ces pièces a été confié par la société Sidéo RDT à la société Amyot, assurée au titre de sa responsabilité civile par la société Generali. Lors d’un contrôle interne, il a été découvert que certaines des pièces commandées n’avaient pas fait l’objet d’un traitement thermique, la société General Motors Strasbourg, aujourd’hui dénommée la société PPS, a assigné la société Sidéo RDT en paiement de dommages-intérêts et de frais financiers. Cette dernière a assigné en garantie la société Amyot. La société PPS a formé contre la société Allianz, intervenue volontairement dans la procédure, une demande de condamnation à garantir son assurée.
Par jugement rendu le 14 juin 2013, la société Amyot a été condamnée à garantir dans une certaine limite, la société Sidéo RDT et son assureur Allianz des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société PPS. Le 6 octobre 2014, la société Amyot a été placée en redressement judiciaire, puis, le 23 septembre 2015, en liquidation judiciaire, et un liquidateur judiciaire a été désigné.
Le 25 juillet 2013, la société Allianz a interjeté appel de la décision, puis elle a assigné le 11 mai 2016, la société Generali en intervention forcée.
Le pourvoi. La société Generali fait grief à l’arrêt (CA Colmar, 14 mars 2018, n° 13/03711 N° Lexbase : A9211XGA) d’avoir violé l’article 555 du Code de procédure civile, en déclarant recevable sa mise en cause par la société Allianz. L’intéressée énonce que l’appel en garantie de l’appelante aurait pu être effectué dès la première instance, du fait que la société Allianz avait été appelée en la cause à ce stade de la procédure. En l’espèce, la cour d’appel, pour déclarer recevable la mise en cause de la société Generali par la société Allianz, retient que la première, qui n’était pas partie à l’instance, a été assignée en intervention forcée devant la cour d’appel. Les juges d’appel ont également retenu que la société Amyot avait été placée en liquidation judiciaire postérieurement au jugement frappé d’appel, ce qui constitue une évolution du litige rendant recevable la mise en cause de la société Generali afin de garantir la société Amyot des condamnations prononcées à son encontre.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 555 du Code de procédure civile, les Hauts magistrats censurent le raisonnement de la cour d’appel, en énonçant les dispositions du texte précité, selon lesquelles « les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
Solution. Après avoir donné avis aux parties, la Cour suprême statuant sur le fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée à l’encontre de la société Generali, retenant qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la mise hors de cause. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt sans renvoi, retenant que la SCP désignée en qualité de liquidateur de la société Aymot sera seule tenue de relever et garantir la société RDT et la société Allianz de l’ensemble de leurs condamnations.
| Conseil pratique : nous ne pouvons que conseiller de ne pas omettre d’assigner l’assureur dès la première instance, afin de ne se pas se heurter à une irrecevabilité en appel. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476501
[Brèves] La réparation du préjudice moral de l’enfant conçu du fait du décès de ses grands-parents
Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2021, n° 19-23.525, F-P+I (N° Lexbase : A80064GM)
Lecture: 2 min
N6535BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 25 Février 2021
► Le préjudice moral de l’enfant conçu avant l’accident ayant causé le décès de l’un de ses grands-parents, mais né après cet accident, est réparable.
Faits et solution. La réparation du préjudice moral de l’enfant conçu avant l’accident ayant causé le décès de l’un de ses ascendants, mais né après cet accident, fait décidément couler beaucoup d’encre ces derniers mois.
Alors que le 10 novembre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’alignait sur la position retenue par la deuxième chambre civile et admettait que le préjudice de l’enfant ayant perdu son père à la suite d’un accident de la circulation est un préjudice réparable (Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-87.136, FS-P+B+I N° Lexbase : A512734N), cette même chambre civile admet aujourd’hui que « l’enfant conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès ».
En l’espèce, le représentant légal d’un enfant demandait réparation en son nom du préjudice moral subi du fait du décès de son grand-père lequel avait été tué par arme blanche. Ce faisant, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi formé par le fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infraction contre l’arrêt d’appel (CA Bordeaux, 16 mai 2019), qui considérait, pour l’essentiel, que le lien de causalité entre le décès de la victime et le dommage moral n’était pas caractérisé.
Apport de l’arrêt. En admettant la possibilité pour l’enfant conçu au jour du décès d’obtenir réparation de son préjudice, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation abandonne la solution qu’elle retenait par le passé, considérant alors « qu’il n’existait aucun lien de causalité entre le décès (du grand-père de l’enfant) et le préjudice subi par sa petite-fille (…), née postérieurement à ce décès » (Cass. civ. 2, 4 octobre 2012, n° 11-22.764, F-D N° Lexbase : A9633ITX, v. également Cass. civ. 2, 4 novembre 2010, n° 09-68.903, FS-P+B N° Lexbase : A5619GDH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476535
[Jurisprudence] Voies d'exécution : Million dollar tiers saisi
Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2021, n° 19-12.424, FS-P+I (N° Lexbase : A81584EU)
Lecture: 16 min
N6575BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sylvian Dorol, Huissier de justice associé (Vénézia & Associés) - Intervenant à l’ENM, EFB, HEDAC et INCJ - Chargé d’enseignement (Paris X et XIII)
Le 24 Février 2021
Mots-clés : huissier • tiers saisi • saisie-conservatoire • biens meubles •responsabilité
Le tiers saisi, qui ne répond pas à l’interpellation de l’huissier de justice lors d’une mesure conservatoire, s’expose à une condamnation aux causes de la saisie, même si le créancier saisissant a pu obtenir les informations souhaitées ultérieurement et auprès d’un autre tiers.
Le tiers saisi, même s’il a répondu de manière exacte à la saisie, engage sa responsabilité s’il fournit par la suite au créancier saisissant des informations inexactes ou mensongères. Il s’expose ainsi à une condamnation à des dommages-intérêts.
La parole est d’or, et le silence est d’argent. Non, ce n’est pas une erreur. Pour le tiers saisi, et contrairement au proverbe, la parole est d’or et le silence est d’argent. La règle n’est pas aussi poétiquement formulée par le législateur dans le Code des procédures civiles d’exécution, mais y est exprimée clairement et sans nul doute. En effet, la place des tiers est déterminée de manière générale par l’article L. 213-1 du Code des procédures civiles de l’exécution (N° Lexbase : L5655LWD) qui dispose « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur ». Les obligations du tiers saisi sont rappelées au fil du code, et notamment à l’article R. 523-5 du même code (N° Lexbase : L2566IT9) qui dispose que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ». Les choses sont donc claires : le tiers saisi doit répondre, sous peine de sanction. Mais la clarté de l’affirmation ne peut occulter les zones d’ombres tapies au cœur des affaires portées devant les juridictions. En témoigne l’arrêt rendu le 4 février 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dont la portée est toute autant pratique que théorique.
Les faits étant extrêmement complexes, il convient de les rappeler brièvement pour bien comprendre cette décision.
Sur le fondement de deux ordonnances du 12 février 2016, la société P. a fait pratiquer une saisie conservatoire sur des biens meubles en garantie de la somme de 600 000 euros. Ces biens étaient en dépôt entre les mains des sociétés du groupe A. opérant en France. Plusieurs saisies ont donc été opérées entre les mains de différentes sociétés de ce groupe.
Le jour des saisies, la société A. France services a déclaré ne pas être débitrice du débiteur et la société A. EU s’est abstenue de répondre. Par la suite, la société A. France services a déclaré à l’huissier de justice que les biens appartenant au débiteur avaient été bloqués entre les mains de la société A. France Logistique, auprès de qui pourtant aucun acte n’avait été régularisé. C’est pourquoi, cette dernière interrogée a déclaré que les biens n’avaient pas été bloqués car aucune saisie conservatoire n’avait été effectuée auprès d’elle.
Pour synthétiser les faits, il est possible de raisonner en trois temps : au sein du même groupe, une société s’est abstenue de répondre à l’huissier de justice, une deuxième a répondu de manière eronnée en engageant une troisième, laquelle n’a été tiers saisi qu’ultérieurement. Dans ces conditions, il semble évident que le créancier saisissant ait introduit une action en justice en vue de voir reconnaître la responsabilité des tiers saisis. La cour d’appel ayant condamné les tiers saisis, et au regard des sommes en jeu, il n’est guère surprenant qu’ils aient formé un pourvoi en cassation.
Deux problématiques se dégageaient : d’abord, il était question de savoir si le fait que le créancier saisissant ait trouvé satisfaction dans une autre mesure conservatoire constitue un « motif légitime » exonérant le tiers saisi initial de son obligation de réponse. Puis, il était question de déterminer si seule la réponse immédiate de l’huissier de justice est susceptible d’engager la responsabilité du tiers saisi, ou si les précisions ultérieures le sont également. En d’autres termes, il était question de l’effet de l’écoulement du temps sur les obligations des tiers saisis.
Les réponses de la Cour de cassation sont sans équivoque et éclairent à la fois sur le rapport du temps et de la qualité de tiers saisi (I), ainsi que sur les rapports du temps et de la réponse à la mesure conservatoire (II).
I. La qualité de tiers saisi dans le temps
Être ou ne pas être tiers saisi ? La question ne se pose pas à la lecture de l’arrêt commenté qui renseigne à propos de la durée dans le temps de la notion de tiers saisi : quand le tiers saisi le devient-il (A) ? Quand cesse-t-il de l’être (B) ?
A. La naissance de la qualité du « tiers saisi »
On ne choisit pas d’être tiers saisi, on le devient. Non par la force des choses, mais par la simple interpellation d’un huissier de justice lors d’une mesure de saisie. C’est donc la signification de cet acte qui fait naître les obligations du tiers saisi, lesquelles sont de répondre à l’huissier de justice et de fournir les renseignements demandés. Il est important de souligner le fait que, même si l’acte de saisie est irrégulier ou s’il excipe d’un motif légitime pour ne pas répondre, il n’est demeure pas moins que la simple signification de l’acte attribue la qualité de tiers saisi. En effet, il n’appartient pas à ce dernier de juger de la validité d’un acte d’huissier (c’est au seul juge de l’exécution que revient cette prérogative), et le motif légitime exonère le tiers de son obligation de réponse immédiate, mais non de sa qualité tant que le juge ne l’a pas décidé. Pour cette raison, la formule employée par la Cour de cassation (« l'huissier de justice invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur »), bien que reprenant l’écriture de l’article R. 221-21 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2266IT4), n’est pas conforme à la réalité juridique : le tiers saisi n’est pas « invité » à communiquer, mais davantage sommé de le faire dans la mesure où c’est sa collaboration qui est attendue et que sa résistance, qu’elle soit silencieuse ou mensongère, sera sanctionnée.
Dans le cas d’espèce, il est possible de conclure à la lecture de la décision de la Cour de cassation commentée, que la qualité de tiers saisi n’est attribuée qu’à l’unique personne (physique ou morale) interpellée par l’huissier de justice. La qualité de tiers saisi est donc personnelle, et se confond donc avec l’autonomie juridique de l’interlocuteur de l’huissier de justice : quand bien même le tiers saisi est une société faisant partie d’un groupe, la qualité de tiers saisi ne s’étend pas aux autres sociétés du groupe sans qu’un procès-verbal de saisie ne leur soit délivré à titre personnel.
Dans les faits, un des tiers saisis avait répondu, en substance, qu’il prenait acte de ce procès-verbal et confirmait que les biens objets de la saisie étaient donc bloqués entre les mains d’une autre société du groupe. À la lecture de sa réponse, le tiers saisi avait donc souhaité spontanément étendre les effets de la saisie à une autre de ses sociétés, pourtant autonome juridiquement et non visée dans l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire. Puisque cette société étrangère au litige n’était pas tiers saisi, sa responsabilité ne pouvait donc être recherchée. Cela explique qu’elle soit absente des parties dans l’arrêt commenté.
D’autre part, il faut souligner que la naissance de la qualité de tiers saisi est indépendante du résultat de la voie d’exécution engagée, comme il sera exposé dans les développements qui suivent.
B. L’extinction de la qualité du « tiers saisi »
L‘extinction de la qualité de tiers saisi n’est évoquée qu’en filigrane dans l’arrêt commenté. D’abord, et comme il ressort de la décision commentée, il est possible d’affirmer que le défaut de réponse à l’huissier de justice ne suffit pas à faire disparaître la qualité de tiers saisi. En effet, la qualité de tiers saisi est totalement indépendante du caractère fructueux de la mesure. C’est pourquoi l’expression « tiers saisi » peut paraître équivoque pour le tiers interpellé qui est convaincu, à tort, que puisque la saisie est infructueuse, il n’est pas tenu des obligations du tiers saisi. Ensuite, il est possible de comprendre que la qualité de tiers saisi ne disparaît pas avec le départ de l’huissier de justice. Elle se poursuit dans le temps et ne cesse que de trois manières.
La première cause d’extinction de la qualité de tiers saisi est, bien évidemment, l’aboutissement de la procédure. Cela se traduira soit par un acte de mainlevée pure et simple si la procédure se solde par un échec (ou si le « motif légitime » revendiqué par le tiers est reconnu comme tel par le juge), soit par un acte de mainlevée quittance si la mesure est un succès.
La deuxième cause d’extinction de la qualité de tiers saisi est sa condamnation en cas de silence ou de réponse mensongère. Condamné, il cessera d’être tiers saisi pour devenir débiteur du créancier saisissant.
La troisième et dernière cause d’extinction de la mesure est la prescription du titre qui la fonde.
Ainsi, il convient de distinguer l’obligation de réponse « sur-le-champ » du tiers saisi de sa qualité. Si l’obligation de réponse instantanée cesse au départ de l’huissier de justice, la qualité de tiers saisi perdure : il doit donc répondre. Autrement formulé, même si le tiers saisi a gardé le silence, les obligations inhérentes à son statut perdurent : il demeure donc obligé de fournir les renseignements demandés. L’obtention des renseignements demandés ultérieurement à la mesure conservatoire et par une procédure parallèle ne suffit pas à éteindre la qualité de tiers saisi et ses obligations comme il ressort de l’arrêt commenté. En l’espèce, le tiers saisi initialement souhaitait s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que sa faute ne causait pas de préjudice au créancier qui était arrivé à ses fins par un autre moyen (autre saisie conservatoire auprès d’un autre tiers). En d’autres termes, il souhaitait voir placée sa responsabilité sous l’angle purement civil (qui nécessite de prouver un préjudice - ce qui autorise la condamnation à des dommages-intérêts), et non sous l’égide du Code des procédures civiles d’exécution (au sens où le préjudice n’a pas à être prouvé mais est présumé par la simple mise en œuvre de la saisie conservatoire-cela est sanctionné par la condamnation aux causes de la saisie).
En conclusion, la responsabilité du tiers saisi qui ne répond pas à une mesure de saisie ne disparaît pas du fait de l’absence de préjudice subi par le créancier saisissant.
II. La réponse du tiers saisi dans le temps
Une fois la qualité de tiers saisi déterminée, il reste à évoquer son obligation de réponse. L’arrêt commenté renseigne à la fois quant à la forme de la réponse qui peut être impactée par l’écoulement du temps (A), et quant à son contenu (B).
A. La forme de la réponse impactée par le temps
L’article R. 523-4 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2565IT8) dispose que « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 (N° Lexbase : L5839IRP) et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0423IGR) ».
A première lecture, ce texte ne vise que le moment de la réponse du tiers saisi, et non sa forme. Pourtant, en cas de « saisie papier » (saisie conservatoire matérialisée par des documents signifiés physiquement par l’huissier de justice), comme c’était le cas en l’espèce, la réponse apparaît devoir être orale puisque l’article précité indique que l’officier public et ministériel fait mention de la déclaration dans son procès-verbal. Cette réponse orale immédiate est bien souvent recherchée par l’huissier de justice dans les faits. Pourtant, et comme il ressort des faits commentés, la forme de la réponse du tiers saisi peut être impactée par le temps. Ainsi, en cas d’impossibilité de réponse immédiate (liée à une indisponibilité immédiate du tiers saisi), la forme de la réponse peut varier. La réponse immédiate fera mention de l’incapacité temporaire et engagement du tiers saisi à répondre dans les plus brefs délais (en pratique, cette réponse peut être : « Nous prenons acte de votre saisie. Nous ne pouvons vous répondre immédiatement mais vous répondrons par écrit sous 24h »). Il est courant, comme c’est le cas en l’espèce, que la forme de la réponse varie au fil du temps : initialement orale, elle peut par la suite revêtir une forme écrite. La forme de la réponse n’ayant pas causé de difficulté en l’espèce, cela démontre bien que toute l’attention doit être portée sur le contenu de la réponse.
B. Le contenu de la réponse impactée par le temps
L’arrêt commenté n’éclaire pas sur les raisons exactes qui ont poussé un des tiers saisis à garder le silence lorsqu’il a été interrogé par l’officier public et ministériel instrumentaire. Bien que disposant d’un siège social à l’étranger, cette société avait été vraisemblablement interpellée en son établissement situé en Ile-de-France. L’excuse de la distance et des délais inhérents à la signification internationale ne pouvaient donc raisonnablement pas être invoquée pour justifier le silence, alors même que cela pourrait constituer un « motif légitime » au sens du Code des procédures civiles d’exécution.
A la lecture des moyens de cassation, il est possible de comprendre que le tiers saisi essayait de se dédouaner de sa responsabilité au motif que le créancier poursuivant avait obtenu une réponse à sa saisie, même si cette réponse n’était pas la sienne, mais celle d’une autre société du même groupe. En d’autres termes, et comme l’a justement formulé Monsieur Payan [1], « est-on en présence d’un « motif légitime » exemptant le tiers des sanctions encourues en raison de son refus de répondre sur-le-champ à l’huissier de justice qui a pratiqué une première saisie, lorsque l’information réclamée est finalement communiquée lors d’une saisie subséquente ? ». La Cour de cassation répond négativement à cette interrogation, ce qui est conforme à la logique de l’exécution. En effet, il convient d’envisager chaque saisie conservatoire comme une procédure indépendante, même si elles sont concomitantes les unes des autres. Les tiers saisis sont tenus d’obligations individuelles et non collectives, quand bien même ces sociétés font partie d’un même groupe. Puisque l’obligation de réponse est individuelle et non collective, il n’est en rien critiquable que le tiers saisi qui répond en évoquant, non ses obligations, mais celles d’une autre société du même groupe, n’engage pas cette dernière par sa déclaration.
L’arrêt commenté pousse également à une autre réflexion. Le tiers saisi, qui a exactement répondu sur le champ à l’acte de saisie, mais qui modifie par la suite sa réponse par des éléments inexacts ou mensongers, engage-t-il sa responsabilité ? Sur ce point, la Cour de cassation répond affirmativement. Ce cas de figure (modification de réponse postérieurement à l’acte de saisie) est expressément envisagé dans le Code des procédures civiles d’exécution, mais uniquement sous l’angle de la saisie de comptes bancaires [2]. En matière de saisie conservatoire de biens meubles corporels, le législateur n’avait pas envisagé cette hypothèse, mais la décision commentée nous convainc que cela est possible.
Plus encore, l’arrêt rendu par la Cour de cassation enseigne qu’en pareil cas la responsabilité civile délictuelle du tiers saisi est retenue. C’est donc confirmer que son obligation de réponse expresse et exacte naît au jour de la saisie et perdure jusqu’à l’extinction de la qualité du tiers saisi. En d’autres termes, s’il fournit une réponse inexacte, mensongère, ou garde le silence lors de la saisie, il peut se raviser et rectifier son comportement par la suite. Comme il a été exposé, au cours d’une mesure de saisie pratiquée entre ses mains, le tiers saisi est acculé dans les cordes du ring de l’exécution. Bien que non belligérant, ni même arbitre, la moindre faute ne lui sera pas pardonnée et sa responsabilité sera recherchée, surtout s’il est notoirement solvable comme en l’espèce. Au final, cette scène fait écho à l’accident que subit la championne dans le film Million Dollar Baby : c’est finalement un tiers qui blesse tragiquement une des boxeuses et sur qui pèse l’issue fatale du combat.
[1] G. Payan, Saisie conservatoire : retour sur les obligations des tiers, D.actualité, 22 février 2021.
[2] CPCEx, art. L. 162-1 (N° Lexbase : L5835IRK) et R. 162-1 (N° Lexbase : L2666ITW).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476575