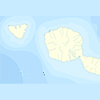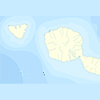FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [F] [O] a été embauchée le 26 février 2020 par L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG HAUTS DE FRANCE NORMANDIE en qualité de technicien de laboratoire.
En application des dispositions de l'article 12 de la loi de 1021-1040 du 5 août 2021 imposant une obligation vaccinale aux salariés travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux, l'employeur a établi le 12 août 2021 une note interne à destination des salariés, doublée d'une information le 16 août 2021 du Comité Social et Economique central, laquelle a été suivie le 20 août 2021 d'un affichage quant aux modalités de mise en oeuvre de cette obligation, et enfin le 21 août 2021 d'un rappel de l'ensemble des obligations par remise en main propre d'une lettre à la salariée.
Le 25 août 2021 cette dernière a produit auprès de son employeur la photographie d'un auto-test n'ayant pas été réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé, accompagnée d'une attestation sur l'honneur.
Le 26 août 2021 l'employeur a notifié à la salariée la suspension de son contrat de travail, ce à quoi cette dernière a répondu le 30 août 2021 par une lettre de contestation de cette décision et de mise en demeure de réintégration dans ses fonctions.
Le 8 octobre 2021 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par ordonnance en date du 24 février 2022 :
S'est déclaré compétent en la matière,
A constaté que la suspension du contrat de travail de la salariée a été mise en oeuvre conformément aux dispositions des
articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021🏛, qu'elle ne constitue pas un trouble manifestement illicite, et débouté la salariée de sa demande ainsi que de celles incidentes,
A dit qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité,
A pour le surplus, concernant les demandes formulées pour l'avenir, renvoyé la salariée à mieux se pourvoir,
A débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
A laissé à chacun la charge de ses propres dépens.
SUR CE
De la demande en annulation de l'ordonnance du 24 février 2022
La salariée conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise au motif que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à la question du non-respect par l'employeur de son obligation de lui fournir du travail et, à celle d'une discrimination en raison de son état de santé.
Toutefois le conseil de prud'hommes, après avoir retenu sa compétence, a jugé que la suspension du contrat de travail ne constitue pas un trouble manifestement illicite, moyen invoqué par la salariée pour fonder ses demandes en réintégration et paiement de la rémunération.
Il a donc répondu au moyen soulevé par la salariée peu important qu'il n'est pas invoqué de manière formelle les différentes branches de ce moyen, qu'il n'a pas accueilli en se basant sur la décision du conseil constitutionnel ayant selon lui retenu la conformité de la
loi du 5 août 2021🏛 à la constitution dès lors que la mesure n'entraîne pas la rupture du contrat de travail et prend fin dès que le salarié présente les justificatifs requis.
Le fait que la salariée conteste le bien-fondé de cette apprécition n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une motivation répondant aux moyens soulevés par cette dernière.
Il y a lieu de constater à ce titre que, contrairement à ce que soutient la salariée, le conseil de prud'hommes s'est bien prononcé quant à la question de l'identification de la suspension du contrat de travail à une sanction disciplinaire puisqu'il l'a rejetée comme mentionné dans les motifs de sa décision.
Il y a lieu au regard de ces éléments de débouter la salariée de sa demande en annulation de l'ordonnance du 24 février 2022.
De la compétence du juge des référés
Les
articles R. 1455-5 et suivants du code du travail🏛 régissent les compétences de la formation de référé du conseil de prud'hommes, pouvant statuer dans trois hypothèses, non cumulatives, parmi lesquelles en application de l'article L 1455-6 la possibilité, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, la constatation de l'urgence n'est pas une condition de la prise en compte du trouble manifestement illicite, et le prononcé de mesures conservatoires n'est pas subordonné à l'absence de contestation sérieuse.
En l'espèce s'il existe une contestation sérieuse, pour autant le juge des référés est compétent pour examiner les prétentions de la salariée, sur le fondement de l'
article L. 1455-6 du code du travail🏛 ne relevant pas du pouvoir d'appréciation du juge du fond, en ce qu'elles tendent à ce que soient ordonnées des mesures conservatoires, telle que sa réintégration et le paiement de la rémunération indépendamment de la réponse pouvant être apportée sur les questions de fond objets d'une contestation sérieuse.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge prud'homal s'est déclaré compétent.
Des demandes en constatation de l'existence d'un trouble manifestement illicite, en réintégration et reprise du paiement du salaire sous astreinte, et en reconstitution des droits à congés payés ainsi que des droits légaux ou conventionnels qui auraient pu être acquis du fait de l'ancienneté pendant la période de suspension du contrat de travail
Le trouble manifestement illicite désigne une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une règle de droit, notamment la méconnaissance manifeste d'une disposition légale ou réglementaire, la formation de référé pouvant alors ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état quelle estime adaptées pour remédier à une illicéité manifeste, toujours actuelle au moment de l'examen du litige, afin de replacer les parties dans la situation antérieure à celle critiquée.
En l'espèce la salariée soutient que la suspension de son contrat de travail peut s'analyser en une mise à pied à titre conservatoire, de sorte que l'employeur avait pour obligation de respecter le droit disciplinaire, étant précisé selon elle qu'une telle mise à pied conservatoire doit déboucher sur une sanction définitive et que seule l'existence d'une faute grave ou d'une faute lourde a pour conséquence de ne pas rendre ladite mise à pied conservatoire nulle.
La salariée fait valoir qu'aucune garantie procédurale n'ayant été respectée par l'employeur la mesure de suspension encourt la nullité et constitue un trouble manifestement illicite.
Elle affirme également que le non-respect par l'employeur de son obligation de lui fournir du travail et la violation par l'employeur de l'interdiction d'une discrimination en raison de son état de santé, doivent être interprétés comme un trouble manifestement illicite.
Elle se prévaut enfin de l'existence d'un dommage imminent en ce qu'il est manifeste que dans l'hypothèse d'une réintégration l'employeur viendrait à reprendre à son encontre une mesure identique.
Toutefois la suspension du contrat de travail ne constitue pas une sanction disciplinaire en ce que l'employeur n'a aucun pouvoir d'appréciation quant à la portée du comportement de la salariée, ne pouvant à ce titre que s'en remettre aux dispositions de la
loi du 5 août 2021🏛, qui après avoir défini plusieurs étapes ayant des conséquences quant au contenu des obligations des personnels exerçant l'une des professions de santé soumises à une obligation vaccinale, a prévu qu'à compter du 15 octobre 2021 inclus ladite obligation vaccinale sera pleinement en place pour le personnel concerné.
L'employeur n'a pu en l'espèce que constater que la salariée a nullement respecté ses obligations légales puisqu'elle n'a pas justifié dans un premier temps de la réalisation d'un test conforme aux modalités prévues par la loi autorisant même un auto-test sous réserve qu'il soit effectué sous la supervision d'un professionnel de santé, puis dans un deuxième temps d'une vaccination complète.
Par ailleurs la suspension du contrat de travail est d'autant moins une sanction que l'employeur n'a aucune possibilité d'en fixer la durée, alors que la salariée en changeant de positionnement peut engendrer sa fin, laquelle peut aussi être la conséquence d'une évolution la législation en lien avec celle des données scientifiques et médicales.
Il y a lieu d'observer enfin que la salariée ne se prévaut pas d'une contre-indication à la vaccination, étant précisé que la question de son appartenance au groupe des professionnels de santé devant se conformer aux obligations de la
loi du 5 août 2021🏛 ne fait pas débat.
En présence d'un tel constat l'employeur n'avait pas d'autre possibilité, sauf à se soustraire lui-même à l'application de la loi, que de procéder à la suspension du contrat de travail de la salariée, laquelle faute d'exécution de sa prestation de travail aux termes des circonstances précitées ne peut pas arguer de l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait du non-paiement de sa rémunération, qui n'est que la conséquence de cette suspension d'origine légale.
En ce qui concerne l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, il convient de constater que la salariée ne présente aucun élément de nature à faire présumer une telle discrimination.
Il y a lieu d'observer en effet que la suspension du contrat de travail n'est pas la conséquence de l'état de santé de la salariée, qui n'hésite pas à se comparer à des victimes d'un viol alors même qu'à leur différence elle n'a subi aucune atteinte à son intégrité physique, mais seulement de son opposition à des dispositions légales n'instaurant pas une vaccination de force.
Il apparaît ensuite que l'employeur aurait pu, s'il avait existé des éléments permettant de faire présumer une telle discrimination, justifier de ce que sa décision est étrangère à toute discrimination, comme reposant sur la seule volonté du législateur.
Il résulte de ces éléments qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu.
Relativement à l'existence d'un dommage imminent, celui invoqué par la salariée est doublement hypothétique comme ne pouvant ressortir que d'une éventuelle réintégration et d'une prétendue volonté de l'employeur de se soustraire à une possible décision de justice voire une modification des dispositions législatives.
Il apparait ainsi, alors même qu'il existe une contestation sérieuse, qu'aucun trouble manifestement illicite et aucun dommage imminent ne peuvent être retenus, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu l'existence ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'un dommage imminent et en a tiré les conséquences en rejetant les demandes de la salariée.
De l'application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛L'équité et la situation économique des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Des dépens
La salariée qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens.