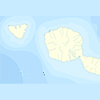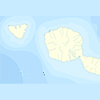N° 1400343
ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES et autres
Mme Ody, Rapporteur
M. Rivas, Rapporteur public
Audience du 18 juin 2015
Lecture du 17 juillet 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes
(6ème Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier, 3 février, 7 novembre et 21 décembre 2014, l'association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillères et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CéDpa), Mme Françoise B et M. Sylvain T, représentés par Me Le Briero, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
Avant-dire droit :
1°) d'ordonner la visite sur les lieux des parties et de la juridiction dans les conditions fixées par l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;
2°) de désigner un amicus curiae en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, avec pour mission de produire un avis sur les compensations aux destructions et modifications de zones humides et les effets cumulatifs des impacts et compensations liés aux aménagements hydrauliques avec les impacts et compensations liés aux destructions, captures et déplacements d'espèces protégées ;
En tout état de cause :
3°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest à réaliser et à exploiter la plateforme aéroportuaire du Grand Ouest et à aménager le programme viaire et la VC 3 et, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Treillières et Fay-de-Bretagne ;
4°) de mettre en demeure la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de cesser tout travail ou ouvrage en lien avec l'arrêté attaqué du 20 décembre 2013 et de remettre les lieux dans leur état initial, les conditions de cette remise en état devant être fixées par le préfet dans un délai d'un mois suivant l'édiction du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une enquête publique irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement ;
- l'étude d'incidences prévue par l'article R. 214-6 du code de l'environnement présente un caractère insuffisant ;
- le dossier de demande d'autorisation présente un caractère insuffisant s'agissant de la présentation des moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident et d'accident ;
- le dossier de demande d'autorisation ne prend pas en compte correctement les définitions légales et réglementaires des zones humides des articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l'environnement et de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 ;
- la procédure d'enquête publique a méconnu les dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement, de la directive communautaire 2003/35 du 26 mai 2003 et de l'article L. 214-4 du code de l'environnement ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement ;
- l'avis de l'autorité domaniale était requis pendant l'instruction de la demande d'autorisation ;
- le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques devait être consulté sur le protocole d'accord signé entre l'Etat, la société concessionnaire AGO et la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique ;
- le dossier d'enquête publique devait présenter les études d'impact réalisées au titre de la législation sur le permis de construire et de celle sur les installations classées ;
- une étude d'impact devait être organisée s'agissant des mesures compensatoires à mettre en oeuvre en dehors de l'emprise, en application de l'annexe II de l'article 4 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8B-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;
- l'arrêté attaqué ne respecte pas les dispositions des schémas d'aménagement et de gestion des eaux des bassins Vilaine et Estuaire de la Loire ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe de précaution énoncé par l'article 5 de la charte de l'environnement et par l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 16 décembre 2014, et le 2 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin, 10 et 31 décembre 2014, la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 7 novembre 2014 avec effet immédiat.
Par une ordonnance du 9 février 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 9 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody, conseiller,
- les conclusions de M. Rivas, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubreuil, substituant Me Le Briero, représentant les requérants, de Me Rouhaud, représentant le préfet de la Loire-Atlantique et de Me Duval, représentant la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 24 juin 2015.
1. Considérant que, par un décret du 9 février 2008, les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes, de sa desserte routière, de voies nouvelles ou de recalibrage de voies existantes et des ouvrages d'assainissement ont été déclarés d'utilité publique ; que, par une convention du 23 décembre 2010, approuvée par décret du 29 décembre 2010, l'Etat a consenti à la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest une délégation de service public portant, pour l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, sur la conception, le financement, les acquisitions foncières, la construction, la mise en service ainsi que la mise en oeuvre du plan de gestion agro-environnemental, du droit de délaissement et des mesures d'accompagnement territorial (amélioration et rétablissements de voirie) ; que, par un arrêté du 5 août 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de sécurisation des voiries départementales et communales existantes dans le secteur entourant le futur aéroport concernant la RD 15 entre le bourg de Fay-de-Bretagne et le Temple-de-Bretagne, la VC 1/VC 12 entre le bourg de Notre-Dame-des-Landes et le Temple-de-Bretagne, le carrefour de la RD 326 avec la voie communale dite de Notre-Dame-des-Landes allant sur Treillières, ainsi que la RD 326 entre le rond-point de Curette et la RN 137, dénommé " programme viaire " ; que, par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest à réaliser et exploiter la plate-forme aéroportuaire du Grand Ouest et à aménager le programme viaire et la VC 3, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. " ; qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. (…) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. / A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'enquête publique, la commission d'enquête a émis le 24 octobre 2012 un avis favorable assorti de deux réserves, à savoir, d'une part, la validation par des experts scientifiques des mesures compensatoires envisagées dans la demande d'autorisation et, d'autre part, la passation d'accords avec la profession agricole pour la mise en oeuvre de ces mesures compensatoires ; qu'il est constant que le rapport remis en avril 2013 par le collège d'experts scientifiques, désigné en décembre 2012 aux fins d'évaluer la méthode des incidences sur les zones humides proposée par le pétitionnaire, a refusé de valider ladite méthode ; qu'ainsi, contrairement aux allégations des requérants, faute pour la première réserve d'avoir été levée, l'avis de la commission d'enquête doit être réputé défavorable, une telle circonstance étant toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de l'instruction que ledit arrêté prévoit aux articles 18 et suivants la mise en oeuvre de mesures compensatoires selon le système de compensation exposé dans le dossier de demande d'autorisation et au vu des modalités techniques et des enveloppes géographiques présentées également dans le dossier de demande d'autorisation soumis à l'enquête publique ; qu'il est ainsi constant que le projet tel qu'autorisé par l'arrêté attaqué n'a pas subi de modifications substantielles par rapport à ce qu'il était dans le dossier soumis à enquête publique ; qu'en outre, la circonstance qu'un protocole d'accord ait été signé entre la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, l'Etat et la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique n'emporte aucune modification substantielle au projet litigieux, dans la mesure où ledit protocole ne remet pas en cause le principe de la mise en oeuvre par contractualisation des mesures de compensation devant être réalisées sur des terrains non acquis par le maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions et dès lors qu'aucune modification substantielle n'a été introduite au projet, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l'enquête publique présente un caractère irrégulier ni qu'une seconde enquête publique devait être organisée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et de la nomenclature annexée à l'article R. 122-1 du même code que le projet de plate-forme aéroportuaire litigieux nécessite la réalisation d'une étude d'impact transmise pour avis à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement ; qu'il est constant qu'une telle étude a été réalisée en 2006 à l'occasion de la déclaration d'utilité publique de ce projet et qu'un avis de l'autorité environnementale a alors été émis ; qu'il résulte également de l'instruction que cette étude d'impact et cet avis ont été annexés au dossier de demande d'autorisation et mis ainsi à la disposition du public, lors de l'enquête publique qui s'est tenue du 21 juin au 7 août 2012 ; qu'il ressort en outre du rapport de la commission d'enquête que l'étude d'impact du programme viaire et l'avis de l'autorité environnementale sur cette étude ont également été joints au dossier d'enquête publique ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions des articles R. 214-8 et L. 122-1 du code de l'environnement ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, à la condition que lesdites dispositions soient précises et inconditionnelles, il est toutefois constant que les articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement assurent la transposition en droit interne des dispositions de l'article 6 § 1 de la directive du 27 juin 1985, lesquelles sont, en toute hypothèse, en raison de leur imprécision, dépourvues d'effet direct ; qu'en outre, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de l'article 6 § 1 de la directive 2011/92/UE, ses dispositions sont, au vu de leur caractère imprécis, tout autant dépourvues d'effet direct ; qu'enfin, il est constant que le délai de transposition de la directive susvisée 2014/52/UE du 16 avril 2014 est fixé au 16 mai 2017, de sorte que les requérants ne sauraient utilement en invoquer la méconnaissance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces trois directives sera écarté, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article L. 214-4 du code de l'environnement qui soumettent l'autorisation litigieuse à une procédure d'enquête publique ; que si les requérants soutiennent que la méthode de compensation retenue est d'une extrême complexité et manquait ainsi de clarté pour le public, il ne ressort pas des observations recueillies à l'occasion de cette enquête que le public ait rencontré de réelles difficultés à comprendre la méthode envisagée, laquelle n'a pas été mal comprise ; qu'au surplus, il ressort du rapport de la commission d'enquête, d'une part, qu'un effort pédagogique a été fourni en cours d'enquête pour aider les personnes intéressées à comprendre le dossier dont la complexité est inévitable compte tenu de l'ampleur du projet et, d'autre part, que le dossier a été mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture et du maître d'ouvrage dès les premiers jours de l'enquête publique ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'enquête publique ait, en l'espèce, nui à la bonne information du public ni que les dispositions législatives qui soumettent l'autorisation litigieuse à une procédure d'enquête publique aient été méconnues ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure méconnaissant les exigences constitutionnelles résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que l'article R. 214-6 du code de l'environnement fixant la composition du dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau n'impose pas de joindre les études d'impact exigées par la législation sur le permis de construire et celle sur les installations classées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose non plus de soumettre ces études d'impact à l'enquête publique relative à l'autorisation sollicitée au titre de la loi sur l'eau ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de soumettre à la même enquête publique le dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau et celui relatif aux espèces protégées ; que, contrairement aux allégations des requérants, l'intégralité des mesures prévues pour compenser la fonctionnalité relative à la qualité de la biodiversité des zones humides a été envisagée dans le dossier concernant l'autorisation litigieuse ; qu'il résulte de l'instruction que la référence au dossier relatif aux espèces protégées a pour seul objet de prévoir une harmonisation des démarches de compensation et une stratégie prenant en compte les deux problématiques, dans la mesure où plusieurs espèces protégées sont inféodées aux zones humides ou les fréquentent de façon régulière ; que, dans ces conditions, l'enquête publique ne présente pas un caractère irrégulier du seul fait que le dossier relatif aux espèces protégées n'a pas été présenté en même temps que celui relatif à la loi sur l'eau ;
9. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de l'article 4 et de l'annexe II de la directive susvisée du 27 juin 1985 que les " projets d'infrastructures " tels que les " barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable " sont soumis à étude d'impact lorsque les Etats membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent ; que les requérantes soutiennent que " les mesures compensatoires réalisées sur des terrains agricoles consistent à maintenir une certaine quantité d'eau dans les sols voire à renforcer l'humidification ou le caractère mouillé de ces sols ", de sorte qu'elles doivent faire l'objet d'une étude d'impact en application des dispositions précédemment évoquées de la directive du 27 juin 1985 ; qu'à supposer même que la directive susvisée du 27 juin 1985 ait entendu soumettre à étude d'impact les mesures de compensation à mettre en oeuvre pour la réalisation de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il ressort toutefois de l'article 19.3 de l'arrêté attaqué déterminant les mesures éligibles à la compensation que n'y figurent ni barrages ni infrastructures destinées à la rétention ou au stockage des eaux ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, les requérantes ne sont pas fondées à invoquer la méconnaissance de l'article 4 et de l'annexe II de la directive du 27 juin 1985 ;
En ce qui concerne le caractère régulier de la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-11 du code de l'environnement : " Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. / Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent. " ; que, d'une part, ces dispositions n'imposent pas de soumettre l'intégralité du dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, lequel est saisi d'un rapport sur la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête, établi par le préfet au vu du dossier de l'enquête publique et des avis émis ; que, d'autre part, le non-respect d'une autorisation administrative par son titulaire, si elle est susceptible d'exposer ce dernier aux sanctions prévues par les lois et règlements, est par lui-même sans influence sur la légalité de cette autorisation ;
11. Considérant qu'il est constant que l'intégralité des mesures compensatoires ne pourra intervenir dans les zones de délaissés de l'emprise de la concession lesquelles présentent une superficie insuffisante ; que l'article 19.4 de l'arrêté attaqué prévoit que les mesures compensatoires qui sont mises en oeuvre sur des terrains non acquis par le maître d'ouvrage nécessitent la conclusion d'accords avec des exploitants agricoles et, le cas échéant, avec des organismes gestionnaires de foncier ou compétents en matière d'environnement ou les propriétaires de ces terrains ; que le protocole d'accord conclu le 23 décembre 2013 par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, l'Etat et la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique constitue un accord-cadre définissant les conditions, notamment financières, de cette contractualisation ; qu'il s'ensuit que ce protocole s'inscrit dans la phase d'exécution de l'autorisation litigieuse ; que, par suite, la circonstance que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, lequel a été saisi d'un rapport dont le caractère suffisant n'est pas contesté, n'a pas été consulté s'agissant de ce protocole n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure régie par les dispositions précitées de l'article R. 214-11 du code de l'environnement ;
En ce qui concerne l'absence d'avis de la personne publique gestionnaire du domaine public :
12. Considérant que si les requérants soutiennent que les terrains d'assiette du projet appartiennent à l'Etat de sorte qu'il fallait solliciter l'avis de l'autorité domaniale pendant l'instruction de la demande, le moyen n'est, toutefois, pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la régularité du document d'incidences :
13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement : " I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (…) / 4° Un document : / a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; / (…) d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. (…) 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; (…) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'incidences ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
14. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le document d'incidences joint à la demande d'autorisation présentée par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest au titre des dispositions précitées du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement prévoit des mesures visant à remédier aux pollutions chroniques dues au fonctionnement et à l'exploitation de la plate-forme aéroportuaire, et aux pollutions saisonnières et accidentelles ; qu'ainsi, s'agissant des pollutions chroniques, sept bassins de rétention dont les deux affectés aux parkings et aux aires de stationnement des aéronefs sont équipés d'un filtre à sable et d'un décanteur lamellaire, doivent recueillir les eaux de ruissellement des infrastructures ; que, s'agissant des pollutions saisonnières, les opérations de dégivrage et d'antigivrage sont effectuées sur une aire dédiée et les eaux de ruissellement drainées vers des aires étanches avant d'être régulièrement évacuées hors du site pour traitement ; que les eaux de déverglaçage sont, quant à elles, stockées dans des bassins de confinement équipés d'un filtre à sable planté de roseaux avant d'être restituées au milieu naturel ; que, par ailleurs, l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite, à l'exception des balisages et éléments de sécurité des pistes ; qu'en cas de pollution accidentelle, les bassins drainant les eaux de déverglaçage assureront le rôle de confinement grâce à des vannes de fermeture, avant que la pollution soit pompée et évacuée hors site vers des traitements adaptés ; qu'enfin, le futur aéroport disposera d'une station d'épuration pour traiter les eaux usées urbaines générées par son exploitation, équipée d'un système de traitement membranaire et complétée par une saulaie permettant de limiter le transfert des eaux traitées au réseau hydrographique en période estivale d'acceptabilité réduite ; qu'il résulte de l'ensemble du dispositif présenté dans l'arrêté attaqué et le dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau que l'impact sur l'aspect qualitatif des eaux superficielles est limité ;
15. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que la qualité physicochimique initiale des eaux et le fonctionnement hydrologique quantitatif ont été mal évalués, il n'est, toutefois, pas même allégué que ces prétendues insuffisances auraient pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou qu'elles auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'en toute hypothèse, afin de tenir compte des critiques formulées par le collège d'experts scientifiques dans son rapport d'avril 2013, des analyses complémentaires sur les eaux superficielles et les eaux souterraines ont été réalisées postérieurement, au cours de l'année 2013, lesquelles ne contiennent aucun élément susceptible de remettre en cause les résultats contenus dans le dossier de demande d'autorisation et présentés au cours de l'enquête publique ; qu'en outre, s'ils soutiennent que la fonction de ralentissement des crues aurait été insuffisamment prise en compte et que la biodiversité aurait été insuffisamment caractérisée, s'agissant notamment des cortèges floristiques ou des connectivités entre les communautés animales, les requérants n'apportent, toutefois, aucune précision quant aux éléments qui manqueraient ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Vilaine et la commission d'enquête ont relevé le caractère complet et la qualité du document d'incidences, s'agissant du diagnostic de l'état initial ; qu'il s'ensuit que le contenu du document d'incidences est en relation avec les incidences prévisibles du projet litigieux et n'a eu pour effet ni de nuire à l'information complète de la population à l'occasion de l'enquête publique ni d'exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement aux allégations des requérants, les dispositions précitées de l'article R. 214-6 du code de l'environnement n'imposent pas de présenter, dans le document d'incidences, le diagnostic de l'état initial des zones qui ont vocation à accueillir les mesures compensatoires à mettre en oeuvre ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations des requérants, le dossier de demande d'autorisation comprend une pièce H de vingt pages présentant les moyens de surveillance en phase de chantier et en phase d'exploitation des installations, ainsi que les mesures d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance du 5° de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ;
En ce qui concerne la violation des définitions légales et réglementaires des zones humides des articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l'environnement et de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 :
18. Considérant que le moyen tiré de la violation des définitions légales et réglementaires des zones humides des articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l'environnement et de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la compatibilité de l'arrêté attaqué avec l'article 8B-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 :
19. Considérant qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux " ; que l'orientation n° 8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 vise la préservation des zones humides et de la biodiversité ; que l'article 8B-2 dispose : " Dès lors que la mise en oeuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l'entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. " ; que l'orientation n° 11 du même SDAGE vise à " préserver les têtes de bassin versant " ;
20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méthode de compensation prescrite à l'article 18 de l'arrêté attaqué prévoit que le besoin compensatoire résulte de l'analyse des enjeux des surfaces concernées et des impacts résiduels pour chacune des trois fonctions " biogéochimie ", " hydrologie " et " biodiversité " attachées aux zones humides ; qu'à chaque niveau d'impact résiduel retenu correspond un coefficient de définition du besoin compensatoire croissant, du niveau d'incidence le plus faible jusqu'au niveau d'incidence le plus fort ; que la surface concernée par l'impact résiduel est multipliée par le coefficient correspondant, afin d'obtenir le besoin compensatoire, exprimé en unités de compensation (UC) ; que pour répondre au besoin compensatoire, des mesures compensatoires sont mises en oeuvre sur des parcelles situées à proximité du projet dans le même bassin versant ; que le niveau de plus-value fonctionnelle apportée par la mise en oeuvre d'une mesure compensatoire est fonction de l'état initial de la parcelle, du type de mesure compensatoire et des mesures complémentaires de création ou renforcement de mares et de haies ; qu'en fonction de la plus-value fonctionnelle retenue, un coefficient est affecté à la parcelle permettant de traduire, en unités de compensation, la plus-value apportée par la mesure compensatoire mise en oeuvre sur cette parcelle ; que la réponse au besoin compensatoire, également exprimée en unités de compensation (UC), est obtenue en multipliant la surface de la parcelle choisie pour la mise en oeuvre de la mesure compensatoire par le coefficient de plus-value qui lui est affecté ; qu'il résulte de l'article 20 qu'à ce système général de compensation s'ajoute la prise en compte des habitats remarquables, des mares et des haies à raison de leur fort intérêt patrimonial ; qu'ainsi, chaque habitat remarquable impacté doit être compensé par une surface minimale de même nature déterminée par l'application de ratios surfaciques allant de 2 à 10 ; que les mares détruites seront compensées à hauteur de deux mares créées pour une mare détruite ; qu'enfin, la destruction des haies est compensée par une recréation de linéaire équivalent au linéaire détruit ; qu'en application du système de compensation précédemment décrit, le besoin compensatoire de la plateforme aéroportuaire et du programme viaire a été évalué à 560 UC, dont 481 UC dans le bassin versant de l'Isac appartenant au bassin Vilaine, situé au Nord du projet, 78 UC dans le bassin versant du Gesvres et 1 UC dans le bassin versant de l'Hocmard, ces deux derniers bassins versants appartenant au bassin Estuaire de la Loire ;
21. Considérant, en premier lieu, que les requérants n'apportent, eu égard au caractère général des termes employés dans leurs écritures, aucun élément de nature à établir l'existence d'une alternative aux atteintes portées par le projet aux zones humides ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté attaqué avec les dispositions précitées de l'article 8B-2 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne ne peut qu'être écarté ;
22. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la méthodologie de compensation et le dispositif de mutualisation des besoins et offres de compensation au moyen des unités de compensation ne permettent pas une compensation totale des fonctions identifiées et rendent impossibles le suivi et le contrôle des fonctions réellement compensées au regard de celles impactées ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été précédemment exposé, que le système de compensation retenu tient compte des caractéristiques et des fonctions " biogéochimie ", " hydrologie " et " biodiversité " attachées aux zones humides pour déterminer à la fois le niveau d'enjeux pour chaque parcelle impactée et les mesures de compensation à mettre en oeuvre en réponse au besoin compensatoire ; qu'en outre, les habitats remarquables dont la fonctionnalité " biodiversité " représente un fort enjeu font l'objet de ratios surfaciques ; qu'en application de l'article 20.1.1 de l'arrêté, chaque habitat remarquable sera compensé par une surface minimale de même nature ; que l'article 20.3 consacré à la traçabilité des fonctions écologiques restaurées prévoit également des surfaces minimales à réaliser variant selon les fonctions impactées et l'enjeu de telles fonctions ; qu'il résulte encore des dispositions de l'article 19 de l'arrêté que les mesures compensatoires sont mises en oeuvre sur des parcelles situées à proximité du projet dans le même bassin versant, à l'intérieur de zones enveloppes présentant des similitudes de milieux avec les zones humides impactées, déterminées sur la carte jointe en annexe 10 de l'autorisation ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est au demeurant pas allégué que les zones humides de plateau présenteraient des fonctions exclusives qui ne pourraient être retrouvées par la mise en oeuvre de mesures compensatoires dans des zones humides liées à des cours d'eau ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le système de compensation retenu dans l'arrêté litigieux est incompatible avec l'article 8B-2 du SDAGE qui préconise que les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
23. Considérant, en troisième lieu, que si la fiche d'aide à la lecture de l'article 8B-2 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, laquelle ne présente au demeurant aucune valeur normative, mentionne que les mesures compensatoires doivent être opérationnelles avant la destruction de la zone humide atteinte par le projet, un tel principe d'antériorité ne ressort, toutefois, pas des dispositions précitées de l'article 8B-2 du SDAGE ;
24. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 19.5 de l'arrêté litigieux impose un calendrier précis de mise en oeuvre des mesures compensatoires selon lequel 100 % des unités de compensation et 100 % des surfaces à compenser au titre des habitats remarquables devront être engagées à la mise en service de l'aéroport ; qu'en outre, l'article 19.4 de l'arrêté litigieux prévoit que les mesures compensatoires qui ne pourraient être mises en oeuvre à l'intérieur de l'emprise de la concession feront l'objet d'une contractualisation s'inscrivant dans le cadre de " l'accord préalable à la charte pour la prise en compte de l'agriculture dans la mise en œuvre des compensations environnementales " et de sa convention d'application ; qu'il résulte de l'instruction que ledit accord et ladite convention ont été conclus respectivement les 25 septembre et 7 novembre 2013 entre l'Etat, le conseil général de la Loire-Atlantique et la chambre d'agriculture du même département ; qu'il est encore constant qu'a été conclu le 23 décembre 2013, dans la continuité de ces engagements, un protocole d'accord entre l'Etat, la société Aéroports du Grand Ouest et la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique ; qu'au vu de ces éléments, les requérants ne sont fondés ni à soutenir que l'arrêté litigieux est incompatible avec les dispositions précitées de l'article 8B-2 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2010-2015, ni à invoquer le fait que la signature de l'accord-cadre avec la chambre d'agriculture n'apporte aucune garantie quant à la réalisation des mesures compensatoires ; qu'en toute hypothèse, les requérants ne sauraient utilement invoquer la circonstance que l'efficacité des mesures de génie écologique n'est pas garantie, dans la mesure où de telles considérations ont trait à l'exécution de l'arrêté dont le non-respect, sans incidence sur la légalité de l'autorisation litigieuse, est seulement susceptible d'exposer son titulaire aux sanctions prévues par les lois et règlements ;
25. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'orientation n° 11 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 visant à la préservation des têtes de bassin versant n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire, de manière absolue, de porter atteinte aux têtes de bassin versant ; que, pour les motifs énoncés au point 22, l'arrêté attaqué n'est pas incompatible avec les prescriptions et orientations du SDAGE ;
En ce qui concerne la compatibilité avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des bassins Vilaine et Estuaire de la Loire :
26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement : " I. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma. (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. " ; qu'aux termes de l'article 2 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin Estuaire de la Loire : " Dans le cas où le maître d'ouvrage doit compenser un aménagement portant sur un écosystème très important en surface et constitué principalement de zones humides, il pourra proposer une démarche de compensation (ainsi que ses éventuelles mesures d'accompagnement) privilégiant la recréation ou la restauration de fonctions écologiques majeures de cet écosystème et se traduisant par un bilan positif à l'échelle de ces fonctions majeures de l'écosystème. " ; qu'aux termes des propositions d'action du SAGE du bassin Vilaine : " Les zones humides - 95. De façon générale, les acteurs publics (État, collectivités Locales et leurs groupements, Établissements publics et organismes assurant des missions de service public) s'interdisent de mettre en place ou de promouvoir les actions pouvant entraîner la dégradation significative de ces milieux. Les mesures compensatoires à la dégradation de ces milieux par des travaux d'intérêt public devront prévoir la création ou la restauration de zones humides avec comme objectif que le bilan global de l'échange soit positif pour le milieu (en termes de surface et de biodiversité). " ;
27. Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations des requérants, les prescriptions des SAGE des bassins Vilaine et Estuaire de la Loire n'imposent pas la réalisation de l'intégralité des mesures compensatoires préalablement à la destruction des zones humides ;
28. Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que les articles 26 et 27 de l'arrêté s'abstiennent de créer un objectif de résultat, une telle abstention ne ressort, toutefois, pas des articles invoqués, lesquels prévoient respectivement la mise en place d'un observatoire environnemental chargé de s'assurer de la bonne application de l'arrêté avant le début des travaux, pendant la réalisation du chantier et en phase exploitation et d'un comité scientifique chargé d'expertiser la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures environnementales ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'incompatibilité de l'arrêté attaqué avec les SAGE des bassins Vilaine et Estuaire de la Loire ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution et des articles L. 214-3, R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement :
29. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-15 du code de l'environnement : " Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. / Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie. / Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. " ; qu'aux termes de l'article R. 214-16 du même code : " L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. / Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet. / Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident. / Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions. " ;
30. Considérant, en premier lieu, que l'article 19.4 de l'arrêté attaqué prévoit la mise en oeuvre par contractualisation des mesures compensatoires qui sont réalisées sur des terrains non acquis par le maître d'ouvrage ; que les requérants soutiennent qu'une telle contractualisation méconnaît l'article 34 de la Constitution et l'article L. 214-3 du code de l'environnement présentant le régime de déclaration et d'autorisation au titre de la loi sur l'eau et qu'elle est contraire, pour reprendre les écritures des requérants, à " la règle fondamentale du droit public applicable en matière de police administrative selon laquelle il n'est pas possible de contractualiser une règle de police administrative " ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entendu déléguer son pouvoir de police de l'eau au pétitionnaire ou à toute autre personne qui serait désignée dans l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen sera écarté ;
31. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 21.1 de l'arrêté attaqué instaure des sites témoins dont l'observation permettra d'appréhender l'évolution naturelle des zones humides afin de pouvoir, le cas échéant, adapter les mesures de génie écologique entreprises ; que, contrairement aux allégations des requérants, la circonstance que ce dispositif n'ait pas été explicité dans le dossier d'autorisation n'est pas contraire aux dispositions précitées des articles L. 214-15 et L. 214-16 du code de l'environnement ;
32. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment énoncé, les articles 26 et 27 de l'arrêté attaqué prévoient respectivement la mise en place d'un observatoire environnemental et d'un comité de suivi ; que, contrairement aux allégations des requérants, de tels organes n'ont pas vocation à exercer les pouvoirs de la police de l'eau en lieu et place du préfet ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en place de ces structures constitue une violation des dispositions précités des articles L. 214-15 et L. 214-16 du code de l'environnement ;
En ce qui concerne la violation du principe de précaution :
33. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " ; qu'aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; (…) " ;
34. Considérant qu'eu égard à ses caractéristiques et à son ampleur, le projet de création de l'aéroport du Grand Ouest est de nature à porter atteinte aux zones humides comprises dans le site de Notre-Dame-des-Landes ; qu'ainsi, l'existence d'un risque de destruction de ces zones ne pouvait être regardée comme affectée d'une incertitude quant à sa réalité et à sa portée, en l'état des connaissances scientifiques ; que, par ailleurs, l'étude d'impact a identifié et analysé les risques de destruction des milieux naturels présents dans les zones humides, ainsi que les risques d'assèchement liés à la création de surfaces imperméabilisées représentant à terme 70 % de la surface aéroportuaire et a prévu des mesures de suivi et des mesures compensatoires ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne peut être accueilli ;
35. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire " Aéroports du Grand Ouest " à réaliser et exploiter la plateforme aéroportuaire du futur aéroport du Grand Ouest et à aménager le programme viaire et la voie communale n° 3, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; que, par suite, leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une visite sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ou de désigner un amicus curiae en application de l'article R. 625-3 du même code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il ne paraît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'Etat et de la société Aéroports du Grand Ouest les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDEPA), Mme Françoise B et M. Sylvain T est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), à l'association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), à l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CéDpa), à Mme Françoise B, à M. Sylvain T, à la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest et au préfet de la Loire-Atlantique.