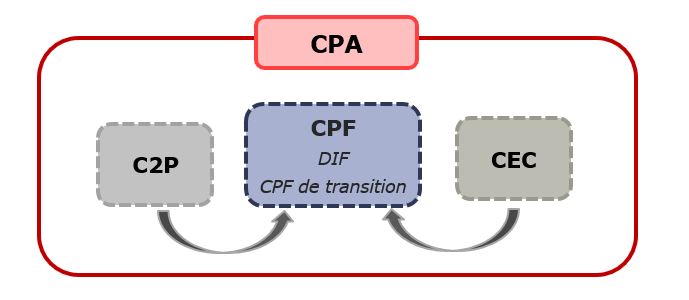[Brèves] Caractère définitif de la notification de la décision de la caisse à l’employeur et condition de reconnaissance individuelle d’une maladie professionnelle
Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-19.764, F-P+B+I (N° Lexbase : A9984ZTX)
Lecture: 4 min
N1114BYW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 15 Novembre 2019
► Dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur, dans les conditions prévues par l’article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L5899IE9), la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l’instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’intéressé ;
► peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Tels sont les principes rappelés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-19.764, F-P+B+I N° Lexbase : A9984ZTX).
Dans cette affaire, le salarié d’une société est décédé et sa veuve a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un cancer du colon, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Suivant l’avis défavorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle. La veuve a alors saisi une juridiction de Sécurité sociale.
Par un jugement du 28 novembre 2016, le TASS a débouté la veuve de ses demandes jugeant qu'il n'y avait pas de lien établi entre l'affection dont est décédé son mari et son activité professionnelle.
La décision de refus de prise en charge est définitive à l’égard de l’employeur (pourvoi incident)
La cour d’appel (CA Versailles, 24 mai 2018, n° 17/00123 N° Lexbase : A1793XP4) rejetant la demande de la caisse de rendre opposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle à l’employeur, la caisse a formé un pourvoi en cassation sur ce point. Selon elle, dès lors qu’il a été appelé dans l’instance, la reconnaissance ultérieure du caractère professionnel d’une maladie née du recours exercé par l’assuré contre le refus par la CPAM de prise en charge de sa maladie s’impose à l’employeur. En affirmant, après avoir reconnu le caractère professionnel de la maladie ayant provoqué le décès de l’assuré, que dans les rapports caisse/employeur, la décision initiale de refus de prise en charge était définitive quand il résultait de la décision que l’employeur avait été appelé dans la cause, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1 (N° Lexbase : L8868LHW) et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale.
Sur ce point, le pourvoi sera rejeté par la Cour de cassation. Rappelant la règle précitée, elle énonce qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que la décision de prise en charge par la caisse a été notifiée à l’employeur (sur La notification de la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3078ET8).
Les conditions de reconnaissance individuelle d’une maladie professionnelle (pourvoi principal)
La cour d’appel pour faire droit au recours, retient essentiellement qu’elle n’est pas liée par les avis défavorables des deux CRRMP, que l’origine multifactorielle de la maladie n’est pas non plus de nature à exclure son caractère professionnel, dès lors que l’article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel du salarié soit la cause unique ou essentielle de la maladie mais qu’elle en soit une cause directe, qu’il est établi que le cancer colo-rectal dont est décédé la victime a été directement causé par une exposition significative aux poussières d’amiante. A tort.
Enonçant la seconde solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant ainsi, alors que la maladie de la victime, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne pouvait être reconnue d’origine professionnelle que s’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime, la cour d’appel a violé l’article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (sur Les cas de reconnaissance individuelle de la maladie professionnelle par la caisse, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3062ETL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471114
[Brèves] Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par des parents séparés : date d’appréciation de la survenance de circonstances nouvelles à l’appui d’une demande de suppression
Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-19.128, F-P+B+I (N° Lexbase : A8752ZTC)
Lecture: 2 min
N1073BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 13 Novembre 2019
► Pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, le juge, saisi d’une demande, par un parent séparé, de suppression de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée à l’autre parent, doit se prononcer en considération des éléments dont il dispose au jour où il statue ; sont, dès lors, parfaitement recevables les circonstances invoquées par le requérant, concernant des faits survenus postérieurement à la requête.
Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-19.128, F-P+B+I N° Lexbase : A8752ZTC ; cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale», La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par des parents séparés N° Lexbase : E5820EY9).
En l’espèce, après le divorce des parents, la résidence de leurs trois enfants avait été fixée au domicile de leur mère, une contribution à l’entretien et à l’éducation de 300 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père ; par requête du 26 novembre 2014, ce dernier avait saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la suppression de ces contributions.
Pour déclarer la demande du père irrecevable, la cour d’appel avait retenu que son mariage comme la naissance d’un nouvel enfant en 2016, ainsi que l’évolution récente de la situation financière de la mère, associée d’une société civile immobilière créée en juin 2017, étaient des circonstances indifférentes à la recevabilité de la requête, s’agissant de faits survenus postérieurement à celle-ci.
A tort. La décision est censurée par la Cour suprême, au visa des articles 371-2 (N° Lexbase : L2895ABT) et 373-2-2 (N° Lexbase : L0528LCK) du Code civil, ensemble, les articles 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH) et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), après avoir relevé que, pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, la cour d’appel devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471073
[Brèves] L’engagement tardif de la NAO n’entraîne pas l’annulation du bénéfice de la réduction générale des cotisations dite «réduction Fillon»
Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.499, F-P+B+I (N° Lexbase : A9986ZTZ)
Lecture: 3 min
N1082BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 13 Novembre 2019
► Pour bénéficier de la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévues par l’article L. 241-13, III, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4985LR3), dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur est seulement tenu d’engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-8, 1° du Code du travail (N° Lexbase : L0335LMD), et non de parvenir à la conclusion d’un accord ; ainsi, en l’espèce, si le protocole d’accord du 22 janvier 2015 mentionne qu’il porte sur les négociations annuelles obligatoires «année 2015», la société justifie que par lettre remise en main propre le 8 décembre 2014 au seul délégué syndical de l’entreprise, elle l’avait convoqué à une première réunion, fixée le 11 décembre 2014, ayant pour objet la négociation annuelle obligatoire «pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014» ; l’engagement de la négociation annuelle en 2014 a certes été tardif, mais antérieur au contrôle dont la société a été informé par le courrier de l’inspecteur du recouvrement daté du 15 décembre 2014, de sorte qu’il ne peut être sérieusement contesté que ces négociations ont bien été engagées au cours de l’année 2014.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.499, F-P+B+I N° Lexbase : A9986ZTZ).
En l’espèce, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l’URSSAF a notifié à une société, un redressement portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du montant de la réduction sur les bas salaires en raison de l’absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au cours des années 2012 à 2014. Une mise en demeure lui ayant été délivrée, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Toulouse, 15 juin 2018, n° 17/02944 N° Lexbase : A2034XRR) accueille la demande de la société et l’URSSAF forme alors un pourvoi en cassation. Pour l’organisme, en retenant que le fait que des négociations aient été engagées au cours de l’année 2014, pour donner lieu au protocole d’accord du 22 janvier 2015 portant sur l’année 2015, justifiait l’exonération au titre de l’année 2014 pour laquelle aucune négociation annuelle n’a été engagée, la cour d’appel a violé les articles L. 2242-1 (N° Lexbase : L7820LGQ) et L. 2242-8 du Code du travail. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. De ses constatations, la cour d’appel a pu faire ressortir que la société avait engagé pour l’année 2014 la négociation annuelle sur les salaires, de sorte qu’elle remplissait la condition prévue pour la réduction de ses cotisations et en a donc exactement déduit que le redressement de l’URSSAF était infondé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471082
[Pratique professionnelle] Approche pratique de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs
Réf. : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs (N° Lexbase : L2043LSH)
Lecture: 26 min
N1103BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Leïla Hebbadj, Magistrat, docteur en droit
Le 13 Novembre 2019
Mots-clés : mineurs • Code de la justice pénale des mineurs • ordonnance du 2 février 1945 • ordonnance du 11 septembre 2019 • magistrat • pratique judiciaire
Cet article est issu du dossier spécial "Code de la justice pénale des mineurs" publié le 14 novembre 2019 dans la revue Lexbase Pénal. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici : (N° Lexbase : N1086BYU)
L’illisibilité de la version actuelle de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante fait l’unanimité parmi les professionnels de la justice pénale des mineurs. En sus d’une économie générale confuse, ce texte décline des dispositions dont l’accessibilité est parfois difficile en raison d’une rédaction ayant souffert les affres des multiples réformes intervenues. Le fascicule « les attributions pénales du juge des enfants [1]» et le forum de discussion « enfants [2]» sont ainsi de précieux outils alternatifs dont disposent les magistrats dans l’attente d’un texte plus lisible. Vivement souhaitée, maintes fois annoncée, et autant de fois reportée, la réforme de la justice pénale des mineurs concrétisée par l’ordonnance n° 2019-950 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs en date du 11 septembre 2019 affiche notamment pour objectif de répondre à ladite attente. C’est d’ailleurs dans cette perspective que la garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait adressé aux praticiens -courant mars 2019- un questionnaire en ligne afin de solliciter leur avis « sur la procédure actuellement applicable et sur les réformes qui (leur) sembleraient pertinentes [3]». Pour autant, et malgré cette consultation des acteurs de la justice des mineurs, le Code de la justice pénale des mineurs (ci-après CJPM) suscite de nombreuses critiques. L’approche pratique de ce nouveau texte est de nature à leur donner du relief dans la mesure où ses apports sont relatifs (I) et qu’il suscite de nombreuses craintes (II).
I - Les apports relatifs du CJPM
Si le CJPM opère une refonte apportant aux praticiens des clarifications (A), il aboutit aussi à une réforme non exempte d’interrogations (B).
A - Une refonte apportant des clarifications
Le principal mérite du CJPM est de clarifier de façon générale les dispositions applicables au mineur, auteur d’infraction. Ces clarifications fluidifient la lisibilité et l’accessibilité du droit pénal des mineurs : pré-requis essentiels pour permettre au praticien de veiller au respect de la légalité. Celles-ci se matérialisent via l’agencement du CJPM mais aussi des éclaircissements plus spécifiques que ce texte apporte.
Le CJPM agence les dispositions afférentes à la justice pénale des mineurs de façon plus claire. Articulées au travers d’un plan matérialisé en amont, les dispositions du CJPM sont ordonnancées peu ou prou selon les différentes étapes de la chaîne pénale. Cette nouvelle présentation est à saluer dans la mesure où elle rectifie celle de l’état actuel du droit positif.
En effet, la version actuelle de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ne facilite pas l’appréhension pratique des règles régissant le droit pénal de fond et de forme applicables aux mineurs, et ce pour deux raisons. D’une part, l’articulation de ses articles se fait sans ordre logique et sans cohérence. A titre d’illustration, les dispositions afférentes aux ordonnances de règlement rendues par le juge d’instruction [4] précédent de façon illogique les règles régissant les mesures de sûreté applicables dans leur attente [5]. D’autre part, de nombreux articles du texte du 2 février 1945 manquent d’accessibilité. Tel est tout particulièrement le cas des dispositions relatives aux mesures de sûreté applicables aux mineurs. Celles-ci sont agencées sans clarté et sans présentation fluide. C’est la raison pour laquelle les magistrats préfèrent se référer aux tableaux formalisés par l’ENM pour éviter toute erreur dans la mise en œuvre desdites dispositions. Cette pratique reste néanmoins insatisfaisante car le devoir de légalité implique le recours systématique au texte. En remaniant la présentation des règles autour desquelles le droit pénal des mineurs s’articule, le CJPM devrait être un outil plus accessible et plus sécurisant pour le praticien. La seule lecture de ses dispositions relatives aux mesures de sûreté [6] permet de s’en convaincre. Un regret doit néanmoins être formulé.
La refonte opérée par le CJPM aurait pu s’accompagner de l’édiction d’un principe général relatif à l’articulation entre le droit pénal commun et celui applicable aux mineurs. Bien que ce code ait consacré l’application du droit commun aux mineurs sauf s’il en dispose autrement [7] et à plus forte raison dans son silence [8], quid de l’hypothèse où le droit spécial des mineurs s’articule difficilement avec le droit commun notamment dans le cadre des procédures dérogatoires ? Le CJPM ne le dit pas de façon explicite même s’il sous-tend la primauté du droit spécial des mineurs sur le droit commun, et ce par application de l’adage selon lequel le « spécial déroge au général ». Ce défaut de réponse explicite rend entière la tentation d’appliquer le droit commun notamment en cas de procédure dérogatoire. L’hypothèse la plus vraisemblable est celle de la matière terroriste. A titre d’exemple, l’article 706-24-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4871K8W) fixe la durée du mandat de dépôt à six mois lorsque la personne est poursuivie pour un des délits prévus aux articles 421-1 (N° Lexbase : L8959K8C) à 421-6 du Code pénal [9]. Or, cet article 706-24-3 du Code de procédure pénale n’exclut pas les mineurs de son champ d’application. Même si les articles L. 433-2 et suivants du CJPM limitent en matière correctionnelle la durée du mandat de dépôt selon l’âge du mineur et le quantum de la peine encouru, le CJPM n’exclut pas à proprement parler l’application des dispositions de l’article 706-24-3 du Code de procédure pénale comme l’aurait commandé son article L. 13-1. Il y fait même écho en son article L. 433-6 [10] dont l’application pourrait être activée via le choix des qualifications pénales lors de l’ouverture de l’information judiciaire. Bien que le réflexe pratique des magistrats soit d’appliquer la règle la plus favorable au mineur, auteur d’infraction, ces considérations ont une acuité certaine notamment en une matière où les règles sont d’ordre public. Les clarifications apportées -sur le plan général- sont ainsi perfectibles.
En sus de cette réorganisation générale, le CJPM apporte des éclaircissements plus spécifiques à la fois sur le plan procédural et au fond.
La procédure pénale applicable au mineur auteur d’infraction suscite en pratique bien des frilosités en raison de sa technicité mais surtout de ses obscurités. Faire une énonciation exhaustive desdites obscurités serait une gageure et ne présenterait pas un intérêt particulier. En revanche, deux d’entre elles ont une acuité toute particulière : à partir de quel moment doit-on prendre en compte la question de la minorité pénale ? Dans quelles modalités doivent s’appliquer les nouvelles dispositions procédurales ? Le CJPM a le mérite d’édicter des dispositions claires sur la première question et sur les réponses procédurales qu’il institue.
La version actuelle de l’ordonnance du 2 février 1945 est totalement silencieuse sur la date à laquelle doit être apprécié l’âge de ses justiciables. Le CJPM comble cette lacune en son article L. 13-2 qui dispose notamment que la juridiction compétente, la procédure applicable, ainsi que les mesures et les peines encourues sont déterminées selon l’âge du mineur au moment des faits sauf s’il en dispose autrement. Tel est le cas lors de l’audition du mineur suspect où doit être pris en compte -selon l’article L. 411-1 du CJPM- l’âge du mineur au moment où la mesure est prise. Bien que ces principes soient globalement intégrés par la pratique judiciaire, de tels éclaircissements sont salutaires notamment sur la question de la détention provisoire. Il n’est pas rare au sein des petites juridictions que des interrogations se cristallisent à ce sujet dans la mesure où les fonctions de juge des libertés et de la détention sont exercées -selon un ordre de roulement- par tous les magistrats du siège ayant le grade de vice-président et dont certains ne sont pas pénalistes. Ces interrogations devraient ainsi disparaître. En sus de combler des lacunes du droit positif actuel, le CJPM est assez éclairant sur les nouvelles dispositions procédurales qu’il introduit.
Bien que la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice élabore à chaque nouveau texte pénal des circulaires et des outils pratiques permettant aux magistrats d’en avoir une meilleure maîtrise, chaque nouveauté pénale suscite son lot d’interrogations dont les réponses ne se dessinent qu’à l’épreuve de la pratique judiciaire. La matière de la procédure pénale applicable aux mineurs -bouleversée ces dix-sept dernières années par les multiples réformes- cristallise tout particulièrement lesdites interrogations. L’exemple le plus récent est l’article 6-2 introduit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC) au sein de la version actuelle de l’ordonnance du 2 février 1945. Cet article garantit notamment au mineur suspecté ou poursuivi un accompagnement éducatif par ses représentants légaux, et à défaut, par un adulte approprié tout particulièrement lors d’une audition, d’un interrogatoire, ou d’une audience. Bien que la philosophie associée à cet article soit à féliciter en ce qu’elle participe au renforcement de la protection du mineur suspecté ou poursuivi, celui-ci n’a pour autant pas été reçu de façon unanime par les praticiens. En sus du travail supplémentaire qu’elle induit pour les officiers de police judiciaire, les magistrats et les greffiers, cette nouveauté procédurale -du moins jusqu’au CJPM- restait obscure dans ses modalités d’application et de dérogation. Le CJPM les clarifie en ses articles L. 311-1 à L. 311-5. En sus d’une présentation plus fluide et accessible, ces dispositions permettent une meilleure appréhension de l’étendue du droit reconnu au mineur à l’accompagnement et à l’information et des hypothèses permettant d’y déroger. Le même effort de clarté peut être constaté s’agissant de la catégorisation des réponses de fond apportées par le CJPM.
Que l’on adhère ou non à la philosophie du CJPM à l’égard de l’enfance en conflit avec la loi pénale, on ne peut nier que ses rédacteurs ont fait l’effort de rationaliser le type des réponses de fond à y apporter.
En l’état actuel du droit positif, le mineur -auteur d’infraction- est justiciable de différentes réponses judiciaires. Il peut faire l’objet d’une réponse alternative aux poursuites ou d’une mesure de composition pénale. S’il est reconnu coupable de ladite infraction, il fera l’objet en priorité d’une mesure éducative, et par exception, d’une sanction éducative ou d’une peine. Si ce panel de réponses variées est une chose positive en soi, l’étude attentive de leur contenu respectif établit qu’il existe entre elles des redondances, des recoupements voire des contradictions, et ce au mépris de leur régime juridique propre. A titre d’illustration, l’accomplissement d’un stage de formation civique est à la fois une alternative aux poursuites [11] et une mesure de composition pénale [12]. La mesure d’activité de jour est à la fois une mesure de composition pénale [13] et une mesure éducative [14]. Le placement peut être à la fois une mesure éducative [15] et la conséquence du non-respect d’une sanction éducative [16]. Ces différentes dispositions entraînent une certaine confusion si l’on part du principe logique que chaque catégorie de réponse doit avoir un objectif distinct. Cette confusion a une nécessaire incidence sur l’office du magistrat qui a la responsabilité d’apporter à l’acte posé par le mineur une réponse lisible et cohérente, notamment par rapport à son parcours pénal. Conscients de cette problématique, les rédacteurs du CJPM ont opéré une rationalisation des réponses de fond applicables au mineur, auteur d’infraction. On note ainsi un moindre recoupement des catégories de réponses entre elles, et on constate surtout qu’au terme de la suppression des sanctions éducatives, le texte revient à une dichotomie plus claire entre la mesure éducative et la peine. Le mérite de cette rationalisation est de rendre un plus lisible la réponse apportée au mineur, auteur d’infraction. Cependant, cette rationalisation reste relative et perfectible dans la mesure où une analyse attentive des réponses de fond instituées par le CJPM donne lieu à un certain nombre d’interrogations.
B - Une réforme non exempte d’interrogations
Le magistrat en charge d’une affaire impliquant un mineur en conflit avec la loi pénale -qu’il soit du parquet ou du siège- doit exercer son office dans le droit fil des principes et des règles édictés par nos engagements internationaux et notre bloc de constitutionnalité en matière de justice pénale des mineurs. L’essence de ces principes et de ces règles est d’assurer le relèvement éducatif du mineur, auteur d’infraction. Dénuée de toute adhésion intellectuelle ou politique, cette conception de l’office du magistrat -en matière de justice pénale des mineurs- se justifie avant tout par le fait que le primat de l’éducatif a un caractère supralégislatif. Il était donc légitime de penser que la réforme de la justice pénale des mineurs s’inscrive dans cette philosophie, et ce à plus forte raison lorsque l’on sait que la critique la plus récurrente et la plus virulente faite à la version actuelle de l’ordonnance du 2 février 1945 est d’avoir sacrifié le pari éducatif sur l’autel d’une approche plus répressive [17].
Pour autant, à la lecture tant de ses principes généraux que des règles qu’il édicte, le CJPM suscite des interrogations tant au sujet de sa philosophie générale que sur la pertinence des réponses qu’il institue.
Contrairement à l’exposé des motifs de la version initiale de l’ordonnance du 2 février 1945 porteur d’une conception engagée de ses rédacteurs, l’article préliminaire du CJPM est assez abrupt pour ne pas dire silencieux sur la philosophie attachée à la réforme engagée. Ledit article se limite à reprendre de façon laconique les principes directeurs classiquement associés à la justice pénale des mineurs. Les rédacteurs du CJPM ne font par ailleurs aucune référence au cadre supralégislatif du droit de l’enfance délinquante ne serait-ce qu’à la Convention relative aux droits de l’enfant. En sus de faire fi des mouvements qui ont appelé à la réforme de la justice pénale des mineurs, ce silence est incohérent lorsque l’on constate que certaines dispositions du CJPM font directement référence à l’intérêt supérieur de l’enfant [18] : notion phare de la Convention de New-York. L’économie générale de l’article préliminaire du CJPM prend en réalité corps aux termes des dispositions de son article L. 11-2. Celui-ci dispose que « les décisions prises à l’égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif ainsi qu’à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes. ». En gommant le primat du relèvement éducatif du mineur auteur d’infraction, et en plaçant cet objectif à rang égal avec les considérations traditionnellement attachées à la loi pénale, on ne peut que s’interroger sur l’approche législative contemporaine en matière de justice pénale des mineurs. La gémellité des dispositions de cet article L. 11-2 du CJPM avec celles de l’article 707 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9874I34) creuse davantage ces interrogations. Pour rappel, cet article du Code de procédure pénale est afférent aux objectifs associés au régime d’exécution des peines applicables aux majeurs. Ces interrogations sont amplifiées lors de la lecture des réponses instituées par le CJPM et tout particulièrement par celle de la procédure de mise à l’épreuve éducative [19].
Abstraction faite de sa terminologie assez curieuse notamment en ce qu’elle fait penser à celle du sursis mise à l’épreuve, la procédure de mise à l’épreuve éducative traduit un esprit suscitant maintes interrogations. Matérialisant la césure du procès pénal déjà consacrée et remaniée par de précédentes lois, cette procédure est le trait d’union entre l’audience d’examen de la culpabilité (et d’indemnisation des victimes) et l’audience du prononcé de la sanction [20]. La première devra intervenir dans un délai maximal de trois mois et la seconde devra intervenir dans un délai de six à neuf mois après la déclaration de culpabilité. On notera que le CJPM articule cette seconde audience autour de l’idée de la « sanction » ce qui participe à confirmer les énonciations précédentes sur la dilution de la philosophie initiale du droit de l’enfance délinquante.
Dans l’attente de cette seconde audience, s’ouvre la période de mise à l’épreuve éducative lors de laquelle le mineur peut faire l’objet de l’une des mesures prévues à l’article L. 521-14 du CJPM. Au titre de ces mesures se trouvent la possibilité pour la juridiction de jugement de prononcer une expertise médicale ou psychologique, une mesure judiciaire d’investigation éducative, une mesure judiciaire éducative provisoire, une mesure de contrôle judiciaire ou une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique. Si certaines de ces mesures permettent de façon pertinente d’apporter tout élément utile au prononcé de la décision par une meilleure appréhension de la personnalité du mineur et la prise en compte de son évolution, d’autres auront un intérêt très limité. Tel est le cas des interdictions pouvant être prises au titre de la mesure judiciaire éducative provisoire, de la mesure de contrôle judiciaire ou de la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique. Il s’agira là de simples mesures de sûreté dont l’intérêt sera en réalité seulement d’établir la capacité du mineur de s’astreindre à respecter une obligation ou une interdiction. L’aspect éducatif de ces mesures pose question. Sans compter que leur régime juridique peut être plus contraignant que celui prévu pour un majeur. À titre d’illustration, hors hypothèse de l’information judiciaire, un majeur ne peut être placé sous contrôle judiciaire pour une durée supérieure à six mois dans l’attente de son jugement. Le CJPM permettra quant à lui de maintenir un mineur sous contrôle judiciaire jusqu’à neuf mois, délai maximal dans lequel doit intervenir l’audience du prononcé de la sanction. Le magistrat ne pourra que s’interroger sur la pertinence de requérir ou de prononcer ces mesures compte tenu de ces constats.
Si la réforme concrétisée par le CJPM n’est pas exempte d’interrogations sur sa philosophie générale et sur la pertinence de certaines de ses dispositions, force est de constater qu’elle fait aussi le choix de laisser d’autres interrogations entières.
La principale question que le CJPM laisse en suspens est celle de l’âge de la responsabilité pénale [21]. En sus de persister à méconnaître les prescriptions internationales en la matière [22], ce non-choix participe à maintenir un état de fait insatisfaisant. Bien que l’article 122-8 du Code pénal, dans le droit fil de la jurisprudence « Laboube », vise le critère du discernement pour déterminer si le mineur est pénalement responsable ou non, l’observation empirique des pratiques judiciaires établit qu’en général -et hors hypothèse de l’information judiciaire où la question est posée de façon systématique par le juge d’instruction au médecin psychiatre commis- les magistrats apprécient ce discernement en fonction d’un seuil d’âge qui varie d’un professionnel à un autre. D’une certaine façon, cette appréciation subjective est problématique dans la mesure où le principe d’égalité des justiciables devant la loi pénale s’en trouve contrarié. L’édiction par le CJPM d’une présomption d’irresponsabilité pénale jusqu’à l’âge de treize ans [23] n’est pas un garde-fou de nature à résorber cette difficulté. D’une part, cette présomption a un caractère simple. D’autre part, le CJPM lui-même contient des dispositions afférentes à des mineurs d’âge inférieur à treize ans. Tel est le cas des règles régissant la retenue du mineur de dix à treize ans [24]. Ce constat relativise ainsi la portée de cette présomption d’irresponsabilité pénale. Il rejoint ainsi l’ensemble des considérations précitées de nature à relativiser les apports du CJPM.
En sus d’apports relatifs, le CJPM suscite un certain nombre de craintes.
II - Les craintes suscitées par le CJPM
Ces craintes se justifient à la fois au regard des fragilités induites ou méconnues par le CJPM (A) et de la réalité de la justice pénale des mineurs (B).
A - Une réforme vectrice de fragilités
Ces fragilités sont d’ordre de forme et de fond.
La principale fragilité de forme induite par le CJPM réside dans les modalités afférentes aux deux temps procéduraux qu’il institue, à savoir celui de l’examen de la culpabilité et celui du prononcé de la sanction.
Bien que le CJPM permette le recours à une audience unique (dans une visée de célérité de la réponse pénale), la procédure de jugement qu’il institue -à titre de principe- est celle de la mise à l’épreuve éducative. Si l’idée qui sous-tend cette procédure est à saluer dans son esprit, sa mise en œuvre concrète sera assurément synonyme de lourdeurs voire d’asphyxie pour les juridictions pour mineurs et ses partenaires. Concrètement, il faudra dédoubler toutes les formalités de greffe afférentes aux convocations et aux notifications ainsi que les temps d’audience -tant en chambre du conseil qu’au tribunal pour enfants- et les voies de recours. Lorsque l’on connaît l’état des stocks, la situation des cabinets de juges des enfants -tant au regard de la charge de travail du greffe que de celle des magistrats (sans oublier celle de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel), et les difficultés d’audiencement qui cristallisent nombreuses discussions voire tensions au sein des juridictions, on peut légitimement se demander comment s’appliquera concrètement cette procédure en deux temps. En sus des difficultés inhérentes aux juridictions pour mineurs, se pose la question du délai dans lequel la procédure de mise à l’épreuve éducative sera effective à l’issue de l’audience de l’examen de culpabilité. Si celle-ci s’articule autour d’une mesure impliquant l’accompagnement du mineur par un éducateur, il est illusoire de penser que cet accompagnement éducatif sera effectif dès l’issue de la première audience (quand bien même l’exécution provisoire sera ordonnée) compte tenu des difficultés que connaît la protection judiciaire de la jeunesse. La principale conséquence de cette difficulté est de finalement vider de son sens la procédure ainsi instituée. En effet, quel sera l’intérêt de cette mise à l’épreuve éducative si la mesure sur laquelle elle repose n’est pas effective immédiatement ou si l’audience de prononcé de la sanction ne peut se tenir dans les délais prévus par le texte faute de possibilités ? D’autant que cette dernière hypothèse conduit à la caducité de la mesure de mise à l’épreuve éducative. En sus de ces fragilités de forme, le CJPM méconnait des réalités plus structurelles affaiblissant l’effectivité de certaines des mesures qu’il institue [25].
Lors du temps procédural, le mineur peut -aux termes du CJPM- être justiciable d’une mesure éducative judiciaire provisoire pouvant prendre la forme d’un module d’insertion, de réparation, de santé, de placement, d’une interdiction de paraître dans un lieu désigné par la juridiction, d’une interdiction de contact avec la victime, les coauteurs ou complices, ou d’une interdiction d’aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures [26]. Ces dispositions sont intéressantes -du moins s’agissant des différents modules (les autres réponses recoupant les interdictions du contrôle judiciaire)- en ce qu’elles permettent de mettre à profit le temps procédural pour favoriser le relèvement éducatif du mineur.
Cependant, en matière d’information judiciaire, ces dispositions passeront par la force des choses en second plan dans la mesure où l’essence de l’office du magistrat-instructeur -qui est la recherche de la vérité- peut aboutir à ce que les considérations afférentes à l’accompagnement éducatif du mineur soient relayées à un plan secondaire notamment pour protéger voire prioriser les investigations en cours. Ainsi, et même si l’article L. 12-1 du CJPM dispose que le juge d’instruction en charge d’une affaire impliquant un mineur doit être spécialisé, la réalité est toute autre. En premier lieu, il s’agit plus précisément d’une habilitation du juge d’instruction par le premier président de la cour d’appel à instruire des affaires impliquant un mineur plus qu’une spécialisation à proprement parler (bien que dans certaines juridictions, des cabinets d’instruction soient dédiés aux affaires concernant les mineurs). En second lieu, les magistrats-instructeurs n’ont pas de formation spécifique sur la question de l’enfance délinquante si ce n’est celle obtenue au cours de leur parcours universitaire. S’ils peuvent solliciter des formations en la matière au titre de leur formation continue, ces formations restent en priorité réservées aux juges des enfants.
Bien que le nombre d’affaires à l’instruction qui impliquent un mineur -auteur d’infraction- soit faible [27], il nous semble regrettable que l’effectivité des mesures instituées par le CJPM soit relative en cas d’instruction préparatoire compte tenu de la réalité judiciaire sus-décrite. Ce regret a une acuité particulière compte tenu de la suppression par la réforme de la convocation par officier de police judiciaire aux fins de mise en examen par le juge des enfants retirant ainsi à ce dernier sa casquette de juge d’instruction.
De façon plus globale, il apparaît que la réforme impulsée par le CPJM est en décalage avec la réalité de la justice pénale des mineurs ce qui va nécessairement la mettre à l’épreuve.
B - Une réforme à l’épreuve de la réalité de la justice pénale des mineurs
L’application du CJPM -tout particulièrement en ses aspects procéduraux- ne se fera pas sans tâtonnements et sans aménagements compte tenu de la réalité de la justice pénale des mineurs.
L’application du CJPM s’accompagnera -dans un premier temps- de flottements dans la mesure où ce code institue en grande partie un droit nouveau notamment sur le plan procédural. Bien que les praticiens soient soucieux d’actualiser en temps réel leurs connaissances, leur charge de travail impliquera nécessairement un temps incompressible d’assimilation des nouvelles règles d’autant que la récente réforme de la loi précitée du 23 mars 2019 vient de bouleverser de nombreux pans de la procédure pénale. Cette affirmation est d’autant plus vraie que les acteurs de la justice pénale des mineurs ne sont pas tous spécialisés. Ainsi, le tribunal de police -compétent en matière de contraventions de quatrième classe commis par les mineurs- est composé d’un magistrat à titre temporaire et les fonctions du ministère public y sont exercées par un commissaire de police ou son adjoint. Ces professionnels ne sont pas forcément sensibilisés aux questions afférentes à la justice pénale des mineurs. Le juge des libertés et de la détention n’est pas non plus un magistrat spécialisé sur la thématique. Il sera nécessaire -notamment dans les petites juridictions- que les magistrats qui exercent cette fonction soient à jour des nouvelles mesures instituées par le CJPM notamment lorsqu’ils refuseront le placement en détention provisoire requis par le parquet et /ou demandé par le juge d’instruction.
L’application du CJPM se fera aussi avec des aménagements dans la mesure où les moyens humains et logistiques des juridictions ne permettront pas toujours de satisfaire pleinement à toutes les dispositions procédurales du CJPM. Certains d’entre eux sont même prévus par le CJPM. Deux illustrations peuvent être formulées à ce titre. L’article L. 12-2 du CJPM dispose -qu’à l’égard d’un mineur- l’action publique est exercée par un magistrat du parquet spécialement désigné pour être en charge des affaires concernant les mineurs. Cependant, dans les petites juridictions ou lors des permanences de nuit et de weekend, le parquetier ne pourra pas toujours être un magistrat spécialisé. Le CJPM a prévu cette difficulté dans la mesure où son article L. 211-1 permet de déroger à la règle de l’article L. 12-2 en cas d’empêchement du parquetier spécialisé ou d’urgence. Un autre exemple d’aménagement peut être donné via le dossier unique de personnalité créé par la loi du 10 août 2011 (N° Lexbase : L9731IQH). Repris par les articles L. 322-8 du CJPM, ce dossier unique de personnalité est pensé pour être un véritable outil de connaissance de la personnalité du mineur. Pour autant, sa mise en place et son alimentation au sein des juridictions restent parfois embryonnaires faute de moyens et de temps.
Cette question des moyens est continuellement relayée par les professionnels de la justice des mineurs. Pour autant, elle constitue la condition sine qua non d’une justice pénale des mineurs efficace. Il conviendra de voir dans quelles modalités les pouvoirs publics y répondront à l’aube de l’entrée en vigueur du CJPM dont la partie réglementaire -non encore publiée- ne manquera pas elle aussi de susciter d’autres interrogations, fragilités, et craintes d’ordre pratique.
[1] Ce fascicule a été formalisé par le pôle processus de décision et de formalisation de la justice pénale de l’École Nationale de la Magistrature. Il est régulièrement actualisé par les magistrats exerçant des fonctions de coordination et d’enseignement au sein de ce pôle.
[2] Les magistrats disposent de différents forums de discussion -en fonction de leur spécialité- pour partager leurs interrogations et pratiques.
[3] Il s’agit là d’extraits du mail reçu par les magistrats à ce sujet.
[4] Ord. n° 45-174 du 2 février 1945, art. 9.
[5] Ord. n° 45-174 du 2 février 1945, art. 10-2 et s.
[6] CJPM, art. L. 331-1 et s.
[7] CJPM, art. L.13-1.
[8] V. Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-87.767, F-P+F (N° Lexbase : A9201DUC).
[9] Ces articles sont relatifs aux actes de terrorisme.
[10] Cet article dispose que la durée totale de la détention provisoire peut aller jusqu’à deux ans lorsque le mineur d’au moins seize ans est poursuivi pour des faits d’association de malfaiteurs visant à l’un des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 et 421-2 du Code pénal.
[11] Ord. n° 45-174 du 2 février 1945, art. 7-1.
[12] Ord. n° 45-174 du 2 février 1945, art. 7-2.
[13] Ord. n° 45-174 du 2 février 1945, art. 7-2.
[14] Ord. n° 45-174 du 2 février 1945, art. 8.
[15] Ibid.
[16] Ord. n° 45-174 du 2 février 1945, art. 15-1.
[17]. Sur ce point, nous renvoyons le lecteur à notre thèse de doctorat : Hebbadj, (L.), L’avenir du droit de l’enfance délinquante, Lille : Université de Lille, 2018, 349 p.
[18] CJPM, art. L. 311-1.
[19] CJPM, art. L. 521-7 et suivants.
[20] CJPM, art. L. 521-1.
[21] Sur ce point, lire E. Gallardo, La nouvelle responsabilité pénale des mineurs délinquants : une perte de spécificité ?, Lexbase Pénal, doss. spé. n° 1 (N° Lexbase : N0953BYX).
[22] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°10 (2007) : Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, CRC/C/GC/10, 25 avril 2007, 28 p.
[23] CJPM, art. L. 11-1.
[24] CJPM, art. L413-1.
[25] CJPM, art. L. 431-1.
[26] CJPM, art. L. 112-2.
[27] Selon les chiffres clés de la justice pénale des mineurs en date de 2018, le nombre d’affaires impliquant un mineur à l’instruction était de 1709 en 2017.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471103
[Point de vue...] De l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante à l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs
Réf. : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs (N° Lexbase : L2043LSH)
Lecture: 24 min
N1085BYT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christine Lazerges, Professeure émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancienne présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH)
Le 13 Novembre 2019
Mots-clés : mineurs • Code de la justice pénale des mineurs • ordonnance du 2 février 1945 • ordonnance du 11 septembre 2019 • réforme
Cet article est issu du dossier spécial "Code de la justice pénale des mineurs" publié le 14 novembre 2019 dans la revue Lexbase Pénal. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici : (N° Lexbase : N1086BYU)
Réforme ou révolution, ajustement ou bouleversement ? Le lecteur de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) ne peut que s’interroger tant le texte recèle de messages différents, voire quelquefois contradictoires, si l’on y réfléchit bien. Signes de continuité et signes de rupture émaillent le texte et conduisent à s’interroger sur la cohérence du projet de politique criminelle de la nouvelle ordonnance concernant les mineurs délinquants.
L’ordonnance du 11 septembre 2019 n’est pas à droit constant, le Parlement, par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC) ayant autorisé le Gouvernement à réformer par voie d’ordonnance, l’ordonnance du 2 février 1945.
De façon rassurante pour celles et ceux qui sont attachés au modèle protectionnel, le rapport au président de la République sur la nouvelle ordonnance débute par le rappel de la phrase la plus connue du préambule de l’ordonnance du 2 février 1945 : « Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains ». Est également rappelé la nécessité « de préserver la continuité de l’intervention du juge des enfants, qui est l’un des éléments de la spécialisation de la justice pénale des mineurs et un gage de son efficacité ».
Les spécialistes du droit des mineurs n’ignorent pas que l’ordonnance du 2 février 1945 a subi plus de quarante réformes, des plus modestes aux plus importantes, au point que Pierre Joxe auditionné en 2018 par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) dans le cadre de la préparation d’un avis sur saisine de la garde des Sceaux sur les mineurs privés de liberté [1], n’hésitait pas à dire : « Il n’y a plus d’ordonnance de 1945 ».
La fièvre législative sur la délinquance des mineurs est liée à la très forte charge symbolique du sujet, facilement instrumentalisé par les politiques.
Indéniablement, le texte était devenu illisible et la mutation du texte initial ne faisait aucun doute. Cette mutation insidieuse ou explicite [2] résultait de tensions évidentes entre la logique protectionnelle, la nécessaire garantie des droits fondamentaux et la double exigence de fermeté et de rapidité revendiquée. Un consensus existait sur la nécessité de réformer l’ordonnance de 1945 depuis quelques années seulement. En effet, dans le rapport que nous remettions au premier ministre en 1998, Jean-Pierre Balduyck et moi-même, sous le titre Réponses à la délinquance des mineurs [3], les 135 propositions faites par la commission mise en place préconisaient une application effective de l’ordonnance de 1945 avec les moyens afférents indispensables et non une réécriture de l’ordonnance. Dix ans plus tard, en 2008, André Varinard, dans un rapport à la garde des Sceaux proposait, avec la commission constituée alors, une réforme profonde sous le titre : Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales, 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs [4]. En dix ans, il n’était plus apparu tenable de ne pas réviser l’ordonnance de 1945 avec le risque de la défigurer dans ses fondements et de céder aux sirènes sécuritaires et en particulier au déséquilibre grandissant entre droit à la sûreté et droit à la sécurité.
L’analyse du texte de l’ordonnance de 2019, qui doit être soumis au Parlement pour ratification, sous l’angle de la politique criminelle invite à présenter dans des propos conclusifs d’une part, les éléments de continuité (I) et d’autre part, les éléments de rupture avec l’esprit de l’ordonnance de 1945, largement trahi au fil des années depuis 1945 jusqu’à parler de porosité de la frontière entre la justice des mineurs et la justice des majeurs [5] (II).
Aussi judicieux qu’apparaîtrait le nouveau code, il ne faut jamais oublier que l’on ne peut pas attendre de la loi ce qu’elle ne peut pas produire. S’agissant de la justice pénale des mineurs, il faut garder à l’esprit sa pauvreté, en d’autres termes la lourde insuffisance de ses moyens dont aussi bien ses acteurs que les experts ou la presse ne cessent de se faire l’écho [6].
I - Les éléments de continuité
La nouvelle ordonnance, ou le CJPM, comporte un article préliminaire porteur d’un principe directeur et un énoncé des principes généraux de la justice pénale des mineurs dans les articles L. 11-1 à L. 12-6 (A) qui sont signes de continuité, comme l’est aussi la prise en compte affichée aussi bien de l’acte posé par le mineur délinquant que de sa personnalité par la consécration de la césure du procès pénal des mineurs mais assortie de bien des exceptions (B).
A - Les principes directeurs et généraux
L’article préliminaire du futur code est simplement une reprise du principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) sur la délinquance des mineurs, érigé comme tel par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 [7]. Il doit être analysé comme un principe directeur de la justice pénale des mineurs. Le texte de cet article préliminaire mérite d’être rappelé, il est bref et même trop bref : « Le présent code régit les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre, en prenant en compte l’atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral par des mesures appropriées à leur âge et leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ». Cet article préliminaire est d’une grande, trop grande sécheresse ; aucun renvoi à l’intérêt supérieur de l’enfant n’est fait, aucun renvoi à la Convention internationale des droits de l’enfant, aucune philosophie pénale n’est affirmée [8].
Le titre préliminaire, qui fait suite à l’article préliminaire, décline en deux temps les principes généraux du droit pénal, puis de la procédure pénale applicable aux mineurs.
Dans un chapitre 1er du titre préliminaire les articles L. 11-1 à L. 11-5 énoncent les principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs. Ces articles rappellent les principes fondateurs de l’ordonnance de 1945 sans trancher, comme déjà ne l’avait pas fait l’ordonnance de 1945, la situation des jeunes enfants matériellement coupables d’une infraction, alors que cela est attendu par la doctrine depuis des décennies et parfaitement traité dans de nombreux pays étrangers respectueux de la Convention internationale des droits de l’enfant (N° Lexbase : L6807BHL). La jurisprudence française depuis le célèbre arrêt « Laboube », rendue par la Chambre criminelle le 13 décembre 1956, pallie ce manque qui aurait dû être comblé. Dans le nouveau Code de la justice pénale des mineurs, il n’est pas question d’un seuil de présomption irréfragable de capacité à répondre de ses actes devant une juridiction pénale. Tel qu’est rédigé l’article L. 11-1, la présomption dont il est question est une présomption simple en l’absence de toute précision : « Lorsqu’ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l’article 388 du Code civil (N° Lexbase : L0260K7R), sont pénalement responsables des crimes délits et contraventions dont ils sont reconnus coupables. Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement. ». La garde des Sceaux a été invitée à plusieurs reprises à se prononcer sur la nature de cette présomption, elle ne l’a jamais qualifiée d’irréfragable. La question de la responsabilité pénale des mineurs délinquants est traitée comme dans l’ordonnance de 1945 sans que l’on sache ce qu’est le discernement, notion abandonnée à la jurisprudence. Il est stupéfiant qu’un âge d’exclusion du champ pénal pour les mineurs les plus jeunes n’ait pas été fixé, aucune présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale n’est introduite. La France ne répond toujours pas à cet égard à ses engagements internationaux.
Concernant les peines et les mesures éducatives, la continuité domine avec la version initiale de l’ordonnance de 1945. Les sanctions éducatives introduites plus tard ont heureusement disparu, elles ne faisaient que créer de la confusion. Cette simplification était souhaitable. La simplification va apparemment plus loin dans la mesure où l’article L. 111-1 n’affiche plus que deux mesures éducatives : l’avertissement judiciaire et la mesure éducative judiciaire (sur ce point, v. C. Marie, La nouvelle mesure éducative judiciaire : la diversité sous l’unité, Lexbase Pénal, doss. spé. n° 1 N° Lexbase : N0955BYZ). En réalité, cette dernière peut comporter quatre modules cumulables ou non (module d’insertion, module de réparation, module de santé, module de placement), des interdictions et/ou des obligations. La présentation est plus moderne, le contenu ne change que peu ; au fil des années de nouvelles mesures éducatives avait été introduites. Toute la gamme ou presque des anciennes mesures éducatives et sanctions éducatives se retrouve dans cette nouvelle classification, y compris le placement dans un centre éducatif fermé qui fait l’objet d’une attention particulière de la part du législateur. Certaines interdictions ou obligations sont exclues pour les mineurs de moins de dix ans.
Concernant les peines, le CJPM est à droit constant. Comme précédemment un mineur de moins de treize ans ne peut pas faire l’objet d’une peine à proprement parler, il ne peut donc pas être privé de liberté dans un établissement pénitentiaire, mais il peut l’être dans un centre éducatif fermé, juridiquement mesure éducative. Contrairement au dispositif de 1945 mais plusieurs fois amendé, peines et mesures éducatives sont cumulables.
Dans un chapitre second du titre préliminaire, les articles L. 12-1 à L. 12-6 énoncent les principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs. Il est regrettable que dans un article préliminaire de ce chapitre ne soit pas rappelé que l’article préliminaire du Code de procédure pénale est applicable in extenso aux mineurs délinquants.
Ces principes généraux débutent par le rappel de la spécialisation des acteurs à tous les stades de la procédure, marque de continuité. Autant la spécialisation effective des juges pour enfants ne prête guère de façon générale au doute, autant il n’en est pas de même en fait pour les magistrats du parquet chargé des affaires concernant les mineurs. L’indivisibilité du parquet permet à des magistrats qui n’ont reçu aucune formation particulière de traiter de dossiers concernant des mineurs. Or, on sait combien nombreuses sont les affaires concernant des mineurs qui font l’objet d’alternatives aux poursuites. Ce ne sont que 50 % environ des mineurs suspectés d’infractions pénales qui rencontrent un juge pour enfants. Les écarts à cet égard sont considérables selon les juridictions. On peut douter aussi, sauf dans les grandes juridictions, de la spécialisation de tous les juges d’instruction chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. Hormis les juges pour enfants, tous les magistrats ayant à connaître à tous les stades de la procédure de poursuites ou d’alternatives aux poursuites à l’encontre d’un mineur ne suivent pas une session de formation à l’ENM (sur ces difficultés pratiques, v. L. Hebbadj, Approche pratique de l’ordonnance n• 2019-950 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, Lexbase Pénal, doss. spé. n° 1 N° Lexbase : N1103BYI).
Une étude mériterait d’être conduite en particulier sur la spécialisation des juges d’instruction spécialement chargés des affaires concernant les mineurs, sujet d’autant plus important que les juges pour enfants perdent leur compétence de juge d’instruction.
La composition de la cour d’assises des mineurs n’a pas bougé, l’occasion était pourtant donnée d’accroître sa spécialisation. En bref, la spécialisation des acteurs magistrats de la justice des mineurs n’est que relative y compris pour les juges pour enfants en raison du turn over très rapide dans de nombreuses juridictions. Ce turn over ne permet pas à chaque juge des enfants d’acquérir une véritable spécialisation et une bonne connaissance des partenaires indispensables pour la mise en œuvre des mesures qu’il prend.
Le principe de la publicité restreinte des audiences concernant un mineur demeure avec des exceptions dont il est traité plus loin dans le nouveau code. De même, le principe selon lequel le mineur poursuivi ou condamné est assisté d’un avocat est réaffirmé. Globalement la continuité domine dans l’énoncé des principes généraux du droit pénal ou de la procédure pénale applicable aux mineurs.
A priori, il en est de même dans la prise en compte affichée de l’acte et de la personnalité du mineur en justice pénale des mineurs
B - La prise en compte de l’acte et de la personne du mineur consacrée par la césure du procès pénal du mineur
L’implicite dans l’ordonnance de 1945 devient explicite. Jean Chazal, juge pour enfants de la première génération, aimait à expliquer que lorsqu’un mineur vole un vélo, ce n’est pas le vélo qui doit retenir l’attention mais le mineur. La personne de l’enfant est au cœur de l’ordonnance de 1945, preuve en est cette mesure phare de l’ordonnance qu’était la liberté surveillée préjudicielle devant éclairer par la suite le jugement rendu.
Cette première forme de césure était une césure entre l’observation du mineur dans le cadre de la liberté surveillée préjudicielle et le jugement du mineur. L’objectif était de connaître le mieux possible la personnalité du mineur avant de faire le choix d’une sanction. Avec le CJPM, la liberté surveillée préjudicielle ou à titre provisoire est remplacée par la mesure éducative judiciaire provisoire, dont le contenu est modulable durant toute la période de mise à l’épreuve éducative pour tenir compte de l’évolution du mineur. Cette période permet d’entamer la constitution ou de compléter « le dossier unique de personnalité » qui fait l’objet des articles L. 322-8 à L. 322-10 du CJPM. Il n’y a pas d’hésitation à affirmer la continuité idéologique apparente avec l’ordonnance de 1945. Distinguant l’acte délictueux commis par le mineur et l’appréhension de sa personnalité, les premiers commentateurs de l’ordonnance de 1945 pensaient déjà la césure du procès pénal du mineur, de nombreux articles et ouvrages de doctrine de l’époque en attestent [9]. En réalité, la continuité n’est qu’apparente dans le CJPM car les délais dans lesquels est enserrée la nouvelle césure du procès pénal casse la possibilité d’une vraie mise à l’épreuve éducative avant jugement, par ailleurs les exceptions à la césure ou les contournements de la césure sont nombreux. La continuité est en trompe-l’œil.
Avant le CJPM, la loi du 10 août 2011 traitait de la césure, modifiée ensuite dans ses modalités par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice au XXIème siècle [10]. Le CJPM consacre à la césure du procès pénal du mineur trois sous-sections dans le titre traitant de la procédure de jugement, aux articles L. 521-7 à L. 521-25 du CJPM. Sont bien distinguées l’audience d’examen de la culpabilité, la période de mise à l’épreuve éducative et l’audience de prononcé de la sanction.
En raison de la faiblesse des moyens de la PJJ et en conséquence de l’incapacité à mettre en application rapidement la mesure éducative judiciaire provisoire, la césure du procès pénal du mineur, enserré dans des délais très courts, ne pourra permettre ni une meilleure connaissance de la personnalité du mineur, ni une mise à l’épreuve de ce mineur avant prononcé de la sanction. L’article L. 521-9 du CJPM dispose que lors de l’audience d’examen de la culpabilité « la juridiction fixe, dans son jugement, la date de l’audience de prononcé de la sanction qui a lieu, dans un délai compris entre six et neuf mois après la déclaration de culpabilité, devant le juge des enfants ou, si la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, devant le tribunal pour enfants de son ressort ». Le délai moyen aujourd’hui de mise en place d’une mesure éducative est de six mois, si l’audience de prononcé de la sanction est fixée à neuf mois, il n’y aura eu le plus souvent que trois mois pour apprécier les effets de la mesure éducative judiciaire provisoire. En l’état des forces de la PJJ ou du secteur associatif de protection de la jeunesse, le dispositif de la césure du procès pénal du mineur selon le CJPM est irréaliste. L’objectif de rapidité avant tout de la procédure tue des innovations qui auraient pu être intéressantes [11].
Les rédacteurs de l’ordonnance du 11 septembre 2019 n’étaient pas inconscients de ces difficultés d’ordre pratique, contournées en prévoyant des exceptions à la césure du procès pénal du mineur. Ainsi, l’article L. 423-4 du CJPM autorise dans certains cas le procureur de la République à saisir le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique. De même l’article L. 521-2 autorise le juge, sur décision motivée, à statuer en audience unique sur la culpabilité et la sanction du mineur. En outre, un vide juridique interpelle : rien n’est prévu dans l’hypothèse ou au terme des neuf mois, autorisés par la loi pour fixer l’audience de jugement, cette dernière ne peut se tenir en raison du volume des affaires à audiencer ; qu’en est-il alors de la mesure éducative provisoire qui doit prendre fin au bout de neuf mois ? En principe elle prend fin brutalement, laissant le mineur sans accompagnement jusqu’au jugement.
À l’évidence, l’ordonnance nouvelle a été préparée trop vite sur un mode bien peu démocratique, sans débats, après un nombre d’auditions très faible, semble-t-il. Le risque est majeur que des dispositions qui constituaient potentiellement des éléments de continuité avec l’ordonnance de 1945 et même d’avancées dans la protection des mineurs délinquants se retournent contre ces mêmes mineurs et s’avèrent en rupture avec l’esprit même de l’ordonnance de 1945.
Il est difficile de ne pas être critique dans l’appréciation d’éléments apparemment seulement en continuité avec la philosophie politique humaniste de l’ordonnance de 1945. D’autres éléments s’inscrivent en rupture sans ambiguïtés.
II - Les éléments de rupture
Seuls deux exemples de rupture explicite (A), puis un exemple de rupture implicite (B) seront pris.
A - Les ruptures explicites
Au titre des ruptures explicites, l’appauvrissement de la fonction de juge des enfants et la rapidité comme objectif sont manifestes. Dans l’un et l’autre cas des développements conséquents seraient nécessaires qui n’ont pas place dans des propos conclusifs, cependant des signes non trompeurs peuvent être notés.
La suppression de l’instruction devant le juge des enfants, appauvrissement manifeste de ses compétences, au nom de la simplification de la procédure pénale applicable aux mineurs, est un bouleversement radical. Le juge des enfants n’était juge d’instruction qu’en matière délictuelle on le sait, mais ceci correspond quantitativement, hormis les contraventions, à la quasi-totalité des affaires. La réforme simplifie la procédure en instituant un mode de saisine unique : la saisine de la juridiction de jugement spécialisée aux fins de jugement sur la culpabilité en principe dans un premier temps, si césure du procès il y a, avant le jugement sur la sanction dans un second temps. En clair, le pouvoir du parquet s’accroit considérablement par la suppression de l’instruction par le juge des enfants en matière délictuelle, sauf dans les affaires complexes où un juge d’instruction spécialisé peut être saisi. On le sait, dans les petites et moyennes juridictions, la spécialisation de ce juge d’instruction, non juge des enfants par définition, peut être très relative.
Concernant cet appauvrissement de la fonction de juge des enfants, les rédacteurs du CJPM ont-ils mesuré la contradiction qu’il y a à souhaiter préserver la connaissance par le juge des enfants du mineur qu’il juge, alors que le jugement sur la culpabilité doit intervenir dans un délai de dix jours à trois mois après l’issue de l’enquête ? Le juge des enfants aura-t-il la possibilité de rencontrer avant le jugement sur la culpabilité, ne serait-ce qu’une fois, le mineur qu’il doit juger si ce dernier est primo délinquant ? On peut sérieusement en douter. Comment va-t-il pouvoir choisir avec pertinence une mesure judiciaire provisoire pour un mineur qu’il ne connait pas, alors que cette mesure judiciaire provisoire doit éclairer au mieux le choix de la sanction lors de la seconde audience ?
Des générations de juges des enfants ont démontré l’importance de connaître au mieux le mineur que l’on juge ainsi que son environnement familial et social. Or remplacer l’instruction par l’enquête dans la très grande majorité des cas tourne le dos à la philosophie pénale en droit des mineurs qui fut celle de l’ordonnance du 2 février 1945 et qui est celle de la plupart des juges des enfants. C’est seulement pour les primo-délinquants, ayant précédemment fait l’objet de mesures d’assistance éducative, que lors de la première audience le juge des enfants bénéficiera d’une certaine connaissance du mineur. Ce sera également le cas pour les mineurs récidivistes. Il est évident que l’objectif de la nouvelle ordonnance est la rapidité en contradiction avec le temps nécessaire pour apprécier les effets de la mesure de protection judiciaire provisoire.
La rapidité comme objectif ressort de nombreuses dispositions de la nouvelle ordonnance. Un jugement qui intervient relativement vite est une bonne chose, mais un mineur ne doit pas être jugé de façon expéditive. Or les délais prévus par le CJPM non seulement s’avèreront rapidement inapplicables en l’état de la justice des mineurs, mais encore tournent le dos à l’intérêt supérieur de l’enfant. Reprenons ces délais presque stupéfiants : la convocation dans un délai de 10 jours à trois mois pour voir tranchée la question de la culpabilité sera particulièrement difficile à respecter et aura les effets pervers déjà dénoncés. Le prononcé de la sanction dans un délai de six à neuf mois à compter du premier jugement ne permet pas d’évaluer les effets de la mesure éducative judiciaire provisoire qui elle-même ne peut pas être mise en place immédiatement.
Frappent dans ces exemples de dispositions en rupture avec l’esprit et la lettre du droit des mineurs antérieurs en dépit de modifications déjà intervenues précédemment, un irréalisme certain.
B - Les ruptures implicites
Au titre des ruptures implicites avec le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant est cette promotion des centres éducatifs fermés (CEF) auxquels est consacrée la seconde section d’un chapitre intitulé « Du régime de placement ». Un long article L. 113-7, définit ce que sont les CEF sur un mode ambitieux alors que, sauf exceptions, les dysfonctionnements des CEF sont légions comme l’ont montré travaux de recherche et études [12]. La rapidité de la justice des mineurs comme l’enfermement de ces derniers dans des établissements différents des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) ou des quartiers pour mineurs des maisons d’arrêt, sont une réponse à une demande politique claire de plus grande sévérité à l’égard des mineurs délinquants, mais bien peu fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’ordonnance de 1945 n’excluait pas les centres fermés mais les derniers d’entre eux avaient été supprimés en 1979. La décision du Conseil constitutionnel d’août 2002, en même temps qu’elle posait le principe fondamental reconnu par les lois de la République sur la délinquance des mineurs, avalisait l’ouverture de nouveaux centres fermés. Le sujet avait donné lieu à de très vifs débats parlementaires. La circulaire de mise en œuvre du programme des CEF définissait le placement dans ce type d’établissement comme une contrainte juridique. Pensé au départ pour un public « multirécidiviste », le placement en CEF peut s’appliquer aux mineurs de 13 à 18 ans, sans condition d’antécédents judiciaires. Il s’agit de mineurs le plus souvent sous contrôle judiciaire. Comme le note la CNCDH, au fil des années les CEF ont vu leur cadre se rigidifier. La tendance à la « carcéralisation » (fermeture des portes, ajout de grilles, de vidéo-surveillance etc…) au point que l’on peut considérer comme privés de liberté les mineurs détenus dans les quelques 50 CEF actuellement ouverts. Le chiffre ne peut pas être donné précisément car fermetures et ouvertures de CEF se succèdent rapidement dans le temps, prouvant ainsi la difficulté à faire fonctionner des établissements de ce type. Les CEF augmentent petit à petit en nombre au détriment d’établissements diversifiés dans leur projet pédagogique. Les juges des enfants ont besoin d’une gamme aussi large que possible de types d’établissements.
Dans son article L. 113-7 sont élargies encore les catégories de mineurs pouvant être placés en CEF : contrôle judiciaire, sursis probatoire, placement à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle. Malgré son coût de fonctionnement considérable le placement en CEF est implicitement présenté comme la mesure phare avant la privation de liberté dans un établissement pénitentiaire, et ce malgré le constat établi de ce que le CEF est la porte de la prison dès que les obligations imposées au mineur, par exemple sous contrôle judiciaire, ne sont pas respectées. L’institution même des CEF participe mécaniquement à accroître le nombre de mineurs détenus par l’administration pénitentiaire. Ce nombre n’a jamais été aussi important depuis 1945.
En définitive, l’ordonnance du 11 septembre 2019 est à ce point porteuse de messages contradictoires et dépourvue de philosophie générale, si ce n’est accélérer le cours de la justice des mineurs, qu’il est difficile de qualifier son économie générale en un temps de surcroît, où la mise en œuvre des textes nouveaux supposerait une autre accélération, une accélération magistrale des moyens donnés à la justice des mineurs délinquants.
[1] CNCDH, Avis sur la privation de liberté des mineurs, 27 mars 2018, JORF, n° 0077 du 1er avril 2018, texte n°48 (N° Lexbase : Z581267X).
[2] Christine Lazerges, La démolition méthodique de la justice pénale des mineurs devant le Conseil constitutionnel, RSC, n° 3/2011.
[3] Réponses à la délinquance des mineurs, La documentation française 1998.
[4] Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales, 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs, La documentation française, 2008.
[5] Cf. Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs, JORF n° 0213 du 13 septembre 2019, texte n°1 (N° Lexbase : Z850978S).
[6] Le sacerdoce des juges pour enfants, Le Monde, 27 septembre 2019 [en ligne] ; et dans le même numéro, Les promesses du gouvernement sur la justice des mineurs [en ligne].
[7] Cons. const., décision n° 2002-461, du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice (N° Lexbase : A2314AZQ).
[8] Cf. Ph. Bonfils, Première approche du Code de la justice pénale des mineurs, AJ Pénal, octobre 2019, p. 476 et s.
[9] Cf. en particulier les écrits de Marc Ancel et son ouvrage phare La défense sociale nouvelle - Un mouvement de politique criminelle humaniste, Paris, Cujas, 1954, 3ème édition 1981.
[10] Nadia Beddiar, La césure du procès pénal des mineurs, AJ Pénal, octobre 2019, p. 483 et s.
[11] Cf. infra.
[12] Cf. note 2 ; Avis précité de la CNCDH sur les mineurs privés de liberté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471085
[Textes] Réforme de la justice pénale des mineurs : une codification dans l’urgence ? - Présentation synthétique du nouveau texte
Réf. : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs (N° Lexbase : L2043LSH)
Lecture: 11 min
N0992BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Philippe Bonfils, Professeur à Aix-Marseille Université, Doyen honoraire de la faculté de droit et de science politique, Avocat au barreau de Marseille
Le 13 Novembre 2019
Mots-clés : mineurs • Code de la justice pénale des mineurs • ordonnance du 2 février 1945 • ordonnance du 11 septembre 2019 • réforme • présentation
Cet article est issu du dossier spécial "Code de la justice pénale des mineurs" publié le 14 novembre 2019 dans la revue Lexbase Pénal. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici : (N° Lexbase : N1086BYU)
Le Code de la justice pénale des mineurs a été adopté par l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019. L’idée d’une codification du droit pénal des mineurs n’est pas nouvelle, et la Commission « Varinard » avait en 2008 proposé l’adoption d’un code dédié [1], et suggéré que celui-ci s’appelle « Code de la justice pénale des mineurs » -pour intégrer le fond et la procédure. Du reste, deux avant-projets de codification avaient été élaborés par le ministère de la Justice, mais les aléas de la vie politique et le caractère sensible de la matière n’avaient pas permis à ces projets d’aboutir.
Le Gouvernement avait ici choisi de procéder par voie d’ordonnance de l’article 38 de la Constitution. Le Parlement, par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), a donc habilité le Gouvernement à « intervenir » dans le domaine de la loi, sans débat démocratique, le Parlement n’étant finalement sollicité que pour ratifier après coup l’ordonnance prise. La méthode est particulièrement gênante, d’autant que le texte qui vient d’être adopté n’est pas la simple reprise de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), mais un texte nouveau, faisant parfois des choix de sociétés -ou le plus souvent ne les faisant pas. Certes, l’entrée en vigueur du texte est repoussée au 1er octobre 2020, ce qui pourrait permettre l’adoption, dans l’intervalle, d’une loi d’adaptation, destinée à corriger les imperfections les plus manifestes du texte. Mais il serait illusoire de penser qu’une loi d’adaptation pourrait refondre profondément le Code de la justice pénale des mineurs, et compenser l’absence de débat ayant présidé à son adoption. Du reste, le projet de loi de ratification déposé en conseil des ministres le 30 octobre 2019 se contente d’un article unique qui dispose que «l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs est ratifiée».
La lecture du code donne l’impression d’un travail un peu précipité, voire inabouti. La terminologie, par exemple, n’est pas fixée, et, malgré son titre, le Code de la justice pénale des «mineurs» ne tranche pas entre les termes d’enfant et de mineur (le juge des enfants et le tribunal pour enfants conservent leur nom, comme la chambre spéciale des mineurs ou la cour d’assises des mineurs). De même, la philosophie générale du code n’est pas énoncée, et l’article préliminaire du code n’apporte rien de ce point de vue, dans la mesure où il se contente de reprendre une partie du principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé par le Conseil constitutionnel en 2002 [2]. Plus encore, la question de l’âge de la responsabilité pénale -ô combien importante [3]- n’est pas clairement précisée, puisque le code affirme à la fois que le discernement est le critère de la responsabilité pénale, et que l’âge de 13 ans est le seuil pivot, en dessous duquel un mineur est présumé ne pas avoir le discernement et au dessus duquel il est présumé l’avoir acquis. Le seuil souple du discernement comme fondement de la responsabilité pénale pouvait parfaitement être conservé, mais on pouvait aussi fixer -comme le font la plupart des droits étrangers [4]- un âge de responsabilité pénale des mineurs, et par exemple 13 ans. Mais la combinaison des deux systèmes manque singulièrement de clarté, et il est possible qu’elle nourrisse même un contentieux nouveau, puisque les présomptions énoncées ne sont que des présomptions simples.
L’objectif annoncé -qui constituait du reste le cadre de l’habilitation parlementaire- était de simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants, d’accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité, de renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération et d’améliorer la prise en compte de leurs victimes. Il est évidemment trop tôt pour dire si ces objectifs ont été atteints. On peut cependant constater, dès à présent, que le texte n’est pas véritablement plus simple que l’ordonnance de 1945. Le Code de la justice pénale des mineurs est un texte long (plus de 250 articles) et complexe, qui modifie profondément le droit pénal des mineurs. Certes, le code reprend nombre de dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945, mais il apporte d’importants changements, sur le fond comme sur la procédure. On les abordera dans cet ordre.
I - Les dispositions de fond
S’agissant des conditions de responsabilité pénale des mineurs, le code énonce, dans un article L. 11-1, que « lorsqu’ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l’article 388 du Code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables ». Cette disposition reprend le principe inscrit à l’article 122-8 du Code pénal (N° Lexbase : L2057AM7) (qui n’est pas modifié sur ce point), qui lui-même consacre la solution posée par l’arrêt « Laboube » en 1956 [5]. Mais le même article prévoit, dans l’alinéa suivant que « les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement ». On peut penser qu’en pratique, la responsabilité pénale des mineurs de moins de treize ans devrait être exceptionnelle. Néanmoins, tout dépendra de la manière dont ces dispositions seront effectivement appliquées et combinées. A cet égard, on peut rappeler qu’actuellement on considère que le discernement s’acquiert aux alentours de l’âge de 7 ans (l’âge de raison) [6], dans la continuité du droit romain qui désignait comme infans ceux qui avaient moins de 7 ans…
Concernant les mesures, le code affirme, au titre des principes directeurs, le principe de primauté de l’éducation sur la répression, en combinant la formule utilisée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 [7] et les fonctions de la peine de l’article 130-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9806I3L). L’article L. 11-2 prévoit ainsi que « les décisions prises à l’égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes ». Le principe se déduit aussi de l’article L. 11-3, qui prévoit quant à lui que « les mineurs déclarés coupables d’une infraction pénale peuvent faire l’objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l’exigent, de peines ». Mais, comme on pouvait s’y attendre, la primauté de l’éducation sur la répression admet le cumul le plus large entre les mesures éducatives et les peines (art. L. 111-3), le code venant ici achever l’abandon progressif de l’option des voies éducative et répressive [8].
Plus précisément, le code revient -avec raison- à un système dualiste, composé de mesures éducatives et de peines. Les sanctions éducatives qui avaient été créées par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 (N° Lexbase : L6903A4G) (et qui n’avaient guère prouvé leur efficacité) disparaissent donc, certaines d’entre elles étant absorbées par la catégorie des mesures éducatives. Ces dernières sont profondément réaménagées. Le code en propose deux : l’avertissement judiciaire (nouvelle dénomination de l’admonestation, de l’avertissement solennel et de la remise à parent) et la mesure éducative judiciaire (lire dans ce numéro, C. Marie, La nouvelle mesure éducative judiciaire : la diversité sous l’unité, Lexbase Pénal, doss. spé. n° 1, novembre 2019 N° Lexbase : N0955BYZ) qui constitue une mesure « fourre-tout », comprenant des « modules » (insertion, réparation, santé et placement) ou des interdictions (de paraître, d’aller et venir, de rencontrer les coauteurs ou complices ou la victime…), ou encore l’obligation d’accomplir un stage, inspirés de certaines mesures éducatives ou sanctions éducatives actuelles.
S’agissant enfin des peines, le code reprend l’exemption légale de peine en dessous de l’âge de treize ans, et la diminution légale applicable à partir de l’âge de treize ans, diminution obligatoire entre treize et seize ans (plafonné à la moitié de la peine encourue par un majeur et plafonnée à vingt ans de réclusion en cas de perpétuité encourue par un majeur), et pouvant être écartée entre seize et dix-huit ans. Le code reprend aussi à l’ordonnance du 2 février 1945 les peines inapplicables aux mineurs, comme l’interdiction du territoire, le jour amende, ou l’affichage de la décision, et l’impossibilité de faire application aux mineurs de la période de sûreté.
II - Les dispositions de procédure
Le Code de justice pénale des mineurs consacre d’abord à la procédure des principes directeurs, dans le titre préliminaire (art. L. 12-4 et s.) : publicité restreinte, assistance obligatoire du mineur par un avocat, droit à l’information et à l’accompagnement des représentants légaux, droit d’exercer des voies de recours, prise en compte de l’âge au moment des faits. Ces principes ne sont pas nouveaux et existent aujourd’hui, soit dans l’ordonnance du 2 février 1945, soit dans la jurisprudence. Mais leur consécration va certainement les stabiliser, et sans doute aussi les renforcer, en leur donnant une plus grande visibilité.
S’agissant des acteurs de la justice pénale des mineurs, le code n’apporte guère de nouveauté, puisqu’il reprend ceux que nous connaissons aujourd’hui : juridictions (juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d’assises des mineurs, tribunal de police, chambre spéciale des mineurs…), protection judiciaire de la jeunesse, et ministère public. On peut cependant relever ici que désormais le premier acteur -et cela n’est pas innocent- n’est pas le juge des enfants, mais le parquet. Mais le juge des enfants se voit reconnaître la possibilité de prononcer seul, en audience de cabinet, des peines autres que les peines d’emprisonnement.
Cela étant, concernant la procédure, ce qui mérite surtout d’être souligné c’est la généralisation de la césure du procès pénal du mineur, consistant à distinguer une première audience sur la culpabilité et l’action civile et une seconde relative aux mesures éducatives et aux peines. Inspirée de la technique de l’ajournement de peine, la césure du procès pénal avait été proposée par la Commission « Varinard », et inscrite dans l’ordonnance du 2 février 1945 (art. 24-5 et s.) par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 (N° Lexbase : L9731IQH). Le code en fait le schéma normal de procédure, et réserve l’instruction aux crimes, et, de manière exceptionnelle, aux délits complexes. Il est prévu que l’audience sur la culpabilité se tienne dans un délai de trois mois après l’interpellation, et que l’audience sur la sanction intervienne ensuite dans un délai de six à neuf mois. Mais, dans l’intervalle, une mesure éducative judiciaire provisoire peut être prononcée par le juge des enfants. En outre, le mineur peut être astreint à un contrôle judiciaire, prévoyant un certain nombre d’interdictions ou d’obligations provisoires, et même, le cas échéant, être placé en détention provisoire. A cet égard, c’est le juge des enfants ou le tribunal pour enfants qui, dans ce cas, pourront prononcer ces mesures de contraintes, en tant que juridictions correctionnelles, d’autant que le code enlève au juge des enfants les fonctions d’instruction (l’instruction relèvera donc désormais des seuls juges d’instruction). La procédure est donc profondément modifiée, et nombre de questions se posent, pour lesquelles on ne peut espérer trouver des éléments de réponse dans les débats parlementaires, puisque précisément il n’y a pas eu de débat… Il n’est pas certain que le droit pénal des mineurs ait finalement gagné en simplicité et en lisibilité…
[1] Rapport de la Commission «Varinard», Adapter la justice pénale des mineurs (entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions), Doc. fr., 2009. Cf. not. les propositions 1 et 2.
[2] Cons. const., décision n° 2002-461, du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice (N° Lexbase : A2314AZQ).
[3] Cf. not. Ph. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, Précis Dalloz, 2ème éd., n° 1364 et s., p. 852 et s.
[4] Cf. not. Ch. Lazerges, Seuils d’âge et responsabilité pénale en Europe, RSC, 1991, p. 414 et s.
[5] Cass. crim., 13 décembre 1956, D., 1957, p. 349, note M. Patin ; J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 11ème éd., 2018, n° 43, p. 710 et s.
[6] Ph. Bonfils, Le discernement en droit pénal, in Mélanges Gassin, PUAM, 2007, p. 97 et s.
[7] Précité.
[8] Ph. Bonfils, La nouvelle primauté de l'éducation sur la répression, Dr. Pénal, 2018, Etudes n° 20.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470992
[Manifestations à venir] Connaître les droits africains
Lecture: 1 min
N1162BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 13 Novembre 2019
Juriconnexion et le CIAN (Conseil français des investisseurs en Afrique) organisent conjointement une journée sur le thème «Connaître les droits africains». Cette journée se déroulera le vendredi 22 novembre 2019 de 9 heures à 17 heures dans la Grand’ Chambre de la Cour de cassation, 5 quai de l'Horloge à Paris.
Cette Journée a pour objectif de donner des clefs pour mieux s’informer sur les différentes sources du droit des pays africains, souvent difficiles d’accès, en abordant les principaux thèmes suivants :
- les difficultés d’obtention des textes législatifs et réglementaires et les progrès de la numérisation ;
- la portée de l’uniformisation du droit des affaires réalisée par l’OHADA ;
- le rôle effectif de la jurisprudence en tant que source du droit et les nouvelles démarches de numérisation des décisions de justice ;
- les ressources éditoriales dédiées à la diffusion et aux commentaires des droits africains qui existent en Europe et en Afrique
La matinée, animée par Me Jean-Jacques Lecat, avocat spécialiste de l'Afrique, président de la Commission juridique et fiscale du CIAN sera consacrée à des échanges avec des personnalités et experts des droits africains et l’après-midi à une table ronde organisée par Juriconnexion sur la pratique de la recherche documentaire.
Programme et inscription sur le site de Juriconnexion ou sur le site du CIAN
Clôture des inscriptions le 18 novembre 2019.
Journée organisée avec le soutien de l’AHJUCAF (Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l’usage du Français) et des éditeurs Lexbase, Lexis-Nexis, Lextenso et Wolters Kluwer.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471162
[Brèves] Fixation des tarifs réglementés de vente de l'électricité : modalités de calcul du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 431902, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8844ZTQ)
Lecture: 2 min
N1077BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 13 Novembre 2019
► Les coûts d'approvisionnement entrant dans la détermination des tarifs réglementés de vente de l'électricité sont, outre le coût du complément d'approvisionnement au prix de marché, le coût d'accès régulé à l'électricité nucléaire, lequel doit être calculé en tenant compte, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique susceptible d'être cédé par la société EDF.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 6 novembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 431902, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8844ZTQ).
Le prix des achats supplémentaires effectués par un fournisseur-type sur le marché de gros du fait de l'atteinte du volume maximal d'électricité nucléaire historique susceptible d'être cédé par la société EDF est inclus dans le coût du complément d'approvisionnement au prix de marché qui entre dans la composition des tarifs en application de l'article L. 337-6 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L3344KGX).
En prévoyant, au deuxième alinéa de l'article R. 337-19 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L0340LNW), que le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique doit être calculé en tenant compte, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique susceptible d'être cédé par la société EDF, le pouvoir réglementaire s'est borné, sans excéder sa compétence, à préciser les modalités d'application de la loi, afin de permettre le maintien d'une concurrence tarifaire effective sur le marché de détail dans l'hypothèse d'une atteinte de ce volume maximal.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471077
[Brèves] Reconnaissance, en France, des effets d’une adoption allemande «convertie» en adoption plénière par l’effet des dispositions transitoires de la loi allemande de 1976
Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-17.111, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8751ZTB)
Lecture: 6 min
N1081BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 14 Novembre 2019
► La «conversion» opérée par les dispositions de la loi allemande du 2 juillet 1976, d’une adoption produisant les effets d’une adoption simple en une adoption produisant les effets d’une adoption plénière, n’est pas contraire à l’ordre public international français ;
► la requérante ayant fait l’objet d’une telle adoption, n’est dès lors pas fondée à revendiquer la qualité d’héritière réservataire de son père de sang français.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-17.111, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8751ZTB).
En l’espèce, après le divorce de ses parents, en France, en 1972, et le remariage de sa mère, le 9 février 1973, en Allemagne, la requérante, qui résidait avec sa mère et son conjoint, avait été adoptée «en qualité d’enfant commun», par contrat du 11 septembre 1975 ; ce contrat d’adoption avait fait l’objet d’une homologation judiciaire par le tribunal d’Offenburg, par décisions des 11 et 25 novembre 1975 ; de la seconde union du père, dissoute par jugement du 21 juillet 2000, était née une fille à Poissy ; le père était décédé à Paris ; la requérante, ayant contesté l’acte de notoriété établi après le décès, qui mentionnait sa sœur pour unique héritière, cette dernière l’avait assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’il soit constaté qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière du père.
Elle faisait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière réservataire de son père, qu’elle devait être tenue pour légataire à titre particulier de certains biens et que sa sœur recevrait l’intégralité de la succession, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers. Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, qui approuve sur tous les points la décision rendue par la cour d’appel.
- Dans l’un des moyens, la requérante soutenait, notamment, que la question de la conversion de cette adoption simple en adoption plénière relevait du droit français, et invoquait l’application des articles 370-3 (N° Lexbase : L8428ASX) et 370-5 (N° Lexbase : L8430ASZ), exigeant le consentement du père de sang, en toute connaissance de cause après avoir été éclairé sur les conséquences de l’adoption.
Mais, ainsi que le relèvent les juges d’appel, approuvés par la Cour suprême, si l’adoption avait, en Allemagne, jusqu’à la loi du 2 juillet 1976, des effets juridiques limités, sans incidence sur les droits successoraux de l’enfant, cette loi a instauré une adoption plénière qui, pour les mineurs, rompt les liens entre ceux-ci et les parents par le sang ; aux termes de ses dispositions transitoires, cette loi nouvelle s’applique de plein droit, à compter du 1er janvier 1978, aux enfants mineurs adoptés sous l’empire de l’ancienne loi, de sorte que, sauf opposition, l’adoption, qui avait les effets d’une adoption simple, se transforme de plein droit en adoption entraînant la rupture des liens juridiques avec la famille d’origine.
Aussi, ayant constaté qu’aucune déclaration s’opposant à cette «conversion» de l’adoption de la requérante n’avait été enregistrée, de sorte que sa situation était régie par la loi nouvelle, la cour d’appel, qui n’avait pas à appliquer les articles 370-3, alinéa 3, et 370-5 du Code civil dès lors qu’elle n’était saisie ni d’une requête en adoption ni d’une demande de conversion de l’adoption simple en adoption plénière, en avait exactement déduit que, l’ordonnance du 25 novembre 1975 produisant en France des effets identiques à ceux produits en Allemagne, la requérante n’avait pas la qualité d’héritière réservataire de son père de sang.
- Par un autre moyen, la requérante invoquait les dispositions de l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, relative aux droits de l’enfant (N° Lexbase : L6807BHL), l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), ainsi qu’une atteinte à l’ordre public international.
En vain. La Haute juridiction relève, tout d’abord, que, l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, relative aux droits de l’enfant n’ayant pas été invoqué devant la cour d’appel, celle-ci n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
Ensuite, selon la Cour suprême, ayant relevé, d’une part, qu’au lien juridique unissant la requérante à son père de sang s’était substitué, par l’effet attaché à la décision d’adoption par la loi nouvelle, un lien juridique nouveau l’unissant à son père adoptif et qu’elle avait bénéficié des dispositions du droit allemand qui en résultaient, d’autre part, que ce lien était ancien et que la requérante avait eu une vie familiale avec ses parents adoptifs durant plusieurs dizaines d’années, la cour d’appel avait pu en déduire que c’est le refus de reconnaître en France le lien de filiation dont l’adoptée bénéficiait depuis aussi longtemps en Allemagne qui aurait été contraire à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Enfin, après avoir rappelé les dispositions de l’article 12, § 2, de la loi allemande du 2 juillet 1976, aux termes desquelles la loi nouvelle s’appliquait de plein droit aux enfants mineurs adoptés sous l’empire de l’ancienne loi, la cour d’appel a retenu qu’en présence d’une décision de justice ayant suppléé le consentement du père, la «conversion» opérée par cette loi, d’une adoption produisant les effets d’une adoption simple en une adoption produisant les effets d’une adoption plénière, n’était pas contraire à l’ordre public international français ; elle a ainsi légalement justifié sa décision.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471081
[Le point sur...] Réforme de l’épargne retraite issue de la loi PACTE : aspects fiscaux
Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK), Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire (N° Lexbase : L9505LQ4) et ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, portant réforme de l'épargne (N° Lexbase : L3019LRA), Décret 2019-807 du 30 juillet 2019 (N° Lexbase : L8401LRL, Arrêté du 07 août 2019 (N° Lexbase : L7033LRW)
Lecture: 12 min
N1088BYX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par David Chrétien, Tax Partner - Financial Services, Mazars Avocats
Le 13 Novembre 2019
Parmi de multiples dispositions, la loi PACTE a réformé en profondeur l’organisation de l’épargne retraite en France, avec l’objectif d’augmenter significativement les montants investis sur produits financiers d’épargne retraite.
En effet, le gouvernement affiche une volonté de dynamiser l’épargne retraite et les montants qui y sont investis. Ils sont actuellement d’environ 200 milliards d'euros d’encours global et une cible raisonnable serait de porter de cet encours à environ 300 milliards d'euros à moyen terme.
Si tous les acteurs de l’épargne-retraite n’ont pas encore réformé leur gamme de produits d’épargne-retraite, le 1er octobre 2019 a néanmoins marqué une date clef dans la mise en œuvre de la loi PACTE car c’est en effet depuis cette date que les institutions financières ont la possibilité de proposer de nouveaux produits d'épargne retraite ainsi organisé par la loi PACTE.
Si cette réforme comporte de nombreux volets qui visent à donner davantage de prérogatives à l’épargnant (modalités de sortie : lors de la retraite ou par anticipation dans certains cas,…), à simplifier le système d’épargne retraite en prévoyant un produit unique -le Plan d’Epargne Retraite («PER»)- avec certaines déclinaisons et à organiser la portabilité et la transférabilité de ce produit, une des clefs de son succès n’en reste pas moins le régime fiscal applicable, notamment les incitations fiscales pour un effort d’épargne supplémentaire et pour des arbitrages de placements en faveur de ce nouveau produit d’épargne-retraite.
Les caractéristiques clefs de la réforme seront exposées (I) seront exposées avant de décrire la fiscalité (II).
I - Caractéristiques clefs de la réforme de l’épargne-retraite
A) Mise en place d’une enveloppe unique avec deux modes de souscription
On précise d’emblée que, en matière d’épargne-retraite, les types de placement préexistants (PERP, Perco…) restent disponibles et commercialisables, y compris depuis le 1er octobre 2019, mais il ne s’agit que d’un sursis puisqu’il ne pourront plus être mis en place à compter du 1er octobre 2020.
La loi PACTE organise par ailleurs un cadre pour la conversion de ces produits d’épargne retraité préexistants vers le PER, qui constitue désormais un cadre unique pour l’épargne retraite. Ainsi, en particulier, les encours d’épargne actuellement gérés dans le cadre de PERP, de contrats «Madelin» ainsi que dans des contrats PREFON, COREM, CRH, ont vocation à être repris dans le PER.
A compter de sa mise en œuvre, la réforme introduite par la loi PACTE préserve la possibilité de développer une épargne retraite soit à titre individuel soit dans un cadre professionnel. Le nouveau PER peut être décliné sous différentes formes et, en fait, deux modes de souscription :
- Dans l’entreprise, par le biais d’un nouveau PER collectif facultatif et ouvert à tous les salariés et ayant vocation à succéder aux actuels PERCO ; ou d’un plan d’épargne retraite obligatoire prenant la succession des actuels contrats régis par l’articles 83 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4877LR3)[1].
Les entreprises ont la possibilité de regrouper ces produits en un PER unique pour davantage de simplicité ;
- A titre individuel, par un nouveau PER qui succède aux actuels contrats PERP et «Madelin».
Tous les nouveaux PER, individuels ou collectifs, sont régis par des règles identiques, plus favorables et plus flexibles pour les épargnants :
- Les droits sont facilement transférables d’un produit à l’autre et les frais de transfert sont strictement encadrés ;
- L’épargne volontaire et l’épargne salariale peuvent être retirées par anticipation par rapport au départ en retraite, en particulier pour procéder au financement de l’acquisition d’une résidence principale ;
- Pareillement, au moment du départ en retraite, l’épargne volontaire peut être liquidée en rente ou en capital, au choix des épargnants et selon les modalités décrites ci-dessous.
B) Le PER et sa structuration en compartiments
Qu’il soit souscrit à titre individuel ou par une entreprise, le PER est structuré par trois compartiments :
- Un compartiment qui est un compartiment dit «individuel» : il constitue la «suite» des dispositifs d’épargne préexistants de type PERP et contrat «Madelin».
- Un compartiment qui, lui, est dit «collectif» et qui mettra en œuvre un régime d’épargne inspiré du plan d'épargne retraite collectif («Perco») et fera une passerelle avec les dispositifs PERCO préexistants.
- Un compartiment dit «catégoriel» qui, lui, est le pendant des régimes de retraite jusqu’à présent régis par l’article 83 du Code général des impôts.
Dans le cadre d’un PER d’entreprise, trois compartiments sont en capacité de recevoir de nouveaux versements. S’agissant d’un PER individuel, en revanche, seul le compartiment individuel va pouvoir pareillement recevoir des versements nouveaux, complémentaires ; les deux autres compartiments existeront bien, d’un point de vue juridique, mais sur le plan financier ils ne pourront recevoir que des sommes issues de transferts provenant de dispositifs préexistants, et notamment d’un PER d’entreprise dont un compartiment collectif pourra être réinvesti dans le compartiment collectif d’un PER individuel; idem, pour le comportement catégoriel.
Dans ce cadre, des règles propres à chacun des compartiments fixent les sources de financement dont ils peuvent faire l’objet :
- Le compartiment individuel est alimenté par des versements personnels issus de la capacité d'épargne propre à l’épargnant ;
- Le compartiment collectif, lui, sera alimenté par des sommes issues de certains mécanismes d’épargne salariale ou de partage des profits tel l'intéressement, la participation des salariés, des abondements, les transferts de certains jours de repos (provenant ou non d'un compte épargne-temps) ;
- Et le compartiment catégoriel, lui, a vocation à être alimenté par des versements obligatoires issus des cotisations versées par l'entreprise, complétées le cas échéant par les salarié, quand un régime de retraite supplémentaire de type ‘article 83’ a été mis en place.
II - Régime fiscal du PER
A) Régime fiscal de l’investissement sur un PER
La loi PACTE reprend certains aspects du régime fiscal de certains des mécanismes d’épargne retraite préexistants notamment en ce qui concerne la déductibilité des sommes investies dans un PER et donne une nouvelle dimension à ce principe. A ce titre, une approche distinguant par type de compartiment est nécessaire.
S’agissant du compartiment individuel, les versements volontaires dont il fait l’objet sont, sauf option contraire, déductibles de l'impôt sur le revenu. (A titre de comparaison, c’était également le principe applicable au régime du PERP[2]). Dans ce cadre, le principe de déductibilité fiscale se présente comme suit :
- La loi PACTE prévoit en effet une déduction fiscale du revenu global pour les versements volontaires aux plans d'épargne retraite[3]. Cette faculté de déduction du revenu global est ouverte à toute personne, salariée ou non (voir cependant ci-dessous le cas des indépendants), effectuant des versements volontaires à un PER, quelle que soit son activité professionnelle et même en l'absence d'activité professionnelle. Il peut s'agir soit de versements volontaires aux PER d’entreprise, soit de versements aux PER individuels. Cette déductibilité est par ailleurs étendue par la loi PACTE à une typologie plus importante de versements volontaires.
- S’agissant en particulier des indépendants (i.e. titulaires de BIC ou de BNC, chefs d'entreprises ou d'exploitations agricoles), une mesure spéciale de déductibilité fiscale s’applique[4] car les versements aux PER sont déductibles de leur revenu catégoriel ; la déduction fiscale susmentionnée au niveau du revenu global n’est que subsidiairement autorisée par l'article 163 quatervicies du Code général des impôts (N° Lexbase : L4891LRL). Par ailleurs, elle comporte des exclusions[5] et joue dans des plafonds qui sont ceux qui prévalaient déjà pour les versements aux contrats «Madelin».
La fiscalité de la phase d’accumulation dans le compartiment catégoriel reste également favorable, à l’instar du régime qui prévalait pour les contrats de retraite régis par l’article 83 ; les cotisations obligatoires concernées vont désormais pouvoir alimenter le compartiment catégoriel du plan d'épargne retraite : elles sont toujours exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 8 % du salaire[6]. L'employeur, en revanche, reste assujetti au forfait social mais à un taux plus favorable de 16 % pour les cotisations investies dans un PER (contre un taux de droit commun du forfait social de 20 %).
S’agissant enfin, des sommes placées dans le compartiment collectif, le régime fiscal reste clément ; le principe reste celui d’une exonération d'impôt sur le revenu sur les montants des primes épargnées dans un PER (prime de participation, prime d'intéressement quand elles sont épargnées dans le PER ou l’abondement que verse l’employeurs sont exonérés d'impôt sur le revenu). Par ailleurs, le forfait social est supprimé sur l’ensemble des versements d’épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés (et sur les sommes versées au titre de l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés).
Par ailleurs, un forfait social à taux réduit de 16 % (au lieu de 20 %) est prévu pour les versements des employeurs en épargne retraite d’entreprise, à condition que l’épargne soit orientée vers le financement des petites et moyennes entreprises[7]. La loi PACTE a en effet prévu de généraliser l’application du taux réduit de 16 % pour les PER d’entreprise (participation, intéressement, abondements et versements unilatéraux de l’employeur).
B) Régime fiscal des prestations du PER
Le PER autorise une sortie sous forme de capital (mais uniquement pour les montants investis dans un compartiment individuel ou un comportement collectif) ou sous forme de rente.
Lorsque la prestation est payée sous forme de capital, au moment de la liquidation des droits à la retraite ou lors de la survenance d’un évènement permettant une sortie anticipée, les points suivants sont notables.
- Les sommes récupérées du compartiment collectif sont exonérées d’impôt, qu’il s'agisse du capital accumulé ou des plus-values. Néanmoins, les plus-values subissent des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ;
- S’agissant du compartiment individuel, la récupération du versement individuel réalisé subit l’impôt sur le revenu au barème applicable au bénéficiaire[8] si la déductibilité à l’entrée a été effectivement effectuée; les plus-values réalisées pendant le placement, elles, subissent le prélèvement forfaitaire unique (PFU) à hauteur de 12,8 %[9] -sauf option pour l’application du barème de l’IRPP-, de même que les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %[10].
La fiscalité applicable pour une sortie en rente est la suivante.
- La rente financée sur le compartiment collectif du PER constitue une rente viagère acquise à titre onéreux, faiblement fiscalisée (CGI, art. 158-6 N° Lexbase : L4886LRE) ;
- La rente financée sur le compartiment catégoriel du PER est fiscalement considérée comme une rente viagère acquise à titre gratuit et est soumise à l'impôt sur le revenu. Des prélèvements sociaux sont également applicables sur les (CSG à 8,3 %, CRDS au taux de 0,5 %, cotisation d’assurance maladie au taux de 1 % et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie de 0,3 %. Total de 10,1 %), ce qui est le même régime que celui applicable à un contrat de retraite régi par l’article 83 du Code général des impôts ;
- La rente financée sur la base du compartiment individuel, et si l’on considère des versements effectivement fiscalement déduits lors l’entrée dans le PER, est qualifiée de rente viagère acquise à titre gratuit soumise à l’impôt sur le revenu comme pension de retraite.
C) Régime fiscal en cas de transmission
Une comparaison du PER avec l’assurance-vie peut s’avérer pertinente au regard du régime fiscal applicable en matière de transmission.
Si l’on commence par un point commun, en cas de transmission par décès, des prélèvements sociaux vont être appliqués, au taux de 17,2 % sur la plus-value prise tant par un PER que par un contrat d’assurance-vie.
En revanche, une première différence survient en matière de fiscalité applicable car une transmission échappe aux droits de succession lorsqu’elle est opérée dans le cadre l’assurance-vie pour des bénéficiaires[11] alors que la transmission d’un PER est, elle, soumise à ces mêmes droits.
Une seconde différence notable consiste, comme on l’a vu, en la déductibilité fiscale des sommes investies dans un PER au regard de l’impôt sur le revenu, alors que l’assurance-vie ne présente pas cette faculté.
A ce stade, il faut mentionner que la loi PACTE organise par ailleurs un mécanisme fiscal incitatif au réinvestissement de montants placés sur des supports d’assurance-vie vers des PER[12]. Il y a néanmoins certaines conditions à cela car Le transfert doit être effectué :
- par voie de rachat total ou partiel d'un contrat d'assurance-vie ayant plus de 8 ans au moment du transfert,
- au moins 5 ans avant l'âge légal de départ à la retraite de son titulaire,
- avant le 1er janvier 2023.
L’incitation fiscale mise en place est alors la suivante :
- Les gains imposables provenant du rachat effectué sur le contrat d’assurance-vie sont exonérés dans la limite annuelle de 4 600 euros pour une personne seule ou de 9 200 euros pour un couple soumis à imposition commune, dès lors que l'intégralité des sommes reçues est reversée avant le 31 décembre de la même année sur un PER au nom de son titulaire.
- De surcroît, cette exonération est cumulable avec le dispositif général d'abattement annuel de 4 600 euros ou de 9 200 euros prévu pour les contrats d'assurance-vie et de capitalisation.
- Ces deux avantages se cumulent avec le fait que, par ailleurs, un versement sur un PER bénéficie du mécanisme de déductibilité au regard de l’IRPP, tel que l’on a examiné ci-dessus.
[1] L’article 83 du CGI désigne le régime fiscal applicable à des contrats d'assurance vie collectifs souscrits par un employeur pour le compte de ses salariés, ou d'une partie d'entre eux. Il s’agit de contrats à cotisations définies, financés par l’employeur et auxquels un salarié peut faire des versements complémentaires à son initiative.
[2] On ne détaillera pas ici les péripéties de la déductibilité fiscales des sommes portées sur un PERP en 2019, du fait d’une mesure ressortant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, de finances rectificative pour 2017 (N° Lexbase : L7653LHW) et consistant inciter les épargnants à prolonger leurs versements en 2018 malgré l’absence d’avantage fiscal en raison de «l’année blanche» et à peine de devoir attendre 2020 pour pouvoir procéder de nouveau à des versements entièrement déductibles.
[3] CGI art. 163 quatervicies, I-1-d; CMF, art. L. 224-2, 1° (N° Lexbase : L7481LQ7).
[4] Ainsi en disposent les articles 154 bis du CGI (N° Lexbase : L4882LRA), pour les titulaires de BIC ou de BNC, et 154 bis-0 A du CGI (N° Lexbase : L4884LRC), pour les chefs d'entreprises ou d'exploitations agricoles, la déduction au niveau du revenu global n'étant que subsidiairement autorisée par l'article 163 quatervicies du CGI.
[5] Les versements aux PER qui correspondent à certaines garanties dans le cadre de la prestation de retraite sont exclues du principe de déductibilité :
Pour les titulaires de BIC ou de BNC : à la garantie complémentaire portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à la date de la retraite ou en cas de décès de l'assuré (C. assur. art. L. 142-3, I-6° N° Lexbase : L5013LR4) ;
Pour les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles : aux garanties complémentaires prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire, de prestations en cas de perte d'emploi subie ; garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à la date de la retraite ou en cas de décès de l'assuré (C. assur., art. L. 142-3, I-4° à 6° nouveau).
[6] CGI, art. 83 2° al.2.
[7] CSS., art. D. 137-1 (N° Lexbase : L6539LRM).
[8] En revanche, en cas d’option pour la non-déductibilité d’un versement à un PER, alors il n’y a pas d’imposition sur la part des versements ainsi récupérés ; en revanche le PFU est dû sur la plus-value réalisée.
[9] CGI, art. 158.
[10] CSS, art. L. 136-7 (N° Lexbase : L4981LRW).
[11] Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, quel que soit le degré de parenté existant entre ce dernier et le bénéficiaire (C. assur. art. L. 132-12). Ces sommes sont donc en principe exonérées. Cependant, certains dispositifs d’imposition relativisent cette exonération :
- Après application d'un abattement de 30 500 euros, les primes versées au-delà de 70 ans ainsi que les sommes dues à raison du décès après 70 ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite sont soumises aux droits de succession (CGI, art. 757 B N° Lexbase : L4900LRW).
- Un prélèvement spécifique s’applique aux sommes dues par les organismes d'assurance et assimilés sur la fraction revenant à chaque bénéficiaire qui excède 152 500 euros (CGI, art. 990 I N° Lexbase : L4902LRY).
[12] CGI, art. 125-0 A I 1° (N° Lexbase : L4878LR4).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471088
[Pratique professionnelle] Guide pratique du compte personnel de formation (CPF)
Lecture: 18 min
N1117BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sabrina Dougados, avocat associé, Pôle Droit de la formation, Fromont Briens
Le 13 Novembre 2019
Créé par la loi du 5 mars 2014 (N° Lexbase : L6066IZP) et d’ores et déjà remanié par les lois n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C) et n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (N° Lexbase : L9567LLW), le compte personnel de formation (CPF) demeure un dispositif d’accès encore peu -voir mal- connu des actifs, en particulier des salariés, lesquels auraient suivi 400 513 formations au total dans le cadre de leur CPF sur l’année 2018.
Le présent article a pour objet d’expliciter de façon pragmatique l’environnement (I) et le fonctionnement (II) du compte personnel de formation pour les salariés de droit privé.
I - L’environnement du CPF
A - Le CPF est une composante du compte personnel d’activité
Le compte personnel d’activité (CPA) est le réceptacle de différents droits sociaux reconnus à son titulaire. Ouvert à toute personne active d’au moins 16 ans, il se compose de 3 comptes :
- le CPF qui est alimenté chaque année en droits à formation ;
- le compte d’engagement citoyen (CEC) qui recense les activités bénévoles du titulaire et lui permet l’acquisition de jours de congés ou de droits à formation ;
- le compte professionnel de prévention (C2P) qui permet aux personnes exposées à certains facteurs de risques professionnels d’obtenir des points notamment pour le financement de droits à formation pour l’exercice d’un emploi moins exposé.
Le CPF est personnel en ce sens qu’il est attaché à son titulaire et non à la détention d’un contrat de travail et ne peut être mobilisé qu’à son initiative exclusive.
Le CPF est universel : tout travailleur dispose d’un CPF dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut et ce, jusqu’à son décès (même s’il cesse d’être alimenté lors de la liquidation de l’ensemble des droits à la retraite).
Le CPF est intégralement transférable jusqu’à la fermeture du compte, car les droits qui y sont inscrits :
- le demeurent même en cas de changement d’employeur, peu important le motif de rupture du contrat de travail,
- restent également disponibles en cas de perte d’emploi, y compris en cas de licenciement pour faute grave,
- demeurent acquis en cas de départ du titulaire à l’étranger.
B - Publics bénéficiaires
-
1 - Conditions d’ouverture
Un CPF est ouvert pour toute personne âgée d’au moins 16 ans (sauf pour les apprentis âgés d’au moins 15 ans) à condition :
- d’occuper un emploi, y compris lorsqu’elle est titulaire d’un contrat de travail de droit français et qu’elle exerce son activité à l’étranger ;
- d’être à la recherche d’emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ;
- d’être accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail ;
Ainsi, tout travailleur, indépendamment de son statut, bénéficie d’un CPF dès son entrée sur le marché du travail.
-
2 - Conditions de fermeture
Le compte cesse d’être alimenté lors de la liquidation de l’ensemble des droits à la retraite mais n’est fermé qu’à la date du décès de la personne. Il peut donc encore être utilisé lorsque la personne est retraitée.
C - Règles d'alimentation
Depuis le 1er janvier 2019, les compteurs CPF sont alimentés en euros (et non plus en heures) pour les salariés du secteur privé et les demandeurs d’emploi.
-
1 - Conversion des heures acquises avant le 1er janvier 2019
Les heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et du CPF au 31 décembre 2018 sont converties en euros à hauteur de 15 euros par heure. Cette conversion est réalisée directement sur les compteurs au cours de l’année 2019.
-
2 - Règles d’alimentation pour les salariés
Le CPF des salariés ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale (soit 804 heures dès lors que la durée légale annuelle est fixée à 1 607 heures) ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année dans la limite d’un plafond de 5 000 euros (cf. tableau ci-dessous).
Le CPF des salariés n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau CAP ou BEP ou une certification reconnue par une convention collective de branche et ayant effectué une durée du travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à hauteur de 800 euros au titre de cette année dans la limite d’un plafond de 8 000 euros (cf. tableau ci-dessous).
Par ailleurs, le salarié bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés bénéficie d’une majoration de 300 euros par an, dans la limite d’un plafond de 8000 euros.
Pour les autres salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année, leur CPF est alimenté à due proportion de la durée de travail effectuée. Lorsque le calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la dernière décimale, au centime d’euro supérieur.
Les salariés au forfait jour bénéficient d’une alimentation à hauteur de 500 euros par an dès lors qu’ils effectuent 218 jours par an de travail. Pour les autres, l’alimentation est calculée au prorata temporis.
Pour les salariés dont la rémunération n’est pas établie en fonction d’un horaire de travail (cas de salariés rémunérés non en fonction du temps de travail mais à la pige, à la vacation, ou à la tâche…), le montant de référence pour le calcul de l’alimentation du CPF est fixé à 2 080 fois le montant du SMIC horaire. L’alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et 2 080 fois le montant du SMIC.
Le tableau ci-dessous récapitule l’acquisition de droits par les salariés, selon leur statut, dans le cas où ils ont bénéficié du DIF et du CPF dès leur création et ne mobilisent aucun de leurs droits au fil des années.
| Année | DIF non utilisé | Salariés de droit commun | Salariés avec un bas niveaux de qualification [1] | Travailleurs handicapés en ESAT [2] | |||
| 2015 | 120 heures acquises au 31 décembre 2014 (mobilisables sans limitation de durée à condition que le titulaire ait procédé à leur inscription avant le 31 décembre 2020) | + 24 heures | = 24 heures | + 24 heures | = 24 heures |
| |
| 2016 | + 24 heures | = 48 heures | + 24 heures | = 48 heures | Environ 9,33 heures | ||
| 2017 | + 24 heures | = 72 heures | + 48 heures | = 96 heures | + 24 heures | = 33 heures 33 | |
| 2018 | + 24 heures | = 96 heures | + 48 heures | = 144 heures | + 24 heures | = 57 heures 33 | |
| 2019 | Conversion des heures à hauteur de 15 €/heure | ||||||
| 120 heures X 15 € = 1 800 € | 96 heures X 15 € = 1 440 € | 120 heures X 15 € = 1 800 € + 144 heures X 15 € = 2 160 € | 57.33h X 15€ = 859,95€ | ||||
| Total des droits acquis au 1er semestre 2019 = 3 240 € | |||||||
| + 500 € | + 800 € | + 800 € | |||||
| = 3 740 € | = 4 760 € | = 1659,95 € | |||||
| 2020 | + 500 € | + 800 € | + 800 € | ||||
| = 4 240 € | = 5 560 € | = 2 459,95 € | |||||
| = 4 740 | = 6 360 € | = 3 259,95 € | |||||
D - Principales fonctionnalités
Le service dématérialisé du CPF prend deux formes : le site internet www.moncompteactivité.gouv.fr ainsi qu’une application numérique accessible depuis un «smartphone».
Ces deux espaces, auxquels l’accès est gratuit, permettent au titulaire du compte de :
- Obtenir et transmettre des informations ;
- Consulter des informations générales sur le site public ;
- Consulter et modifier des données personnelles sur l’espace personnel sécurisé ;
- Consulter les droits inscrits sur son CPF : alimentation annuelle et abondements éventuels ;
- Saisir le solde d’heures DIF et consulter les droits y afférents ;
- Déclarer remplir les conditions requises pour bénéficier de l’alimentation majorée à hauteur de 800 euros par an (personnes peu qualifiées) ;
- Consulter le détail de l’historique des mouvements d’alimentation et de débit du compteur CPF ;
- Consulter des informations relatives aux formations éligibles ;
- Consulter l’ensemble de l’offre de formation proposée par les prestataires de formation ;
- Prendre connaissance et accepter les conditions générales d’utilisation ;
- Etre mis en relation avec un opérateur de conseil en évolution professionnelle ;
- Mobiliser les droits acquis pour bénéficier d’une action via un parcours d’achat direct ;
- Choisir sa formation via le catalogue et s’inscrire à une session ;
- Abonder en ligne son compte ;
- Déclarer son assiduité à la formation et évaluer la prestation (obligatoire) ;
- Faire prendre en charge la formation choisie directement auprès du prestataire de formation ;
- Consulter l’historique des dossiers de formations (en cours, validé, rejeté, clos) ;
- Disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle, et dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire.
E - Rôle des acteurs
1 - Le titulaire
Le titulaire du CPF est le seul décisionnaire de la mobilisation des droits qu’il a acquis au titre de son CPF, afin de financer à son initiative une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
Lorsque les droits qu’il a acquis sont insuffisants pour financer la formation qu’il souhaite suivre, le titulaire peut abonder en droits complémentaires son CPF. En dehors de ce cas de figure, il ne peut pas alimenter son compte. En pratique, le titulaire du CPF ne peut pas déposer de fonds sur son CPF en vue de se créer une sorte «d’épargne formation».
2 - L’employeur
L’employeur a, tout d’abord, un rôle d’information de ses salariés s’agissant du CPF, notamment lors de l’entretien professionnel qui a lieu en principe tous les deux ans et à l’occasion duquel il est tenu de délivrer des informations relatives à la VAE, à l'activation par le salarié de son CPF, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
L’employeur doit, par ailleurs, autoriser le départ en formation lorsque celle-ci se réalise en tout ou partie sur temps de travail. En effet, si les formations financées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies sur le temps personnel, le salarié doit obligatoirement demander une autorisation d’absence à son employeur lorsque sa formation se déroule sur le temps de travail (cf. III.3.).
Enfin, l’employeur a un rôle de financeur :
- de façon facultative, lorsqu’il souhaite abonder le CPF du salarié (de façon spontanée ou en application d’un accord collectif) ;
- de façon obligatoire, dans 2 cas de figure :
1°) dans le cadre d’accord de performance collective : le salarié licencié suite à son refus d’une modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord collectif bénéficie d’un abondement de son CPF du montant prévu par l’accord (au minimum 3000 euros) ;
2°) à l’issue de l’entretien professionnel renforcé : si lors de l’état des lieux organisé tous les 6 ans, il est constaté que l’entreprise (de plus de 50 salariés) n’a pas rempli ses obligations en matière de formation à l’égard du salarié, elle est tenue de verser une somme de 3 000 euros à la caisse des dépôts et consignations pour financer un abondement au compte du salarié concerné.
II - Le fonctionnement du compte
A - L'activation du CPF
1 - Comment activer le compte ?
Il convient de se connecter à l’adresse Internet suivante : https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/connexion. L’accès au compteur est effectué par chaque titulaire en renseignant son numéro de sécurité sociale et un mot de passe choisi par ce derneier.
2 - Comment saisir les heures de DIF ?
Les heures de DIF acquises et non utilisées au 31 décembre 2014 (cf. le bulletin de paie de décembre 2014/janvier 2015 ou l’attestation ou courrier d’information remis par l’employeur avant le 31 janvier 2015 ou le certificat de travail remis par le dernier employeur avant décembre 2014) doivent être inscrites dans les compteurs CPF au plus tard le 31 décembre 2020 afin que les titulaires puissent en bénéficier.
Le document mentionnant les heures de DIF acquises sera demandé lors de la validation du premier dossier de formation afin de permettre l’utilisation de ces heures. Il convient donc d’inviter les auditeurs à le conserver.
Une fois les heures saisies, celles-ci seront converties à hauteur de 15 € de l’heure.
Les heures sont saisissables jusqu’au 31 décembre 2020. Les heures qui n’auront pas été inscrites avant cette date ne pourront plus être mobilisées.
Les heures qui auront effectivement été inscrites avant le 31 décembre 2020 via la plateforme CPF sont mobilisables sans limitation temporelle.
B - La mobilisation du CPF
1 - Formations éligibles
Depuis le 1er janvier 2019, les formations éligibles au CPF sont prévues par le code du travail et non plus par des listes établies au niveau national, régional et des branches professionnelles.
Formations certifiantes. Sont éligibles au CPF les actions de formations dites certifiantes :
- les actions de formations sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- les actions de formation sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences composant les certifications professionnelles [3] ;
- les actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique des certifications et habilitations (RSCH), notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (certificats CléA et CléA numérique).
Actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience. La validation des acquis de l'expérience a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
La VAE est ouverte à toute personne :
- justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, de sportif de haut niveau ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée,
- d’une durée minimale d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non.
Bilans de compétences. Ils ne constituent pas des actions de formation, ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Le bilan de compétences peut être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. En effet, le titulaire du CPF est informé, via la plateforme CPF et avant la mobilisation de ses droits pour effectuer un bilan, de la possibilité de s'adresser à un organisme de CEP pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle. Dans le cas où la mise en œuvre du projet de la personne nécessite le recours à un bilan de compétences, le CEP est notamment chargé d’identifier les prestataires potentiels (cf II.3.).
La durée du bilan de compétences est limitée à 24 heures.
Actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprise. Ces actions doivent être réalisées dans le cadre d’un parcours pédagogique et avoir pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci.
L’organisme de formation sollicité peut refuser en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise ou si le projet n’entre pas dans son champ de compétences.
Actions de formation permettant aux bénévoles et volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. Pour ces formations seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen (CEC) peuvent être mobilisés.
2 - A quel moment mobiliser son CPF ?
Le CPF doit être mobilisé avant le démarrage de la formation, concomitamment à l’inscription à une session de formation.
Le projet doit être réfléchi suffisamment en amont pour permettre si besoin l’obtention d’abondement(s) et, dans tous les cas, l’inscription à la formation souhaitée.
En effet, le parcours d’achat direct du CPF se fait en plusieurs étapes et selon des délais qui seront prévus par les conditions générales de la formation.
A titre indicatif, le suivi d’une formation dans le cadre du CPF devrait nécessiter les étapes suivantes :
- Envoi d’une demande d’inscription par le titulaire à l’organisme de formation
- Validation de la demande d’inscription par l’organisme de formation
- Inscription du titulaire
- Mobilisation des droits et de l’abondement éventuel formalisant la contractualisation entre le titulaire et l’organisme de formation
- Déclaration de l’entrée en formation par l’organisme
- Suivi de la formation
- Déclaration d’assiduité à la formation et évaluation de la prestation par le titulaire
- Déclaration de fin de formation et service fait par l’organisme
- Facturation par l’organisme de formation à la Caisse des dépôts et consignations
- Paiement de l’organisme par la CDC.
3 - Quand solliciter l’autorisation préalable de son employeur ?
Dans le cas où le salarié entend mobiliser son CPF pour suivre une formation en tout ou partie sur son temps de travail, il doit être autorisé à s’absenter de son travail par son employeur.
Pour cela, il est tenu de demander une autorisation d’absence :
- au minimum 60 jours avant le début de la formation si celle-ci est d’une durée inférieure à 6 mois ;
- au minimum 120 jours avant si la formation est d’une durée de 6 mois ou plus.
A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour notifier sa réponse au salarié. L’absence de réponse de sa part dans ce délai est considérée comme une acceptation de la demande.
Lorsque la formation est prévue en totalité en dehors du temps de travail du salarié, aucune demande n’a à être adressée à l’employeur.
C - Le financement de la formation
1 - Ce qui est finançable avec le crédit d’euros inscrit sur le CPF
La caisse des dépôts et consignations (CDC) prend en charge le coût pédagogique, soit le prix fixé par l’organisme de formation pour l’action concernée, dans la limite du montant des droits inscrits sur le CPF.
Elle ne prend donc en charge ni les frais annexes ni l’éventuel maintien de rémunération du travailleur. Si le salarié suit l’intégralité ou une partie de sa formation sur son temps de travail, sa rémunération est maintenue par son employeur. La CDC ne finance pas davantage les abondements sur la dotation qui lui est versée par France compétences (fonds mutualisés). Les abondements doivent donc être financés sur les fonds propres de l’entreprise, les derniers personnels de l’auditeur ou un organisme paritaire/public.
La CDC procède au paiement du coût de la formation pris en charge, après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le CPF et vérification du service fait, directement auprès du prestataire de formation, selon les modalités prévues par les conditions générales d’utilisation.
Les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du CPF restent à la charge du titulaire du compte.
2 - Ce qui peut être financé au moyen d’abondements
Chaque titulaire d’un CPF a connaissance des abondements dont il bénéficie via son espace personnel et peut les mobiliser directement.
En effet, les abondements sont intégrés dans le parcours d’achat direct de la plateforme CPF.
Lorsqu’un abondement en droits complémentaires ou supplémentaires est décidé, le financeur de cet abondement en informe la CDC et lui verse la somme correspondante. La CDC se charge ensuite d’inscrire l’abondement au compteur du titulaire concerné.
Pour pouvoir mobiliser des abondements, la CDC doit avoir été destinataire des fonds correspondants. Le titulaire du CPF ne pourra pas mobiliser ces droits supplémentaires ou complémentaires avant réception effective par la CDC des ressources correspondances.
C’est la CDC qui se chargera, lors du paiement de la prestation de l’organisme de formation de décréter en priorité les droits acquis par le titulaire du CPF (par conversion de ses heures DIF ou par l’alimentation annuelle) puis, si nécessaire, utiliser les abondements.
Lorsqu’une entreprise a conclu un accord collectif sur la possibilité d’abonder le CPF de ses salariés, elle a la possibilité de régler la totalité du coût de la formation suivie dans le cadre du CPF et de se faire rembourser par la CDC à hauteur du crédit d’euros disponible sur le CPF de chaque salarié concerné.
A l’heure où nous bouclons cet article, la CDC n’a pas encore communiqué les modalités selon lesquelles les tiers et notamment les entreprises pourront co-financer une formation suivie par leurs salariés dans le cadre du CPF en dehors de tout accord collectif. Cette question apparait déterminante et conditionne certainement l’essor réel de ce dispositif auprès des salariés.
[1] Bas niveaux de qualification = salariés n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau CAP ou BEP ou une certification reconnue par une convention collective de branche.
[2] Travailleurs handicapés en Etablissement ou Service d’Aide par le Travail, n’ayant pas la qualité de salarié et n’ayant pas bénéficié du DIF. A distinguer des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, dont le régime est celui des salariés avec une alimentation majorée de 300 euros par an.
[3] En pratique, une simple UE faisant partie d’un bloc de compétences n’est pas éligible. C’est le bloc, dans son ensemble, avec les différentes UE qui le composent qui est éligible.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471117
[Brèves] Saisies pénales : exigence de proportionnalité relative à la saisie en valeur de l’instrument de l’infraction
Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 19-82.683, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8757ZTI)
Lecture: 4 min
N1078BYL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 20 Novembre 2019
► Peuvent être saisis en valeur les biens ou droits incorporels pour lesquels le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, dont la valeur représente celle des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre ;
dans ce cas, il appartient au juge, d’une part, de s’assurer que les conditions de la confiscation de l’instrument de l’infraction prévues par le deuxième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) étaient réunies au moment de la commission des faits, d’autre part, de vérifier que la valeur du bien saisi n’excède pas celle de l’instrument de l’infraction, enfin, lorsqu’une telle garantie est invoquée, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle.
C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 19-82.683, FS-P+B+I N° Lexbase : A8757ZTI).
Résumé des faits. Le juge d’instruction a ordonné la saisie, entre les mains d’un notaire, du produit de la vente par une SCI, dont le gérant a été mis en examen pour des faits de proxénétisme aggravé, de deux ensembles immobiliers, ainsi que de lots d’un troisième ensemble immobilier pour un montant total de 2 418 668,25 euros. Le juge d’instruction a rendu une seconde ordonnance prescrivant la saisie en valeur, entre les mains du même notaire, du solde créditeur de la vente de ces immeubles pour un montant total de 25 302,53 euros. La SCI a interjeté appel de ces décisions.
En cause d’appel. Pour infirmer les ordonnances, cantonner la saisie à la somme de 436 000 euros, et ordonner la restitution à la SCI du surplus du produit de la vente, l’arrêt retient, après avoir relevé que le gérant encourt la saisie et la confiscation en valeur des biens lui appartenant ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, que les immeubles litigieux et le produit de leur vente sont à sa libre disposition, la SCI ne pouvant être considérée comme propriétaire de bonne foi, et que ces immeubles constituent le lieu des faits de proxénétisme aggravé reprochés au gérant. Pour qu’une saisie en valeur soit ordonnée, il est exigé que la valeur du bien dont la saisie est envisagée soit en corrélation avec le montant des gains issus de l’infraction susceptible d’être constituée. Selon les juges, les gains provenant des faits poursuivis pouvant être considérés comme s’élevant à la somme de 436 000 euros, la SCI invoque à raison la disproportion des saisies pratiquées en valeur par le juge d’instruction, de sorte que la saisie en valeur doit être limitée à la somme de 436 000 euros.
Un pourvoi a été formé par le procureur général.
Précision apportée par la Chambre criminelle. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt. Elle considère en effet qu’en limitant la saisie au montant du produit de l’infraction, alors qu’elle avait constaté que, d’une part, les immeubles ayant servi à commettre le délit poursuivi, bien que cédés postérieurement aux faits, étaient lors de leur commission à la libre disposition du gérant et que la SCI n’était pas de bonne foi, d’autre part, les sommes saisies par le juge d’instruction représentaient la valeur de l’instrument de l’infraction, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 706-141-1 (N° Lexbase : L6393ISL) et 706-153 (N° Lexbase : L7453LPQ) du Code de procédure pénale et 131-21 du Code pénal. Au visa de ces articles, elle rappelle en effet : « qu’il résulte des deux premiers de ces textes qu’au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut ordonner la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal ; que la saisie peut être ordonnée en valeur ; que le troisième de ces textes dispose que la confiscation porte notamment sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que la confiscation peut être ordonnée en valeur ». C’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation apporte une telle précision.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471078
[Focus] Disparition d’un «Banksy» : variations juridiques à huit mains
Lecture: 41 min
N1022BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Séverin Jean / Guillaume Beaussonie / Didier Krajeski / Julien Laurent, Maître de conférences et Professeurs, UT1 Captitole / IEJUC EA 1919
Le 13 Novembre 2019
La vidéo n’est pas de très bonne qualité, on y voit une personne découper, en pleine nuit, un morceau de panneau de signalisation sur lequel un rongeur a été dessiné au pochoir accompagnée de la légende, en anglais, «cinquante ans depuis les émeutes de 1968 à Paris. Le berceau de l'art du pochoir». Plus loin un complice attend dans un véhicule. Quelques temps auparavant, une tentative visant le même but avait été interrompue. L’œuvre est attribuée au mystérieux artiste Banksy. On sait, en effet, que si l’artiste revendique ses œuvres à partir d’un compte Instagram, son identité demeure pour l’instant cachée alimentant de nombreuses théories sur celle-ci. L’événement a, l’on s’en doute, provoqué de nombreuses réactions. Les représentants du Centre Pompidou, situé à proximité de l’œuvre, ont décidé de porter plainte pour «vol et dégradation». La municipalité fait savoir qu’une réflexion est en cours afin de mettre au point un dispositif permettant de protéger ces œuvres de street art sans les dénaturer. Il n’y a là que des réflexes inspirés par le bon sens. Pourtant, si l’on décide de confronter ces démarches à la réalité de nos principes juridiques, les solutions qui en sortent paraissent moins évidentes. C’est à cet exercice que se sont livrés les auteurs du présent article. Chacun, dans son domaine de prédilection, a tenté de déterminer comment pouvait être réceptionnée la démarche de Banksy. Il s’agit, au fond, de répondre à trois questions centrales que cette affaire suggère eu égard au particularisme de l’œuvre de street art : a-t-elle un propriétaire ? Peut-elle être volée ? Est-il possible de l’assurer ?
I - Protection et propriété d’une œuvre de street art
L’analyse juridique de la «subtilisation» du pochoir de Banksy -nous laissons le soin au pénaliste de qualifier juridiquement plus avant ce qui s’est passé- pose plusieurs questions de droit des biens, à la croisée du droit des biens fondamental (on pourrait dire «classique» ou civil) et du droit d’auteur, droit spécial des biens.
Elle mobilise, d’abord, le droit d’auteur car une œuvre de street art apparaît à maints égards, malgré son caractère transgressif voire illicite, pouvoir relever de la protection du droit d’auteur [1]. La question de la protection de l’œuvre se pose alors, même s’il est évident que dans le cas qui nous occupe, elle soit subsumée sous celle du support.
Elle mobilise, ensuite, le droit des biens classique en tant que l’image graphique était reproduite sur un support physique -en l’espèce un panneau de signalisation situé à proximité du Centre Pompidou-. Il s’en infère que la question de la propriété du support se pose, d’autant que sa résolution apparaît d’emblée comme cardinale dans la question qui nous occupe : concrètement, c’est bien le support de cette réalisation qui a été séparé du panneau et subtilisé.
Si l’on part de l’idée que des réponses peuvent être apportées aux questions qui précèdent, enfin, se posera également la question du croisement de ces droits et de la difficile conciliation des prérogatives respectives du propriétaire du support, de l’auteur du pochoir et leur mise en œuvre en cas de subtilisation par un tiers. Peut-être faut-il, alors, envisager d’autres pistes permettant de dépasser le conflit de droits.
- La propriété de l’œuvre de Banksy : le droit d’auteur mobilisable
La création de street art paraît devoir relever sans grande difficulté de la catégorie des œuvres de l’esprit que consacre le droit d’auteur en droit français. La démonstration en ayant déjà été faite brillamment [2], nous pouvons nous contenter de rappeler brièvement les termes du débat.
La loi ne donne aucune définition générale des œuvres de l’esprit. L’article L. 111-1 du CPI (N° Lexbase : L2838HPS) énonce sobrement que «L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous». L’article L. 112-1 du CPI (N° Lexbase : L3333ADS) dispose, quant à lui, que sont considérées «notamment» comme œuvres de l’esprit toute une série de types de création. Le texte en énumère quatorze exemples, parmi lesquelles on doit relever «Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie» (7°) du texte) et «Les œuvres graphiques et typographiques» (8°) du texte) auxquels peuvent être rattachés, à notre avis sans grande difficulté, la création de Banksy en cause ici.
Au surplus, les éléments de définition dégagés à la fois par la jurisprudence et la doctrine permettent de classer a priori les œuvres de street art parmi les œuvres protégées par le droit d’auteur. Une œuvre peut être, en effet, définie comme une création incorporelle répondant à la double condition d’originalité et de l’existence d’une mise en forme ou de concrétisation.
Le critère d’originalité n’est en fait pas un critère véritable de nouveauté au sens d’un d’apport net à la création culturelle dans son ensemble -par comparaison à une invention par exemple-, mais plus simplement une manière de rattacher la création personnellement à son auteur [3]. En l’occurrence, la création est sans nul doute attribuable à l’artiste [4]. Observons, toutefois, que l’anonymat de l’artiste et l’absence de signature -courante dans le street art- pourrait poser certaines difficultés. Ces difficultés ne sont, toutefois, pas dirimantes dans le cas de Banksy. Cet artiste utilise, en effet, diverses méthodes afin de faire savoir au public les œuvres qui lui sont attribuables : ainsi, notamment, son compte Instagram (comme dans le cas du pochoir) et une société Pest Control [5]. En toute hypothèse, elles ne sont pas un obstacle définitif à la qualification d’œuvre (CPI, art. L. 113-6 N° Lexbase : L3342AD7), le débat sur l’authenticité de telle ou telle création étant consubstantiel à l’art.
Le critère de la mise en forme (ou de concrétisation) renvoie à l’idée que l’œuvre doit revêtir une forme déterminée, permettant son identification et lui donnant, tout simplement, une consistance concrète. A défaut, l’œuvre reste une idée, un simple concept. Selon la Cour de cassation, «le droit d'auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu'autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication ; que la flagrance d'un parfum, qui, hors son procédé d'élaboration, lequel n'est pas lui-même une œuvre de l'esprit, ne revêt pas une forme présentant cette caractéristique, ne peut dès lors bénéficier de la protection par le droit d'auteur» [6]. En l’espèce, le dessin réalisé par pochoir répond au critère de la mise en forme, puisque cette technique a précisément pour objet la réalisation, à partir d’une plaque évidée selon une forme, un dessin précis, qui permet de du dessin par simple passage d'un pinceau ou d'une brosse sur la plaque. Il faut relever au passage que le caractère éphémère n’est pas un obstacle à la qualification d’œuvre de l’esprit.
Il reste naturellement la délicate question de la licéité de l’œuvre. Perturbe-t-elle la qualification d’œuvre de la création de street art ? Encore faut-il préciser ce que recouvre exactement cette notion de licéité ici. Il paraît peu probable qu’une œuvre intrinsèquement illicite puisse donner lieu à protection. On peut citer en ce sens une décision de la Cour de cassation de 1999 approuvant une décision de la cour d’appel d’avoir considéré qu’une œuvre devait avoir droit à une protection «en l’absence de preuve de son caractère illicite», semblant ainsi suggérer qu’a contrario, une telle protection n’était pas méritée [7]. Un rapprochement avec le brevet d’invention ou la marque est d’ailleurs possible [8]. Mais sans doute ne faut-il pas confondre l’œuvre intrinsèquement illicite, des circonstances dans lesquelles l’œuvre a été faite, c’est-à-dire lorsque ce n’est pas l’acte de création qui est illicite en soi mais le contexte dans lequel ce dernier est survenu. Dans cette dernière hypothèse, l’acte de création pourrait faire naître une œuvre protégée, indépendamment des conditions ou des circonstances illicites dans lesquelles l’œuvre a été élaborée. Au soutien de cette distinction, Madame le Professeur Blanc cite une décision du tribunal de grande instance de Paris du 13 octobre 2000 [9] ayant accordé une protection temporaire à des squatteurs d’un immeuble ayant composé une œuvre sur le sol et les murs d’un appartement, qu’ils occupaient par conséquent sans titre. La naissance d’un droit d’auteur sur une œuvre portée ou apposée -ce qui est le cas du pochoir- sur le bien d’autrui ne paraît, par conséquent, pas totalement incompatible avec l’hypothèse d’une dégradation (comme en l’espèce) ou plus généralement une atteinte au bien d’autrui.
Il subsiste que les conditions particulières dans lesquelles l’œuvre a été créée laissent entière la question de la propriété du support de l’œuvre.
- La propriété du support : le retour du concret
La propriété du support de l’œuvre de Banksy -graphique en l’occurrence- interroge. Puisque celle-ci trouve comme support un bien corporel, ce sont les règles du droit des biens classique -celle du Code civil- qui s’appliquent. L’œuvre graphique dont s’agit, spécialement dans la technique du pochoir, s’incorpore dans son support. Il résulte de l’article 546 du Code civil (N° Lexbase : L3120AB8) que, par accession par incorporation, la propriété du support devient la propriété du propriétaire du bien fournissant le support. Il faut, donc, déterminer si ce bien-support est un meuble ou un immeuble. En l’occurrence, le pochoir étant apparemment reproduit sur un panneau de signalisation de la Ville de Paris [10], la qualification la plus probable est soit celle de domaine public immobilier spécial, et plus précisément un bien immobilier relevant du domaine public routier [11], soit celle d’effet mobilier attaché à perpétuelle demeure au sens des articles 524 (N° Lexbase : L9489I7L) et 525 (N° Lexbase : L3099ABE) du Code civil [12], autrement dit d’immeubles par destination. Peut-être même s’agit-il -mais cela est peu probable- d’immeuble par nature si le dispositif de fixation au sol procède plus de l’incorporation dans le sol (C. civ., art. 518 N° Lexbase : L3092AB7). Dans l’hypothèse où le panneau appartiendrait au Centre Pompidou, les mêmes règles s’appliqueraient (CGPPP, art. L.1 N° Lexbase : L0391H4A), le Centre étant un établissement public national à caractère culturel [13].
Cette qualification probable d’immeuble public donc, fait sans doute de la Ville de Paris le véritable propriétaire du support de l’œuvre de Banksy, et non le Centre Pompidou, bien que la subtilisation ait eu lieu dans son «périmètre» [14] et que l’implantation du Centre ne soit peut-être pas sans rapport avec le choix de l’endroit de la création. C’est la raison pour laquelle, à en croire les articles de presse, le Centre Pompidou n’aurait pas porté plainte pour vol. Autrement dit, on serait devant un cas classique de propriété du domaine public, en l’occurrence municipale (CGPPP, art. L. 3111-1 N° Lexbase : L7752IPS).
La concrétisation de l’œuvre sur/dans un support que ne contrôle pas l’artiste -l’abandon du support ou le choix d’un support qui ne lui appartient pas- crée un risque inhérent au street art : que le contrôle de l’œuvre échappe à son créateur par le biais du support. De là, peuvent s’élever des conflits de droits entre l’artiste et le(s) propriétaire(s) du support ou encore des tiers s’emparant du support.
- Conflits de droits : substance over form ?
Indépendamment de la nature publique ou privée du support, plusieurs types de conflits peuvent naître. On envisagera, notamment, d’une part, les conflits entre le propriétaire du support et l’artiste ; et d’autre part, ceux entre le propriétaire du support et un tiers.
S’agissant d’abord des conflits de droits entre le propriétaire du support et l’artiste, il faut commencer par rappeler qu’il ne faut pas confondre la propriété du support physique de l’œuvre (la toile d’un tableau) et l’œuvre elle-même, objet du droit de l’auteur. La distinction est directement évoquée par l’article L. 111-3, alinéa 1er, du CPI (N° Lexbase : L3330ADP). La propriété matérielle du support n’entraîne donc pas ipso facto celle de l’œuvre. Réciproquement, la propriété de l’œuvre (son apposition sur un bien corporel) ne peut jamais entraîner celle du support. En la matière, en effet, la jurisprudence refuse d’appliquer les règles de l’accession mobilière du Code civil au cas du support d’une œuvre de l’esprit [15]. Notamment, le jeu de la spécification prévoyant que lorsqu’un travail est appliqué à une matière de manière à créer une chose entièrement nouvelle, le produit de ce travail est, en principe, attribuée au propriétaire de la matière (C. civ., art. 570 N° Lexbase : L3150ABB), sauf lorsque la main d’œuvre est tellement importante qu’elle dépasse de beaucoup la valeur de la chose (C. civ. art. 571 N° Lexbase : L3151ABC). Or, précisément, «une telle disparité de valeur semble de rigueur face à un support vierge devenu support de création» [16]. L’application des règles de la spécification devrait, donc, permettre l’acquisition du support, lorsque celui-ci n’appartient pas à l’auteur. Pourtant, la Cour de cassation se refuse, cependant, à appliquer ces règles à la question du support d’une œuvre. Il est donc nécessaire de faire coexister les droits de l’auteur et ceux du propriétaire du support matériel.
Les prérogatives morales et patrimoniales de l’auteur ne peuvent donc être exercées par le propriétaire du support. Les prérogatives morales concernent, notamment, la question de la divulgation de l’œuvre (CPI, art. L. 121-2, al. 1er N° Lexbase : L3347ADC) et de son éventuel retrait. Notons que ce droit de divulgation s’accommode parfaitement de l’anonymat de l’auteur, comme en l’espèce (CPI, art. L. 113-6 N° Lexbase : L3342AD7). Les prérogatives patrimoniales s’entendent du monopole d’exploitation. Elles concernent, notamment, le droit de reproduction, qui n’appartient qu’à l’auteur ; la reproduction de l’œuvre est, donc, interdite sans son autorisation.
Ces prérogatives se concilient difficilement avec la nature particulière du street art. En effet, l’article L. 111-3, alinéa 2, du CPI précise que, si les droits de l’auteur subsistent malgré le fait que la propriété du support matériel appartienne à un autre, l’auteur ne pourra pourtant exiger du propriétaire la mise à disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Certes, le même texte prévoit qu’en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance pourra prendre toute mesure appropriée. Et l’on sait que cette disposition a été étendue au-delà de la lettre du texte, permettant d’exiger du propriétaire coupable d’abus notoire de mettre à disposition le support.
Cette prérogative pourra-t-elle empêcher le propriétaire privé n’ayant pas donné son accord pour voir apposer sur son bien immeuble l’œuvre dont il s’agit, de remettre en état son bien ? On en doute fortement, même si la décision du TGI de 2000 précitée laisse entendre que les juges ne sont pas hostiles à une conciliation temporaire. Il n’est pas certain, toutefois, que cette conciliation respecte parfaitement le pouvoir d’exclusivité du propriétaire. Dans un arbitrage ferme de droits fondamentaux, nous aurions tendance au contraire à penser qu’une protection proportionnée de la propriété doit permettre une remise en état du bien, sans compter qu’il s’agit d’un délit pénal. La destruction (l’effacement) de l’œuvre de manière à restaurer l’intégrité du bien corporel nous semble, donc, en toute hypothèse possible. D’autant que les conditions dans lesquelles sont créées ces œuvres tendent à en faire des œuvres éphémères.
Différemment, pourrait-on empêcher le propriétaire de séparer le support de l’immeuble lui appartenant -donc d’en faire un meuble- et de vendre ce support ? La réponse n’est pas aisée. D’un côté, il est clair que cette possibilité entre potentiellement en conflit avec le monopole d’exploitation de l’auteur ainsi surtout qu’avec son droit moral et, notamment, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : un esprit de désintéressement imprègne ces œuvres particulières, comme dans le cas de Banksy. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles Banksy choisirait, désormais, des lieux publics, afin de compliquer une appropriation privée et une commercialisation pour des intérêts privés de son œuvre. D’un autre côté, le support appartenant au propriétaire de l’immeuble, on hésite sur un fondement ferme permettant de lui refuser cette possibilité. Une solution serait peut-être de limiter son droit d’exclusivité sur le fondement de la lettre même de l’article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4), de manière comparable à ce qu’a réalisé la Cour de cassation en matière d’image des biens [17]. La propriété des biens n’inclurait donc pas la possibilité de séparer le support matériel d’une œuvre de street art sans autorisation de l’artiste, à moins que le propriétaire ne démontre par exemple que la présence de celle-ci ne lui cause un trouble anormal.
La possibilité d’une séparation du support de l’immeuble -comme dans le cas du Banksy- pose encore la question d’un éventuel conflit entre le propriétaire du support et les tiers.
S’agissant, ensuite, des conflits entre le propriétaire du support et un tiers entré en possession du support, dans le cas où le tiers est devenu licitement propriétaire du support (par exemple une vente), aucune difficulté particulière ne surgit. Qu’il s’agisse d’un meuble ou d’un immeuble, se retrouveront, alors, les questions que soulèvent la conciliation des droits de l’auteur et de ceux du propriétaire du support précédemment évoquées.
En revanche, la question se pose d’un conflit entre le véritable propriétaire du support et du tiers mis en possession du support. Il faut distinguer selon que le bien est meuble ou immeuble. Si le bien est immeuble, on peut imaginer que le tiers l’ait acquis par prescription acquisitive prolongée ou abrégée. Le possesseur deviendra propriétaire de l’immeuble selon les cas, soit par trente, soit par dix ans de possession utile dans le cas d’usucapion abrégée (C. civ., art. 2272 N° Lexbase : L7195IAQ). Si le bien est meuble, soit que l’œuvre ait été apposée sur un bien meuble directement, soit, comme en l’espèce, qu’elle ait été séparée physiquement de son support immeuble, se posera alors la question de l’application de l’article 2276 du Code civil (N° Lexbase : L7197IAS). Si le possesseur acquiert de bonne foi le bien meuble, il en devient propriétaire par le seul jeu de la possession, faisant échec au droit du verus dominus. Encore faudra-t-il que l’on puisse considérer le possesseur de bonne foi. Notons, enfin, quoi qu’il en soit, que cette règle ne vaut pas lorsque, précisément comme nous le pensons en l’espèce, le bien ressortit au domaine public [18]. La Cour de cassation a, en effet, considéré très récemment, par un arrêt du 13 février 2019 [19], que les règles d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité des biens du domaine public neutralisaient les dispositions de l’article 2276 du Code civil [20]. De sorte que la Ville de Paris devrait pouvoir revendiquer le morceau de panneau supportant le pochoir en quelque main qu’il se trouve.
- Dépassement des conflits des droits ?
Si nous croyons que le pochoir de Banksy est assurément une œuvre d’art, alors la négation de la propriété -pour l’un du support, pour l’autre de l’œuvre- n’est pas possible. Dès lors, envisager un dépassement des conflits suscités par la rencontre du droit de propriété et du droit d’auteur exige d’imaginer d’autres catégories juridiques maintenant l’exigence de propriété sauf à en considérer son abandon.
L’hypothèse d’un abandon de propriété conduit à distinguer selon que l’abdication de la propriété procède de l’artiste ou du propriétaire du support.
Si l’on envisage l’absence de propriété du côté de l’artiste, il est tentant de rattacher le street art à l’œuvre libre. En effet, le Code de propriété intellectuelle dispose que «l’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits […] des tiers […]» [21]. Cette idée, aussi séduisante soit-elle, pose deux difficultés majeures : d’une part, l’œuvre libre exige une autorisation écrite de l’artiste qui s’accommode mal avec le street art et qui ne peut notamment être présumée lorsque l’œuvre est réalisée dans l’espace public ; d’autre part, quand bien même une telle autorisation interviendrait, faut-il encore rappeler que l’auteur demeure investi du droit de paternité de telle manière qu’il n’y a pas, en tout état de cause, d’abdication du droit de propriété de l’artiste. Par conséquent, ce n’est pas parce que les street artistes renoncent à exercer leurs droits -du moins sur l’œuvre- qu’ils abandonnent leur propriété (songeons simplement à la volonté de Banksy de détruire intégralement l’œuvre Girl with Balloon en cas de vente aux enchères).
Si l’on se place, désormais, du côté du propriétaire du support, une autre qualification juridique est envisageable : le street art comme chose commune. L’article 714, alinéa 1er du Code civil (N° Lexbase : L3323ABP) énonce qu’«il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous». Là encore, l’idée est attrayante dans la mesure où le street art s’insère généralement dans l’espace public afin d’en permettre l’accès précisément au public. Cela étant, au-delà du fait qu’il faudrait une nouvelle fois admettre que son auteur a renoncé au moins à la dimension matérielle de son droit d’auteur, c’est surtout que cette catégorie juridique requiert, également, la négation du droit de propriété du support matériel de l’œuvre. Dès lors, pas davantage que l’œuvre libre, le recours aux choses communes ne surmonte pas les conflits des droits. Quid alors des catégories juridiques qui prennent en compte la propriété ?
Les catégories juridiques laissant subsister le droit de propriété invitent à considérer deux notions dans l’air du temps : les biens communs et la transpropriation [22].
La qualification de bien commun [23] a l’avantage de ne pas supprimer la propriété tant de l’artiste que du propriétaire du support tout en créant une forme d’appropriation collective à un groupe de personnes. Or, de nombreux obstacles s’opposent à retenir le concept de bien commun pour accueillir le street art. D’abord, cela impliquerait -au-delà de déterminer le groupe- une difficulté tenant à la gestion de l’œuvre, laquelle devrait échoir au groupe. Ensuite, au moins pour la dimension matérielle de l’œuvre, on voit mal comment le propriétaire du support serait privé des prérogatives qu’il tire de l’article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4). Enfin, il ne faut pas oublier que le contexte de réalisation d’une œuvre de street art fait partie intégrante de cette forme artistique de sorte que laisser la gestion de l’œuvre à la communauté revient à porter atteinte aux prérogatives -notamment le droit au respect de l’œuvre- de l’artiste.
Quant à la transpropriation, l’idée semble meilleure dans la mesure où la propriété est maintenue mais elle s’exerce au bénéfice de l’usage d’un groupe de personnes que l’on reconnaîtrait comme légitimes. En d’autres termes, l’intérêt collectif justifierait l’accès à certaines utilités au titre desquelles figure surtout l’accès à l’œuvre tandis que les intérêts individuels du propriétaire du support et de l’artiste seraient corrélativement réduits en restreignant leurs prérogatives. La transpropriation a pour mérite de mettre en évidence que la résolution des conflits des droits ne passe sans doute pas par la perte des propriétés, mais par une limitation des prérogatives des propriétaires comme l’exige la rencontre du droit des biens et du droit d’auteur, et comme le permet l’article 544 in fine du Code civil. Aussi, faut-il davantage se placer sur le terrain, non pas de l’existence des droits, mais sur celui de leur exercice.
Si les conflits entre le droit d’auteur et le droit des biens sont envisagés sous l’angle des prérogatives juridiques, leur résolution n’apparaît peut-être plus insurmontable. Rappelons que le droit de propriété est lien un exclusif entre un sujet de droit et un bien autorisant alors le propriétaire -le sujet de droit- à retirer toutes les utilités que le bien permet. A cela s’ajoute l’idée que l’étendue des utilités, au-delà d’être limitée par la nature intrinsèque du bien envisagé, peut également l’être par une norme juridique comme l’exprime l’article 544 du Code civil in fine. Aussi, les restrictions ne manquent pas. Il suffit de penser aux restrictions subies par un propriétaire lorsque son fonds est grevé d’une servitude. La technique de la servitude pourrait être transposée au street art en ce sens que le propriétaire d’un bien, sur lequel serait réalisé un pochoir de Banksy, verrait sa propriété assujettie à une charge de conservation de l’œuvre d’art. Toutefois, au moins deux arguments doivent conduire à son rejet : d’une part, la servitude nécessite un fonds dominant et un fonds servant ce qui n’est nullement le cas en matière de street art. D’autre part, cette reconnaissance tendrait à consacrer une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Plus moderne, n’est-il pas possible, par analogie, de s’inspirer de l’obligation réelle environnementale, mise à la charge des propriétaires immobiliers, dont la finalité est «le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques» [24]. Appliquée au street art, l’obligation réelle, qui serait «artistique», viendrait restreindre les prérogatives du propriétaire du support en exigeant de lui qu’il maintienne, voire conserve le support accueillant l’œuvre de street art. Néanmoins, cette solution n’est pas plus viable que l’idée d’une servitude car l’obligation réelle environnementale suppose un accord de volonté du propriétaire immobilier et autorise l’existence d’une compensation. Or, il ne faudrait pas oublier que le street art advient, le plus souvent, en toute illégalité et partant, sans l’accord du propriétaire du support. En définitive, repenser le street art eu égard aux prérogatives du propriétaire du support et de l’artiste appert plus pertinent mais pas plus efficient pour résoudre les conflits des droits.
L’avenir est, sans doute, au compromis à trouver dans l’articulation des prérogatives du propriétaire du support et de l’artiste. Sans aller jusqu’à reprendre la décision du TGI précitée, puisqu’une telle solution consacre à une atteinte disproportionnée au pouvoir d’exclusivité du propriétaire du support, une conciliation plus respectueuse des droits fondamentaux et de l’esprit du street art pourrait être imaginée. Le raisonnement procéderait en deux temps. Dans un premier temps, dès lors que l’accord du propriétaire du bien à partir duquel l’œuvre est réalisée n’a pas été obtenu, le propriétaire du support, conformément à l’exclusivité dont il dispose en cette qualité, serait en droit d’exercer pleinement son droit de propriété afin de remettre en état son bien. En d’autres termes, le droit des biens l’emporterait chronologiquement sur le droit d’auteur ; la réalisation de l’œuvre portant atteinte au droit de propriété. Cependant, dans un second temps, faute de mettre en œuvre cette prérogative dans un délai (qui resterait à déterminer), le propriétaire du support verrait ces prérogatives limitées par le déploiement de celles de l’artiste.
En conclusion, on le voit, même si des solutions peuvent être puisées dans notre droit positif ou peuvent être imaginées, de nombreuses incertitudes subsistent. Il en est ainsi parce que les œuvres de street art se situent à la périphérie de la légalité, d’une part ; et du droit des biens et de la propriété intellectuelle, d’autre part ; sans compter le jeu perturbant du domaine public. Autant d’éléments qui nécessitent en priorité une adaptation des règles du droit d’auteur.
II - «Vol» d’une œuvre de street art ?
A lire la presse généraliste, la chose serait acquise : une œuvre de Banksy aurait été dérobée, durant la nuit du lundi 2 au mardi 3 septembre, en plein centre de Paris. La victime serait, au surplus, le Centre culturel Georges-Pompidou, dont l’un des panneaux sur lequel figurait ladite œuvre a été découpé, malgré le dépôt d’une plaque de plexiglas pour la protéger, puis emporté par un individu dont les agissements ont même été filmés.
Problème : ce qui était en cause était en vérité une œuvre de street art -d’«art urbain», si l’on préfère-, plus précisément un graffiti ou un pochoir sans doute réalisé par l’artiste britannique Banksy sur l’envers du panneau d’entrée du parking souterrain du Centre Pompidou. D’où une plainte dudit Centre pour vol et dégradation, mais surtout cette question : peut-on vraiment voler une œuvre de street art qui, non seulement, a une origine illicite -car, lorsqu’elle a été faite sans autorisation, une telle œuvre n’en représente pas moins une infraction : C. pén., art. 322-1, al. 2 (N° Lexbase : L1825AMK)-, mais aussi, en principe du moins, devrait avoir un destin éphémère ?
Passons sur le plus simple : la dégradation consistant à découper le panneau est incontestable et, en raison de la nature même du Centre Pompidou, sa répression est même aggravée (C. pén., art. 322-3-1, al. 1, 1° N° Lexbase : L2583K9K : sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, éventuellement élevée jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré).
Le statut précis des panneaux n’est néanmoins pas très clair : était-ce la propriété de la commune de Paris, car il s’agissait d’un parking municipal ? Etait-ce celle du gestionnaire du parking ? Etait-ce celle du Centre Pompidou, car il s’agissait de son parking ? Par facilité, nous ne raisonnerons qu’à partir de cette dernière hypothèse, le raisonnement n’apparaissant cependant pas différent dans l’autre hypothèse.
En ce qui concerne le vol, en revanche, les choses sont beaucoup plus compliquées car, dans un premier temps, il faudrait déjà régler les questions -liées- de l’identification de l’objet volé et de la détermination de son propriétaire.
Sur la première question, il existe deux façons de voir les choses : soit ce qui a été volé n’est qu’un bout de panneau contenant une peinture ; soit c’est, à l’inverse, une peinture contenue sur un bout de panneau.
Dans le premier cas, le plus simple car la question de la propriété ne serait alors pas polémique, la sanction du vol serait surabondante avec celle de la destruction, de sorte qu’il faudrait faire un choix entre les deux -le vol étant appréhendé comme la conséquence de la destruction ou, ce qui est plus envisageable au regard des faits, comme sa cause-, les peines encourues étant de toute façon les mêmes, toujours à raison de la particularité de la nature du Centre Pompidou (C. pén., art. 311-4-2, al. 1, 1° N° Lexbase : L0232IB9).
Dans le second cas, plus probable car le panneau a vraisemblablement été découpé parce qu’il supportait une peinture, et pas n’importe laquelle, la question de la propriété redevient discutable : le Centre Pompidou en était-il propriétaire, était-ce le peintre, voire était-ce les deux à la fois ?
Nous renvoyons, à cet égard, aux contributions de nos collègues relatives à la propriété, de droit commun ou intellectuelle, de l’œuvre ainsi considérée (ainsi qu’à propos du problème sus-évoqué de l’éventuelle l’attribution à la commune), nous contentant donc de préciser -même si le juge pénal éventuellement saisi devrait, quant à lui, trancher ces questions- que, quelles que soient l’attribution considérée et sa cause, la contrefaçon ne saurait être concernée en l’occurrence, en raison de la nature plus matérielle que juridique de l’atteinte réalisée.
La contrefaçon, en effet, sanction du détournement d’une œuvre par une personne qui n’en a pas la propriété intellectuelle, est en concours avec l’abus de confiance (C. pén., art. 314-1 N° Lexbase : L7136ALU) plus qu’avec le vol, leur distribution s’opérant selon le statut de l’objet : abus de confiance en cas d’œuvre intellectuelle pas suffisamment originale ; contrefaçon en cas d’œuvre intellectuelle au sens -strict- du Code de la propriété intellectuelle [25].
Revenant donc au vol, l’importance ne réside pas tant, d’un point de vue substantiel, dans la propriété du Centre Pompidou ou de Banksy que, de l’autre côté, dans l’absence de propriété de l’auteur de la soustraction [26].
Le débat porterait alors, éventuellement, sur le caractère approprié de l’œuvre, sa non-revendication par l’artiste pouvant être perçue, de sa part, comme une forme d’abandon. Or, une chose abandonnée étant libre de droit, sa soustraction n’est pas un vol ; au contraire, c’est une appropriation -non frauduleuse- ! Toutefois, cet état de fait n’empêcherait précisément pas une telle appropriation par le maître du panneau, c’est-à-dire le Centre Pompidou, par une forme d’accession dont on inverserait peut-être le principe, la valeur résidant plutôt dans la peinture, mais qui n’apparaitrait pas si illégitime.
Précisons aussi, à ce stade, que l’origine illicite de l’œuvre n’a pas d’incidence sur la question de son vol éventuel, un tel bien pouvant avoir malgré tout un propriétaire et, en conséquence, être volé [27].
D’un point de vue procédural, en revanche, il est important de savoir qui est précisément propriétaire de quoi, afin de savoir qui serait légitime à faire une citation directe ou à se constituer partie civile, en vertu des critères de l’article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) : «L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction» (nous soulignons). Là encore, cela ne poserait pas de problème pour le Centre Pompidou qui, en tant que propriétaire du support, a inéluctablement été victime, si ce n’est du vol, au moins d’une destruction.
Pour Banksy, tout dépendrait de l’existence, ou pas, d’une propriété intellectuelle de la peinture, sa qualité de victime n’excluant pas inéluctablement celle du Centre Pompidou, propriétaire et possesseur pouvant agir de concert [28]. A condition que cette qualité lui soit reconnue, l’artiste aurait alors toute possibilité de faire une citation directe ou de se constituer partie civile sans que cela ne heurte l’article 2 du Code de procédure pénale.
Dans un second temps, en ce qui concerne les éléments proprement constitutifs du vol, la soustraction, élément matériel, ne serait pas vraiment difficile à caractériser. Il n’était pas question, ici, d’une reproduction de l’œuvre, forme habituelle bien qu’encore polémique du vol de biens incorporels [29]. Le caractère radical du découpage du panneau empêche effectivement toute discussion sur ce point, le déplacement de l’œuvre ayant bel et bien eu lieu concomitamment à celui de son support -d’où la difficulté dont nous avons déjà fait état de différencier, en l’espèce, vol et destruction-.
Il n’en irait pas différemment pour l’élément moral, c’est-à-dire l’intention de soustraire un bien appartenant à un autre, l’erreur sur la propriété paraissant invraisemblable, tant l’auteur de la soustraction a, dans la présente affaire, emprunté un mode d’action dépourvu de toute ambiguïté : action la nuit, découpage d’un panneau, autant d’indices d’une volonté sans équivoque de capter l’œuvre qui figurait sur le bout de panneau qui a été dissipé.
En conclusion, la particularité des évènements ayant eu lieu à Beaubourg rend peu polémique la reconnaissance d’une infraction et, le cas échéant, d’un vol. La teneur de ce vol, en revanche, et c’est sans doute l’essentiel, demeurera tributaire de la détermination et de l’attribution du bien considéré, par référence ou pas à l’intervention de Banksy ; vol d’un bout de panneau, fût-ce celui d’un musée, et vol d’une œuvre d’art ne sont pas vraiment comparables. Dans d’autres hypothèses où il sera, de façon plus orthodoxe en la matière, question d’une soustraction-reproduction plutôt que d’une soustraction-préhension, le débat sera d’ordre purement intellectuel. Contrairement aux apparences, les choses seront alors peut-être plus simples !
III - Assurance d'une œuvre de street art ?
Manifestement, le marché de l’assurance des œuvres d’art a, si l’on peut dire, un fort potentiel de progression. On estime que peu de propriétaires ou de collectionneurs assurent les œuvres qu’ils possèdent [30]. La plupart du temps, ce rejet de l’assurance est dû à des préjugés persistants sur le lien entre assureur et fisc, ainsi que sur le niveau supposé des primes.
On peut, d’ailleurs, relativiser tout de suite cette première affirmation, le défaut d’assurance semble toucher une catégorie particulière d’assurés, et non l’ensemble des personnes susceptibles d’être intéressées par l’assurance des œuvres d’art : à côté des propriétaires et collectionneurs, apparaissent les organisateurs d’exposition, les professionnels de l’art (restaurateurs, galéristes, encadreurs…). Nul doute que le taux de pénétration de l’assurance est, pour ces activités, plus important. Il n’y a, d’ailleurs, pas toujours le choix, le Code du patrimoine impose la souscription d’une assurance en cas de prêt ou de dépôt d’une oeuvre ou d’un objet d’art appartenant à l’Etat et confié à la garde du Centre national des arts plastiques : celle-ci doit couvrir «le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt» [31]. Un arrêté du ministre de la Culture peut dispenser l’emprunteur ou le dépositaire de l’obligation d’assurance.
Stoppons, tout de suite, ces remarques générales avant d’être suspecté de réaliser un hors-sujet. On est loin, dans les considérations qui viennent d’être faites, de l’assurance d’une œuvre réalisée par un artiste sur un support public dans le but d’éviter une patrimonialisation et une valorisation de l’œuvre par la vente d’un support privé [32]. On ne se rapproche pas plus de l’assurance d’une propriété de l’œuvre lorsque l’artiste n’en revendique tout au plus que la paternité. On peut d’ailleurs se demander ce qu’il reste à assurer lorsque l’artiste intègre à l’œuvre un dispositif de destruction !
Ces propos n’auront pourtant pas été inutiles. Deux notions d’assurance y sont apparues en creux : le risque et l’intérêt d’assurance. La variété des acteurs du domaine de l’art illustre l’idée soulignée par l’article L. 121-6 du Code des assurances (N° Lexbase : L0082AAB) : «Toute personne ayant un intérêt à la conservation de la chose peut la faire assurer». Il ne manque pas de décisions ayant précisé que la qualité de propriétaire n’est pas nécessaire pour assurer un bien et percevoir la prime [33]. Si l’intérêt permet de justifier la qualité de bénéficiaire de l’indemnité, on peut considérer qu’il détermine (ce qui est nécessaire à la validité de l’assurance), en fonction de l’événement pris en compte (vol, dégât des eaux, vandalisme, accident de transport…) [34], les conséquences dommageables que l’on veut faire prendre en charge : la valeur de l’oeuvre, le coût de remise en état en cas de détérioration, les dommages consécutifs à la détérioration ou la perte de l’oeuvre. Autrement dit, il contribue à la délimitation du risque assuré.
Il y a peu de chances dans notre hypothèse, que l’auteur de l’œuvre sollicite un assureur pour protéger l’œuvre qu’il réalise. On pourrait même affirmer que sa démarche artistique est à l’opposé de la recherche de sécurité que propose un assureur. En revanche, on pressent dans l’attitude du Centre George Pompidou, auteur d’une plainte, une volonté de protéger l’œuvre. A ce titre, pourquoi ne pas envisager que, même non propriétaire de l’œuvre celui-ci puisse la faire assurer contre les détériorations dont elle pourrait faire l’objet en cas de vandalisme, d’une atteinte involontaire ou d’un autre événement non humain (événement climatique) ? Un intérêt d’assurance pourrait-il être dégagé ? Rien n’est moins sûr. Bien sûr beaucoup de personnes manifestent de l’intérêt pour le travail de l’artiste et pour ses œuvres. Cependant, l’intérêt d’assurance ne peut être conçu comme une notion large qui permettrait d’intégrer toute forme d’intérêt pour la chose considérée. L’intérêt requis est d’ordre économique : il doit exister un rapport de cet ordre entre la personne en quête d’assurance et la chose qu’elle veut assurer [35]. Au titre des événements que nous avons décrits, un intérêt d’assurance pourrait alors résider dans la protection des moyens matériels éventuellement mis en œuvre pour prévenir le vol ou le vandalisme. S’il s’agit d’assurer l’œuvre elle-même, la notion d’intérêt d’assurance nous oriente, alors, vers des techniques d’assurance dans lesquelles une personne assure l’intérêt d’assurance d’autrui. Il en va ainsi du mécanisme de l’assurance pour le compte de qui il appartiendra [36]. Mais généralement dans cette hypothèse, un accord préalable entre le souscripteur et le tiers a organisé cette prise en charge de l’intérêt d’assurance d’autrui. On se trouve, ici, dans une situation bien différente : l’artiste ne demande rien. On peut se demander si un intérêt d’assurance n’existe pas de façon plus tangible chez le propriétaire du support de l’œuvre. Ce dernier pourrait se trouver bien aise qu’un bien qu’il détient soit le support d’une œuvre d’un artiste réputé. A ce titre, il peut vouloir préserver l’œuvre en même temps que le support dont il est propriétaire.
Cette question de l’intérêt d’assurance en rejoint alors une autre : Banksy produit ses œuvres sur les biens d’autrui. Il s’agit d’une dégradation [37], la qualification a été retenue dans des hypothèses similaires [38]. Or, la licéité est une condition de l’assurabilité du risque. Il n’est pas possible d’assurer une activité contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’une des dernières applications de cette exigence concerne l’assurance d’une exposition qui a été interdite car portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs [39]. L’œuvre ne paraît pas assurable si elle résulte de la commission d’une infraction. Dans notre hypothèse, la situation est cependant un peu plus complexe : même si l’œuvre est le fruit d’une dégradation au sens pénal, la victime peut très bien considérer cette dernière comme une valorisation de son bien. Au lieu de faire sanctionner le comportement, elle vise à protéger son produit. En sollicitant une garantie, le propriétaire du support rend-il l’œuvre licite et le risque assurable ?
La logique d’assurance rend plausible, on le voit, l’hypothèse de l’assurance d’une œuvre de street art. Cependant, il semble que la technique de délimitation de la garantie la rende difficile à mettre en œuvre. L’assureur ne prend pas en charge la totalité du risque auquel est exposée une personne. A ce titre, il se soucie, pour l’événement considéré et redouté, de sa fréquence de réalisation et du coût que peut avoir le risque qui se réalise. Différents éléments dans le contrat permettent de délimiter le risque pris en charge, afin de le rendre supportable au prix proposé : la façon de définir l’événement redouté, l’exposé des conséquences prise en charge, la stipulation de plafonds et des clauses de restriction de garantie que sont les conditions de garantie et exclusions de garantie. Ces deux dernières stipulations sont, en particulier, l’occasion pour l’assureur de soumettre la chose assurée à des mesures de prévention qui lui semblent de nature à influencer les chances de survenance du sinistre ou son coût.
La façon dont Banksy produit ses œuvres et la conception qu’il semble avoir de leur existence est loin de la logique suivie par un assureur. Cette dernière implique que l’œuvre ait un niveau de protection proportionné à la convoitise qu’elle est susceptible de susciter. Si un assureur acceptait de garantir l’œuvre dans les cas que nous avons évoqués, il le ferait certainement en limitant les événements susceptibles d’être assurés (le risque de vol, de vandalisme sont importants), en multipliant les conditions, et en retranchant des circonstances où le risque a plus de chances de se réaliser. Dans l’affaire qui a provoqué les présents propos, le vol de l’œuvre s’est produit en pleine nuit à une heure où le public est peu présent dans les rues de Paris. La personne disposée à assurer l’œuvre est-elle, par exemple, prête à la faire surveiller de façon permanente ? En-a-t-elle seulement les moyens financiers ?
Au long des développements consacrés à l’assurance, nous avons pu constater que la façon de produire l’œuvre dont l’assurabilité est envisagée mettait en question la logique et la technique d’assurance. Il est temps d’inverser le raisonnement. Assurer l’œuvre ne revient-il pas à lui faire vivre une existence non voulue par l’artiste ? Il a manifestement souhaité lui donner un caractère éphémère, ou, en tout cas, ne s’est pas soucié de sa pérennité. Les obstacles à l’assurabilité ne font finalement que protéger sa démarche artistique. On ne peut donc que se réjouir de leur existence.
Perdue dans ses pensées et son sourire énigmatique, la Joconde n’envie-t-elle pas un peu le sort du rongeur de Banksy ?
[1] V. Nathalie Blanc, Art subversif et droit d’auteur : le Street Art peut-il être protégé par le droit d’auteur ?, in Droit(s) et Street art, LGDJ, 2017, p. 61.
[2] Nathalie Blanc, art. préc..
[3] CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10 (N° Lexbase : A4925H3S).
[4] V., entre autres, les articles dans Le Parisien, 4 septembre 2019 ; Libération, 4 septembre 2019 ; Les échos, 4 septembre 2019.
[5] Banksy, le roi du street art, revendique plusieurs œuvres à Paris, Le Figaro, 28 juin 2018.
[6] Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-19.872, F-D (N° Lexbase : A3660KRY). V. également, CJUE, 13 novembre 2018, aff. C-310/17 (N° Lexbase : A0243YLL).
[7] Cass. crim., 28 septembre 1999, n° 98-83.675 (N° Lexbase : A5601AWD) : «aux termes de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, les œuvres de l'esprit sont protégées, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; qu'ils en déduisent qu'en l'absence de preuve de son caractère illicite, une œuvre pornographique bénéficie de la protection accordée par la loi sur la propriété littéraire et artistique».
[8] CPI, art. L. 611-16 (N° Lexbase : L2623IBR) et art. L. 711-3 (N° Lexbase : L3712ADT).
[9] N. Blanc, préc., n° 12.C.
[10] Les articles de presse ne sont pas extrêmement précis sur cette question. Certaines images suggèrent, toutefois, qu’il s’agit d’un panneau sur la voirie indiquant l’accès à un parking du Centre Pompidou.
[11] CF. CGPPP, art. L. 2111-14 (N° Lexbase : L4514IQA) : «Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées».
[12] Cf. C. urb., art. R. 421-17.
[13] Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975, portant création du centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
[14] Expression utilisée par les articles de presse précités.
[15] Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 09-15.819, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4839H3M) ; D., 2011, 2995, et 2012. 2836, obs. P. Sirinelli ; RTDCiv., 2012, 131, obs. T. Revet ; RTDCom., 2012, 110, obs. F. Pollaud-Dulian : à propos de la propriété de plaques de zinc sur lesquelles avaient été reproduits deux dessins par Giacometti, attribuées à l’imprimeur, et non aux ayants-droit de l’artiste ; v. ég. Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-22.207, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1472NU3) ; D., 2016, 238, obs. P. Noual, note A. Latil ; ibid. 449, obs. N. Fricero ; Dalloz IP/IT 2016. 34, obs. N. Dissaux ; JCP éd. G, 2016, 281, note E. Treppoz ; PI, 2016, 48, obs. J.-M. Bruguière ; RLDI, décembre 2015, p. 17, obs. L. Costes : à propos de la propriété de pellicules attribuée à la société les ayant financés et non au photographe.
[16] E. Treppoz, art. préc., spéc. n° 8.
[17] Ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450 (N° Lexbase : A1578DCG) ; BICC, 15 juillet 2004, rapp. Collomp, concl. Sainte-Rose ; GAJC, 12ème éd., n° 68-69 (II) ; D., 2004, 1545, notes Bruguière et Dreyer ; ibid. Somm. 2406, obs. Reboul-Maupin ; JCP 2004. II. 10085, note Caron ; ibid. I. 147, n° 12, obs. Tricoire ; ibid. I. 163, n°s 24 s., obs. Viney ; ibid. I. 171, n° 1, obs. Périnet-Marquet ; Gaz. Pal., 2005, 1256, note Tellier-Loniewski et Revel de Lambert ; Defrénois 2004. 1554, note S. Piedelièvre et Tenenbaum ; Dr. et patr. 7-8/2004. 34, étude Revet ; LPA, 10 janvier 2005, concl. Sainte-Rose ; CCE 2004. Etude 35, par Siiriainen ; Cah. dr. entr. 2004, n° 6, étude Roman ; RDI 2004. 437, obs. Gavin-Millan-Oosterlynck ; RTDCiv., 2004. 528, obs. Revet.
[18] CGPPP, art. L. 1 ([LXB=LXB=L0391H4A]).
[19] Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-13.748, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3441YXQ) ; AJDA, 2019, 366 ; JCP 2019.582, note P. Noual et 785, obs. H. Périnet-Marquet ; JCP éd. N, 15 mars 2019, 10, note M. Touzeil-Divina ; RDC, 2019, 85, obs. F. Danos.
[20] Il s’agissait, en l’espèce, d’un fragment du jubé arraché à la cathédrale de Chartres appartenant à l’Etat.
[21] CPI, art. L. 122-7-1 (N° Lexbase : L2842HPX).
[22] F. Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, 2003, p. 323 et s..
[23] V. l’article d’A. Héritier, Le street art, bien commun artistique ?, Juris art etc., 2014, n° 12, p. 39 et s..
[24] C. env., art. L. 132-3 (N° Lexbase : L7662K9N).
[25] Pour un ex., v. Cass. crim., 18 octobre 2011, n° 11-81.404, F-D (N° Lexbase : A9977HZK).
[26] V. par ex., en ce sens, Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-82.152 (N° Lexbase : A5022AWW) à propos de biens volés dans un cimetière et, conséquemment, difficiles à attribuer avec précision.
[27] V. par ex., Cass. crim., 5 novembre 1985, n° 85-94.640 (N° Lexbase : A5841AAL), à propos d’un vol de produits stupéfiants.
[28] V. par ex. Cass. crim., 9 mars 2016, n° 15-80.107, F-P+B (N° Lexbase : A1733Q7C), à propos d’une action civile recevable au profit de l’ancien voleur, inéluctablement détenteur du bien...).
[29] V. par ex. Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-81.113, FS-P+B (N° Lexbase : A7053WLS) : «le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d’une entreprise n’est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction».
[30] Bien assurer ses œuvres d’art, Le monde, éd. en ligne, 29 avril 2017.
[31] C. patr., art. D. 113-4 (N° Lexbase : L0061LBU).
[32] Vol d’un Banksy en plein Paris, Le point, éd. en ligne, 3 septembre 2019.
[33] Cass. civ. 1, 15 février 2000, n° 97-20.179 (N° Lexbase : A5293AWX), Bull. civ. I, n° 47 ; RCA, 2000, chron. 7, H. Groutel ; RGDA, 2000, 604, note A. Favre-Rochex.
[34] Pour une illustration de l’assurance «clou à clou» : Cass. com., 8 juillet 2014, n° 12-28.764, F-D (N° Lexbase : A4265MUI), RCA, 2014, 332.
[35] J. Bigot et alii, n° 415 et s..
[36] C. assur., art. L. 112-1 (N° Lexbase : L0052AA8).
[37] C. pén., art. 322-1, al. 2 (N° Lexbase : L1825AMK).
[38] Sur la reconnaissance d’une infraction : Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 08-84.989, FS-P+B (N° Lexbase : A9827WMW), Dr. pén., 2017, 159, obs. Ph. Conte ; Com. Com Elect., 2018, étude 5, par G. Goffaux Callebaut.
[39] Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-19.729, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2832MZW), cette revue n° 595 ; RGDA, 2015, 16, note J. Kullmann.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471022
[Questions à...] Retard d’un vol : l’indemnisation n’est plus subordonnée à la preuve par les passagers de leur présence à l’enregistrement - Questions à Maître Joyce Pitcher, avocate au barreau de Paris
Réf. : CJUE, ord., 24 octobre 2019, aff. C‑756/18 (N° Lexbase : A2649ZUN)
Lecture: 11 min
N1176BY9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 13 Novembre 2019
Par une décision en date du 24 octobre 2019, la CJUE est venue préciser l’interprétation de l’article 3.2 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU) applicable en cas de retard, d’annulation de vol et de refus d’embarquement.
Rompant avec la jurisprudence de la Cour de cassation, la CJUE affirme, notamment au nom de l’objectif de garantir un niveau élevé de protection des passagers, que les passagers d’un vol retardé d’au moins trois heures et «possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce Règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier».
Afin de nous éclairer sur les tenants et les aboutissants de cette décision, Lexbase Hebdo - édition affaires a rencontré Maître Joyce Pitcher, avocate au barreau de Paris, qui est à l’origine du renvoi préjudiciel ayant conduit à cette décision.
Lexbase : Dans quel contexte avez-vous pris la décision de solliciter un renvoi préjudiciel auprès des tribunaux d’instance ?
Joyce Pitcher : L’article 3, paragraphe 2, sous a) du Règlement n° 261/2004 soumet l’application du Règlement aux conditions suivantes :
«Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :
- comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyage ou un agent de voyages autorisé ;
- ou, en l’absence d’indication de l’heure ;
- au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou [...]».
Le Règlement définit la notion de réservation, qui permet de comprendre que le passager doit prouver disposer d’une réservation, mais ne définit pas la notion d’enregistrement, ni n’en détermine la charge de la preuve.
Par une décision en date du 14 février 2018, la Cour de cassation est venue considérer que les passagers devaient prouver s’être présentés à l’enregistrement, sans indiquer les modes de preuve mais en considérant qu’une réservation confirmée et une attestation de retard non nominative étaient insuffisants (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-23.205, F-P+B N° Lexbase : A7573XDT). Cette solution a depuis été réaffirmée, dans les mêmes termes (Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-25.926, F-D N° Lexbase : A7731X44), la Cour de cassation se montrant dernièrement encore plus sévère à l’égard des passagers en retenant que la production d’une copie du billet électronique ainsi que de la carte d’embarquement pour le vol de réacheminement ne suffit pas à établir que les passagers qui réclament une indemnisation pour annulation de vol s’étaient présentés dans les délais impartis à l’enregistrement du vol initialement programmé (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-20.491, FS-P+B+I N° Lexbase : A0007ZRP).
Fort de cette décision, et par une interprétation très extensive, la majorité des compagnies aériennes conditionnait le paiement de l’indemnisation à la remise d’une carte d’embarquement au format papier.
Aucun renvoi préjudiciel n’avait été sollicité devant la Cour de cassation, qui aurait été contrainte de renvoyer la question à la CJUE, en application de l’article 267 b) du TFUE (N° Lexbase : L2581IPB) : «lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour».
Contrairement à la Cour de cassation, les juridictions du fond ont une simple faculté de renvoi.
Nous avions donc soit l’option de former un pourvoi en cassation, puis de solliciter un renvoi préjudiciel, soit de convaincre une juridiction du fond. Nous avons choisi la deuxième option, qui nous permettait d’aller plus vite, bien que nécessitant de parvenir à convaincre les juridictions du fond de renvoyer la question à la CJUE.
Nous avons sollicité un renvoi préjudiciel devant les tribunaux d’instance de Paris, Villejuif, Nice, Villeurbanne, Toulouse, Ivry-sur-seine et Aulnay-sous-bois. Seul le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-bois a accepté de renvoyer la question préjudicielle posée à la CJUE, les autres tribunaux considérant soit que la décision de la Cour de cassation devait être suivie, soit que les compagnies devaient fournir les éléments permettant de démontrer que les passagers n’étaient pas présents à l’embarquement.
Lexbase : Quel a été le raisonnement que vous avez développé devant la CJUE ?
Joyce Pitcher : Notre argumentation devant la CJUE a été présentée en 3 temps.
Premièrement, la notion d’enregistrement n’est pas définie par le Règlement : si au moment de la rédaction du Règlement, en 2004, l’enregistrement se faisait à l’aéroport, les évolutions technologiques ont conduit à la dématérialisation de l’enregistrement. Ainsi, un passager enregistré électroniquement sur un vol ne s’y est pas nécessairement présenté. Nous avons donc considéré que la notion d’enregistrement devait en réalité être assimilée à la notion d’embarquement.
Deuxièmement, la charge de la preuve de l’enregistrement : nous avons considéré que le fait de faire reposer la charge de la preuve sur les passagers était totalement contraire à l’objectif du Règlement de garantir un niveau élevé de protection des passagers et à la position de la CJUE qui invite le juge à tenir un rôle actif en droit de la consommation, afin de «suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel».
Troisièmement, les modes de preuve : en tout état de cause, les modes de preuve dont dispose le passager pour tenter de justifier sa présence à l’embarquement sont très limités, contrairement aux transporteurs qui disposent des listes des passagers ayant embarqué et peuvent donc très facilement vérifier si un passager s’est ou non présenté à l’embarquement du vol.
L’exigence de production d’une carte d’embarquement était dénuée de tout sens puisque la majorité des compagnies incitent à l’enregistrement en ligne, sur leur site internet ou via leur application. Les passagers embarquent avec ce document obtenu plusieurs jours avant le vol et cela ne démontre donc en rien qu’ils étaient présents ou non à l’embarquement. Plus étonnant encore, lorsque l’enregistrement est fait sur les applications, les cartes d’embarquement s’effacent quelques jours après le vol. Cette demande était donc totalement absurde.
Une attestation de retard pouvait permettre de justifier de la présence à l’embarquement, mais sa délivrance et son caractère nominatif ou non, dépendait exclusivement de la bonne volonté des compagnies aérienne.
Dans le cadre de la procédure, les Etats français et portugais, ainsi que la Commission européenne, se sont joints à la procédure et ont produit des mémoires rejoignant notre position.
Lexbase : Quelle a été la stratégie judiciaire mise en œuvre dans l’attente de la décision de la CJUE ? Quelles ont été les réactions des compagnies aériennes et des juridictions ?
Joyce Pitcher : Nous avons obtenu la décision de renvoi préjudiciel le 28 novembre 2018 et la décision de la CJUE est intervenue le 24 octobre 2019. Dans l’intervalle, nous avons dû faire en sorte de défendre au mieux nos clients en répondant au mieux aux réactions des juridictions et des compagnies aériennes.
Dans chaque dossier, nous avons dû solliciter toutes sortes de preuve de la part de nos clients et avons donc soutenu des dossiers en présentant des photos des passagers à l’aéroport, dans l’avion ou à l’arrivée, des tampons dans les passeports justifiant du jour d’arrivée, des attestations sur l’honneur entre passagers, des cartes d’embarquement papier, des relevés de comptes justifiant de dépenses réalisées à l’aéroport, des données de géolocalisations, ou encore des «posts» sur les réseaux sociaux.
Nous avons pu obtenir des indemnisations en produisant certaines de ces pièces, mais le jeu de certaines compagnies était d’exiger comme seule preuve, une carte d’embarquement papier, document très rarement conservé par les passagers.
Les plus récalcitrantes considéraient même qu’un tampon dans le passeport à l’arrivée dans le pays d’accueil, justifiait que le passager était arrivé dans le pays mais pas qu’il y était arrivé avec le vol qu’il avait réservé.
Nous avons également fait des demandes de transmissions des données personnelles des clients sur le fondement du «RGPD» (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), toutes soldées par un échec, les compagnies sollicitant toujours des pièces complémentaires pour transmettre les informations.
Afin de limiter les risques, et dans la majorité des dossiers, nous avons sollicité des sursis à statuer à titre principal dans l’attente de la décision de la CJUE, puis tenté de défendre les dossiers avec les pièces que nous avions pu récupérer à titre subsidiaire.
Cette stratégie a conduit à ralentir très sensiblement l’indemnisation des passagers mais nous a permis de limiter l’impact de la décision de la Cour de cassation sur les résultats obtenus.
Lexbase : Quel est l’apport de cette décision ?
Joyce Pitcher : Cette décision, plutôt très attendue, vient mettre fin au débat, par sa clarté.
Tout d’abord, il est important de relever que la CJUE a décidé de se prononcer par voie d’ordonnance motivée, en application de l’article 99 de son règlement de procédure, qui permet cette possibilité, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable.
La CJUE a appliqué cette disposition à la question posée, reformulée dans les termes suivants: «le Règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit-il être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol peuvent se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce Règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement».
Avant de répondre à la question, la Cour a pris le soin de rappeler le contexte mis en exergue par la juridiction de renvoi et tenant à l’augmentation du contentieux, les compagnies aériennes sollicitant systématiquement la production de cartes d’embarquement au format papier pour s’opposer au paiement de l’indemnisation forfaitaire due en application du Règlement.
Pour répondre à la question posée, la Cour a considéré que, lorsque la compagnie transporte des passagers possédant une carte d’embarquement, il convient d’en conclure que ces derniers se sont présentés à l’embarquement à l’heure indiquée par le transporteur.
La Cour en déduit ainsi que si les passagers disposent d’une réservation et ont réalisé le vol, ces derniers se sont acquittés de l’exigence de se présenter à l’enregistrement.
Le point 30 de l’ordonnance met très clairement fin à la stratégie des compagnies aériennes qui sollicitaient systématiquement la production des cartes d’embarquement pour indemniser les passagers : «dès lors qu’ils atteignent leur destination avec un retard égal ou supérieur à trois heure, lesdits passagers bénéficient du droit à indemnisation au titre de ce retard en vertu du Règlement n° 261/2004, sans devoir fournir, à cette fin, la carte d’embarquement ou un autre document attestant leur présence, dans les délais prescrits, à l’enregistrement du vol retardé».
La CJUE rappelle que cette décision est prise en tenant compte de l’objectif du Règlement visant à assurer un niveau élevé de protection des passagers.
Pour finir, la Cour confirme notre position selon laquelle, le transporteur est en mesure de prouver qu’un passager ne s’est pas présenté à l’embarquement. L’ordonnance va plus loin : le transporteur qui entend contester la présence du passager à l’enregistrement devra prouver que ce passager n’a pas été transporté sur le vol.
Cette décision nous paraît donc juridiquement très cohérente, puisqu’étant fidèle à la lettre et à l’esprit du Règlement, tout en tenant compte du contexte des évolutions technologiques et de l’engorgement des tribunaux.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471176